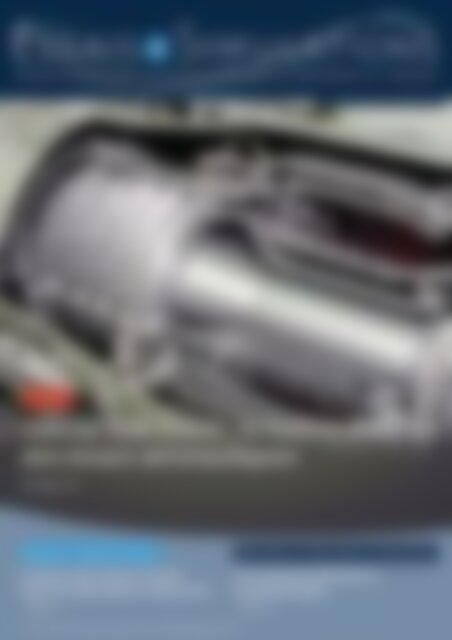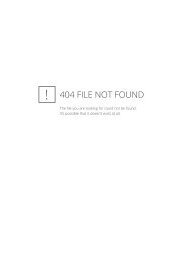Essais & Simulations n°110
Spécial Sud-Ouest : le fleuron français des essais aéronautiques
Spécial Sud-Ouest : le fleuron français des essais aéronautiques
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
www.mesures-et-tests.com<br />
DOSSIER<br />
Spécial Sud-Ouest : le fleuron français<br />
des essais aéronautiques<br />
Page 45<br />
<strong>Essais</strong> et modélisation<br />
La place des essais virtuels<br />
dans les laboratoires industriels<br />
Page 32<br />
Mesures et méthodes de mesures<br />
Les nouveaux défis de la<br />
nanométrologie<br />
Page 16<br />
N° 110 Avril, mai, Juin 2012 Trimestriel 20 €
Aéronautique et sud-ouest :<br />
un exemple à suivre ?<br />
Près de 120 000 emplois industriels et 1 600 établissements, le tout représentant un<br />
tiers des effectifs aéronautiques français et plus de 50% dans le domaine spatial,<br />
8 500 chercheurs répartis dans différents laboratoires publics et dans deux des trois<br />
plus grandes écoles françaises du secteur... Voici en quelques chiffres un aperçu du quart<br />
sud-ouest de la France, ce que d'aucuns aimeraient voir un jour s'intituler « Grand Sud-Ouest »,<br />
à l'image d'une marque de fabrique propre ou d'un label à part entière.<br />
Cette spécificité « aérospatiale » du sud-ouest, ou plutôt devrions-nous parler d'identité, rouvre<br />
la question de la qualité du tissu industriel sur le territoire national et a fortiori celle des<br />
clusters, définition anglo-saxonne de ce que l'on a appelé en France les « pôles de compétitivité<br />
» au moment de leur création tardive. Pour faire simple, dans une région géographique<br />
donnée, un écosystème se crée autour d'une filière et de quelques grands acteurs qui font<br />
appel à des sous-traitants de taille significative, lesquels se fournissent chez de petites PME<br />
très spécialisées et figurant parmi les plus innovantes de leur niche d'activités.<br />
Tout ce terreau fertile est arrosé par des acteurs plus ou moins directs, comme des laboratoires<br />
de recherche publics et privés, des universités et des écoles d'ingénieurs ainsi que des<br />
sociétés de recrutement ou d'intérim sans oublier les centres de formations et, naturellement,<br />
les infrastructures nécessaires au bon rouage d'une mécanique à la fois mature et en perpétuel<br />
développement.<br />
Force est de constater que cette « super-région » (qu'il serait toutefois un peu ambitieux de<br />
comparer à un Länd allemand) possède les ingrédients d'une recette qui a fait ses preuves<br />
et qu'il serait utile de réitérer, à condition toutefois de mettre les bouchées doubles en lançant<br />
de vastes programmes aussi ambitieux que le ferroviaire, le nucléaire ou encore l'aéronautique<br />
qui ont vu le jour sous la V e République. Une nouvelle initiative dans ce sens serait aujourd'hui<br />
la bienvenue ; voici ce que l'on pourrait attendre notamment du ministère du Redressement<br />
productif...<br />
Olivier Guillon<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1
Actualités<br />
Entreprises & Marché<br />
Nomination : Un nouveau directeur marketing<br />
Manufacturing pour Lectra.......................................................4<br />
Qualité : Flexim France certifié Cefri .......................................4<br />
Acquisition :<br />
Ansys acquiert le Français Esterel Technologies....................5<br />
Récompense : Distinction pour le banc d’essai Astraios<br />
pour roulements de grande dimension ...................................5<br />
Décryptage : Les raisons d'un rapprochement majeur<br />
autour de la filière des composites .........................................6<br />
Reportage :<br />
Un siècle d’expérience dans les essais aérodynamiques .....8<br />
Produits & Technologies<br />
Matériaux : Un laboratoire mobile d'expertise<br />
pour des interventions sur sites............................................10<br />
Semi-conducteurs : Nouveau SourceMeter ®<br />
forte tension, pour les tests de forte puissance ..................10<br />
Maintenance : Un banc d’essai pour le contrôle<br />
ultrasonore par ondes guidées au Cetim .............................11<br />
Aéronautique : Démarrage des essais de green taxiing<br />
électrique sur un B.737-800 .................................................12<br />
Visualisation 3D : ESI Group dévoile à Hanovre<br />
sa nouvelle offre de réalité virtuelle......................................12<br />
Acquisition de données :<br />
Nouveau système de mesure dynamique portable .............13<br />
Couplemètre : Kistler lance KiTorq pour tester<br />
les moteurs, les pompes et les transmissions.....................13<br />
Solutions :<br />
Nouvel oscilloscope 4 GHz de Rohde & Schwarz.................14<br />
Application : Labsphere lance la gamme de systèmes<br />
de mesure de la lumière illumia............................................14<br />
Dynamométrie : Stahlwille lance Manoskop 714 ................15<br />
Contrôle :<br />
Une nouvelle référence en Contrôle Process Industriel ......15<br />
Mesures et méthodes de mesures<br />
Tendances marché – Risques liés aux nanoparticules :<br />
les nouveaux défis de la nanométrologie.............................16<br />
Vision :<br />
Les lecteurs Cognex contrôlent les fromages de Labelys ...20<br />
Système : Un nouveau couplemètre rotatif de précision ....21<br />
Solutions : Recourir au scanner électromagnétique<br />
pour la détection de défauts .................................................22<br />
Solutions pour l'étalonnage :<br />
La détermination des contraintes résiduelles<br />
par la méthode du trou ..........................................................24<br />
Outil : Guide pratique des précautions d’inter-câblage<br />
des dispositifs de mesure ......................................................30<br />
Dossier<br />
ESSAIS ET MODÉLISATION<br />
Préface : Le sud-ouest de la France,<br />
une terre riche en moyens d'essais ............................44<br />
Équipements :<br />
Stéréo-corrélation d’images numériques : deux ans<br />
d’utilisations variées sur les essais aéronautiques ...46<br />
Tendances :<br />
Nouveaux challenges en simulation numérique pour<br />
la conception de turbomoteurs moins polluants........49<br />
Simulation électromagnétique :<br />
Exemple de simulation d’un schéma électrique<br />
d’uncâblage d’avion (harnais) .....................................55<br />
Projet Promea-Aquitaine :<br />
La tomographie industrielle ........................................60<br />
<strong>Essais</strong> et modélisation<br />
Tendance marché :<br />
Le virtuel, dernier rempart des essais en environnement ..32<br />
ESI Group élargit les compétences de simulation<br />
des procédés de fonderie ......................................................34<br />
Retour d’expérience :<br />
Un logiciel aide à optimiser la forme des comprimés<br />
pour un complément alimentaire..........................................36<br />
En pratique :<br />
Application de la thermographie infrarouge embarquée<br />
en exploitation d’infrastructures............................................38<br />
Des essais insolites<br />
Voyage au centre de la terre..................................................61<br />
Outils<br />
Formations professionnelles 2012 .......................................62<br />
Agenda.....................................................................................63<br />
Répertoire des annonceurs ...................................................64<br />
ESSAIS & SIMULATIONS est la revue partenaire<br />
exclusive de l’ASTE (Association pour le<br />
développement des sciences et techniques<br />
de l’environnement).<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3
Vega se développe en Inde<br />
Déjà présent sur le marché indien depuis<br />
près de vingt ans, le fabricant allemand d’instruments<br />
de mesure de niveau et de pression<br />
vient de renforcer sa présence locale<br />
par la création d’une filiale commerciale à<br />
Pune, en Inde.<br />
Cette dernière dénommée Vega India Level<br />
and Pressure Measurement mobilise une<br />
équipe d'une quinzaine de personnes dans<br />
les domaines techniques et commerciaux.<br />
Objectif : offrir un service client de proximité,<br />
le tout en liaison directe avec la maison-mère<br />
en Allemagne. Gunter Kech, directeur général<br />
de Vega Grieshaber KG, a déclaré : « l’Inde<br />
offre de fortes perspectives de croissance<br />
du fait d’une grande diversité d'industries<br />
utilisatrices de nos technologies en mesure<br />
de niveau et de pression ».<br />
Gérald Lignon élu président<br />
de l’IRT Jules Verne<br />
Les membres Fondateurs de l’IRT Jules<br />
Verne, réunis en conseil d’administration,<br />
ont élu Gérald Lignon à la fonction de président.<br />
Son mandat sera d’une durée de trois<br />
ans. Gérald Lignon, 54 ans, diplômé de<br />
l'Ensae (Sup’Aero, promotion 1982), est<br />
depuis 2009 senior vice-président chez<br />
Airbus en charge de la direction de l’usine<br />
de Saint-Nazaire dédiée à l’assemblage des<br />
sections avants et centrales des avions de<br />
la gamme Airbus.<br />
Spécialiste des technologies de production<br />
métallique et composite, mais aussi de stratégie<br />
industrielle internationale, il est depuis<br />
longtemps attaché aux questions d’innovation<br />
et de développement économique en<br />
étant l’un des artisans des créations de<br />
EMC2 et de Technocampus EMC2.<br />
Alphanov embarqué<br />
dans 4 projets de R&D<br />
Le centre technologique du pôle de compétitivité<br />
aquitain Route des Lasers, a été sélectionné<br />
pour participer à plusieurs contrats<br />
de R&D.<br />
Ces contrats lui permettront de mettre au<br />
service des industriels ses compétences<br />
scientifiques et technologiques en fibres<br />
optiques, procédés laser, imagerie Terahertz,<br />
conception de sources laser et de composants<br />
et systèmes optiques.<br />
Les quatre projets concernés sont LNP Key<br />
(utilisation de nanoparticules pour le<br />
marquage du bois), TeraVision (caméra Terahertz<br />
tout optique), Perceval (module de soufflante<br />
allégé pour l’aéronautique : diminution<br />
de l’impact environnemental et validation de<br />
la tenue structurale) et Orto (analyseur de<br />
signal – optique et électronique – à très large<br />
bande passante).<br />
Nomination<br />
Un nouveau directeur<br />
marketing Manufacturing<br />
pour Lectra<br />
Lectra, numéro un mondial des solutions<br />
technologiques intégrées pour<br />
les industries utilisatrices de matériaux<br />
souples, a nommé Bertrand<br />
Crönert au poste de directeur marketing<br />
Manufacturing. Il a pour objectif<br />
de renforcer le leadership de Lectra, partenaire<br />
de longue date des industriels de la<br />
mode, de l'automobile, de l'aéronautique<br />
et de l'ameublement, engagés dans l’optimisation<br />
globale de leurs processus de<br />
production.<br />
Ingénieur des Mines et titulaire d’un MBA<br />
de l’Edhec, Bertrand Crönert a débuté sa<br />
carrière en 1987 au sein du groupe SKF.<br />
Il y exerce différentes responsabilités<br />
commerciales et marketing, où il obtient<br />
notamment un contrat majeur auprès de<br />
General Motors US. En 1994, il rejoint<br />
Qualité<br />
Flexim France<br />
certifié Cefri<br />
Afin de répondre aux besoins des clients<br />
grandissant en matière d'utilisation de la<br />
technologie non-intrusive, Flexim (société<br />
spécialisée dans la mesure de débit nonintrusive<br />
par ultrasons) injecte tous les ans<br />
environ 10% de son chiffre d’affaires en<br />
recherche et développement et s’engage<br />
Valeo au poste de directeur marketing<br />
de la division échangeurs thermiques,<br />
puis à celui de directeur de<br />
la ligne de produits condenseurs<br />
(P&L), et assure le lancement de<br />
nouvelles technologies de rupture. Il<br />
est promu ensuite directeur marketing<br />
produit de la branche Climate Control, en<br />
charge de la définition et du déploiement<br />
de la stratégie mondiale produit, du pilotage<br />
des alliances stratégiques et du positionnement<br />
innovant B2B2C des solutions<br />
de confort aux passagers. En 2006, il<br />
rejoint Areva T&D au poste de directeur<br />
marketing monde de la Business Unit Automation.<br />
A partir de 2010, il exerce des<br />
responsabilités analogues au sein d'Alstom<br />
Grid, issues de la vente des activités haute<br />
tension d'Areva T&D ●<br />
dans diverses actions telles que<br />
de nouveaux bureaux d’accueil et<br />
d’écoute avec de nouveaux interlocuteurs<br />
techniques et commerciaux<br />
ainsi qu’un engagement<br />
reconnu par de grandes sociétés<br />
externes.<br />
Après la certification ISO9001<br />
version 2008, Flexim entend aller<br />
plus loin dans son système de<br />
management qualité du personnel<br />
avec sa nouvelle certification du<br />
Comité français de certification des entreprises<br />
pour la formation et le suivi du<br />
personnel travaillant sous rayonnement<br />
ionisant (Cefri). Mais l'entreprise doit pour<br />
cela poursuivre sa démarche de qualité<br />
pour le travail en centrale nucléaire ainsi<br />
qu’en centre de recherche. ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4
Acquisition<br />
Ansys acquiert le Français<br />
Esterel Technologies<br />
Ansys, leader mondial dans l’édition de<br />
solutions de simulation numérique et<br />
Esterel, principal fournisseur mondial d’outils<br />
de simulation pour les applications<br />
critiques embarquées, viennent de signer<br />
le contrat final d’acquisition d’Esterel Technologies<br />
pour un montant au comptant<br />
d’environ 42 M€.<br />
Implantée à Elancourt, dans les Yvelines,<br />
Esterel a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre<br />
de 15 M€ l’an passé avec un effectif de 80<br />
personnes. La société a développé Esterel<br />
Scade, une solution qui permet aux développeurs<br />
et aux ingénieurs systèmes de<br />
concevoir, simuler et produire un logiciel<br />
embarqué. Ce système s'applique au contrôle<br />
des équipements électroniques embarqués<br />
dans des systèmes de l’aviation, du transport<br />
par rail, de l’automobile, de l’énergie et de la<br />
médecine, ainsi que d’autres produits industriels<br />
équipés d’une unité centrale.<br />
Cette acquisition va permettre à Ansys<br />
d’étendre sa vision Simulation Driven<br />
Product Development afin de couvrir à<br />
la fois les aspects matériels et logiciels de<br />
systèmes complets. La solution combinée<br />
permettra à ses utilisateurs de mieux<br />
appréhender le comportement de tout logiciel<br />
embarqué en interaction avec les soussystèmes<br />
électriques, mécaniques et<br />
fluidiques (l’installation physique) ●<br />
Récompense<br />
Distinction pour le banc d’essai<br />
Astraios pour roulements<br />
de grande dimension<br />
Le 24 avril dernier à la Chancellerie<br />
de Bavière, le Chef<br />
de la Chancellerie Thomas<br />
Kreuzer, représentant le<br />
ministre-président Horst<br />
Seehofer, a récompensé<br />
Schaeffler et son banc<br />
d’essai pour roulements de<br />
grande dimension. Chef de projet du banc d’essai,<br />
Reinhold Korn a déclaré que « Schaeffler montre,<br />
avec cet investissement dans le banc d’essai pour<br />
roulements de grande dimension dans son centre<br />
de développement à Schweinfurt, sa contribution<br />
significative à la poursuite du développement des<br />
énergies renouvelables ».<br />
En novembre de l’année dernière, Schaeffler a<br />
officiellement mis en service le banc d’essai pour<br />
roulements de grande dimension le plus<br />
moderne, le plus grand et le<br />
plus performant au monde.<br />
Ce banc d’essai permet de<br />
tester, à l’aide d’un vaste<br />
programme de simulation et<br />
dans des conditions proches<br />
de la réalité, des roulements<br />
pesant jusqu’à quinze<br />
tonnes et d’un diamètre extérieur maximal de<br />
3,5 mètres, tels qu’utilisés dans les éoliennes.<br />
Objectif : contribuer à une conception plus rapide<br />
et plus sûre des éoliennes en augmentant leur<br />
rentabilité et leur fiabilité. Avec un coût de l’ordre<br />
de 7M€, le banc d’essai Schaeffler pour roulements<br />
de grande dimension est un investissement<br />
déterminant pour le développement des<br />
énergies renouvelables et pour le centre de développement<br />
de Schweinfurt ●<br />
Sofradir parraine la promotion<br />
2014 de SupOptique<br />
Le fabricant de détecteurs infrarouge pour<br />
applications militaires, spatiales et industrielles,<br />
parrainera la promotion 2014 de<br />
l’Institut d’Optique Graduate School, SupOptique.<br />
Cette école d’ingénieurs (membre<br />
fondateur de ParisTech) a pour vocation de<br />
former les ingénieurs et les cadres pour l'industrie<br />
optique française. D’une durée de<br />
trois ans (2012-2014), ce parrainage permet<br />
de faire connaître le groupe Sofradir auprès<br />
des étudiants de SupOptique et leur donne<br />
les clés pour mieux appréhender le monde<br />
industriel.<br />
Les étudiants bénéficieront notamment<br />
d’échanges privilégiés avec les cadres dirigeants<br />
de l’entreprise. Ils auront également<br />
l’opportunité de découvrir les spécificités des<br />
métiers exercés chez Sofradir lors de forums<br />
ou de stages tout au long de leur scolarité.<br />
Mettler Toledo Service obtient<br />
l’accréditation Cofrac<br />
Mettler Toledo Service, et ses 130 techniciens<br />
agréés en métrologie légale répartis<br />
sur tout le territoire vient d’obtenir l'accréditation<br />
Cofrac.<br />
L'entité peut donc réaliser depuis le début<br />
du mois de mai les prestations de métrologie<br />
légale en la qualité d’organisme agréé<br />
pour la vérification périodique (VP).<br />
L'équipe est ainsi en mesure de procéder<br />
aux opérations de révision pour la détermination<br />
d'un prix ou pour une application<br />
médicale.<br />
Tecnatom/Metalscan<br />
annonce un vaste plan<br />
d’investissement<br />
Expert mondial de la conception d'appareils<br />
et de la prestation de contrôles non destructifs<br />
(CND) par ultrasons, Tecnatom/ Metalscan,<br />
domicilié à Chalon-sur-Saône, a<br />
annoncé fin mai un vaste plan de développement<br />
avec une augmentation importante<br />
des effectifs, un nouveau bâtiment et d'importantes<br />
acquisitions en matériels.<br />
Dans le cadre de son projet de développement,<br />
la société a sollicité l'accompagnement<br />
de l'Aderc pour l'identification et<br />
l'aménagement d'un terrain sur le Parc d'Activités<br />
Val de Bourgogne (P.A.V.B.) à Saint-<br />
Loup de Varennes, la recherche d'un<br />
partenaire architecte et maître d'œuvre, et<br />
la mise en œuvre de dispositifs d'aides, dont<br />
la prime à l'aménagement du territoire d'une<br />
valeur de 208 000 euros. Ce projet de développement<br />
permettra la création nette de<br />
26 emplois d'ici fin 2015.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5
Décryptage<br />
Les raisons d'un rapprochement<br />
majeur autour de la filière<br />
des composites<br />
Manzour Afzali, responsable R&D spécialisé dans les polymères et les<br />
composites (Cetim) nous explique les objectifs du partenariat entre le Cetim,<br />
l'ENS-Cachan et Centrale Nantes pour le développement des composites<br />
thermoplastiques. L'enjeu principal étant de lever les verrous scientifiques<br />
et technologiques qui freinent aujourd'hui encore le développement de<br />
procédés efficaces et rentables pour la conception et la fabrication des<br />
matériaux composites.<br />
L’école Centrale de Nantes, l’ENS Cachan<br />
et le Cetim s'entendent pour relever le défi<br />
de la mise en œuvre des matériaux composites.<br />
Objectif de cet accord signé entre<br />
les trois partenaires le 27 mars dernier sur<br />
le JEC Composites Show de Paris : initier<br />
une démarche nouvelle, depuis la conception<br />
fiabiliste jusqu’au développement de<br />
procédés. Pour ce faire, les chercheurs<br />
s'appuieront sur l’expérience acquise au<br />
sein de Technocampus EMC2 à Nantes.<br />
Mais ce laboratoire commun reçoit également<br />
le soutien de l’Institut des sciences<br />
de l’ingénierie et des systèmes (Insis),<br />
donnant ainsi un rôle au CNRS dans cet<br />
ambitieux projet.<br />
Certes la collaboration entre les différentes<br />
entités n'est pas nouvelle ; déjà le Centre<br />
technique des industries mécaniques a<br />
pour habitude de faire front commun avec<br />
les écoles d'ingénieurs, les laboratoires<br />
académiques comme les CNRS ou Cachan,<br />
Quatre grands verrous<br />
technologiques à lever<br />
en priorité<br />
Parmi les grands verrous technologiques<br />
à lever, les partenaires du nouveau rapprochement<br />
en matière de composites (Cetim,<br />
ENS Cachan, CNRS et Centrale Nantes)<br />
devront se focaliser sur plusieurs axes de<br />
travail : le développement d’outils de simulation<br />
modulaires et paramétrés d’aide à<br />
la conception, le pilotage et la maîtrise de<br />
scénarios de rupture et des mécanismes<br />
d’absorption de l’énergie, la mise au point<br />
de solutions innovantes de mise en œuvre<br />
des matériaux répondant aux exigences<br />
de la production automobile, et le développement<br />
de l’assemblage multi-matériaux<br />
au travers du couplage de procédés<br />
et de la maîtrise des modèles multiphysiques.<br />
et tout particulièrement avec Centrale avec<br />
qui il s'investit depuis plusieurs années<br />
dans le cadre d'EMC2 en portant sur ses<br />
épaules thèses et autres travaux universitaires.<br />
Mais cette fois, c'est bel et bien<br />
pour former un laboratoire commun que<br />
le Cetim, l'ENS et Centrale Nantes se sont<br />
mis d'accord, et sur une filière bien particulière<br />
– les composites thermoplastiques<br />
– en raison de son fort potentiel de croissance<br />
(et de la concurrence mondiale de<br />
plus en plus pressante) mais également à<br />
cause de la complexité de ce domaine en<br />
termes de procédés de fabrication.<br />
Signature de l'accord entre les partenaires sur le salon JEC Composites,<br />
le 27 mars 2012. De gauche à droite : Christophe Clergeau, 1er vice-président<br />
de la région Pays de la Loire, Patrick Chedmail, directeur de l'école Centrale Nantes,<br />
Marie-Christine Lafarie-Frenot, directrice adjointe scientifique au CNRS/Insis,<br />
Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim et Jean-Yves Mérindol,<br />
président de l'École normale supérieure de Cachan.<br />
Lever des verrous<br />
scientifiques déterminants<br />
L'enjeu est crucial. En effet, l’intégration<br />
des composites dans les pièces semistructurelles<br />
et structurelles automobiles<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 6
est déjà à l’étude chez de nombreux acteurs<br />
internationaux, notamment en Allemagne<br />
et au Japon et – sans réelle<br />
surprise – beaucoup moins en France où<br />
pour le moment le sujet est traité de<br />
manière parcellaire. Le temps est pourtant<br />
compté car les voitures disposant d’une<br />
structure en matériaux composites sont<br />
attendues sur le marché en 2020. Pour<br />
rester dans la compétition mondiale, les<br />
constructeurs français se doivent de<br />
répondre aux défis du composite au plus<br />
tard d'ici trois ans. Pour ce faire, ce rapprochement<br />
entre les différents partenaires<br />
vise à développer des prototypes industriels<br />
hors aéronautique (mécanique,<br />
équipements, automobile...) en tenant<br />
compte des verrous technologiques<br />
encore existants.<br />
Ces obstacles technologiques concernent<br />
par exemple les crash-tests mais aussi la<br />
bonne tenue des produits face à la fatigue.<br />
Manzour Afzali indique notamment que<br />
« pour les transports terrestres tels que<br />
l'automobile, les problématiques concernent<br />
l'absorption d'énergie en cas<br />
d'impact et de choc, ou encore le dimensionnement<br />
des matériaux composites<br />
thermoplastiques fibres longs lors de leur<br />
fabrication, le tout en tenant compte naturellement<br />
des contraintes économiques.<br />
Les axes de recherche porteront donc<br />
essentiellement sur les procédés de<br />
conception et de fabrication de ces matériaux<br />
; objectif : « que la structure tienne ! »<br />
Mais les contraintes économiques sont<br />
nombreuses. Les technologies composites<br />
doivent convaincre avant tout les industriels<br />
au niveau des gains en matière de<br />
consommation d'énergies réalisés grâce<br />
aux réductions de poids des structures ;<br />
c'est le cas notamment dans l'aéronautique<br />
mais aussi le secteur de l'éolien. L'objectif<br />
est donc de rendre ces solutions<br />
aussi compétitives que les matériaux classiques<br />
sur toute la chaîne de valeurs de<br />
la production à la maintenance et le<br />
remplacement ou le recyclage. « Les efforts<br />
sont d'abord à fournir au niveau du choix<br />
des matériaux thermoplastiques. Mais les<br />
verrous les plus importants concernent<br />
la mise en œuvre des procédés et l'assemblage<br />
des matériaux autres que des<br />
composites... car nous n'allons pas du jour<br />
au lendemain tout fabriquer en ''tout<br />
composite'' ». Manzour Afzali mentionne<br />
clairement les solutions dites multiprocédés<br />
ou multi-matériaux, lesquelles il<br />
est impératif de marier et dont les perspectives<br />
de croissance présentent un intérêt<br />
important mais aussi un vrai défi.<br />
La raison d'être de ce rapprochement est<br />
donc de faire collaborer des institutions<br />
clés : l'équipe nantaise du Cetim pour ses<br />
compétences mécaniques, son expertise<br />
et ses infrastructures d'essais, l'ENS<br />
Cachan avec son laboratoire mécanique<br />
et technique (LMT-Cachan), sans oublier<br />
le CNRS et les compétences en recherche<br />
et ses doctorants mis à disposition pour<br />
mener des travaux de thèses pilotées par<br />
un ingénieur du Cetim.<br />
Premier « cobaye » : l'automobile, secteur<br />
dans lequel les applications multiples des<br />
composites thermoplastiques devraient<br />
être les plus significatives et les avancées<br />
les plus importantes. Reste à savoir – et<br />
les résultats des premiers projets nous le<br />
diront – si ce rapprochement aura suffi à<br />
faire émerger un savoir-faire français à part<br />
entière dans le domaine des composites ●<br />
Olivier Guillon<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 7
Reportage<br />
Un siècle d’expérience<br />
dans les essais aérodynamiques<br />
Parmi les grandes dates de l'année 2012 en matière d'essais restera gravé<br />
en mémoire le centenaire de la Soufflerie Eiffel et de son laboratoire d'essais<br />
; celui-ci est d'ailleurs toujours en activité et permet de réaliser des<br />
projets particulièrement variés. Seul point commun entre ces différentes<br />
réalisations : le besoin de connaître avec exactitude l'aérodynamique et le<br />
comportement d'un objet face au vent.<br />
L'entrée est discrète. On y pénètre les lieux<br />
comme on s'introduirait en catimini chez<br />
l'habitant d'une petite rue tranquille du 16 e<br />
arrondissement de Paris. Un interphone,<br />
une simple porte d'entrée et un accueil<br />
chaleureux dans ce qui n'est pourtant pas<br />
une demeure particulière, encore moins<br />
un musée... même si les maquettes de<br />
bois et le parquet grinçant trahissent l'âge<br />
– avancé – d'un laboratoire qui vient de<br />
fêter son centième anniversaire.<br />
C'est en effet en 1912 que Gustave Eiffel<br />
accepta la proposition d'un ami russe d'introduire<br />
son laboratoire rue Boileau sur ce<br />
qui n'était à l'époque qu'un maraicher, afin<br />
de « migrer » ses activités d'essais en aérodynamique<br />
de la Tour Eiffel (dont il perdit<br />
l'usage exclusif)* dans un laboratoire à<br />
part entière. Cette structure accueille donc<br />
depuis cent ans une nouvelle soufflerie<br />
créée lorsque l'ingénieur prit la décision<br />
de quitter sa tour... il faut rappeler qu'il<br />
avait déjà réalisé une première soufflerie<br />
après que les essais aérodynamiques,<br />
jusqu'alors effectués à travers des expériences<br />
sur les chutes. L'idée a donc été<br />
de créer une soufflerie consistant à<br />
déplacer l'outil au lieu de faire chuter<br />
l'objet.<br />
Aussi propriété du CSTB depuis 2000, ce<br />
laboratoire se présente comme un véritable<br />
outil de mesure. Mais le plus surprenant<br />
c'est qu'il fonctionne toujours et fait<br />
travailler quatre personnes parmi<br />
lesquelles un ingénieur d’études, un technicien<br />
de mesure et un maquettiste, sans<br />
oublier bien entendu Benoit Blanchard,<br />
gérant et responsable du laboratoire.<br />
Une soufflerie d’époque<br />
remise au goût du jour<br />
Construite en bois et entoilée selon la technique<br />
des ailes d’avion, la soufflerie Eiffel<br />
est constituée d’un collecteur de quatre<br />
mètres de diamètre à l’entrée et de deux<br />
mètres de diamètre à l’entrée de la<br />
chambre d’expérience. Sa structure se<br />
compose ensuite d'une veine non guidée<br />
de deux mètres de diamètre et de<br />
2,37 mètres de long, d’un diffuseur de<br />
deux mètres de diamètre à la sortie de la<br />
chambre d’expérience et de quatre mètres<br />
de diamètre au ventilateur. Enfin, un ventilateur<br />
de vingt-trois pales de quatre mètres<br />
de diamètre et pesant sept tonnes exerçant<br />
une force de 280 tours par minute.<br />
Les systèmes de mesure utilisés ont pour<br />
leur part largement évolué au fil des ans,<br />
permettant au laboratoire de s’adapter aux<br />
nouvelles demandes de l’industrie. Le laboratoire<br />
dispose ainsi aujourd’hui d’une<br />
large palette d’outils à la pointe de la technologie<br />
à l'exemple de cette balance-avion<br />
installée au-dessus de la veine d’essais ;<br />
celle-ci est utilisée pour mesurer les forces<br />
de trainée et de portance de tangage sur<br />
un objet suspendu. Le laboratoire possède<br />
également une balance-auto six composantes,<br />
montée en tourelle dans l’épaisseur<br />
d’un plancher caréné, pouvant<br />
prendre toutes les orientations dans le lit<br />
du vent. Objectif de cette installation :<br />
mesurer le torseur des efforts dus au vent<br />
sur un objet. Par ailleurs, pas moins de<br />
128 capteurs de pression synchrones sont<br />
chargés d'évaluer les efforts locaux et par<br />
intégration sur des surfaces les efforts<br />
globaux. Enfin, un système d’anémométrie<br />
à film chaud permet quant à lui de<br />
mesurer des champs de vitesse dans des<br />
flux turbulents et de calculer la composante<br />
fluctuante.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 8
Par ailleurs, plusieurs appareils de mesure<br />
de concentration gazeuse utilisés pour<br />
analyser la diffusion des gaz. Parmi eux<br />
figurent différents dispositifs de visualisation<br />
des écoulements (générateur de<br />
fumée, enduit gras pariétal, fil de laine...)<br />
permettant de qualifier et d’optimiser les<br />
études aérauliques, mais aussi un banc à<br />
air mobile de débit 6m 3 /s.<br />
Des compétences<br />
recherchées<br />
et des réalisations aussi<br />
diverses que variées<br />
Fort d'un haut niveau de performance de<br />
ses équipements, le Laboratoire Aérodynamique<br />
Eiffel est en mesure de répondre<br />
à des problématiques à la fois diversifiées<br />
et spécifiques. Il est ainsi reconnu<br />
dans plusieurs domaines d’excellence :<br />
l’architecture et l’urbanisme climatique,<br />
la ventilation naturelle, l’environnement,<br />
l’aérodynamique et l’aéraulique industrielles,<br />
le génie civil et la tenue au vent<br />
des ouvrages et l’automobile.<br />
Les applications sont nombreuses et les<br />
projets concernent des domaines bien<br />
différents les uns des autres, à commencer<br />
par le C33, un bateau de croisière dont le<br />
fabricant exigeait une étude sur la pesée<br />
et la mesure de la structure face au vent<br />
mais aussi pour optimiser le confort, la<br />
porosité des paravents ainsi que pour<br />
réduire la pollution... Il a également été<br />
étudié les effets du vent sur la résistance<br />
d'un radar de contrôle Thompson pour le<br />
compte de Thales Aerospace. Ou encore<br />
dans le domaine des ouvrages et des<br />
infrastructures comme la Tour Montparnasse,<br />
le viaduc de Garabit ou encore ce<br />
projet destiné à étudier la forme du stade<br />
de la Licorne d'Amiens et qui a consisté à<br />
mesurer des prises de pression.<br />
Quelques dates clés de l’histoire du Laboratoire Eiffel...<br />
1912 : Construction de la Soufflerie d’Auteuil, alors appelée « Laboratoire Aérodynamique Eiffel ».<br />
1921 : Don du Laboratoire par Gustave Eiffel au Service Technique de l’Aéronautique.<br />
1923 : Décès de Gustave Eiffel.<br />
1945 : Reprise du Laboratoire par le Groupement des industries françaises aéronautiques et<br />
spatiales (Gifas). Le Laboratoire Eiffel développe alors son expertise et les essais sur<br />
maquette dans les domaines de l’automobile, du bâtiment et de la ventilation.<br />
1983 : Création de la société Aérodynamique Eiffel qui exploite la soufflerie. Le bâtiment reste<br />
propriété du Gifas.<br />
1984 : Le bâtiment abritant la soufflerie est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments<br />
historiques.<br />
1997 : La soufflerie et l’ensemble de ses dispositifs (ventilateur, moteurs, courroie et tableau<br />
de commande) sont classés « Monument Historique ».<br />
2001 : Dans le cadre de sa mission d’accompagnement de l’innovation, le Centre scientifique<br />
et technique du bâtiment rachète les locaux et la société qui devient filiale à 100% du<br />
groupe CSTB.<br />
2005 : Le Laboratoire Aérodynamique Eiffel est la première installation française reconnue par<br />
l’ASME (American Society of Mechanical Engineers) comme lieu historique et scientifique<br />
de l’ingénierie mécanique mondiale.<br />
2012 : Centième anniversaire du Laboratoire Aérodynamique Eiffel.<br />
Le laboratoire aérodynamique participe<br />
également à de nombreux travaux dans<br />
les domaines aéronautique et automobile.<br />
Sur ce dernier secteur, notons que la Soufflerie<br />
Eiffel collabore depuis une vingtaine<br />
d'années avec le groupe PSA. Ce partenariat<br />
a permis de développer des méthodes<br />
et des outils utilisés pour les<br />
voitures concourant aux programmes de<br />
compétitions du constructeur comme les<br />
24 heures du Mans (la 905 et la 908), le<br />
Paris-Dakar (ZX Grand Raid et Baja), les<br />
championnats du monde des Rallyes<br />
(Xsara, C4, DS3, 206, 207, 307) sans<br />
oublier les quelques expériences du groupe<br />
en championnat du monde de Formule 1<br />
(Jordan, Prost et Mac Laren).<br />
Enfin, et les perspectives de développement<br />
s'avèrent plutôt optimistes depuis<br />
le Grenelle de l'environnement, la ventilation<br />
naturelle et mécanique se révèle<br />
comme une activité croissante au sein<br />
du Laboratoire Eiffel. L’optimisation de la<br />
ventilation naturelle pose en effet la<br />
problématique de l’aérodynamique propre<br />
aux dispositifs d’entrée et de sortie. Le<br />
Laboratoire Eiffel a largement participé à<br />
ce type de travail, afin de diminuer la<br />
perte de charge aéraulique de ces<br />
bouches d’entrées et sorties et favoriser<br />
l’action naturelle du vent ●<br />
Olivier Guillon<br />
* Après la finalisation de la Tour Eiffel pour<br />
l'Exposition universelle de 1889 à Paris,<br />
de Gustave Eiffel a pu profiter de son<br />
exploitation durant vingt ans. Il s'est consacré<br />
aux essais aérodynamiques avant de créer<br />
une soufflerie qu'il dut déplacer rue Boileau<br />
afin de rester proche.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 9
Ulis lance un capteur<br />
infrarouge muni du I2C<br />
Le fabricant de détecteurs infrarouge de<br />
haute qualité pour des applications de<br />
thermographie, de surveillance, de transport<br />
et militaires, a mis sur le marché un nouveau<br />
capteur thermique de 17 micromètres.<br />
Celui-ci a pour but de simplifier la conception<br />
des caméras infrarouge en améliorant<br />
la compatibilité avec la production à grande<br />
échelle de caméras visibles.<br />
Ce nouveau capteur thermique est muni du<br />
bus I2C (Inter Integrated Circuit), un circuit<br />
standard utilisé dans la plupart des dispositifs<br />
électroniques actuels.<br />
Le bus I2C rend les capteurs infrarouge<br />
compatibles avec les processus utilisés pour<br />
la production à grande échelle de caméras<br />
visibles.<br />
Alyotech en charge<br />
du projet Nemo<br />
Dans le cadre de son expertise en simulation<br />
et réalité virtuelle, Alyotech est en charge<br />
du développement du projet Nemo, qui vise<br />
la création d’un simulateur temps réel multicapteurs<br />
pour la détection et le suivi des<br />
menaces en mer.<br />
Il s'agit d'un second projet porté par Alyotech<br />
à être labellisé par le pôle de Mer Bretagne<br />
et subventionné par le Fonds unique interministériel<br />
(FUI).<br />
Ce simulateur permettra le dimensionnement<br />
et la qualification de systèmes d’observation<br />
et de surveillance maritimes à partir de<br />
données simulées vues depuis différents<br />
capteurs fixes et mobiles (côtier, embarqué<br />
sur navire, drone, avions et satellites).<br />
Avec ce nouveau projet, Alyotech conforte sa<br />
position européenne dans les outils logiciels<br />
de simulation.<br />
Keyence lance un capteur<br />
de vision avec mise au point<br />
automatique<br />
L'éclairage de la série IV offre une luminosité<br />
améliorée grâce à une distribution<br />
uniforme de la lumière sur la totalité du<br />
champ de vision.<br />
Une fonction de plage dynamique étendue<br />
HDR règle la sensibilité de l'éclairage en fonction<br />
des variations de la lumière réfléchie,<br />
permettant ainsi d'obtenir des images nettes<br />
même de cibles difficiles à détecter.<br />
Enfin, les algorithmes de détection permettent<br />
d'éliminer les variations dans le temps<br />
et les fluctuations de luminosité en ajustant<br />
automatiquement le capteur de vision série<br />
IV en fonction de votre environnement.<br />
Matériaux<br />
Un laboratoire mobile<br />
d'expertise pour des<br />
interventions sur sites<br />
Le Cetim-Cermat de Mulhouse, centre technique<br />
régional dédié aux expertises, mesures et essais<br />
matériaux pour l’industrie, a inauguré le Mobilab,<br />
un laboratoire mobile d’investigation et d’expertise<br />
en matériaux pour le prélèvement et l’analyse<br />
immédiate des échantillons. Ce nouveau service<br />
d’expertise mobile entend faire face aux urgences<br />
et répondre aux besoins pour lesquels le transfert<br />
vers un laboratoire est impossible. Ce laboratoire<br />
mobile dispose de nombreux équipements<br />
d’analyse miniaturisés capable de réaliser des<br />
contrôles par thermographie infrarouge ou par ultrasons<br />
multiéléments, des analyses chimiques par<br />
spectrométrie d’émission optique (SEO) et fluorescence<br />
X, de l’endoscopie, de la dynamométrie,<br />
des mesures vibratoires, etc.<br />
Ces moyens permettent notamment d’intervenir<br />
plus efficacement sur site, lors de défaillances<br />
industrielles et d’effectuer sur le terrain le maximum<br />
d’analyses, de façon à préserver l’intégrité des équipements<br />
ou des produits à expertiser. Objectif :<br />
« répondre aux besoins des industriels qui veulent<br />
avoir le plus rapidement possible des indications<br />
claires et précises sur l’état de dégradation de leurs<br />
moyens de production ou de leurs produits, afin<br />
de minimiser le coût lié à ces défectuosités »,<br />
indique Pascal Gadacz, responsable commercial<br />
du Cetim-Cermat. Plusieurs entreprises telles que<br />
EDF ou Total auraient déjà exprimé leur intérêt pour<br />
ce nouveau service ●<br />
Semi-conducteurs<br />
Nouveau SourceMeter ®<br />
forte tension,pour les tests<br />
de forte puissance<br />
Keithley Instruments vient de<br />
commercialiser un nouveau<br />
SourceMeter forte puissance, le<br />
modèle 2657A. Ce nouveau<br />
modèle s'ajoute aux Source-<br />
Meter 2600A et dote cette série<br />
d’une capacité de source et<br />
mesure en forte tension. Avec<br />
tous les instruments de cette<br />
famille, les utilisateurs peuvent<br />
désormais caractériser une plus grande diversité<br />
de composants semi-conducteurs de puissance<br />
et de matériaux.<br />
Une source de tension de 3000V (180W de puissance<br />
disponible) « permet au modèle 2657A<br />
de fournir cinq fois plus de puissance au composant<br />
en cours de test (DUT) » que des solutions<br />
classiques, indique-t-on au sein<br />
du fabricant.<br />
Le modèle 2657A est utilisé<br />
dans des applications en forte<br />
tension telles que les tests de<br />
composants semi-conducteurs<br />
de puissance, notamment les<br />
diodes, les FET et les IGBT mais<br />
aussi pour caractériser les<br />
nouveaux matériaux tels que le<br />
nitrure de gallium (GaN), le carbure de silicium<br />
(SiC) et autres matériaux semi-conducteurs et<br />
composants. Il trouve aussi son intérêt pour<br />
caractériser des phénomènes transitoires<br />
rapides et dans les tests de claquage et de fuites<br />
sur une grande diversité de composants électroniques<br />
jusqu'à 3000V ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 0
Maintenance<br />
Un banc d’essai pour le contrôle<br />
ultrasonore par ondes guidées au Cetim<br />
Le Cetim propose désormais un nouveau banc d’essai sur son site de Senlis. Utilisant le principe de<br />
la propagation des ondes ultrasonores guidées, il permet notamment le contrôle de la qualité de<br />
tuyauteries de grandes longueurs recouvertes d’un revêtement ou enterrées. Les industriels sont<br />
dores et déjà intéressés pour vérifier la facilité de maintenance de leurs projets avant fabrication.<br />
L’objectif de ce nouveau banc d’essai est<br />
de simuler divers types de canalisation<br />
grâce à la présence de nombreuses<br />
sondes ; le but étant de qualifier la<br />
méthodologie des ondes guidées pour<br />
détecter rapidement les défauts d’une<br />
structure métallique de grande longueur revêtue ou<br />
enterrée. Générée par magnétostriction (propriété<br />
des matériaux ferromagnétiques à se déformer sous<br />
l’effet d’une variation de champ magnétique) ou par<br />
effet piézoélectrique, l’onde se propage entre les<br />
parois de l’épaisseur de la structure à contrôler. Une<br />
partie de l’onde émise se réfléchit sur un défaut ou<br />
sur un élément de géométrie de cette structure<br />
(soudure, bout du pipe, piquage, etc.).<br />
Les échos, dus aux « particularités<br />
géométriques » de la ligne<br />
auscultée, sont identifiés au<br />
préalable. Ils peuvent alors servir<br />
d’étalons d’amplitude et de<br />
distance pour les contrôles ultérieurs.<br />
Lors des opérations de maintenance, l’analyse<br />
des signaux reçus (temps de parcours et<br />
amplitude) permet de repérer des zones suspectes<br />
qui peuvent faire l’objet d’un contrôle complémentaire<br />
plus approfondi. « Ce nouveau banc d’essai va<br />
nous permettre de quantifier l’influence de la géométrie<br />
de la structure, des revêtements anticorrosion,<br />
de la profondeur de l’enfouissement ou de la<br />
traversée de murs, sur la qualité du contrôle<br />
des tubes », explique François Berthelot du Cetim.<br />
L’installation comprend six lignes de tubes modulables<br />
d’environ 40 mètres chacune, avec trois diamètres<br />
(304,8, 254 et 101,6 mm) et quatre épaisseurs<br />
(3,2, 5,2, 7,1 et 12,7 mm). Ces lignes pourront être<br />
modifiées en fonction des situations à tester. L’objectif<br />
est bien entendu de reconstituer au plus près<br />
les conditions rencontrées dans la réalité.<br />
De nombreux industriels (fabricants et exploitants de<br />
conduite de gaz et de pétrole, raffineurs, distributeurs<br />
d’eau, spécialistes des eaux de process industriel),<br />
soucieux de détecter rapidement les défauts sur leurs<br />
tuyauteries et leurs pipelines, se sont déjà montrés<br />
intéressés par cette nouvelle installation. « Avant de<br />
se lancer dans la fabrication de configurations de<br />
tuyauteries particulières et coûteuses, les industriels<br />
souhaitent pouvoir s’assurer que celles-ci sont contrôlables<br />
et peuvent être maintenues aisément, poursuit<br />
François Berthelot. Le banc permet alors d’étudier<br />
la faisabilité du projet. » ●<br />
BANC D’ESSAIS UNIVERSELS<br />
(www.sitia.fr)<br />
Forte de plus de 25 ans d’expérience dans la<br />
conception et la fabrication de bancs d’essais<br />
spécifiques, SITIA propose des solutions<br />
standards pour répondre rapidement aux<br />
besoins des responsables de laboratoire<br />
d’essais, de R&D et R&T.<br />
Déjà équipé d’actionneurs ou bien débutant<br />
dans votre activité d’essais, SITIA vous offre<br />
tous les outils nécessaires pour piloter,<br />
contrôler, mesurer, positionner actionneurs et<br />
produits, afin de répéter avec fiabilité tous<br />
vos essais.<br />
Nos solutions universelles comprennent :<br />
• Un contrôleur numérique avec technologie Ethercat au Cœur (Déclinable de 1 à 16 actionneurs)<br />
• Des Actionneurs instrumentés au choix : pneumatique, électrique ou hydraulique<br />
• Un large choix de montage mécanique consultable sur demande dans notre catalogue mécanique<br />
(Marbre, Table, équerres, interfaces,…)<br />
Pour plus de renseignements, envoyez-nous une simple demande à : contact@sitia.fr<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 1
Des fils inférieurs<br />
à 1 micron<br />
Goodfellow, fournisseur de métaux et matériaux,<br />
propose désormais des fils à partir<br />
de de 0,6 micron.<br />
Plus fin qu’un cheveu, ces fils sont destinés<br />
à des procédés de microfabrication tels que<br />
des circuits intégrés, des microsystèmes<br />
électromécaniques (MEMS), des cellules<br />
solaires et des capteurs thermiques utilisés<br />
dans le domaine biomédical.<br />
Ces produits ouvrent de nouvelles perspectives<br />
pour les ingénieurs et chercheurs<br />
toujours en quête de solutions de plus en<br />
plus miniatures.<br />
Le catalogue en ligne de Goodfellow répertorie<br />
les renseignements nécessaires sur<br />
la gamme de fils élaborés à partir de<br />
125 métaux purs, alliages, céramiques ou<br />
verre. Ces produits sont proposés sous différents<br />
diamètres et conditionnements.<br />
PTC lance la nouvelle version<br />
Creo 2.0<br />
PTC a annoncé lors de son 1er forum qui<br />
s'est déroulé à L'Usine, à St-Denis (93), le<br />
lancement de Creo® 2.0.<br />
Avec la nouvelle version de sa dernière génération<br />
de logiciels de CAO, PTC propose une<br />
nouvelle application basée sur des rôles qui<br />
prend en charge la conception modulaire de<br />
produits, permettant ainsi aux entreprises<br />
de travailler sur des concepts et de réaliser<br />
des gains de productivité significatifs.<br />
PTC a en effet ajouté une nouvelle application<br />
– Creo Options Modeler – destinée aux<br />
concepteurs qui doivent créer ou valider des<br />
variantes de produits en 3D dès les<br />
premières phases du cycle de développement.<br />
Le Romer Absolute Arm<br />
gagne plus de 20%<br />
de précision<br />
Hexagon Metrology a repensé son bras de<br />
mesure portable.<br />
Le Romer Absolute Arm présente un gain de<br />
précision jusqu'à 23 % par rapport aux<br />
versions précédentes.<br />
Avec une répétabilité de point à partir de<br />
0,016 mm, le Romer Absolute Arm est le plus<br />
précis des bras de mesure portables réalisés<br />
par Hexagon Metrology à ce jour. Il est disponible<br />
en sept longueurs, de 1,5 à 4,5 mètres.<br />
Hexagon Metrology a également introduit<br />
SmartLock, un mécanisme de verrouillage<br />
qui bloque en toute sécurité le bras dans<br />
sa position de repos.<br />
En outre, les utilisateurs peuvent verrouiller<br />
le bras dans toute position intermédiaire pour<br />
des mesures dans des espaces exigus. Enfin,<br />
Hexagon Metrology a lancé une nouvelle<br />
version du Romer Absolute Arm pour l'inspection<br />
de tubes.<br />
Aéronautique<br />
Démarrage des essais<br />
de green taxiing électrique<br />
sur un B.737-800<br />
Honeywell et Safran ont effectué à Montpellier<br />
une nouvelle campagne d’essais de leur<br />
système de green taxiing électrique (EGTS) sur<br />
un Boeing 737 Next-Generation de la compagnie<br />
TUIfly. Ces essais marquent un nouveau<br />
jalon dans le développement du système de<br />
green taxiing électrique. Ils permettent d’évaluer<br />
les conditions de piste et de calculer les<br />
efforts nécessaires pour déplacer un 737 Next-<br />
Generation au sol.<br />
Pour une compagnies comme TUIfly qui opère<br />
des avions mono-couloirs à fort taux de rotation,<br />
le système EGTS permettra des gains d’environ<br />
200 000 $ par an et par avion.<br />
Actuellement en cours de développement, le<br />
système de green taxiing électrique utilisera le<br />
générateur électrique de l’APU (Auxiliary Power<br />
Unit) pour alimenter des moteurs au niveau des<br />
roues principales, permettant à l’avion de se<br />
déplacer au sol sans les moteurs principaux.<br />
Chacune des roues motrices sera équipée d’un<br />
actionneur électro-mécanique, tandis que l’électronique<br />
de puissance et l’électronique de<br />
commande donneront au pilote la maîtrise<br />
complète de la vitesse, de l’orientation et du<br />
freinage de l’avion au sol ●<br />
Visualisation 3D<br />
ESI Group dévoile à Hanovre sa<br />
nouvelle offre de réalité virtuelle<br />
ESI Group, spécialisé dans les solutions de prototypage<br />
virtuel pour les industries manufacturières,<br />
a présenté sa nouvelle gamme Virtual Reality<br />
Solutions à l'occasion de la foire d’Hanovre qui<br />
s'est déroulée du 23 au 27 avril dernier. À la suite<br />
de son acquisition l’été dernier d’IC.IDO, leader<br />
en visualisation 3D, ESI était présent au sein de<br />
la « Digital Factory », l'une des expositions les plus<br />
importantes en ce qui concerne les solutions technologiques<br />
pour la production et le développement<br />
de nouveaux produits ; cet espace dédie<br />
en effet plus de 500 m² à la réalité virtuelle et<br />
la visualisation 3D.<br />
Cette gamme de solutions de visualisation 3D<br />
immersive, commercialisée par ESI sous la<br />
marque IC.IDO, permet aux industriels de donner<br />
vie à leurs produits et de prendre des décisions<br />
liées au design produit en conséquence. Les<br />
secteurs concernés par IC.IDO appartiennent à<br />
l'automobile, l'aéronautique et les machines de<br />
production. Vincent Chaillou, directeur général<br />
délégué d’ESI, déclare que « cette technologie<br />
de visualisation en 3D à haute performance<br />
apporte un élément clé dans le processus de<br />
décision de nos clients industriels puisqu’elle<br />
va leur permettre de réunir l’univers du prototypage<br />
physique et celui du prototypage virtuel.<br />
En effet, elle combine une interface utilisateur<br />
immersive et remarquablement intuitive, et une<br />
solution unique de simulation physique en<br />
temps réel. » ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 2
Acquisition de données<br />
Nouveau système<br />
de mesure<br />
dynamique portable<br />
Le Q.brixx est un système de mesure en<br />
aluminium totalement modulaire. Il permet<br />
de composer un système jusqu’à 128 voies<br />
de mesures avec des cartes de conditionnement<br />
de hautes performances (CAD<br />
24 bits et échantillonnage 10 KHz). Les<br />
types d’entrées disponibles vont des<br />
signaux standards (V, mV, mA, TC, IEPE,..)<br />
aux capteurs type pont (¼, ½, pont<br />
complet résistif, inductif, LVDT…) en<br />
passant par des signaux allant jusqu’à<br />
1200V ou nécessitant une isolation importante<br />
(TC avec 1,2 kV d’isolation).<br />
La connectique proposée (bornier à vis,<br />
BNC, DIN, mini TC...) permet une mise en<br />
place du système rapide.<br />
Le concentrateur permet de récupérer<br />
toutes les mesures de manière synchrone<br />
jusqu’à 10 Khz. Connecté à un PC via son<br />
port Ethernet le logiciel Test.Commander<br />
permet une configuration simple et une<br />
mise en place rapide de l’acquisition. Autonome,<br />
des règles d’enregistrement sont définies<br />
(pré-post trigger, événement,..) et les<br />
données stockées sur support clé ou disque<br />
dur via le port USB. Plusieurs Q.brixx peuvent<br />
être synchronisés via différents protocole<br />
(NMEA, IRIG...) pour construire des systèmes<br />
de plusieurs centaines de voies de mesures<br />
synchrones. Le Q.brixx est compatible avec<br />
un grand nombre de logiciels d’acquisition<br />
(Labview, Dewesoft) ●<br />
Couplemètre<br />
Kistler lance KiTorq<br />
pour tester les moteurs,<br />
les pompes et les transmissions<br />
Le nouveau couplemètre type bride<br />
KiTorq de Kistler permet de tester<br />
les moteurs, les pompes et les<br />
transmissions. Ce système consiste<br />
en une unité de mesure (rotor)<br />
Type 4550A et une unité d’évaluation<br />
(stator) Type 4541A.<br />
Comme le rotor a une configuration<br />
standard ISO 7646 pour les<br />
brides de transmission, il est compatible<br />
avec tous les environnements de test habituels<br />
et offre un grand choix de plages de<br />
mesure : 500, 1 000, 2 000 ou 3 000 Nm.<br />
Des rotors de dimensions différentes<br />
peuvent être associés à un même stator<br />
sans anneau de transmission, ce qui<br />
simplifie l’installation. Ils peuvent également<br />
être utilisés pour tester différents<br />
assemblages sans avoir à modifier<br />
complètement l’unité de test.<br />
La conception « stator ouvert »<br />
rend l’installation plus rapide tout<br />
en la protégeant des dommages,<br />
et en facilitant son inspection<br />
visuelle durant la phase de test.<br />
Les signaux de mesure du stator<br />
sont de type fréquences analogiques<br />
et numériques. Toutes les sorties<br />
sont totalement paramétrables via RS-<br />
232C ou USB. Quelle que soit le réglage<br />
initial du rotor, l’utilisateur pourra effectuer<br />
tout type d’essai en adaptant la pleine<br />
échelle de mesure à son besoin. De plus,<br />
il est aussi possible de définir librement<br />
une seconde plage de mesure pour<br />
chaque sortie ●<br />
Nouveau débitmètre<br />
tube de pitot Itabar<br />
Adaptés pour les mesures de process liquide,<br />
air, gaz et vapeur dans les domaines de<br />
l’énergie, de l’environnement, de la pétrochimie,<br />
du traitement des eaux et de l’agroalimentaire,<br />
les tubes de pitot Itabar effectuent<br />
une mesure directe du débit (température<br />
et débit) pour des conduites de DN 20 à DN<br />
12000. Adaptés à des mesures de hautes<br />
pressions (allant jusqu’à 400 bars), les tubes<br />
de pitot Itabar mesurent un débit jusqu’à<br />
5500 m 3 /h pour une température pouvant<br />
atteindre 1 200°C. S’installant en ligne ou<br />
en insertion avec une possibilité de démontage<br />
en charge, le tube de pitot dispose d’un<br />
faible coût d’installation. Il effectue une<br />
mesure de débit bidirectionnel avec de<br />
faibles longueurs droites (10D) et une faible<br />
perte de charge.<br />
EADS et Creaform collaborent<br />
dans le domaine de la mesure<br />
3D optique<br />
EADS et la société canadienne spécialisée<br />
dans la 3D ont annoncé la signature d’un<br />
partenariat technologique dans le secteur<br />
de la mesure 3D optique appliquée aux<br />
domaines de l’aéronautique, du spatial et de<br />
la défense.<br />
Cette entente de collaboration technologique<br />
de cinq ans a pour objectif de développer<br />
des applications innovantes dans le secteur<br />
de la mesure 3D optique pour ce qui<br />
concerne notamment le contrôle non<br />
destructif (CND), le monitoring de tests, la<br />
mesure de forme et de surface appliqués<br />
aux domaines de l’aéronautique, du spatial<br />
et de la défense.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 3
20 nouveaux modèles<br />
en électromagnétisme RF,<br />
plasmonique et conception<br />
d’antennes<br />
Solutions<br />
Nouvel oscilloscope<br />
4 GHz de Rohde<br />
& Schwarz<br />
Comsol met à disposition de ses utilisateurs<br />
une nouvelle série de modèles tutoriaux en<br />
électromagnétisme haute fréquence. Ces<br />
modèles montrent comment utiliser Comsol<br />
Multiphysics et son module RF pour la<br />
conception d’antenne et les technologies en<br />
plasmonique. Cela porte à plus de cinquante<br />
le nombre de modèles tutoriaux pour des<br />
applications aussi variées que les antennes<br />
patch microruban, des lignes de transmission,<br />
des filtres à mode évanescent et des<br />
antennes résonantes diélectriques.<br />
Un transmetteur de pression<br />
à électronique séparée<br />
Rohde & Schwarz continue d’élargir son<br />
portefeuille d’oscilloscopes en ajoutant un<br />
modèle 4 GHz à sa famille R&S RTO à<br />
hautes performances. Doté d’un taux<br />
d’échantillonnage de 20 Géch/s, ce nouvel<br />
oscilloscope hautes performances 4 GHz<br />
de Rohde & Schwarz répond à un large<br />
éventail d’applications : le R&S RTO1044<br />
est destiné à l’analyse des signaux rapides<br />
à fronts raides. Il peut gérer différents types<br />
d’interfaces de données jusqu’à un débit<br />
de 1,6 Gb/s et peut également être utilisé<br />
pour tester des signaux d’horloge rapides<br />
jusqu’à une fréquence de 800 MHz.<br />
Grâce à l’étage d’entrée très faible bruit,<br />
la bande passante de mesure complète<br />
de 4 GHz est toujours disponible, même<br />
pour le plus petit calibre (1 mV/div). Le<br />
convertisseur A/D single-core de 10 GHz<br />
fournit une dynamique améliorée (ENOB<br />
> 7 bits). Le taux d’acquisition et d’analyse<br />
de 1 million de formes d’ondes par<br />
seconde constitue également une de ses<br />
caractéristiques. Le système de déclenchement<br />
numérique permet de localiser<br />
avec précision des impulsions parasites<br />
(glitch) extrêmement brèves (moins de<br />
50 ps) et de déterminer leur origine ●<br />
Le Vegadif 65 à cellule de mesure métallique<br />
piézorésistive, couvre des plages de mesure<br />
de 0,01 à 40 bar avec 0,075 % de précision.<br />
Ses domaines d’application sont la mesure<br />
de pression, niveau, débit, densité et niveau<br />
d’interface liquide-liquide. Il dispose notamment<br />
d’une version étanche IP 68 avec<br />
électronique séparée pour les applications<br />
en environnement humide ou sur des<br />
mesures difficiles d’accès. Cette solution se<br />
distingue aussi par une tenue en température<br />
de -40 à +120°C ainsi qu’une tenue aux<br />
pressions statiques allant jusqu’à 420 bar.<br />
Côté réglage, elle peut être paramétrée directement<br />
sur site avec le module d’affichage<br />
et de réglage Plicscom pouvant être<br />
embroché et rétro-éclairé. Un réglage à<br />
distance est également possible avec PC et<br />
logiciel PACTware, mais aussi avec d’autres<br />
outils tels que PDM, AMS ou pockets de<br />
terrain. Grâce aux sorties signal allant de 4<br />
à 20 mA/HART, le capteur Vegadif 65 peut<br />
être intégré à tout système de contrôle usuel.<br />
Application<br />
Labsphere lance la gamme<br />
de systèmes de mesure<br />
de la lumière illumia ®<br />
Labsphere, Inc. lance la gamme de systèmes<br />
de mesure de la lumière et de LED illumia et<br />
illumia-pro. Les nouveaux systèmes offrent<br />
une grande flexibilité de mesure des<br />
propriétés thermiques, optiques et électriques<br />
des LED et des réseaux, ainsi que des<br />
produits d’éclairage traditionnels et SSL.<br />
Équipés de quatre spectromètres et de<br />
sphères d’intégration de 25 à 195 cm, les<br />
systèmes illumia ® sont facilement personnalisables<br />
en fonction des budgets et des<br />
applications. Grâce aux gammes dynamiques<br />
étendues des spectromètres, une<br />
sphère d’intégration unique peut mesurer<br />
une large ampleur de luminosité.<br />
Les systèmes illumia mesurent le flux spectral<br />
total, le flux lumineux, le flux énergétique,<br />
la chromacité, la TCP et l’IRC, la longueur<br />
d’onde de crête, la longueur d’onde dominante<br />
I et V, et l’efficacité lumineuse. Associé<br />
à un système de contrôle de la température<br />
TEC et de commande, l’illumia pro fournit<br />
également les propriétés thermiques,<br />
optiques et électriques complètes des LED ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 4
Dynamométrie<br />
Stahlwille lance<br />
Manoskop 714<br />
L’expert en dynamométrie a mis sur le marché<br />
une nouvelle clé dotée d’une technologie innovante.<br />
Conçue pour les industriels qui ont besoin<br />
de moyens dynamométriques précis, fiables,<br />
traçables, mais néanmoins simples et robustes,<br />
Manoskop 714 rassemble, dans un produit<br />
compact, la mesure d’angle et de coupe, le<br />
déclenchement (clic), avec une précision de<br />
+/- 2% pour la mesure et de 1° pour la mesure<br />
HBM a annoncé le lancement<br />
de sa nouvelle plateforme de<br />
conditionnement, d’acquisition<br />
et de contrôle pour applications<br />
industrielles, le PMX. Cette<br />
nouvelle gamme se démarque<br />
par la diversité de ses entrées<br />
et son architecture modulaire<br />
véritablement ouverte qui<br />
apportent à l’utilisateur une<br />
souplesse de configuration et une plus<br />
grande précision de mesure. En effet le<br />
module PMX offre de 1 à 16 voies de<br />
mesure : pour étendre le nombre de voies,<br />
il est possible de lier jusqu’à 32 modules<br />
PMX ensemble (soit un total de 512 voies).<br />
Le PMX apporte au monde industriel les techniques<br />
de mesure déjà présentes dans les<br />
laboratoires R&D comme une alimentation<br />
d’angle, soit une ergonomie et une sécurité de<br />
procédé et de travail améliorées.<br />
La principale innovation est l’alliance « angle et<br />
couple » permanente qui garantit que toute vis<br />
soit serrée, et ce une seule fois. En mode de<br />
fonctionnement à déclenchement comme en<br />
mode à lecture de couple – en option avec affichage<br />
de la valeur de crête – il est possible de<br />
sélectionner, pour chaque cas de vissage, un<br />
mode de serrage combinant mesure du couple<br />
et/ou mesure de l’angle de rotation. Pour<br />
chaque mode de fonctionnement, l’utilisateur<br />
a le choix entre quatre modes de mesure (coupe,<br />
angle de rotation, couple-angle de rotation, angle<br />
de rotation-couple). Autre innovation, la première<br />
clé de la gamme couvre une plage de 1 à 10 Nm<br />
et la gamme complète comptera onze modèles<br />
pour une plage de 1 à 1000 Nm. La clé est<br />
disponible pour les capacités de serrage de 1Nm<br />
à 400 Nm. Elle sera disponible en sept tailles<br />
à partir de septembre prochain ●<br />
Contrôle<br />
Une nouvelle référence en<br />
Contrôle Process Industriel<br />
contrôlée, des amplificateurs<br />
faible bruit, la fréquence porteuse<br />
(insensibilité aux parasites)<br />
ou encore la conversion<br />
A/N rapide 24bits.<br />
Son architecture « multi noyau »<br />
garantit une évaluation temps<br />
réel ainsi que la compatibilité<br />
avec tous types de bus de<br />
terrain (Profinet, Ethernet IP,<br />
Profibus, CAN…) et avec l’Ethercat (10KHz).<br />
Il s’intègre ainsi dans toutes les architectures<br />
d’automatismes même les plus anciennes<br />
de type analogique. De plus, la multitude des<br />
drivers et API assure la compatibilité avec<br />
toutes les applications d’informatique industrielles<br />
tout en garantissant un accès total et<br />
instantané à toutes les données, mesures<br />
ou paramètres ●<br />
5 millions de pixels capturés<br />
15 fois par seconde<br />
Matrix 450, le nouvel Imageur Datalogic Automation<br />
intercepte quinze images de grande<br />
qualité en une seule seconde et offre des<br />
performances de lecture permettant une<br />
large gamme d’applications logistiques,<br />
importantes pour un imageur 2D.<br />
Grâce à son taux d’acquisition extraordinaire<br />
à haute résolution, Matrix 450 est destiné<br />
au transport à grande vitesse sur les<br />
convoyeurs de petites et moyennes tailles.<br />
Avec le Matrix 450, les tentatives de lectures<br />
multiples ne sont plus nécessaires ; grâce<br />
à sa couverture large zone en un seul flash,<br />
au plus haut taux de rendement en lecture<br />
et à une facilité d’utilisation.<br />
Superviser des compteurs<br />
sans contraintes filaires<br />
Enerdis, filiale du groupe Chauvin Arnoux et<br />
experte en gestion et supervision des énergies,<br />
vient de lancer sur le marché un<br />
nouveau logiciel de gestion et supervision<br />
énergétiques multi-fluides E.online 2.<br />
Cette solution logicielle communique et<br />
relève à distance toutes les énergies (eau,<br />
gaz, électricité, chaud/froid et paramètres<br />
climatiques), les températures ou les signaux<br />
4–20 mA de tous types de compteurs et<br />
capteurs.<br />
Une solution radio fréquence qui présente<br />
l’avantage d’éviter d’avoir à tirer des câbles<br />
pour récupérer les informations provenant<br />
des compteurs.<br />
Cette technologie sans fil est adaptée aux<br />
traitements automatiques. Elle apporte un<br />
haut niveau de sécurité et de performance<br />
dans le transfert des données, pour des<br />
distances allant de quelques centaines de<br />
mètres à plus d’un kilomètre.<br />
De plus, par le simple ajout de modules radio<br />
fréquence, l’exploitant peut facilement<br />
augmenter ses points de comptage.<br />
Enfin, E.online 2 permet l’exploitation de<br />
compteurs isolés, comme des compteurs<br />
d’eau en extérieur par exemple, parfois difficilement<br />
accessibles.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 5
Tendances marché<br />
Risques liés aux nanoparticules :<br />
les nouveaux défis<br />
de la nanométrologie<br />
Alors que l’Académie des Technologies vient de faire paraître un ouvrage<br />
répertoriant les différents risques pour l’homme et l’environnement liés aux<br />
nanoparticules des produits manufacturés, Georges Labroye, président du<br />
groupe de travail chargé de cette étude, nous explique comment la métrologie<br />
se révèle aujourd’hui comme une discipline indispensable pour limiter<br />
et anticiper les dangers que peuvent présenter les nanoproduits.<br />
« Un progrès raisonné, choisi et partagé ».<br />
La formule semble tout droit sortie d’une<br />
publicité télévisée pour de l’auto-partage<br />
en ville, les solutions d’un opérateur mobile<br />
ou pour redorer l’image d’un acteur du<br />
nucléaire. Il n’en est rien. Cette accroche<br />
a été lancée par un établissement de référence<br />
dans le domaine de la recherche<br />
pour traduire ses activités, sa ligne de<br />
conduite mais aussi le rôle que sa notoriété<br />
publique lui confère, ou plutôt lui<br />
impose. L’Académie des Technologies,<br />
puisque c’est de cette institution (créée<br />
en 2000 et rattachée depuis six ans au<br />
ministère de la Recherche et de l’enseignement<br />
supérieur) qu’il s’agit, entend bien<br />
se positionner comme un acteur majeur<br />
de la recherche mais également comme<br />
un organisme chargé de prévenir et de<br />
mettre en garde sur ce qui semble aujourd’hui<br />
balbutier faute de connaissances<br />
profondes sur les risques et de référentiel<br />
reconnu au niveau international.<br />
C’est le cas en particulier des nanotechnologies<br />
et des nanoproduits. Plus précisément,<br />
et c’est bien là l’objet d’un ouvrage<br />
présenté fin mai et intitulé Les risques liés<br />
aux nanoparticules manufacturées, les<br />
nanomatériaux ont fait l’objet ces dix<br />
dernières années d’un grand nombre de<br />
travaux menant à des applications diverses<br />
d’une part, et au développement de<br />
nouveaux nanomatériaux d’autre part. Ces<br />
derniers présentent, comme toute nouvelle<br />
création de matière et de matériau, des<br />
points obscures que ni la recherche fondamentale,<br />
ni la recherche industrielle et<br />
appliquée n’a été en mesure ou n’a eu le<br />
temps de décrypter, caractériser, analyser<br />
et modifier. Des risques surviennent alors<br />
de façon inhérente, à la fois sur la santé<br />
humaine, et sur l’environnement.<br />
La nanométrologie :<br />
un axe déterminant<br />
dans l’analyse des risques<br />
Or, comme le précisent les auteurs de l’ouvrage<br />
(lesquels appartiennent à un groupe<br />
de travail créé au sein de l’Académie des<br />
Technologies*), l’idée est de poser le<br />
problème et de faire un point sur les<br />
risques toxiques pour l’homme et l’environnement<br />
puis de proposer des éléments<br />
* Présidé par Georges Labroye, le groupe<br />
de travail chargé de rédiger cette publication<br />
sur les risques liés aux nanoparticules<br />
manufacturées a été créée par<br />
la commission Environnement de l’Académie<br />
des Technologies présidée par Thierry<br />
Chambole avec le concours de Josy<br />
Mazodier, secrétaire scientifique de<br />
la commission.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 6
de réponses. L’autre idée force est de<br />
convaincre les acteurs industriels et de<br />
la recherche de n’autoriser aucune production<br />
de nanomatériaux sans évaluation des<br />
risques au préalable et sans être pleinement<br />
sûrs qu’elle ne comporte aucun<br />
danger. « Cet ouvrage a été présenté après<br />
que le ministère a fourni une réponse au<br />
débat particulièrement sujet à polémiques<br />
qui se posait déjà depuis longtemps sur<br />
les nanotechnologies. Une réponse allant<br />
dans le sens des mesures à adopter contre<br />
les risques a été en effet donnée le 13<br />
février dernier, rappelle Georges Labroye,<br />
président du groupe de travail. Car l’un des<br />
enjeux de la recherche réside bien dans<br />
la toxicologie mais aussi la métrologie. Il<br />
s’agit d’un axe déterminant de la recherche<br />
publique car pour connaître l’existence<br />
de tous les dangers, il convient d’étudier<br />
le degré d’exposition afin de bien déterminer<br />
les risques. Or l’exposition ne<br />
s’étudie sérieusement que grâce à la<br />
mesure et à la métrologie ».<br />
La nanométrologie devrait désormais<br />
prendre une place nettement plus importante<br />
mais la tâche n’est pas simple du<br />
fait de la nécessité de mesurer une masse<br />
sphérique, pouvant s’amalgamer avec<br />
d’autres éléments ; d’où la question de<br />
départ qui consiste à savoir s’il vaut mieux<br />
mesurer une particule ou un agglomérat.<br />
« On peut donc résumer la nanométrologie<br />
à la fois comme indispensable pour<br />
évaluer les risques et complexe. Mais seule<br />
celle-ci ne peut sainement ouvrir les portes<br />
d’une commercialisation de biens et<br />
d’équipements », ajoute Georges Labroye.<br />
Une confiance<br />
qui ne peut s’appuyer<br />
que sur la métrologie<br />
Autre impératif : celui de mettre en place<br />
un référentiel international, un système<br />
commun auquel les acteurs de la<br />
recherche mondiale et l’industrie pourraient<br />
se raccorder. « Il existe énormément<br />
de collaborations menées au niveau européen,<br />
à l’exemple des travaux réalisés sur<br />
les nanomatériaux dans les aérosols. On<br />
peut dire que l’Europe a ‘’mis le paquet’’,<br />
ce qui a permis aux chercheurs du Vieux<br />
Continent d’échanger et de travailler<br />
ensemble. Il en est de même à travers des<br />
programmes de recherche français, à<br />
l’exemple du projet Nano-Innov qui, lancé<br />
en 2009 par l’ancienne ministre Valérie<br />
Pécresse, consacre près de 70M€ à la<br />
recherche publique et privée dans le<br />
domaine ».<br />
“<br />
Pour les nano-objets,<br />
la définition même<br />
de grandeur mesurée<br />
constitue un enjeu majeur.<br />
Pour parvenir à une meilleure caractérisation<br />
possible des nanomatériaux, la<br />
métrologie apparaît comme « Le » moyen<br />
d’établir une confiance avec les résultats<br />
obtenus en raison du caractère inébranlable<br />
de méthodes à la fois uniformes,<br />
pérennes et reconnues auprès de tous.<br />
Sur ce point, le groupe de travail se montre<br />
intransigeant : « Le domaine des nanosciences<br />
et des nanotechnologies cherche<br />
à explorer, comprendre et exploiter la<br />
complexité des matériaux et des systèmes<br />
à l’échelle nanométrique. À la mesure<br />
correspond toujours une réduction de la<br />
complexité : on ne caractérise, détermine<br />
et met en mémoire que les grandeurs définies,<br />
choisies ou construites dans le cadre<br />
d’un modèle de représentation des matériaux<br />
et des systèmes étudiés. Plus encore<br />
que pour tout autre domaine, cette particularité<br />
joue un rôle décisif pour les nanoobjets<br />
pour lesquels la définition même de<br />
grandeur mesurée constitue un enjeu<br />
majeur. »<br />
Mais malgré l’existence de normes internationales<br />
dans le domaine des grandeurs<br />
de référence – à commencer par le<br />
système métrique – malgré la progressive<br />
harmonisation européenne en matière de<br />
métrologie, malgré la création<br />
de structures aux<br />
niveaux nationaux chargés<br />
de conduire et de coordonner<br />
les opérations de<br />
recherche en suivant les<br />
”<br />
valeurs communes d’étalonnage,<br />
elles-mêmes assurées<br />
par des acteurs à la<br />
fois public et privés d’essais<br />
et d’étalonnage (accrédités par des<br />
comités nationaux – comme le Cofrac en<br />
France par exemple), quasiment aucun de<br />
ces systèmes n’ont travaillé sur les nanoobjets<br />
(à l’exception de la chimie).<br />
La caractérisation<br />
de l’exposition :<br />
« un élément crucial »<br />
Risques liés aux nanoparticules manufacturées<br />
Académie des Technologies<br />
Éditions Le Manuscrit<br />
Paris, mars 2012 – 162 pages<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Christian Bordé, Pierre-Étienne Bost, Sébastien<br />
Candel, Jean-Pierre Causse, Robert Corriu,<br />
Michel Courtois, Jean Kovalevsky, Jacques<br />
Lenfant, Francis Lévi, Bernard Maitenaz,<br />
Michel Pouchard, Érich Spitz, Pierre<br />
Tournois et Claude Weisbuch (animateur)<br />
Secrétaire scientifique : François Ozanam<br />
En matière de risques pour les personnes,<br />
l’exposition aux nanoparticules présente<br />
des difficultés majeures et un verrou scientifique<br />
à part entière dans le domaine de<br />
la métrologie. Savoir où, quand et combien<br />
de temps un individu a été exposé à ce<br />
type de matériaux, puis mettre en place<br />
à cet effet une gestion des risques,<br />
prévenir et diffuser des bonnes pratiques<br />
se révèlent être un défi pour la nanométrologie.<br />
C’est le cas notamment en qui<br />
concerne les aérosols de nanoparticules<br />
(encore appelés nanoaérosols), « la question<br />
de la mesure ne se limite pas à la<br />
disponibilité d’instruments (…). Elle intègre<br />
également celles des critères de mesures,<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 8
de la stratégie et de la manière d’interpréter<br />
ces résultats ». Il convient alors de<br />
définir les critères de mesure à adopter,<br />
comme il est essentiel de définir quelles<br />
techniques et quelles méthodes il est<br />
nécessaire de pratiquer pour mesurer les<br />
particules des aérosols.<br />
Si aucun équipement de mesure parfaitement<br />
adapté à ce type d’opération ne<br />
semble exister pour le moment, l’équipe de<br />
Georges Labroye prend la liberté d’énoncer<br />
les critères de ce qui pourrait être « l’instrument<br />
idéal ». Celui-ci doit être capable de<br />
« fonctionner en temps réel et de donner<br />
des résultats sur de multiples paramètres<br />
– concentration (en nombre, en surface et<br />
en masse), granulométrie et charge des<br />
particules ». Cet instrument devrait également<br />
être petit et portatif de manière à<br />
pouvoir effectuer des mesures au plus près<br />
des voies respiratoires de l’individu. Enfin,<br />
il doit être qualifié pour intervenir en milieu<br />
industriel (en particulier dans les zones à<br />
risques) et, bien entendu, relativement peu<br />
coûteux de façon à être utilisé par le plus<br />
grand nombre d’entreprises. En Europe,<br />
le programme de recherche NanoDevice<br />
devrait pallier cette absence d’équipement.<br />
Par ailleurs, outre les instruments nécessaires<br />
pour réaliser les opérations cruciales<br />
à la caractérisation d’exposition, la<br />
recherche doit adopter une stratégie de<br />
mesure. Parmi les recommandations de<br />
l’Académie des Technologies, la stratégie<br />
retenue doit reposer sur la caractérisation<br />
de différents paramètres complémentaires.<br />
Il faut dire que l’absence de stratégie<br />
unique a mené à des travaux de<br />
recherche éparpillés aux quatre coins du<br />
monde, sur des thématiques à la fois différentes<br />
et parfois très transversales.<br />
Toutefois, au niveau français, le projet<br />
NanoInnov – qui réunit différents acteurs<br />
clés comme l’Ineris, l’INRS ou encore le<br />
CEA – a pour objet de relancer cette idée<br />
de stratégie commune ●<br />
Olivier Guillon<br />
Les « 11 commandements »<br />
de la recherche dans les nanoparticules<br />
Les nanotechnologies et les nanoproduits sont de plus en plus courants et présents dans de nombreux domaines comme le médical, l’agroalimentaire,<br />
l’électronique, l’optique. Toutefois, ceux-ci restent encore mal connus et leurs propriétés ont besoin d’être affinées, optimisées et utilisées en<br />
admettant un minimum de risques. Cette valorisation est le fer de lance du groupe de travail lancé au sein de l’Académie des Technologies et spécialement<br />
dédié aux risques liées aux nanoparticules. Dans un ouvrage récemment publié aux éditions Le Manuscrit, ce groupe de travail a émis onze<br />
recommandations destinées à améliorer la sécurité dans la fabrication et l’utilisation de ces nouveaux matériaux.<br />
Recommandation 1 : Bien évaluer la balance bénéfices / risques<br />
Intégrer l’évaluation des risques dès le début de l’étude de conception<br />
du produit, dans le cadre d’une approche « Safe by Design ».<br />
Recommandation 2 : Évaluer les risques a priori<br />
Développer l’évaluation des risques a priori avant toute mise sur le marché<br />
de nouveaux produits contenant des nanomatériaux susceptibles de<br />
diffuser des nanoparticules.<br />
Recommandation 3 : Connaître et caractériser les dangers des<br />
nanoparticules et des nanomatériaux<br />
- Renforcer les compétences françaises en métrologie, en toxicologie, en<br />
écotoxicologie, en épidémiologie et en connaissance des risques accidentels.<br />
- Exiger que toutes les études se fassent dans des conditions de qualité<br />
non critiquables et reconnues au niveau international.<br />
Recommandation 4 : Connaître et caractériser les expositions<br />
Améliorer la connaissance sur les scénarios d’exposition, les expositions<br />
réelles aux nanoparticules pouvant présenter un risque aussi bien dans l’environnement<br />
qu’au poste de travail ou sur les lieux de vie (air intérieur –<br />
risques consommateurs) et renforcer les recherches sur les bio-indicateurs.<br />
Recommandation 5 : Améliorer la prévention en milieu de travail<br />
Porter une attention particulière aux PME utilisatrices qui ne possèdent<br />
pas toujours l’infrastructure de protection, sans oublier le monde de<br />
la recherche.<br />
Recommandation 6 : Améliorer la traçabilité au profit des consommateurs<br />
Prévoir un marquage et/ou un étiquetage des nanomatériaux contenant<br />
des nanoparticules susceptibles de diffuser au cours de leur cycle de vie.<br />
Recommandation 7 : Maîtriser les risques tout au long du cycle<br />
de vie<br />
Depuis leur création en laboratoire jusqu’à leur fin de vie, maîtriser et<br />
contrôler les rejets de particules dans l’environnement tant qu’on n’aura<br />
pas démontré leur innocuité.<br />
Recommandation 8 : Prévoir un volet risques dans tous les projets<br />
financés par les pouvoirs publics et les collectivités territoriales<br />
Consacrer de 5 a 10 % de chaque budget de recherche sur les nanoparticules<br />
manufacturées à l’étude des risques et aux moyens de les<br />
prévenir.<br />
Recommandation 9 : Renforcer les coopérations scientifiques<br />
Mieux utiliser les outils de l’ANR et du PCRDT pour y parvenir, pérenniser<br />
les coopérations et renforcer la recherche avec les grandes entreprises<br />
du secteur (Instituts Carnot).<br />
Recommandation 10 : Normaliser et réglementer<br />
Accélérer la prise en compte des nanomatériaux dans les instances de<br />
normalisation (ISO-OCDE-Afnor) et les règlements européens (plus particulièrement<br />
Reach) ou les recommandations internationales (OCDE,<br />
SGH de l’ONU, travaux du Niosh et de l’EPA américains).<br />
Recommandation 11 : Organiser la concertation, consulter,<br />
respecter<br />
- Associer dès le départ les parties prenantes afin de favoriser des formes<br />
nouvelles et évolutives de concertation.<br />
- Former et informer le public sur les nouveaux produits, leurs avantages,<br />
leurs inconvénients, les précautions d’usage ; organiser des<br />
débats publics.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 1 9
Vision<br />
Les lecteurs Cognex contrôlent<br />
les fromages de Labelys<br />
Spécialisée dans la fabrication d’étiquettes en caséine destinées au<br />
marquage des fromages, la société Labelys a également développé une<br />
solution globale d’identification et de traçabilité de ces fromages. Développée<br />
en partenariat avec Cognex, cette solution s’appuie sur les systèmes<br />
d’identification DataMan. Elle est aujourd’hui opérationnelle dans les caves<br />
de production d’un grand fabricant de fromage italien...<br />
Le premier métier de la société<br />
Labelys, fondée en 2004 et basée<br />
à Bellignat dans l’Ain, est la fabrication<br />
d’étiquettes en caséine (une<br />
protéine de lait biocompatible avec<br />
les fromages) et l’impression sur<br />
ces étiquettes de dessins, logos,<br />
caractères alphanumériques ou<br />
toute autre information souhaitée<br />
par les fromagers. Ce mode de<br />
marquage naturel est indélébile,<br />
inamovible et infalsifiable. Il représente le<br />
« passeport » du fromage et permet ainsi<br />
aux fabricants de protéger leurs fromages<br />
et leur savoir-faire et d’éviter la contrefaçon,<br />
tout en garantissant une traçabilité<br />
du produit sans faille.<br />
Outre des données de production telles<br />
qu’un code sanitaire et un code de traçabilité<br />
que le fabricant s’octroie lui-même,<br />
ces étiquettes peuvent également<br />
comporter le nom d’une « AOC ». Cette<br />
fameuse « appellation d’origine contrôlée »,<br />
véritable garantie d’authenticité et symbole<br />
de qualité pour les consommateurs est<br />
soumise au strict respect du cahier des<br />
charges de l’AOC par le producteur.<br />
Une lecture et un contrôle<br />
garantis fiables à 100%<br />
L’arrivée des codes Datamatrix avec leur<br />
capacité de stockage d’un nombre considérable<br />
d’informations sur un faible<br />
espace, a poussé Labelys à ajouter à son<br />
offre des systèmes de lecture adaptés à<br />
ce type de marquage. Après avoir testé<br />
différents produits, la société a retenu les<br />
lecteurs DataMan de Cognex, reconnus<br />
« les meilleurs dans leur catégorie » par<br />
Jean-Paul Maître, président de Labelys. Mr<br />
Maître précise : « La qualité des<br />
lecteurs Cognex, leur adéquation<br />
à la problématique de lecture des<br />
étiquettes en caséine et leurs<br />
performances ont fait la différence.<br />
Grâce à leurs algorithmes<br />
puissants qui permettent de<br />
reconstituer des codes, même<br />
dégradés, les lecteurs DataMan<br />
se sont révélés les seuls capables<br />
de garantir une identification<br />
fiable et un taux de relecture des étiquettes<br />
avoisinant les 100% ».<br />
En effet, lors de son affinage, le fromage<br />
évolue et la lecture de son étiquette peu<br />
devenir plus délicate. Il fallait donc un<br />
lecteur capable de s’affranchir des défauts<br />
potentiellement rencontrés : dégradation<br />
dimensionnelle, étiquette mal positionnée,<br />
code en partie endommagé pendant les<br />
opérations de soin du fromage… Les<br />
lecteurs de Cognex permettent de lisser<br />
les différentes qualités d’étiquettes, de<br />
reconstituer un marquage complet à partir<br />
des informations saisies et d’assurer ainsi<br />
une identification sûre à 100%.<br />
Une solution globale<br />
d’identification<br />
et de traçabilité<br />
Dans l’industrie agroalimentaire, la traçabilité<br />
est aujourd’hui devenue impossible<br />
à éviter. Sur la base de la solution d’identification<br />
Cognex, premier maillon de la<br />
chaîne de traçabilité, Labelys a donc<br />
décidé d’aller plus loin et a développé avec<br />
l’aide d’un partenaire une solution<br />
complète de traçabilité, capable non seulement<br />
de lire ces étiquettes et de vérifier<br />
les informations qu’elle comporte, mais<br />
également de les stocker dans une base<br />
de données centralisée afin d’être utilisées<br />
par un système de gestion de la<br />
production, installé chez le fromager.<br />
La solution proposée aujourd’hui par<br />
Labelys couvre donc la fabrication des<br />
marques en caséine, le système de dépose<br />
automatisé des marques, la fourniture des<br />
lecteurs fixes ou mobiles DataMan de<br />
Cognex, la relecture automatique des<br />
étiquettes et les outils d’analyse et de<br />
gestion informatisées, assurant notamment<br />
l’ensemble des contrôles.<br />
Cette solution économique et efficace,<br />
adaptée aussi bien à la gestion de petites<br />
fromageries qu’à celle de sites industriels,<br />
permet de piloter en temps réel la production<br />
des ateliers, de déterminer l’état des<br />
stocks et d’obtenir un inventaire instantané,<br />
de « géolocaliser » chacun des fromages<br />
stockés dans les caves, de suivre<br />
les opérations de brossage et de retournement<br />
des meules, d’enregistrer les<br />
événements et de gérer les outils de<br />
production.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 0
Une solution opérationnelle<br />
et de nombreux projets<br />
à venir<br />
Aujourd’hui, la solution Labelys-Cognex a<br />
été adoptée par les plus grands consortiums<br />
et syndicats de fromages d’AOC et<br />
d’AOP. Ainsi, le consortium « del Formaggio<br />
Parmigiano-Reggiano » qui gère l’AOP du<br />
fromage Parmigiano-Reggiano en Italie, a<br />
choisi Labelys comme partenaire attitré.<br />
La solution va être prochainement déployée<br />
sur plusieurs centaines de fromageries<br />
de l’appellation.<br />
Cette solution intéresse de nombreux<br />
autres fabricants du monde entier, qui<br />
pourront compter sur la présence internationale<br />
de Cognex et la garantie de<br />
pouvoir disposer d’un support 24 heures<br />
sur 24, où qu’ils se trouvent ●<br />
DataMan300-autofocus<br />
Une mise au point<br />
désormais automatique<br />
pour le Dataman 300<br />
Cognex Corporation, leader mondial de l’identification industrielle, ajoute un objectif liquide aux<br />
lecteurs de codes-barres fixes DataMan 300. Ce nouvel accessoire permet à n’importe quel lecteur<br />
DataMan 300 déjà équipé d’un objectif fixe de disposer d’une fonctionnalité de mise au point<br />
automatique. La technologie de mise au point automatique à focale variable avec objectif liquide<br />
est destinée à des applications qui exigent une grande profondeur de champ ou lorsqu’une nouvelle<br />
mise au point est nécessaire après un changement de produit.<br />
La fonction de réglage intelligent du DataMan 300 sélectionne automatiquement l’éclairage adapté<br />
et effectue la mise au point de l’objectif simultanée en fonction de l’application. Cette méthode<br />
de réglage garantit au lecteur de codes-barres d’être réglé de manière à obtenir les taux de lecture<br />
les plus élevés possible pour les codes 1D, 2D et à marquage direct (DPM). L’objectif liquide<br />
peut également être réglé par logiciel (via le port série) sans toucher au lecteur. Pour la lecture par<br />
présentation, la lecture dans des bacs ou le tri de petits colis, l’objectif liquide peut être configuré<br />
de manière à balayer dynamiquement toute la plage focale de l’objectif afin de rechercher et<br />
de lire les codes-barres sur une plage étendue de distances de travail.<br />
Système<br />
Un nouveau couplemètre rotatif<br />
de précision<br />
ICA Systèmes Motion vient de lancer sur le marché un nouveau couplemètre<br />
de précision. Développé et fabriqué par Burster à Gernsbach en Allemagne,<br />
cet appareil est destiné à des mesures de couple statique ou<br />
dynamique en sens horaire ou anti-horaire. Ce couplemètre a été conçu<br />
pour des applications rotatives avec mesure d'angle et de vitesse intégrés<br />
de 0...+/-0,5Nm à 0...+/-200Nm.<br />
« Sans usure, ni maintenance », indiquet-on<br />
au sein de la société ICA Systèmes<br />
Motion, en raison notamment de la transmission<br />
sans contact de la valeur et du<br />
courant d'excitation. Cet outil est utilisé<br />
pour les applications d'assemblage industrielles<br />
pour lesquelles il est nécessaire de<br />
vérifier et de mesurer un couple de maintient,<br />
de vissage ou d'arrêt. La précision<br />
de ce couplemètre permet aussi d'envisager<br />
un contrôle qualité ainsi que des<br />
applications de recherche en laboratoire.<br />
Pour une utilisation mobile, une sortie avec<br />
interface USB permet d'enregistrer et de<br />
visualiser les courbes de couple. Par<br />
ailleurs, le couple appliqué peut être<br />
évalué en utilisant un afficheur numérique<br />
connecté à la sortie analogique 0...+/-10V.<br />
Une multitude d'utilisations<br />
dans le domaine des essais<br />
et de la mesure<br />
Les exemples d'utilisation sont multiples<br />
et vont des essais mécaniques de pression<br />
à mesure micromécanique sur des<br />
actionneurs en passant par les bancs d'essais<br />
moteurs et puissance, l'enregistrement<br />
de mouvements biomécaniques<br />
dans le domaine médical ou encore la<br />
mesure des efforts de frottement dans les<br />
roulements et la mesure des efforts<br />
de serrageCouple de 0...+/-0,5 Nm à<br />
0...200 Nm.<br />
L'arbre de mesure est équipé de jauges<br />
de contrainte qui se déforment lors de la<br />
torsion. La variation de résistance qui en<br />
résulte est convertie en signal analogique<br />
proportionnel au couple. Pour éviter toute<br />
usure, l'alimentation est effectuée par des<br />
coupleurs inductifs et le signal de mesure<br />
est transmis de manière optique.<br />
Le signal qui a été digitalisé du côté de<br />
l'arbre est converti et amplifié en<br />
0...+/-10V avec une résolution de 16 bits<br />
coté stator. Un codeur haute résolution<br />
1024 points TTL mesure le déplacement<br />
angulaire.<br />
Trois leds indiquent quant à eux la plage<br />
de couple de travail. Enfin, les roulements<br />
et l'équilibrage dynamique permettent de<br />
travailler jusqu'à 25 000trs/min ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 1
Solutions<br />
Recourir au scanner<br />
électromagnétique<br />
pour la détection de défauts<br />
Détecter les défauts sur les lignes de production ou mesurer des paramètres<br />
physiques avec une extrême précision sur toutes les faces d’un<br />
produit, est crucial pour éviter tous risques de production défectueuse<br />
pouvant entraîner à la fois des arrêts de chaînes et des pertes colossales<br />
d’argent. Pour ce faire, la société Satimo (groupe Microwave Vision) vient<br />
de lancer le Dentro LSX, un nouveau scanner industriel électromagnétique<br />
capable d’analyser de manière transversale les matériaux en défilement.<br />
Dans la production de laine de verre ou de<br />
laine de roche, mais aussi dans l’industrie<br />
du bois ou du placoplâtre par exemple, la<br />
mesure de défaut est à la fois indispensable<br />
et délicate. Pourquoi ? Tout simplement<br />
parce que la moindre tâche d’eau,<br />
d’humidité ou encore la présence de tout<br />
corps solide et métallique peuvent avoir<br />
des conséquences désastreuses sur le<br />
produit fini. Par ailleurs, la mesure de la<br />
densité des matériaux en temps réel, soit<br />
pendant le défilement des produits, soit<br />
sur la ligne de production, est tout aussi<br />
nécessaire. Pour cela, il existait déjà sur<br />
le marché des solutions optiques ou thermiques,<br />
ainsi que des scanners. Le<br />
problème était que la compilation de ces<br />
différents systèmes et de leurs avantages<br />
n’était pas possible. Mais la filiale brestoise<br />
du groupe français Microwave Vision<br />
Group (MVG) spécialisée dans le contrôle<br />
industriel est parvenue à regrouper ces<br />
différentes compétences en un seul et<br />
même produit, le Dentro LSX.<br />
Ce scanner industriel électromagnétique<br />
s’installe sur les lignes de production ou<br />
de tri et offre une analyse transversale des<br />
matériaux en défilement. Il fonctionne dans<br />
le domaine des ondes électromagnétiques<br />
centimétriques. Ce domaine spectral<br />
permet de détecter des défauts ou de<br />
mesurer des paramètres physiques (la<br />
composition chimique, la teneur en humidité,<br />
la densité…). Ne nécessitant pas de<br />
contact entre les capteurs et les matériaux,<br />
il permet une analyse externe et interne<br />
avec une résolution de l’ordre du centimètre,<br />
tout en s’affranchissant des<br />
problèmes de pollution liés aux scanners<br />
qui utilisent des rayons ionisants. Dentro<br />
LSX complète ainsi les outils d’analyse du<br />
spectre électromagnétique actuellement<br />
à la disposition des industriels. En plus des<br />
caméras (optique et thermique) et des<br />
scanners (rayons X, gamma), ils peuvent<br />
désormais compter sur ce scanner innovant<br />
dont une version plus robuste et plus<br />
précise vient de sortir.<br />
Se diriger vers d’autres<br />
applications que la laine<br />
de verre ou de roche<br />
L’entreprise bretonne Satimo (comprendre :<br />
Société d’applications technologiques de<br />
l’imagerie micro-onde) conçoit et fabrique<br />
des systèmes de mesure du champ<br />
électromagnétique. Les applications y sont<br />
diverses et vont de la caractérisation des<br />
antennes dans l’industrie du sans-fil à la<br />
communication satellite en passant par<br />
l’automobile, la défense et l’aéronautique.<br />
Mais la société développe et produit également<br />
des systèmes de contrôle qualité<br />
pour l’inspection des matériaux non métalliques.<br />
Le Dentro LSX fait partie de ces<br />
solutions ; « le système inspecte toutes<br />
sortes de matériaux à l’exception naturellement<br />
des matériaux métalliques puisqu’il<br />
s’agit d’une technologie micro-onde,<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 2
appelle Jean-Baptiste Lattard, directeur<br />
du site brestois de Satimo. Pour<br />
le reste, ce matériel détecte tout, du<br />
thermique aux tâches d’humidité en<br />
passant par les points durs à l’exemple<br />
du verre qui n’aurait pas fondu. Ainsi,<br />
il permet de regrouper plusieurs appareils<br />
en même temps ».<br />
Concrètement, le système est composé<br />
d’un émetteur placé au-dessus<br />
du convoyeur et d’un récepteur installé<br />
en-dessous.<br />
Ce récepteur comporte des capteurs<br />
distants d’environ un centimètre les uns<br />
des autres. Puis il suffit d’adapter le Dentro<br />
LSX aux largeurs de lignes du client, allant<br />
de 3,6 à 64 cm. « Le Dentro LSX est ainsi<br />
capable de mesurer tous les produits non<br />
métalliques, dans tous les sens, tous les<br />
1, 2 ou 3 cm, en fonction des besoins de<br />
l’industriel ».<br />
Ces industriels,<br />
qui sont-ils ?<br />
« Pour le moment, nos principaux clients<br />
se positionnent sur les marchés de la laine<br />
de verre et de la laine de roche. Mais nous<br />
avons la volonté d’étendre ce système à<br />
la mesure d’autres matériaux pour des<br />
applications sur des lignes de production<br />
dans l’industrie du bois, du placoplâtre ou<br />
autres. En revanche, si la piste de l’industrie<br />
agroalimentaire est envisageable,<br />
les limites technologiques demeurent difficiles<br />
à franchir pour adapter la géométrie<br />
du système à la problématiques des<br />
clients ».<br />
À ce scanner industriel s’ajoute un logiciel<br />
de traitement que l’on interface avec le<br />
reste de l’usine ou de l’unité de<br />
production.<br />
De là, il est alors possible de récupérer<br />
les informations pour chacun des sites<br />
ainsi que toutes les données relatives<br />
au nom et à l’identification du produit,<br />
sa densité, la vitesse des lignes, etc.<br />
« Il s’agit de mettre en place une véritable<br />
interface avec les automates<br />
présents dans l’usine et ainsi de suivre<br />
la production, en gérer tous les paramètres<br />
et de mettre en place des<br />
alertes en cas de défauts ou de fuites<br />
d’eau par exemple », conclut Jean-Baptiste<br />
Lattard.<br />
Le Dentro LSX est capable de mesurer des<br />
défauts et la densité des matériaux en défilement<br />
sur des lignes allant de 1 m. à<br />
60 m. par seconde.<br />
Ces vitesses peuvent évoluer et être<br />
augmentées ; pour l’heure, les besoins des<br />
clients de Satimo utilisant le Dentro LSX<br />
n’en ont pas l’utilité. Mais les applications<br />
à venir pourront répondre à des demandes<br />
plus exigeantes ●<br />
Olivier Guillon<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 3
Solutions pour l'étalonnage<br />
La détermination des contraintes<br />
résiduelles par la méthode du trou<br />
Plus que jamais le chalenge du mécanicien<br />
concepteur est de dimensionner des<br />
pièces ou des structures au plus juste en<br />
évitant toutefois les risques de ruptures<br />
en service. L’une des difficultés de telles<br />
opérations de conception est la prise en<br />
compte réaliste des contraintes résiduelles<br />
pouvant exister dans le matériau utilisé<br />
pour construire les pièces ou les machines<br />
considérées. Pour en savoir plus sur l’origine<br />
de ces contraintes résiduelles, il est<br />
possible consulter un précédent numéro<br />
de cette revue intitulé : « Détermination<br />
des contraintes résiduelles sur pièces de<br />
forte épaisseur par la méthode de la flèche<br />
_ 1ère partie : Rappel du principe de la<br />
méthode » (numéro 105 de la revue <strong>Essais</strong><br />
& simulations »).<br />
En pratique, les contraintes résiduelles<br />
internes au matériau des pièces et des<br />
structures mécaniques sont difficiles à<br />
prévoir par calcul. Il est souvent nécessaire<br />
de les déterminer expérimentalement.<br />
Il existe pour cela plusieurs méthodes utilisables<br />
industriellement. L’une des plus<br />
couramment utilisée est la méthode du<br />
trou.<br />
Son fonctionnement repose sur le fait que,<br />
si on perce un petit trou dans une pièce à<br />
la surface de laquelle il y a des contraintes,<br />
alors l’équilibre des contraintes est modifié<br />
au voisinage du trou. En faisant des<br />
mesures caractérisant cette modification<br />
d’équilibre, il est possible de remonter aux<br />
contraintes qu’il y avait dans la matière<br />
qui est partie en copeaux pendant le<br />
perçage du trou.<br />
C’est donc une méthode de détermination<br />
des contraintes résiduelles par relaxation<br />
locale dont le principe et la mise en œuvre<br />
vont être traités ci-après.<br />
Les mesures qui sont relevées au cours<br />
de la mise en œuvre de la méthode sont<br />
des mesures de déformations mécaniques<br />
par jauges.<br />
Le principe de<br />
fonctionnement de la<br />
méthode du trou dans le<br />
cas de contraintes<br />
résiduelles<br />
unidirectionnelles et<br />
uniformes (cas de la barre<br />
en traction) :<br />
Il est aisé de comprendre intuitivement<br />
le principe de la détermination des<br />
contraintes résiduelles par la méthode du<br />
trou en analysant qualitativement ce qui<br />
se passe lorsqu’un trou est percé dans une<br />
barre en fer plat soumise à un effort de<br />
traction longitudinale.<br />
La barre en question est représentée sur<br />
la figure 1 ci-après.<br />
Mots-clés<br />
contrainte résiduelle, méthode du trou,<br />
déformation mécanique, jauge de déformation,<br />
rosette de jauges de déformation,<br />
tenseur de déformations, tenseur de<br />
contraintes, équations de Lamé, module<br />
d’élasticité, coefficient de Poisson, coefficient<br />
de sensibilité.<br />
Les schémas indiquent comment se répartissent<br />
les contraintes dans une telle barre<br />
avant et après qu’un trou soit percé.<br />
Lorsqu’une barre en fer plat de grande<br />
longueur est sollicitée par un effort de traction<br />
longitudinal à chacune de ses extrémités,<br />
elle est soumise à des contraintes<br />
unidirectionnelles de traction.<br />
La répartition de ces contraintes est une<br />
répartition uniforme dans les sections<br />
droites de la partie centrale de la barre<br />
(sections telles que celles représentées<br />
en bas de la figure), ainsi que dans toutes<br />
les sections voisines avec en particulier la<br />
section passant par la jauge la plus à droite<br />
sur la partie haute de la figure.<br />
Il en est de même pour les déformations<br />
mécaniques pouvant être mesurées avec<br />
les autres jauges collées dans la direction<br />
longitudinale de la barre comme indiquée<br />
sur la vue de la barre se trouvant en haut<br />
de la figure.<br />
Cette répartition uniforme se transforme<br />
de la manière indiquée sur les croquis de<br />
la figure suivante dans le cas où un trou<br />
est percé au milieu de la longueur de la<br />
barre. (figure 2)<br />
Figure 1 - Barre de grande longueur soumise à un effort de traction<br />
La matière qui se trouve sur la surface<br />
du perçage à l’intérieur du trou est uniquement<br />
en contact avec l’air ambiant.<br />
Elle n’est donc soumise à aucune contrainte<br />
mécanique mis à part la pression<br />
atmosphérique. La valeur standard de la<br />
pression atmosphérique est de 1013 hPa,<br />
soit 0,1 MPa. La contrainte normale à la<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 4
Ainsi, la répartition des contraintes longitudinales<br />
dans la section droite passant<br />
la jauge de déformation apparaissant sur<br />
la figure précédente est aussi modifiée.<br />
L’allure de la nouvelle répartition de<br />
contraintes est représentée sur le schéma<br />
du bas de cette figure.<br />
Il apparait que la valeur des contraintes<br />
aux points situés sous la jauge est beaucoup<br />
plus faible que la valeur<br />
trou.<br />
qu’il y avait avant le perçage du<br />
Donc, si cette jauge est collée sur la barre<br />
en traction avant le perçage du trou et que<br />
le conditionneur est réglée pour indiquer<br />
zéro à ce moment là, alors après le<br />
perçage du trou, le conditionneur indiquera<br />
une valeur de déformation négative qui<br />
correspondra au passage de la valeur de<br />
la contrainte de<br />
faible.<br />
à une valeur beaucoup plus<br />
Pour un point à une distance donnée par<br />
rapport au trou, cette diminution de déformation<br />
est proportionnelle à la contrainte<br />
qu’il y avait dans la barre avant de percer<br />
le trou.<br />
Figure 2 - Croquis montrant les modifications des répartitions de contraintes<br />
consécutives au perçage d’un trou dans une barre de grande longueur soumise<br />
à un effort de traction<br />
surface du trou est donc de 0,1 MPa. En<br />
mécanique, de tels niveaux de contraintes<br />
sont toujours négligés et il est considéré<br />
que les contraintes normales et les cisaillements<br />
à la surface du trou sont nuls. Ceci<br />
est vrai en particulier au point A sur la vue<br />
agrandie de la partie centrale de la barre.<br />
Donc en ce point la contrainte longitudinale<br />
est nulle, alors qu’elle était de<br />
avant le perçage du trou.<br />
L’effet du perçage du trou est donc très<br />
important.<br />
Au voisinage de ce point, le perçage du<br />
trou fait également que les contraintes<br />
sont très faibles.<br />
Cependant, au fur et à mesure que la<br />
distance au trou augmente, les contraintes<br />
qui subsistent dans la barre augmentent<br />
aussi progressivement (voir croquis ci-avant),<br />
alors qu’elles étaient toutes égales à<br />
avant le perçage du trou.<br />
Par contre, sur les parties de la section<br />
droite passant par l’axe du trou, les<br />
contraintes longitudinales sont plus<br />
élevées que ce qu’elles étaient avant le<br />
perçage du trou<br />
Ceci est logique car il faut que l’intégrale<br />
des contraintes longitudinales sur toute la<br />
surface de la section droite équilibre l’effort<br />
de traction de la barre, qui lui est<br />
toujours le même.<br />
Toutes ces modifications de répartitions<br />
des contraintes dans les sections droites<br />
successives de la barre se propagent en<br />
s’atténuant au fur et à mesure que la<br />
distance au trou augmente.<br />
Connaissant le coefficient de proportionnalité<br />
qui relie cette diminution de déformation<br />
à la contrainte, il est possible de<br />
déterminer la contrainte qu’il y avait dans<br />
la barre avant le perçage du trou à partir<br />
de la variation de déformation indiquée<br />
par la jauge au cours du perçage.<br />
Ceci est la base de la détermination des<br />
contraintes résiduelles par la méthode du<br />
trou.<br />
Les coefficients de proportionnalité permettant<br />
d’obtenir ces contraintes résiduelles<br />
peuvent être calculés en utilisant<br />
la théorie de l’élasticité comme ceci est<br />
présenté dans le document intitulé « Théorie<br />
de la détermination des contraintes<br />
résiduelles par la méthode du trou » disponible<br />
sur le site de l’ASTE :<br />
http://www.aste.asso.fr, dans la bibliothèque.<br />
Ainsi, les expressions qui donnent les<br />
composantes du tenseur des contraintes<br />
dans une plaque sollicitée en traction unidirectionnelle<br />
percée d’un trou comme celle<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 5
eprésentée sur la figure ci-après sont<br />
(formule 1).<br />
Formule 1<br />
σ est la contrainte de traction uniforme de<br />
la barre dans les sections éloignées du<br />
trou.<br />
Plaque sollicitée par une traction<br />
unidirectionnelle percée d’un trou<br />
Dans le cas de l’utilisation de la méthode<br />
du trou pour déterminer les contraintes<br />
résiduelles, ce ne sont pas les déformations<br />
mécaniques qui correspondent à ces<br />
contraintes qui sont mesurées par les<br />
jauges, mais les variations de déformations<br />
qui correspondent au passage de<br />
l’état de contraintes de traction unidirectionnelle<br />
uniforme existant dans la plaque<br />
avant le perçage du trou à l’état de<br />
contrainte non uniforme dont les composantes<br />
sont<br />
Formule 2<br />
Formule 3<br />
qui viennent d’être définies.<br />
Les indications des jauges seront donc les<br />
variations de déformations mécaniques<br />
qui correspondent aux variations de<br />
contraintes suivantes (formule 2), qui,<br />
après simplification et regroupement des<br />
termes semblables deviennent (formule 3).<br />
Les variations de déformations mécaniques<br />
engendrées par une telle variation d’état de<br />
contraintes sur une jauge comme celle se<br />
trouvant prés du trou sur la figure intitulée<br />
« Schémas montrant les modifications des<br />
répartitions de contraintes consécutives au<br />
perçage d’un trou dans une barre de grande<br />
longueur soumise à un effort de traction » se<br />
calculent en utilisant les équations de Lamé<br />
ci-après (formule 4).<br />
E (module d’élasticité) et υ (coefficient de<br />
Poisson) sont les constantes élastiques du<br />
matériau.<br />
En réalité, dans le cas de jauges de déformations<br />
mécaniques orientées suivant la<br />
direction des rayons du trou, comme c’est le<br />
cas de la jauge de la figure, c’est seulement<br />
Formule 4<br />
Formule 5<br />
Formule 6<br />
la première de ces trois relations qui doit être<br />
utilisée. Les autres relations ne sont jamais<br />
utilisées pour déterminer les contraintes résiduelles<br />
par la méthode du trou.<br />
L’indication fournie par une jauge de déformations<br />
mécaniques placée au bord d’un<br />
trou, une fois que celui-ci est percée est<br />
donc (formule 5), qui après simplification<br />
prend la forme (formule 6).<br />
Cette relation montre que, pour un point<br />
donné de la plaque, l’indication ∆ε r (r,θ) p<br />
de la jauge est proportionnelle à la<br />
contrainte qu’il y avait dans la plaque avant<br />
de percer le trou.<br />
Le coefficient de proportionnalité se<br />
calcule aisément, lorsque r et θ coordonnées<br />
du centre de la jauge dans un<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 6
système d’axes en coordonnées cylindriques,<br />
sont connues.<br />
En posant<br />
la relation qui relie la contrainte résiduelledans<br />
la plaque à l’indication de la jauge<br />
prend la forme :<br />
Ce qui vient d’être vu correspond au cas<br />
simple d’une plaque soumise à une<br />
tension unidirectionnelle. Cela permet de<br />
comprendre le fonctionnement de la<br />
méthode.<br />
Extension du cas simple<br />
des contraintes<br />
unidirectionnelles et<br />
uniformes au cas des états<br />
de contraintes résiduelles<br />
quelconques :<br />
Dans le cas général, l’état de contraintes<br />
résiduelles inconnues qu’il peut y avoir<br />
dans une pièce est un état bidirectionnel<br />
de directions principales inconnues.<br />
Dans ce cas, il est facile de démontrer que<br />
la relation qui va relier l’indication donnée<br />
par une jauge de déformations mécaniques<br />
au moment du perçage d’un trou<br />
est une fonction linéaire des deux<br />
contraintes principales σ I et σ II qui a<br />
la forme :<br />
Cette relation montre que pour déterminer<br />
l’état de contraintes résiduelles inconnu,<br />
il faut placer trois jauges sur la périphérie<br />
du trou, relever leurs indications après le<br />
perçage du trou et, dans le cas où les trois<br />
jauges font entre elles un angle de 45°<br />
comme indiqué sur la figure ci-après,<br />
remonter aux contraintes résiduelles à<br />
l’aide des relations suivantes :<br />
Croquis montrant le positionnement des jauges de déformations<br />
autour du trou à percer<br />
(voir document intitulé « Théorie de la<br />
détermination des contraintes résiduelles<br />
par la méthode du trou » disponible sur le<br />
site de l’ASTE : http : www.aste.asso.fr/fr,<br />
dans la bibliothèque).<br />
Il apparaît donc que les contraintes résiduelles<br />
se calculent directement à partir<br />
des déformations indiquées par les jauges,<br />
à condition de connaître les coefficients<br />
de sensibilité A et B.<br />
Comme ceci a été vu précédemment, ces<br />
coefficients peuvent se calculer à l’aide des<br />
relations obtenues par la théorie de la<br />
mécanique des milieux continus. Ces calculs<br />
qui dans le principe sont simples se compliquent<br />
un peu car, pour ne pas faire d’erreur<br />
par la suite, ils doivent prendre en compte<br />
les dimensions des jauges.<br />
Aussi, en pratique, ils sont plutôt déterminés<br />
expérimentalement par les fournisseurs<br />
de jauges. Les coefficients A et B<br />
se trouvent donc dans les documents<br />
distribués par ces fournisseurs de jauges.<br />
de contraintes prises en compte, sont<br />
celles qui résultent du perçage d’un trou<br />
qui traverse la plaque dans laquelle il y a<br />
les contraintes à déterminer.<br />
Il est aussi considéré que la répartition<br />
dans l’épaisseur de ces contraintes est<br />
uniforme.<br />
Dans le cas du perçage d’un trou dans une<br />
plaque de forte épaisseur également<br />
soumise à des contraintes réparties uniformément<br />
dans l’épaisseur, des essais ont<br />
montrés que les indications d’une jauge<br />
placée à proximité du trou évoluent en<br />
fonction de la profondeur p du trou de la<br />
manière indiquée sur le graphique de la<br />
figure ci-après.<br />
Effet de la profondeur<br />
du trou :<br />
Jusqu’à présent, tous les développements<br />
sont faits en considérant que les variations<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 7
Evolution de l’indication d’une jauge<br />
de déformations mécaniques placée<br />
au bord d’un trou, au fur et à mesure<br />
du perçage de ce dernier<br />
Il apparaît que lorsque la profondeur p du<br />
trou dépasse 1,2 fois le diamètre, les indications<br />
de la jauge restent approximativement<br />
constantes. Il n’est donc pas<br />
nécessaire de faire des trous qui traversent<br />
les pièces épaisses.<br />
Mise en œuvre<br />
de la méthode, validité<br />
et qualité des résultats :<br />
répartition des contraintes résiduelles dans<br />
l’épaisseur et si la précision des perçages<br />
est correcte.<br />
En prenant un certain nombre de précautions,<br />
il est possible de minimiser l’effet<br />
de tout cela.<br />
En ce qui concerne l’uniformité de répartition,<br />
dans bon nombre de cas, il est<br />
possible de s’affranchir, en partie au<br />
moins, de ce type de perturbation des<br />
résultats de mesure pour la raison<br />
suivante. Généralement, les contraintes<br />
résiduelles qui sont gênantes dans les<br />
pièces, sont les contraintes résiduelles en<br />
surface. Si il est suspecté que la répartition<br />
n’est pas uniforme, il faut choisir un<br />
diamètre de perçage très petit. Dans ces<br />
conditions, les contraintes résiduelles qui<br />
seront déterminées sont les moyennes de<br />
répartitions des contraintes résiduelles<br />
dans l’épaisseur correspondant à la profondeur<br />
percée, c’est-à-dire 1 à 2 mm.<br />
Il y a beaucoup de cas où, dans une telle<br />
épaisseur, les variations de contraintes ne<br />
sont pas très importantes et l’erreur<br />
correspondante sur le résultat de la détermination<br />
est faible.<br />
En ce qui concerne la précision des<br />
perçages, il faut se rappeler que les coefficients<br />
de sensibilité sont des fonctions<br />
du rayon du trou et de la distance du centre<br />
de la jauge à l’axe du trou.<br />
Les rosettes de jauges de déformations<br />
mécaniques distribuées par les fournisseurs<br />
de jauges ont des dispositions du<br />
type de celles indiquées sur la figure<br />
ci-après.<br />
Le trou est percé une fois que les rosettes<br />
sont collées sur la pièce dans laquelle les<br />
contraintes résiduelles doivent être déterminées.<br />
Comme ceci se devine sur la figure, le<br />
perçage doit être centré le mieux possible<br />
par rapport aux jauges.<br />
Pour avoir de bons résultats, il faut que<br />
le diamètre de perçage pris en compte<br />
dans les coefficients de sensibilité soit<br />
respecté à mieux qu’au 1/10 e de millimètre<br />
et que l’erreur de centrage soit inférieure<br />
au 1/10 e de millimètre.<br />
En fait pour être certain de respecter ces<br />
impératifs, il faut utiliser des dispositifs de<br />
perçage spécifiquement conçus pour la<br />
détermination des contraintes résiduelles<br />
par la méthode du trou.<br />
Ces dispositifs se fixent à la surface de la<br />
pièce et possèdent un petit bâti dans<br />
lequel se monte d’abord une lunette de<br />
visée qui permet de faire un centrage<br />
précis par rapport à la rosette. Ensuite, la<br />
lunette est déposée et remplacée par une<br />
petite broche de perçage. Du fait que le<br />
système vient d’être centré sur la rosette,<br />
il n’y aura que très peu d’erreur de positionnement<br />
du trou.<br />
Par contre, pour éviter les déviations de forêt<br />
au début ou au cours du perçage, il ne faut<br />
pas utiliser des forets classiques. Il faut<br />
prendre des forets spéciaux qui ressemblent<br />
plutôt à de toutes petites fraises.<br />
Et si le diamètre du trou est faible (2 mm<br />
par exemple), alors les contraintes résiduelles<br />
peuvent être déterminées dans<br />
une couche superficielle de quelques millimètres<br />
sans faire un perçage très profond<br />
(guerre plus de 2 mm). Si, en plus, la pièce<br />
n’est pas très petite, comme c’est souvent<br />
le cas dans l’industrie, alors les traces laissées<br />
par la mise en œuvre de la méthode<br />
sont très ténues et ne sont, bien souvent,<br />
pas gênante pour envisager une utilisation<br />
ultérieure de la pièce.<br />
C’est pour cela que cette méthode de<br />
détermination des contraintes résiduelles<br />
est dite « semi destructive ».<br />
Les résultats obtenus sont de bonne<br />
qualité si il y a une bonne uniformité de<br />
Vue de rosettes tri directionnelles de jauges de déformations<br />
pour la méthode du trou<br />
(document Vishay MicroMesures)<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 8
Une fois que le trou est percé, il faut<br />
remonter la lunette pour relever la valeur<br />
exacte du diamètre du trou qui a été percé.<br />
Les coefficients de sensibilité doivent alors<br />
être corrigés en tenant compte de la valeur<br />
exacte du diamètre du trou.<br />
Ainsi, si le centrage est bon et si le diamètre<br />
du trou est mesuré à quelques centièmes<br />
de millimètre prés, alors il est possible d’obtenir<br />
des valeurs de contraintes résiduelles<br />
avec une incertitude relative inférieure ou<br />
égale à 5% lorsque les contraintes résiduelles<br />
à déterminer sont supérieures à 100<br />
à 150 MPa.<br />
Lorsque les erreurs de centrage et de<br />
relevé du diamètre du trou se rapprochent<br />
du 1/10 e de millimètres, cette incertitude<br />
atteint voire dépasse 10%.<br />
Conclusions :<br />
Grâce aux développements récents effectués<br />
d’une part au niveau de l’outillage de<br />
mise en œuvre et d’autre part sur l’optimisation<br />
des formes de rosettes spécifiques<br />
de mesure de déformations, la<br />
technique de détermination des contraintes<br />
résiduelles par la méthode du trou est<br />
utilisable industriellement sans difficulté<br />
particulière et donne des résultats satisfaisants.<br />
Il est maintenant possible de<br />
maîtriser le centrage et le diamètre de<br />
perçage des trous à quelques centièmes<br />
de mm, ce qui permet d’avoir des valeurs<br />
de contraintes résiduelles à +/- 5% (qualité<br />
de mesure largement suffisante pour<br />
prendre en compte correctement l’effet<br />
des contraintes résiduelles).<br />
L’exploitation des résultats de mesure<br />
relevés au cours du perçage des trous<br />
n’est plus une difficulté car elle est faite<br />
automatiquement par des logiciels dédiés<br />
simples.<br />
La tendance à la réduction des diamètres<br />
et des profondeurs perçage des trous<br />
(fréquemment diamètres et profondeurs<br />
de l’ordre de 2 mm), fait que, sur bon<br />
nombre de pièces de l’industrie, ils ne sont<br />
pas gênants par la suite et n’entraine pas<br />
de rebut. C’est d’ailleurs pour cela que<br />
cette méthode est souvent appelée<br />
méthode semi destructive de détermination<br />
des contraintes résiduelles ●<br />
Il apparaît donc que les effets des erreurs<br />
sur les mesures des déformations mécaniques<br />
indiquées par les jauges restent<br />
faibles par rapport aux effets des erreurs<br />
liées au processus de perçage. Les incertitudes<br />
sur les résultats proviennent essentiellement<br />
du perçage.<br />
Abstract<br />
Blind hole drilling method is a residual<br />
stress determination method largely used<br />
in the industry. The basic principal of the<br />
method is given first, resting on a simple<br />
application case: the determination of a<br />
uniform single axial stress pattern like<br />
the one existing in a flat plate in tension.<br />
This sketch clearly demonstrates, in a<br />
pragmatic way, how the method works in<br />
order to show to future users how to<br />
adapt it as better as possible to their<br />
future applications.<br />
Then, the simplified presentation is enlarged<br />
to the general case of biaxial stress<br />
pattern of unknown directions. All mathematical<br />
strains reduction relations<br />
converting strains in stresses are given<br />
and commented so that they can be used<br />
or programmed easily.<br />
Finally, main parts of the implementation<br />
of the method are depicted, especially<br />
the strain rosettes types and special<br />
drilling machine tool. Special cares to<br />
have good results are also emphasized. If<br />
well applied, this method gives good<br />
results in accordance with the needs.<br />
Résumé<br />
Dans l’industrie, la détermination des contraintes résiduelles se fait souvent en utilisant la<br />
méthode du trou. Le principe de cette méthode est d’abord présenté sur la base d’un cas<br />
simple d’application : la détermination d’un état de contrainte résiduelle uniforme et unidirectionnel<br />
du type de l’état de contrainte existant dans une barre plate en traction simple.<br />
Il est ainsi possible de se rendre compte de manière pragmatique comment fonctionne la<br />
méthode afin d’être capable de l’appliquer à bon escient par la suite.<br />
Ensuite, la présentation simplifiée est élargie au cas général des états bidirectionnels de<br />
contraintes résiduelles de directions inconnues. Toutes les relations mathématiques permettant<br />
de calculer les contraintes à partir des déformations mécaniques mesurées au cours<br />
du perçage des trous sont données et commentées afin de pouvoir être utilisées ou programmées<br />
facilement.<br />
Enfin, les principaux aspects de la mise en œuvre de la méthode sont traités avec en<br />
particulier les types de rosettes de jauges de déformations et l’outillage spécifique de<br />
perçage à utiliser ainsi que les précautions à prendre. Il apparait que la qualité des résultats<br />
obtenus est satisfaisante si la mise en œuvre est faite avec soin.<br />
Références<br />
Encyclopédie VISHAY d’analyse des contraintes par Jean Avril,<br />
avec la collaboration de Thomas W. Corby Jr., James Dorsey, Yves Dunand, Jacques Fleury,<br />
Michel Gérant, Jean-Luc Legoër, Georges Marcillac, Charles C. Perry, Alex S. Redner, James<br />
E. Starr, Robert J. Whitehead, Felix Zandman.<br />
Handbook of Residual Stress and Deformation of steel<br />
ASM International The Material Information Society<br />
edited by G. Totten, M. Howes, T. Inoue.<br />
An introduction to Measurements using Strain Gages _ Karl Hoffmann _<br />
Publisher: Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 2 9
Outil<br />
Guide pratique des précautions<br />
d’inter-câblage des dispositifs<br />
de mesure<br />
Ce guide a comme objectif d’aider les entreprises à se poser les bonnes<br />
questions et à prendre les bonnes dispositions pour réaliser des mesures<br />
de qualité en milieu industriel perturbé et cela au moindre coût et dans des<br />
délais acceptables. L’outil sera disponible courant 2013 à l’ASTE et mis<br />
gratuitement à la disposition de toutes les entreprises qui lui en feront la<br />
demande, en particulier les PME et les PMI. Ce guide est en cours d’élaboration<br />
à l’ASTE avec le concours d’un certain nombre de partenaires<br />
convaincus de son utilité et grâce à l’appui du ministère de l’Industrie/Direction<br />
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS).<br />
Les dispositifs de mesure sont de plus en<br />
plus largement utilisés dans l’industrie. Grâce<br />
aux développements récents associant les<br />
progrès réalisés dans les domaines de l’électronique<br />
et de l’informatique, ils ont toujours<br />
de très bonnes performances intrinsèques<br />
et sont en apparence très simples à utiliser.<br />
Or, l’expérience montre que leur mise en<br />
œuvre dans un environnement industriel peut<br />
parfois être à l’origine d’anomalies de fonctionnement<br />
dont les utilisateurs n’ont pas<br />
conscience (par exemple : l’utilisation sans<br />
précaution de grandes longueurs de câbles<br />
pour relier les capteurs au reste du dispositif<br />
de mesure ou le branchement sur un secteur<br />
électrique, par ailleurs perturbé par le fonctionnement<br />
anormal de certaines grosses<br />
machines, peuvent entrainer des erreurs<br />
dans les mesures).<br />
Les apports du guide<br />
Ce guide permet :<br />
- de décrire simplement la constitution des<br />
dispositifs de mesure utilisés dans l’industrie<br />
et leur environnement de fonctionnement<br />
(quantification des perturbations environnantes,<br />
en particulier les perturbations électromagnétiques),<br />
- d’estimer automatiquement les erreurs de<br />
mesure dues aux perturbations électromagnétiques,<br />
- de dimensionner les techniques de réduction<br />
des effets perturbateurs les moins<br />
onéreuses possible.<br />
L’utilisation du guide<br />
Le guide est un outil informatique conversationnel<br />
qui présente les différents systèmes<br />
de mesure pris en compte, sous la forme<br />
de schémas synoptiques sur lesquels l’utilisateur<br />
indique les valeurs des paramètres<br />
caractéristiques propres à son utilisation et<br />
les types de perturbations qui risquent de se<br />
produire.<br />
L’outil informatique indique alors l’ordre de<br />
grandeur des erreurs qui peuvent résulter de<br />
ces perturbations. Ensuite, il propose des<br />
techniques de réduction des effets perturbateurs<br />
que l’utilisateur peut choisir et dimensionner.<br />
L’outil informatique évalue les<br />
améliorations apportées par les techniques<br />
sélectionnées.<br />
Les types de mesures<br />
traitées par le guide<br />
Dans sa version initiale, le guide traitera les<br />
mesures des types de grandeurs physiques<br />
suivantes :<br />
- les températures (mesures par thermocouples<br />
et sondes à résistances – RTD),<br />
- les grandeurs électriques (tensions,<br />
courant, fréquence),<br />
- les grandeurs mécaniques (forces,<br />
couples, moments),<br />
- les longueurs, distances, déplacements,<br />
- les débits et les pressions,<br />
- les vibrations.<br />
Les types de sources<br />
de perturbations<br />
électromagnétiques<br />
prises en compte<br />
- la présence de machines génératrices de<br />
parasites à proximité des dispositifs de<br />
mesure (robots, postes à souder, tourets<br />
secteurs non déroulés, gros moteurs électriques,<br />
alternateurs, grosses génératrices à<br />
courants continus, émetteurs d’ondes électromagnétiques<br />
à très hautes fréquences tels<br />
que téléphones portables, télécommandes),<br />
- le fonctionnement de la machine ou de<br />
l’équipement sur lequel sont relevées les<br />
mesures,<br />
- le fonctionnement du banc d’essais sur<br />
lequel est installée la pièce ou la structure<br />
dont le comportement est caractérisé par<br />
les mesures,<br />
- la présence sur le secteur de charges déformantes<br />
engendrées par exemple par une<br />
mauvaise utilisation de batteries de condensateurs<br />
de redressement du cos (cas des<br />
installations de cogénération dans lesquels<br />
les batteries de condensateurs ne sont pas<br />
reconfigurées au moment du démarrage ou<br />
de l’arrêt des moteurs diesel),<br />
- le fonctionnement de grosses machines<br />
avec des déséquilibres de charge des<br />
phases,<br />
- la présence sur le secteur de système à<br />
thyristors ou à composants statiques de<br />
puissance (régulateurs de puissance pour<br />
machines tournantes, régulateur de puissance<br />
de chauffage de fours ou de batteries<br />
de chauffage à résistances, régulateurs<br />
de vitesses par onduleurs changeant la<br />
fréquence du secteur),<br />
- l’existence d’anomalies dans le régime du<br />
neutre des installations électriques, en particulier<br />
dans le cas des installations avec<br />
neutre impédant (régime IT),<br />
- les défauts d’équipotentialité des masses,<br />
- le passage de câbles de puissance à proximité<br />
des dispositifs de mesure ●<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 0
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 1
Tendance marché<br />
Le virtuel,dernier rempart<br />
des essais en environnement<br />
Les entreprises industrielles sont de plus en plus confrontées à une problématique<br />
de réduction de coûts qui les pousse à chercher par tous les<br />
moyens des outils pour optimiser leurs process. Et les essais ne sont pas<br />
exclus de cette logique. Si, il n’y a encore pas si longtemps, les essais<br />
virtuels ne représentaient qu’une part infime des opérations de tests industriels,<br />
ils occupent aujourd’hui une place prépondérante et se posent en<br />
tant que véritable soutien des essais en environnement.<br />
« Les possibilités d’applications avec la simulation<br />
sont de plus en plus nombreuses,<br />
s’enthousiasme Ascension Vizinho-Coutry,<br />
directrice technique MathWorks France. À<br />
titre d’exemple, les souffleries font appel<br />
à la modélisation pour l’étude du comportement<br />
des ailerons ou encore pour chaque<br />
partie du véhicule de façon à s’affranchir<br />
de la “composante matériel” ». Pour répondre<br />
à une demande croissante, des éditeurs<br />
de renom tels que MahWorks ont tour à tour<br />
développé des outils mathématiques et<br />
physiques dans le but d’aider les industriels<br />
à développer des algorithmes – à l’exemple<br />
de MatLab – afin de matérialiser des idées<br />
grâce à des solutions de modélisation bien<br />
plus perfectionnées que naguère. « Nous<br />
avons également mis au point dès les<br />
années 1990 SimuLink, une solution appliquée<br />
en particulier à l’automobile puis à<br />
l’aéronautique pour simuler les comportements<br />
liés au pilotage ».<br />
Mathworks-Ecocar 2 : un partenariat<br />
pour former la prochaine génération d’ingénieurs<br />
Grâce au soutien de MathWorks à EcoCAR 2, un concours (étalé sur trois ans) qui permet aux élèves<br />
ingénieurs de concevoir et de construire des véhicules écologiques en utilisant des technologies<br />
automobiles de pointe, les participant au concours bénéficieront de conseils et d’outils Matlab et<br />
Simulink pour une pédagogie de projet. Objectif pour les étudiants : acquérir durant toute la durée du<br />
concours une expérience pratique en utilisant les technologies employées par les principaux constructeurs<br />
automobiles actuels.<br />
Mis en place par le Département de l’Énergie des États-Unis (DOE) et par General Motors (GM), EcoCAR<br />
2 fournit une expérience de conception pratique aux élèves ingénieurs. Ce concours met au défi seize<br />
universités nord-américaines de réduire l’impact environnemental d’une Chevrolet Malibu sans sacrifier<br />
pour autant les aspects performances et popularité auprès des consommateurs. Les étudiants doivent<br />
suivre le processus de General Motors (le GVDP, Global Vehicle Development Process) pour la conception<br />
de leur véhicule. Dans le cadre de ce programme, les participants utiliseront les outils de l’approche<br />
Model-Based Design de MathWorks pour créer, modéliser et simuler l’architecture de leur véhicule.<br />
« MathWorks participe aux concours de technologie automobile avancés du Département de l’Énergie des<br />
États-Unis depuis plus de dix ans, a déclaré Paul Smith, directeur des services de conseil chez<br />
MathWorks, et conseiller principal du concours EcoCAR 2. Ces concours permettent aux étudiants de passer<br />
de la théorie à la pratique grâce à un apprentissage des pratiques et technologies de l’industrie. Nous<br />
pensons que cette approche avec EcoCAR 2 permettra de former de futurs ingénieurs automobiles et<br />
encouragera les innovations en matière de conception technique dans toutes les industries. »<br />
L’aéronautique est bel et bien présent sur<br />
le marché des outils d’essais virtuels,<br />
même si les tests physiques, comme en<br />
témoignent notamment les pages suivantes<br />
du dossier central de ce numéro<br />
d’<strong>Essais</strong> & <strong>Simulations</strong>, occupent toujours<br />
une place prédominante ; « il existe bien<br />
entendu et il existera toujours des flighttests<br />
pour s’assurer du comportement de<br />
la structure ou du moteur d’un avion en<br />
plein vol, pour tester sa robustesse. Mais<br />
le souci c’est que ces opérations coûtent<br />
très cher, d’où l’intérêt de la simulation et<br />
de la modélisation dont les outils permettent<br />
aujourd’hui de tester à moindre coût<br />
mais aussi bien plus rapidement les<br />
parties de l’appareil – comme le pilotage<br />
ou l’électronique – que l’on souhaite précisément<br />
tester sans pour autant étudier<br />
toute la structure ». Il en est de même pour<br />
le pilotage virtuel dont les technologies de<br />
plus en plus pointues permettent de<br />
prendre en compte le « facteur humain »<br />
de la façon la plus précise possible.<br />
Des applications<br />
de plus en plus complexes<br />
La simulation va désormais bien plus loin<br />
qu’un simple support des essais physiques.<br />
Bien plus qu’une aide, elle se<br />
présente comme un soutien à part entière<br />
dans le développement de différents<br />
produits dans la mesure où les outils<br />
proposés sur le marché intègrent désormais<br />
tous les paramètres nécessaires à la<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 2
éalisation d’essais, à commencer par la prise<br />
en compte d’une multitude de composants<br />
électroniques. « Les structures sur lesquelles<br />
on effectue des tests sont de plus en plus<br />
complexes. C’est le cas de l’automobile ou<br />
l’aéronautique ; ces deux secteurs ont beaucoup<br />
de problématiques communes en<br />
raison d’une électronique omniprésente »,<br />
rappelle Ascension Vizinho-Coutry. Par<br />
ailleurs, de nouveaux critères de qualité<br />
ont fait leur apparition comme le volume<br />
sonore général de l’appareil et d’une façon<br />
plus générale le confort. « Prenons l’exemple<br />
d’un Airbus A380. Dans ce type d’appareil<br />
s’y trouvent beaucoup plus de<br />
fonctionnalités, d’électronique, de systèmes<br />
multimédias et de données à traiter<br />
; tout cela amène à de la simulation. Il a<br />
donc été essentiel<br />
pour nous de développer<br />
des outils spécifiques<br />
et pouvant être<br />
intégrés sur des bancs<br />
de test pour réaliser<br />
des analyses plus<br />
poussées ».<br />
Au final, deux grandes<br />
tendances se dessinent.<br />
L’une concerne<br />
les grands volumes de<br />
données, exigeant des<br />
systèmes de traitement<br />
d’informations de plus en plus puissants et<br />
une présence omniprésente de capteurs de<br />
toutes sortes. D’autre part, les éditeurs d’outils<br />
de simulation doivent travailler sur des<br />
modèles bien plus complexes, « à l’exemple<br />
de la modélisation des produits mécatroniques<br />
». Par ailleurs, cette modélisation<br />
revêt plusieurs aspects bien définis, comme<br />
la modélisation physique, multi-physique ou<br />
multi-domaine, et ce dans des environnements<br />
très divers avec des plateformes<br />
collaboratives impliquant de plus en plus<br />
d’individus aux métiers et aux univers différents<br />
les uns des autres. Le but est-il encore<br />
d’œuvrer pour une meilleure compréhension<br />
et aboutir à un langage commun ●<br />
Olivier Guillon<br />
Des outils de calcul parallèle optimisent l’analyse<br />
de risques lors d’une transplantation cardiaque<br />
L’Université de Lund, l’une des plus grandes universités au monde dans le domaine de la recherche,<br />
utilise Matlab, Neural Network Toolbox et Parallel Computing Toolbox, ainsi que Matlab Distributed<br />
Computing Server, pour améliorer le taux de survie à long terme des receveurs de greffe cardiaque<br />
en identifiant la compatibilité optimale entre le receveur et le donneur. Les chercheurs de l’Université<br />
de Lund et de l’Hôpital universitaire de Skåne ont en effet exploré les relations complexes entre les<br />
nombreuses variables intervenant lors d’une transplantation, y compris le poids, le sexe, l’âge et le<br />
groupe sanguin du donneur et du receveur, ainsi que la durée d’interruption du flux sanguin vers le<br />
cœur pendant la transplantation. L’analyse de ces six variables a demandé la simulation de 30 000<br />
combinaisons différentes et la simulation de toutes ces combinaisons pour 50 000 patients a pris plusieurs<br />
semaines à l’aide d’un logiciel open-source qui s’est avéré être instable et inexact.<br />
Pour relever les défis liés à la vitesse et à la fiabilité, les chercheurs ont utilisé Matlab et Neural<br />
Network Toolbox pour développer des modèles de réseaux neuraux artificiels (ANN) prédictifs. Ces<br />
modèles ANN ont été définis à l’aide des données des donneurs et des receveurs issues de deux<br />
bases de données mondiales : le registre de la Société internationale de transplantation cardiaque et<br />
pulmonaire (ISHLT - International Society for Heart and Lung Transplantation) et la base de données<br />
de transplantation thoracique nordique (NTTD - Nordic Thoracic Transplantation Database). « Les<br />
gains réalisés par l’Université de Lund illustrent parfaitement la façon dont le calcul haute performance<br />
permet aux équipes de développer des modèles complexes plus fiables en moins de temps,<br />
a déclaré Silvina Grad-Freilich, responsable marketing pour le calcul parallèle chez MathWorks. Les<br />
ingénieurs et les scientifiques veulent résoudre leurs problèmes plus rapidement, et, au cours de la<br />
dernière décennie, la capacité à dénicher les meilleurs matériels a entravé leurs efforts. Des outils<br />
tels que Parallel Computing Toolbox et Matlab Distributed Computing Server, leur ont permis de surmonter<br />
cet obstacle ».<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 3
ESI Group élargit les compétences de<br />
simulation des procédés de fonderie<br />
ESI Group, leader et pionnier des solutions<br />
de prototypage virtuel pour les industries<br />
manufacturières, a lancé la dernière version<br />
de la Suite Logicielle de Fonderie<br />
d’ESI, composée de ProCAST et QuikCAST.<br />
La suite permet de simuler l’intégralité des<br />
procédés de fonderie, dont les défauts de<br />
coulée et de solidification, les propriétés<br />
mécaniques et les changements dimensionnels<br />
de la pièce.<br />
La Suite Logicielle de Fonderie propose<br />
une analyse rapide des effets dus à des<br />
changements géométriques ou des changements<br />
de procédé, pour toutes sortes<br />
de pièces coulées, afin de prendre les<br />
bonnes décisions au bon moment, depuis<br />
le tout début du cycle de fabrication.<br />
Le prototypage virtuel permet aux fonderies<br />
d’abaisser les coûts de développe-<br />
ment produit, réduire les délais de mise<br />
sur le marché et augmenter la qualité des<br />
pièces.<br />
Par ailleurs, en complément des nouvelles<br />
fonctionnalités de la Suite Logicielle de<br />
Fonderie, ESI distribue désormais un outil<br />
de conception de systèmes de coulée en<br />
fonderie sous pression.<br />
Le Centre technique des industries de la<br />
fonderie (CTIF) et ESI Group ont d’ailleurs<br />
signé un accord pour la distribution exclusive,<br />
le support technique et le développement<br />
de Salsa 3D.<br />
Développé par CTIF, cet outil permet de<br />
dimensionner les systèmes d’alimentation<br />
en s’appuyant sur des règles à la fois empiriques<br />
et physiques.<br />
SALSA 3D permet d’équilibrer les pertes<br />
de charges à chaque attaque pour garantir<br />
un débit de métal assurant le même temps<br />
de remplissage pour chaque élément, d’obtenir<br />
l’écoulement désiré, et de transférer<br />
le dessin du système soit dans un logiciel<br />
de simulation, soit pour usiner le moule.<br />
Intérêt de cette solution : d’importantes<br />
réductions de coûts, de délais de développement<br />
et mise au point.<br />
Réduire ses délais<br />
de conception<br />
et de livraison<br />
grâce à un logiciel<br />
La réalisation de prototypes numériques<br />
permet à Škoda Electric d’accroître l’efficacité<br />
de son processus de conception et<br />
de mieux relever les défis actuels en<br />
matière de production. Pour ce faire, ce<br />
fournisseur de commandes électriques de<br />
traction, trolleybus et moteurs de traction<br />
a fait appel à Autodesk, éditeur de logiciels<br />
de conception, d’ingénierie et de divertissements<br />
3D.<br />
La société tchèque a en effet utilisé les<br />
méthodes de prototypage numérique intégrées<br />
au logiciel Autodesk Inventor pour<br />
réduire les délais de livraison et augmenter<br />
l’efficacité de ses processus<br />
de conception.<br />
Dassault Systèmes sur le point d’acquérir Gemcom<br />
Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et<br />
de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), a<br />
annoncé au printemps son intention d’acquérir la société canadienne Gemcom Software International<br />
(Gemcom), un éditeur de logiciels de modélisation et de simulation géologique. Gemcom est également<br />
le leader mondial des solutions logicielles pour le secteur minier. Le montant de l’opération s’élèverait<br />
à environ 360M$.<br />
« Avec l’acquisition de Gemcom, qui vient compléter les capacités offertes par notre plate-forme 3D<br />
Expérience, l’objectif est de modéliser et de simuler notre planète, d’améliorer la prédictibilité, l’efficacité,<br />
la sécurité et la conformité aux normes environnementales dans l’industrie dédiée à l’exploitation<br />
de nos ressources naturelles, a déclaré Bernard Charlès, directeur général de Dassault<br />
Systèmes. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons créé une nouvelle marque, Geovia.<br />
L’approvisionnement en matières premières et la disponibilité à long terme des ressources naturelles<br />
constituent une des préoccupations majeures de notre société. Notre ambition est de fournir des<br />
expériences 3D permettant d’imaginer des innovations durables capables d’harmoniser les produits,<br />
la nature et la vie. Cette annonce représente une avancée significative dans cette stratégie. »<br />
Aussi, avec le logiciel Inventor, l’équipe de<br />
concepteurs de Škoda Electric a développé<br />
des prototypes numériques du moteur. Ces<br />
prototypes ont fourni les données requises<br />
pour acquérir les pièces nécessitant un<br />
long délai d’approvisionnement dès le<br />
début du projet, alors même que les différents<br />
composants étaient en cours de<br />
développement. Résultat, les fournisseurs<br />
ont été impliqués beaucoup plus tôt dans<br />
la phase de développement, ce qui a<br />
permis de rationaliser le processus de<br />
conception du produit et de préparer le<br />
lancement de la production.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 4
Objectif de Maple 16, traiter n’importe quel type<br />
de mathématiques.<br />
Avec Drag-to-Solve, les utilisateurs peuvent résoudre les équations<br />
étape par étape, en faisant simplement glisser les termes<br />
un à un. Ils peuvent également explorer des expressions pour<br />
approfondir leur compréhension du problème et déterminer les<br />
étapes suivantes vers la solution.<br />
Un logiciel intuitif destinés<br />
aux ingénieurs de tests<br />
Smart Popups fait apparaître instantanément pour l’expression<br />
soulignée des identités mathématiques, des tracés, des factorisations,<br />
et bien plus encore, aidant ainsi l’utilisateur à choisir<br />
l’opération suivante à effectuer ●<br />
La société française Adas, filiale du groupe Nexeya, spécialisée<br />
dans les domaines de la mesure, de la télémesure et du conditionnement<br />
de signal, propose désormais un nouveau logiciel<br />
permettant de développer des applications pour moyens d’essais<br />
de laboratoires ou embarqués. Développé en France, ce<br />
nouveau logiciel, nommé Kallisté, est dédié aux ingénieurs d’essais<br />
et s’appuie sur un ensemble de nouveaux concepts permettant<br />
d’envisager le développement de ces applications de manière<br />
intuitive.<br />
Kallisté se programme en langage humain et propose les phrases<br />
adaptées en fonction du contexte. La programmation se fait par<br />
simples opérations de « Drag And Drop », limitant les saisies clavier<br />
au minimum nécessaire. L’utilisateur manipule des volts, des<br />
intensités, des accélérations sans pour autant se soucier de leur<br />
codage informatique (nombres flottants, chaînes de caractères,<br />
etc.).<br />
Une nouvelle version du logiciel<br />
de calcul Maple 16<br />
MaplesoftTM vient de lancer une nouvelle version de son produit<br />
phare, MapleTM, le logiciel de calcul technique des ingénieurs,<br />
mathématiciens et scientifiques. Avec Maple 16, Maplesoft introduit<br />
de nouveaux outils et de nouvelles techniques dans sa collection<br />
Clickable MathTM. Dans cette nouvelle solution logicielle,<br />
Smart Popups et Drag-to-SolveTM associent des assistants,<br />
tuteurs, menus contextuels et autres outils Clickable Math qui<br />
procurent une interface pointer-cliquer pour résoudre, visualiser<br />
et explorer les problèmes mathématiques.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 5
Retour d’expérience<br />
Un logiciel aide à optimiser la forme<br />
des comprimés pour un complément<br />
alimentaire<br />
Asahi Group, fabricant japonais de boissons alcoolisées, de boissons gazeuses<br />
et de compléments alimentaires, a exploité Optimus pour peaufiner la forme<br />
de comprimés afin de faciliter la déglutition des compléments alimentaires.<br />
Des évaluations sensorielles et une modélisation de surfaces de réponse (RSM,<br />
Response Surface Modeling) ont permis à Asahi d’identifier la meilleure forme<br />
de comprimé, tant du point de vue de la conformité que de la facilité de prise.<br />
Cependant, le fait de donner aux comprimés une forme plus arrondie a réduit<br />
aussi la durée de vie des comprimés et celle des machines de poinçonnage<br />
utilisées pour les produire. En simulant la dureté du comprimé et la résistance<br />
du poinçon, les techniques RSM d’Optimus ont révélé un meilleur<br />
compromis de conception entre d’une part, la durée de vie des comprimés et<br />
de l’outillage et, d’autre part, la facilité de déglutition.<br />
Produire des comprimés<br />
plus faciles à avaler<br />
Disponibles dans une multitude de formes,<br />
de couleurs et de saveurs, les comprimés<br />
sont aujourd’hui la forme la plus courante<br />
d’administration de médicaments et de<br />
compléments alimentaires par voie orale.<br />
Compte tenu du fait que les personnes<br />
âgées éprouvent des difficultés à déglutir<br />
les comprimés, il s’est avéré nécessaire<br />
de mettre au point des comprimés faciles<br />
à avaler. C’est ainsi que M. Hideaki Sato,<br />
M. Hideaki Sato a étudié la corrélation<br />
pouvant exister entre les<br />
caractéristiques des comprimés et la<br />
facilité de déglutition.<br />
responsable au Research Laboratories for<br />
Fundamental Technology of Food, Asahi<br />
Group Holdings Ltd., a étudié la corrélation<br />
susceptible d’exister entre chacun des<br />
trois facteurs caractéristiques du<br />
comprimé, à savoir diamètre, rayon de<br />
courbure et épaisseur, et la facilité de<br />
déglutition. Les recherches ont porté sur<br />
des comprimés dont les faces comportaient<br />
un ou deux rayons de courbure.<br />
La surface de réponse générée à partir des<br />
résultats d’évaluation sensorielle a montré<br />
qu’un plus petit diamètre du comprimé ne<br />
favorise pas nécessairement la déglutition.<br />
Compte tenu de la difficulté de modifier le<br />
diamètre des comprimés pour des raisons<br />
de réglementation, il a été décidé que la<br />
Lorsque l’on fabrique des comprimés de<br />
forme plus arrondie, cela diminue leur<br />
dureté ainsi que la durée de vie des<br />
poinçons des presses de production.<br />
solution la plus appropriée consistait à<br />
réduire leur rayon de courbure (c’est-à-dire<br />
à arrondir davantage le comprimé). Cependant,<br />
une telle modification de forme réduit<br />
la dureté du comprimé et diminue la durée<br />
de service de la presse de production.<br />
Simulation de la dynamique<br />
de poinçonnage<br />
des comprimés<br />
La machine à poinçonner les comprimés<br />
fonctionne en continu pour comprimer<br />
instantanément de la poudre par mise en<br />
œuvre de pressions extrêmement élevées.<br />
Les poinçons de la presse à comprimés<br />
subissent en production des niveaux de<br />
contrainte très élevés qui provoquent<br />
parfois des défaillances mécaniques. Si<br />
l’on réduit le rayon de courbure des<br />
comprimés, la forme de la tête du poinçon<br />
devient plus anguleuse et la force de poinçonnage<br />
de l’outil diminue. Pour remédier<br />
aux ruptures de têtes de poinçon, les capacités<br />
de modélisation de surfaces de<br />
réponse (RSM) d’Optimus ont été mises à<br />
contribution pour évaluer la relation<br />
pouvant exister entre la forme du poinçon<br />
et/ou du comprimé et les charges mécaniques<br />
admissibles.<br />
Des simulations avec Ansys ont fourni les<br />
données d’entrée permettant d’effectuer<br />
des évaluations RSM à l’aide d’Optimus.<br />
En règle générale, Optimus permet une<br />
approche de type plan d’expériences (DOE,<br />
Design of Experiments) à même de fournir<br />
l’entrée la plus pertinente pour la phase<br />
de modélisation RSM à venir. Le DOE est<br />
un plan d’expériences virtuel visant à<br />
obtenir un maximum d’informations pertinentes<br />
avec un minimum d’efforts de simulation.<br />
En fonction des résultats du plan<br />
d’expériences virtuel, Optimus applique<br />
une méthode d’interpolation pour créer un<br />
modèle de surface de réponse.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 6
Le graphique de contribution RSM montre que le<br />
critère ayant la plus forte influence sur la charge<br />
admissible est le diamètre du comprimé (D), suivi<br />
par le rapport des rayons (S). Les deux rayons<br />
individuels (R1 et R2) ont montré une influence à<br />
peu près identique.<br />
La méthode RSM d’Optimus a mis en avant un comprimé comportant<br />
un grand rayon de courbure R1 (pour garantir la dureté des comprimés)<br />
et un rayon de courbure R2 plus petit (pour faciliter la déglutition).<br />
C’est le compromis qui répond le mieux aux objectifs fixés.<br />
L’étude des contraintes par la méthode<br />
des éléments finis n’était pas gagnée<br />
d’avance car les comprimés sont un agglomérat<br />
de substances pulvérulentes<br />
compactées par compression. Contrairement<br />
aux structures mécaniques, la forme<br />
et le module d’Young peuvent être très<br />
différents en fonction des charges de<br />
compression. En collaboration avec<br />
Cybernet Systems, le distributeur japonais<br />
d’Ansys et d’Optimus, M. Hideaki Sato a<br />
mis au point une méthode révolutionnaire<br />
de prévision des contraintes subies par un<br />
comprimé. De toute évidence, le module<br />
d’Young du matériau du comprimé ne<br />
pouvait pas être considéré comme constant.<br />
L’équipe a alors extrapolé un module<br />
d’Young variable réaliste en transcrivant<br />
la force de réaction s’exerçant sur la tête<br />
du poinçon lors de la compression d’un<br />
comprimé et en l’utilisant comme une<br />
approche alternative pour définir le module<br />
d’Young de ce dernier. La cohérence de<br />
cette approche avec les résultats expérimentaux<br />
a été validée et a conduit à des<br />
résultats de simulation convenables et<br />
relativement précis. Pour une région allant<br />
du centre au bord du comprimé, le module<br />
d’Young local interne diminue progressivement<br />
tandis que la densité et le risque<br />
de fissure augmentent.<br />
Les chercheurs ont également effectué<br />
des simulations Ansys pour estimer la<br />
capacité de charge de la tête du poinçon.<br />
Ils ont préparé un modèle axisymétrique<br />
2D et défini entre le poinçon et le<br />
comprimé un élément de contact représentant<br />
la tête du poinçon glissant légèrement<br />
sur le comprimé pendant la phase<br />
de compression de la poudre. Dans ces<br />
simulations, les calculs ont été répétés<br />
jusqu’à ce que la contrainte à l’intérieur<br />
du comprimé atteigne la valeur admissible<br />
afin d’identifier la capacité de charge.<br />
Utilisation de la méthode<br />
RSM d’Optimus<br />
pour améliorer la forme<br />
du comprimé<br />
Les résultats de simulation de contraintes<br />
fournis par Ansys ont ensuite été analysés<br />
à l’aide de la méthode RSM d’Optimus. Les<br />
chercheurs ont défini comme critères de<br />
conception le diamètre (D) du comprimé,<br />
les rayons de courbure (R1 et R2) dans<br />
deux directions et le rapport des rayons (S<br />
= R1/R2). Ils ont spécifié que le résultat<br />
de conception visé était l’obtention de la<br />
charge admissible la plus élevée possible.<br />
La surface de réponse a été calculée par<br />
la méthode des moindres carrés en utilisant<br />
un polynôme du second degré. Cette<br />
méthode mathématique détermine la<br />
surface qui s’ajuste le mieux à un<br />
ensemble défini de points de données en<br />
minimisant la somme des carrés des<br />
résidus de points de la surface.<br />
Les surfaces de réponse Optimus ont<br />
montré que la charge admissible du<br />
comprimé à double rayon de courbure est<br />
inférieure à celle du comprimé présentant<br />
un seul rayon de courbure. En outre, la<br />
charge admissible du comprimé à double<br />
rayon de courbure augmente en même<br />
temps que les rayons de courbure R1 et<br />
R2. À partir de l’analyse du modèle de<br />
surface de réponse, les chercheurs ont<br />
constaté que la charge admissible<br />
augmentait en même temps que les différents<br />
critères de conception. Dans l’ordre<br />
décroissant des paramètres les plus<br />
influents, on trouve le diamètre (D), suivi<br />
par le rapport des rayons de courbure (S),<br />
puis les deux rayons individuels (R1 et R2)<br />
qui affichent une influence à peu près<br />
égale. Les surfaces de réponse ont indiqué<br />
qu’un comprimé doté d’un grand rayon de<br />
courbure R1 (pour garantir la dureté des<br />
comprimés) et un rayon de courbure R2<br />
plus petit (pour faciliter la déglutition) représentait<br />
le compromis qui répondait le<br />
mieux aux objectifs d’ensemble. La modélisation<br />
par surfaces de réponse Optimus<br />
révélant des tendances inhérentes dans<br />
l’espace du modèle, lesquelles sont<br />
souvent non linéaires, cette technique est<br />
intéressante pour aider les ingénieurs à<br />
prendre plus rapidement des décisions<br />
mieux étayées et ainsi concevoir des<br />
produits plus durables et répondant mieux<br />
aux souhaits des consommateurs ●<br />
Cette surface de réponse Optimus<br />
montre que le diamètre (D) d’un<br />
comprimé a plus d’influence que le<br />
rapport (S) de ses rayons de courbure.<br />
Une autre surface de réponse Optimus<br />
illustre une influence à peu près égale<br />
des deux rayons de courbure individuels<br />
(R1 et R2) sur la charge admissible.<br />
M. Hideaki Sato<br />
Research Laboratories for Fundamental<br />
Technology of Food,<br />
Asahi Group Holdings Ltd.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 7
En pratique<br />
Application de la thermographie<br />
infrarouge embarquée<br />
en exploitation d’infrastructures<br />
Cet article relate la réalisation d’un travail dont l’objectif était de savoir si<br />
la mise en place d’une caméra thermique pouvait conduire à des résultats<br />
comparables à ceux du radiomètre, et augmenter le rendement de<br />
mesure. Le but étant d’établir la possibilité de mettre en œuvre une caméra<br />
infrarouge sur un véhicule destiné aux signatures thermo-hygrométriques<br />
pour avoir une analyse sur plusieurs voies et sur une zone plus étendue.<br />
Le suivi thermo-hygrométrique des itinéraires,<br />
appelé communément « thermal<br />
mapping » est employé depuis trente ans.<br />
Par la mesure de la température de<br />
surface des chaussées et des paramètres<br />
atmosphériques, la susceptibilité des itinéraires<br />
à la formation de verglas est alors<br />
établie, bien que des modèles numériques<br />
existent aussi. Les mesures sont réalisées<br />
à l’aide d’un véhicule placé dans le trafic<br />
et pour des conditions météorologiques<br />
anticycloniques. Ces mesures servent à la<br />
fois à la construction d’un index de risque<br />
hivernal, et comme donnée d’entrée pour<br />
des modèles numériques de prévision s’appuyant<br />
sur un bilan énergétique. Lorsque<br />
le point de rosée passe sous une température<br />
de surface négative, un risque de<br />
verglas et de perte d’adhérence apparaît.<br />
La température de surface de chaussée<br />
est généralement mesurée par un radiomètre<br />
infrarouge avec une fréquence<br />
spatiale donnée quelle que soit la vitesse<br />
du véhicule.<br />
Pour éviter des artéfacts radiatifs du soleil,<br />
les mesures sont effectuées avant l’aube,<br />
cette période exacerbant le comportement<br />
thermique de la chaussée, là où l’énergie<br />
accumulée par la chaussée termine sa<br />
dissipation par conduction, convection et<br />
rayonnement, et avant d’entamer un<br />
nouveau cycle. Les itinéraires auscultés<br />
sont de plusieurs dizaines de kilomètres<br />
et parfois sur plusieurs voies. Le « thermal<br />
mapping » permet aux gestionnaires d’instrumenter<br />
pour surveillance ou tout simplement<br />
d’installer une signalisation adaptée.<br />
L’environnement routier est également<br />
saisi (ponts, revêtements, zones boisées,<br />
agglomérations,...) pour faciliter l’analyse<br />
ultérieure. Cependant, les itinéraires longs<br />
et à voies multiples demandent énormément<br />
de temps avec un simple radiomètre.<br />
Description<br />
des instruments et<br />
du protocole expérimental<br />
Un radiomètre infrarouge PRT5 de chez<br />
Barnes Pyrometer avec un angle de vue<br />
de 20° a été utilisé. Il était installé dans<br />
un compartiment régulé à 18°C, et l’ensemble<br />
fixé à l’avant du véhicule, 40 cm<br />
environ au-dessus de la surface auscultée<br />
(Cf. Tableau 1). En raison de sa sensibilité,<br />
sa précision et de son NET, cet instrument<br />
a servi de référence. Les paramètres<br />
atmosphériques usuels (température d’air,<br />
humidité relative, pression atmosphérique)<br />
ont été enregistrés. Ils sont fournis par une<br />
sonde atmosphérique SSBC, élaborée pour<br />
fonctionner sur des véhicules en mouvement,<br />
y compris des ailes d’avion.<br />
La caméra thermique était une Flir ® S65,<br />
constituée d’une matrice bolométrique non<br />
refroidie de 320x240 pixels en bande infrarouge<br />
III (Cf. Tableau). La caméra est<br />
installée dans un boîtier fixée côté<br />
passager. Elle est reliée à un ordinateur<br />
par câble firewire IEEE 1394. Elle était<br />
mise en route plus de trente minutes avant<br />
les mesures pour obtenir un conditionnement<br />
optimal de l’électronique. L’angle de<br />
vue de la caméra était tel que l’image thermique<br />
comprenait plusieurs éléments de<br />
la scène, de la surface de chaussée et<br />
jusqu’à la voûte céleste. Dans une telle<br />
configuration, la route est observée selon<br />
un angle presque rasant. Un « miroir » est<br />
installé dans le champ de vision de la<br />
caméra, ainsi qu’une surface recouverte<br />
de Nextel Velvet coating 811-21, dont<br />
l’émissivité est considérée comme stable<br />
et égale à 0.97. Celle du miroir a été<br />
établie à 0.063. En raison de l’angle d’observation<br />
presque rasant, la zone de<br />
mesure de la caméra est située bien audevant<br />
de celle du radiomètre.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 3 8
Figure 1 : Véhicule pour les signatures thermo-hygrométriques, et illustration de mise en œuvre<br />
Il existe donc un décalage en distance<br />
entre la température donnée par le radiomètre<br />
et celle donnée par la caméra au<br />
même moment. Ce décalage en distance<br />
dépend de la zone de l’image thermique<br />
qui sera analysée. Plus cette zone sera<br />
éloignée de l’avant du véhicule, plus le<br />
décalage sera important (Cf. Figure 1). Les<br />
images thermiques produites par la<br />
caméra sont analysées avec le logicel ThermaCam<br />
Researcher 2.9. Plusieurs zones<br />
d’intérêt ont été définies sur le miroir, la<br />
peinture Nextel et la surface de la<br />
chaussée. Cette dernière était telle qu’aucune<br />
interférence thermique liée aux véhicules<br />
n’était incorporée dans la zone<br />
d’intérêt.<br />
Dans la configuration choisie, le décalage<br />
en distance était de douze mètres. Cette<br />
valeur représente la distance entre le point<br />
de mesure du radiomètre et le milieu de<br />
la zone d’intérêt sur l’image thermique.<br />
L’acquisition des données pour les paramètres<br />
atmosphériques se fait tous les 3<br />
m, avec une vitesse inférieure à 110 km/h,<br />
et à l’aide d’une interface développée sous<br />
LabView ® . L’émissivité de la chaussée était<br />
d’abord supposée égale à 1 et devait se<br />
comporter comme un corps noir. Un<br />
ensemble de situations ont été enregistrées<br />
par l’opérateur (ponts, zones<br />
urbaines, forêts, ...) susceptibles de faciliter<br />
l’analyse de la réponse thermique.<br />
Une interface logicielle d’acquisition de<br />
données, également développée sous<br />
LabView ® et utilisant un module spécifique<br />
Flir ® a été élaboré. Le code a été développé<br />
pour opérer en mode «snapshot» pour les<br />
prises de vue. Pour composer avec le<br />
temps d’intégration de la caméra thermique,<br />
les transferts de données, l’acquisition<br />
des images thermiques se fait seulement<br />
tous les douze mètres, à des vitesses<br />
inférieures à 70 km/h et avec le format<br />
natif Flir ® pour les images. Malgré le mode<br />
« snapshot », la matrice microbolomètre et<br />
l’ensemble de l’électronique de la caméra<br />
infrarouge possède un temps d’intégration<br />
de quelques ms. Il engendre un léger effet<br />
de trainée sur les images thermiques<br />
lorsque le véhicule est en mouvement. La<br />
trace induite derrière l’objet s’étend sur<br />
2 pixels pour la configuration de mesure<br />
choisie à 70 km/h. Cet aspect est<br />
compensé par le choix d’une zone d’intérêt<br />
dont la taille excède l’effet de trainée. Les<br />
paramètres atmosphériques mesurés avec<br />
les différents capteurs tels que la température<br />
de l’air, l’humidité relative, sont<br />
utilisés comme paramètres objets d’entrée<br />
sur la caméra thermique lors de l’enregistrement<br />
des images.<br />
Équation 1 :<br />
L mesuré = τ atmosphère .ε chaussée .L chaussée + τ atmosphère .(1 − ε chaussée ).L environnement + (1 − τ atmosphère ).L atmosphère<br />
Équation 2 :<br />
T 4 mesuré = ε chaussée .T 4 chaussée+(1 − ε chaussée ).T 4 environnement<br />
Équation 3 :<br />
WR = 2.WR(Ts ) + WR(Td ),<br />
avec WR(T s ) = 0 si −0.5°C ≤ T s − T s,moyenne
L’itinéraire choisi pour le test avait trente<br />
kilomètres environ de long, avec des<br />
mesures qui duraient près de trente<br />
minutes. Cet itinéraire comportait plusieurs<br />
configurations, avec des 2x1 voies à des<br />
autoroutes à plusieurs voies, des passages<br />
supérieurs et inférieurs, avec et sans forêts<br />
sur le côté. Les mesures ont été conduites<br />
en absence de rayonnement solaire pour<br />
éviter des artéfacts, et avec une légère<br />
couverture nuageuse. Le véhicule est resté<br />
dans la voie la plus à droite en circulation<br />
sur autoroutes. Une distance importante<br />
a été laissée entre le véhicule et celui qui<br />
le précédait pour éviter de prendre en<br />
compte sa signature thermique.<br />
Dans une telle configuration, il existe une<br />
forte variété de matériaux utilisés pour<br />
l’élaboration de la route empruntée. De<br />
plus, avec le vieillissement et l’usure des<br />
revêtements, ainsi que les réparations, de<br />
nombreuses situations différentes ont été<br />
rencontrées tout au long de ces trente kilomètres.<br />
Une émissivité constante pouvait<br />
difficilement être choisie. Son émissivité<br />
peut être considérée comme proche de 1<br />
dans des conditions d’observations proche<br />
de la normale par rapport à la surface de<br />
la chaussée. D’après la littérature consultée,<br />
l’émissivité décroît lorsque l’angle<br />
d’observation s’approche des 90° par<br />
rapport à la normale de la surface considérée.<br />
Cependant, en première approche,<br />
la spécularité de la chaussée a été<br />
négligée. Des différences peuvent survenir<br />
entre les mesures du radiomètre et celles<br />
de la caméra thermique.<br />
Résultats et discussion<br />
Avant tout traitement spécifique ou correction<br />
d’environnement radiatif, un offset est<br />
alors observé entre les mesures données<br />
par les deux instruments, les températures<br />
mesurées par la caméra thermique étant<br />
significativement basses. Cependant, l’allure<br />
des courbes semble similaire. De plus,<br />
les éléments principaux de l’itinéraire tels<br />
que des ponts sont correctement détectés<br />
par les deux instruments. Avant toute<br />
correction, l’amplitude thermique mesurée<br />
avec la caméra (11°C) est supérieure à<br />
celle donnée par le radiomètre (6°C).<br />
L’équilibre radiatif du système peut s’écrire<br />
selon l’équation 1.<br />
Dans la configuration choisie, la distance<br />
maximale entre la caméra et la route, où<br />
une mesure est effectuée, est approximativement<br />
quinze mètres. La situation<br />
météorologique était telle qu’aucun nuage<br />
ni brouillard n’étaient présents durant les<br />
mesures. Le coefficient de transmission<br />
atmosphérique a donc été pris égal à 1.<br />
La contribution de l’atmosphère peut dès<br />
lors être négligée.<br />
Les mesures avec la caméra thermique<br />
ont été effectuées en considérant que les<br />
corps dans son champ de vision étaient<br />
de corps noirs. L’équation 1 devient alors<br />
équation 2 en absence de spécularité. La<br />
luminance de l’environnement radiatif s’obtient<br />
avec un miroir installé dans le champ<br />
de vision de la caméra infrarouge. Comme<br />
expliqué dans les paragraphes précédents,<br />
les mesures sont conduites avec une<br />
caméra présentant un angle rasant par<br />
rapport à la surface de la chaussée. Dans<br />
une telle configuration, l’émissivité est inférieure<br />
aux habituels 0.95-0.98 de matériaux<br />
non métalliques en général et des<br />
bétons bitumineux en particulier. Une émissivité<br />
de 0.77 a été choisie, en cohérence<br />
avec la littérature. Cette valeur permet de<br />
prendre en compte le caractère rasant de<br />
l’observation. Ce choix conduit à faire coïncider<br />
les valeurs issues du radiomètre<br />
infrarouge, choisi comme référence, avec<br />
celles de la caméra thermique. Ainsi, avec<br />
l’équation 2, les corrections d’environnement<br />
radiatif peuvent être obtenues. Une<br />
fois accomplies les corrections d’environnement<br />
radiatif, et celle de distance entre<br />
les deux mesures, on obtient une bonne<br />
concordance des températures mesurées<br />
avec les deux instruments.<br />
Il existe de nombreuses manières de<br />
calculer le risque hivernal (RH, ou WR en<br />
anglais) d’un itinéraire. En France, la<br />
moyenne de certains paramètres (température<br />
d’air, humidité relative, température<br />
de surface de chaussée, point de rosée)<br />
sont communément utilisées pour analyser<br />
le risque d’occurrence d’eau solide.<br />
Le risque hivernal RH est défini selon<br />
l’équation 3.<br />
Une telle approche du risque hivernal n’est<br />
pas optimale. Le choix d’une moyenne de<br />
tout l’itinéraire peut dissimuler des singularités<br />
d’un itinéraire. De plus, si on considère<br />
deux tronçons d’un même itinéraire<br />
analysés à deux moments différents d’une<br />
même saison, un tel calcul ne permet pas<br />
la concaténation. Un calcul avec l’équation<br />
(3) a été entrepris avec les données<br />
de la caméra thermique et les corrections<br />
nécessaire. L’allure globale était respectée<br />
mais avec des différences nettes entre les<br />
deux instruments. Cette différence peut<br />
être aisément expliquée en raison de la<br />
sensibilité de l’expression à la moyenne.<br />
Elle est de 0.7°C avec le radiomètre,<br />
contre 1.3°C pour la caméra Flir, alors que<br />
la moyenne du point de rosée est identique<br />
dans les deux cas.<br />
Les mesures avec la caméra thermique<br />
ont une étendue spatiale donnée. En<br />
raison de l’angle d’observation rasant, les<br />
points les plus lointains de la caméra apparaissent<br />
plus froids que ceux plus proches<br />
du véhicule, la différence atteignant parfois<br />
2°C. Une correction basée sur une distribution<br />
d’émissivité sur la zone d’analyse<br />
de la caméra peut être envisagée, en lieu<br />
et place d’une émissivité constante. Ce<br />
paramètre décroît fortement pour des<br />
angles d’observation inférieurs à 10°<br />
d’angle. Ces effets, combinés à la sensibilité<br />
de la caméra thermique, ont conduit<br />
à exacerber le risque hivernal. Bien que<br />
très courante, cette approche présente<br />
des limites. Bien que les deux instruments<br />
présentent des distributions gaussiennes<br />
de températures, la sensibilité à la moyenne<br />
est nette. Deux mesures distinctes d’un<br />
même tronçon ne permettent pas de<br />
recouvrement en terme de risque hivernal<br />
puisque la moyenne change. De plus,<br />
prendre une moyenne globale est délicat<br />
puisque le comportement thermique local<br />
est le résultat d’un équilibre énergétique<br />
local, et non la conséquence d’évènements<br />
plusieurs kilomètres amont et aval. L’autre<br />
désavantage d’une moyenne globale est<br />
la disparition de prise en compte des<br />
saisons et de l’infrastructure. Le risque<br />
hivernal est nécessairement davantage<br />
marqué en hiver qu’en n’importe quelle<br />
autre saison, bien que le risque de condensation<br />
existe toujours. Cependant une<br />
moyenne globale d’un itinéraire ne reflète<br />
ni les saison, ni les effets d’un pont<br />
communément identifiés comme des<br />
zones préférentielles d’occurrence de<br />
verglas en raison d’un effet convectif<br />
plus marqué.<br />
Afin d’étudier une approche plus appropriée<br />
et plus cohérente du risque hivernal,<br />
une moyenne glissante a été testée, et ce<br />
sur des mesures conduites tout au long<br />
d’une année calendaire. Cette moyenne<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 0
glissante portait sur une distance de 500<br />
m centrée sur chaque point de mesure<br />
(Equation 4).<br />
Une comparaison a été établie pour les<br />
deux approches de calcul du risque<br />
hivernal, et cela pour analyser la cohérence<br />
avec les saisons, et celle avec l’infrastructure<br />
(Figure 3).<br />
(a) risque hivernal classique en fonction de la distance (m),<br />
mesure du 31 janvier 2009<br />
(b) risque hivernal avec moyenne glissante en fonction de la distance (m),<br />
mesure du 2009-01-31<br />
Une différence significative apparaît entre<br />
les deux approches. Avec la moyenne glissante,<br />
le risque hivernal décroît avec le<br />
printemps et l’été. Il existe un risque résiduel<br />
puisque le risque de condensation<br />
est toujours présent. Il est remarquable<br />
que les maximales du risque apparaissent<br />
toujours aux mêmes endroits quelle que<br />
soit la saison. Une cohérence ressort clairement<br />
vis à vis de l’infrastructure, notamment<br />
les ponts. La présence de zones<br />
boisées est également pointée comme<br />
zones à risque en raison d’une humidité<br />
relative plus grande, ou encore en raison<br />
d’une topographie qui bloque le rayonnement<br />
solaire. Ces explications étaient plus<br />
difficiles à trouver avec l’approche classique.<br />
Des calculs supplémentaires ont<br />
été entrepris avec d’autres moyennes glissantes<br />
(250 mètres, 125 mètres) et<br />
confirme les résultats avec 500 mètres,<br />
avec une modification de l’intensité.<br />
Conclusion<br />
et perspectives<br />
La réalisation effectuée, les mesures ont<br />
été comparées à celles issues du radiomètre<br />
PRT5 pour calculer la susceptibilité<br />
d’un itinéraire à l’apparition d’eau solide.<br />
Un itinéraire de trente kilomètres a été<br />
sélectionné, avec différentes configurations<br />
routières (autoroutes, routes urbaines,<br />
ponts, forêts,...).<br />
La caméra infrarouge a été installée sur<br />
un véhiculé dédié à l’auscultation des<br />
routes.<br />
(c) risque hivernal avec moyenne glissante en fonction de la distance (m),<br />
mesure du 2009-08-19<br />
Figure 3 : cohérence du risque hivernal avec les saisons et l’infrastructure<br />
Des corrections radiométriques simplifiées<br />
ont été réalisées pour prendre en compte<br />
l’angle d’observation de la caméra par<br />
rapport à la surface de la chaussée. De<br />
plus, une correction d’offset de distance<br />
a été considérée entre les mesures des<br />
deux instruments.<br />
Une interface LabView ® a été développée<br />
pour l’acquisition de données, avec prise<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 2
en compte des paramètres atmosphériques<br />
et des images thermiques. L’analyse<br />
des températures de surface des deux<br />
instruments a montré des similarités. Une<br />
comparaison a été effectuée sur une zone<br />
située entre les bandes de roulement.<br />
Une fois effectuées les corrections d’émissivité<br />
et d’offset de distance, il existe un<br />
bon accord entre les mesures de températures<br />
de surface de chaussée.<br />
La caméra thermique donne une amplitude<br />
plus importante que le radiomètre.<br />
L’angle d’observation rasant induit une<br />
émissivité plus faible, avec la forme d’une<br />
distribution sur la zone d’intérêt.<br />
Le risque hivernal a été établi de manière<br />
conventionnelle et simple. L’approche avec<br />
une moyenne glissante conduit à une<br />
meilleure cohérence avec les saisons et<br />
l’infrastructure.<br />
En conclusion, la faisabilité de la réalisation<br />
de signatures thermo-hygrométriques<br />
avec une caméra infrarouge a été établie.<br />
Cela améliorerait le rendement de mesures<br />
par l’analyse de plusieurs voies de circulation<br />
en simultané.<br />
La position de la caméra infrarouge mérite<br />
d’être optimisée en fonction de son angle<br />
de vue. Une réduction de la fréquence d’acquisition<br />
des images thermiques de vingtquatre<br />
à douze mètres aiderait l’analyse<br />
des données ●<br />
(1) Cete de l’Est-LRPC Nancy-ERA,<br />
(2) Certes, université Paris Est,<br />
(3) Ifsttar, Macs<br />
M. Marchetti (1) ,<br />
M. Moutton (1) ,<br />
S. Ludwig (1) ,<br />
L. Ibos (2) ,<br />
J. Dumoulin (3)<br />
Bibliographie<br />
1. Thornes, J.E. The prediction of ice formation on motorways in Britain. Unpublished PhD Thesis,<br />
Department of Geography, University of London, UK., 1984.<br />
2. Thornes, J. E. Thermal mapping and road-weather information systems for highway engineers.<br />
Highway Meteorology, A. H. Perry and L. J. Symons, Eds., E and FN Spon, pp. 39–67, 1991.<br />
3. Gustavsson T., Bogren J. Infrared thermography in applied road climatological studies.<br />
International Journal of Remote Sensing 12, pp. 1811–1828, 1991.<br />
4. Belk D.G., «Thermal mapping for a highway gritting network», Ph D thesis, University of Sheffield,<br />
ISBN z0940068, 1993.<br />
5. Shao J., Lister P.J., Pearson H.B., «Thermal Mapping: reliability and repetability», Meteorological<br />
Applications. 3, pp. 325-330, 1996.<br />
6. Shao J., Swanson J.C., Patterson R., Lister P.J., McDonald A.N., «Variation of winter road surface<br />
temperature due to topography and application of Thermal Mapping», Meteorological<br />
Applications, 4, 131-137 (1997).<br />
7. Gustavsson T., Thermal mapping - a technique for road climatological studies. Meteorological<br />
Applications, 6, pp. 385-394, 1999.<br />
8. Chapman, L., Thornes, J.E. & Bradley, A.V. Modelling of road surface temperature from a geographical<br />
parameter database. Part 2: Numerical. Meteorological Applications 8, pp. 421- 436,<br />
2001.<br />
Mesures et Techniques Optiques pour l’Industrie – Lille 2011 Session 5 : Thermographie IR / 6 /<br />
9. Chapman, L. & Thornes, J.E. A geomatics based road surface temperature prediction model.<br />
Science of the Total Environment 360: 68-80, 2006.<br />
10. Chapman L., Thornes J.E., Small-scale road surface temperature and condition variations across<br />
a road profile. Proceedings of the 14th SIRWEC Conference, Prague, 14-16 May 2008<br />
11. Chapman L., Thornes J.E. The influence of traffic on road surface temperatures: implications for<br />
thermal mapping studies. Meteorological Applications 12, pp. 371–380, 2005.<br />
12. Bouilloud L., Martin E., Livet J., Marchetti M. A coupled model to simulate snow behavior on<br />
roads. Journal of Applied Meteorology and Climatology, volume 45, pp.500-516, 2006.<br />
13. Bouilloud L., Martin E., Habets F., Boone A., Le Moigne P., Livet J., Marchetti M., Foidart A.,<br />
Franchisteguy L., Morel S., Noilhan J., Pettré P., Road surface condition forecasting in France.<br />
Journal of Applied Meteorology and Climatology, Volume 48, Issue 12 , pp. 2513- 2527, 2009.<br />
14. Coudert O. Optima : Road Weather Informations dedicated to road sections. XIII e International<br />
PAIC Congress on winter maintenance, Quebec, 8-11 february 2011.<br />
15. Chapman L., Thornes J.E. A geomatics-based road surface temperature prediction model.<br />
Science of the Total Environment 360: pp. 68–80, 2006.<br />
16. Bogren, J., Gustavsson, T., Lindqvist, S. A description of a local climatological model used to predict<br />
temperature variations along stretches of road. Meteorological Magazine, 121, pp. 157-164,<br />
1992.<br />
17. Norrman, J. Slipperiness on roads – an expert system classification. Meteorological Applications,<br />
7, pp. 27-36, 2000.<br />
18. Bouris, D., Theodosiou, T., Rados, K., Makrogianni, M., Koutsoukos, K. and Goulas,<br />
A. Thermographic measurement and numerical weather forecast along a highway road surface.<br />
Meteorological Applications, 17, , pp. 474–484, 2010.<br />
19. http://www.forumgraphic.eu/prod/index.php/Mesure/sonde-basse-couche.html.<br />
20. Ibos L., Marchetti M., Boudenne A., Datcu S., Candau Y., Livet J., Infrared emissivity measurement<br />
device: principle and applications, Meas. Sci. Technol., 17, pp. 2950–2956, 2006.<br />
21. Dactu S., Ibos L., Candau Y., Mattei S., Improvement of building wall surface temperature measurements<br />
by infrared thermography, Infrared Physics & Technology, 46, pp. 451-467, 2005.<br />
22. Maldague X.P.V., Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing, John<br />
Wiley & sons, Inc., 684 p, 2001.<br />
23. Gaussorgues G., La thermographie infrarouge. Techniques et Documentation (France), 386 p.,<br />
1981.<br />
24. Handbook of Military Infrared Technology, Office of Naval Research Department of the Navy<br />
(Washington D.C., USA), 906 p,1965.<br />
Mesures et Techniques Optiques pour l’Industrie – Lille 2011 Session 5 : Thermographie IR / 7<br />
25. Marchetti M., Ibos L., Valérie Muzet, Pitre R., Boudenne A., Datcu S., Candau Y., Livet J.,<br />
Emissivity Measurements of Road Materials, QIRT Journal, Volume 1, Issue 1, pp. I.2.1- I.2.7,<br />
2004.<br />
26. J. Dumoulin, V. Boucher, F. Greffier. Numerical and experimental evaluation of road infrastructure<br />
perception in fog and/or night conditions using infrared and photometric vision systems. SPIE<br />
International Symposium on Optical Engineering + Applications: Session Infrared Spaceborne<br />
Remote Sensing and Instrumentation XVII (OP501), San Diego, USA, 2-6 August 2009.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 3
Dossier<br />
Préface<br />
Le sud-ouest de la France,<br />
une terre riche en moyens d'essais<br />
Pour le grand public, le sud-ouest est surtout connu pour ses<br />
vins, sa gastronomie, ses plages et sa forêt des Landes.<br />
Il dispose aussi, mais c’est moins connu, d’une industrie de<br />
très haute technologie, essentiellement dans les domaines<br />
de l’aéronautique, du spatial et de l’optique laser, basée<br />
sur une composante financée dans le cadre d’activités civiles<br />
(avec Airbus, Safran, Dassault et le Cnes comme grands<br />
donneurs d’ordre) et une composante Défense, issue des<br />
programmes liés à la dissuasion nucléaire (avec la DGA, EADS<br />
et le CEA).<br />
Pour maitriser les produits de leur responsabilité, ces organismes<br />
se sont équipés au cours du temps de moyens de<br />
calcul (matériels et logiciels) et d’essais très performants<br />
permettant de maîtriser la physique de l’extrême et de devenir<br />
des leaders mondiaux dans leur domaine (aviation, turbomoteurs<br />
d’hélicoptères, lanceurs, satellites, lasers…).<br />
Deux grands pôles de compétitivité (Aerospace-Valley et Route<br />
des Lasers), associés à des pôles non régionaux (Systematic,<br />
Astech, Pegase…), permettent de développer des projets<br />
communs de recherche entre les grands groupes, les laboratoires<br />
et les PME-PMI.<br />
Nous présentons dans ce dossier quelques activités réalisées<br />
dans le grand Sud-Ouest dans le domaine des essais<br />
et simulations numériques.<br />
• 2ADI présente la plate-forme PROMEA, un site Web ouvert,<br />
permettant de connaître l’ensemble des moyens expérimentaux<br />
disponibles en Aquitaine,<br />
• Astrium met en avant ses moyens de tomographie X,<br />
permettant d’atteindre une résolution de quelques dizaines<br />
de mm sur des objets de plusieurs m3.<br />
• Le CEA–Cesta nous fait visiter ses moyens d’essais<br />
accidentels (lanceurs, tours de chute, fosses<br />
à incendie) du TEE utilisés pour la tenue au crash<br />
de conteneurs et de véhicules.<br />
• Metexo décrit la plate-forme de services Mosart<br />
(dont le démonstrateur avait été présenté dans le<br />
N°99 de la revue), une opportunité pour les PME<br />
d’accès depuis leur entreprise et au juste besoin<br />
à la simulation numérique et aux services associés.<br />
• Turbomeca montre quelques exemples de simulation<br />
pour la mise au point d’un turbomoteur<br />
•Algotech décrit la démarche et les outils de compatibilité<br />
électromagnétique (CEM) disponibles pour<br />
l’aide à la conception de torons de câbles dans un<br />
environnement industriel.<br />
Tous ces outils et moyens ne sont qu’un échantillon des<br />
travaux effectués dans le sud-ouest. Ils montrent le dynamisme<br />
des entreprises et leur volonté d’être toujours à la<br />
pointe des développements. Des contacts directs peuvent<br />
être pris pour des informations plus précises (cf. tableau cidessous)<br />
Jean-Paul Prulhière .Metexo Eng.<br />
Entreprise Correspondant Mail<br />
2ADI Bertrand Deraigne b.deraigne@aquitaine-dev-innov.com<br />
ALGOTECH Jacques Père-Laperne j.perelaperne@algotech.fr<br />
ASTRIUM Patrick Jamain Patrice.jamain@astrium.eads.net<br />
CEA-CESTA Michel Guidon michel.guidon@cea.fr<br />
METEXO Jean-Paul Prulhière jean-paul.prulhiere@laposte.net<br />
TURBOMECA Eric Seinturier Eric.seinturier@turbomeca.fr<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 4
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 5
Dossier<br />
Équipements<br />
Stéréo-corrélation d’images<br />
numériques : deux ans d’utilisations<br />
variées sur les essais aéronautiques<br />
DGA Techniques Aéronautiques (DGA-TA), anciennement Centre d’essais<br />
aéronautiques de Toulouse (CEAT) a pour mission d’assurer la sécurité des<br />
aéronefs grâce à des essais et des expertises dans des domaines très<br />
variés comme les essais de structure (statique, fatigue, impact) ou les<br />
essais environnementaux (climatiques, électromagnétique, agression<br />
foudre). Pour améliorer ces prestations, le CEAT s’est doté en 2009 d’un<br />
appareil de mesure par stéréo-corrélation d’images numériques (ou DIC<br />
pour Digital Image Correlation) Aramis ® produit par la société GOM.<br />
Après une période de caractérisation<br />
métrologique et de prise en main sur les<br />
essais mécaniques, ce moyen a été utilisé<br />
en tant que capteur de champs de déplacements<br />
sur d’autres plateformes d’essai.<br />
Ainsi cette technique de mesure a permis<br />
de fournir des données quantitatives<br />
jusque là inaccessibles et a permis d’ouvrir<br />
de nouveaux domaines d’études. Dans<br />
cet article, sont détaillées les expérimentations<br />
pour la caractérisation de plaques<br />
composites aux effets de la foudre et pour<br />
l’étude du comportement des voiles de<br />
parachute.<br />
Présentation succincte<br />
de la technique de mesure<br />
par stéréo-corrélation<br />
d’images numériques<br />
Du point de vue des utilisateurs industriels,<br />
la technique de mesure par stéréo-corrélation<br />
se présente sous la forme d’un<br />
capteur optique doté de deux caméras<br />
accompagné d’un logiciel de configuration<br />
et de traitement de données. Le spécimen<br />
doit être préalablement recouvert d’un<br />
motif type mouchetis.<br />
Des paires d’images successives sont<br />
prises au cours de l’essai, lors de la sollicitation<br />
de l’éprouvette. Les résultats<br />
obtenus sont, à chaque prise de vue, la<br />
forme 3D du spécimen, les champs de<br />
déplacements et des champs de déformations.<br />
Les applications typiques de cette technique<br />
sont la mesure de champs de déplacements<br />
et de déformations sur des essais<br />
de matériaux. La mesure de champ de<br />
déplacement permet par exemple de<br />
détecter, localiser, et mesurer un phénomène<br />
de cloquage sur une structure avion<br />
lors d’un essai statique de structure avion<br />
(figure 1 et 2).<br />
Les courbes de la figure 2 représentent le<br />
déplacement des trois sections (visibles<br />
sur la représentation 3D de droite) au<br />
cours d’un chargement de l’état initial<br />
(courbe du bas) à l’état final (courbe du<br />
haut). On peut observer sur la section<br />
médiane ainsi que sur la vue 3D que la<br />
peau de l’avion présente bien un relief. Ce<br />
cloquage apparaît lors du septième niveau<br />
Figure 1 : Capteur et zone de mesure<br />
sur l’aéronef<br />
Figure 2 : Résultat des mesures par DIC<br />
sur un essai statique de structure<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 6
Dossier<br />
de chargement. Ces mesures de déplacements<br />
ont permis de comprendre le<br />
comportement des mesures de contrainte<br />
sur la structure avion, qui apparaissaient<br />
au même niveau de chargement sur les<br />
essais précédents.<br />
Caractérisation<br />
métrologique du moyen<br />
de mesure<br />
Le moyen de mesure Aramis ® a été caractérisé<br />
métrologiquement à DGA-TA pour<br />
les mesures de champs de déplacements.<br />
Le mode opératoire a consisté à déplacer<br />
un objet rigide préalablement moucheté,<br />
sur la tête d’une machine à mesurer tridimensionnelle.<br />
Pour les grandes surfaces<br />
de mesure, le banc d’étalonnage était<br />
constitué d’un interféromètre laser mesurant<br />
le déplacement rectiligne d’un objet<br />
moucheté. Cette caractérisation a été<br />
menée pour l’ensemble des configurations<br />
optiques utilisées à DGA-TA (caméras<br />
rapides, objectifs, et taille de zone de prise<br />
de vue). Cela a aussi permis de déterminer<br />
certains facteurs d’influence sur la qualité<br />
de la mesure et d’améliorer le mode opératoire<br />
expérimental.<br />
Tableau 1 : Exemple d’incertitudes de mesure proposées en essai<br />
Figure 3 : Vue globale d’une installation DIC sur un essai de foudroiement<br />
À titre d’exemple, des incertitudes de<br />
mesures proposées en essai sont présentées<br />
dans le tableau 1. Ces incertitudes<br />
sont supérieures à la justesse constatée<br />
lors des étalonnages en laboratoire pour<br />
prendre en compte l’environnement de<br />
l’essai.<br />
Caractérisation<br />
de matériaux composites<br />
à l’effet direct foudre<br />
DGA-TA dispose de plusieurs générateurs<br />
de courant et de tension pour évaluer l’endommagement<br />
des systèmes avion à la<br />
foudre. Le générateur Super Dicom permet<br />
de reproduire les trois phases d’une agression<br />
foudre, dont l’onde A qui atteint<br />
250 kA en 10 µs.<br />
Une étude sur le comportement des<br />
composites au foudroiement en fonction<br />
de leur composition, de leur protection et<br />
de l’épaisseur de la peinture nécessitait<br />
de mesurer la déflexion de la plaque juste<br />
après l’impact.<br />
Le dispositif mis en place (Cf. figure 3)<br />
consistait à filmer la face arrière de la<br />
Figure 5 : Résultats de DIC lors d’un essai de foudroiement<br />
plaque à l’aide de deux caméras rapides.<br />
Ce capteur était préalablement calibré<br />
pour que les images soient traitées par<br />
Aramis ® . Les caméras sont des caméras<br />
Photron APX de résolution 250 Kpx à 6000<br />
images par seconde. La plaque mesurant<br />
une trentaine de centimètres de diamètre<br />
est encastrée dans un bâti d’essai.<br />
Une première phase d’essais a permis de<br />
valider la représentativité du mode de sollicitation<br />
sur des éprouvettes identiques<br />
d’aluminium de 2 mm. Différents paramètres<br />
ont été modifiés : fixations, distance<br />
entre l’électrode d’injection et l’éprouvette,<br />
polarité, etc. Les tirs étaient identiques, à<br />
(200kA±10% / 2×106A 2 .s±20%).<br />
Une fois que le mode opératoire a été<br />
validé, les essais ont permis d’évaluer des<br />
matériaux de type CFPR (Carbon Fibre<br />
Reinforced Plastic) en fonction de l’épaisseur<br />
d’une peinture aéronautique (100 ou<br />
300 µm) et de la protection. Les protections<br />
étaient du Bronze Mesh (BM) 65g/m 2<br />
ou de l’Expanded Aluminium Foil (EAF)<br />
90g/m 2 .<br />
Les résultats de la DIC exploités sont principalement<br />
le déplacement d’une section<br />
de la plaque (section positionnée sur un<br />
diamètre) et le déplacement maximal du<br />
centre de la plaque (Cf figure 5).<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 7
Dossier<br />
La courbe du haut représente la forme<br />
de 3 sections à un instant t. On peut<br />
observer la présence de modes d’oscillation.<br />
La courbe du bas représente le déplacement<br />
(en mm) du point de central de la<br />
plaque au cours du temps (en ms). La<br />
visualisation 3D de droite représente la<br />
cartographie 3D des déplacements lors de<br />
la déflexion maximale.<br />
Cette campagne d’essais a permis de<br />
constater que :<br />
- la déflexion maximale augmentait avec<br />
l’épaisseur de la peinture<br />
- sans peinture, la déformation d’une<br />
éprouvette protégée avec de l’EAF<br />
90g/m 2 est sensiblement inférieur à celle<br />
protégée par du BM 65 g/m 2<br />
- avec de la peinture, la déformation est<br />
supérieure avec une protection type EAF<br />
90g/m 2 .<br />
Ces données ont été accessibles grâce à<br />
la DIC. D’autres techniques de mesure de<br />
déplacement pour les essais foudre existent,<br />
mais ne permettent pas d’obtenir une<br />
mesure globale et sont lourdes à mettre<br />
en œuvre. Ces techniques de mesure ont<br />
validé les mesures par DIC sur la mesure<br />
de la déflexion maximum.<br />
L’utilisation de la DIC pour cette application<br />
est toutefois limitée par le couple<br />
cadence des caméras. Nous ne pouvons<br />
pas, pour le moment, mettre en évidence<br />
des phénomènes dynamiques se produisant<br />
au-delà de 3 kHz.<br />
<strong>Essais</strong> d’une voile<br />
de parachute en soufflerie<br />
impulsionnelle<br />
Le système de mesure par DIC a aussi été<br />
utilisé sur l’installation « Wind Blast » de<br />
DGA-TA. Cette installation permet de<br />
générer des rafales d’air de 300 m/s en<br />
100 ms, avec un pallier de 500 ms. La<br />
soufflerie impulsionnelle Wind Blast sert<br />
à tester par exemple des équipements<br />
pilotes (casque, masque) dans des conditions<br />
d’éjection pilote. La mesure par<br />
Stéréo-corrélation s’est greffée à une<br />
campagne d’essai sur l’extraction d’un<br />
parachute à une vitesse d’air de 50 m/s.<br />
Cette opération s’est déroulée dans le<br />
cadre d’une étude de faisabilité pour<br />
mesurer en vol la forme d’une voile de<br />
parachute. A terme, les résultats viendront<br />
Figure 6 « Installation DIC au Wind<br />
Blast »<br />
alimenter les modèles de simulation aérodynamique<br />
utilisée par DGA-TA.<br />
L’installation d’essai est constituée d’un<br />
couple de caméras rapides (1 MPx à 1000<br />
images/secondes) disposé à plus de deux<br />
mètres de hauteur. La zone d’intérêt mesure<br />
1 mètre cube. Les caméras ont été disposées<br />
à l’arrière de la voile, à une certaine<br />
distance de la buse d’air pour ne pas que le<br />
capteur se décalibre (Cf. figure 6).<br />
Cet essai de faisabilité a servi à valider<br />
une partie de l’aspect expérimental :<br />
- peinture du mouchetis sur tissu et résolution<br />
spatiale des résultats<br />
- mesure sur des matériaux très souples<br />
- grande surface de mesure<br />
- éclairage naturel<br />
Le mouchetis a été créé grâce à des stylos<br />
indélébiles noirs, avec des tâches de 10<br />
mm. La résolution spatiale des résultats<br />
est suffisante pour cette application.<br />
Le logiciel de traitement d’images arrive<br />
bien à déterminer la forme du parachute<br />
à chaque instant et à suivre ses différentes<br />
parties au cours de son déplacement dans<br />
la veine d’air (Cf figure 7).<br />
Pour une application en vol, d’autres points<br />
sont à lever dont le principal est le positionnement<br />
des caméras par rapport à la<br />
voilure, le conditionnement du capteur, et<br />
Bibliographie<br />
Figure 7 « Forme d’un parachute<br />
d’extraction lors de son déploiement »<br />
de la grande dimension de la zone d’intérêt.<br />
Conclusion<br />
Les quelques exemples qui ont été<br />
présentés montrent la diversité des applications<br />
dans lequel le moyen de mesure<br />
a été utilisé à DGA-TA. Des expérimentations<br />
ont été moins concluantes que<br />
prévues, comme les essais dynamiques<br />
de structure. En effet, des débris viennent<br />
altérer la vision des spécimens de mesure.<br />
La qualité de la mesure de déplacement<br />
a été quantifiée par une série de manipulation<br />
pour la majorité des cas d’applications<br />
du moyen, en vidéo haute résolution<br />
et en vidéo rapide. Une étude de caractérisation<br />
du moyen en déformation reste à<br />
mener.<br />
Enfin, le potentiel d’utilisation à DGA-TA va<br />
encore être augmenté grâce au couplage<br />
de ce système avec un appareil de mesure<br />
par photogrammétrie qui permettra de<br />
faire des mesures en multi-capteurs sur<br />
des plus grandes zones de mesure. L’achat<br />
en cours de nouvelles caméras rapides<br />
permettra d’augmenter la cadence de prise<br />
de vue pour les essais dynamiques ●<br />
Christophe Larrieu, Christophe<br />
Simond et Frederic Lago<br />
(DGA Techniques Aeronautiques)<br />
[1] M.A. Sutton, J.-J. Orteu, H.W. Schreier, Image Correlation for Shape, Motion and Deformation<br />
Measurements - Basic Concepts, Theory and Applications, 364 p. 100 illus. Hardcover, Springer,<br />
2009. ISBN 978-0-387-78746-6.<br />
[2] F. Lago, G. Fontaine, C. Larrieu, P-Q. Elias, L. Chemartin, P. Lalande, Measurement by a digital<br />
image correlation technique of the deflection of panels submitted to lightning impulse, Icolse<br />
2011.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 8
Dossier<br />
Tendances<br />
Nouveaux challenges en simulation<br />
numérique pour la conception de<br />
turbomoteurs moins polluants<br />
Avec les préoccupations environnementales croissantes et la raréfaction<br />
des ressources pétrolières, l’amélioration de la performance énergétique<br />
des produits aéronautiques est devenue la priorité des industriels du<br />
secteur. En dix ans, l’industrie aéronautique a pris l’engagement de réduire<br />
la consommation de carburant de 20% et de 50% des émissions (NOx,..).<br />
À plus long terme, des recherches ont démarré pour remplacer les combustibles<br />
fossiles par des alternatives plus écologiques et pour rechercher des<br />
concepts de propulsion nouveaux. La simulation numérique intensive est<br />
devenue un outil indispensable pour répondre à ces objectifs très ambitieux<br />
dans un délai aussi court.<br />
Les motoristes aéronautiques sont des<br />
contributeurs clés à la réduction de la<br />
consommation et de la pollution du trafic<br />
aérien. Dans ce cadre, la démarche de<br />
Turbomeca pour développer des moteurs<br />
plus écologiques est basée selon 3 axes<br />
principaux de recherche portant sur :<br />
- Une meilleure efficacité, par amélioration<br />
du rendement du moteur en optimisant<br />
le cycle thermodynamique, c’est-à-dire<br />
en augmentant le rapport de pression.<br />
Cela implique le développement de<br />
compresseurs plus fortement chargés et<br />
de turbines plus chaudes. Ces composants<br />
sont très sollicités mécaniquement<br />
et thermiquement mais doivent être<br />
fiables et sûrs. Leur conception est donc<br />
fortement contrainte.<br />
Architecture typique d’un turbomoteur<br />
- Une réduction de la masse, obtenue en<br />
diminuant le volume du moteur et en<br />
augmentant la température de fonctionnement.<br />
En effet, la puissance d’un<br />
moteur est directement liée à son débit<br />
massique et à la température d’entrée<br />
de turbine (TET). Pour un objectif de puissance<br />
donné, une augmentation de la<br />
TET permet de réduire le débit massique<br />
à travers le moteur, c’est-à-dire sa taille<br />
et par conséquence sa masse. Le point<br />
dur est de garantir la durée de vie des<br />
structures chaudes, principalement de la<br />
turbine haute pression, juste en aval de<br />
la chambre de combustion. L’optimisation<br />
de masse de tous les composants<br />
du moteur est effectuée par des simulations.<br />
- Une réduction des émissions de NOx, CO,<br />
CO 2 et particules, en développant des<br />
chambres de combustion adaptées aux<br />
mélanges pauvres en carburant sans<br />
compromis sur l’opérabilité (stabilité de<br />
flamme, performance d’extinction et d’allumage).<br />
Bien entendu, ces améliorations permettant<br />
de réduire l’impact environnemental<br />
des systèmes de propulsion pèsent fortement<br />
sur leur conception. Avec ces<br />
contraintes, les composants sont globalement<br />
plus chargés et des simulations avancées<br />
sont systématiquement requises car :<br />
- les marges de conception sont réduites<br />
et doivent donc être évaluées avec précision,<br />
- de nouveaux phénomènes physiques,<br />
notamment instationnaires et fortement<br />
couplés font leur apparition.<br />
- chaque détail géométrique local peut<br />
avoir un impact significatif sur le comportement<br />
du moteur complet<br />
- les interactions entre les phénomènes de<br />
différentes disciplines deviennent significatives<br />
Cela induit une complexité croissante des<br />
simulations liées aux aspects multiphysiques<br />
(plus de degrés de liberté par<br />
point d’intégration, modèles de couplage),<br />
instationnaires (résolution temporelle, non<br />
harmonique) et multi-échelles (d’avantage<br />
de points d’intégration) nécessitant des<br />
centres de calcul de grande puissance<br />
(HPC High Performance Computing).<br />
Cet article illustre ces différents aspects à<br />
travers quatre exemples choisis en suivant<br />
le flux d’air dans le turbomoteur :<br />
- les simulations aérodynamiques dans les<br />
compresseurs<br />
- la conception des chambres de combustion<br />
(états stables et instables)<br />
- la simulation aérothermique dans les<br />
turbines<br />
- la conception mécanique des blindages<br />
de turbine<br />
<strong>Simulations</strong><br />
aérodynamiques<br />
dans les compresseurs<br />
Les performances des compresseurs,<br />
caractérisées par l’efficacité du composant,<br />
le débit, l’opérabilité (la capacité à<br />
accélérer) et taux de compression (rapport<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 4 9
Dossier<br />
entre la pression en sortie du compresseur<br />
et la pression d’admission à l’entrée du<br />
moteur) sont très sensibles aux détails<br />
géométriques. Ces effets technologiques<br />
très localisés sont par exemple les jeux de<br />
fonctionnement (entre les parties fixes et<br />
mobiles), les rayons de raccordement entre<br />
les pales et les disques, les interactions<br />
entre le flux principal et le flux secondaire,<br />
etc. Bien que locaux, ils impactent à<br />
l’ordre 1 les performances globales du<br />
compresseur.<br />
Par ailleurs, le fait de pousser la charge<br />
aérodynamique des compresseurs expose<br />
ceux-ci à des phénomènes instationnaires<br />
violents, souvent non-synchrones, générant<br />
de fortes vibrations.<br />
La conception de ces composants nécessite<br />
donc de modéliser à la fois le compresseur<br />
complet (vaste domaine) et les détails<br />
technologiques (petite taille).<br />
Les équations tridimensionnelles en écoulement<br />
visqueux avec modélisation de la<br />
turbulence, doivent être résolues sur ces<br />
immenses domaines décomposés en<br />
plusieurs millions de cellules, idéalement<br />
avec des approches instationnaires. Cela<br />
revient à cumuler quasiment toutes les<br />
difficultés du calcul numérique.<br />
Conception des chambres<br />
de combustion<br />
Les nouvelles conceptions de chambre de<br />
combustion doivent couvrir un large éventail<br />
de conditions d’exploitation. Leur modélisation,<br />
en particulier à la limite du<br />
domaine de vol ou pendant les phases<br />
transitoires, est un défi pour les modèles<br />
physiques et les méthodes numériques.<br />
- Tout d’abord, la physique de formation<br />
du mélange air-carburant doit être intégrée<br />
par une analyse de l’injecteur (instationnaire,<br />
diphasique, visqueux)<br />
- Puis la simulation aérothermique doit<br />
coupler le flux principal et le flux de dilution,<br />
pour déterminer le comportement<br />
de la flamme et les champs de température<br />
générés. Bien sûr, le comportement<br />
flamme est fortement couplé aux<br />
champs de température / pression dans<br />
la chambre de combustion.<br />
- Ces champs de température sont ensuite<br />
transportés à la sortie de la chambre de<br />
combustion et utilisés pour déterminer<br />
les champs de température sur les<br />
composants de la turbine située en aval.<br />
- Enfin, le comportement instationnaire de<br />
Figure 1 - Simulation d’équilibre de la combustion dans une chambre -<br />
Les champs de température<br />
la chambre de combustion doit être<br />
étudié afin de déterminer sont comportement<br />
transitoire, aux limites du domaine.<br />
Il faut en particulier veiller à ce<br />
qu’aucun des phénomènes instationnaires<br />
n’apparaisse sur la plage de fonctionnement<br />
du moteur (les chambres de<br />
combustion produisant des faibles<br />
niveaux de NOx sont plus sensibles à ces<br />
phénomènes).<br />
Deux exemples sont présentés ici, concernant<br />
le couplage aéro-thermo-chimique<br />
dans la chambre et les comportement<br />
instationnaire haute fréquence.<br />
Couplages<br />
aéro-thermo-chimique<br />
Pour atteindre les cycles thermodynamiques<br />
plus efficaces, il est nécessaire<br />
d’augmenter le rapport pression / température<br />
en entrée de turbine, ce qui entraine<br />
de facto l’augmentation de la charge thermique<br />
dans la chambre de combustion.<br />
De plus, l’emploi de technologies à faible<br />
NOx impose d’utiliser plus d’air pour la<br />
combustion et moins pour le refroidissement<br />
que les chambres conventionnelles.<br />
Ainsi, le refroidissement de la chambre de<br />
combustion nécessite la réalisation d’études<br />
spécifiques. L’utilisation de simulations<br />
avancées avec des moyens de calcul<br />
haute performance (HPC) est devenue<br />
indispensable.<br />
A titre d’exemple, une simulation avancée<br />
3D d’un secteur de chambre de combustion<br />
est présenté sur la figure 1. Afin de<br />
traiter précisément le refroidissement des<br />
parois de la chambre de combustion, tous<br />
les trous d’injection ont été inclus dans<br />
la simulation. Ceci conduit à un maillage<br />
de 13 millions de cellules tétraédriques.<br />
Avec cette technique, il est possible :<br />
- d’avoir une carte précise des charges<br />
thermiques sur les parois refroidies.<br />
- de mieux prendre en compte l’interaction<br />
entre les jets produits par les trous de<br />
refroidissement et le flux principal,<br />
- et donc de prédire plus précisément la<br />
carte de la température à la sortie de<br />
combustion, ce qui est dimensionnant<br />
pour la durée de vie des pales de turbine.<br />
Le code utilisé pour cette simulation<br />
comporte de nombreux modèles physiques<br />
: mélange de flux, pulvérisation, interactions<br />
pulvérisation / flux, combustion,<br />
interactions turbulence / combustion, flux<br />
de convection sur la paroi. Il est basé sur<br />
un modèle de turbulence de Navier Stokes<br />
Moyenné (RANS : Random Averaged Navier<br />
Stokes). Développé pour des machines<br />
massivement parallèles, il a permis de<br />
réaliser le calcul présenté sur les 8200<br />
coeurs du CEA-CCRT (Commissariat à<br />
l’énergie atomique). Il a nécessité l’utilisation<br />
simultanée de 100 processeurs en<br />
parallèle pendant environ 72 heures pour<br />
simuler un dixième de la chambre de<br />
combustion.<br />
Si le comportement global de la chambre<br />
est bien représenté, cette formulation est<br />
mal adaptée pour prédire précisément les<br />
interactions locales (en régime très turbulent)<br />
entre les trous de refroidissement<br />
et le flux principal. Une approche plus<br />
précise est possible grâce à des codes<br />
de simulation instationnaires spécifiques,<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 0
Dossier<br />
Figure 2 - Détails de la géométrie:<br />
Secteur de combustion (à gauche)<br />
et vrille (à droite)<br />
comme celui utilisé dans l’application<br />
suivante, mais ces techniques sont encore<br />
très coûteuses en termes de CPU).<br />
Figure 3 - maillage de calcul<br />
La simulation<br />
du comportement<br />
instationnaire dans<br />
la chambre de combustion<br />
Le comportement instationnaire de la<br />
chambre de combustion doit être étudié<br />
afin de déterminer si la flamme est stable<br />
sur la pleine plage de fonctionnement du<br />
moteur. Des études récentes ont démontré<br />
la capacité et la précision de simulations<br />
turbulentes aux grandes échelles (LES<br />
Large Eddy Simulation) pour calculer les<br />
problèmes fortement turbulents et instationnaire<br />
dans les chambres de combustion<br />
aéronautiques [Figures 1, 2].<br />
Cependant, en raison des coûts de calcul,<br />
ces études sont souvent limitées à des<br />
géométries simplifiées (par exemple<br />
secteur de chambre avec un seul injecteur).<br />
Des études [3-5] ont montré que<br />
cette simplification ne permettait pas de<br />
prendre en compte les interactions entre<br />
les injecteurs et les propagations azimutales<br />
des phénomènes physiques.<br />
Le cas présenté ici est un calcul LES réalisé<br />
sur une chambre de combustion complète.<br />
Pour réduire la dépendance des résultats<br />
aux conditions limites appliquées, tous les<br />
éléments caractéristiques de la géométrie<br />
ont été pris en compte, sur 360°.<br />
Cette approche fait de cette simulation une<br />
première mondiale. La configuration se<br />
compose de 15 secteurs identiques contenant<br />
chacune un injecteur de pré-vaporisation<br />
à mélange pauvre (Lean Premixed<br />
Prevaporised) comme le montre la figure 2.<br />
Le domaine complet de calcul se compose<br />
de plus de 42 millions de cellules tétraédriques<br />
et 8 millions de nœuds comme le<br />
montre la Figure 3.<br />
Les simulations ont été réalisées par<br />
l’équipe CFD du CERFACS (Toulouse,<br />
France), avec le code AVBP sur le supercalculateur<br />
Mare-Nostrum situé à Barcelone,<br />
Espagne (10.240 processeurs<br />
fonctionnant à 2,3 GHz).<br />
Tous les résultats présentés sont obtenus<br />
avec :<br />
- Un algorithme de troisième ordre pour<br />
intégrer les équations LES,<br />
- un modèle Smagorinsky pour la turbulence,<br />
- un modèle dynamique de la flamme<br />
comportant une chimie simplifiée du kérosène.<br />
Lla vaporisation du kérosène est<br />
supposée instantanée de sorte que seul<br />
le flux gazeux est calculé (calcul monophasique).<br />
Un champ de température calculé sur la<br />
structure complète (360°) est présenté<br />
en figure 4. Il montre clairement le caractère<br />
non-axisymétrique de l’écoulement.<br />
Figure 4 - Champ de température<br />
dans la chambre de combustion<br />
L’analyse de la pression dans la chambre<br />
de combustion indique la présence d’un<br />
mode acoustique à 600Hz se propageant<br />
azimutalement, également identifié dans<br />
les résultats expérimentaux obtenus par<br />
ailleurs. Chaque injecteur réagit à la<br />
présence de ce mode acoustique. L’interaction<br />
entre ce mode et chaque injecteur<br />
modifie localement les conditions de<br />
combustion conduisant à des résultats<br />
significativement différents de ceux<br />
obtenus dans un calcul sur un seul secteur<br />
LES dans les mêmes conditions.<br />
Plus de 700 000 pas de temps ont été<br />
calculés (5,4 s / itération sur 256 processeurs).<br />
Plus de 200 Gb de données (avec<br />
2,5 Gb stockées par pas de temps) ont été<br />
enregistrées. 5 configurations ont été simulées.<br />
Elles ont nécessité 10 jours de calcul<br />
sur 256 processeurs en parallèle, et<br />
montré que ce type de calcul est maintenant<br />
accessible dans le cadre d’un développement<br />
moteur.<br />
<strong>Simulations</strong><br />
aérothermiques<br />
dans les turbines<br />
La turbine est le composant situé juste en<br />
aval de la chambre de combustion : elle<br />
est donc soumise aux températures<br />
extrêmes des gaz de combustion, qui<br />
dépassent largement la température limite<br />
supportable par les matériaux qui la constituent.<br />
Il est donc nécessaire de refroidir<br />
la structure de la turbine avec l’air « frais»<br />
(500°) prélevé en sortie du compresseur.<br />
L’efficacité des turbomoteurs étant liée<br />
aux rapports de pression et aux températures,<br />
chaque nouvelle génération de<br />
turbine voit augmenter le niveau de température<br />
qu’elle doit supporter, tout en devant<br />
assurer un taux de détente plus élevé, avec<br />
un bon rendement.<br />
Des simulations avancées sont donc<br />
nécessaires pour les concevoir, comme<br />
illustré ici sur la simulation thermique du<br />
distributeur de turbine haute pression (il<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 1
Dossier<br />
- effectuer une analyse paramétrique pour<br />
différentes configuration de refroidissement.<br />
Le maillage du domaine de calcul, illustré<br />
en figure 5, nécessite environ 20 millions<br />
de cellules.<br />
La simulation a nécessité 72 heures de<br />
calcul sur 12 processus (cluster Linux<br />
moderne de 128 CPU à 2 GHz).<br />
Figure 5: domaine de calcul constitué de passage d’écoulement NGV et de<br />
refroidissement interne<br />
Figure 6 - rationalise (à gauche) et champ de température sur la surface de la lame<br />
s’agit de la pièce statique qui homogénéise<br />
et oriente l’écoulement avant les aubages<br />
mobiles de la turbine). L’enjeu principal de<br />
cette simulation est d’optimiser le refroidissement<br />
nécessaire (disposition de trous<br />
de refroidissement) vis-à-vis :<br />
- des niveaux de température sur la pièce<br />
pour identifier les zones sujettes au fluage<br />
- des zones de fort gradient local de température<br />
pouvant provoquer de la fatigue<br />
thermo-mécanique<br />
- du besoin en air de refroidissement<br />
alimentant le système d’air secondaire<br />
qui doit être minimisé au possible pour<br />
réduire l’impact sur les performances.<br />
Les analyses associées sont complexes<br />
car pour déterminer la température de la<br />
structure il est nécessaire de prendre en<br />
compte la convection, la conduction et le<br />
comportement mécanique (problème<br />
puridisciplinaire et fortement couplé). En<br />
effet, les champs de températures provoquent<br />
des dilatations de la structure qui<br />
modifient les jeux qui eux même impactent<br />
les écoulements donc les champs de<br />
température.<br />
L’exemple présenté met en œuvre un<br />
modèle numérique tridimensionnel sur un<br />
distributeur de turbine haute pression.<br />
Les calculs sont réalisés avec le code<br />
Fluent avec un double objectif :<br />
- caractériser l’aérothermique, c’est-à-dire<br />
les écoulements et les échanges thermique,<br />
du distributeur de turbine (flux<br />
chaud, flux de refroidissement interne,<br />
conduction thermique),<br />
Une comparaison avec des essais a<br />
montré que le modèle est représentatif<br />
des phénomènes aéro-thermiques internes<br />
et externes et qu’il peut être utilisé en<br />
conception pour identifier l’influence de<br />
différents paramètres (débit de refroidissement,<br />
répartition, conditions aux limites).<br />
Quelques résultats sont proposés sur la<br />
figure 6, en particulier les lignes de courant<br />
qui permettent d’illustrer le comportement<br />
du fluide à l’intérieur et l’extérieur du profil.<br />
Ces couplages convection / conduction<br />
donnent accès à la température dans la<br />
structure qui est une donnée critique pour<br />
l’évaluation la durée de vie.<br />
Si ce type de calcul est aujourd’hui tout à<br />
fait accessible en conception, l’évolution<br />
des codes d’analyse thermique consistera<br />
à augmenter la performance de calcul pour<br />
intégrer plus d’effets géométriques et des<br />
modèles plus complexes pour la transition<br />
laminaire-turbulent qui est un facteur clé<br />
des transferts de chaleur.<br />
L’optimisation de masse<br />
des blindages de turbine<br />
soumis à des impacts<br />
Les objectifs d’amélioration des performances<br />
et de réduction de masse des<br />
turbomoteurs doivent être atteints sans<br />
compromis sur la sécurité. Dans le cadre<br />
de la certification d’un nouveau produit<br />
aéronautique, les organismes internationaux<br />
de réglementation de l’aviation, tels<br />
que la FAA aux États-Unis (Federal Aviation<br />
Administration) ou l’agence européenne<br />
de sécurité aérienne (AESA)<br />
demandent la démonstration de la sureté<br />
par des essais ou analyses. Par exemple,<br />
des règlementations doivent être respectées<br />
par rapport aux débris à haute<br />
énergie, basées sur le principe que tout<br />
débris du moteur doit être contenu [6] à<br />
l’intérieur de celui-ci.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 2
Dossier<br />
Chaque pièce en rotation est conçue pour<br />
résister à des niveaux de charge élevés,<br />
couvrant un large éventail d’incidents<br />
possibles. Néanmoins, dans certains cas<br />
très rares, une survitesse de l’arbre est<br />
possible, générant alors des charges mécaniques<br />
énormes sur les disques de turbine.<br />
Cela peut se produire lorsque la turbine<br />
de puissance n’est plus freinée mais que<br />
la chambre continue de produire des gaz<br />
chauds. La turbine accélère donc très rapidement<br />
jusqu’à atteindre ses limites de<br />
tenue mécanique.<br />
Afin d’éviter une rupture de disque entrainant<br />
la centrifugation de débris lourds difficiles<br />
à contenir, Turbomeca utilise un<br />
système de fusible qui consiste à casser<br />
toutes les pales de la turbine de puissance<br />
à une vitesse donnée. Sans aubages dans<br />
la veine d’air, les gaz chaud résiduels de<br />
la chambre n’entraînent plus le disque en<br />
rotation, ce qui le protège d’une accélération<br />
trop brutale jusqu’à des vitesses<br />
trop élevées. Ce concept est nommé<br />
« blade shedding » ou « dispositif de séparation<br />
des pales » [7].<br />
Figure 7 - Géométrie : aube de turbine de puissance (à gauche), la turbine de module<br />
(à droite)<br />
Si ce dispositif protège le disque, la règlementation<br />
impose néanmoins de contenir<br />
tous les débris des pales, ce qui impose<br />
l’utilisation d’un blindage circonférentiel<br />
de turbine, qui est un composant lourd.<br />
Son optimisation (performance de rétention<br />
vis-à-vis de la masse) est difficile et<br />
nécessite des essais de démonstration<br />
très coûteux en raison de leur aspect<br />
destructif. Pour réduire le nombre de ces<br />
essais, Turbomeca réalise des simulations<br />
de blade shedding, phénomène transitoires<br />
rapide traité avec des codes de<br />
calcul spécifiques.<br />
En effet, le phénomène ne dure que<br />
quelques millisecondes, mais est si violent<br />
que la simulation associée doit se baser<br />
sur une intégration temporelle explicite.<br />
En outre, au cours de la perte des pales,<br />
d’importantes charges transitoires sont<br />
transmises à la structure de l’hélicoptère<br />
à travers les supports du moteur : ces<br />
phénomènes sont à des échelles de temps<br />
et d’espace différentes. En conséquence,<br />
les simulations doivent répondre à deux<br />
problèmes :<br />
- La prédiction des charges transitoires<br />
transmises à l’hélicoptère [8], phénomène<br />
transitoire « lent » et « global »<br />
- L’optimisation du blindage et la garantie<br />
Figure 8 - Déformation plastique et libération des pales au cours d’une séquence<br />
«Domino»<br />
de non perforation de celui-ci [9] par les<br />
impacts des pales, phénomène très<br />
rapide et « local ».<br />
Il s’agit typiquement d’un problème multiéchelle,<br />
en temps et en espace, qui nécessite<br />
de coupler 2 approches numériques<br />
Le cas étudié ici est celui d’une turbine<br />
libre de deux étages qui nécessite la modélisation<br />
d’un domaine géométrique assez<br />
large comme exposé sur la figure 7.<br />
- le rotor de la turbine avec les 2 disques,<br />
- les 45 aubes du premier étage et les<br />
49 aubes du deuxième étage la turbine<br />
avec leur zone de rupture,<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 3
Dossier<br />
- l’anneau de turbine définissant la veine<br />
d’air extérieure,<br />
- le blindage de rétention.<br />
Le maillage est composé d’environ<br />
300 000 nœuds et 200 000 éléments. La<br />
plupart des composants, y compris les<br />
pales sont représentés par des éléments<br />
parallélépipédiques avec 8 nœuds, modélisation<br />
validée en [8] nécessitant un effort<br />
de maillage important.<br />
Les deux ensembles impactés sont modélisés<br />
avec des modèles de plasticité<br />
Johnson-Cook (identifiés en quasi-statique)<br />
à haute vitesse de déformation (10-4 - 104<br />
s-1) et fonction de la température (0° à<br />
500°C) [10]. La modélisation de fragmentation<br />
est alors prise en charge par un<br />
critère de déformation plastique, tel que<br />
décrit dans la littérature [11].<br />
Le calcul est effectué en deux étapes :<br />
- une phase de mise en précontrainte, qui<br />
intègre le champ de force centrifuge pour<br />
trouver la position d’équilibre des disques<br />
aubagés en rotation (conditions initiales<br />
de la deuxième phase),<br />
- une phase transitoire physique, avec mise<br />
en rotation explicite des rotors et libération<br />
d’une pale.<br />
La simulation présentée montre la fragmentation<br />
de la première pale éjectée et<br />
la libération des autres pales que l’on<br />
appelle «effet domino». L’analyse de la<br />
séquence est obtenue en intégrant l’ensemble<br />
de la turbine. Elle permet de<br />
comprendre le phénomène et d’optimiser<br />
la masse du blindage.<br />
Une vue typique du résultat après quelques<br />
millisecondes est montrée sur la figure 8.<br />
Le calcul a été effectué avec quatre processeurs<br />
fonctionnant à 2GHz. 80 heures de<br />
calcul ont été nécessaires pour simuler les<br />
20 premières millisecondes du phénomène.<br />
Conclusions<br />
L’effort réalisé dans le monde aéronautique<br />
pour réduire l’impact environnemental<br />
du transport aérien nécessite de<br />
maitriser de nouvelles technologiques. Les<br />
délais de développement imposés par le<br />
marché (Lead Time to Market) et les coûts<br />
associés sont des contraintes structurantes<br />
pour les industriels. En apportant<br />
des réponses à ces contraintes, la simulation<br />
s’est imposée dans l’aéronautique<br />
comme un outil indispensable, pierre angulaire<br />
pour la prospection de nouvelles technologies<br />
et leur maturation.<br />
Le matériel informatique est capable de<br />
répondre à la plupart des besoins en<br />
termes de puissance de calcul, si bien<br />
qu’aujourd’hui, ce sont souvent les logiciels<br />
qui limitent les performances de<br />
calcul. En effet, pour exploiter la puissance<br />
des machines actuelles, le mode de<br />
codage des logiciels doit évoluer pour tirer<br />
le meilleur partir d’une mise en œuvre<br />
massivement parallèle. Divers projets sont<br />
en cours dans le monde pour améliorer les<br />
performances des outils de simulation.<br />
Références bibliographiques<br />
En parallèle, plusieurs initiatives sont<br />
prises en charge par la communauté européenne<br />
pour développer la puissance CPU<br />
disponible en Europe (http://www.hpceuropa.eu,<br />
http://www.prace-project.eu,<br />
etc.). En France, les défis HPC sont abordées<br />
dans les pôles System@tic<br />
( h t t p : / / w w w . s y s t e m a t i c - p a r i s -<br />
region.org/fr/index.html) et Aerospace Valley<br />
(http://www.aerospace-valley.com) ●<br />
Eric Seinturier<br />
(eric.seinturier@turbomeca.fr),<br />
Laurence Vial (Laurence<br />
.vial@turbomeca.fr), Nicolas Savary<br />
(Nicolas.savary@turbomeca.fr),<br />
Thomas Léderlin<br />
(thomas.lederlin@turbomeca.fr),<br />
Sylvain Coste<br />
(Sylvain.coste@turbomeca.fr),<br />
Mathieu Herran<br />
(Mathieu.herran@turbomeca.fr).<br />
Traduction : Jean-Paul Prulhière<br />
(Metexo Eng)<br />
[1] G. Boudier, L. Gicquel, T. Poinsot, D. Bissières and C. Bérat, Comparison of LES, RANS and<br />
Experiment in an Aeronautical Gas Turbine Combustion Chamber, In Proc. of the<br />
Combustion Institute, 31(2):3075-3982 (Elsevier,Pittsburgh, 2007).<br />
[2] P. Moin and S.V. Apte, Large-Eddy Simulation of Realistic Gas Turbine Combustors, AIAA<br />
Journal, 44(4), 698-708, April 2006.<br />
[3] G. Boudier, N. Lamarque, G. Staffelbach, L.Y.M. Gicquel, and T. Poinsot. Thermo-acoustic<br />
stability of a helicopter gas turbine combustor using large-eddy simulations, International<br />
Journal of Aeroacoustics, 8(1):69-94, 2009.<br />
[4] G. Staffelbach, L.Y.M. Gicquel, G. Boudier, and T. Poinsot. Large Eddy Simulation of self<br />
excited azimuthal modes in annular combustors. Proc. of the Combustion Institute, 32,<br />
2009.<br />
[5] G. Staffelbach, L.Y.M. Gicquel, and T. Poinsot. Highly parallel large eddy simulations of multiburner<br />
configurations in industrial gas turbines. The Cyprus International Symposium on<br />
Complex Effects in Large Eddy Simulation, 2005.<br />
[6] European Aviation Safety Agency, CS-E Rules for the Certification of engines, 2007<br />
[7] F. Deheeger, M. Lemaire, M. Pendola, D. and Vallino, Reliability analysis of a blade shedding<br />
safety system. In Safety and Reliability of Engineering Systems and Structures, A. G.,<br />
ed., Rome, Millpress, Rotterdam, June, 19-23, 2005, Schuller G.I. and Ciampoli M. Eds, p.<br />
544.<br />
[8] M. Herran, H. Chalons, D. Nélias and R. Ortiz, Implementation of rotor dynamics effects into<br />
the Europlexus code for the prediction of transient dynamic loading of engine mountings<br />
due to Blade Shedding unbalance, In Proc of ASME Turboexpo 2009, GT2009-59615<br />
[9] M. Herran, H. Chalons, D. Nélias, R. and Ortiz, Modelling the impact of a blade on a shield<br />
during a blade shedding . In Proc. of the Vibrations, Choc and Bruit Congress 2008, Ecully,<br />
France.<br />
[10] A. Rusinek, J.R. Klepaczko, R. Bernier, Caractérisation de trois alliages et modélisation du<br />
comportement themo-visco-plastique, Internal technical report Turbomeca - LPMM Metz,<br />
2007<br />
[11] K.S. Carney, J.M. Pereira, D.M. Revilock, P. Matheny, Jet engine fan blade containment<br />
using an alternate geometry, International Journal of Impact Engineering 2008, 1-9<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 4
Dossier<br />
Simulation électromagnétique<br />
Exemple de simulation d’un schéma<br />
électrique d’un câblage d’avion<br />
(harnais)<br />
La longueur totale des câbles électriques dans un véhicule est impressionnante<br />
et ne fait qu’augmenter. Souvent considérés comme secondaires<br />
lors des phases de conception, les câbles, regroupés dans des<br />
harnais utilisent des espaces non adaptés. C’est pourquoi des outils<br />
spécialisés dans l’optimisation des torons plus ou moins complexes ont<br />
été développés afin de répondre à des objectifs croissants de performance<br />
et de sécurité.<br />
La longueur totale des câbles électriques<br />
dans un véhicule ne cesse de croître et de<br />
poser des problèmes. Ceux-ci atteignent<br />
plusieurs kilomètres dans une voiture,<br />
plusieurs centaines dans un avion et<br />
plusieurs milliers dans un navire. Ils sont<br />
pourtant souvent considérés comme<br />
secondaires dans les phases de conception.<br />
On regroupe ainsi ces câbles dans<br />
harnais de câblage de l’Airbus A380<br />
terminé en place dans l’avion<br />
Exemples de toron<br />
Figure 1<br />
des torons (ou harnais) qui utilisent les<br />
espaces disponibles laissés par la conception<br />
mécanique pour relier les équipements<br />
électriques. Pour répondre aux<br />
objectifs globaux de performance et de<br />
sécurité, des outils spécialisés dans l’optimisation<br />
des torons plus ou moins<br />
complexes ont été développés.<br />
Constitués de modules optionnels, ils<br />
Description fonctionnelle de l’outil<br />
harnais en cours de réalisation<br />
peuvent permettre d’optimiser les harnais<br />
selon différents critères :<br />
- volumiques : densité de câblage dans les<br />
torons, optimisation des chemins de<br />
câbles,<br />
- vthermiques : dimensionnement des<br />
câbles pour maitriser leur échauffement<br />
lorsqu’ils sont parcourus par des courants<br />
importants,<br />
- vélectromagnétiques (CEM ) : minimisation<br />
des couplages entre câbles, choix<br />
des types de câblage (blindé, surblindé,<br />
bifilaire,... et de la topologie)<br />
Les outils les plus complexes sont destinés<br />
en général aux donneurs d’ordre. Ils utilisent<br />
des techniques de modélisation 3D<br />
basés sur des maillages de la totalité de<br />
la structure et nécessitent en général l’emploi<br />
de gros calculateurs.<br />
Il existe aussi des outils complémentaires,<br />
conviviaux, adaptés à des PME-PMI et des<br />
bureaux d’étude.<br />
Intégrés à l’environnement PC, ils sont<br />
utilisés comme des aides à la conception<br />
de torons.<br />
Nous présentons ci-après un tel outil et<br />
ses différentes potentialités (figure 1).<br />
Description fonctionnelle<br />
de l’outil<br />
Il est constitué de plusieurs modules,<br />
correspondant aux différentes phases<br />
d’avancement de l’étude comme schématisé<br />
figure 2.<br />
Nous décrivons ci-après ces modules.<br />
Le schéma de câblage<br />
(wiring diagram)<br />
Figure 2<br />
Il donne une représentation simplifiée du<br />
circuit électrique (fourni par le client) où<br />
figurent de manière schématique :<br />
- les modules électriques constituant le<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 5
Dossier<br />
circuit circuit (connecteurs type de<br />
signaux émis et reçus niveaux acceptables…)<br />
- les connexions (pour les alimentations et<br />
les transports de signaux entre les<br />
modules).<br />
Il est utilisé pour s’assurer que toutes les<br />
demandes, en particulier les connexions<br />
indiquées, ont été prises en compte.Il<br />
définit la topologie générale qui est une<br />
des contraintes dimensionnantes dans la<br />
construction du harnais et qui impose des<br />
règles d’interconnexions entre les composants<br />
correspondant à leur emplacement<br />
physique dans le produit fini. Basé sur une<br />
interface graphique très conviviale, il utilise<br />
des bibliothèques de symboles spécifiques<br />
(norme ATA notamment : connecteurs,<br />
prises de coupure, « coax », blindages, etc.).<br />
Nous présentons ci-contre quelques vues<br />
d’écran.<br />
Les listes de câblage<br />
(hook-Up List)<br />
A partir des schémas faits précédemment<br />
(Wiring Diagrams), le logiciel génère une<br />
liste de câblage, exportable au format<br />
Excel, qui donne pour l’ensemble du<br />
dossier ou par fonction :<br />
- les extrémités de chaque fil ou câble:<br />
pinoche/contact et connecteur/ équipement,<br />
- les caractéristiques de chaque fil :<br />
section, couleur, route, type (blindé,<br />
surblindé, bifilaire)<br />
- le côté mâle ou femelle des disconnecteurs/prises<br />
de coupure,<br />
- la localisation par zone de chaque<br />
élément,<br />
- les reprises de blindage,...<br />
Celle-ci est entièrement paramétrable et<br />
permet la détection des anomalies :<br />
doublons de fils ou de pinoches par<br />
exemple.<br />
Les vues ci-après montrent les types de<br />
sorties obtenues (dans un formalisme<br />
métier utilisé par les sociétés réalisant les<br />
harnais).<br />
Création du synoptique<br />
du harnais<br />
Il est alors possible de créer le synoptique<br />
du harnais de câblage qui sera la représentation<br />
2D du véritable harnais.<br />
Simulation<br />
électromagnétique<br />
Il est maintenant possible d’étudier le<br />
comportement électrique du harnais :<br />
- dans son mode de fonctionnement électrique<br />
nominal,<br />
- en étudiant (option) les interactions entre<br />
câbles situés à l’intérieur d’un toron pour<br />
analyser les couplages qui pourraient<br />
perturber les équipements<br />
Fonctionnement électrique<br />
Conçu spécialement pour l’automatisme<br />
et l’électrotechnique, l’outil permet de<br />
mesurer les courants et tensions :<br />
- en tout point de l’installation,<br />
- en régime nominal ou évenementiel<br />
(fermeture d’un relais par exemple).<br />
- dans le domaine temporel ou fréquentiel<br />
Il est possible<br />
- de calculer les consommations ou d’étudier<br />
:<br />
- Le fonctionnement des contacteurs,<br />
disjoncteurs, fusibles, etc.<br />
- Le fonctionnement en cycle complet<br />
d’un automatisme,<br />
- La sélectivité des protections.<br />
- de faire des modifications rapides sans<br />
avoir à modifier le schéma : impédance<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 6
Dossier<br />
des composants, longueurs de fils, types<br />
de couplage.<br />
- de visualiser le comportement séquentiel<br />
d’une installation.<br />
Nous présentons ci-dessous deux types de<br />
présentation (de type oscilloscope ou<br />
analyser de spectre).<br />
EXEMPLE DE SIMULATION D'UN SCHEMA ELECTRIQUE D'UN CABLAGE D'AVION (HARNAIS)<br />
Etude des couplages<br />
entre câbles<br />
Lorsque des fils parallèles sont situés dans<br />
un environnement proche (ce qui est le<br />
cas d’un toron), une réplique des signaux<br />
haute fréquence (de quelques kHz à<br />
environ 1 MHz) circulant dans un fil est<br />
observé sur les fils situés à proximité.<br />
Il est important de la connaître et de vérifier<br />
si elle ne risque pas de perturber les<br />
matériels situés à son extrémité.<br />
Si c’est le cas, il faudra prendre des<br />
mesures correctives pour en réduire le<br />
niveau (éloignement des câbles du câble<br />
perturbateur, blindage, filtrage à l’entrée<br />
de l’équipement,...)<br />
Pour décrire ces interactions électromagnétiques,<br />
la théorie des lignes de transmissions<br />
est généralement utilisée. Elle<br />
permet de connaître l’ensemble des<br />
courants et tensions le long des câbles.<br />
L’approche retenue dans le simulateur<br />
utilise un formalisme basé sur la topologie<br />
électromagnétique transformant les courants<br />
et tensions en ondes.<br />
Dans ces équations tensorielles, les paramètres<br />
principaux sont les matrices d’inductances,<br />
de capacités, de conductances<br />
et de résistances linéiques. Ils sont directement<br />
liés à la position relative des câbles<br />
dans le toron.<br />
Or celui-ci, lié aux contraintes de fabrication<br />
et d’installation des harnais est difficilement<br />
maîtrisable comme le montre la<br />
vue ci-contre (coupe d’un toron)<br />
Le logiciel développé tient compte de ce<br />
phénomène en travaillant sur des données<br />
probabilistes.<br />
- Il utilise :<br />
- la topologie des câbles fournie par le<br />
synoptique du harnais<br />
- les paramètres électromagnétiques de<br />
chaque module électrique (impédance<br />
d’entrée ou de sortie, tensions et<br />
courants, fréquences de coupure, seuils<br />
d’acceptabilité,...)<br />
- Il fournit ensuite des indicateurs d’alerte<br />
ou de bon fonctionnement en balayant<br />
automatiquement ou manuellement les<br />
différents modes de fonctionnement des<br />
équipements connectés.<br />
- Il permet aussi de proposer des modifications<br />
locales de la topologie (distance<br />
entre câbles, type de câble, blindé ou<br />
non...) pour supprimer les alertes.<br />
Le formalisme utilisé (basé sur des<br />
résolutions de systèmes d’équations<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 7
Dossier<br />
différentielles appliquées à des réseaux<br />
filaires) permet des calculs très rapides<br />
avec des moyens de calcul de type PC.<br />
Cet outil est à privilégier dans la phase de<br />
conception du harnais (début du cycle en<br />
V). Il ne remplace pas ceux maillant la totalité<br />
de la structure, de type 3D, qui valideront<br />
le toron virtuel mis en place dans<br />
l’avion (fin du cycle en V) avant son intégration<br />
physique.<br />
Extensions prévues<br />
Le module actuel est limité aux couplages<br />
entre câbles situés dans un toron. Il ne<br />
couvre pas la totalité des phénomènes<br />
rencontrés en CEM. Il est donc prévu de<br />
le compléter par des modules prenant en<br />
compte le rayonnement généré par un<br />
toron et l’illumination d’un toron par un<br />
champ électromagnétique (Foudre, Wi-FI,<br />
radar). L’augmentation de matériaux<br />
composites dans les avions, souvent peu<br />
blindées de par leur nature, justifie le développement<br />
de ces extensions ●<br />
JP. PRULHIERE<br />
J. PERE-LAPERNE<br />
Compétences<br />
Promea : le portail des moyens<br />
d’essais en Aquitaine<br />
Les essais représentent pour les industriels de tous secteurs une étape<br />
décisive dans le développement de leurs produits de haute technologie.<br />
Qu’il s’agisse de mettre au point des matériaux, des procédés ou des<br />
machines, les tests d’évaluation nécessitent des compétences spécialisées,<br />
des moyens spécifiques couteux et une garantie de confidentialité.<br />
Il est apparu très vite nécessaire de disposer d’un catalogue actualisé des<br />
moyens d’essais disponibles existant en France, accessible aux industriels<br />
ayant besoin de tels moyens.<br />
http://www.promea-aquitaine.com/ proposant<br />
une offre de services de moyens d’essais<br />
et de compétences aux grandes<br />
entreprises et aux PME dans les domaines<br />
de l’aéronautique, du spatial, de la<br />
défense, des transports et de l’énergie.<br />
Conçu comme un catalogue de prestations<br />
professionnelles spécialisées, ce site<br />
permet deux types d’accès :<br />
À notre connaissance, le premier catalogue,<br />
sous format papier et toujours disponible,<br />
a été réalisé par l’ASTE dans les<br />
années 80.<br />
Plus récemment, les grands centres d’essais<br />
aquitains tels que Astrium (AST:<br />
Groupe EADS), le CEA-CESTA, SME (Groupe<br />
SAFRAN) et Snecma Propulsion Solide<br />
(Groupe SAFRAN), soutenus par le Conseil<br />
régional d’Aquitaine et son agence régionale<br />
Aquitaine Développement Innovation,<br />
se sont fédérés pour créer un site Web<br />
- une recherche par famille et type d’essais<br />
couplée à un outil de recherche pertinent,<br />
- un accès direct au centre de ressources<br />
correspondant à chaque besoin précis,<br />
pour un contact rapide et confidentiel.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 8
Dossier<br />
Domaines<br />
Caractérisation matériaux<br />
Chocs/Accélérations<br />
Vibrations<br />
<strong>Essais</strong> statiques<br />
Tenue en environnement<br />
Vieillissement accéléré<br />
Laser<br />
Optique<br />
Radioélectrique CEM-SER<br />
Contrôle Non Destructif (CND)<br />
Famille<br />
Impact<br />
Mécanique<br />
Physique<br />
Physique optique<br />
Thermo-physique<br />
Accélération constante (centrifugeuse)<br />
Choc pyrotechnique<br />
Choc simple sur vibrateur (dent de scie, 1/2 sinus, trapèze)<br />
Choc SRC<br />
Chute libre (machine à choc et tour de chute)<br />
Impact (Lanceur)<br />
Analyse modale<br />
Essai acoustique en chambre réverbérante<br />
Vibration sur excitateur électrodynamique (fréquence min ≥ 5 Hz)<br />
Vibration sur générateur hydraulique (fréquence min < 5 Hz)<br />
Caractérisation liaison vissée<br />
Dépression<br />
Impact<br />
Pression décompression gazeuse<br />
Pressurisation gazeuse<br />
Pressurisation liquide<br />
Surpression gazeuse<br />
Torsion-Traction-Compression<br />
Brouillard salin<br />
Incendie<br />
Pluie<br />
Cyclage thermique<br />
Cyclage thermique par infrarouge<br />
Tenue au flux<br />
Etat de surface<br />
Interférométrie<br />
Réflexion<br />
Transmission<br />
Caractérisation<br />
Mesures<br />
Fuite<br />
Infrarouge<br />
Optique shearographie<br />
Rayon X haute énergie<br />
Rayon X radiographie<br />
Rayon X scopie<br />
Rayon X tomographie<br />
Timbrage<br />
Ultrason<br />
Il fait appel à plus d’une centaine de<br />
moyens d’essais, certains étant uniques en<br />
Europe (comme les centrifugeuses ou les<br />
chambres anéchoïques), associés à des<br />
compétences métier pour fournir, si nécessaire,<br />
une aide en ingénierie d’essai : spécification<br />
et préparation d’essai, conduite<br />
d’essais, analyse des résultats.<br />
Le tableau ci-après donne une liste des<br />
principaux essais qu’il est possible de<br />
réaliser avec le parc existant.<br />
A titre d’exemple, nous présentons cidessous<br />
les moyens d’essais de vibration<br />
disponibles, avec un résumé de leurs<br />
performances et l’organisme qui les<br />
possède.<br />
En cliquant sur l’icône à droite, on accède<br />
directement à un masque de saisie<br />
permettant de contacter l’organisme, pour<br />
une réponse sous 48 h maximum.<br />
Ce portail d’accueil permettra de connaitre<br />
le parc des moyens d’essais aquitains, à<br />
l’origine dédiés essentiellement aux activités<br />
Défense et qui s’ouvre aujourd’hui<br />
au domaine civil.<br />
La plate-forme Mosart<br />
(http://mosart.org), dédiée aux PME (cf.<br />
article dans ce numéro) a pour but de faire<br />
connaitre et fédérer les ressources nécessaires<br />
pour concevoir un produit soumis à<br />
des contraintes environnementales, en<br />
privilégiant les proximités, géographique<br />
et thématique. Elle s’appuiera donc naturellement<br />
sur cette plate-forme ●<br />
De longue date, l’Aquitaine, tournée vers<br />
le secteur aéronautique, concentre autour<br />
de Bordeaux un véritable vivier de ressources<br />
de tout premier plan :<br />
• la plus grande concentration de moyens<br />
d’essais d’Europe,<br />
• des spécialistes en ingénierie d’essais<br />
(études, calculs, programmes d’essais,<br />
analyses, expertises).<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 5 9
Dossier<br />
Contrôle non destructif<br />
La tomographie industrielle<br />
Créée en 2003 Astrium, leader mondial du transport spatial et satellite est<br />
une filiale à 100% d’EADS. Réputé pour ses compétences en tant que<br />
maitre d’œuvre européen des grands programmes spatiaux et militaires<br />
tels que les lanceurs Ariane et les missiles de la force de dissuasion française,<br />
Astrium répartit son activité à travers ses centres de conceptions et<br />
d’assemblages en France et en Europe.<br />
L’établissement d’Aquitaine situé près de<br />
Bordeaux est le site de la société engagé<br />
dans le projet Promea-Aquitaine (cf article<br />
du dossier). En effet Astrium Aquitaine<br />
dispose de nombreuses compétences en<br />
ingénierie et moyens d’essais qui confortent<br />
sa position de maitre d’œuvre du<br />
transport spatial civil et militaire.<br />
Elargir ses moyens de<br />
contrôles non destructifs<br />
vers la Haute Définition<br />
En 2011, le département chargé des<br />
moyens de contrôles non destructifs en<br />
Aquitaine s’est engagé dans une politique<br />
d’amélioration des performances de ses<br />
machines en complétant sa gamme d’équipement<br />
de radiographie X. Ainsi Jacques<br />
Bouteyre, responsable de l’activité CND<br />
sur le site Bordelais a bénéficié de l’investissement<br />
de deux tomographes par<br />
absorption de rayons X. Ces scanners<br />
industriels permettent la reconstruction<br />
informatique d’un volume virtuel de l’objet<br />
inspecté dont on pourra extraire des<br />
coupes en tous lieux.<br />
Ces moyens peuvent répondre à de nombreux<br />
besoins dans le domaine du contrôle<br />
non destructif. Notamment le Tomographe<br />
de 450 kV qui offre, pour des structures<br />
de grande dimension de 2m x 3,5m et de<br />
masse de 3T, une résolution de 60 à<br />
200µm.<br />
Par ailleurs, un Macro-Tomographe 225 kV<br />
de haute définition permet d’obtenir une<br />
résolution de 10µm maximum sur des<br />
structures de dimension de 1,5m x<br />
620mm et de masse de 100kg.<br />
Grâce à ces tomographes et son expertise,<br />
Astrium répond à une forte demande des<br />
clients qui recherchent des contrôles de<br />
plus en plus performants et précis. « Cet<br />
engagement se révèle être fructueux par<br />
la qualité des analyses et le contrôle des<br />
objets confiés par nos clients qui nous ont<br />
fait confiance » explique Patrice Jamain<br />
responsable des ventes ●<br />
Votre contact Astrium :<br />
Patrice JAMAIN<br />
Program, Sales & Contracts Manager<br />
Patrice.jamain@astrium.eads.net<br />
Sur le web:<br />
www.promea-aquitaine.com<br />
www.astrium.eads.net/en/equipment/<br />
?tab=681<br />
Tomographe 450 KV<br />
Macro Tomographe 225 KV<br />
Expertise Moteur MOTO<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 6 0
Voyage au centre de la terre<br />
Des essais insolites<br />
Comment tester des ascenseurs lorsque l’on ne dispose pas de tour directement<br />
sortie du sol mais que non loin de ses usines et de ses bureaux<br />
d’études se trouve une carrière ? Le fabricant finlandais Kone a trouvé la<br />
solution en construisant un centre d’essais au cœur même d’une exploitation<br />
de calcaire. Reportage à près de 350 mètres sous la terre.<br />
seconde et contenir une charge de<br />
50 tonnes. Surtout, cette tour est destinée<br />
à tester les ascenseurs Kone dans des<br />
conditions extrêmes. Le laboratoire Kone<br />
High-Rise, nom de l’endroit où sont effectués<br />
les tests, est en effet situé dans un<br />
lieu qui de par sa raison d’être, est familier<br />
des conditions de travail dures : une<br />
température qui n’excède pas les 6°C., de<br />
l’eau qui coule en permanence et, de fait,<br />
un taux d’humidité élevé.<br />
La tour de test d’ascenseurs la plus grande<br />
d’Europe se trouve dans le nord de l’Europe,<br />
en Finlande, elle est souterraine !<br />
Située à moins d’une heure de Helsinki,<br />
l’exploitation minière de Lohja, ville du sud<br />
de la Finlande, a démarré il y a plus d’un<br />
siècle – en 1897 pour être plus précis –<br />
au moment où l’on décida d’exploiter le<br />
calcaire à l’échelle industrielle. L’extraction<br />
minière de ce gisement se chiffre en<br />
plusieurs millions de tonnes par an. Aujourd’hui,<br />
la carrière est détenue par Tytyri<br />
Nordkalk Corporation. Pour information,<br />
notons que Partek Nordkalk est le premier<br />
producteur de produits à base de calcaire<br />
dans le nord de l’Europe.<br />
Pourtant, il y a près de quatorze ans, le<br />
destin de cette exploitation prit un tout<br />
autre tournant. Kone, l’un des leaders<br />
mondiaux de la fabrication et de la maintenance<br />
d’ascenseurs, décide d’y construire<br />
un arbre de test pour ses produits<br />
qui, est-il utile de le rappeler, sont soumis<br />
à des critères d’espace, de confort, d’intelligence,<br />
de design, de bruit et de vitesse,<br />
mais aussi et surtout à des exigences de<br />
sécurité.<br />
C’est alors que le constructeur finlandais<br />
bâtit en 1998 une tour en plein cœur d’une<br />
carrière de pierre et de 350 mètres de<br />
profondeur. Construite en moins d’une<br />
année à partir d’une extension du site dès<br />
le mois de mai 1997, la tour en question<br />
se compose d’un arbre en acier installé en<br />
septembre de cette même année. Celle-ci<br />
a été rendue opérationnelle en mars 1998.<br />
Une première mondiale qui a permis à<br />
Kone de tester à l’intérieur de sa tour des<br />
élévateurs destinés à des immeubles et<br />
des bâtiments pouvant atteindre plus de<br />
200 mètres de hauteur.<br />
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec<br />
une course verticale d’une distance de<br />
317 mètres, l’arbre de test peut atteindre<br />
une vitesse maximale de 17 mètres par<br />
Plusieurs types d’essais sont possible : la<br />
tour Kone Tytyri est en effet capable de<br />
mener des mesures du kilométrage et de<br />
la vitesse, des tests de performances<br />
diverses comme le confort par exemple,<br />
mais aussi de tester les composants existants<br />
– ou nouveaux – comme l’électronique,<br />
les commandes ou les portes. Des<br />
tests connexes mettent en scène des<br />
essais de freinage mais aussi des tests<br />
relatifs à la méthode d’installation, la mise<br />
en service, les procédures d’inspections<br />
de sécurité et la fiabilité. Cette tour permet<br />
enfin de réaliser des tests de qualité du<br />
produit et de son influence sur l’humain,<br />
en analysant par exemple les effets du<br />
changement de pression atmosphérique<br />
sur son corps ●<br />
Olivier Guillon<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AVR I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 6 1
Formations professionnelles 2012<br />
Modules de formation<br />
« intra-entreprise »<br />
• Les modules de formation qui ne comportent<br />
pas de section « travaux pratiques »<br />
peuvent être organisés au sein de votre<br />
entreprise, à partir de six personnes par<br />
session,<br />
• Les modules comportant des travaux<br />
pratiques pourront, le cas échant, être<br />
proposés en version « intra-entreprise »<br />
mais devront obligatoirement être adaptés<br />
aux moyens d’essais disponibles dans<br />
votre entreprise,<br />
• Vous pourrez mieux cibler la formation de<br />
vos personnels en demandant à l’intervenant<br />
ASTE de mieux la centrer sur vos<br />
besoins spécifiques,<br />
• Vous économiserez le temps de voyage,<br />
les frais de voyage, d’hébergement et de<br />
repas (hors session) que vos personnels<br />
exposeraient dans le cadre d’une formation<br />
classique.<br />
Un nouveau thème Mesure en 2012<br />
Un nouveau thème « Mesure » est proposé<br />
en 2012. Ce thème intègre 3 modules dont<br />
un nouveau sur les bonnes pratiques de la<br />
mesure :<br />
• Collage des jauges, analyse des résultats<br />
et de leur qualité<br />
• Concevoir, réaliser, exploiter une campagne<br />
de mesures<br />
• Bonne pratique des mesures<br />
Objectifs de la formation ASTE<br />
Par son approche originale centrée sur les «<br />
essais, les mesures et la simulation des environnements<br />
rencontrés par vos produits au<br />
cours de leur cycle de vie », la formation ASTE<br />
vous permet d’optimiser vos processus de<br />
mise en œuvre de produits, donc le binôme<br />
« Coût/Qualité ».<br />
Selon le module choisi, la formation ASTE<br />
s’adresse à vos expérimentateurs, techniciens,<br />
ingénieurs et scientifiques impliqués<br />
dans les métiers suivants :<br />
• Spécifications et conception de produits,<br />
bureaux d’études, recherche et développement,<br />
• Technologie et matériaux, achats, contrôles,<br />
mesures et métrologie, production,<br />
• Modélisation et simulation d’essais,<br />
conduite des essais de validation, essais<br />
SAV,<br />
• Qualité, assurance-qualité, certification,<br />
accréditation, maîtrise des risques,<br />
• Ingénieurs-conseils, expertises techniques.<br />
Elle intègre les dernières techniques d’essais,<br />
de mesures, de modélisation et de simulation<br />
d’essais d’environnements disponibles<br />
sur le marché et utilisées par les experts qui<br />
animent nos modules de formation. Notre<br />
indépendance vis-à- vis des fournisseurs et<br />
la mise à niveau des connaissances au cours<br />
de nos stages sont les garants du meilleur<br />
choix possible pour répondre à vos besoins<br />
spécifiques de formation.<br />
PROGRAMME 2012<br />
Thème Code Module Date<br />
Mécanique vibratoire MV1 Mesure et analyses des phénoménes vibratoires (Niveau 1) 16-20 avr. 3-7 sept.<br />
MV2 Mesure et analyses des phénoménes vibratoires (Niveau 2) 21-25 mai – 10-14 sept<br />
MV3 Application au domaine industriel 12-15 juin 23-26 oct.<br />
MV4 Chocs mécaniques : mesures, specifications, essais et analyses de risques vis-à-vis des chocs 4-6 avr. – 6-8 nov.<br />
Acquisition et traitement des signaux TS1 Principes de base et caractérisation des signaux 5-8 juin<br />
TS2 Traitement du signal avancé des signaux vibratoires 18-20 sept.<br />
Pilotage des générateurs de vibrations PV Principes utilisés et applications 27-30 nov.<br />
Analyse modale AM Analyse modale expérimentale et Initiation aux calculs de structure et essais 4-7 juin – 19-22 nov.<br />
Acoustique AC Principes de base, mesures et application aux essais industriels 20-23 nov.<br />
Climatique CL1 Principes de base et mesure des phénomènes thermiques 13-15 nov.<br />
CL2 Application au domaine industriel 9-11 nov.<br />
Electromagnétisme EL1 Sensibilisation à la compatibilité électromagnétique 16-20 avril<br />
EL2 Application à la prise en compte de la CEM dans le domaine industriel 18-21 sept.<br />
EL3 Exploitation des normes CEM 21-22 fév.<br />
Personnalisation du produit P1 Prise en compte de l'environnement dans un programme industriel 11-12 sept.<br />
à son environnement P2 Prise en compte de l'environnement mécanique 22-24 oct.<br />
P3 Utilisation des outils de synthèse mécanique pour la conception<br />
et prédimensionnement des équipements<br />
21-23 nov.<br />
P4 Prise en compte de l'environnement climatique 25-27 sept.<br />
P5 Prise en compte de l'environnement électromagnétique 25-27 avril<br />
Mesure M1 Extensométrie : Collage de Jauge, analyse des résultats et de leur qualité 19-21 juin – 20-22 nov.<br />
M2 Concevoir, réaliser, exploiter une campagne de mesures 3-4 déc.<br />
M3 Bonne pratique des mesures 5-6 juin<br />
<strong>Essais</strong> E1 Conception et validation de la fiabilité<br />
Dimensionnement des essais pour la validation de la conception des produits. Cas d'etude 14-16 mai<br />
E2 Fiabilité, déverminage, essais (accélérés, aggravés) 12-13 sept.<br />
E3 Accroissement de fiabilité par les méthodes HALT & HASS 16 mars – 14 sept.<br />
E4 Estimation des incertitudes de mesure dans les essais 11-12 oct.<br />
E5 Accréditation des laboratoires d’essais et d'analyse 13-14 sept.<br />
E6 Méthodes statistiques appliquées aux essais 5-6 juin<br />
Contact<br />
ASTE<br />
9-11, rue Benoît Malon – 92150 Suresnes – Tél. : 01 42 66 58 29 – Fax : 01 42 66 12 06 – info@aste.asso.fr – www.aste.asso.fr<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 6 2
Événements,colloques,<br />
séminaires à venir...<br />
Juin 2012<br />
Forum Teratec 2012<br />
Le rendez-vous des experts internationaux de la conception et<br />
de la simulation numérique hautes performances aura lieu fin<br />
juin à l’école Polytechnique. Le Forum Teratec 2012 est l’opportunité<br />
de rencontrer les plus grands acteurs industriels et les<br />
utilisateurs les plus avancés qui feront le point des développements<br />
en cours et des perspectives à court et moyen termes<br />
dans ces domaines essentiels pour la compétitivité industrielle<br />
et l’innovation.<br />
Les 27 et 28 juin 2012<br />
À l’école Polytechnique<br />
www.teratec.eu/forum/index.html<br />
Juillet 2012<br />
VCB & ASTELAB 2012<br />
Cette année, pour la première fois, VCB (Vibration, Choc et Bruit)<br />
et ASTE organisent conjointement les 3, 4 et 5 juillet 2012 un<br />
colloque accompagné d’une exposition au centre de recherche<br />
d’EDF à Clamart. Ce XVIII e symposium réunira tous les experts<br />
du domaine de la vibration, du choc et des essais d’environnement<br />
mécanique et climatique.<br />
Les 3, 4 et 5 juillet 2012<br />
Au centre de recherche d’EDF, à Clamart<br />
http://aste.siteo.com/fr/<br />
Septembre 2012<br />
10 e Conférence internationale<br />
sur la ventilation industrielle<br />
La conférence sur la ventilation industrielle est organisée par<br />
l’INRS, en partenariat avec l’IRSN, le CSTB, l’Observatoire de la<br />
Qualité de l’air intérieur et le Cetiat. Cette rencontre permettra<br />
aux experts en ventilation industrielle, en hygiène du travail, en<br />
ingénierie aéraulique des bâtiments et des procédés industriels,<br />
aux concepteurs d’équipements de ventilation et de filtration,<br />
aux responsables techniques de groupes industriels,<br />
aux gestionnaires de bâtiments du tertiaire, aux prescripteurs<br />
institutionnels et aux universitaires de présenter leurs travaux<br />
de recherche/développement et de confronter leurs pratiques<br />
professionnelles dans le domaine de la ventilation industrielle.<br />
Du 17 au 19 septembre 2012<br />
À la Maison de la Mutualité (Paris)<br />
www.inrs-ventilation2012.fr/fr/<br />
Sepem Industries Sud-Ouest<br />
Le salon régional spécialisé dans les services à l’industrie, les<br />
équipements, les process et la maintenance ouvrira pour la première<br />
fois ses portes dans le sud-ouest de la France, plus précisément<br />
à Toulouse. Il rassemblera les décideurs issus des<br />
sites de production implantés dans les régions Aquitaine, Midi-<br />
Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Un espace « nouveautés »<br />
permettra aux visiteurs de se tenir informés des grandes innovations<br />
du moment et la mise en place d’un système de navettes<br />
gratuites leur facilitera l’accès au salon.<br />
Du 25 au 27 septembre 2012<br />
À Toulouse<br />
www.sepem-industries.com/toulouse<br />
Octobre 2012<br />
Séminaire Européen - Applications des Lasers<br />
de Puissance<br />
LASERAP’7 organisera début octobre un séminaire de 3,5 jours<br />
qui comprendra des conférences plénières et des sessions thématiques<br />
sous la forme d’ateliers interactifs.<br />
Le séminaire portera sur la simulation et la modélisation des<br />
procédés laser, le micro-usinage par laser à impulsions courtes,<br />
les gravures, les assemblages et les découpes, les procédés<br />
hybrides, l'apport des lasers dans les traitements de surface et<br />
la fabrication additive.<br />
Du 1 er au 5 octobre 2012<br />
À « La vieille Perrotine », Ile d’Oléron (17),<br />
Gite du CNRS<br />
www.laserap7.org<br />
Mesurexpovision<br />
Conjointement aux salons Carrefour de l’Électronique, Opto et<br />
RF&Hyper Wireless, Mesurexpovision se tiendra à la Porte de<br />
Versailles à la fin du mois d’octobre.<br />
L’événement de la mesure accueillera près de 300 exposants<br />
et environ 5 000 visiteurs issus de la mesure/instrumentation,<br />
des industries mécaniques, de l’automobile, de l’aérospatial et<br />
l’aéronautique, de la recherche, des laboratoires, des organismes<br />
de recherche, de l’éducation, de la formation, de l’électronique<br />
industrielle ou encore des services, du conseil, des<br />
bureaux d’études, de l’énergie, de l’environnement et de<br />
la défense.<br />
Du 24 au 26 octobre 2012<br />
À Paris – Porte de Versailles<br />
www.gl-events.com<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● JA NVI E R , F ÉVR I E R , M A R S 2 0 1 2 ● PAG E 6 3
Au sommaire<br />
du prochain numéro<br />
Mesures et méthodes de mesure<br />
Les méthodes et les technologies de mesure vibratoires<br />
et acoustiques au service des industriels<br />
et des laboratoires d'essais.<br />
Mesure tridimensionnelle : Optimiser la mesure<br />
de ses pièces et de ses produits industriels<br />
grâce à la métrologie 3D.<br />
<strong>Essais</strong> et modélisation<br />
L’évolution des moyens d’essais climatiques.<br />
Zoom sur les projets et les travaux les plus significatifs<br />
des laboratoires, des universités et des industriels.<br />
Sans oublier<br />
Des avis d'experts ainsi que toutes les informations<br />
concernant la vie de l'ASTE et du Gamac, les événements,<br />
les formations et les actualités du marché de la mesure,<br />
des essais, de la modélisation et de la simulation.<br />
R é p e r t o i r e d e s a n n o n c e u r s<br />
CONCEPTION ÉDITORIALE & RÉALISATION<br />
MRJ - 24 rue Firmin Gillot - 75015 Paris<br />
Tél. : 01 56 08 59 00<br />
Fax : 01 56 08 59 01<br />
www.mrj-presse.fr<br />
(La rédaction n’est pas responsable des documents qui lui sont<br />
adressés, sauf demande express, ceux-ci ne sont pas retournés)<br />
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION<br />
Jérémie Roboh<br />
RÉDACTION<br />
Olivier Guillon<br />
(o.guillon@mrj-corp.fr)<br />
Comité de rédaction :<br />
Anne Marie Ajour (ASTE), Raymond Buisson,<br />
Charki Abdérafi (Istia), Bernard Colomiès (Sopemea –<br />
ASTE), François Derkx (IFSTTAR), Jean-Claude Frölich<br />
(ASTE), Pierre Girard (ASTE), Olivier Guillon (MRJ),<br />
Henri Grzeskowiak (HG Consultant), Michel Roger<br />
Moreau (Gamac – ASTE), Lambert Pierrat<br />
(LJ Consulting), Jean Paul Prulhière (Metexo),<br />
Jean-François Romain (MRJ), Philippe Sissoko (LCIE),<br />
Pierre Touboul (Onera)<br />
Ont participé à ce numéro :<br />
Raymond Buisson (RB Consultant), Sylvain Coste<br />
(TURBOMECA), Bertrand Deraigne (2ADI), J. Dumoulin<br />
(Ifsttar, Macs), Michel Guidon (CEA-Cesta), Mathieu Herran<br />
(TURBOMECA), L. Ibos (Certes, université Paris Est),<br />
Patrick Jamain (Astrium), Frédéric Lago (DGA Techniques<br />
Aéronautiques), Christophe Larrieu (DGA Techniques<br />
Aéronautiques), Thomas Léderlin (TURBOMECA), S.<br />
Ludwig(Cete de l'Est-LRPC Nancy-ERA), M. Marchetti<br />
(Cete de l'Est-LRPC Nancy-ERA), M. Moutton (Cete de<br />
l'Est-LRPC Nancy-ERA), Jacques Père-Laperne<br />
(ALGOTECH), Jean-Paul Prulhière (METEXO),<br />
Hideaki Sato (Research Laboratories for Fundamental<br />
Technology of Food, Asahi Group Holdings Ltd.),<br />
Nicolas Savary (TURBOMECA), Eric Seinturier<br />
(TURBOMECA), Christophe Simond (DGA Techniques<br />
Aéronautiques), Laurence Vial (TURBOMECA)<br />
ÉDITION<br />
Maquette : Graphaël (Paris)<br />
Couverture : Sandrine Weyland (MRJ)<br />
PUBLICITÉ<br />
MRJ - Tél. 01 56 08 59 00<br />
Patrick Barlier - p.barlier@mrj-corp.fr<br />
DIFFUSION ET ABONNEMENTS<br />
Sonia Cheniti<br />
www.essais-simulations.com<br />
Abonnement 1 an (4 numéros) : 58 €<br />
Prix au numéro : 20 €<br />
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de MRJ<br />
(DOM-TOM et étranger : nous consulter)<br />
CETIM ........................................................23<br />
DB-VIB........................................................17<br />
HBM...........................................................33<br />
KISTLER .......................................................7<br />
M+P INTERNATIONAL ...............................31<br />
OMEGA.........................................................2<br />
ROTRONIC .................................................35<br />
SHIMADZU.................................................31<br />
SITIA...........................................................11<br />
THE MATHWORKS .............2 e de couverture<br />
SALONS :<br />
MESUREXPO .............................................41<br />
MICRONORA..............................................45<br />
SEPEM TOULOUSE.............3 e de couverture<br />
VIRTUAL PLM .....................4 e de couverture<br />
Trimestriel - N° 110<br />
avril, mai, juin 2012<br />
Éditeur : MRJ<br />
SARL au capital de 50 000 euros<br />
24 rue Firmin Gillot – 75015 Paris<br />
RCS Paris B 491 495 743<br />
TVA intracommunautaire : FR 38491495743<br />
N° ISSN : 2103-8260<br />
Dépôt légal : à parution<br />
Imprimeur : Imprimerie de Champagne<br />
Z.I. Les Franchises – 52200 Langres<br />
Toute reproduction partielle ou globale est soumise à<br />
l’autorisation écrite préalable de MRJ.<br />
E S S A I S & S I M U L AT I O N S ● AV R I L , M A I , J U I N 2 0 1 2 ● PAG E 6 4