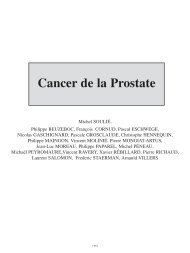Héparines antivitamines K
Héparines antivitamines K
Héparines antivitamines K
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Cardiologie - Pathologie vasculaireB 3 73<strong>Héparines</strong>, <strong>antivitamines</strong> KPrincipes et règles d'utilisationPosologie des héparines non fractionnéesDR Daphné DELSART, DR Valérie CHAMBEFORT, PR HERVÉ DECOUSUSUnité de pharmacologie clinique, service de médecine interne et thérapeutique, CHU, h8pital de Bellevue. 42055 Saint-Étienne Cedex 2.Points Forts à comprendre• Les héparines constituent un mélange de molécules de poids moléculaire très variable, mélangeentrait de tissus animaux. Les héparines de bas poids moléculaire contiennent des molécules depoids moléculaire beaucoup plus faible que l'héparine non fractionnée.• Les hëparines de bas poids moléculaire ont, par rapport à l'héparine non fractionnée, une activitéanti-thrombine nettement moins marquée expliquant une élévation moindre du taux de céphalineactivée.• Contrairement à l'héparine non fractionnée :.`~. les héparines de bas poids moléculaire ont uneélimination strictement rénale avec risque d'accumulation en cas d'insuffisance rénale sévère.• Le risque de thrombopénie induite par l'héparine observé sous héparine non fractionnée persistebien que diminué au cours d'un traitement par héparines de bas poids moléculaire.• Les <strong>antivitamines</strong> K sont des anticoagulants oraux. Elles ne constituent pas une thérapeutiqued'urgence et se prescrivent toujours en relais d'une héparinothérapïe.• Le risque hémorragique et l'efficacité des <strong>antivitamines</strong> K sont étroitement corrélés au résultat dePM (international normalized ratio).• Les interférences médicamenteuses sont fréquentes et doivent être recherchéessystématiquement.La revue du praticien 1
Héparine : principes et règles d'utilisation,posologie• Origine et structure1. Héparine non fractionnéeL'héparine non fractionnée (INF) est un mélangecomplexe de chaînes polysaccharidiques sulfatéesnaturelles, extrait industriellement de l'intestin de porc.Elle est hétérogène en taille avec un poids moléculairevariant de 5 000 à 30 000, pour un poids moléculairemoyen de 15 000 daltons.2. <strong>Héparines</strong> de bas poids moléculaireLes chaînes polysaccharidiques de l'héparine naturellepeuvent être fractionnées par divers procédés. Leshéparines de bas poids moléculaires (HBPM) sontpréparées selon des procédés différents qui génèrentdes produits dont les propriétés ne sont pasidentiques.Une différence importante réside dans la distributiondes poids moléculaires (PM) des chaînespolysaccharidiques qui composent l'héparine de baspoids moléculaire. Le poids moléculaire moyen deshéparines de bas poids moléculaires est d'environ 5000 dallons (d) avec une distribution qui va de 2 000 dà 10 000 d. Les chaînes d'héparine dont le poidsmoléculaire est supérieur à 5 400 d inhibent aussi bienle facteur IIa (thrombine) que le facteur Xa, tandis quecelles dont le poids moléculaire est inférieur à 5 400 dinhibent exclusivement le facteur Xa. La proportion dechaînes dont le PM est supérieur à 5 400 d varie selonle type d'héparines de bas poids moléculaires.• Mécanisme d'action1. Action sur le système de la coagulationLes héparines agissent de façon rapide, ce qui en faitun traitement d'urgence.L'héparine non fractionnée se lie à l'antithrombine III(ATM). Ce complexe catalyse l'inactivation deplusieurs enzymes générées au cours de la coagulationen particulier la thrombine (facteur II), le facteur IXaet le facteur Xa. Il en résulte un allongement du tempsde coagulation du plasma mesuré par le temps decéphaline activatée (TCA). Les héparines de bas poidsmoléculaire se lient également à l'antithrombine III.Elles ont, par rapport à l'héparine non fractionnée, uneplus faible activité anti-IIa et une activité anti-Xacomparable mais pas équivalente entre les différenteshéparines de bas poids moléculaires. Le rapportactivité anti-Xa/anti-IIa varie, en effet, d'une héparinede bas poids moléculaire à l'autre, de 1,8 à 3,6 (tableauI). L'aptitude d'une héparine de bas poids moléculaireà prolonger le temps de céphaline activatée, moindredans tous les cas que pour l'héparine non fractionnée,est fonction de son activité anti-Ha.Ces différences pharmacologiques entre les héparinesde bas poids moléculaires expliquent égalementpourquoi une même dose exprimée en unitéanti-Xa/kg de 2 héparines de bas poids moléculairesdistinctes puisse générer des héparinémies, mesuréespar activité anti-Xa, significativement différentes chezun même sujet (tableau II).La revue du praticien 2
Tableau 1Activités biologiques moyennesdes différentes héparinesde bas poids moléculairePoidsmoléculaireAnti-Xa/anti-Ilamoyen (d)-Nadroparinecalcique-Fraxiparine 4 500 3Daltéparine sodique-Fragmine 5 000 2Tinzaparine sodique-Innohep 4 500 1,8Reviparine sodique-Clivarine 3 900 ' 3,3Énoxaparine sodique-Lovenox 4 800 3,3Tableau 2Héparinémiedes différentes héparinesde bas poids moléculaireHBPM Héparinémie (réalisée(dose curative en sc) 4 h après l'injection)Nâdroparine calcique-Fraxiparine0,9 à 1 U/mL-Fraxodi*1,3 U/mLDaltéparine sodique-Fragmine0,6 U/mLTinzaparine sodique .-lnnohep*0,7 à 0,8 U/mLÉnoxaparine sodique-Lovenox0,9 à 1 U/mL*une seule injection parjour en traitement curatif2. Action sur le système fibrinolytiqueIl pourrait exister une discrète action fibrinolytique enprovoquant la stimulation ou la synthèse de l'activateurtissulaire du plasminogène (t-PA). Cette action restecependant contestée en raison du rôle de la fibrinolysephysiologique.3. Action lipolytiqueL'héparine favoriserait la libération et l'activation de lalipoprotéine lipase et provoquerait la diminution deschylomicrons d'où ses propriétés de «clarification» dusérum lactescent après un repas riche en graisse.• • PharmacocinétiqueLes héparines ne sont pas absorbées par voie orale etdoivent être administrées par voie parentérale.1. Héparine non fractionnéeLa demi-vie d'élimination moyenne est d'environ 1 h 30min après injection intraveineuse et de 2 h aprèsinjection sous-cutanée. Celle-ci peut être allongée encas d'augmentation de posologie ou diminuée en cas dephénomène thrombotique par consommation.L'élimination se fait par dégradation hépatique etl'inactivation est réalisée par le systèmeréticulo-endothélial, le facteur 4 plaquettaire et lefibrinogène. Ce processus peut se trouver saturé en casde posologies élevées, ce qui explique alorsl'augmentation de la demi-vie. Aux doseshabituellement prescrites, le système n'est pas saturé.L'excrétion se fait par voie urinaire sous formeinactivée. Il n'y a donc pas d'accumulation en casd'insuffisance rénale. La biodisponibilité de l'héparinenon fractionnée après injection sous-cutanée à doseprophylactique est de 20 à 30 %.2. <strong>Héparines</strong> de bas poids moléculaireLes héparines de bas poids moléculaires ont despropriétés originales qui les distinguent de l'héparinenon fractionnée un effet antithrombine plus faible, uneplus grande facilité d'administration et une meilleuretolérance. Leur demi-vie d'élimination est plus longue(entre 3 et 4 h suivant les héparines) et, contrairement àl'héparine non fractionnée, l'élimination est rénale avecun risque d'accumulation en cas d'insuffisance rénale.Autre différence par rapport à l'héparine nonfractionnée, la biodisponibilité après injectionsous-cutanée est supérieure à 90 %.• Mode de présentation1. Héparine non fractionnéeL'héparine non fractionnée doit être prescrite en unitésinternationales. Si autrefois l'activité spécifique del'héparine non fractionnée était de 100 UI/mg, elle estaujourd'hui comprise entre 150 et 200 UI/mg. Prescrirel'héparine en mg est donc une erreur, d'autant plus quel'activité spécifique (nombre d'unités par mg) despréparations commerciales utilisées n'est jamaismentionnée sur les flacons. De la même façon, laconcentration (nombre d'unités par mL) des solutionsd'héparine susceptibles d'être injectées varie selon lespréparations, ce qui est une autre cause d'erreur.La revue du praticien 3
Tableau 3Présentation des héparinesde bas poids moléculaireHBPMPrésentationConcentration(amp. se) (UI) anti-XaNadroparine calcique- Fraxiparine 0,2 mL 2 0500,3 mL 3 0750,4 mL 4 1000,5 mL 6 1500,8 ML 8 2001 ML 10 250 ,Nadroparine- Fraxodi 1 ML 20 500Daltéparine_- Fragmine 0,2 mL 2 5000,2 mL 5 000 .0,75 mL 7 5001 ML ;.- 10 000Tinzaparine- Innohep 0,5 ML 100000,7 mL 14 0000,9 ML 18 000Énoxaparine- Lovenox 20 mg 2 10040 mg 4 200 -60 mg 6 300`° 80 mg 8 400100 mg 10 500 %'.Reviparine- Clivarine 0,25 mL 1 4320,60 mL 3 4360,90 mL i 5 1532. <strong>Héparines</strong> de bas poids moléculairePlusieurs héparines de bas poids moléculaires sontactuellement disponibles et utilisées en France à dosespréventives ou curatives avec des modes deprésentation très différents (tableau III).• • Posologie, voie d'administration1. Héparine non fractionnée• Le traitement prophylactique est classiquement de 5000 UI (0,2 mL), 2 fois/j par voie sous-cutanée sansadaptation posologique à un test biologique. En cas dehaut risque, la posologie peut être augmentée à 5 000UI, 3 fois /j et (ou) être adaptée au temps de céphalineactivée.• Le traitement curatif est habituellement administrépar voie intraveineuse en perfusion continue maisl'administration par voie sous-cutanée en 2 ou 3injections/j peut constituer une solution tout aussifiable sauf chez l'obèse où l'on craint un problème demauvaise absorption et en cas de nécessité deposologie ou de volume élevé à injecter.La mise en route du traitement consiste à débuter parune dose d'héparine non fractionnée calculée enfonction du poids du patient soit 500 U/kg/j, dosesecondairement adaptée aux résultats des testsbiologiques. Elle peut être précédée d'un bolus de 50U/kg, même si l'efficacité clinique de ce bolus n'ajamais été clairement démontrée. En son absence, 4 à 6h sont en effet nécessaires pour obtenir uneanticoagulation stable. Les intraveineuses en injectionsdiscontinues ne sont plus utilisées en raison du risquehémorragique.2. <strong>Héparines</strong> de bas poids moléculaire• Avec le traitementprophylactique, les posologiessont définies en fonction du risquethromboembolique. Elles s'utilisent par voiesous-cutanée à raison d'une seule injectionsous-cutanée par jour).• Dans le traitement curatif, on retrouvel'hétérogénéité de présentation. Les hépariness'administrent pour la plupart en 2 injections/j,sous-cutanées, à 12 h d'intervalle. Certaines héparinesde bas poids moléculaire existent actuellement sousforme concentrée permettant une seule injection parjour (tableau IV).Tableau 4Posologies des héparinesde bas poids moléculaires' HBPM_. _ .z ,-z Y Posologie:- Fraxiparine 0,1 mL/10 kg x 2/j- Fraxodi* 0,1 mL/10 kg/j- Fragmine 100 Ul/kg x 2/j- Innohep* 175 Ul/ kg /j* '`- Lovenox 10 mg/10 kg x 2/j- Clivarine 71 UI/kg x 2/j• 1 seule injection parjour produit concentra.La revue du praticien
• Surveillance1. Activité anticoagulante• Héparine non fractionnée: le contrôle de l'efficacitédu traitement repose sur la mesure du temps decéphaline activée ou de l'héparinémie (mesure del'activité anti-Xa) qui doit être effectuée 6 h après lamise en route de la perfusion et contrôlée 6 h aprèschaque changement de posologie. En effet, il est trèsprobable que le taux de récidives précoces estdirectement lié à la rapidité d'efficacité du traitementanticoagulant. Le contrôle est ensuite réalisé au moinsune fois par jour. La zone thérapeutique pour le tempsde céphaline activée se situe entre 1,5 et 2,5 fois letémoin. Ehéparine non fractionnée a l'inconvénient denécessiter une adaptation posologique car il existe unegrande variabilité inter- et intra-individuelle. Elleprésente cependant l'avantage de ne pas s'accumuleren cas d'insuffisance rénale.La sensibilité des réactifs utilisés pour effectuer lamesure du temps de céphaline activée varie cependantde façon très importante d'un laboratoire à un autre, cequi constitue un problème majeur, source d'accidentsthérapeutiques potentiellement graves par sur- ousousdosage. Des niveaux très différents d'héparinémiepeuvent en effet correspondre à une même valeur detemps de céphaline activée suivant le réactif utilisé. Ilest donc plutôt conseillé de surveiller si possible letraitement par l'héparinémie (zone thérapeutique situéeentre 0,3 et 0,7 U/mL), particulièrement en casd'inefficacité biologique (temps de céphaline activéequi ne s'allonge pas) ou d'inefficacité clinique. Audépart, il convient de demander au laboratoire leszones thérapeutiques pour le réactif du temps decéphaline activée utilisé, zones qui doiventcorrespondre à une héparinémie entre 0,3 et 0,7 U/mL.En cas d'injection sous-cutanée, le prélèvement doits'effectuer à mi-distance entre 2 injections.• <strong>Héparines</strong> de bas poids moléculaire: quelle que soitla posologie, contrairement à l'héparine nonfractionnée, il n'est pas nécessaire de faire d'adaptationposologique par l'activité anti-Xa du fait d'unemoindre variabilité inter- et intra-individuelle.Toutefois, l'héparinémie par la mesure de l'activitéanti-Xa peut s'avérer utile dans certains cas, pourdépister un surdosage ou un risque hémorragique(insuffisance rénale, sujet très âgé, obésité). La zonethérapeutique, qui n'est pas validée, se situerait entre0,5 et 1 UI anti-Xa/mL selon les héparines de baspoids moléculaires (tableau II), le prélèvement devantêtre effectué entre la 3e et la 4e h après l'injection, auminimum 2 j après le début du traitement.2. Numération plaquettaire sanguineElle est absolument nécessaire afin de permettre ledépistage de la thrombopénie induite par l'héparine detype II (TIH). Cette numération plaquettaire doit êtreréalisée avant le début du traitement puis 2 fois parsemaine jusqu'au 21e j voire plus si le traitement estprolongé au delà.Même si l'incidence des thrombopénies induites parl'héparine de type II sous héparine de bas poidsmoléculaires est moindre que sous héparine nonfractionnée, il demeure indispensable de réaliser lamême surveillance de la numération plaquettaire.1 Indications1. Prévention de la maladie veineusethromboemboliquel'héparine non fractionnée est actuellement délaisséeau profit des héparines de bas poids moléculaires.Pour celles-ci, la posologie recommandée estdifférente selon le risque thrombotique auquel estexposé le patient.• En chirurgie, les héparines de bas poidsmoléculaires sont aussi sûres et efficaces quel'héparine non fractionnéeTableau 5Posologie prophylactiquedes héparines de bas poidsmoléculaires en chirurgieRisque modéré Risque élevéHBPM (chirurgie (chirurgiegénérale) hanche-genou)- Fraxiparine 2 850 UI/j 38 UI/kg/j- Fragmine 2 500 UI/j 5 000 UIJj- Innohep 2 500 UI/j 4 500 UI/j- Lovenox. 20 mg/j 40 mg/j- Clivarine 1 432 U7/j 3 436 UI/jLa revue du praticien
en chirurgie générale, indication dans laquelle la duréedu traitement est de 10 j. Elles ont par contre démontréleur supériorité en chirurgie orthopédique (chirurgiede la hanche ou du genou), où elles sontrecommandées pendant 5 semaines aprèsl'intervention. Cette supériorité, associée à une plusgrande maniabilité et une meilleure tolérance, expliquele remplacement de l'héparine non fractionnée par leshéparines de bas poids moléculaires dans cesindications (tableau V). La présence d'une insuffisancerénale sévère reste la seule situation où il est licited'utiliser l'héparine non fractionnée.• En médecine, une étude récente a permis de validerune héparine de bas poids moléculaire (Lovenox 40mg/j) pour une durée de 10 j dans le traitement de laprévention de la maladie veineuse thromboemboliquechez le sujet âgé alité avec facteurs de risque associés.Uhéparine non fractionnée a également cette indicationmais tend à être abandonnée sauf en cas d'insuffisancerénale sévère.2. Traitement curatif de la maladie veineusethromboemboliqueActuellement, seule une minorité de malades atteintsd'une thrombose veineuse profonde sont encore traitéspar héparine non fractionnée. Il s'agit avant toutd'insuffisants rénaux sévères (contre-indication auxhéparines de bas poids moléculaires) et d'emboliespulmonaires graves (absence d'études avec leshéparines de bas poids moléculaires). L'héparine nonfractionnée est encore également utilisée par voieintraveineuse continue chez les obèses pour lesquelsse pose, avec les héparines de bas poids moléculaireen sous-cutané, un problème potentiel debiodisponibilité.Comme pour la prévention, les héparines de bas poidsmoléculaire sont au moins aussi sûres et efficaces quel'héparine non fractionnée pour le traitement desthromboses veineuses. A ce jour, une seule a obtenul'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans letraitement de l'embolie pulmonaire non grave(Innohep à la dose de 175 U/kg une fois/j).Tableau 6Posologie des héparines de bas poidsmoléculaire dans l'angor instableet l'infarctus sans onde QHBPMPosologieFraxiparine0,1 mL/10 kg/12 hFragmine120 UI/kg/12 hLovenox1 mg/kg/12 hSeules 2 héparines de bas poids moléculaire peuvents'administrer en une seule injection par jour (Innohepet Fraxodi), les autres étant administrées en 2injections par jour (tableau IV). Cette simplification arendu possible le traitement des thromboses veineusesà domicile.La durée maximale de traitement est de 10 j avec unrelais par <strong>antivitamines</strong> K précoce.3. Autres indicationsCertaines héparines de bas poids moléculaire(Fraxiparme, Fragmine, Lovenox) ont obtenu uneextension d'indication pour le traitement de l'angorinstable et de l'infarctus du myocarde sans onde Q enphase aiguë en association à l'aspirine (tableau VI).En ce qui concerne les maladies cardiaques (arythmiepar fibrillation auriculaire, prévention des thrombosessur valves cardiaques mécaniques) et les thrombosesartérielles il n'existe pas d'autorisation de mise sur lemarché pour l'utilisation des héparines de bas poidsmoléculaires, l'héparine non fractionnée restant letraitement de référence.• Cas particulier de la grossesse et del'allaitementL'héparine non fractionnée ne traverse pas la barrièreplacentaire, elle est donc a priori sans risque pour lefcetus. Les doses préventives sont de 5 000 UI x 2/j. Ilest recommandé d'adapter la dose pour obtenir 0,1 à0,2 U/mL d'activité anti-Xa.Le traitement curatif s'effectue selon les modalitéshabituelles. Il existe un risque hémorragique àl'accouchement qui nécessite l'arrêt du traitement 12 à24 h, l'héparine étant reprise 12 h aprèsl'accouchement.Les héparines de bas poids moléculaire ne traversentpas non plus la barrière placentaire. De nombreusesobservations concernant surtout le traitement préventifsemblent indiquer que les héparines de bas poidsmoléculaires en traitement curatif sont aussi efficaceset aussi sûres que l'héparine non fractionnée.Cependant, en l'absence d'essais cliniques prospectifs,les héparines de bas poids moléculaires n'ont pas pourl'instant l'autorisationde mise sur le marché chez la femme enceinte. Aussi,l'utilisation des héparines de bas poids moléculaires enpréventif au cours des 2e et 3e trimestres de lagrossesse ne doit être envisagée d'après l'AFSSPSLa revue du praticien
(Agence française de sécurité sanitaire des produits desanté) que si nécessaire. Leur utilisation en traitementcuratif n'est même pas mentionnée par l'AFSSPSmême si elles sont largement utilisées sur le terrain.Par ailleurs, aucune héparine ne passe pas dans le laitet toutes peuvent donc être utilisées pendantl'allaitement.• Contre-indicationsLes principales contre-indications sont identiques pourles héparines de bas poids moléculaire et l'héparinenon fractionnée : les antécédents de thrombopénieinduite par l'héparine, la diathèse hémorragique,l'hémorragie en cours et enfin classiquementl'endocardite infectieuse. Toutes les ponctionsartérielles et la péridurale sont égalementcontre-indiquées en cas de traitement héparinique.En cas d'insuffisance rénale sévère avec une clairancede la créatinine < 30 mL/min, les héparines de baspoids moléculaire sont contre-indiquées en curatif etdéconseillées en préventif.• Effets indésirables1. HémorragiesAu cours du traitement curatif, la fréquence desaccidents hémorragiques graves est d'environ 5 %. Cesaccidents peuvent survenir dans des circonstancesdiverses le plus souvent par surdosage par erreurthérapeutique (injection biquotidienne des formesconcentrées prévues pour une seule injection/j, duréedu traitement au delà de 10 j, accumulation deshéparines de bas poids moléculaires lors d'uneinsuffisance rénale sévère...) ou après des gestesagressifs (ponctions artérielles ou biopsies).Le sulfate de protamine neutralise complètementl'activité du facteur IIa mais incomplètement l'activitédu facteur Xa. Il est donc plus difficile de neutraliserl'effet des héparines de bas poids moléculaire quecelui de l'héparine non fractionnée. Pour neutraliser100 UI d'héparine non fractionnée, il faut 1 mg desulfate de protamine. Des réactions rares mais sévèresd'intolérance avec bradycardie et hypotension sontdécrites, ainsi que des réactions anaphylactiques chezun patient déjà sensibilisé. Pour toutes ces raisons, cetantidote est très rarement utilisé.2. ThrombopéniesElles sont de 2 types- la thrombopénie apparaissant dès les premiers joursde traitement ou thrombopénie de type I qui restemodérée, disparaît à la fin de la première semaine etest sans conséquence clinique;- la thrombopénie de type II dite thrombopénie induitepar l'héparine (TIH).Celle-ci est d'origine immuno-allergique et s'exprimebeaucoup plus souvent par des thromboses artériellesou veineuses (apparition d'une thrombose ouaggravation d'une thrombose déjà présente) que pardes hémorragies. Aussi, tout accident thrombotiquesurvenant sous héparme doit immédiatement faireévoquer la thrombopénie induite par l'héparine. Ellearrive plus souvent sous héparine non fractionnée quesous héparine de bas poids moléculaire. Elle estdéfinie par un chiffre plaquettaire < 100 000 et (ou)une chute relative des plaquettes de 30 à 50 % sur 2numérations successives. Elle apparaît essentiellemententre le 5e et le 21e j suivant l'instauration dutraitement héparinique avec un pic de fréquence au l0èm j, mais elle peut apparaître plus tôt en cas detraitement antérieur et après le 21e j en cas detraitement prolongé par héparine de bas poidsmoléculaire. Toute forte suspicion de thrombopénieinduite par l'héparine doit faire arrêter immédiatementl'héparinothérapie en cours et faire demander les testsbiologiques de confirmation.3. Manifestations dermatologiques -Il s'agit le plus souvent d'urticaire voire de nodules etexceptionnellement de nécroses cutanées au pointd'injection. Sur le plan biologique, il s'y associeparfois une éosinophilie importante.4. Réactions allergiquesLes réactions d'hypersensibilité à l'héparine sont trèsrares. Les symptômes principalement retrouvés sont:le bronchospasme, les conjonctivites, les rhinites, latachycardie et l'hypertension, les manifestations lesplus sévères étant l'oedème angioneurotique et le chocallergique. Sur le plan biologique, il peut s'y associerégalement une hyperéosinophilie.La revue du praticien
5. OstéoporoseDes phénomènes d'ostéoporose ont été constatésparfois lors de traitement au long cours par héparine,particulièrement au cours de la grossesse. Leshéparines de bas poids moléculaire exposeraientmoins à ce risque que l'héparine non fractionnée.6. Perturbations métaboliquesLe traitement par héparine peut entraîner unhypo-aldostéronisme responsable d'hyperkaliémierarement sévère, sauf en cas d'association à desthérapeutiques hyperkaliémiantes.Il est souvent observé une augmentation destransaminases réversible à l'arrêt du traitement et sansaucune conséquence clinique.• PharmacocinétiqueLes <strong>antivitamines</strong> K ont une absorption intestinalecomplète et se fixent à 98 % aux protéinesplasmatiques. Seule la fraction libre est active. Leurmétabolisme est essentiellement hépatique, lesmétabolites étant éliminés dans les urines et les selles.La classe des indanediones a une affinité plus forteaux protéines par rapport aux coumariniques (tableauVIII).Tableau 8Médicament.Caractéristiques des différentes<strong>antivitamines</strong> KDemi-vie(h)Dose/cp(mg)Antivitamines K : principes et règlesd'utilisation posologie• • Origine et structureLes <strong>antivitamines</strong> K peuvent être regroupées en 2classes (tableau VII) : les dérivés de la coumarine etles dérivés de l'indanedione.Tableau 7Classes des <strong>antivitamines</strong> KClasse Spécialité ,Coumarini iresacénocoumarol Sintrom0warfarineCoumadinetioclomarolApegmoneIndanedionesfluorophénylindanedionePréviscanphénindione PindioneDemi-vie courteAcénocoumarol? Sintom (sécable)? Mini Sintrom nonsécable)Phénindione? PindioneDemi-vie longueWarfarine? Coumadine(sécableTiclomarol? ApegmoneFludione? Préviscan (sécable)8,7 45 à 10 506 à 42 2 et 1024 431 20• Mécanisme d'actionLe mécanisme d'action de toutes les <strong>antivitamines</strong> Kest identique, elles agissent au niveau de l'hépatocytedans le mécanisme de réduction de la vitamine K.Elles inhibent la carboxylation des facteurs II, VII, IX,X et des protéines C et S. La diminution des facteursde la coagulation dépendants de la vitamine K estfonction de leur demivie d'élimination (6 h pour lefacteur VII et la protéine C, 2 à 3 j pour les facteurs Xet II).La revue du praticien
• Modalités du traitementEn raison de la bonne absorption digestive,l'administration se fait essentiellement par voie orale.II est déconseillé d'utiliser une dose de charge. Celle-cipeut être dangereuse en cas de sensibilité individuelleaux <strong>antivitamines</strong> K et peut entraîner uneaugmentation transitoire du risque thrombotique pardiminution précoce et importante de la protéine C.Pour cette même raison, un traitement par<strong>antivitamines</strong> K ne doit jamais être débuté seul mais enrelais d'un traitement héparinique à maintenir pendantle temps nécessaire pour être efficace. Pendant lapériode de relais, le traitement par héparine (héparinenon fractionnée ou héparines de bas poidsmoléculaire) doit être poursuivi pendant une durée de5 à 7 j et ne peut être interrompu qu'après obtentiond'un INR (international normalized ratio) supérieur à2 sur 2 contrôles successifs (tableau IX).Les modalités d'arrêt du traitement sont laissées à ladiscrétion des prescripteurs.Il n'existe actuellement aucun critère scientifiquevalidé permettant de choisir une antivitamine K plutôtqu'une autre. Les <strong>antivitamines</strong> K à demi-vie courtepermettent d'atteindre plus rapidement la posologied'équilibre et pour la même raison l'effet s'estompeplus vite après l'arrêt. Par contre, pour une meilleurestabilité de l'INR, les <strong>antivitamines</strong> K à demi-vielongue sont préconisées en cas de traitement au longcours.Il n'est pas rare de trouver des malades chez qui defortes doses d'<strong>antivitamines</strong> K sont nécessaires pourmaintenir l'INR dans les taux thérapeutiques désirés.L'absence d'hypocoagulabilité doit absolument fairerechercher avant tout une mauvaise observance dupatient, mais aussi une interaction médicamenteuse oualimentaire, voire même une erreur de laboratoire.Parfois, des difficultés d'adaptation thérapeutiquepeuvent être rencontrées chez des patients présentantdes anomalies métaboliques telles que lesdysthyroidies ou, plus rarement, un syndrome demalabsorption digestive.En cas de modification posologique de l'antivitamineK, il est nécessaire d'attendre une semaine avant unnouveau contrôle.Dans tous les cas, l'éducation du patient est essentielled'autant qu'un traitement au long cours est nécessaire.• • IndicationsLes <strong>antivitamines</strong> K ne constituent en aucun cas unethérapeutique d'urgence en raison de leur délaid'action. Avant de débuter un traitement anticoagulant,il faut rechercher l'existence d'une contre-indicationcomportant un risque hémorragique potentiellementvital et de s'assurer de la bonne observance potentielledu traitement (contexte psychologique et social,éthylisme...). L'âge n'est plus à lui seul unecontre-indication à condition que le risque de chutesoit écarté.Au delà de 70 ans, on propose de diminuer la doseinitiale de 1 quart. En cas d'insuffisance rénalechronique sévère, les posologies administrées doiventêtre plus faibles et la surveillance de l'11VR plusrapprochée.• SurveillanceIl n'existe pas de posologie standard et le traitementdoit obligatoirement être adapté au temps de Quickexprimé aujourd'hui en INR plutôt qu'en taux deprothrombine, pour se rapprocher d'une réponsestandardisée. Le niveau d'INR souhaité et la durée detraitement sont dépendants de la maladie. L'obtentionde cet objectif est absolument fondamentale carcelui-ci permet de limiter considérablement les risqueshémorragiques du traitement et d'optimiser sonefficacité.La revue du praticien
Tableau 9Modalités du relais <strong>antivitamines</strong> KINR . Sintrom Prëvisean . C'oumadine< 70 ans-' > 70 ans < 70 ans > 70 ansJO < 1,2 1 cp 3/4 1 cp 6 mg 4 mgJl ' '' _ _ _ 1 cp 3/4 1 cp 6 mg ., 4 mgJ2 - < 1,3 1 cp + F 1 cp 1 cp + F 8 mg 6 mg1,3 à 1,7 . 1 cp G 1 cp 6 mg 4 mg1,7 à 2 Ü° cp 3/4 cp Ù` cp 4 mg 2 mg> 2 - 3/4 cp 3/4 cp 3/4 cp 2 mg 0J3Idem J2J4 < 1,6 + 3/4+ 3/4 cpcp1,6 à 2,5 idem idem Modifier les posologies> 2,5 -F cp -P cp par 0,5 mg> 3 - 3/4 cp - 3/4 cp1. Fibrillation auriculaireUne méta-analyse a montré que les <strong>antivitamines</strong> Kdans l'accident vasculaire cérébral s'avèrent enmoyenne supérieures à l'absence de traitement et àl'aspirine. L'INR recherché doit alors être comprisentre 2 et 3 pour obtenir un bon rapportbénéfice/risque.2. Prothèses valvulaires cardiaquesIl est maintenant établi que le risquethromboembolique est lié au type de prothèsevalvulaire, à la localisation aortique ou mitrale et,enfin, à la présence d'une arythmie par fibrillationauriculaire (ACFA) associée. Le niveaud'anticoagulation et l'INR recherché dépendent doncde ces différents paramètres (tableau X).Tableau 10Niveaux d'INR recommandésen fonction des prothèses valvulaires.=„,~--: Niveau d'INR .Prothèse initiale 3 à 4,5Prothèse aortiqueD IR génération en rythme 3 à 4,5sinusalO 2o génération en rythme 2 à 3sinusalO Arythmie par fibrillation 3 à 4,5auriculaireProthèse tricuspide 2 à 3Prothèse biologiqueINR: International normolizedratio.3. Maladie veineuse thromboemboliqueLa durée du traitement reste encore controversée et està discuter en fonction des circonstances d'apparitionde l'épisode thromboembolique, du contextepathologique et de la présence d'une thrombophilie(tableau XI).• • Grossesse et allaitementLa période à risque est comprise entre la 8c et la 12esemaine d'aménorrhée, il s'agit de « l'embryopathiecoumarinique ». Si une grossesse débute sous<strong>antivitamines</strong> K, le passage à l'héparine doit se faireavant la 6e semaine de grossesse. Au cours des 2e et3e trimestres, il est également décrit des anomaliescérébrales probablement en rapport avec deshémorragies intracérébrales. Aussi, s'oriente-t-on deplus en plus vers un traitement par héparine tout aulong de la grossesse.La revue du praticien
Tableau 11Durée du traitement<strong>antivitamines</strong> KCaractéristiques des patients1er - événementthromboembolique associé à unfacteur déclenchant réversible*1er épisode idiopathiqueRécidive de maladie veineusethromboembolique ou facteurfavorisant non réversible"Durée dutraitement~ 3 mois~ 6 mois~ 12 moisThrombose distale (surale 6 à 12 semainesstricte)* Chirurgie, traumatixne, immobilisationtemporaire, ostrogènes.** Cancer, déficit antithrombine III,anticoagulant circulantIl est par conséquent indispensable d'assurer unecontraception efficace chez les femmes en âge deprocréer sous traitement par <strong>antivitamines</strong> K et deréaliser un test de grossesse en urgence devant toutretard de règles.L'allaitement est contre-indiqué avec le groupe desindanediones.La warfarine apparaît dans le lait maternel sous formeinactive et les nouveau-nés allaités par une mèretraitée par Coumadine n'ont pas de modification deleur taux de prothrombine. Néanmoins, à ce jour,l'allaitement est à éviter avec les coumariniques. Encas d'allaitement, un apport de vitamine Kl aunouveau-né est recommandé.• • Effets indésirablesLa classe des indanediones est susceptible d'induiredes effets indésirables spécifiques, notammentimmunoallergiques qui, bien que rares, peuvent êtregraves. La nécrose cutanée est exceptionnelle etsurvient en cas de déficit en protéines C ou S.Les complications hémorragiques représentent l'effetiatrogénique le plus important. Il est indispensable derechercher en 1- lieu un surdosage, le plus souvent encause, et de démasquer des lésions sous-jacentessusceptibles de saigner (maladie néoplasique, ulcèregastroduodénal...). Toute manifestation cliniqueinopinée chez un patient sous <strong>antivitamines</strong> K, afortiori en cas d'INR élevé, doit faire évoquer deprincipe un hématome profond (hématome du psoas,hémato-rachis, hématome sous-ducal, hématomerétropéritonéal...).En fonction de la gravité des manifestationshémorragiques, différents antidotes sont disponibles.Dans tous les cas, le traitement par <strong>antivitamines</strong> Kdoit être arrêté.Les hémorragies majeures responsables d'une chute dutaux d'hémoglobine nécessitent une correction rapidede l'hémostase par l'administration de fractions PPSB(prothrombine proaccélérine facteurs Stuartantihémophilique B) du plasma. La dose préconiséeest de 10 à 20 UIde facteur IX/kg auquel il faut associer une injectionintraveineuse lente de vitamine K1 (5 à 10 mg) pournormaliser la coagulation.Les hémorragies mineures ou un surdosageuniquement biologique peuvent être corrigés parl'administration de petite doses de vitamine KI enintraveineuse lente ou per os (0,5 à 2 mg).• • Interactions médicamenteusesDe nombreux médicaments ont une activité inhibitriceou potentialisatrice sur les <strong>antivitamines</strong> K (tableauXII). Les mécanismes d'interaction médicamenteusesont nombreux et variés. Les plus dangereux étantceux qui modifient la liaison des <strong>antivitamines</strong> K auxprotéines plasmatiques qui sont donc contre-indiquéesen raison du risque hémorragique immédiat.Les interactions médicamenteuses sont variables d'unindividu à un autre. Quoi qu'il en soit, il est impératif,en cas de modifications thérapeutiques associées autraitement <strong>antivitamines</strong> K, d'augmenter la fréquencedes contrôles des INR afin d'ajuster éventuellement ladose.• • Contre-indicationsEn cas de situation hémorragique évolutive,l'indication de débuter ou poursuivre un traitement par<strong>antivitamines</strong> K doit être prise en fonction du rapportbénéfice-risque propre à chaque situation.Les ponctions artérielles, lombaires et les injectionsintramusculaires sont contre-indiquées sous ce type detraitement.La revue du praticien
Points Forts à retenir :• Les héparines de bas poids moléculaire ontsupplanté l'héparine non fractionnée dans letraitement de la maladie veineusethromboembolique en raison d'une meilleuresécurité pour une efficacité équivalente et d'uneplus grande sécurité d'utilisation permettant deplus en plus un traitement à domicile. ,• Cette simplicité entraîne cependant unebanalisation du traitement par héparines de baspoids moléculaire. Cette banalisation et ladiversité des modes de présentation sont sourcesd'erreurs thérapeutiques graves telles quel'utilisation d'héparines de bas poids moléculaire àdoses curatives en cas d'insuffisance rénalesévère.• La thrombopénie induite à l'héparine doit êtreévoquée devant tout accident thrombotique ettoute aggravation d'une thrombose survenantchez un malade traité à l'héparine.• Certaines héparines de bas poids moléculaire,~` ont maintenant l'autorisation de mise sur lemarché, en association à l'aspirine, dans l'angorinstable et l'infarctus sans onde Q.• Les <strong>antivitamines</strong> K ont un indexthérapeutique particulièrement étroit etconstituent la première cause d'accidentsiatrogéniques en France.• Toute manifestation clinique inopinée chez unmalade sous <strong>antivitamines</strong> K doit faire évoquerde principe la possibilité d'un hématome profond.• L'optimisation du traitement est grandementaméliorée par une surveillance biologiquerapprochée et par l'éducation du malade de façonà maintenir l'INR dans la fourchette souhaitée.Tableau 12Liste non exhaustive des médicaments interférant avec les <strong>antivitamines</strong> KMédicaments augmentant L'effet anticoagulant ~ Médicaments diminuantl'effet anticoagulantAssociations contreindiquées• miconazole (Dalctarin)millepertuis• phénylbutazone• acide salycilyque 3 3 g/jAssociationsdéconseillées• acide acétylsalicylique < 3 g/j• anti-inflammatoires non-stéroidiens• chloramphénicol '~Associations nécessitant• ticlopidine (Ticlid)carbamazépine (Tégrétol)des précautions d'emploi• amiodarone• inhibiteurs de l'HMG CoA-réductase• antidépresseurs sérotoninergiques purs• antibiotiques: céphalosporines,fluoroquinolones, macrolides, cyclines• ffbrates• sulfamides• cimétidine > 800 mg/j• hormones thyroïdiennes• isoniazidecholestyramme (Questran)La revue du praticien