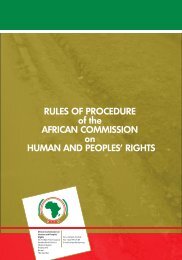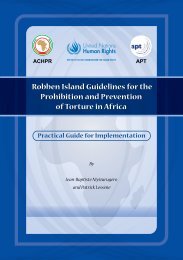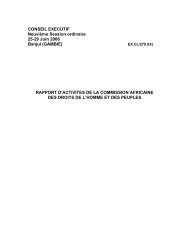Français - African Commission on Human and Peoples' Rights
Français - African Commission on Human and Peoples' Rights
Français - African Commission on Human and Peoples' Rights
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
BURKINA FASOUNITE PROGRES JUSTICE.MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.LaRAPPÔRT'INÎ. i_DUBURKE\A4;FASOSUR LA PROI■iiI01101IP ET i-r intRITECTION DESDROITSADEOMM ErOCTOBRE 1998
2SOMMAIRE.TABLE DES SIGLES 3INTRODUCTION GENERALE. 7PARTIE PRELIMINAIRE : LE BURKINA FASO ETAT DES LIEUX 9I. HISTOIRE POLITIQUE DU BURKINA FASO. 11II. REALITE POLITIQUE ACTUELLE. 17III. RÉALITÉS ECONOMIQUES 24PARTIE I : LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 33I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 33II. MISE EN ŒUVRE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 44PARTIE II : LA PROMOTION DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS 73I. PROTECTION DES DROITS ECONOMIQUES. 74II. DROIT A L'EDUCATION. 79III. NIVEAU DE VIE, ALIMENTATION, SANTE ET LOGEMENT. 86IV. FAMILLE ET PROTECTION DES GROUPES SOCIAUX SENSIBLES. 106PARTIE III : LE RESPECT DES DROITS DES PEUPLES. 116I. L'EGALITE. 116II. LE DROIT A L'AUTODETERMINATION. 117III. LE DROIT A LA PAIX ET A LA SECURITE. 118IV. LES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES PEUPLES. 119PARTIE IV : LE RESPECT DES DEVOIRS SPECIFIQUES DE LA CHARTE 122I. LE DEVOIR DE SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA CHARTE. 122II. LE DEVOIR DE GARANTIR L'INDEPENDANCE DES TRIBUNAUX. 124III. LES DEVOIRS SPECIFIQUES DE TOUS. 125CONCLUSION GENERALE 127TABLE DES TEXTES JURIDIQUES 128TABLE DES MATIERES. 130
3TABLE DES SIGLES.ACAT :ADF :ADP :AEMO :AMBF :ANC :Acti<strong>on</strong> des Chrétiens pour l'Aboliti<strong>on</strong> de la Torture.Alliance pour la Démocratie et la Fédérati<strong>on</strong>.Assemblée des Députés du Peuple.Activités éducatives en milieu ouvert.Associati<strong>on</strong> des Maires du Burkina Faso.<str<strong>on</strong>g>African</str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>al C<strong>on</strong>gress (C<strong>on</strong>grès Nati<strong>on</strong>al Africain).APED-Liberté :Associati<strong>on</strong> pour la Promoti<strong>on</strong> des Droits et Libertés.ASVE :AT :ATG :AVB :AVE :BPAF :CADSS :CAMEG :CASEM :CDP :CDR :CEBNF :Activités de suivi visite des exploitati<strong>on</strong>s.Assemblée Territoriale.Activités de travail en groupe.Agent vulgarisateur de base.Activités de visite des exploitati<strong>on</strong>s.Bureau de Promoti<strong>on</strong> des Activités des Femmes.Cellule d'Appui à la Décentralisati<strong>on</strong> du Système de Santé.Central d'Approvisi<strong>on</strong>nement en Médicaments Essentiels Génériques.C<strong>on</strong>seil d'Administrati<strong>on</strong> des Secteurs Ministériels.C<strong>on</strong>grès pour la Démocratie et le Progrès.Comité de défense de la Révoluti<strong>on</strong>.Centre d'Educati<strong>on</strong> de Base N<strong>on</strong> Formel.CEDEAO : Communauté Ec<strong>on</strong>omique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.CENI :CFD :CGTB :CHN :CHR :<str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>ale Electorale Indépendante.Coordinati<strong>on</strong> des Forces Démocratiques.C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> Générale des Travailleurs du Burkina.Centres Hospitaliers Nati<strong>on</strong>aux.Centres Hospitaliers Régi<strong>on</strong>aux.CNTB :C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale des Travailleurs du Burkina.CM : Centres Médicaux .
4CMA :CMRPN :CND :CNPLE :Centres Médicaux avec Antenne chirurgicale.Comité Militaire de Redressement pour le Progrès Nati<strong>on</strong>al.<str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>ale de la Décentralisati<strong>on</strong>.Comité Nati<strong>on</strong>al de Lutte c<strong>on</strong>tre la Pratique de l'Excisi<strong>on</strong>.CNPP-PSD : C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale des Patriotes Progressistes, Parti SocialDémocrate.CNR :C<strong>on</strong>seil Nati<strong>on</strong>al de la Révoluti<strong>on</strong>.CODESUR : Comité Départemental de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>.CONAREF : <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>ale pour les Réfugiés.CONASUR : Comité Nati<strong>on</strong>al de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>.COPROSUR :Comité Provincial de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>.COVISUR : Comité Villageois de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>.CP :CRPA :CSFA :CSN :CSPS :DPS :DSAP :EVF :FAARF :Code Pénal.Centres Régi<strong>on</strong>aux de Promoti<strong>on</strong> Agro-pastorale.C<strong>on</strong>seil Supérieur des Forces Armées.Caisse de Solidarité Nati<strong>on</strong>ale.Centres de Santé et de Promoti<strong>on</strong> Sociale.Directi<strong>on</strong> Provinciale de la Santé.Directi<strong>on</strong> des Statistiques Agro-Pastorales.Educati<strong>on</strong> à la Vie Familiale.F<strong>on</strong>ds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes.FODECOM : F<strong>on</strong>ds de Démarrage des Communes.FONALEP : F<strong>on</strong>ds Nati<strong>on</strong>al de Lutte c<strong>on</strong>tre les Epidémies.FP :Fr<strong>on</strong>t Populaire.GERDDES : Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie et leDéveloppement Ec<strong>on</strong>omique et Social.GMP :GRN :HCR :LDLP :Gouvernement Militaire Provisoire.Gouvernement du Renouveau Nati<strong>on</strong>al.Haut Commissariat pour les Réfugiés.Ligue de Défense de la Liberté de la Presse.
5MARA :MBDHP :MNR :MST :Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples.Mouvement du Renouveau Nati<strong>on</strong>al.Maladies Sexuellement Transmissibles.ODP-MT : Organisati<strong>on</strong> pour la Démocratie Populaire, Mouvement du Travail.ONG :ONU :OUA :PAM :PAPEM :PAS :Organisati<strong>on</strong> N<strong>on</strong> Gouvernementale.Organisati<strong>on</strong> des Nati<strong>on</strong>s Unies.Organisati<strong>on</strong> de l'Unité Africaine.Paquet Minimum d'Activités.Point d'Appui de Pré-vulgarisati<strong>on</strong> et d'Expérimentati<strong>on</strong> Multi-locale.Programme d'ajustement structurel.PATECORE :Projet Aménagement des Terroirs et C<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des Ressources dansle Plateau Central.PCF :PD :PDP :PDRI :PDSN :PEV :PSN :RDA :RDP :Parti Communiste Français.Parcelle de Dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong>.Parti pour la Démocratie et le Progrès.Projet de Développement Rural Intégré.Plan de Développement Sanitaire Nati<strong>on</strong>al.Programme Elargi de Vaccinati<strong>on</strong>.Politique Nati<strong>on</strong>ale Sanitaire.Rassemblement Démocratique Africain.Révoluti<strong>on</strong> Démocratique et Populaire.SAGEDECOM :Service d'Appui à la Gesti<strong>on</strong> et au Développement Communal.SBCP :SBMC :SIAO :Société Burkinabé des Cuirs et Peaux.Société Burkinabé de la Manufacture et du Cuir.Sal<strong>on</strong> Internati<strong>on</strong>al de l'Artisanat de Ouagadougou.SOFITEX : Société des Fibres Textiles.SONAGESS :Société Nati<strong>on</strong>ale de Gesti<strong>on</strong> de Stock et de Sécurité.SR :SWAPO :Santé de la Reproducti<strong>on</strong>.South west <str<strong>on</strong>g>African</str<strong>on</strong>g> People Organisati<strong>on</strong> (Organisati<strong>on</strong> du Peuple SudOuest Africain.
TD :TPR :TVA :UEMOA :UMOA :UF :UPV :UNDD :Troupeau de Dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong>.Tribunaux Populaires de la Révoluti<strong>on</strong>.Taxe sur la Valeur Ajoutée.Uni<strong>on</strong> Ec<strong>on</strong>omique et M<strong>on</strong>étaire Ouest Africaine.Uni<strong>on</strong> M<strong>on</strong>étaire Ouest Africaine.Uni<strong>on</strong> Française.Uni<strong>on</strong> Progressiste Voltaïque.Uni<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale pour le Développement de la Démocratie.
7INTRODUCTION GENERALE.Le Burkina Faso après avoir participé à l'élaborati<strong>on</strong> et à l'adopti<strong>on</strong> en 1981 de laCharte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples a procédé à sa signature le05 mars 1984 puis à sa ratificati<strong>on</strong> le 06 juillet 1984.L'entrée en vigueur de ladite «Charte» en 1986 obligeait chaque Etat partie,c<strong>on</strong>formément à l'article 62 de procéder au dépôt, tous les deux ans, devant la<str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, d'un rapport sur lasituati<strong>on</strong> des droits de l'homme dans chaque pays.Le Burkina Faso a pendant l<strong>on</strong>gtemps manqué a cette obligati<strong>on</strong>.La présentati<strong>on</strong> de ce rapport initial dans un c<strong>on</strong>texte historique de retour duBurkina Faso à un Etat de droit et à une démocratie républicaine, témoigne d'unepart, la vol<strong>on</strong>té d'assumer les obligati<strong>on</strong>s vis-à-vis de la Charte, en indiquant lesmesures d'ordre législatif et autres, prises en vue de d<strong>on</strong>ner effets aux droits etlibertés rec<strong>on</strong>nus et garantis par la Charte, et d'autre part la nouvelle dimensi<strong>on</strong>politique que le Burkina Faso accorde désormais à la protecti<strong>on</strong> et à la promoti<strong>on</strong>des droits de l'homme.Il reflète les réalisati<strong>on</strong>s que le Burkina Faso a fait en matière de protecti<strong>on</strong>, degarantie et de promoti<strong>on</strong> des droits de l'homme. Il indique aussi la mesure danslaquelle les autorités politiques et administratives <strong>on</strong>t d<strong>on</strong>né effet aux droits et auxlibertés f<strong>on</strong>damentales én<strong>on</strong>cés dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme etdes Peuples.
8Ce rapport permettra à la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Africaine des Droits de l'homme et desPeuples ainsi qu'à toute autre instituti<strong>on</strong> ou observateur intéressé, d'apprécier lajuste mesure des efforts c<strong>on</strong>sentis par le Burkina Faso en la matière et l'évoluti<strong>on</strong>sensible des moyens de protecti<strong>on</strong> des droits de l'Homme. Il est présenté, suivantla nomenclature des différents aspects des droits de l'Homme tel que cela estenvisagé et traité par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.Ainsi, il sera traité successivement :La protecti<strong>on</strong> des droits civils et politiques,La promoti<strong>on</strong> des droits éc<strong>on</strong>omiques et sociaux,Le soutien aux droits des Peuples,Le respect des devoirs spécifiques de la Charte.
9PARTIE PRELIMINAIRE : LE BURKINA FASO, ETAT DES LIEUX.Pays sans littoral situé au coeur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, (ex Haute-Volta), a une superficie de 274.000 km2. Limité au Nord et à l'Ouest par le Mali, auSud par le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, à l'Est par le Niger, il estcompris entre 9°20 et 15°5 de latitude Nord et 2°20 et 3°3 de l<strong>on</strong>gitude Ouest.S<strong>on</strong> relief est uniforme et plat, comprenant un plateau central occupant les troisquartsdu territoire surplombé par deux plateaux latéraux. Le point culminant, leTena-Kourou s'élève à 747 m d'altitude et se trouve à l'Ouest du pays.Le Burkina Faso possède un réseau hydrographique relativement important ; il estarrosé par :• Le Mouhoun, le Nazin<strong>on</strong> et le Nakambé qui coulent du Nord au Sud pour serejoindre au Ghana avant de se jeter dans le Golfe de Guinée.• La Comoé qui prend sa source dans la régi<strong>on</strong> de Banfora et qui traverse laCôte d'Ivoire pour se jeter dans l'Océan Atlantique.Le climat tropical de type soudanien c<strong>on</strong>naît une alternance de deux sais<strong>on</strong>sinégales : une l<strong>on</strong>gue sais<strong>on</strong> sèche (octobre - avril) et une courte sais<strong>on</strong> des pluies(mai - septembre).Le Burkina Faso est divisé en 45 provinces, 377 départements et 8000 villages .Sa populati<strong>on</strong> estimée à 10.373.651 en 1997 comprend 52% de femmes et a untaux de croissance de 2,68%. Elle est caractérisée par sa jeunesse (50% de moinsde 15 ans), s<strong>on</strong> aspect essentiellement rural (85% habitent les z<strong>on</strong>es rurales). Ilexiste d'importants courants de migrati<strong>on</strong>s tant internes (du Nord vers le Sud etSud-Ouest) qu'externes (vers la Côte d'Ivoire et le Ghana).Le taux de mortalité infantile est de 134 pour mille, celui de la mortalité maternellede 6,5 pour mille. L'espérance de vie oscille entre 48 et 50 ans.
10Du point de vue des caractéristiques socio-culturelles, le Burkina Faso est un Etatmultinati<strong>on</strong>al de plus d'une soixantaine d'ethnies d<strong>on</strong>t :• Mossi : 48%• Peulh : 11%• Lobi-Dagara : 8%• M<strong>and</strong>é : 7%• Bobo : 6,7%• Senoufo : 5,4%• Gourounsi : 5,3%• Bissa : 4,7%• Gourmatché : 4,5%.La langue officielle est le français. Parmi les langues nati<strong>on</strong>ales, les plus parléess<strong>on</strong>t : le mooré, le djula et le fulfuldé.Du point de vue de la religi<strong>on</strong>, la populati<strong>on</strong> se repartit comme suit :• Animistes : 57,8%• Musulmans : 30,7%• Catholiques : 10,6%• Protestants : 1,3%.La répartiti<strong>on</strong> socioprofessi<strong>on</strong>nelle de la populati<strong>on</strong> active s'établit comme suit :• agriculture et élevage : 85,01 %• autres activités rurales : 6,8%• industrie et artisanat : 4%• services : 4,2%.
11I. HISTOIRE POLITIQUE DU BURKINA FASO.1. La période précol<strong>on</strong>iale.Jusqu'à la fin du siècle dernier, la géopolitique du Burkina Faso précol<strong>on</strong>ial étaitmarquée par deux entités relativement bien distinctes de par la structure desformati<strong>on</strong>s politiques en place :• Un bloc oriental de sociétés étatiques.A l'extrémité septentri<strong>on</strong>ale de ce bloc, les Peuhl avaient f<strong>on</strong>dé les chefferies duDjelgodji (Djibo) et l'émirat du Liptako (Dori). Plus à l'est, se trouvaient lesroyaumes du Gourma ou Gulmu (pays des gourmantché) centrés sur FadaN'Gourma. Enfin, la partie centrale corresp<strong>on</strong>dait au Mogho (pays des Mossi). Sur leplan politique, le Mogho était en réalité un m<strong>on</strong>de pluriel. Outre le royaume deOuagadougou d<strong>on</strong>t le chef portait le titre de Mogho-Naba (souverain des Mossi), <strong>on</strong>y renc<strong>on</strong>trait aussi les royaumes du Yatenga (capitale Ouahigouya), Tenkodogo(voisin du pays bissa) et Boussouma pour ne citer que les plus influents.• Un bloc occidental dominé par des sociétés « sans Etat ».A la fin du 19e siècle, le Gwiriko, f<strong>on</strong>dé par des Dioula originaires du royaume deK<strong>on</strong>g (actuelle Côte d'Ivoire), avait pratiquement échoué dans sa tentative d'édifierun vaste territoire au centre de l'ouest Burkina actuel (régi<strong>on</strong> de Bobo-Dioulasso)sous leur dominati<strong>on</strong> politique. D'aucuns <strong>on</strong>t qualifié cette entité de « ficti<strong>on</strong>d'empire » car, miné de l'intérieur par les rivalités entre princes Ouattara, le Gwirik<strong>on</strong>'avait pu faire face à la révolte des populati<strong>on</strong>s à commencer par les Bobo euxmêmes,les Bwaba, les Tiéfo, les Toussian et les Sembla principalement. De même,les principautés musulmanes peuhl ou marka de Barani, Ouidi, D<strong>on</strong>kui, Safané etOuahabou, qui avaient vocati<strong>on</strong> de c<strong>on</strong>struire des théocraties par la guerre sainte,étaient demeurées des enclaves, voire des centres de diffusi<strong>on</strong> de l'islam àl'intérieur ou aux marges des pays Bwaba et Samo. Ces derniers c<strong>on</strong>tinuaient àvivre dans de nombreuses communautés villageoises indépendantes les unes desautres. Enfin, l'extrémité méridi<strong>on</strong>ale était occupée par les populati<strong>on</strong>s àorganisati<strong>on</strong> dite lignagère où la seule « autorité » plutôt sacerdotale rec<strong>on</strong>nue étaitcelle du maître de la terre. Ce s<strong>on</strong>t, les populati<strong>on</strong>s apparentées du sud-ouest
12majoritairement composées des Lobi et Dagara, et de certaines fracti<strong>on</strong>s de lamosaïque gourounsi (Léla, Ko...).Certes, la gér<strong>on</strong>tocratie qui régissait les sociétés sans Etat et les m<strong>on</strong>archies plusou moins centralisées des royaumes et chefferies ne f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naient pas sur desbases démocratiques au sens occidental du mot. Mais, ces systèmes politiquesassuraient l'équilibre des sociétés qui les avaient produites pour elles-mêmes,c<strong>on</strong>trairement au régime col<strong>on</strong>ial aux f<strong>on</strong>dements exogènes.2. La période col<strong>on</strong>iale.C'est à la c<strong>on</strong>férence de Berlin (1884-1885) que les puissances occidentalesfixèrent les règles du jeu qui allaient c<strong>on</strong>duire au partage de l'Afrique. S'agissantdes territoires du Burkina Faso actuel en particulier, leur c<strong>on</strong>quête et leurréorganisati<strong>on</strong> commençèrent une décennie après cet événement.• La genèse et les avatars de la Haute-Volta (1886-1947).Entre 1886 et 1894, les pays du Burkina Faso actuels furent sill<strong>on</strong>nés par lesexplorateurs européens qui passaient pour être de simples chercheurs de traitésd'amitié avec les souverains en place. A compter de 1895, et ce jusqu'aux années1900, ce fut la c<strong>on</strong>quête proprement dite des territoires rattachés à l'Afriqueoccidentale française (AOF) d<strong>on</strong>t Dakar était la capitale, et plus particulièrement à lacol<strong>on</strong>ie du Haut-Sénégal-Niger (chef-lieu Bamako).Quels que soient les aspects positifs de l'occupati<strong>on</strong> col<strong>on</strong>iale, celle-ci avait instauréun Etat d'excepti<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tre lequel les populati<strong>on</strong>s protestaient sous plusieursformes. Elles s'opposaient notamment aux recrutements militaires et aux travauxforcés et <strong>on</strong> réprouvé plus tard le code de l'indigénat qui permettait au col<strong>on</strong>isateurd'empris<strong>on</strong>ner les « indigènes » sans jugement. En 1915-1916 par exemple,l'autorité col<strong>on</strong>iale eut à réprimer dans le sang une vaste insurrecti<strong>on</strong> populairec<strong>on</strong>tre les exacti<strong>on</strong>s de l'Administrati<strong>on</strong> dans l'ouest Burkina actuel.Néanmoins, le décret du premier mars 1919 créait la col<strong>on</strong>ie aut<strong>on</strong>ome de Haute-Volta. Il s'agissait de palier les c<strong>on</strong>séquences éc<strong>on</strong>omiques de la première guerrem<strong>on</strong>diale par une meilleure organisati<strong>on</strong> administrative de l'AOF. Mais le lieutenantgouverneurinstallé à Ouagadougou n'exerça ses f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s que durant 13 ans
13seulement.En effet, pour faire face aux difficultés financières nées de la crise éc<strong>on</strong>omique de1929-1930, le gouvernement français, soucieux de diminuer les frais def<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des col<strong>on</strong>ies, décida de supprimer la Haute-Volta. C<strong>on</strong>formémentau décret du 5 septembre 1932 pris dans ce sens, les cercles voltaïques furentrepartis entre le Niger, le Soudan français (actuel Mali), et la Côte-d'Ivoire. Lachefferie mossi n'accepta jamais ce démantèlement du territoire et l'éparpillementde ses ethnies. Sous l'impulsi<strong>on</strong> du Mogho-Naba et des élites voltaïques (toutesappartenances ethniques c<strong>on</strong>f<strong>on</strong>dues) des luttes croisées furent menées en vue dela rec<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de la col<strong>on</strong>ie dans ses limites de 1932. La loi du 4 septembre1947 rétablissant la Haute-Volta visait deux objectifs majeurs : satisfaire lenati<strong>on</strong>alisme voltaïque naissant, mais aussi, et surtout endiguer la progressi<strong>on</strong> du« communisme » à travers le Rassemblement démocratique africain (RDA),fortement implanté en Côte-d'Ivoire et qui s'était affilié au Parti communismefrançais (PCF) jusqu'en 1950. En fait , la rec<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de la col<strong>on</strong>ie était le préludeà s<strong>on</strong> accessi<strong>on</strong> à la souveraineté nati<strong>on</strong>ale.• La marche vers l'indépendance politique (1948-1960).Au lendemain de la sec<strong>on</strong>de guerre m<strong>on</strong>diale, le c<strong>on</strong>texte internati<strong>on</strong>al étaitfavorable à l'émancipati<strong>on</strong> politique des peuples soumis. De ce fait, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>de la Quatrième République française comportait d'importantes réformes permettantaux col<strong>on</strong>isés d'accéder à un peu plus d'aut<strong>on</strong>omie administrative dans le cadred'une Uni<strong>on</strong> française (UF). A cet effet, une loi du 7 octobre 1946 créait danschaque col<strong>on</strong>ie, désormais appelée Territoire, une Assemblée Territoriale (AT).Utilisant ces réformes à b<strong>on</strong> escient, la Haute-Volta rec<strong>on</strong>stituée se dotaeffectivement de deux (2) Assemblées Territoriales (en 1948-1952 et 1952-1957).Par ailleurs, la loi-cadre ou loi Gast<strong>on</strong> Defferre du 23 juin 1956 accéléra la marchede la Haute-Volta vers la souveraineté nati<strong>on</strong>ale. Celle-ci introduisait un début deséparati<strong>on</strong> de pouvoirs entre l'exécutif et le législatif dans les col<strong>on</strong>ies.C<strong>on</strong>crètement, elle y créait des gouvernements locaux (appelés C<strong>on</strong>seils deGouvernement) et renforçait le pouvoir des Assemblées Territoriales devantlesquelles les gouvernements s<strong>on</strong>t resp<strong>on</strong>sables. En Haute-Volta, la troisième
14Assemblée Territoriale (composée de 70 membres majoritairement RDA) fut éluepour la première fois au suffrage universel : Yalgado Ouédraogo en était leprésident. C<strong>on</strong>formément au décret d'applicati<strong>on</strong> de la loi-cadre (n°57-459 du 14avril 1957), le C<strong>on</strong>seil de Gouvernement voyait le jour. Il était présidé par legouverneur du Territoire, Yv<strong>on</strong> Bourges, et par un vice président, Daniel OuezzinCoulibaly.Qu<strong>and</strong> vint le référendum du 28 septembre 1958, le « Oui » à la Communautéfranco-africaine proposée par le général de Gaulle, l'emporta à 91 % en Haute-Volta.En c<strong>on</strong>séquence de cela, la République aut<strong>on</strong>ome de Haute-Volta membre de laCommunauté fut proclamée le 11 décembre 1958. Dès le lendemain, l'AssembléeTerritoriale, devenait l'Assemblée Législative ; les c<strong>on</strong>seillers dudit organedevenaient les députés t<strong>and</strong>is que le C<strong>on</strong>seil de Gouvernement était transformé enGouvernement Provisoire de la Haute-Volta. L'attitude des dirigeants voltaïques visà-visde la Communauté s'expliquait par le fait que ceux-ci entendaient mener lecombat émancipateur de commun accord avec leurs voisins de la sous-régi<strong>on</strong>.Dans cette perspective, la Haute-Volta avait c<strong>on</strong>stitué avec le Mali, le Sénégal et leDahomey la Fédérati<strong>on</strong> du Mali (janvier-février 1959). Elle la quittera pour intégrer leC<strong>on</strong>seil de l'Entente créé le 29 mai de la même année sous l'initiative de FélixHouphouët-Boigny. C'est d<strong>on</strong>c après c<strong>on</strong>certati<strong>on</strong> avec ses partenaires du C<strong>on</strong>seilde l'Entente, que Maurice Yaméogo, fort d'une Assemblée Législative touteacquise à sa cause, faisait voter le 11 décembre 1959, une loi c<strong>on</strong>sacrant sac<strong>on</strong>quête du pouvoir d'Etat. En effet, ladite loi transformait le président du C<strong>on</strong>seildes ministres, c'est-à-dire lui-même, en chef d'Etat et l'Assemblée Législative enAssemblée Nati<strong>on</strong>ale. La proclamati<strong>on</strong> solennelle de l'indépendance n'interviendracependant que le 5 août 1960 et la Haute-Volta entrera à l'ONU le 20 septembre dela même année.3. L'évoluti<strong>on</strong> politique depuis l'indépendance (1960-1998).La Haute-Volta indépendante, rebaptisée Burkina Faso (patrie des hommes intègres)en 1984, allait entamer une évoluti<strong>on</strong> politique particulièrement mouvementée. De1960 à 1990, ce pays a effectivement c<strong>on</strong>nu trois (3) Républiques et plusieursEtats d'excepti<strong>on</strong> issus de six (6) coups d'Etats.
15• De la Première République au GMP (1960-1970)La Première République au Burkina Faso actuel est issue de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> adoptéepar l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale et approuvée par référendum populaire les 6 et 27novembre 1960 respectivement. Elle est caractérisée par un régime fortementprésidentialiste que dirige Maurice Yaméogo avec le RDA, qui deviendra un partiunique puis se transformera en parti-Etat quatre ans seulement aprèsl'indépendance. Dans ce c<strong>on</strong>texte, les pouvoirs législatif et judiciaire pouvaientdifficilement c<strong>on</strong>trebalancer le pouvoir exécutif c<strong>on</strong>centré entre les mains duprésident.Bien qu'une insurrecti<strong>on</strong> populaire c<strong>on</strong>duite par les syndicats principalement aitc<strong>on</strong>duit au renversement de la Première République, le 3 janvier 1966, c'estl'armée, qui à travers le Gouvernement militaire provisoire (GMP), allait arbitrer lejeu politique jusqu'en 1970. Le chef de l'Etat, le lieutenant col<strong>on</strong>el SangouléLamizana s'était doté d'un organe politique de décisi<strong>on</strong> à savoir le C<strong>on</strong>seil supérieurdes forces armées (CSFA). Dirigé par le ministre de la défense et composé de tousles officiers de l'Etat-major, le CSFA était c<strong>on</strong>sulté par le GMP avant la prise detoute mesure importante. Cependant, <strong>on</strong> retrouvait les représentants des principauxpartis politiques dans le gouvernement. En dehors du CSFA et du GMP, il y avaitaussi un troisième organe dénommé Comité c<strong>on</strong>sultatif composé de 41 membresd<strong>on</strong>t 26 civils siégeant au nom des partis politiques et des syndicats. C'est d<strong>on</strong>cd'une collaborati<strong>on</strong> apparemment fructueuse entre militaires et civils que naquit laDeuxième République (1970-1974) qui en porte d'ailleurs les empreintes..• De la Deuxième République au MNR (1970-1977).En prévoyant que « les charges et les prérogatives de Président de la Républiqueser<strong>on</strong>t assurées par la pers<strong>on</strong>nalité militaire la plus ancienne dans le grade le plusélevé », l'article 108 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de cette République (adoptée parréferendum le 18 juin 1970) réservait de fait les f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s présidentielles augénéral Lamizana. Mais, le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la Deuxième République était àl'opposé de celui de la Première sur bien d'aspects. D'abord, <strong>on</strong> avait instauré unrégime parlementaire à travers lequel le président de la République n'avaitfinalement qu'un rôle d'arbitre. Pour la première fois dans s<strong>on</strong> histoire, le Burkina
16Faso actuel s'était doté d'un premier ministre d<strong>on</strong>t le titulaire était le leader du partimajoritaire, en la pers<strong>on</strong>ne de Gérard Kango Ouédraogo du RDA. Cependant,l'exercice du pouvoir par le général Lamizana se caractérisa par ce que certainspolitologues appellent « un régime mou » ouvrant la porte à toutes les dérivespoliticiennes possibles.C'est ainsi qu'un c<strong>on</strong>flit d'hégém<strong>on</strong>ie entre le chef du Gouvernement et le présidentde l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale tous deux membres du RDA bloqua le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement desinstituti<strong>on</strong>s républicaines au point de justifier le retour de l'armée au pouvoir avec leGouvernement du Renouveau Nati<strong>on</strong>al (GRN) du 8 février 1974 à 1977.Les instituti<strong>on</strong>s politiques mises sur place s<strong>on</strong>t une reproducti<strong>on</strong> de celles du GMP.Seulement, comme pour instaurer cette fois-ci ce qu'<strong>on</strong> appelle un « régime fort »,le général Lamizana, toujours au pouvoir, voulut instituer alors un parti uniquedénommé Mouvement nati<strong>on</strong>al pour le renouveau (MNR). La forte c<strong>on</strong>testati<strong>on</strong> d'untel projet par les syndicats derrière lesquels se cachait en réalité la classe politiquemit fin à cette idée et permit la mise en place de la Troisième République du BurkinaFaso actuel (1977-1980).• De la troisième République au Fr<strong>on</strong>t populaire (1977- 1990).La c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de novembre 1977 adoptée par réferendum instaurant la TroisièmeRépublique ne diffère pas f<strong>on</strong>damentalement de la précédente excepté quelquesaménagements :■rec<strong>on</strong>aissance instituti<strong>on</strong>nelle de trois. Il s'agissait du RDA (majoritéprésidentielle) de l'Uni<strong>on</strong> nati<strong>on</strong>ale pour la défense de la démocratie(UNDD) et de l'Uni<strong>on</strong> progressiste voltaïque (UPV).■révalorisati<strong>on</strong> de la f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> présidentielle.■double resp<strong>on</strong>sabilité du Prémier Ministre, devant le Président de laRépublique et l'Assemblée Nati<strong>on</strong>aleMalgré ces aménagements, les maux qui allaient miner la Troisième Républiquejusqu'à l'emporter proviennent de la deuxième République. Pendant que lesquerelles de pers<strong>on</strong>nes s'avivaient au sein de l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale, le mouvementsyndical, où s'activaient les militants des partis de l'oppositi<strong>on</strong>, préparait la fin
17définitive des années Lamizana.En tout état de cause, l'eff<strong>on</strong>drement de la Troisième République le 25 novembre1980 inaugurait une série ininterrompue de régimes dits d'excepti<strong>on</strong> de 1980 à1990, c'est-à-dire du Comité militaire de redressement pour le progrès nati<strong>on</strong>al(CMRPN) au Fr<strong>on</strong>t populaire (FP). Durant tout ce temps, la période allant de 1983 à1990 marque un prof<strong>on</strong>d bouleversement des instituti<strong>on</strong>s politiques. En effet, avecl'avènement, le 4 août 1983, de la Révoluti<strong>on</strong> démocratique et populaire (RDP),l'opti<strong>on</strong> politique tendait vers la démocratie populaire. Elle le resta même après laRectificati<strong>on</strong>, le 15 octobre 1987. Dans un tel système, tous les pouvoirs s<strong>on</strong>tc<strong>on</strong>centrés entre les mains du C<strong>on</strong>seil nati<strong>on</strong>al de la révoluti<strong>on</strong> (CNR) et du Fr<strong>on</strong>tpopulaire (FP) par la suite. Ces organes suprêmes régulaient alors le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nementdes instituti<strong>on</strong>s sur la base du centralisme démocratique. L'avènement de laQuatrième République c<strong>on</strong>sécutive à l'ouverture démocratique préc<strong>on</strong>isée par leprésident de Fr<strong>on</strong>t populaire, Blaise Compaoré, mit fin à 30 années d'instabilitéinstituti<strong>on</strong>nelle.Il. REALITE POLITIQUE ACTUELLE.Le 2 juin 1991, le peuple burkinabè adopte par référendum une nouvelleC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de facture libérale élaborée par une commissi<strong>on</strong> c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle miseen place par le Fr<strong>on</strong>t populaire. L'oppositi<strong>on</strong> réunie dans une Coordinati<strong>on</strong> desForces Démocratiques (CFD) va chercher à déstabiliser le régime en place enréclamant la c<strong>on</strong>vocati<strong>on</strong> d'une c<strong>on</strong>férence nati<strong>on</strong>ale souveraine. Celui-ci refuse etc<strong>on</strong>cède cependant un succédané, un forum de réc<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> d<strong>on</strong>t les effetsd'ann<strong>on</strong>ce v<strong>on</strong>t c<strong>on</strong>duire à la divisi<strong>on</strong> de l'oppositi<strong>on</strong>. Devant l'échec - prévisible -du forum, celle-ci boycotte l'électi<strong>on</strong> présidentielle de décembre 1991. Le présidentse retrouve seul c<strong>and</strong>idat en lice. Il est élu avec 86,1% des voix, avec un taux departicipati<strong>on</strong> de 24%. En mai 1992, s<strong>on</strong>t organisées les électi<strong>on</strong>s législatives.L'oppositi<strong>on</strong> divisée en sort laminée, puisque le parti présidentiel, l'O.D.P-M.T(Organisati<strong>on</strong> pour la Démocratie et le Populaire - Mouvement du Travail) remporte78 des 107 sièges de l'Assemblée. La Cour Suprême rec<strong>on</strong>naîtra l'existenced'irrégularités sans pour autant remettre f<strong>on</strong>damentalement en cause le verdict desurnes.
181. La vie politique sous la Quatrième République.Au lendemain de la victoire écrasante de s<strong>on</strong> parti, le président Compaoré vadévelopper une politique d'ouverture vis-à-vis de ses adversaires, en cooptantcertains d'entre eux. L'oppositi<strong>on</strong> burkinabè va se diviser entre les « modérés » quiv<strong>on</strong>t se rallier à la mouvance présidentielle et les « radicaux » de plus en plusmarginalisés par des défecti<strong>on</strong>s internes. En fait, depuis qu'elle a boycotté l'électi<strong>on</strong>présidentielle de 1991, alors qu'elle avait des chances de mettre en difficulté leprésident sortant, l'oppositi<strong>on</strong> burkinabè n'a cessé de se déliter après ses échecsaux électi<strong>on</strong>s législatives de 1992 et municipales de 1995. Cet affaiblissement del'oppositi<strong>on</strong> s'est poursuivi à l'occasi<strong>on</strong> des électi<strong>on</strong>s législatives de 1997, le partiprésidentiel ayant remporté 101 des 111 sièges à pourvoir.En dépit des imperfecti<strong>on</strong>s qui <strong>on</strong>t entaché ces électi<strong>on</strong>s, celles-ci s<strong>on</strong>t à la fois lesigne d'un certain enracinement du processus démocratique en cours et celui de lagr<strong>and</strong>e stabilité du régime actuel. De ce point de vue, ces électi<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>tprof<strong>on</strong>dément ambivalentes, dans la mesure où l'ampleur même du succès du partiprésidentiel rend improbable à court et moyen terme l'hypothèse de l'alternancepolitique. En effet, lors des électi<strong>on</strong>s présidentielles du 15 novembre 1998,IePrésident COMPAORE s'est succédé à lui-même, en obtenant 87,52des suffragesexprimés. Les leaders de l'oppositi<strong>on</strong> avaient en effet préféré boycotter lesélecti<strong>on</strong>s, n<strong>on</strong>obstant la satisfacti<strong>on</strong> en avril 1998 d'une de leurs revendicati<strong>on</strong>srécurrentes, à savoir la mise en place d'une <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> électorale Nati<strong>on</strong>aleIndépendante (CENI). Sel<strong>on</strong> la loi n°021/98/AN du 7 mai 1998 portant Codeélectoral, la CENI se compose de 27 membres d<strong>on</strong>t 6 représentants de la majorité,6 de l'oppositi<strong>on</strong>, et 15 des diverses organisati<strong>on</strong>s de la société civile. Par ailleurs,l'instituti<strong>on</strong>nalisati<strong>on</strong> de la CENI en tant qu'organe et l'octroi d'immunités def<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s à ses membres s<strong>on</strong>t c<strong>on</strong>cédés à l'oppositi<strong>on</strong>. Toutefois, un secrétairepermanent et un Comité technique d'assistance composé de f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nairesnommés par le Gouvernement s<strong>on</strong>t mis à la dispositi<strong>on</strong> de la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g>. Cettedispositi<strong>on</strong> est dén<strong>on</strong>cée par l'oppositi<strong>on</strong>, qui stigmatise d'une part la n<strong>on</strong>attributi<strong>on</strong> à la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> de la phase de préparati<strong>on</strong> (établissement des listes,cartes, affiches, etc.) que la loi c<strong>on</strong>fie à l'Administrati<strong>on</strong>, et d'autre part, la gesti<strong>on</strong>du c<strong>on</strong>tentieux électoral par une Cour Suprême qu'elle juge peu crédible. En fait, si
19la CENI créée n'est pas parfaite, elle représente tout de même un progrèsc<strong>on</strong>sidérable par rapport aux dispositifs antérieurs. Dans ces c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s, <strong>on</strong> peut sedem<strong>and</strong>er si l'oppositi<strong>on</strong> ne cherche pas à masquer s<strong>on</strong> impuissance face à s<strong>on</strong>échec prévisible et à négocier un statut plus favorable pour elle en boycottantl'électi<strong>on</strong> du 15 novembre 1998. L'ouverture du dialogue entre l'oppositi<strong>on</strong> et leprésident, disposé par ailleurs à l'octroi d'un statut à l'oppositi<strong>on</strong>, pourraitpermettre d'amorcer la réc<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> au sein de la classe politique burkinabè aprèsles électi<strong>on</strong>s.2. Les instituti<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelles de la Quatrième RépubliqueLa C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> promulguée le 11 juin 1991 précise que « le Burkina Faso est unEtat démocratique, unitaire et laïc. Le Faso est la forme républicaine de l'Etat »(article 31). Elle instaure un régime républicain, semi-présidentiel sur le modèle de laVème République française. Le pouvoir exécutif appartient au Président du Faso, éluau suffrage universel direct pour 7 ans. Le Président du Faso nomme un PremierMinistre qu'il peut révoquer. A ce poste se s<strong>on</strong>t succédé Youssouf OUEDRAOGO(juin 1992-mars 1994), Roch Marc Christian KABORE (mars 1994-février 1996) etDésiré Kadré OUEDRAOGO (depuis février 1996).Le Parlement comprend deux Chambres, mais il s'agit d'un bicaméralisme trèsimparfait puisque seule l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale a le m<strong>on</strong>opole du pouvoir législatif.Celle-ci, pour la première fois depuis l'indépendance, a commencé une deuxièmelégislature sans interrupti<strong>on</strong>. Quant à la deuxième Chambre appelée « Chambre desReprésentants », elle ne dispose que de pouvoirs purement c<strong>on</strong>sultatifs. Elle secompose de représentants élus au suffrage indirect sel<strong>on</strong> l'article 80 de laC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> et est dirigée par un président élu en s<strong>on</strong> sein.Sel<strong>on</strong> la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, « le Pouvoir Judiciaire est c<strong>on</strong>fié aux juges ; il est exercé surtout le territoire du Burkina Faso par les juridicti<strong>on</strong>s de l'ordre judiciaire et de l'ordreadministratif déterminées par la loi » (article 124). La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> c<strong>on</strong>sacre leprincipe de l'indépendance du Pouvoir judiciaire. Le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la justice faitapparaître des insuffisances, et des acti<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t déployées pour y remédier.La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> prévoit une Cour Suprême, composée de quatre Chambres(Administrative, C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle, Judiciaire, et des Comptes). La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>
20prévoit aussi une Haute Cour de Justice (articles 137 et suivants ) devant laquellele Président du Faso et les membres du gouvernement peuvent rép<strong>on</strong>dre de certainsactes. Mais cette Cour n'a été installée complètement que le 4 juin 1998, sept ansaprès l'adopti<strong>on</strong> de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.Un Médiateur du Faso a été institué en mai 1996. La f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> est exercée par legénéral en retraite Marc Tiémoko GARANGO, ancien ministre des Finances dugénéral LAMIZANA.Il a été également institué un C<strong>on</strong>seil Ec<strong>on</strong>omique et Social composé dereprésentants des principales catégories socioprofessi<strong>on</strong>nelles. S<strong>on</strong> rôle estd'émettre des avis c<strong>on</strong>sultatifs sur les projets de loi, d'ord<strong>on</strong>nance ou de décretainsi que sur les propositi<strong>on</strong>s de lois qui lui s<strong>on</strong>t soumis. S<strong>on</strong> Président actuel estune femme en la pers<strong>on</strong>ne de Madame Juliette BONKOUNGOU.Un C<strong>on</strong>seil Supérieur de l'Informati<strong>on</strong> a été institué comme organe de régulati<strong>on</strong> del'espace audiovisuelle du Burkina Faso. S<strong>on</strong> président est M<strong>on</strong>sieur AdamaFOFANA.3. La décentralisati<strong>on</strong>En juin 1993 cinq textes de loi <strong>on</strong>t redéfini l'organisati<strong>on</strong> territoriale burkinabè. Ilsinstituent des collectivités territoriales décentralisées à savoir les provinces et lescommunes. En novembre 1993 a été créée la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>ale de laDécentralisati<strong>on</strong> d<strong>on</strong>t la missi<strong>on</strong> principale est de piloter le projet dedécentralisati<strong>on</strong>.Jusqu'ici, la décentralisati<strong>on</strong> n'est opérati<strong>on</strong>nelle qu'au niveau des communes ditesde plein exercice, qui s<strong>on</strong>t administrées par des maires issus des c<strong>on</strong>seilsmunicipaux élus au suffrage universel direct. Les premières électi<strong>on</strong>s municipales<strong>on</strong>t eu lieu le 12 février 1995. Elles <strong>on</strong>t c<strong>on</strong>nu une forte participati<strong>on</strong>, de l'ordre de70%. Vingt-six (26) des trente-trois (33) mairies en jeu <strong>on</strong>t été remportés par leparti présidentiel, d<strong>on</strong>t notamment celles des arr<strong>on</strong>dissements de la capitaleOuagadougou. En 1996 quinze nouvelles provinces <strong>on</strong>t été créées, portant lenombre de celles-ci à 45 et le nombre de communes de plein exercice à 47 puisqueles chefs-lieux des provinces s<strong>on</strong>t, sel<strong>on</strong> la loi, des communes de plein exercice.
21Le modèle burkinabè de décentralisati<strong>on</strong> se caractérise par la recherche d'une voieoriginale, tenant compte des réalités éc<strong>on</strong>omiques et socio-politiques du terrain.Cette voie comprend trois aspects : la vol<strong>on</strong>té d'asseoir la réforme sur une réflexi<strong>on</strong>approf<strong>on</strong>die, inclusive et participative, la perspective de la l<strong>on</strong>gue durée avec pourobjectif la créati<strong>on</strong> de 500 communes à l'horiz<strong>on</strong> 2010, la combinais<strong>on</strong> du modèled'inspirati<strong>on</strong> française et des dynamiques locales. Deux instruments techniques <strong>on</strong>tété mis en place : le Service d'Appui à la Gesti<strong>on</strong> et au Développement Communal(SAGEDECOM) et le F<strong>on</strong>ds de démarrage des Communes (FODECOM). Par ailleurs ilexiste une Associati<strong>on</strong> des Maires du Burkina Faso (AMBF). La <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g>Nati<strong>on</strong>ale de la Décentralisati<strong>on</strong>, instituti<strong>on</strong> d'étude et de pilotage du processus dedécentralisati<strong>on</strong> a transmis au gouvernement qui les a adoptés, quatre projets delois qui <strong>on</strong>t été votés par l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale, à savoir le projet de loid'orientati<strong>on</strong> de la décentralisati<strong>on</strong>, les projets de loi portant programmati<strong>on</strong> de lamise en oeuvre des textes d'orientati<strong>on</strong> de la décentralisati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> del'administrati<strong>on</strong> du territoire, organisati<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des collectivitéslocales.4. Les partis politiquesL'article 13 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> garantit le multipartisme. Sur ce plan, le Burkina Fasoa c<strong>on</strong>nu une multitude de partis politiques. Mais une importante recompositi<strong>on</strong> de lascène politique est intervenue en février 1996. A la suite de s<strong>on</strong> deuxième c<strong>on</strong>grèsordinaire qui s'est tenu du 2 au 4 février 1996, le parti présidentiel l'ODP-MT afusi<strong>on</strong>né avec une dizaine de partis politiques pour former le C<strong>on</strong>grès pour laDémocratie et le Progrès (CDP), qui dispute aujourd'hui au PDP (Parti pour laDémocratie et le Progrès) la référence social-démocrate. Ce parti né d'une scissi<strong>on</strong>trois ans plus tôt de la CNPP-PSD (C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale des Patriotes ProgressistesParti Social Démocrate) a accueilli en s<strong>on</strong> sein quatre formati<strong>on</strong>s politiques n<strong>on</strong>représentées à l'Assemblée, et demeure la principale force politique de l'oppositi<strong>on</strong>.L'ADF (Alliance pour la Démocratie et la Fédérati<strong>on</strong>) va elle aussi recueillirl'adhési<strong>on</strong> d'une dizaine de formati<strong>on</strong>s politiques. Cette recompositi<strong>on</strong> estintervenue quelques mois avant les électi<strong>on</strong>s législatives de mai 1997.
22Les principales forces politiques en présence étaient :• le CDP qui a renforcé sa positi<strong>on</strong> avec 88 députés ;• le PDP deuxième groupe parlementaire avec 9 députés ;• l'ADF et le RDA, qui forment un groupe parlementaire de 9 membres. Cesdeux partis fusi<strong>on</strong>ner<strong>on</strong>t plus tard, dans la perspective des électi<strong>on</strong>sprésidentielles de 1998 pour d<strong>on</strong>ner naissance à l'ADF-RDA.Quatre (4) partis <strong>on</strong>t été représentés à l'Assemblée fin 1997, c<strong>on</strong>tre neuf (9) audébut de la législature, sur les 27 qui <strong>on</strong>t pris part à la compétiti<strong>on</strong> électorale de mai1992 alors que 67 partis <strong>on</strong>t été officiellement enregistrés. A la date du 28 janvier1997, le nombre de partis officiellement enregistrés est passé à 46. Seuls 13d'entre eux <strong>on</strong>t participé aux législatives du 11 mai 1997 et seulement 4 <strong>on</strong>tobtenu des sièges de députés. Fin mai 1998, l'Assemblée nati<strong>on</strong>ale burkinabè necomptait plus désormais que trois (3) groupes parlementaires aux forces trèsinégales : le groupe parlementaire majoritaire du CDP (101 députés), celui du PDP(6 députés) et celui de l'ADF/RDA (4 députés), deux partis qui <strong>on</strong>t fusi<strong>on</strong>né en mai1998. Les deux principaux leaders de l'oppositi<strong>on</strong>, le Pr. Joseph KI-ZERBO etGérard Kango OUEDRAOGO tous deux sexagénaires et figures de proue del'ancienne classe politique voltaïque s<strong>on</strong>t en semi-retraite politique puisqu'ils <strong>on</strong>tcédé leur place de députés à leurs suppléants.D'une manière générale, les partis d'oppositi<strong>on</strong> <strong>on</strong>t du mal à s'affirmer sur la scènepolitique, moins en rais<strong>on</strong> des entraves du pouvoir qu'en rais<strong>on</strong> de la faiblesse deleurs ressources humaines, matérielles et financières. Le problème financier setrouve en partie résolu par le système de financement des partis politiques par lebudget de l'Etat, lors des campagnes électorales. C<strong>on</strong>fère la loi n°44/98/AN portantmodificati<strong>on</strong> de l'intitulé du chapitre 203, secti<strong>on</strong> 99 du titre IV du budget de l'Etat,gesti<strong>on</strong> 1998, relatif à la subventi<strong>on</strong> aux partis politiques et sa répartiti<strong>on</strong>. Lasubventi<strong>on</strong> au titre de ladite loi « est répartie en deux tranches d'égal m<strong>on</strong>tant. Unetranche destinée aux partis politiques ayant pris part aux électi<strong>on</strong>s législatives demai 1997 et une tranche destinée aux c<strong>and</strong>idats participant aux électi<strong>on</strong>sprésidentielles de novembre 1998 ». De plus, l'oppositi<strong>on</strong> s'est souvent
23caractérisée par ses volte-face, sa désuni<strong>on</strong>, s<strong>on</strong> inorganisati<strong>on</strong> et s<strong>on</strong> manque deréalisme.5. Le pluralisme syndical et la presseLe pluralisme syndical a toujours existé dans l'Etat post-col<strong>on</strong>ial burkinabè et lessyndicats y <strong>on</strong>t historiquement joué un rôle politique important. Fers de lance de lasociété civile, ils <strong>on</strong>t c<strong>on</strong>stitué un réel c<strong>on</strong>tre-pouvoir. Plusieurs gouvernements destrois premières Républiques s<strong>on</strong>t tombés sous leurs coups de boutoir. Ceux-ci s<strong>on</strong>ten effet sortis très affaiblis de la période révoluti<strong>on</strong>naire et s'efforcent derec<strong>on</strong>stituer leurs forces perdues. Mais ils s<strong>on</strong>t divisés face au pouvoir en place.C'est ainsi que le m<strong>on</strong>de syndical burkinabé c<strong>on</strong>naît une bipolarisati<strong>on</strong> de plus enplus nette, entre d'une part des syndicats (appelés « le groupe des 13 »), quipréfèrent dialoguer avec le pouvoir et qui s<strong>on</strong>t soupç<strong>on</strong>nés de faire s<strong>on</strong> jeu, etd'autre part des syndicats dits révoluti<strong>on</strong>naires, résolument hostiles à la gesti<strong>on</strong>éc<strong>on</strong>omique et politique du pouvoir, enclins à recourir plus à la grève qu'audialogue, et qui s<strong>on</strong>t soupç<strong>on</strong>nés d'être une oppositi<strong>on</strong> politique qui ne dit pas s<strong>on</strong>nom.Le pluralisme au niveau de la presse et des médias est réel. Le code de l'informati<strong>on</strong>adopté en 1992 et révisé en 1993 est l'un des plus libéraux en Afrique. Radios etpresse privées s<strong>on</strong>t en plein essor au Burkina depuis l'amorce du processusdémocratique.L'Etat possède des éléments de presse écrite d<strong>on</strong>t un quotidien, un hebdomadaireet un mensuel édités par les Editi<strong>on</strong>s Sidwaya, une stati<strong>on</strong> de télévisi<strong>on</strong> nati<strong>on</strong>ale(TNB), une stati<strong>on</strong> de radiodiffusi<strong>on</strong> nati<strong>on</strong>ale (RNB) avec des chaînes locales etrégi<strong>on</strong>ales.La presse écrite privée comprend plusieurs publicati<strong>on</strong>s de périodicités diverses ;quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Les stati<strong>on</strong>s audiovisuellesprivées s<strong>on</strong>t tout aussi nombreuses, toutes en modulati<strong>on</strong> de fréquence, d<strong>on</strong>t laplupart s<strong>on</strong>t des radios communautaires. On peut citer entre autres, « Horiz<strong>on</strong>FM », « Radio Pulsar », « Africa n°1 », « Radio France Internati<strong>on</strong>ale », « RadioSalankol<strong>on</strong>to », sans parler des radios appartenant à des c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>s religieuses,aux Groupements ruraux etc.
24A noter la profusi<strong>on</strong> des antennes paraboliques, notamment dans la capitale,permettant de capter les télévisi<strong>on</strong>s étrangères.La plupart des titres et radios privés renc<strong>on</strong>trent des difficultés financières etmatérielles. C'est d<strong>on</strong>c à b<strong>on</strong> escient que le gouvernement a octroyé unesubventi<strong>on</strong> de 100 milli<strong>on</strong>s de FCFA pour le développement de la presse. Toutefois,<strong>on</strong> note un manque de professi<strong>on</strong>nalisme chez certains animateurs ou journalistes,d'autant plus le statut de journaliste n'est pas codifié. L'informati<strong>on</strong> traitée par lesmédias est par ailleurs souvent dépourvue de réflexi<strong>on</strong> critique. Elle estgénéralement instituti<strong>on</strong>nelle. D'où la nécessité de renforcer la formati<strong>on</strong> desjournalistes et communicateurs. Les principaux quotidiens s<strong>on</strong>t Sidwaya (étatique),l'Observateur-Paalga, le Pays, le Journal du Soir (tous privés). Les principauxhebdomadaires s<strong>on</strong>t « l'Indépendant » (journal d'opini<strong>on</strong> critique), « le Journal duJeudi » (satirique), « l'Opini<strong>on</strong> », « l'Hebdomadaire du Burkina », etc.III. RÉALITÉS ECONOMIQUESLa situati<strong>on</strong> éc<strong>on</strong>omique du Burkina Faso est marquée par de nombreusesc<strong>on</strong>traintes structurelles d<strong>on</strong>t les plus importantes s<strong>on</strong>t l'enclavement, l'insuffisancedes infrastructures productives et les coûts élevés de producti<strong>on</strong>.Vers la fin des années 80, l'éc<strong>on</strong>omie burkinabé a traversé une phase difficilecaractérisée par l'insuffisance dans la maîtrise de la gesti<strong>on</strong> des finances publiques,la faible efficacité des investissements publics et la rigidité des structures deproducti<strong>on</strong>. Cette situati<strong>on</strong> a c<strong>on</strong>duit les autorités à engager en mars 1991, unprogramme de stabilisati<strong>on</strong> financière et de réformes structurelles avec l'appui de lacommunauté des bailleurs de f<strong>on</strong>ds, d<strong>on</strong>t la Banque M<strong>on</strong>diale et le F<strong>on</strong>ds M<strong>on</strong>étaireInternati<strong>on</strong>al. L'objectif de ce programme était de jeter les bases d'undéveloppement éc<strong>on</strong>omique et social durable qui permettent d'atténuer à moyenterme les déséquilibres internes et externes, et d'améliorer le niveau de vie despopulati<strong>on</strong>s.Pour réaliser cet objectif, le Gouvernement a privilégié une stratégie orientée versl'améliorati<strong>on</strong> de la gesti<strong>on</strong> des finances publiques, l'augmentati<strong>on</strong> de la producti<strong>on</strong>agricole, la situati<strong>on</strong> de l'investissement privé par le biais des réformes desentreprises publiques et du système bancaire, la libéralisati<strong>on</strong> du commerce et des
25prix, l'améliorati<strong>on</strong> du f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement du marché du travail et la réforme du cadrejuridique et administratif.Cet ensemble du dispositif de l'ajustement a vite révélé ses limites compte tenu desdifficultés renc<strong>on</strong>trées dans la mise en oeuvre du programme. Aussi, leGouvernement s'est c<strong>on</strong>vaincu, en c<strong>on</strong>certati<strong>on</strong> avec les autres membres de l'Uni<strong>on</strong>M<strong>on</strong>étaire Ouest Africaine (UMOA), de la nécessité de compléter les effortsd'ajustement par un ajustement m<strong>on</strong>étaire en procédant le 12 janvier 1994 auchangement de parité entre le Franc CFA et le franc Français. Cette dernière mesureayant pour finalité de rendre l'éc<strong>on</strong>omie nati<strong>on</strong>ale plus compétitive.Le bilan global des différentes réformes entreprises depuis près de cinq ans indiqueque des résultats significatifs <strong>on</strong>t été enregistrés. Cependant, ces efforts devr<strong>on</strong>t sepoursuivre en vue de créer un envir<strong>on</strong>nement macro-éc<strong>on</strong>omique viable quipermette une croissance éc<strong>on</strong>omique durable.Comme la plupart des pays africains, l'éc<strong>on</strong>omie burkinabé repose essentiellementsur l'agriculture et l'élevage. Le secteur minier prend de plus en plus del'importance. Le secteur sec<strong>on</strong>daire est encore embry<strong>on</strong>naire et stimule très peu lessecteurs primaire et tertiaire.1. L'agriculture et l'élevageL'éc<strong>on</strong>omie du Burkina Faso est fortement tributaire de l'agriculture et de l'élevagequi occupent envir<strong>on</strong> 90% de la populati<strong>on</strong> active, et c<strong>on</strong>tribuent au PIB pour38,6% avec un taux de croissance d'envir<strong>on</strong> 2,5%. Ce secteur fournit 83% desexportati<strong>on</strong>s.1.1. L'agricultureL'agriculture est h<strong>and</strong>icapée dans s<strong>on</strong> développement par une série de facteursd<strong>on</strong>t :• les aléas climatiques ;• le manque de maîtrise de l'eau ;• l'enclavement ;• le coût élevé des investissements ;
26• l'insuffisance et le mauvais état des infrastructures routières et ferroviaires ;• le caractère extensif de l'exploitati<strong>on</strong> ;• le faible niveau d'utilisati<strong>on</strong> des intrants.Les principales producti<strong>on</strong>s agricoles s<strong>on</strong>t :les céréales : mil, sorgho, riz, f<strong>on</strong>io ;les produits de cueillette : am<strong>and</strong>e de karité, gomme arabiqueles cultures maraîchères : haricot vert, pomme de terre, tomate, etc. ;les fruits : mangues, agrumes, papayes.L'agriculture est à dominante pluviale et extrêmement c<strong>on</strong>trastée suivant lesrégi<strong>on</strong>s.Si la campagne 94/95 a été qualifiée d'excepti<strong>on</strong>nelle en rais<strong>on</strong> d'une pluviométrieab<strong>on</strong>dante et bien répartie, celle de 95/96 s'est avérée médiocre et déficitaire.De même, la campagne 96/97 s'est caractérisée par un démarrage tardif des pluieset des stades de culture très inégaux, entraînant des problèmes d'alimentati<strong>on</strong> etd'abreuvage des cheptels surtout dans la régi<strong>on</strong> sahélienne.De manière générale, le Burkina n'a pas encore résolu la questi<strong>on</strong> de sa sécuritéalimentaire. L'exploitati<strong>on</strong> rati<strong>on</strong>nelle du secteur agro-pastoral est altérée par s<strong>on</strong>aspect traditi<strong>on</strong>nel (feux de brousse, divagati<strong>on</strong> des cheptels...) qui la rend peuouverte aux techniques nouvelles.Sur les 274 200km2 de superficie que compte le pays, seulement 3,27 milli<strong>on</strong>sd'hectares s<strong>on</strong>t cultivés soit un tiers des terres cultivables. Les superficies irriguéess<strong>on</strong>t estimées à 15 000 hectares.1.2. L'élevageLes produits de l'élevage s<strong>on</strong>t les animaux sur pied, la vi<strong>and</strong>e, les cuirs, les peaux,les cornes et les sabots. Le sous-secteur de l'élevage est l'un des plus dynamiquesde l'éc<strong>on</strong>omie burkinabé puisque sa valeur ajoutée s'est accrue en moyenne de2,5% en termes réels au cours de ces quatre dernières années, et sa part dans lesexportati<strong>on</strong>s est passée de 11% en 1993 à 35% en 1995.
27Cependant, l'élevage est c<strong>on</strong>fr<strong>on</strong>té, d'une part, au problème de l'inadéquati<strong>on</strong> de ladem<strong>and</strong>e en aliments de bétail avec l'offre fourragère nati<strong>on</strong>ale, et d'autre part, àun encadrement technique insuffisant.L'élevage représente la deuxième ressource du pays après le cot<strong>on</strong> et avant lesecteur minier. Cette filière est porteuse puisque les exportati<strong>on</strong>s <strong>on</strong>t atteint 321300 têtes en 1994 (13 milliards de FCFA) c<strong>on</strong>tre 152 600 têtes l'annéeprécédente, soit une hausse de 111%. Cette envolée due à la dévaluati<strong>on</strong> ne futcependant qu'un coup de fouet. Les chiffres ultérieurs m<strong>on</strong>trent une c<strong>on</strong>tracti<strong>on</strong> dela dem<strong>and</strong>e due à l'adaptati<strong>on</strong> progressive des marchés sous-régi<strong>on</strong>aux. Le seulchiffre de l'exportati<strong>on</strong> des bovins, qui passe de 200 à 500 têtes en 1994 à 160000 têtes en 1995 ou des petits ruminants (11800 têtes en 94 c<strong>on</strong>tre 4100 têtesen 1995) m<strong>on</strong>tre combien la compétitivité de la filière est inc<strong>on</strong>stante. Sel<strong>on</strong> lesexperts, ses résultats s<strong>on</strong>t imputables au coût des transports et à la cherté desproduits vétérinaires qui dissuadent les éleveurs et qui se répercutent sur la santéanimale (péri-pneum<strong>on</strong>ie, fièvre aphteuse...). Pourtant des opportunités existent.L'élevage participe pour 13% du PIB et occupe 6% de la populati<strong>on</strong>. En 1995, lecheptel était estimé à 4 345 milli<strong>on</strong>s de bovins, 5 850 milli<strong>on</strong>s d'ovins, 7459milli<strong>on</strong>s de caprins, 563 400 porcins, 454 200 asins, 23 262 équins, 13 317camelins et 1 339 milli<strong>on</strong>s de volailles. Les exportati<strong>on</strong>s d'animaux sur pied se f<strong>on</strong>tpour l'essentiel vers la Côte d'Ivoire et le Ghana.Le taux de croissance de la producti<strong>on</strong> agricole exerce une influence sur le rythmede l'industrialisati<strong>on</strong> et il existe une certaine complémentarité entre l'agriculture etl'industrie.2. L'industrie et l'artisanat2.1. L'industrieL'industrie burkinabé est c<strong>on</strong>fr<strong>on</strong>tée à des problèmes tels que le coût élevé desfacteurs de producti<strong>on</strong> (énergie et eau), la lourdeur des réglementati<strong>on</strong>sadministratives, l'étroitesse du marché intérieur, les difficultés d'accès au créditbancaire, les taux élevés des taxes à l'importati<strong>on</strong> pour les intrants et les pièces derechange, la fraude et la c<strong>on</strong>treb<strong>and</strong>e.
28Le secteur industriel occupe 5% de la populati<strong>on</strong> active et c<strong>on</strong>tribue pour 23% duPIB. L'industrie est essentiellement c<strong>on</strong>centrée à Ouagadougou (71%) et à Bobo-Dioulasso (18%) pour envir<strong>on</strong> une centaine d'unités industrielles.Dans sa politique de recherche de croissance durable, le Gouvernement metl'accent sur le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et desPetites et Moyennes Industries (PMI).Le secteur industriel est dominé par :2.1.1 L'industrie agro-alimentaireLes industries du secteur agro-alimentaire (biscuiterie, boulangerie, huilerie)participent activement à la politique de transformati<strong>on</strong> céréalière. Avec 49,5% decréati<strong>on</strong> d'emplois, cette industrie fournit 55,2% de la valeur ajoutée et réalise41,2% du chiffre d'affaires du secteur.2.1.2 L'industrie manufacturièreElle reste encore embry<strong>on</strong>naire et représente 15% du PIB. Elle fournit envir<strong>on</strong> 7.000emplois et une valeur ajoutée de 32,550 milliards de FCFA entre 1985 et 1990.2.1.3 L'industrie textile et du cuirLes secteurs du textile, de l'habillement et du cuir représentent 21,6% des emplois,26,6% de la valeur ajoutée, 34,7 % du chiffre d'affaires du secteur et 38% de laproducti<strong>on</strong> industrielle. On compte 4 principales entreprises : FASO FANI, Sociétédes Fibres Textiles (SOFITEX), Société Burkinabé des Cuirs et Peaux ( SBCP) (cuiret tannage) et Société Burkinabé de la Manufacture du Cuir (SBMC) (pyrogravure).2.1.4 L'industrie du bâtiment et des travaux publicsIl est dominé par un gr<strong>and</strong> nombre d'entreprises privées de tailles très diverses.C'est un secteur dynamique qui a c<strong>on</strong>nu ces dernières années un développementrapide tant du point de vue du nombre des unités que de l'importance du secteur ausein de l'éc<strong>on</strong>omie.
292.2. L'artisanatL'artisanat c<strong>on</strong>stitue avec l'agriculture, une activité traditi<strong>on</strong>nelle au Burkina Faso. Ilparticipe pour 15% au Produit Nati<strong>on</strong>al Brut et occupe 54% de la populati<strong>on</strong>. Troistypes d'artisanat existent :• L'artisanat d'art : le travail du br<strong>on</strong>ze est une activité traditi<strong>on</strong>nelle del'artisanat d'art. Utilisant la technique dite « cire perdue », les maîtresbr<strong>on</strong>ziers tirent de leurs forges des pièces toujours uniques d'une rare beauté.Le travail du cuir et de la peau est également très rép<strong>and</strong>u au Burkina. LaSociété burkinabé de manufacture du cuir (SBMC) propose de très beauxarticles en peau pyrogravée. La poterie est également très rép<strong>and</strong>ue.• L'artisanat de service : Il regroupe les activités fournissant un serviced'entretien ou de réparati<strong>on</strong> (petite mécanique, électricité, plomberie, peintureetc.).• L'artisanat de producti<strong>on</strong> : Il s'agit de la producti<strong>on</strong> de biens d'usage courant(menuiserie, tapisserie, forge, couture etc.). L'activité artisanale du BurkinaFaso a trouvé un cadre d'expressi<strong>on</strong> et d'expansi<strong>on</strong> avec l'organisati<strong>on</strong>biennale du Sal<strong>on</strong> Internati<strong>on</strong>al de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO).3. Le commerceLe secteur du commerce souffre de l'insuffisance de l'organisati<strong>on</strong> de la professi<strong>on</strong>,de la méc<strong>on</strong>naissance des méthodes modernes de gesti<strong>on</strong> et de la faiblesse del'encadrement des commerçants. Cependant, l'activité commerciale est assezdéveloppée. Elle c<strong>on</strong>tribue pour 38,4% du PIB.3.1. Le commerce intérieurLe commerce intérieur est caractérisé par des échanges s'opérant sur les marchésquotidiens et périodiques. Les marchés des gr<strong>and</strong>es villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, Koudougou) ravitaillent les autres marchés en produitsalimentaires et en biens d'équipement.
303.2. Le commerce extérieurLe commerce extérieur est quant à lui, caractérisé par une balance commercialedéficitaire. Il est tributaire des ports de Lomé (Togo), de Cot<strong>on</strong>ou (Bénin) etd'Abidjan (Côte d'Ivoire), qui s<strong>on</strong>t les principaux débouchés maritimes du BurkinaFaso.Depuis la dévaluati<strong>on</strong> du F CFA, <strong>on</strong> enregistre une forte croissance des exportati<strong>on</strong>snotamment en ce qui c<strong>on</strong>cerne les secteurs comme l'or et le cot<strong>on</strong>.Bien que le déficit commercial s'accentue en volume, le taux de couverture desimportati<strong>on</strong>s par les exportati<strong>on</strong>s ne cesse de s'améliorer. En effet, ce taux estpassé de 52,7% en 1993 à 59,1% en 1995.Le solde de la balance des services, structurellement déficitaire, est devenuexcédentaire en 1994. Les transferts sans c<strong>on</strong>trepartie <strong>on</strong>t pris des proporti<strong>on</strong>simportantes et <strong>on</strong>t quasiment doublé. Cet accroissement est dû à l'augmentati<strong>on</strong>importante des d<strong>on</strong>s émanant de la communauté internati<strong>on</strong>ale et aussi à la haussedes transferts de revenus des burkinabé travaillant à l'étranger.Les principales exportati<strong>on</strong>s portent sur les produits agro-pastoraux et artisanaux. Ils'agit du cot<strong>on</strong>, des animaux vivants, des oléagineux (am<strong>and</strong>es de karité, sésame,noix d'acajou), et de l'or.Les principaux clients du Burkina Faso s<strong>on</strong>t : la Côte d'Ivoire, la France, la Suisse,l'Ind<strong>on</strong>ésie, la République de Chine, l'Italie.Les importati<strong>on</strong>s portent sur les produits alimentaires (céréales, lait, sucrerie..), lesproduits énergétiques (produits pétroliers), les biens d'équipements (machines,matériel de transport etc.), les produits manufacturés, les produits chimiques, lesboiss<strong>on</strong>s et les tabacs.Les principaux fournisseurs du Burkina Faso s<strong>on</strong>t : la France, la Côte d'Ivoire, lesEtats-Unis d'Amérique, le Jap<strong>on</strong>, le Nigéria.Afin de réduire la forte dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'extérieur, lesautorités encouragent la créati<strong>on</strong> d'industries d'import-substituti<strong>on</strong>.
314. Les minesLe Burkina recèle de nombreuses richesses minières ; or, manganèse, phosphate,zinc, cuivre, nickel, plomb, argile, kaolin, calcaire...Si l'agriculture est la principale activité du pays, le secteur minier occupe une placede plus en plus importante. 25% du territoire s<strong>on</strong>t exploitables soit 72 000 km2. Ilc<strong>on</strong>tribue pour 5% au Produit Nati<strong>on</strong>al Brut (PNB) et intéresse 2% de la populati<strong>on</strong>,soit envir<strong>on</strong> 200 000 pers<strong>on</strong>nes.5. Les communicati<strong>on</strong>sLes voies de communicati<strong>on</strong> et les moyens de transport s<strong>on</strong>t essentiels pour unpays enclavé comme le Burkina. Aussi, d'importants efforts s<strong>on</strong>t entrepris pouratténuer les effets de cette situati<strong>on</strong>. Ces efforts portent sur les infrastructuresroutières, ferroviaires, aéroportuaires et les télécommunicati<strong>on</strong>s.5.1. Le réseau routierLes routes s<strong>on</strong>t classées en trois gr<strong>and</strong>es catégories : les routes nati<strong>on</strong>ales,départementales et régi<strong>on</strong>ales. Le réseau routier est de 13.117 km d<strong>on</strong>t 1.833 kmbitumés et 7.341 km de pistes.Les liais<strong>on</strong>s routières entre le Burkina Faso et les pays voisins dans leur ensembles<strong>on</strong>t bitumées. Le parc automobile comporte près de 30.000 engins auxquels il fautajouter des centaines de milliers de bicyclettes et motocyclettes.5.2. Le réseau ferroviaireLe réseau ferroviaire est c<strong>on</strong>stitué d'une seule ligne : Kaya/Ouagadougou/Bobo-Dioulasso/Abidjan, l<strong>on</strong>gue de 1156 km. Un prol<strong>on</strong>gement vers Tambao (Nord duBurkina), où se trouve un important gisement de manganèse est en projet.5.3. Les transports aériensLe Burkina Faso compte deux (2) aéroports internati<strong>on</strong>aux : Ouagadougou et BoboDioulasso.Des compagnies internati<strong>on</strong>ales telles Air Afrique, Air France, Sabéna, Aéroflot, AirAlgérie relient le Burkina au reste du m<strong>on</strong>de notamment l'Europe, t<strong>and</strong>is que lacompagnie nati<strong>on</strong>ale Air Burkina assure les liais<strong>on</strong>s avec les pays voisins.
325.4. Les télécommunicati<strong>on</strong>sD'importants investissements <strong>on</strong>t été c<strong>on</strong>sacrés à ce secteur et <strong>on</strong>t permis auBurkina de disposer d'un réseau de bases fiables qui relie toutes les gr<strong>and</strong>es villesdu pays entre elles, ainsi que certaines villes moyennes. Le réseau permet aussid'établir des liais<strong>on</strong>s avec plus de 100 pays dans le m<strong>on</strong>de en automatique intégralou en transit par la France, la Gr<strong>and</strong>e-Bretagne, l'Italie, la Suisse ou les Etats-Unisd'Amérique. La densité téléph<strong>on</strong>ique (nombre de ligne, pour 100 habitants) est de0,2.La radiodiffusi<strong>on</strong>, par ailleurs, c<strong>on</strong>naît une explosi<strong>on</strong> depuis ces dernières annéesavec l'appariti<strong>on</strong> des radios privées d'informati<strong>on</strong> et de divertissement (radioHoriz<strong>on</strong> FM, Canal Arc en ciel, Radio Energie, Radio France Internati<strong>on</strong>al, BBC, VOAetc.) de même que des radios c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nelles.De nombreuses c<strong>on</strong>traintes d'ordre naturel, structurel et instituti<strong>on</strong>nel pèsentlourdement sur l'éc<strong>on</strong>omie burkinabé. Toutefois, des potentialités n<strong>on</strong> négligeablesexistent et leur mobilisati<strong>on</strong> dans un avenir proche sera porteuse de croissanceéc<strong>on</strong>omique pour le Burkina Faso.La clé de cette croissance réside dans le développement des secteurs agro-pastoralet minier et le développement des activités exportatrices basées sur les produitslocaux. L'objectif est d'atteindre désormais des taux de croissance du PIB supérieurà celui de la populati<strong>on</strong>. En 1996, la croissance du PIB était de 6,9% et entre1997-1999, l'objectif est d'avoir en moyenne un taux de croissance de 7,5%. Cetobjectif s'élèvera progressivement au cours des années suivantes pour atteindre 8%à partir de l'an 2.000.Une telle performance est envisageable compte tenu des gains escomptés desréformes macro-éc<strong>on</strong>omiques et structurelles engagées depuis 1991, del'accroissement des investissements productifs et de la mise en place d'un systèmed'intermédiati<strong>on</strong> financière plus actif. Elle s'inscrit également dans une perspectivede renforcement des liens d'intégrati<strong>on</strong> et de coopérati<strong>on</strong> éc<strong>on</strong>omique régi<strong>on</strong>aleavec les pays de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'Uni<strong>on</strong> Ec<strong>on</strong>omique etM<strong>on</strong>étaire Ouest Africaine (UEMOA) et de la Communauté Ec<strong>on</strong>omique des Etats del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).
33PARTIE I : LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.La questi<strong>on</strong> des Droits de l'Homme, notamment en ses aspects civils et politiquesest de plus en plus indissociable de la questi<strong>on</strong> de la Démocratie, comme gagef<strong>on</strong>damental de créati<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s stables de leur garantie.Le Burkina Faso depuis 1991, année d'adopti<strong>on</strong> de sa dernière c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> oeuvrevéritablement à asseoir un pouvoir démocratique, c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong> cadre de protecti<strong>on</strong> desdroits civils et politiques. Les réflexi<strong>on</strong>s qui suivr<strong>on</strong>t en d<strong>on</strong>ner<strong>on</strong>t toute la mesure.I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ETPOLITIQUES.1. Le Cadre c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>nel.Le Burkina Faso est partie à de multiples c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s internati<strong>on</strong>ales en matière dedéfense des droits de l'Homme. Il adhère fortement à la Déclarati<strong>on</strong> Universelle desDroits de l'Homme de 1948 d<strong>on</strong>t il évoque les principes dans le Préambule de laC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de la IVème République. L'adhési<strong>on</strong> à ces c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>stitue unengagement à c<strong>on</strong>tribuer à la promoti<strong>on</strong> des Droits de l'Homme au plan universelc<strong>on</strong>tinental et nati<strong>on</strong>al. Ces c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s, c<strong>on</strong>stitutives de sources d'engagementset d'obligati<strong>on</strong>s internati<strong>on</strong>ales s<strong>on</strong>t les suivantes :■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> pour la préventi<strong>on</strong> et la répressi<strong>on</strong> du crime de génocide. Elle a étéadoptée par l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 9 décembre 1948 etratifiée par le Burkina Faso le 14 septembre 1965.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> internati<strong>on</strong>ale sur l'éliminati<strong>on</strong> de toutes les formes de discriminati<strong>on</strong>raciale. Elle a été ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966 et ratifiéepar le Burkina Faso le 18 juillet 1974.■Pacte internati<strong>on</strong>al relatif aux droits éc<strong>on</strong>omiques, sociaux et culturels. Il a étéadopté par l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 16 décembre 1966 etratifié par le Burkina Faso, le 10 septembre 1998.
34■Pacte internati<strong>on</strong>al relatif aux droits civils et politiques. Il a été adopté parl'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 16 décembre 1966 et ratifié par leBurkina Faso, le 10 septembre 1998.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> internati<strong>on</strong>ale sur l'éliminati<strong>on</strong> et la répressi<strong>on</strong> du crime d'Apartheid.Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 30 novembre1973 et ratifiée par le Burkina Faso le 24 octobre 1978.1•1 C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> sur l'éliminati<strong>on</strong> de toutes les formes de discriminati<strong>on</strong>s à l'égard desfemmes. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 8décembre 1979 et ratifiée par le Burkina Faso le 14 octobre 1987.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants. Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le10 décembre 1984 et ratifiée par le Burkina Faso le 10 septembre 1998.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> internati<strong>on</strong>ale c<strong>on</strong>tre l'Apartheid dans les sports. Elle a été adoptéepar l'Assemblée générale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 10 décembre 1985 et ratifiée parle Burkina Faso le 29 juin 1988.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> relative aux droits de l'enfant. Elle a été adoptée par l'Assembléegénérale des Nati<strong>on</strong>s Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Burkina Fasole 31 août 1990.■C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> sur les droits politiques de la femme adoptée le 20 décembre 1952.Elle a été ouverte à la signature à New York le 31 mars 1953 et ratifiée par leBurkina Faso le 5 octobre 1998.■Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Elle a été adoptée le 26juin 1981 à Nairobi et ratifiée par le Burkina Faso le 6 juillet 1984.■Protocole relatif à la charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuplesportant créati<strong>on</strong> d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du10 juin 1998, ratifié par le Burkina Faso, le 20 janvier 1999.■Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'enfant du 11 juillet 1990, ratifiépar le Burkina Faso le 8 juin 1992.
352. Le cadre c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nel.Au Burkina Faso, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> garantit les droits et libertés de la pers<strong>on</strong>nehumaine. Après avoir proclamé solennellement l'attachement du peuple burkinabé àla protecti<strong>on</strong>, à la promoti<strong>on</strong> et à la sauvegarde des droits humains et s<strong>on</strong>engagement vis-à-vis de la Déclarati<strong>on</strong> Universelle des Droits de l'Homme de 1948,aux instruments internati<strong>on</strong>aux traitant des problèmes éc<strong>on</strong>omiques, politiques,sociaux, culturels ainsi qu'à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et desPeuples dans le préambule qui fait partie intégrante de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, lec<strong>on</strong>stituant burkinabé a c<strong>on</strong>sacré le titre I aux droits et devoirs f<strong>on</strong>damentaux. Cesdroits et devoirs f<strong>on</strong>damentaux s<strong>on</strong>t en fait une énumérati<strong>on</strong> des différents droitsgarantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, d<strong>on</strong>t lesdroits et devoirs civils (Chap.1), les droits et devoirs politiques (chap. Il), les droitset devoirs éc<strong>on</strong>omiques (chap. III) et les droits et devoirs sociaux et culturels (chap.IV).Les droits prévus par les divers instruments internati<strong>on</strong>aux relatifs aux droits del'homme d<strong>on</strong>t la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples s<strong>on</strong>t reprisdans le préambule et dans le corps de la Loi f<strong>on</strong>damentale du 02 juin 1991. Desdérogati<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t prévues, mais ne peuvent être mises en oeuvre que par des lois.En outre, elles ne peuvent avoir qu'un caractère excepti<strong>on</strong>nel. Ce s<strong>on</strong>t les lois depolice, celles se rapportant aux expropriati<strong>on</strong>s pour cause d'utilité publique, les loiset règlements pris en vertu des circ<strong>on</strong>stances graves comme le cas des pouvoirsexcepti<strong>on</strong>nels du Président du Faso, prévus par l'article 59 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.Il est important de relever que les traités et accords internati<strong>on</strong>aux régulièrementratifiés ou approuvés <strong>on</strong>t dès leur publicati<strong>on</strong>, une autorité supérieure à celle deslois, sous réserve de réciprocité (art 151 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>). Ils peuvent êtreinvoqués devant les autorités judiciaires ou administratives pour une applicati<strong>on</strong>directe. C'est dire que les dispositi<strong>on</strong>s de la Charte Africaine des Droits de l'Hommeet des Peuples <strong>on</strong>t une autorité supérieure à celle des lois et peuvent être invoquéesdirectement devant toutes les juridicti<strong>on</strong>s burkinabé. Aucune autre mesure n'estnécessaire pour leur applicati<strong>on</strong>.
363. Le système judiciaire.L'organisati<strong>on</strong> judiciaire au Burkina Faso a pris les dispositi<strong>on</strong>s utiles pour créer lesc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s nécessaires à l'applicati<strong>on</strong> effective des libertés f<strong>on</strong>damentales telles quele droit à la vie, l'égalité devant la loi, le droit à une égale protecti<strong>on</strong> de la loi, ledroit à un procès équitable et l'interdicti<strong>on</strong> de la pris<strong>on</strong> pour une violati<strong>on</strong> d'unesimple obligati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tractuelle prévus par les articles 3, 6 et 7.La Loi N° 010/93/ADP du 17 Mai 1993 portant organisati<strong>on</strong> judiciaire a fixé lesiège, le ressort, la compétence et la compositi<strong>on</strong> des Cours et Tribunaux,c<strong>on</strong>formément à l'article 128 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.• La Cour Suprême• Les Cours d'Appel• Les Tribunaux de Gr<strong>and</strong>e Instance• Les Tribunaux d'Instance• Les Tribunaux départementaux• Les Tribunaux du Travail3.1. La Cour SuprêmeL'ord<strong>on</strong>nance N°91-0051/PRES du 26 Août 1991 détermine la compositi<strong>on</strong>,l'organisati<strong>on</strong> et le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la Cour Suprême.3.1.1. Le Président de la Cour SuprêmeLa Cour Suprême comprend un Président, un Vice-président, trois_Présidents dechambre, des c<strong>on</strong>seillers, un Procureur Général, des Avocats généraux et desCommissaires de Gouvernement.L'article 5 de ladite Ord<strong>on</strong>nance stipule ceci :« il ne peut être mis fin aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s du Président de la Cour Suprême en périodeélectorale, de dissoluti<strong>on</strong> de l'Assemblée des députés du peuple, de l'exercice despouvoirs excepti<strong>on</strong>nels du Président du Faso ».Ces dispositi<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t importantes à plusieurs égards :• Parmi les attributi<strong>on</strong>s de la Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle, <strong>on</strong> relève qu'elle statuesur la régularité des opérati<strong>on</strong>s relatives à l'électi<strong>on</strong> du Président du Faso,
37examine les réclamati<strong>on</strong>s et proclame les résultats.Le Président de la Cour Suprême étant le Président de la ChambreC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle, le législateur a entendu le soustraire à l'influence del'exécutif pendant la période électorale.Le Président du Faso qui nomme le Président de la Cour Suprême et qui peutmettre fin à ses f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s pourrait être tenté d'user abusivement de cetteprérogative si celui-ci refuse d'obtempérer à d'éventuelles inj<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s ou si laChambre prend ou est soupç<strong>on</strong>née de vouloir prendre une décisi<strong>on</strong> en défaveurde l'exécutif, notamment en matière de c<strong>on</strong>tentieux électoral.• Lorsque l'Assemblée est dissoute seuls deux pouvoirs demeurent : l'exécutif etle judiciaire, la Chambre des Représentant n'ayant pas les véritables moyenslégaux de c<strong>on</strong>trôle de l'exécutif. Si le représentant du pouvoir judiciaire estdestitué, le pays ne sera géré que par le seul pouvoir exécutif ce qui excluttoute possibilité de c<strong>on</strong>trôle.• L'exercice des pouvoirs excepti<strong>on</strong>nels par le Président du Faso nécessite unminimum de c<strong>on</strong>trôle.C'est pourquoi le c<strong>on</strong>stituant burkinabé a exclu la possibilité de mettre fin auxf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s du Président de la Cour Suprême pendant cette période.3.1.2. La Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelleLes attributi<strong>on</strong>s de la Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle s<strong>on</strong>t les suivantes :■elle assure le c<strong>on</strong>trôle de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nalité des lois■elle statue sur la régularité des opérati<strong>on</strong>s relatives à l'électi<strong>on</strong>s du Président duFaso, examine les réclamati<strong>on</strong>s et proclame les résultats du scrutin...■elle statue en cas de c<strong>on</strong>testati<strong>on</strong> sur l'éligibilité des députés et la régularité deleur électi<strong>on</strong>...■elle statue sur la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nalité des clauses insérées dans les engagementsinternati<strong>on</strong>aux■elle statue sur la régularité des opérati<strong>on</strong>s de référendum et proclame lesrésultats...Cette juridicti<strong>on</strong> doit veiller à l'applicati<strong>on</strong> de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. Les instituti<strong>on</strong>s del'Etat f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nent sous s<strong>on</strong> c<strong>on</strong>trôle :
38En incluant dans ses attributi<strong>on</strong>s le c<strong>on</strong>trôle de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nalité des lois, lelégislateur a entendu c<strong>on</strong>fier à la Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle la surveillance del'activité du pouvoir législatif qui porte essentiellement sur l'élaborati<strong>on</strong> etl'adopti<strong>on</strong> des lois.Le c<strong>on</strong>trôle de la régularité de l'électi<strong>on</strong> du Président du Faso lui permet des'assurer que le chef de l'exécutif a été investi c<strong>on</strong>formément à la vol<strong>on</strong>té dupeuple. Elle est habilitée à annuler, le cas échéant, l'électi<strong>on</strong> du Président du Faso.3.1.3. La Chambre Judiciaire de la Cour SuprêmeC'est la juridicti<strong>on</strong> de recours c<strong>on</strong>tre les décisi<strong>on</strong>s prises par la Cour d'Appel.La Chambre judiciaire a les attributi<strong>on</strong>s classiques de la cour de cassati<strong>on</strong> dans lesystème judiciaire français.3.1.4. la Chambre administrativeIl y a lieu de menti<strong>on</strong>ner qu'une innovati<strong>on</strong>importante a été opérée dansl'organisati<strong>on</strong> judiciaire. Il s'agit de l'adopti<strong>on</strong> de la loi n°21/95/ADP du 16 Mai1995, portant créati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des TribunauxAdministratifs.L'ancien système judiciaire en vigueur au Burkina Faso avait institué la ChambreAdministrative de la Cour Suprême. Cette Chambre Administrative tranchait enpremier et en dernier ressort des litiges qui lui étaient soumis et qui relevaient de sacompétence. Aucune voie de recours c<strong>on</strong>tre ces décisi<strong>on</strong>s n'était offerte aujusticiable. Le principe du double degré de juridicti<strong>on</strong> était ainsi violé. L'adopti<strong>on</strong> dela loi n°21/95/ADP du 16 Mai 1995, portant créati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> etf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des Tribunaux Administratifs a mis fin à cette violati<strong>on</strong>.On mesure la gr<strong>and</strong>e portée de cette loi lorsqu'<strong>on</strong> résume le domaine decompétence de la Chambre Administrative. Elle est compétente pour c<strong>on</strong>naître desrecours pour excès de pouvoir. A l'image de la Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle, elle sepenche sur les textes réglementaires et les actes administratifs qui lui s<strong>on</strong>t soumis.Elle peut en pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer la nullité.Les litiges liés à l'expropriati<strong>on</strong> peuvent lui être soumis.
39En outre la Chambre Administrative c<strong>on</strong>naît les différends soulevés à l'occasi<strong>on</strong> desélecti<strong>on</strong>s municipales.Les recours visant à engager la resp<strong>on</strong>sabilité de l'Administrati<strong>on</strong> lui s<strong>on</strong>t soumis.Le c<strong>on</strong>tentieux c<strong>on</strong>cernant le lotissement et les parcelles relève de sa compétence.Compte tenu du large domaine d'interventi<strong>on</strong>, il était dangereux que la ChambreAdministrative statue en premier et en dernier ressort.3.2. La Cour d'AppelL'article 10 de la loi n°089/93/ADP du 17 Mai 1993, portant organisati<strong>on</strong> judiciaireau Burkina Faso traite de la compositi<strong>on</strong> de la Cour d'Appel :• Un Président ;• Un Vice Président ;• Des C<strong>on</strong>seillers ;• Un Procureur Général ;• Des Avocats généraux ou des Substituts généraux ;• Un Greffier en Chef et des Greffiers.L'article 12 dispose que la Cour d'Appel comprend :• Une Chambre Civile ;• Une Chambre Commerciale ;• Une Chambre Sociale ;• Une Chambre Criminelle ;• Une Chambre d'Accusati<strong>on</strong>.L'élément nouveau qui mérite de retenir l'attenti<strong>on</strong> est la créati<strong>on</strong> de la ChambreCriminelle par la loi n°51/93/ADP du 16 Décembre 1993.Avant le 12 Janvier 1994, date d'entrée en vigueur de ladite loi, les affairescriminelles étaient jugées par la Cour d'Assises. Cette juridicti<strong>on</strong> ne pouvait siégerque suite à l'autorisati<strong>on</strong> d<strong>on</strong>née par le C<strong>on</strong>seil des Ministres. Cette situati<strong>on</strong>comportait des c<strong>on</strong>séquences négatives :
40• Il était porté atteinte à l'indépendance de la magistrature. L'exécutif devaitautoriser des magistrats supposés indépendants à siéger. De nombreusesprocédures criminelles en état d'être jugées peuvent être bloquées, la Courd'assises ne pouvant siéger à défaut d'y avoir été autorisé par le C<strong>on</strong>seildes Ministres.• Seuls les magistrats, qui <strong>on</strong>t accès aux dossiers peuvent savoir s'il y asuffisamment d'affaires pour qu'une sessi<strong>on</strong> de la juridicti<strong>on</strong> chargée dejuger les crimes soit organisée. L'exécutif ne dispose pas de d<strong>on</strong>néessuffisantes pour faire une telle appréciati<strong>on</strong>. Elle peut d'ailleurs avoir, àcertaines périodes, des préoccupati<strong>on</strong>s d'ordre politique qui peuventl'amener à reléguer au sec<strong>on</strong>d plan le jugement des affaires criminelles.Cette situati<strong>on</strong> entravait la mise en œuvre du principe sel<strong>on</strong> lequel chaquecitoyen a droit à ce que s<strong>on</strong> affaire soit jugée dans un délai rais<strong>on</strong>nable.L'instituti<strong>on</strong> d'une Chambre Criminelle de la Cour d'Appel a résolu cesentraves. Un budget est voté par année judiciaire à cette ChambreCriminelle qui fixe ses sessi<strong>on</strong>s en f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> des procédures qui s<strong>on</strong>t en étatd'être jugées ou qui le ser<strong>on</strong>t au cours de l'année.Il faut préciser que cette reforme n'a pas écarté la participati<strong>on</strong> de la sociétécivile dans le jugement des affaires Criminelles. A côté du Président et desdeux c<strong>on</strong>seillers qui composent la Chambre Criminelle, quatre jurés qui s<strong>on</strong>ttirés au sort, siègent également.La Cour d'Appel c<strong>on</strong>naît des décisi<strong>on</strong>s des Tribunaux de Gr<strong>and</strong>e Instance et desTribunaux du travail qui <strong>on</strong>t fait l'objet d'un appel.3.3. Le Tribunal de Gr<strong>and</strong>e InstanceL'article 19 de la loi n°10/93/ADP du 17 Mai 1993 portant organisati<strong>on</strong> judiciairedispose que le Tribunal de Gr<strong>and</strong>e Instance se compose :• d'un Président ;• d'un Vice Président ;• de Présidents de Chambre ;• de Juges ;
41• du Procureur du Faso et de ses Substituts ;• d'un Greffier en Chef et de Greffiers.Par souci d'introduire une plus gr<strong>and</strong>e impartialité dans les décisi<strong>on</strong>s desjuridicti<strong>on</strong>s, le législateur avait introduit le système de collégialité dans lesformati<strong>on</strong>s du Tribunal de Gr<strong>and</strong>e Instance. Mais cette mesure n'a pas pu êtreappliquée à cause du nombre insuffisant de magistrats. La loi N°044/94 ADP du 24Novembre 1944 a autorisé les Tribunaux de Gr<strong>and</strong>e Instance à siéger à juge unique.3.4. Le Tribunal DépartementalL'ancien système judiciaire applicable au Burkina Faso avait créé des tribunauxcoutumiers qui f<strong>on</strong>daient leurs décisi<strong>on</strong>s sur la coutume. Dans un Etat de droit, lelégislateur a c<strong>on</strong>sidéré qu'il ne pouvait pas être admis que les citoyens d'un mêmepays soient soumis à deux systèmes judiciaires différents : les juridicti<strong>on</strong>s ditesmodernes et les juridicti<strong>on</strong>s coutumières. Ce souci était d'autant plus justifié quecette ancienne organisati<strong>on</strong> avait été c<strong>on</strong>çue pendant la période col<strong>on</strong>iale ou ladistincti<strong>on</strong> était faite entre indigènes et citoyens, mais aussi parce qu'il existe denombreuses coutumes au Burkina Faso.Mais la suppressi<strong>on</strong> des tribunaux coutumiers, si elle était justifiée, créait un vide etéloignait la justice du justiciable. La créati<strong>on</strong> des tribunaux départementaux comblece vide. Tous les chefs lieux de départements abritent un tribunal départemental.Leur domaine de compétence a été défini. Ils c<strong>on</strong>naissent :• de toutes les situati<strong>on</strong>s n<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tentieuses relevant de l'état des pers<strong>on</strong>nes ;• des affaires civiles et commerciales d<strong>on</strong>t le taux ne dépasse pas 100 000 ;• des différends relatifs à la divagati<strong>on</strong> des animaux.Ces juridicti<strong>on</strong>s <strong>on</strong>t permis de désengorger les Tribunaux de Gr<strong>and</strong>e Instance.En outre, ils privilégient la voie de la c<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> à celle de la répressi<strong>on</strong>.3.5. Le Tribunal du TravailLa loi n° 11/92/ADP du 22 Décembre 1992 a institué un Code du Travail.L'article 179 de ladite loi dispose qu'il est institué des Tribunaux du Travail quic<strong>on</strong>naissent des différends individuels pouvant s'élever à l'occasi<strong>on</strong> du c<strong>on</strong>trat de
42travail et d'apprentissage.L'article 183 en d<strong>on</strong>ne la compositi<strong>on</strong> :• un magistrat, Président• deux Assesseurs employeurs et deux assesseurs salariés....La loi n°11/92/ADP du 22 Décembre 1992 portant Code du Travail a introduit desinnovati<strong>on</strong>s comparativement à la loi n°9-73/AN du 7 Juin 1973 , portant Code duTravail qu'elle a abrogée. En effet la procédure de l'arbitrage a été introduite.Les articles 209 et 210 précisent la procédure de l'arbitrage.Article 209 « Dans les cinq jours qui suivent la récepti<strong>on</strong> du procès-verbal de n<strong>on</strong>c<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong>, le Ministre chargé du Travail soumet le différend à la procédured'arbitrage par la désignati<strong>on</strong> d'un arbitre ».L'article 210 : « L'arbitre est désigné parmi les pers<strong>on</strong>nalités susceptibles de remplirles f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s d'arbitre, d<strong>on</strong>t la liste est établie, chaque année, par un arrêté c<strong>on</strong>jointdu Ministre chargé du Travail et du Ministre chargé de la Justice, après avis de la<str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> c<strong>on</strong>sultative du Travail ».Il faut signaler que la procédure d'arbitrage est précédée par une tentative dec<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> d<strong>on</strong>t est chargée l'Inspecti<strong>on</strong> du Travail.En outre la procédure de l'arbitrage n'intervient qu'en cas de différend collectif.4. Le Médiateur du Faso.Il c<strong>on</strong>stitue un recours complémentaire essentiel dans le cadre juridique général pourla promoti<strong>on</strong>, la protecti<strong>on</strong> et le recouvrement des droits de l'homme et despeuples. Le Médiateur du Faso est une instituti<strong>on</strong> de recours gracieux offerte auxcitoyens qui se sentiraient lésés dans leur droit vis-à-vis de l'administrati<strong>on</strong> ou quivoudraient obtenir une faveur de l'administrati<strong>on</strong>.Le Médiateur du Faso a été institué par la loi organique n°22/94/ADP du 17 mai1994. C'est un organe intercesseur gracieux entre l'administrati<strong>on</strong> publique et lesadministrés.Le Médiateur du Faso est compétent pour c<strong>on</strong>naître des différends qui opposent
43l'administré, c'est-à-dire une pers<strong>on</strong>ne physique ou une pers<strong>on</strong>ne morale, àl'administrati<strong>on</strong> publique au sens large du terme, c'est-à-dire les Administrati<strong>on</strong>sd'Etat, les collectivités territoriales, les Etablissements publics ou tout organismeinvesti d'une missi<strong>on</strong> de service public, dans les cas de mauvais f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement deces services, ou du refus d'exécuti<strong>on</strong> d'une décisi<strong>on</strong> de justice.La missi<strong>on</strong> générale dévolue au Médiateur du Faso est de rép<strong>on</strong>dre au besoin dedialogue et de compréhensi<strong>on</strong> entre l'Administrati<strong>on</strong> publique et les administrés,dialogue permanent ayant pour effet de rompre le rigidité, l'inertie et la lourdeur desstructures et organes administratifs, de combattre les pratiques néfastes des agentspublics et de c<strong>on</strong>tribuer à l'assise d'une administrati<strong>on</strong> respectueuse de la légalité etdes droits des citoyens. Cette missi<strong>on</strong> est d'autant plus pertinente que le BurkinaFaso, pays en voie de développement, compte plus de 70% d'analphabètes et 90%de sa populati<strong>on</strong> est rurale. Très peu de pers<strong>on</strong>nes <strong>on</strong>t une culture juridique etadministrative suffisante, ce qui les expose à toutes sortes de vexati<strong>on</strong>s et debrimades de la part de certains agents de l'Administrati<strong>on</strong> publique.Le Médiateur du Faso a pour principaux pouvoirs :■de procéder à des vérificati<strong>on</strong>s et enquêtes à propos d'une réclamati<strong>on</strong> qui luiest soumise avec ses propres moyens ou avec le c<strong>on</strong>cours des corps dec<strong>on</strong>trôle et d'inspecti<strong>on</strong> ;■de dem<strong>and</strong>er à tout Ministre ou à toute autorité compétente, communicati<strong>on</strong>de tout document ou dossier qu'il juge utile à s<strong>on</strong> enquête et d'autoriser lesagents placés sous leur autorité à rép<strong>on</strong>dre à ses questi<strong>on</strong>s et éventuellement,à ses c<strong>on</strong>vocati<strong>on</strong>s ;■de requérir d'être tenu informé des mesures qui aur<strong>on</strong>t été effectivementprises pour remédier à une situati<strong>on</strong> préjudiciable. A défaut de rép<strong>on</strong>sesatisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut aviser par écrit, le Président duFaso et s'il le juge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou danss<strong>on</strong> rapport annuel ;■de dem<strong>and</strong>er à l'autorité compétente d'engager c<strong>on</strong>tre tout agent publicindélicat une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de saisir d'une plainte
44la juridicti<strong>on</strong> répressive ;■d'enjoindre à tout organisme mis en cause d'exécuter une décisi<strong>on</strong> de justicepassée en force de chose jugée, dans un délai qu'il fixe. Si cette inj<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>n'est pas suivie d'effet, il peut en aviser par écrit le Président du Faso, et s'il lejuge à propos, exposer le cas dans un rapport spécial ou dans s<strong>on</strong> rapportannuel ;d'attirer l'attenti<strong>on</strong> du Président du Faso sur les réformes législatives,réglementaires ou administratives qu'il juge c<strong>on</strong>formes à l'intérêt général en vue deremédier à des situati<strong>on</strong>s préjudiciables qu'il a c<strong>on</strong>statées et pour éviter leurrépétiti<strong>on</strong> ou parer à des situati<strong>on</strong>s analogues.II. MISE EN ŒUVRE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.1. F<strong>on</strong>dements juridiques.1.1. La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.Dans s<strong>on</strong> préambule, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> ann<strong>on</strong>ce solennellement l'adhési<strong>on</strong> du Burkinaà la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (C.A.D.H.P.) :« Réaffirmant solennellement notre adhési<strong>on</strong> à la Charte Africaine des Droits del'Homme et des Peuples ».Les articles 1 à 13 traitent des droits civils et politiques prévus par les articles 1er à18 de la Charte : le droit à la vie, l'interdicti<strong>on</strong> de la torture et des mauvaistraitements, l'interdicti<strong>on</strong> de l'arrêt ou de la détenti<strong>on</strong> arbitraire, l'égalité devant laloi, l'aboliti<strong>on</strong> de l'esclavage, de la servitude et des travaux forcés, le droit à unprocès équitable, la liberté de c<strong>on</strong>science, d'expressi<strong>on</strong>, de réuni<strong>on</strong> et d'associati<strong>on</strong>,la liberté de recevoir et de rép<strong>and</strong>re des informati<strong>on</strong>s, le droit de circuler librement,la libre participati<strong>on</strong> au gouvernement du pays, et le droit d'accéder aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>spubliques, l'interdicti<strong>on</strong> d'une c<strong>on</strong>damnati<strong>on</strong> pour une infracti<strong>on</strong> qui ne c<strong>on</strong>stituaitpas un acte délictueux au moment où elle a été commise, l'interdicti<strong>on</strong> de ladiscriminati<strong>on</strong> en rais<strong>on</strong> de la race, de l'ethnie, de la couleur, de la religi<strong>on</strong>, d'uneopini<strong>on</strong> politique ou de tout autre opini<strong>on</strong>.
451.2. Les dispositi<strong>on</strong>s de la Charte face aux juridicti<strong>on</strong>s nati<strong>on</strong>ales.Les dispositi<strong>on</strong>s de la Charte peuvent être invoqués devant les juridicti<strong>on</strong>s ycompris celles qui n'<strong>on</strong>t pas fait l'objet de réglementati<strong>on</strong> intérieure. L'article 5 ducode pénal est ainsi c<strong>on</strong>çu« Les traités, accords ou c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s dûment ratifiés et publiés s'imposent auxdispositi<strong>on</strong>s pénales internes ».Sur la base de ces dispositi<strong>on</strong>s, la juridicti<strong>on</strong> répressive burkinabé peut appliquerdirectement le c<strong>on</strong>tenu de la Charte.1.3. Autorités nati<strong>on</strong>ales et applicati<strong>on</strong> des dispositi<strong>on</strong>s de la CharteLa C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du Burkina Faso ayant expressément repris tous les droits recenséspar la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les décisi<strong>on</strong>s, lesrèglements ou les textes de loi d<strong>on</strong>t les dispositi<strong>on</strong>s seraient en c<strong>on</strong>tradicti<strong>on</strong> avecle c<strong>on</strong>tenu des dites libertés pourraient être déférés devant la ChambreC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle de la Cour Suprême. En effet, l'article 26 de l'Ord<strong>on</strong>nance N°-91-0050/PRES du 26 Août 1991 portant compositi<strong>on</strong>, Organisati<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nementde la Cour Suprême dispose que la Chambre c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle assure le c<strong>on</strong>trôle dela C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nalité des lois.Or, dans la hiérarchie des textes au Burkina Faso, les traités internati<strong>on</strong>aux <strong>on</strong>t unevaleur supérieure à celle de la loi. La c<strong>on</strong>séquence de cette c<strong>on</strong>sidérati<strong>on</strong> est que siun texte législatif ou réglementaire est c<strong>on</strong>traire aux dispositi<strong>on</strong>s d'un traité oud'une c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>, le premier texte doit être annulé.1.4. Les autorités judiciaires ou administratives ayant compétence en matière desdroits de l'homme.Parmi les attributi<strong>on</strong>s dévolues par l'article 36 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> au Président duFaso figure le fait qu'il veille au respect de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. Etant d<strong>on</strong>né que laC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> a repris les libertés f<strong>on</strong>damentales proclamées par la Charte, lePrésident du Faso veille par c<strong>on</strong>séquent à leur respect.D'ailleurs la lecture de la formule du serment prêté par le Président du Faso devantle Cour Suprême fait apparaître qu'un accent particulier a été mis sur l'obligati<strong>on</strong>
46faite à celui-ci de veiller au respect des libertés f<strong>on</strong>damentales :« Je jure devant le Peuple Burkinabé et sur m<strong>on</strong> h<strong>on</strong>neur de préserver, de respecteret de faire respecter et de défendre la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> et les lois, de tout mettre enoeuvre pour garantir la Justice à tous les habitants du Burkina Faso ».Mais c'est l'article 125 qui détermine l'autorité directement compétente en matièredes droits de l'homme : « le pouvoir judiciaire est gardienne des libertésindividuelles et collectives.Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> ».Cette importante attributi<strong>on</strong> est exercée par les juridicti<strong>on</strong>s. Il importe dès lors defaire un aperçu de l'organisati<strong>on</strong> judiciaire au Burkina Faso.1.5. Les voies de recours d'un individu victime de la violati<strong>on</strong> de ses droits.L'individu d<strong>on</strong>t les droits <strong>on</strong>t été violés peut saisir la juridicti<strong>on</strong> compétente quistatuera sur sa requête.• L'article 126 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> détermine les juridicti<strong>on</strong>s au Burkina Faso :« Les juridicti<strong>on</strong>s au Burkina Faso.• L'article 127 indique que la Cour Suprême est la juridicti<strong>on</strong> supérieure. Enoutre, il dispose que la loi fixe le siège, le ressort, la compétence et lacompositi<strong>on</strong> des Cours et Tribunaux.1.6. Droit de toute pers<strong>on</strong>ne à la jouissance des droits et libertés rec<strong>on</strong>nus etgarantis par la Charte (art.2).Les droits et libertés rec<strong>on</strong>nus et garantis par la Charte s<strong>on</strong>t les mêmes que ceuxrec<strong>on</strong>nus et garantis par la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> burkinabé, qui stipule en s<strong>on</strong> article 1' que« tous les burkinabé naissent libres et égaux. Tous <strong>on</strong>t une égale vocati<strong>on</strong> à jouir detous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.Les discriminati<strong>on</strong>s de toutes sortes, notamment celles f<strong>on</strong>dées sur la race, l'ethnie,la régi<strong>on</strong>, la couleur, le sexe, la langue, la religi<strong>on</strong>, la caste, les opini<strong>on</strong>s politiques,la fortune et la naissance, s<strong>on</strong>t prohibées ».A la suite de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, le Code du travail burkinabé interdit toute
47discriminati<strong>on</strong> en matière d'emploi et de travail (art 1). Mieux, le Code pénal en s<strong>on</strong>article 132 punit d'un empris<strong>on</strong>nement de 1 à 5 ans et de l'interdicti<strong>on</strong> de séjour de5 ans, tout acte de discriminati<strong>on</strong>. La discriminati<strong>on</strong> est alors définie comme « toutedistincti<strong>on</strong>, exclusi<strong>on</strong>, restricti<strong>on</strong> ou préférence f<strong>on</strong>dée sur la race, la couleur,l'ascendance ou l'origine nati<strong>on</strong>ale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet dedétruire ou de compromettre la rec<strong>on</strong>naissance, la jouissance ou l'exercice dans desc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s d'égalité, des droits de l'homme et des libertés f<strong>on</strong>damentales dans lesdomaines politique, éc<strong>on</strong>omique, social et culturel ou dans tout autre domaine de lavie publique. »2. Protecti<strong>on</strong> des droits civils et politiques.Par loi N°43/96/ADP du 13 Novembre 1996, le Burkina Faso s'est doté d'unnouveau code Pénal. Ce texte c<strong>on</strong>stitue une mise en oeuvre des libertésf<strong>on</strong>damentales én<strong>on</strong>cées par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et desPeuples.« Les dispositi<strong>on</strong>s de notre Code Pénal étaient essentiellement celles du CodeNapolé<strong>on</strong> de 1810 rendu applicable en Afrique Occidentale.Ces dispositi<strong>on</strong>s, souvent archaïques et inadaptées à nos réalités nati<strong>on</strong>alesappelaient une ref<strong>on</strong>te complète de notre législati<strong>on</strong> pénale dans un code uniquerép<strong>on</strong>dant aux exigences de notre temps et renforçant l'Etat de droit... »De même, de nouvelles incriminati<strong>on</strong>s protectrices des droits de l'homme <strong>on</strong>t vu lejour comme les crimes c<strong>on</strong>tre l'humanité, la répressi<strong>on</strong> des atteintes c<strong>on</strong>trel'intégrité sexuelle de la femme et à la liberté du mariage.Le nouveau code pénal prend d<strong>on</strong>c largement en compte les libertés f<strong>on</strong>damentalesc<strong>on</strong>tenues dans la Charte. C'est ce qui justifie que nous y fer<strong>on</strong>s fréquemmentréférence lorsque nous traiter<strong>on</strong>s de la mise en oeuvre de chacun des droitsf<strong>on</strong>damentaux c<strong>on</strong>tenus la Charte.2.1. Droit à la vie et à l'intégrité physique .Le Code pénal prévoit toutefois au nombre des peines en matière criminelle, la peinede mort, qui s'exécute par fusillade en un lieu désigné par décisi<strong>on</strong> du ministèrechargé de la justice (art.15 et 16). Mais elle ne peut être mise à exécuti<strong>on</strong> que
48lorsque la grâce a été refusée (art ; 684 du Code de procédure pénale).Il faut aussi relever le régime spécial réservé aux femmes et aux mineurs.L'exécuti<strong>on</strong> d'une femme c<strong>on</strong>damnée à mort est subord<strong>on</strong>née à la délivrance d'uncertificat de n<strong>on</strong> grossesse. Si s<strong>on</strong> état de grossesse est médicalement c<strong>on</strong>staté, lafemme c<strong>on</strong>damnée à mort ne subira sa peine qu'après sa délivrance (art. 19). Il estcependant important de noter que, bien que cette peine peut être pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cée c<strong>on</strong>treles femmes, elle n'a jamais été appliquée. D'une manière générale, la peine capitalereste très peu appliquée.C<strong>on</strong>cernant les mineurs, le Code pénal a fixé la majorité pénale à 18 ans (art. 632).Pour le mineur de moins de 13 ans ainsi que celui de 13 à 18 ans qui a agi sansdiscernement, il est prévu des mesures d'assistance éducative c<strong>on</strong>sistant pourl'essentiel à la remise à sa famille, s<strong>on</strong> placement chez un parent ou chez unepers<strong>on</strong>ne digne de c<strong>on</strong>fiance, s<strong>on</strong> placement dans une instituti<strong>on</strong> charitable,religieuse ou autre ou dans un établissement public spécialisé.Pour le mineur de moins de 13 ans, il est prévu une irresp<strong>on</strong>sabilité pénale. L'article74 du Code pénal dispose expressément qu'il n'y a ni crime, ni délit, nic<strong>on</strong>traventi<strong>on</strong> lorsque l'auteur de l'infracti<strong>on</strong> était âgé de moins de 13 ans à la datede la commissi<strong>on</strong> des faits.Le mineur de moins de 13 ans, ainsi que celui de 13 à 18 ans qui a agi sansdiscernement ne peut faire l'objet que de mesures éducatives et de sûreté.Le mineur de 18 ans, même s'il est c<strong>on</strong>damné, ne subit pas immédiatement lapeine.De manière générale, même si le Code pénal burkinabé prévoit la peine capitale, elleest rarement mise en exécuti<strong>on</strong> ; elle a toujours été dans la pratique commuée enpeine privative de liberté qu<strong>and</strong> la grâce n'a pas été accordée.2.2. Droit à la liberté et à la sécurité de sa pers<strong>on</strong>ne (art.6)L'article 3 de la Loi f<strong>on</strong>damentale dispose que nul ne peut être privé de sa liberté s'iln'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.A cet égard, la loi n°43/96/ADP du 13 novembre 1996 portant Code pénal prévoit
99expressément les cas où le citoyen peut se voir privé de sa liberté ; il s'agitnotamment de l'empris<strong>on</strong>nement à vie et de l'empris<strong>on</strong>nement à temps en matièrecriminelle, et seulement de l'empris<strong>on</strong>nement à temps en matière correcti<strong>on</strong>nelle.Elle détermine la durée de la peine d'empris<strong>on</strong>nement sel<strong>on</strong> la gravité de l'infracti<strong>on</strong>.A la suite, le Code de procédure pénale édicte les règles d'applicati<strong>on</strong> de ces peinesen allant de la phase de l'enquête, de la détenti<strong>on</strong> préventive à la c<strong>on</strong>damnati<strong>on</strong>définitive par le tribunal.Ainsi qu<strong>and</strong> les besoins de l'enquête l'exigent, l'accusé peut être gardé à vuependant 72 heures prorogeables de 48 heures (art.62). Quant à la détenti<strong>on</strong>préventive qui est une mesure excepti<strong>on</strong>nelle, elle peut aller de 5 jours en matièrecorrecti<strong>on</strong>nelle à 6 mois pour les infracti<strong>on</strong>s plus graves.Mais la loi ne prévoit pas seulement les cas où une pers<strong>on</strong>ne peut être légalementprivée de sa liberté ; elle punit tout f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naire public ou tout représentant del'autorité qui se serait rendu coupable d'un acte arbitraire ou attentatoire à la libertéindividuelle (art. 141 CP) ou qui, ayant c<strong>on</strong>naissance de faits de détenti<strong>on</strong> illégaleou arbitraire, refuse ou néglige de les c<strong>on</strong>stater ou de les faire cesser (art 146 CP).D'une manière générale, la loi punit ceux qui, sans ordre des autorités c<strong>on</strong>stituéeset hors les cas où la loi le permet ou l'ord<strong>on</strong>ne, enlèvent, arrêtent, détiennent,séquestrent une pers<strong>on</strong>ne ou prêtent, en c<strong>on</strong>naissance de cause, un lieu pourdétenir ou séquestrer une pers<strong>on</strong>ne ( art 356 à 358 CP).2.3. L'interdicti<strong>on</strong> de l'arrestati<strong>on</strong> et de la détenti<strong>on</strong> arbitraire.L'article 6 de la Charte c<strong>on</strong>sacre le principe de l'interdicti<strong>on</strong> de l'arrestati<strong>on</strong> et de ladétenti<strong>on</strong> arbitraire.Les articles 147 à 148 du code pénal prévoient et punissent les cas de détenti<strong>on</strong>arbitraire :« S<strong>on</strong>t punis d'un empris<strong>on</strong>nement de un à cinq ans :• Les Procureurs Généraux ou du Faso, les substituts généraux, les juges ou lesofficiers de police judiciaire qui retiennent ou f<strong>on</strong>t retenir un individu hors deslieux ou en dehors des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s déterminées par la loi ».L'article 356 du code pénal punit d'un empris<strong>on</strong>nement de cinq à dix ans, ceux qui,
50sans ordre des autorités c<strong>on</strong>stituées et hors les cas ou la loi le permet oul'ord<strong>on</strong>ne, enlèvent, arrêtent ou détiennent, séquestrent une pers<strong>on</strong>ne ou prêtent enc<strong>on</strong>naissance de cause un lieu pour détenir ou séquestrer une pers<strong>on</strong>ne.2.4. Egalité devant la loi et droit a une égale protecti<strong>on</strong> de la loi (art 3 et art 7)La Loi f<strong>on</strong>damentale du Burkina Faso garantit en s<strong>on</strong> article 4, l'égalité devant la loiet le droit à une égale protecti<strong>on</strong> de la loi ; elle rec<strong>on</strong>naît la présompti<strong>on</strong>d'innocence et le droit à la défense y compris le libre choix du défenseur devanttoutes les juridicti<strong>on</strong>s.La loi n°010/93/ADP du 17 mai 1993 portant organisati<strong>on</strong> judiciaire au BurkinaFaso dispose en s<strong>on</strong> article 6 que <
51Tout citoyen qui se rend auteur d'un fait qualifié de c<strong>on</strong>traventi<strong>on</strong>, de délit ou decrime peut être traduit respectivement devant le tribunal d'instance, la chambrecorrecti<strong>on</strong>nelle du Tribunal de Gr<strong>and</strong>e Instance et la Chambre Criminelle de la Courd'Appel.L'article 138 de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose que la Haute Cour de Justice estcompétente pour c<strong>on</strong>naître des actes commis par le Président du Faso dansl'exercice de ses f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s et c<strong>on</strong>stitutifs de haute trahis<strong>on</strong>, d'attentat à lac<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> ou de détournement de deniers publics.La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres duGouvernement en rais<strong>on</strong> des faits qualifiés de crimes ou délits dans l'exercice ou àl'occasi<strong>on</strong> de l'exercice de leurs f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s. Dans tous les autres cas ils restentjusticiables des juridicti<strong>on</strong>s de droit commun ou des autres juridicti<strong>on</strong>s.L'exposé du c<strong>on</strong>tenu et cet article m<strong>on</strong>tre que même les plus hautes autorités dupays ne s<strong>on</strong>t pas au dessus de la loi.La Haute Cour de Justice a été effectivement mise en place. Ses membres <strong>on</strong>t éténommés et ils <strong>on</strong>t prêté serment. Ils <strong>on</strong>t élu leur Président. Ceci doit être menti<strong>on</strong>nécar toutes les c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>s qui <strong>on</strong>t été en vigueur en Haute Volta devenue BurkinaFaso prévoyait formellement ce type de juridicti<strong>on</strong> mais n'avait jamais vu le joureffectivement.Cependant la loi a prévu des dérogati<strong>on</strong>s pour certaines catégories de pers<strong>on</strong>nes.Ces pers<strong>on</strong>nes bénéficient des causes de n<strong>on</strong> imputabilité. Ainsi l'article 73 ducode pénal prévoit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni c<strong>on</strong>traventi<strong>on</strong> lorsque l'auteurétait en état de démence au temps de l'acti<strong>on</strong>... »L'article 74 : « Il n'y a ni crime, ni délit, ni c<strong>on</strong>traventi<strong>on</strong> lorsque l'auteur del'infracti<strong>on</strong> était âgé de moins de treize ans à la date de commissi<strong>on</strong> des faits.Les dispositi<strong>on</strong>s des articles 515 et 516 instituant l'immunité familiale dérogentégalement au principe de l'égalité devant la loi : « Ne s<strong>on</strong>t pas punissables et nepeuvent d<strong>on</strong>ner lieu qu'à des réparati<strong>on</strong>s civiles le vol, l'escroquerie, l'abus dec<strong>on</strong>fiance et le recel commis entre époux ou par des ascendants au préjudice deleurs enfants ou autres descendants ».
522.5. Aboliti<strong>on</strong> de l'esclavage, de la servitude et des travaux forcés (art. 5).Outre la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> qui, en s<strong>on</strong> article 2, al.2 interdit et punit l'esclavage, lespratiques esclavagistes... et toutes les formes d'avilissement de l'homme, le Codedu travail interdit le travail forcé ou obligatoire de faç<strong>on</strong> absolue. Cette dernière loidéfinit le travail forcé ou obligatoire comme étant tout travail ou service exigé d'unindividu sous la menace d'une peine quelc<strong>on</strong>que et pour lequel ledit individu nes'est pas offert de plein gré (art. 2).Le Code pénal qualifie la pratique de l'esclavage de crime c<strong>on</strong>tre l'humanité et punitde mort ceux qui déportent, réduisent en esclavage ... (art 314).2.6. Le droit d'être jugé par une juridicti<strong>on</strong> impartialeCe droit est prévu par l'article 7 de la Charte.Lorsqu'un justiciable doute de l'impartialité d'une juridicti<strong>on</strong>, il peut en attaquer ladécisi<strong>on</strong> en faisant usage des voies de recours qui lui s<strong>on</strong>t ouvertes.Des dispositi<strong>on</strong>s en vue de sa mise en oeuvre s<strong>on</strong>t c<strong>on</strong>tenues dans l'Ord<strong>on</strong>nancen°-91-0051/PRES du 26 Août 1991 portant compositi<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> etf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la Cour Suprême. Il s'agit de la procédure de la prise à partie etde la récusati<strong>on</strong>.L'article 283 de la dite ord<strong>on</strong>nance cite les cas où la procédure de la prise à partiepeut être engagée :• S'il y a dol, fraude, c<strong>on</strong>cussi<strong>on</strong> ou faute lourde professi<strong>on</strong>nelle qu'<strong>on</strong>prétendrait avoir été commis par le juge, soit dans le cours de l'instructi<strong>on</strong>,soit lors des jugements.• S'il y a déni de justice• Etc.La récusati<strong>on</strong> fait l'objet des articles 291 à 296 de l'Ord<strong>on</strong>nance portantcompositi<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la Cour Suprême.
532.7. Le droit à un procès équitable, le droit de la défense et la présompti<strong>on</strong>d'innocence.Ce principe avait toujours été réaffirmé avant le 4 Août 1983.Le gouvernement révoluti<strong>on</strong>naire avait créé de nouvelles juridicti<strong>on</strong>s : les TribunauxPopulaires de la Révoluti<strong>on</strong>, les Tribunaux Populaires Départementaux et lesTribunaux Populaires d'Appel.La pers<strong>on</strong>ne qui était traduite devant ces juridicti<strong>on</strong>s n'était pas autorisée à se faireassister d'un avocat.La suppressi<strong>on</strong> de ces juridicti<strong>on</strong>s Populaires et le rétablissement des juridicti<strong>on</strong>sdites classiques a permis la restaurati<strong>on</strong> du droit de la défense.Une autre atteinte grave avait été portée au droit de la défense. La Zatu AN IV-20/CNR/MIJ du 31 Décembre 1986 avait créé les cabinets populaires d'Assistancejudiciaire. Les magistrats qui y étaient nommés, appelés « S<strong>on</strong>gda », étaientchargés de les animer. Il s'agissait en réalité de vrais cabinets d'avocats et lesS<strong>on</strong>gda avaient les mêmes attributi<strong>on</strong>s que les avocats.Le caractère libéral de la professi<strong>on</strong> d'avocat était menacé. En effet le traitementdes S<strong>on</strong>gda était servi par le Trésor public. Ils ne pouvaient pas prétendre de ce faitêtre indépendants.L'intenti<strong>on</strong> des auteurs de ce texte était manifestement claire : Laf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>narisati<strong>on</strong> de la professi<strong>on</strong> d'avocat.Avec l'avènement de l'Etat de droit les S<strong>on</strong>gda <strong>on</strong>t été supprimés. Le 4 Décembre1997, la loi n°024/97/11/AN du 4 Novembre 1997, portant réglementati<strong>on</strong> de laprofessi<strong>on</strong> d'avocat a été promulguéeLa présompti<strong>on</strong> d'innocence est prévue à l'article 7 de la Charte.Ce principe n'a pas toujours été respecté au Burkina Faso. Ainsi, des pers<strong>on</strong>nes quicomparaissaient devant les Tribunaux Populaires de la Révoluti<strong>on</strong> en tantqu'inculpés devaient verser la somme de 30.000 Francs pour couvrir les frais deJustice avant d'avoir été entendues sur les faits qui leur étaient reprochés. Ellesétaient d<strong>on</strong>c c<strong>on</strong>damnées à payer des dépens avant même que la juridicti<strong>on</strong> n'ait
54établi leur culpabilité.L'article 3 du Code Pénal prévoit que nul ne peut être déclaré pénalementresp<strong>on</strong>sable et encourir de ce fait une sancti<strong>on</strong> s'il ne s'est pas rendu coupabled'une infracti<strong>on</strong>.C'est dans le souci de respecter la présompti<strong>on</strong> d'innocence que l'article 136 ducode de procédure pénale stipule que la détenti<strong>on</strong> préventive est une mesureexcepti<strong>on</strong>nelle.Lorsque, pour des circ<strong>on</strong>stances particulières, l'obligati<strong>on</strong> est faite au juge dedétenir une pers<strong>on</strong>ne alors que la juridicti<strong>on</strong> de jugement ne s'est pas pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cée sursa culpabilité, cette mesure de détenti<strong>on</strong> doit obéir à certaines règles : limitati<strong>on</strong> dela détenti<strong>on</strong> dans le temps, séparati<strong>on</strong> des détenus préventifs des détenusc<strong>on</strong>damnés.2.8. Le traitement humain des pers<strong>on</strong>nes arrêtées ou détenues.La situati<strong>on</strong> carcérale au Burkina Faso est régie par le KITI (Décret) n° An VI-0103/FP/MIJ portant organisati<strong>on</strong>, régime et réglementati<strong>on</strong> des établissementspénitentiaires au Burkina Faso. L'article 10 du Décret stipule que « les détenusdoivent être séparés suivant les catégories ci-après :- les femmes des hommes ;- les mineurs de moins de 18 ans, des majeurs ;- Les prévenus des c<strong>on</strong>damnés, lorsque le même établissement sert demais<strong>on</strong> d'arrêt et de mais<strong>on</strong> de correcti<strong>on</strong> ;- Les détenus qui bénéficient d'un régime spécial lié à des troublesphysiologiques ;- Les c<strong>on</strong>damnés entre eux sel<strong>on</strong> les divisi<strong>on</strong>s auxquelles ilsappartiennent... »Le Décret cité met en exergue l'acti<strong>on</strong> du Gouvernement en faveur d'une politiquegouvernementale basée sur le traitement humain des pers<strong>on</strong>nes détenues, ainsi queleur inserti<strong>on</strong> ou réinserti<strong>on</strong>.
55La mise en oeuvre des nombreuses c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s prévues au bénéfice des pers<strong>on</strong>nesdétenues n'est pas toujours aisée, du fait des coûts très élevés des réalisati<strong>on</strong>scarcérales. Néanmoins le Gouvernement fait de réels efforts en faveur desc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s des pers<strong>on</strong>nes détenues.2.8.1. Etat des lieux.Le Burkina Faso compte <strong>on</strong>ze (11) établissements pénitentiaires ;Il existe dix mais<strong>on</strong>s d'arrêt qui corresp<strong>on</strong>dent aux dix tribunaux de gr<strong>and</strong>e instancequi couvrent le pays.Le tableau annexé détermine la date de c<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> des dites mais<strong>on</strong>s d'arrêt, leurcapacité et la moyenne d'occupati<strong>on</strong>.On observe que la surpopulati<strong>on</strong> carcérale est manifestement pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cée dans lesdeux plus gr<strong>and</strong>es villes du Burkina Faso : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.La mais<strong>on</strong> d'arrêt et de correcti<strong>on</strong> de Bobo-Dioulasso accueille en moyenne 400détenus pour une capacité de 120 détenus.En outre, seule la mais<strong>on</strong> d'arrêt et de correcti<strong>on</strong> de Ouagadougou possède unquartier pour femmes, un quartier pour mineurs et un quartier pour gr<strong>and</strong>sdélinquants.Il faut noter que le quartier pour mineurs, en moyenne, ne fait pas le plein. On peuts'en féliciter.La vétusté des mais<strong>on</strong>s d'arrêt des deux plus gr<strong>and</strong>es villes du Burkina c<strong>on</strong>tribue àfavoriser les évasi<strong>on</strong>s et aussi rendent plus pénibles les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de détenti<strong>on</strong>.2.8.2. La populati<strong>on</strong> carcérale.De 1994 à 1997 le nombre d'entrées dans les mais<strong>on</strong>s d'arrêt est stagnant voirrégressif dans certains cas.L'étude du mouvement des entrées par catégories (hommes, femmes, mineurs)permet de tirer les c<strong>on</strong>clusi<strong>on</strong>s suivantes.Le pourcentage de femmes détenues est faible par rapport au nombre total depers<strong>on</strong>nes placées dans les mais<strong>on</strong>s d'arrêt.
56Le mouvement total des entrées dans les pris<strong>on</strong>s du Burkina Faso se présente commesuit :1993: total des détenus : 5797Femmes : 125 soit 2,15 croMineurs : 439 soit 7,57%1994: total des détenus : 5739Femmes : 58 soit 1%Mineurs : 430 soit 7,49 %1995 : total des détenus : 5260Femmes : 55 soit 1%Mineurs : 451 soit 8,57%1996: total des détenus : 4984Femmes : 31 soit 0,62 %Mineurs : 389 soit 7,801997 : total des détenus : 5232Femmes : 80 soit 1,52 %Mineurs : 569 soit 10,87%.Il apparaît que le nombre et le pourcentage des femmes qui entrent en pris<strong>on</strong> s<strong>on</strong>tinsignifiants.La situati<strong>on</strong> est par c<strong>on</strong>tre préoccupante en ce qui c<strong>on</strong>cerne les mineurs. Le taux desmineurs qui entrent dans les pris<strong>on</strong>s à progressé de manière sensible en 1997,comparativement aux années antérieures.
572.8.3. Mesures prises ou à prendre pour l'améliorati<strong>on</strong> de la situati<strong>on</strong> carcérale.Le Centre Pénitentiaire Agricole de Baporo.Il s'agit d'un centre de réinserti<strong>on</strong> sociale et d'éducati<strong>on</strong> en milieu ouvert.Des pers<strong>on</strong>nes qui <strong>on</strong>t été déjà c<strong>on</strong>damnées bénéficient de la semi liberté eteffectuent des travaux agricoles et du maraîchage .Leur producti<strong>on</strong> sert à les nourrir. Le surplus est destiné aux autres établissementspénitentiaires du pays.Cet établissement qui a commencé à f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>ner en 1990 a une capacitéd'hébergement de 60 pers<strong>on</strong>nes. Il a été créé pour remédier à la surpopulati<strong>on</strong>carcérale et aussi pour c<strong>on</strong>tribuer à la réinserti<strong>on</strong> sociale des détenus.L'expérience de ce centre pénitentiaire agricole ayant été c<strong>on</strong>cluante, le Ministère dela Justice a entrepris de rechercher les moyens qui lui permettr<strong>on</strong>t d'en créerd'autres. Ainsi, un site a été retenu à Kamadéni dans la Province du Mouhoun pourabriter un établissement du même genre que celui de Baporo. Une quinzaine dedétenus y travaille déjà.Le Travail d'intérêt GénéralLe Ministère de la Justice est en train de travailler à l'introducti<strong>on</strong> du travail d'intérêtgénéral au Burkina Faso. Il est proposée que le travail d'intérêt général puisse êtrec<strong>on</strong>sidéré comme étant une peine alternative à la peine d'empris<strong>on</strong>nement. Lesjuridicti<strong>on</strong>s burkinabé pourr<strong>on</strong>t pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer des peines à des travaux d'intérêt généralen lieu et place des peines d'empris<strong>on</strong>nement.Si ce projet était adopté, il c<strong>on</strong>tribuerait à diminuer la surpopulati<strong>on</strong> des pris<strong>on</strong>s.
58La C<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> de Quartiers spéciaux :L'objectif du gouvernement est de doter toutes les mais<strong>on</strong>s d'arrêt de quartiers pourmineurs et pour femmes.Mais le manque de moyens ne permet pas de réaliser immédiatement et en mêmetemps cet objectif.Les mais<strong>on</strong>s d'arrêt de Bobo-Dioulasso et de Ouahigouya ser<strong>on</strong>t dotées trèsprochainement de quartiers pour enfants.Les mêmes travaux ser<strong>on</strong>t réalisés dans les autres pris<strong>on</strong>s du pays progressivementet dans les limites des moyens mis à la dispositi<strong>on</strong> du Ministère de la Justice par lebudget nati<strong>on</strong>al ou les partenaires au développement.Le tableau ci-dessous indique les capacités théoriques et pratiques des établissementspénitentiaires.Etablissements Pénitentiaires Date Capacité MoyenneOuagadougou (quartier central) 1962 400 700Ouagadougou (autres quartiers)quartier des femmesquartier des mineursquartier des gr<strong>and</strong>sdélinquants1994108080183545Bobo-Dioulasso 1947 150 400Koudougou 1994 120 190Ouahigouya 1994 120 200Gaoua 1968 80 150Dori 1994 120 80Dédougou 1956 80 160Kaya 1994 120 130Fada N'Gourma 1995 120 90Tenkodogo 1995 120 175Centre Pénitentiaire Agricole de Baporo 1990 60 30
59Le tableau ci-dessous d<strong>on</strong>ne les statistiques des entréesMAC 1994 1995 1996 1997Ouagadougou 1742 1608 1373 1561Bobo-Dioulasso 1093 1082 1026 910Koudougou 496 431 454 422Ouahigouya 393 400 428 468Fada N'Gourma 409 350 373 319Kaya 287 234 226 283Dédougou 332 319 405 360Dori 243 183 117 210Tenkodogo 397 423 379 4862.9. Liberté de c<strong>on</strong>science, d'expressi<strong>on</strong>, de réuni<strong>on</strong> et d'associati<strong>on</strong> (art .8. 10.11)L'article 7 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> burkinabé stipule que « la liberté de croyance, de n<strong>on</strong>croyance, de c<strong>on</strong>science, d'opini<strong>on</strong> religieuse, philosophique, d'exercice de culte, laliberté de réuni<strong>on</strong>, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège etde manifestati<strong>on</strong> s<strong>on</strong>t garanties par la présente C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> sous réserve durespect de la loi, de l'ordre publique, des b<strong>on</strong>nes moeurs et de la pers<strong>on</strong>nehumaine ».En s<strong>on</strong> article 13, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose que les partis politiques se créentlibrement, excepti<strong>on</strong> faite des partis ou formati<strong>on</strong>s tribalistes, régi<strong>on</strong>alistes,c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nels ou racistes. Ils mènent librement leurs activités et s<strong>on</strong>t égaux endroits et en devoirs.Sur la base de ces dispositi<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelles, le législateur burkinabé a, par laloi n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'associati<strong>on</strong>, c<strong>on</strong>sacré leprincipe de la liberté de formati<strong>on</strong> des associati<strong>on</strong>s. L'article 2 de cette loi rec<strong>on</strong>naîten effet que les associati<strong>on</strong>s se forment librement et sans autorisati<strong>on</strong>administrative préalable. Cette même liberté de formati<strong>on</strong> est rec<strong>on</strong>nue auxsyndicats (art 28) défini comme toute organisati<strong>on</strong> ou groupe d'organisati<strong>on</strong>s de
60travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre lesintérêts moraux, matériels et professi<strong>on</strong>nels de leurs membres (art. 25).C<strong>on</strong>cernant les réuni<strong>on</strong>s et les manifestati<strong>on</strong>s sur la voie publique, la loin°22/97/II/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réuni<strong>on</strong> et de manifestati<strong>on</strong>ssur la voie publique dispose qu'elles « s<strong>on</strong>t libres au Burkina Faso » (art. 1).Toutefois, pour des rais<strong>on</strong>s de protecti<strong>on</strong> des pers<strong>on</strong>nes et des biens, elles s<strong>on</strong>tsoumises à des déclarati<strong>on</strong>s préalables. Les réuni<strong>on</strong>s privées (celles qui <strong>on</strong>t lieudans un endroit privé clos ou n<strong>on</strong> et qui s<strong>on</strong>t réservées à certaines pers<strong>on</strong>nes),quant à elles ne s<strong>on</strong>t soumises à aucune restricti<strong>on</strong>, sous réserve de l'observati<strong>on</strong>des lois et règlements c<strong>on</strong>cernant la tranquillité et la moralité publiques (art. 6).Enfin, le Code pénal punit d'une amende de 50.000 à 100.000F ceux quic<strong>on</strong>treviennent aux dispositi<strong>on</strong>s sur les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de formati<strong>on</strong> et de déclarati<strong>on</strong>des associati<strong>on</strong>s. (art. 220), dans le cadre de la garantie de la sécurité publique.2.10. Le droit de recevoir et de diffuser des informati<strong>on</strong>s (art.9)La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> en s<strong>on</strong> article 8 garantit la liberté d'opini<strong>on</strong>, de presse et le droit àl'informati<strong>on</strong>.Par la suite, la loi n°56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code del'Informati<strong>on</strong> a été adoptée d<strong>on</strong>t l'applicati<strong>on</strong> de certaines dispositi<strong>on</strong>s a nécessitél'interventi<strong>on</strong> de mesures administratives.Cette loi, promulguée par le Décret n°94-42/PRES du 28 janvier 1994 c<strong>on</strong>sacre ledroit à l'informati<strong>on</strong>, parmi les droits f<strong>on</strong>damentaux du citoyen burkinabé etgarantit la liberté de l'entreprise au Burkinabé. L'article 1°' de la loi précise« La créati<strong>on</strong> et l'exploitati<strong>on</strong> des agences d'informati<strong>on</strong>, des organismes deradiodiffusi<strong>on</strong>, de télévisi<strong>on</strong> et de cinéma s<strong>on</strong>t libres c<strong>on</strong>formément aux lois etrèglements en vigueur ».Cette liberté affirmée c<strong>on</strong>stitue une avancée par rapport à la situati<strong>on</strong> antérieure. Eneffet, les codes précédents subord<strong>on</strong>naient l'exercice de cette liberté à certainesc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>nalités. Par exemple, en matière de presse écrite, l'obtenti<strong>on</strong> d'uneautorisati<strong>on</strong> de publicati<strong>on</strong>. Ce qui signifie qu'elle pouvait être accordée ou refusée.
61Cet acquis majeur est ainsi c<strong>on</strong>sacré par l'article 6 : « L'éditi<strong>on</strong>, l'imprimerie, lapublicati<strong>on</strong>, la librairie et la messagerie s<strong>on</strong>t libres ». Et pour appuyer et éviter touteéquivoque les article 7 et 13 explicitent :Article 7 : « Tout journal périodique peut être publié sans autorisati<strong>on</strong> préalable etsans dépôt de cauti<strong>on</strong>nement après la déclarati<strong>on</strong> prescrite par la loi ».Article 13 : « Avant leurs publicati<strong>on</strong>s, les journaux ou écrits périodiquesd'informati<strong>on</strong> générale, les publicati<strong>on</strong>s périodiques doivent être déclarés au Parquetdu Procureur du Faso qui est tenu de délivrer un récépissé de déclarati<strong>on</strong> dans lesquinze (15) jours suivant le dépôt du dossier ».En matière de radiodiffusi<strong>on</strong> et de télévisi<strong>on</strong>, c'est la fin du m<strong>on</strong>opole de l'Etat(article 25). Désormais les activités y relatives f<strong>on</strong>t l'objet de réglementati<strong>on</strong>, et lesarticles 28 et 29 réaffirment ce principe.Dans l'exercice de sa professi<strong>on</strong>, le journaliste voit renforcé s<strong>on</strong> droit à l'accès auxsources d'informati<strong>on</strong> (article 49). La loi va jusqu'à faire inj<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> à toutesinstituti<strong>on</strong>s ou sources potentielles de fournir l'informati<strong>on</strong> au journaliste.Les limitati<strong>on</strong>s inscrites à l'article 51 s<strong>on</strong>t celles généralement admises. Elles s<strong>on</strong>trelatives au secret militaire, au secret judiciaire, à la sécurité de l'Etat, et à la vieprivée du citoyen.Cette loi a également le mérite de renforcer la garantie du secret professi<strong>on</strong>nel quine peut plus être délié que sur la seule autorisati<strong>on</strong> écrite de l'autorité judiciaire(article 54).En s<strong>on</strong> article 143, la loi portant Code de l'informati<strong>on</strong> dispose qu'il sera créé uneinstituti<strong>on</strong> nati<strong>on</strong>ale indépendante de l'informati<strong>on</strong> pour c<strong>on</strong>tribuer à l'applicati<strong>on</strong> dela présente loi. Cette dispositi<strong>on</strong> est f<strong>on</strong>damentale car elle préfigure moinsd'emprise directe de l'Etat sur la vie et dans la régulati<strong>on</strong> du c<strong>on</strong>tenu des médias auBurkina Faso.Et de fait, en applicati<strong>on</strong> de cette dispositi<strong>on</strong> le Décret n°95-304/PRES/PM/MCC du1 er Août 1995 portant créati<strong>on</strong> du C<strong>on</strong>seil Supérieur de l'Informati<strong>on</strong> a été pris. LeC<strong>on</strong>seil Supérieur de l'Informati<strong>on</strong> en vigueur depuis mars 1996, atteste de la pleinemesure de s<strong>on</strong> utilité. Il a eu le mérite, aux dernières électi<strong>on</strong>s législatives, de gérer
62de faç<strong>on</strong> c<strong>on</strong>séquente le flux de communicati<strong>on</strong> électorale. Une maîtrise saluée parles observateurs indépendants du scrutin.L'<strong>on</strong> peut retenir que l'applicati<strong>on</strong> des dispositi<strong>on</strong>s juridiques a permis des progrèsen matière de liberté d'opini<strong>on</strong>, de presse et du droit à l'informati<strong>on</strong>.En cas de difficultés dans l'exercice de ces libertés d'opini<strong>on</strong>, de presse et les droitsà l'informati<strong>on</strong>, les pers<strong>on</strong>nes ou groupes de pers<strong>on</strong>nes d<strong>on</strong>t les droits <strong>on</strong>t étéviolés <strong>on</strong>t recours aux autorités judiciaires (Tribunaux, Cour d'Appel, Cour decassati<strong>on</strong>).De manière générale, le Code pénal burkinabé qualifie de crime, les infracti<strong>on</strong>s àl'exercice des droits civiques. Ces crimes s<strong>on</strong>t punis sel<strong>on</strong> leur gravité d'unempris<strong>on</strong>nement allant de 2 mois à 10 ans, d'une amende de 50.000 à 300 000FCFA et, la juridicti<strong>on</strong> saisie peut en outre pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer l'interdicti<strong>on</strong> d'exercer desdroits civiques pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. (art. 133 à 139).2.11. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidenceL'article 12 de la Charte én<strong>on</strong>ce que toute pers<strong>on</strong>ne a le droit de circuler librementet de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.L'article 165 du code pénal punit d'un empris<strong>on</strong>nement de deux mois à un an etd'une peine d'amende... tout f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naire de l'ordre administratif ou judiciaire, toutofficier ministériel ou de justice ou de police, tout comm<strong>and</strong>ant ou agent de la forcepublique qui s'introduit dans le domicile d'une pers<strong>on</strong>ne c<strong>on</strong>tre le gré de celle-ci ethors les cas prévus par la loi et sans les formalités prescrites.L'article 360 du code pénal traite de la violati<strong>on</strong> de domicile commise par unparticulier.L'article 42 du code pénal apporte une excepti<strong>on</strong> à cette liberté f<strong>on</strong>damentale. Ilc<strong>on</strong>cerne l'interdicti<strong>on</strong> de séjour qui c<strong>on</strong>siste dans la défense faite à un c<strong>on</strong>damnéde paraître dans certains endroits.Il n'existe pas de cas, c<strong>on</strong>trairement à la dégradati<strong>on</strong> civique, où la loi oblige le jugeà pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer l'interdicti<strong>on</strong> de séjour sauf pour une pers<strong>on</strong>ne c<strong>on</strong>damnée à une peined'empris<strong>on</strong>nement à vie qui obtient une commutati<strong>on</strong> ou une remise de sa peine.
63Les articles 55 à 58 du code de procédure pénale c<strong>on</strong>stituent également unerestricti<strong>on</strong> au principe de l'inviolabilité du domicile. Ils s<strong>on</strong>t relatifs à la perquisiti<strong>on</strong>.Afin d'éviter que les autorités habilitées à opérer les perquisiti<strong>on</strong>s ne fassent desabus sur la base de cette procédure, les articles 55 à 58 du code de procédure lasoumettent à des règles strictes :. La perquisiti<strong>on</strong> doit être effectuée entre 6 heures et 21 heures.. Elle doit se faire en présence de la pers<strong>on</strong>ne au domicile de laquelle elle est opéréeou de s<strong>on</strong> représentant ou de deux témoins.. Le secret professi<strong>on</strong>nel, doit être respecté ainsi que les règles liées au droit de ladéfense.2.12. Le droit de participer librement au vote.L'article 13 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples réaffirmele principe que chaque citoyen a le droit de choisir librement ses représentants.L'article 12 de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose que tous les burkinabé sans distincti<strong>on</strong>aucune <strong>on</strong>t le droit de participer à la gesti<strong>on</strong> des affaires de l'Etat et de la société.A ce titre ils s<strong>on</strong>t électeurs et éligibles...Dans le cadre de l'applicati<strong>on</strong> de ce principe, les articles 134 et 135 du code pénalproscrivent la fraude électorale et la corrupti<strong>on</strong> des électeurs.Afin de permettre le b<strong>on</strong> déroulement des électi<strong>on</strong>s, l'Assemblée Nati<strong>on</strong>ale a adoptéla loi n°021/98/AN du 7 Mai 1998 portant Code Electoral.L'article 26 du code pénal a introduit une restricti<strong>on</strong> à ce principe. Il s'agit de ladégradati<strong>on</strong> des droits civiques et politiques.Il c<strong>on</strong>vient de souligner que la dégradati<strong>on</strong> civique, qui c<strong>on</strong>siste dans la privati<strong>on</strong> dudroit de vote, d'électi<strong>on</strong>, d'éligibilité et en général des droits civiques et politiquesn'est obligatoirement applicable qu'en cas de c<strong>on</strong>damnati<strong>on</strong> à une peine criminelle.La lecture de l'article 37 du code pénal permet de c<strong>on</strong>stater qu'en matièrecorrecti<strong>on</strong>nelle, il appartient aux juges d'apprécier souverainement s'ils doiventpr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer la dégradati<strong>on</strong> civique ou n<strong>on</strong>.
642.13. Le droit d'accéder aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s publiquesLe principe sel<strong>on</strong> lequel tous les citoyens <strong>on</strong>t également le droit d'accéder auxf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s publiques de leurs pays est l'objet de l'article 13 al 2 de la Charte.Le législateur burkinabé a tenu compte de ce droit lorsqu'il a adopté le statutgénéral de la f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> publique.Le mode d'accès ordinaire à la f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> publique est le c<strong>on</strong>cours sur épreuves àchaque spécialité professi<strong>on</strong>nelle. Ces c<strong>on</strong>cours d<strong>on</strong>nent lieu à l'établissement deslistes classant par ordre de mérite les c<strong>and</strong>idats déclarés aptes par le jury. Lesnominati<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t faites sel<strong>on</strong> cet ordre.2.14. L'interdicti<strong>on</strong> de la pris<strong>on</strong> pour une violati<strong>on</strong> d'une simple obligati<strong>on</strong>c<strong>on</strong>tractuelleIl ressort de la loi portant organisati<strong>on</strong> judiciaire en vigueur au Burkina Faso qu'unejuridicti<strong>on</strong> qui siège en matière civile n'est pas compétente pour pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cer unepeine d'empris<strong>on</strong>nement.2.15. La protecti<strong>on</strong> de l'intégrité physiqueLes articles 318 à 355 du Code Pénal traitent des homicides ou des atteintes àl'intégrité physique.L'article 329 punit les pers<strong>on</strong>nes qui se s<strong>on</strong>t rendues coupables de coups etblessures ayant entraîné des mutilati<strong>on</strong>s, amputati<strong>on</strong>s ou privati<strong>on</strong>s de l'usage d'unmembre, cécité, perte d'un oeil ou infirmités permanentes.2.16. La protecti<strong>on</strong> de la vie privéeLes article 361 et suivants du Code pénal traitent des atteintes portées à l'h<strong>on</strong>neuret à la c<strong>on</strong>sidérati<strong>on</strong> des pers<strong>on</strong>nes, en sancti<strong>on</strong>nant entre autres les casd'allégati<strong>on</strong> ou imputati<strong>on</strong> qui porte atteinte à l'h<strong>on</strong>neur d'autrui, la diffamati<strong>on</strong>, lesexpressi<strong>on</strong>s outrageantes, la calomnie etc.Les articles 371 à 373 traitent des atteintes à l'intimité de la vie privée despers<strong>on</strong>nes.
65Il est interdit d'écouter, d'enregistrer et de publier des paroles d'une pers<strong>on</strong>ne sanss<strong>on</strong> autorisati<strong>on</strong>, de prendre des images etc.2.17. Eliminati<strong>on</strong> de toutes les formes de discriminati<strong>on</strong> sociale.2.17.1. Mesures d'ordre législatif2.17.1.1. La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>Dans s<strong>on</strong> préambule, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du Burkina Faso trace un véritable programmeaux gouvernants en ce qui c<strong>on</strong>cerne la lutte c<strong>on</strong>tre les discriminati<strong>on</strong>s de toutessortes. Il engage le peuple burkinabé à édifier un Etat de droit garantissantl'exercice des droits collectifs et individuels, la sûreté, le bien-être, ledéveloppement, l'égalité et la justice, comme valeurs f<strong>on</strong>damentales d'une sociétépluraliste, de progrès, et débarrassée de tout préjugé.La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, dans ses dispositi<strong>on</strong>s, rec<strong>on</strong>naît et protège les droits civils,politiques et éc<strong>on</strong>omiques :• Article 1er : alinéa 3 : « les discriminati<strong>on</strong>s de toutes sortes, notamment cellesf<strong>on</strong>dées sur la race, l'ethnie, la régi<strong>on</strong>, la couleur, la langue, la religi<strong>on</strong>, lacaste, les opini<strong>on</strong>s politiques, la fortune et la naissance s<strong>on</strong>t prohibées ».• Article 2 : « s<strong>on</strong>t interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques,esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, latorture physique ou morale, les services et les mauvais traitements infligés auxenfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme ».• Article 7 : « la liberté de croyance, de n<strong>on</strong> croyance, de c<strong>on</strong>science, d'opini<strong>on</strong>religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réuni<strong>on</strong>, la pratiquedes coutumes ainsi que la liberté de cortège et de manifestati<strong>on</strong> s<strong>on</strong>t garantiespar la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, desb<strong>on</strong>nes moeurs et de la pers<strong>on</strong>ne humaine ».
66• Article 13 : « les partis et formati<strong>on</strong>s politiques se créent librement... Ilsmènent librement leurs activités dans le respect de la loi. Tous les partispolitiques s<strong>on</strong>t égaux en droits et devoirs. Toutefois, ne s<strong>on</strong>t pas autorisés, lespartis ou formati<strong>on</strong>s politiques tribalistes, régi<strong>on</strong>alistes, c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nels ouracistes ».• Article 15 : « le droit de propriété est garanti... Il ne peut y être porté atteinteque dans les cas de nécessité publique c<strong>on</strong>statée dans les formes légales ».• Article 18 : « l'éducati<strong>on</strong>, l'instructi<strong>on</strong>, la formati<strong>on</strong>, le travail, la sécurité, lasécurité sociale, le logement, les loisirs, la santé, la protecti<strong>on</strong> de la maternitéet de l'enfance, l'assistance aux pers<strong>on</strong>nes âgées ou h<strong>and</strong>icapées et aux cassociaux, la créati<strong>on</strong> artistique et scientifique, c<strong>on</strong>stituent des droits sociaux etculturels rec<strong>on</strong>nus par la présente C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> qui vise à les promouvoir ».• Article 19 - 2 : < > .A la suite de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, la loi 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Codedu Travail, en s<strong>on</strong> article premier, interdit toute discriminati<strong>on</strong> en matière d'emploiet de professi<strong>on</strong>.2.17.1.2. Le Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la FamilleCe texte a supprimé de nombreuses c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s qui étaient exigées par la loin°50/61 AN du 1er décembre 1961, portant adopti<strong>on</strong> du code de la nati<strong>on</strong>alitévoltaïque.Ainsi, pour acquérir la nati<strong>on</strong>alité burkinabé, il n'est plus nécessaire de ren<strong>on</strong>cer àsa nati<strong>on</strong>alité d'origine. Le Code des pers<strong>on</strong>nes et de la famille a c<strong>on</strong>sacré le
67système de la double nati<strong>on</strong>alité.L'article 155 du Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille dispose que tout individu néau Burkina Faso de parents étrangers, acquiert la nati<strong>on</strong>alité burkinabé à samajorité, s'il a sa résidence habituelle au Burkina Faso à cette date et depuis aumoins cinq ans. Il acquiert automatiquement la nati<strong>on</strong>alité burkinabé à sa majorité,s'il n'y a pas ren<strong>on</strong>cé dans les six mois précédant ladite majorité (art. 156 du Codedes Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille). Il pourra acquérir la nati<strong>on</strong>alité burkinabé de lafaç<strong>on</strong> suivante :■Par déclarati<strong>on</strong> acquisitive de la nati<strong>on</strong>alité s'il a entre 18 et 21 ans(art.160).■Par déclarati<strong>on</strong> acquisitive de la nati<strong>on</strong>alité avec autorisati<strong>on</strong> des parentss'il est âgé de 16 ans au moins, de 18 ans au plus (art.160).■La déclarati<strong>on</strong> est faite par les parents pour le compte du mineur demoins de 16 ans (art. 160).La nati<strong>on</strong>alité est accordée aux étrangers justifiant d'une résidence de 10 ans auBurkina Faso. Ce délai est réduit de 2 ans pour l'étranger né au Burkina Faso, etpour les étrangers qui <strong>on</strong>t rendu ou peuvent rendre des services importants auBurkina Faso, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires,l'introducti<strong>on</strong> d'industries ou d'inventi<strong>on</strong>s utiles, la créati<strong>on</strong> d'établissementsindustriels ou d'exploitati<strong>on</strong>s agricoles.En matière de mariage, il est interdit toute discriminati<strong>on</strong> f<strong>on</strong>dée sur la race, lacouleur, la religi<strong>on</strong>, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune ; une égalité stricteest établie entre les époux.Les oppositi<strong>on</strong>s à mariage en rais<strong>on</strong> de la race, de la caste, de la couleur ou de lareligi<strong>on</strong> s<strong>on</strong>t interdites. Le Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille en vigueuractuellement au Burkina Faso, entend moderniser et unifier le système matrim<strong>on</strong>ialen éliminant toutes les formes de mariage discriminatoire, notamment le mariageforcé, les « d<strong>on</strong>ati<strong>on</strong>s » de filles en mariage en bas âge, le lévirat.
682.17.2. Mesures d'ordre judiciaireLe système judiciaire dans s<strong>on</strong> organisati<strong>on</strong> et s<strong>on</strong> f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement actuel, tel queprévu par la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de 1991 et les textes organiques, se veut démocratiqueavec l'ambiti<strong>on</strong> d'assurer à toutes les pers<strong>on</strong>nes habitant le Burkina Faso, lagarantie des libertés collectives et individuelles des droits civils, politiques,éc<strong>on</strong>omiques, sociaux, culturels, etc. Aux termes des articles 3, 4 et 5 de laC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>, il est ainsi stipulé :• Article 3 : < < Nul ne peut être privé de la liberté s'il n'est poursuivi pour desfaits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être gardé, déporté ou exilé qu'envertu de la loi > > .• Article 4 :< >• Article 5 : « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché etnul ne peut être c<strong>on</strong>traint à faire ce qu'elle n'ord<strong>on</strong>ne pas. La loi pénale n'apas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loipromulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La peine estpers<strong>on</strong>nelle et individuelle ».2.18. Autres mesures prises en faveur des droits de l'Homme.De multiples mesures <strong>on</strong>t été prises par le Gouvernement dans le cadre durecouvrement de droits de certains citoyens. Ces mesures s<strong>on</strong>t intervenues surtoutdans le cadre des réhabilitati<strong>on</strong>s de citoyens dans leurs droits, et de l'exercice decertaines professi<strong>on</strong>s. Ces mesures s<strong>on</strong>t les suivantes :■L'ord<strong>on</strong>nance n°91-0080 portant réhabilitati<strong>on</strong> administrative.Cette ord<strong>on</strong>nance c<strong>on</strong>stitue un énorme progrès dans l'applicati<strong>on</strong> des Droits de
69l'Homme au Burkina Faso. Il faut se rappeler qu'à une certaine période, denombreux agent publics ou des salariés du privé <strong>on</strong>t été victimes de sancti<strong>on</strong>s :suspensi<strong>on</strong>s, licenciements, dégagements, mises à la retraite etc.. Ces mesuresavaient souvent été prises sans que la procédure prévue en la matière ait étérespectée : saisine du c<strong>on</strong>seil de discipline ou de l'Inspecti<strong>on</strong> du Travail . Cessancti<strong>on</strong>s avaient parfois été prises pour des motifs d'ordre syndical ou politique.L'ord<strong>on</strong>nance N°-91-0080/PRES du 30 Décembre 1991 est venue réparer cettegrave violati<strong>on</strong> des Droits de l'Homme. Ses implicati<strong>on</strong>s <strong>on</strong>t été c<strong>on</strong>sidérablementpositifs. De nombreuses pers<strong>on</strong>nes <strong>on</strong>t retrouvé leur emploi ou <strong>on</strong>t bénéficié d'unepensi<strong>on</strong>.L'indemnisati<strong>on</strong> financière des réhabilités se poursuit avec la mise en dispositi<strong>on</strong> en1998, d'une enveloppe d'un milliard de francs et en 1999, d'une enveloppe de 1,6milliard, portant ainsi l'effort global à 6.030.000.000 de francs depuis le début del'opérati<strong>on</strong>.■L'ord<strong>on</strong>nance n°-92-053/PRES du 21 Octobre 1992 portant statut des Huissiersde Justice.Le Kiti AN V-0291/FP/MIJ du 3 juin 1988, portant réglementati<strong>on</strong> de la f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> dem<strong>and</strong>ataire de Justice avait créé les Cabinets de m<strong>and</strong>ataires de Justice. Desdispositi<strong>on</strong>s de l'ord<strong>on</strong>nance N°-85-50/CNR/PRES du 29 Août 1985 avaientsupprimé les Huissiers de Justice. Ils avaient été remplacés par des m<strong>and</strong>ataires deJustice recrutés parmi des militaires de la Gendarmerie ou des f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naires de laPolice. Les difficultés nées de la créati<strong>on</strong> d'un tel organe s<strong>on</strong>t évidentes : lem<strong>and</strong>ataire de Justice peut-il exécuter avec diligence, impartialité et sans crainteune décisi<strong>on</strong> qui c<strong>on</strong>damne s<strong>on</strong> employeur qu'est l'Etat ? Le rétablissement descharges d'huissier de Justice améliore c<strong>on</strong>sidérablement le système d'exécuti<strong>on</strong> desdécisi<strong>on</strong>s judiciaires.■L'ord<strong>on</strong>nance N°-92-52/PRES du 20 Octobre 1992, portant statut des Notaires.L'ord<strong>on</strong>nance N°-85-50/CNR/PRES du 29 Août 1985 avait procédé à lasuppressi<strong>on</strong> des charges de Notaire. Les f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s de notaire avaient été attribuées
70à des Greffiers notaires. L'ord<strong>on</strong>nance N°-92-52 a mis fin à cette situati<strong>on</strong>. Elleréaffirme en s<strong>on</strong> article 3 que le notaire appartient à la catégorie de professi<strong>on</strong>slibérales. Il est indépendant.■L'ord<strong>on</strong>nance N°-91-070/PRES du 25 Novembre 1991, portantdispositi<strong>on</strong>sspéciales relatives aux procédures de révisi<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>damnati<strong>on</strong>s pr<strong>on</strong><strong>on</strong>cées parles Tribunaux Populaires de la Révoluti<strong>on</strong> et des Tribunaux d'excepti<strong>on</strong> .Les Tribunaux Populaires de la Révoluti<strong>on</strong> statuaient en premier et dernier ressort.La seule voie de recours était la révisi<strong>on</strong> prévue par les articles 738à 755 du codede procédure pénale. Cette voie de recours extraordinaire n'était déclarée recevableque dans les cas où l'existence de faits nouveaux était révélée.Compte tenu des lacunes inhérentes à certaines décisi<strong>on</strong>s (n<strong>on</strong> motivati<strong>on</strong> desjugements, défaillance dans la tenue et la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des dossiers, plumitifs maltenus ou égarés, cas de témoins inculpés et c<strong>on</strong>damnés à l'audience etc..) lelégislateur a procédé à l'élargissement des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de recevabilité des requêtesen révisi<strong>on</strong> en adoptant l'ord<strong>on</strong>nance sus menti<strong>on</strong>née. En applicati<strong>on</strong> de ce texte denombreux recours en révisi<strong>on</strong> <strong>on</strong>t été adressés au Ministre de la Justice.Suite à des recours introduits sur la base de cette Ord<strong>on</strong>nance, l'Etat a étéc<strong>on</strong>damné à verser des centaines de milli<strong>on</strong>s de francs à des pers<strong>on</strong>nes qui avaientété c<strong>on</strong>damnées par les Tribunaux Populaires de la Révoluti<strong>on</strong>.L'une des particularités de cette procédure est que, lorsque la Cour Suprême admetla révisi<strong>on</strong>, elle statue au f<strong>on</strong>d sur l'affaire sans devoir la renvoyer, comme cela estprévu par la procédure ordinaire. Le renvoi nécessiterait la créati<strong>on</strong> d'une juridicti<strong>on</strong>d'excepti<strong>on</strong>. Les impératifs de l'Etat de Droit amènent le législateur à éviter unetelle créati<strong>on</strong>.
712.19. Garantie des droits des réfugiés.Les droits des réfugiés s<strong>on</strong>t c<strong>on</strong>signés dans les instruments internati<strong>on</strong>aux que s<strong>on</strong>tla C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> de Genève de 1951 et s<strong>on</strong> Protocole de 1967 relatifs au statut desréfugiés, ainsi que dans la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> de l'OUA de 1969 régissant les aspectspropres aux problèmes des réfugiés en Afrique.S'agissant des premiers instruments, le Burkina Faso a adhéré à la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> deGenève de 1951 et à s<strong>on</strong> Protocole de 1967, le 18 juin 1980. Pour ce qui c<strong>on</strong>cernela C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> de l'OUA de 1969, le Burkina Faso l'a signée le 10 septembre 1969,ratifiée le 19 mars 1974 et déposé les instruments de ratificati<strong>on</strong> au siège de l'OUAle 16 août 1978. Le Burkina Faso, dans le but de respecter ses engagements enmatière de droits des réfugiés a pris un certain nombre de textes garantissant cesdroits sur le territoire nati<strong>on</strong>al. Au nombre de ces textes, <strong>on</strong> peut menti<strong>on</strong>ner entreautres :• la Zatu (Loi) n°An V 28/FP/PRES du 03 août 1988, portant statut des réfugiésau Burkina Faso ;• le Kiti (Décret) An V 360/FP/REX du 03 août 1988, relatif à la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g>Nati<strong>on</strong>ale pour les Réfugiés (CONAREF) ;• le Décret n°94-005/PRES/REX du 10 février 1994, portant applicati<strong>on</strong> du statutdes Réfugiés ;• l'Arrêté n°97-001/MAET/CONAREF/PRES du 07 février 1997 portantattributi<strong>on</strong>s de la Coordinati<strong>on</strong> de la CONAREF.L'objectif de tous ces textes est d'assurer la protecti<strong>on</strong> des réfugiés et garantirleurs droits civils, socio-éc<strong>on</strong>omiques et culturels.Ainsi le rôle de la CONAREF va au delà de l'octroi du statut des réfugiés auxdem<strong>and</strong>eurs d'asile ; cette <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> a également pour attributi<strong>on</strong>s essentiellesentre autres d'exercer la protecti<strong>on</strong> juridique et administrative des réfugiés etd'assurer en liais<strong>on</strong> avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécuti<strong>on</strong>de la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> de Genève de 1951 et celle de l'OUA de 1969.
72La <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Nati<strong>on</strong>ale pour les Réfugiés (CONAREF), de par ses attributi<strong>on</strong>s faitégalement délivrer aux réfugiés par les instituti<strong>on</strong>s compétentes et, après enquêtes'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'accomplir les diversactes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositi<strong>on</strong>s de la législati<strong>on</strong> interneou des accords internati<strong>on</strong>aux qui intéressent leur protecti<strong>on</strong>.Les acti<strong>on</strong>s pour la garantie des droits des réfugiés a valu au Burkina Faso d'êtresollicité par la communauté internati<strong>on</strong>ale pour être le premier pays de réinstallati<strong>on</strong>de réfugiés en Afrique. A cet effet, un document de politique nati<strong>on</strong>ale sur laréinstallati<strong>on</strong> dénommé « Country Chapter » a été élaboré et accepté par le HCR enjuin 1998. Ce programme, une première en Afrique, permettra l'intégrati<strong>on</strong> dans lasociété burkinabé de deux cent (200) réfugiés qui <strong>on</strong>t un besoin particulier deprotecti<strong>on</strong> physique et ce, sur une période initiale de deux ans, soit cent pers<strong>on</strong>nespar an.Dans plusieurs secteurs de la vie sociale et/ou éc<strong>on</strong>omique, les réfugiés rec<strong>on</strong>nusau Burkina Faso jouissent des mêmes droits que les nati<strong>on</strong>aux.Ainsi :Les bénéficiaires du statut des réfugiés reçoivent le même traitement que lesnati<strong>on</strong>aux en ce qui c<strong>on</strong>cerne l'accès à l'éducati<strong>on</strong> et le m<strong>on</strong>tant des fraisd'inscripti<strong>on</strong> et des oeuvres universitaires. Pour l'exercice d'une activitéprofessi<strong>on</strong>nelle, les bénéficiaires du statut des réfugiés s<strong>on</strong>t assimilés auxressortissants du pays qui a c<strong>on</strong>clu avec le Burkina Faso, la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>d'établissement la plus favorable en ce qui c<strong>on</strong>cerne l'activité envisagée ;Les réfugiés, sous réserve de certains emplois publics <strong>on</strong>t accès au marché dutravail dans les mêmes c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s que les nati<strong>on</strong>aux et ne s<strong>on</strong>t pas soumis auxrestricti<strong>on</strong>s habituelles applicables aux étrangers relevant du droit commun.
73PARTIE II : LA PROMOTION DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ETCULTURELS.Si la protecti<strong>on</strong> des droits civils et politiques peut être c<strong>on</strong>sidérée à plusieurs égardscomme imputable à la vol<strong>on</strong>té politique des Gouvernants, la questi<strong>on</strong> de laprotecti<strong>on</strong> et de la promoti<strong>on</strong> des droits éc<strong>on</strong>omiques, sociaux et culturels pour unpays comme le Burkina Faso est tributaire de multiples facteurs n<strong>on</strong> imputablesexclusivement à la vol<strong>on</strong>té de ses gouvernants ou à l'acti<strong>on</strong> de ses populati<strong>on</strong>s.Ces facteurs qui rendent difficile la garantie des droits éc<strong>on</strong>omiques, sociaux etculturels s<strong>on</strong>t les suivants :- Le sous développement du pays lié à de multiples facteurs d<strong>on</strong>t les aléas géoclimatiqueset envir<strong>on</strong>nementaux, les rapports éc<strong>on</strong>omiques d'exploitati<strong>on</strong> et dedominati<strong>on</strong> entretenus par les gr<strong>and</strong>es puissances occidentales, les rapports desoumissi<strong>on</strong> à des modèles inaptes à réaliser dans le c<strong>on</strong>texte du Burkina Faso, lacréati<strong>on</strong> des richesses nécessaires et suffisantes ;- Les difficultés d'adaptati<strong>on</strong> à un c<strong>on</strong>texte m<strong>on</strong>dial de partage des richesses par lebiais du commerce m<strong>on</strong>dial, n'accordant pas les moyens au Burkina Faso d'acquérirla science et la technologie suffisantes à l'évoluti<strong>on</strong> de s<strong>on</strong> tissu éc<strong>on</strong>omique etsocial au service du bien être de ses populati<strong>on</strong>s ;Néanmoins, demeure la questi<strong>on</strong> de la b<strong>on</strong>ne gouvernance qui est la c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>f<strong>on</strong>damentale d'optimalisati<strong>on</strong> des capacités et d'augmentati<strong>on</strong> des effets liés àl'exploitati<strong>on</strong> des ressources existantes, au profit des droits éc<strong>on</strong>omiques, sociauxet culturels.L'effort en matière de b<strong>on</strong>ne gouvernance et de b<strong>on</strong>ne gesti<strong>on</strong> des affairespubliques du Burkina Faso en faveur de ses citoyens ressort dans les réflexi<strong>on</strong>s quisuivr<strong>on</strong>t.
74I. PROTECTION DES DROITS ECONOMIQUES.1. Droit au travailIl sera questi<strong>on</strong> de faire ici le point des acti<strong>on</strong>s menées pour d<strong>on</strong>ner un sens réel audroit au travail, c<strong>on</strong>formément aux engagements internati<strong>on</strong>aux du Burkina Faso etdes dispositi<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelles en la matière. Le Droit au travail est régi auBurkina Faso d'une part, par la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régimejuridique applicable aux emplois et aux agents de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique et d'autrepart la loi n°11/92/ADP portant Code du travail.La questi<strong>on</strong> sera illustrée par l'étude des aspects suivants :• l'accès aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s publiques,• l'accès à l'emploi.1.1. Accès aux F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s PubliquesAu Burkina Faso l'accès aux F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s Publiques est régi par la loi n°013/98/AN du28 avril 1998. Les articles 9 à 13 définissent les différentes c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s d'accès.L'article 9 de la loi citée, stipule que « l'accès aux emplois de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publiqueest ouvert à égalité de droit, sans distincti<strong>on</strong> aucune, à tous lesburkinabé remplissant les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s requises pour chaque emploi postulé, sousréserve des sujéti<strong>on</strong>s propres à certains emplois définis par décret».Les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s requises d<strong>on</strong>t il est s<strong>on</strong>t des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s d'ordre général comme lanati<strong>on</strong>alité (pour les f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naires), l'âge minimum ou la b<strong>on</strong>ne moralité. Toutediscriminati<strong>on</strong> quelle qu'elle soit est d<strong>on</strong>c proscrite.Cette dispositi<strong>on</strong> du Statut Général est, par ailleurs, la même que celle de l'article19 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du 02 juin 1991 qui dispose que « le droit au travail estrec<strong>on</strong>nu et est égal pour tous. Il est interdit de faire des discriminati<strong>on</strong>s en matièred'emploi et de rémunérati<strong>on</strong> en se f<strong>on</strong>dant notamment sur le sexe, la couleur,l'origine sociale, l'ethnie ou l'opini<strong>on</strong> publique ».1.2 EmploiLes citoyens burkinabé <strong>on</strong>t un droit égal d'accès aux emplois publics, ils choisissenteux-mêmes librement l'emploi pour lequel ils veulent postuler.
75L'article 1" stipule que la loi n°11/92/ADP portant Code du travail « est applicableaux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professi<strong>on</strong>nelle au BurkinaFaso. Est c<strong>on</strong>sidéré comme travailleur..., quels que soient s<strong>on</strong> sexe et sanati<strong>on</strong>alité, toute pers<strong>on</strong>ne qui s'est engagée à mettre s<strong>on</strong> activité professi<strong>on</strong>nellemoyennant rémunérati<strong>on</strong>, sous la directi<strong>on</strong> et l'autorité d'une pers<strong>on</strong>ne physique oumorale, publique ou privée, appelée employeur... La présente loi interdit toutediscriminati<strong>on</strong> en matière d'emploi et de professi<strong>on</strong>. Par discriminati<strong>on</strong>, il estentendu toute distincti<strong>on</strong>, exclusi<strong>on</strong> ou préférence f<strong>on</strong>dée sur la race, le sexe, lareligi<strong>on</strong>, l'opini<strong>on</strong> politique ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire oud'altérer l'égalité des chances ou de traitement en matière d'emploi ou deprofessi<strong>on</strong>... »L'emploi est une nécessité et un droit. Dans ce sens, des mesures s<strong>on</strong>t prises pourprévenir toute cessati<strong>on</strong> arbitraire de travail. Ainsi le licenciement, la révocati<strong>on</strong>, lamise à la retraite et la démissi<strong>on</strong> s<strong>on</strong>t soumis à des règles précises c<strong>on</strong>tenues dansla loi.2. Droit à des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de travail équitables et satisfaisantes.2.1. La F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> publique.Les droits communs aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naires et aux c<strong>on</strong>tractuels de l'Etat, relatifs auxb<strong>on</strong>nes c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de travail s<strong>on</strong>t les suivants :■Le droit à la rémunérati<strong>on</strong> après le service fait (la rémunérati<strong>on</strong> s'entendantcomme étant le traitement soumis à retenue pour pensi<strong>on</strong> auquel s'ajoutentéventuellement d'autres avantages pécuniaires en f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>traintes etsujéti<strong>on</strong>s particulières à l'emploi exercé) (article 27).■Le droit à la pensi<strong>on</strong> de retraite après la cessati<strong>on</strong> définitive des f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s et ce,c<strong>on</strong>formément à la législati<strong>on</strong> en vigueur (article 42).■Le droit à la protecti<strong>on</strong> sociale en matière de risques professi<strong>on</strong>nels, d'assurancevieillesse, de soins de santé, etc., d<strong>on</strong>t les modalités doivent être fixées par untexte spécifique (article 28).■Le droit au c<strong>on</strong>gé annuel de trente (30) jours c<strong>on</strong>sécutifs pour une période de
76<strong>on</strong>ze (11) mois de services effectifs (article 29).■Le droit aux permissi<strong>on</strong>s et autorisati<strong>on</strong>s d'absence n<strong>on</strong> déductibles du c<strong>on</strong>géannuel, accordées aux représentants syndicaux à l'occasi<strong>on</strong> de la c<strong>on</strong>vocati<strong>on</strong>des c<strong>on</strong>grès de leurs organisati<strong>on</strong>s, à tous autres agents pour participer à desacti<strong>on</strong>s ou à des manifestati<strong>on</strong>s d'intérêt nati<strong>on</strong>al ou pour événements familiauxdans la limite de dix (10) jours dans l'année (articles 33 et 34).■Le droit aux c<strong>on</strong>gés pour examens ou c<strong>on</strong>cours présentant un intérêt pour ledéroulement de la carrière (article 41).■Le droit aux c<strong>on</strong>gés de maladie ou aux suspensi<strong>on</strong>s de c<strong>on</strong>trat de travail pourcause de maladie (article 36).■Le droit au c<strong>on</strong>gé de maternité de quatorze (14) semaines pour le pers<strong>on</strong>nelféminin (article 37).■Le droit à l'évoluti<strong>on</strong> de la carrière par le biais de la formati<strong>on</strong> professi<strong>on</strong>nelle, dela spécialisati<strong>on</strong> et du perfecti<strong>on</strong>nement (article 43).■Le droit de participer à la créati<strong>on</strong> et à la vie des associati<strong>on</strong>s ou des syndicatsprofessi<strong>on</strong>nels, d'y adhérer et d'y exercer des m<strong>and</strong>ats, de même que le droit degrève et dans le respect des textes en vigueur en la matière (articles 44et 45).2.2. Les emplois privés.Le titre IV du Code du travail porte sur les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s générales du travail. Il disposedes règles suivantes :■Impositi<strong>on</strong> d'une durée légale du travail à quarante (40) heures par semaine, avecdes dérogati<strong>on</strong>s possibles accordées par « arrêtés ministériels » (article 79).■Réglementati<strong>on</strong> spécifique du travail de nuit et du travail posté (articles 80 et81).■Réglementati<strong>on</strong> du travail des femmes et des adolescents (articles 82 à 88).■Impositi<strong>on</strong> d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre (24) heuresc<strong>on</strong>sécutives par semaine (article 89).■droit au c<strong>on</strong>gé payé à la charge de l'employeur, à rais<strong>on</strong> de deux jours et demiouvrables par mois de service (article 90).
771•1 Egalité de salaire pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leursexe, leur âge et leur statut, pour des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s égales de travail, dequalificati<strong>on</strong> professi<strong>on</strong>nelle et de rendement (article 104).■Obligati<strong>on</strong> à toute entreprise, société ou organisme installé au Burkina Fasod'assurer la couverture sanitaire du travailleur c<strong>on</strong>formément aux c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>sdéfinies par les textes portant créati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de lamédecine du travail (article 143).Outre ces éléments, le Code du travail dispose d'une réglementati<strong>on</strong> stricte pourtous les éléments se rapportant à la formati<strong>on</strong> et à la cessati<strong>on</strong> du c<strong>on</strong>trat detravail, au c<strong>on</strong>trat d'apprentissage et aux modalités d'exécuti<strong>on</strong> des obligati<strong>on</strong>s desdifférentes parties.3. Droit des syndicats.3.1. Droit de former et de s'affilier à des syndicats.L'article 21 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose que la « liberté d'associati<strong>on</strong> est garantie.Toute pers<strong>on</strong>ne a le droit de c<strong>on</strong>stituer des associati<strong>on</strong>s et de participer librementaux activités des associati<strong>on</strong>s créées. La liberté syndicale est garantie. Lessyndicats exercent leurs activités sans c<strong>on</strong>trainte et sans limitati<strong>on</strong> autres quecelles prévues par la Loi ».L'article 44 de la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 régissant la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publiquestipule que « les agents de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique jouissent des droits et libertéspubliques rec<strong>on</strong>nus par la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> à tout citoyen burkinabé. Ils peuventnotamment créer des associati<strong>on</strong>s ou des syndicats professi<strong>on</strong>nels, y adhérer et yexercer des m<strong>and</strong>ats... Il s<strong>on</strong>t libre de leurs politiques philosophiques et religieuseset aucune menti<strong>on</strong> faisant état de ces opini<strong>on</strong>s ne doit figurer dans leur dossierindividuel... ».L'article 149 du Code du travail stipule que « les travailleurs ... ainsi que leursemployeurs peuvent c<strong>on</strong>stituer librement des syndicats professi<strong>on</strong>nels... Touttravailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de s<strong>on</strong> choix dans lecadre de sa professi<strong>on</strong>. Il est interdit à tout employeur de prendre en c<strong>on</strong>sidérati<strong>on</strong>
78l'appartenance ou n<strong>on</strong> à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pourarrêter ses décisi<strong>on</strong>s en ce qui c<strong>on</strong>cerne notamment, l'embauchage, la c<strong>on</strong>duite etla répartiti<strong>on</strong> du travail, la formati<strong>on</strong> professi<strong>on</strong>nelle, l'avancement, la rémunérati<strong>on</strong>et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de c<strong>on</strong>gédiement... »Les Lois n°10/92/ADP du 15/12/1992, portant liberté d'associati<strong>on</strong> etn°11/92/ADP du 22/12/1992, portant Code du Travail régissent essentiellement laformati<strong>on</strong> et le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des syndicats.Mais il y a des limitati<strong>on</strong>s. Certains textes interdisent le droit syndical et le droit degrève à des pers<strong>on</strong>nels précis. Il en est ainsi du Kiti (Décret) n°AN VIII -0326/FP/MF/MTSSFP/MDPS du 04 juin 1991, portant Statut Particulier du Cadredes Pers<strong>on</strong>nels de la Police Nati<strong>on</strong>ale, qui dispose à s<strong>on</strong> article 45 que « le droitsyndical et le droit de grève ne s<strong>on</strong>t pas rec<strong>on</strong>nus au pers<strong>on</strong>nel de la PoliceNati<strong>on</strong>ale ».Les syndicats <strong>on</strong>t le droit de c<strong>on</strong>stituer des fédérati<strong>on</strong>s ou des c<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong>s etces dernières <strong>on</strong>t le droit de s'affilier à des organisati<strong>on</strong>s internati<strong>on</strong>ales desyndicats. Ce droit est rec<strong>on</strong>nu par la Loi n°10/92/ADP sus-citée qui précise que« les organisati<strong>on</strong>s syndicales peuvent s'affilier librement à des organisati<strong>on</strong>ssyndicales internati<strong>on</strong>ales de leur choix ».Cette dispositi<strong>on</strong> est elle-même une applicati<strong>on</strong> de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.Dans la pratique, plusieurs syndicats se s<strong>on</strong>t regroupés pour c<strong>on</strong>stituer descentrales syndicales, à l'exemple de la C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> Générale des TravailleursBurkinabé (C.G.T.B.), de la C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> syndicale du Burkina (C.S.B), del'Organisati<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale des Syndicats Libres (O.N.S.L) etc. Certaines centraless<strong>on</strong>t affiliées à des organisati<strong>on</strong>s internati<strong>on</strong>ales. Ainsi, la C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>aledes Travailleurs du Burkina (C.N.T.B.), est affiliée à la C<strong>on</strong>fédérati<strong>on</strong> M<strong>on</strong>diale duTravail.3.2. Droit de grèveL'article 22 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> garantit le droit de grève.La loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 le rec<strong>on</strong>naît en s<strong>on</strong> article 45, « aux agents de
79la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> publique qui l'exercent dans le cadre défini par les textes législatifs ».La loi n°11/92/ADP du 22/12/1992, portant Code du Travail prévoit le droit degrève et de lock-out en s<strong>on</strong> article 24-§7, mais à la c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong> d'intervenir aprèsépuisement des procédures de c<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> et d'arbitrage (article 216).4. Droit à la Sécurité SocialeLe droit à la Sécurité Sociale est régi par la loi n°13-72 AN du 28-12-72 portantCode de Sécurité Sociale au Burkina Faso.Les arrêtés n°1317 et 1318/FPT du 24-12-1976 réglementent l'affiliati<strong>on</strong> desemployeurs d'une part et le règlement du service des prestati<strong>on</strong>s de SécuritéSociale d'autre part.En marge de cette réglementati<strong>on</strong>, les travailleurs organisés en syndicats défendentles droits à la Sécurité Sociale et veillent au respect des textes par les employeurset l'Etat.Il. DROIT A L'EDUCATION.En applicati<strong>on</strong> des différentes C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s Internati<strong>on</strong>ales des Droits de l'Homme etde la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du 11 juin 1991, le Gouvernement burkinabé a pris des mesuresen vue de rendre effectif le droit à l'éducati<strong>on</strong>. Ces mesures couvrent tous lessecteurs du système éducatif qui va de l'enseignement primaire à l'enseignementsupérieur. Le présent rapport se propose de retenir le cas de l'enseignementprimaire et f<strong>on</strong>damental comme illustrati<strong>on</strong> de la situati<strong>on</strong>.1. GénéralitésLes chiffres qui caractérisent la situati<strong>on</strong> du Burkina Faso en matière d'éducati<strong>on</strong>s<strong>on</strong>t les suivants :• 37,7% de taux de scolarisati<strong>on</strong> (taux filles : 30,38%, taux garç<strong>on</strong>s : 44,73%)corresp<strong>on</strong>dant à un effectif total de 705927 élèves.• 12290 salles de classe corresp<strong>on</strong>dant à 3368 écoles• 14784 enseignants d<strong>on</strong>t les 2/3 ne s<strong>on</strong>t pas qualifiés du fait des recrutementsdirects.
80• 22% de taux d'alphabétisati<strong>on</strong> des adultes.Au plan qualitatif, les déperditi<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t encore élevées et les acquisiti<strong>on</strong>s faibles etpeu adaptées à la vie active post - scolaire.La dem<strong>and</strong>e d'éducati<strong>on</strong> demeure forte face à une offre insuffisante tant du pointde vue quantitatif que qualitatif.Face à cette situati<strong>on</strong> le Gouvernement burkinabé a décidé de faire de l'éducati<strong>on</strong>de base une priorité avec une double orientati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>stante : l'expansi<strong>on</strong> de l'offred'éducati<strong>on</strong> et l'améliorati<strong>on</strong> de la qualité et de la pertinence de l'enseignement.Cette décisi<strong>on</strong> est clairement affirmée dans la lettre d'Intenti<strong>on</strong> de Politique deDéveloppement.L'instrument de base pour cette entreprise est le plan Décennal de Développementde l'Educati<strong>on</strong> de Base 1998 - 2007 en cours de finalisati<strong>on</strong>.Les objectifs globaux de ce Plan Décennal s<strong>on</strong>t les suivants :• Au plan quantitatif■Faire passer le taux brut de scolarisati<strong>on</strong> à 70% en l'an 2007.■Réduire l'écart entre les provinces de manière à porter le taux descolarisati<strong>on</strong> des provinces les moins scolarisées à au moins 50% dans lamême période.■Faire passer le taux de scolarisati<strong>on</strong> des filles à 65% en 2007■Faire passer le pourcentage des effectifs du privé de 10% à 20%.• Au plan qualitatif■Faire baisser la proporti<strong>on</strong> de redoublants de 18% à 10,5% en 2007.■Faire passer le pourcentage de places assises de 70% à 90% en 2007.■Généraliser le système de mise à dispositi<strong>on</strong> gratuite de manuels de françaiset de mathématiques de manière à atteindre le ratio de un livre pour deuxélèves dans les écoles publiques et privées.■Supprimer progressivement le recrutement direct des maîtres sans formati<strong>on</strong>initiale et porter le pourcentage des maîtres ayant bénéficié d'une formati<strong>on</strong>
81c<strong>on</strong>tinue à 100% en 2007.■Faire passer le taux de réussite à l'examen terminal à 75%.■Mettre en place un cycle terminal qui permet de lier l'école au milieuproductif par la créati<strong>on</strong> pour les sortants d'activités rémunératrices.• Alphabétisati<strong>on</strong> et éducati<strong>on</strong> des adultes■Faire passer le taux général d'alphabétisati<strong>on</strong> à 40% en 2007 et celui desfemmes de 15% à 20%.■Faire baisser le taux des ab<strong>and</strong><strong>on</strong>s internes de 20 à 10% et celui desfemmes de 30 à 15%.■Améliorer les taux de réussite aux évaluati<strong>on</strong>s finales et les faire passer de60 à 80% envir<strong>on</strong>.Comme <strong>on</strong> peut le c<strong>on</strong>stater, il s'agit véritablement d'objectifs de démocratisati<strong>on</strong>de l'éducati<strong>on</strong> de base de faç<strong>on</strong> à toucher le plus gr<strong>and</strong> nombre et avec desservices éducatifs de qualité.2. Promoti<strong>on</strong> du droit à l'éducati<strong>on</strong>La principale référence à ce point demeure la Loi d'Orientati<strong>on</strong> de l'Educati<strong>on</strong>adoptée par l'Assemblée des Députés du Peuple le 09 mai 1996 à la suite des EtatsGénéraux de l'Educati<strong>on</strong> tenus en septembre 1994. La Loi dispose en s<strong>on</strong> article 2que « l'éducati<strong>on</strong> est une priorité nati<strong>on</strong>ale. Tout citoyen a droit à l'éducati<strong>on</strong> sansdiscriminati<strong>on</strong> f<strong>on</strong>dée sur le sexe, l'origine sociale, la race ou la religi<strong>on</strong>. L'obligati<strong>on</strong>scolaire couvre la période d'âge de 6 à 16 ans.Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dèslors que les infrastructures, les équipements les ressources humaines et laréglementati<strong>on</strong> en vigueur le permettent... »Par ailleurs il est dit dans la Loi d'Orientati<strong>on</strong> que « les langues d'enseignement s<strong>on</strong>tle français et les langues nati<strong>on</strong>ales » (Article 4). Cette dispositi<strong>on</strong> traduit le souci
82d'assurer une participati<strong>on</strong> réelle de toutes les pers<strong>on</strong>nes et ethnies du pays àl'éducati<strong>on</strong> de la société.Enfin les programmes d'enseignement <strong>on</strong>t été révisés de faç<strong>on</strong> à y inclure desvolets spécifiques sur l'enseignement des droits de l'homme et la promoti<strong>on</strong> de lacompréhensi<strong>on</strong>, la tolérance et l'esprit d'équité. Ces volets s<strong>on</strong>t les suivants :• Educati<strong>on</strong> sociale et genre• Civisme, droits humains et valeurs nati<strong>on</strong>ales.Dans les manuels scolaires issus de ces programmes, le même souci d'équité etd'enseignement des droits de l'homme prévaut à travers notamment les aspectssuivants :• Une représentati<strong>on</strong> équitable des différentes régi<strong>on</strong>s socio-culturelles du pays(noms de pers<strong>on</strong>nages, récits de cérém<strong>on</strong>ies coutumières etc...)• Un soin particulier à éviter les stéréotypes sexistes campant pers<strong>on</strong>nagesmasculins et féminins dans des rôles traditi<strong>on</strong>nels.• Une valorisati<strong>on</strong> des situati<strong>on</strong>s où les pers<strong>on</strong>nages s<strong>on</strong>t au c<strong>on</strong>traire dans desrapports n<strong>on</strong> discriminatoires, n<strong>on</strong> sexistes.• Une valorisati<strong>on</strong> des situati<strong>on</strong>s où s<strong>on</strong>t prônées certaines vertus moralesrattachées au respect des droits humains.3. Droit a l'éducati<strong>on</strong> primaireDes différents ordres d'enseignement, l'enseignement primaire demeure prioritaireau Burkina Faso.Il c<strong>on</strong>stitue un cycle d'éducati<strong>on</strong> terminal qui offre cependant une ouverture sur lepost-primaire que c<strong>on</strong>stitue l'enseignement sec<strong>on</strong>daire.« L'enseignement du Premier Degré est gratuit en ce qui c<strong>on</strong>cerne la périodesoumise à l'obligati<strong>on</strong> scolaire « (Décret 289 bis PRES/EN du 13-08-65, toujoursen vigueur).Au-delà de cette gratuité de principe, le Gouvernement a entrepris un certainnombre d'acti<strong>on</strong>s visant à favoriser le plus gr<strong>and</strong> nombre et à encourager les
83parents d'élèves. Il s'agit notamment :• de l'ouverture de classes à double flux (pour rati<strong>on</strong>aliser les effectifs dans lesgr<strong>and</strong>s centres urbains) ; .• de l'ouverture de classes multigrades dans les z<strong>on</strong>es à faible dem<strong>and</strong>e descolarisati<strong>on</strong> pour permettre des recrutements annuels ;• d'opérati<strong>on</strong>s de distributi<strong>on</strong> gratuite de manuels scolaires aux écoles publiqueset privées (livres de base du cours préparatoire au cours moyen ) ;• la créati<strong>on</strong> d'écoles satellites. Ces écoles dispensent un enseignement bilingue(langue nati<strong>on</strong>ale et français) et <strong>on</strong>t un cycle de trois ans au terme duquel lesenfants rejoignent une école mère pour y poursuivre le reste de leurs étudesprimaires en français. Leur créati<strong>on</strong> rép<strong>on</strong>d à plusieurs soucis d<strong>on</strong>t notammentcelui de la scolarisati<strong>on</strong> et la fréquentati<strong>on</strong> des filles et celui de la pertinencede l'enseignement. 132 écoles satellites s<strong>on</strong>t aujourd'hui f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nelles.Un accent particulier doit être sur la promoti<strong>on</strong> de la scolarisati<strong>on</strong> des filles pourlaquelle le Gouvernement a adopté un « Plan Nati<strong>on</strong>al pour l'Educati<strong>on</strong> des filles »d<strong>on</strong>t l'objectif est de faire passer le taux de scolarisati<strong>on</strong> des filles des 30,38%actuels à 65% en l'an 2007.Au-delà de ces chiffres, ce Plan Nati<strong>on</strong>al traduit la préoccupati<strong>on</strong> du GouvernementBurkinabé pour une améliorati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>stante de la fréquentati<strong>on</strong> scolaire des filles.Il s'inscrit dans un ensemble de mesures visant la protecti<strong>on</strong> particulière de la petitefille, c<strong>on</strong>formément aux décisi<strong>on</strong>s de la gr<strong>and</strong>e renc<strong>on</strong>tre de BEIJING sur la situati<strong>on</strong>des femmes.Une dernière dispositi<strong>on</strong> à ce niveau c<strong>on</strong>cerne le recrutement des maîtres que leGouvernement autorise, en dépit du fait que le recrutement de nouveauxf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>naires est pratiquement arrêté dans la plupart des secteurs, compte tenu dela c<strong>on</strong>j<strong>on</strong>cture éc<strong>on</strong>omique nati<strong>on</strong>ale.Les difficultés au niveau de l'enseignement primaire demeurent encore lespesanteurs socio-culturelles à vaincre, pour une plus gr<strong>and</strong>e scolarisati<strong>on</strong> desenfants, et notamment des filles.
844. Droit à l'éducati<strong>on</strong> f<strong>on</strong>damentaleDans le cadre du Plan Décennal de développement de l'éducati<strong>on</strong> de base, lesmesures gouvernementales envisagées c<strong>on</strong>cernent autant les adultes que les jeuneset s<strong>on</strong>t les suivantes :• Une intensificati<strong>on</strong> des acti<strong>on</strong>s d'alphabétisati<strong>on</strong> des adultes ; l'inserti<strong>on</strong> deces acti<strong>on</strong>s d'alphabétisati<strong>on</strong> dans des projets de développement intégré.• Le développement de programmes au profit des jeunes n<strong>on</strong> scolarisés oudéscolarisés.4.1. Pour les adultesLe Gouvernement a rompu avec la pratique d'opérati<strong>on</strong>s d'alphabétisati<strong>on</strong>p<strong>on</strong>ctuelles et spectaculaires pour s'engager résolument dans la créati<strong>on</strong> deCentres Permanents d'Alphabétisati<strong>on</strong> et de Formati<strong>on</strong> (CPAF). En 1996-1997,4898 centres <strong>on</strong>t été ouverts c<strong>on</strong>tre 3970 en 1994-1995 soit 928 de plus. Lesprévisi<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t de l'ordre de 1000 nouveaux centres par an jusqu'en 2007.Ces centres f<strong>on</strong>t désormais partie de l'envir<strong>on</strong>nement quotidien des publicsc<strong>on</strong>cernés, au même titre que les écoles. Ils c<strong>on</strong>stituent également des lieuxprivilégiés où les adultes peuvent être saisis pour une mobilisati<strong>on</strong> communautaireen faveur de l'éducati<strong>on</strong> notamment.A la suite des six Engagements Nati<strong>on</strong>aux initiés par le Chef de l'Etat en 1992, leGouvernement a également entrepris pour les adultes, l'opérati<strong>on</strong> ZANU, qui est unvaste programme d'animati<strong>on</strong> communautaire pour le développement en z<strong>on</strong>e ruralenotamment.Par le biais de l'alphabétisati<strong>on</strong>, ce projet permet une participati<strong>on</strong> resp<strong>on</strong>sable despublics c<strong>on</strong>cernés à différents programmes socio-éc<strong>on</strong>omiques pour ledéveloppement (santé, hydraulique, créati<strong>on</strong> et gesti<strong>on</strong> d'unités éc<strong>on</strong>omiques etc.).4.2. Pour les jeunesLe Gouvernement a entrepris depuis 1995 la créati<strong>on</strong> et le développement deCentres d'Educati<strong>on</strong> de Base N<strong>on</strong> Formelle (CEBNF) destinés aux jeunes n<strong>on</strong>scolarisés et déscolarisés âgés de 9 à 15 ans. Ces centres c<strong>on</strong>stituent une véritable
85« école de la deuxième chance », en ce qu'ils permettent au-delà desapprentissages noti<strong>on</strong>nels, des formati<strong>on</strong>s prévocati<strong>on</strong>nelles qui peuvent êtredirectement réinvesties dans la vie active.Le CEBNF a une durée de quatre ans et c<strong>on</strong>cerne autant les filles que les garç<strong>on</strong>s.30 CEBNF s<strong>on</strong>t aujourd'hui f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nels avec un effectif total d'envir<strong>on</strong> 1200élèves.5. Améliorati<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s matérielles du corps enseignantLes mesures gouvernementales à ce niveau c<strong>on</strong>cernent notamment :• les logements des maîtres• les indemnités compensatoires• la formati<strong>on</strong>• la participati<strong>on</strong> des organisati<strong>on</strong>s syndicales d'enseignants aux C<strong>on</strong>seilsd'Administrati<strong>on</strong> des Secteurs Ministériels (CASEM) chargés de l'éducati<strong>on</strong>.La questi<strong>on</strong> du logement du maître est devenu un mot d'ordre du Département del'Enseignement de Base ainsi libellé : « Une classe, un logement de maître ».L'affectati<strong>on</strong> d'un maître dans une école est c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>née par le respect de ce motd'ordre de la part notamment des partenaires communautaires (parents d'élèves,collectivités...)Quant aux indemnités, les enseignants s<strong>on</strong>t encore un des rares corps de laF<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique burkinabé à bénéficier d'indemnités de sujéti<strong>on</strong>.Des indemnités spécifiques s<strong>on</strong>t également servies aux enseignants en charge declasses innovées que c<strong>on</strong>stituent les classes multigrades et à double flux.La participati<strong>on</strong> des syndicats d'enseignants aux CASEM leur d<strong>on</strong>ne la possibilité departiciper directement à la mise en oeuvre des plans et programmesgouvernementaux en matière d'éducati<strong>on</strong>.Bien qu'insuffisante, la formati<strong>on</strong> et le recyclage des enseignants demeurent unedes préoccupati<strong>on</strong>s majeures du Gouvernement. Un plan directeur de la formati<strong>on</strong>des pers<strong>on</strong>nels a été élaboré à cet effet et prend en compte autant les enseignants
86que les pers<strong>on</strong>nels d'encadrement.III. NIVEAU DE VIE, ALIMENTATION, SANTE ET LOGEMENT.1. Droit à un niveau de vie adéquat1.1. Mesures prises en vue de développer ou de réformer le système agraireL'occupati<strong>on</strong> et l'exploitati<strong>on</strong> rati<strong>on</strong>nelles des terres et des ressources naturellesf<strong>on</strong>t l'objet d'une attenti<strong>on</strong> particulière de la part des autorités. La gesti<strong>on</strong> dupatrimoine f<strong>on</strong>cier est liée aux facteurs socio-culturels et à l'évoluti<strong>on</strong> desbesoins de la société. La dernière réorganisati<strong>on</strong> agraire et f<strong>on</strong>cière intervenue en1996 et d<strong>on</strong>t les textes s<strong>on</strong>t en vigueur est l'objet de la loi n°14/96/ADP et duDécret n°97-054/PRES/MEF du 6 février 1997 portant applicati<strong>on</strong> de la dite Loi.1.2. Mesures prises en vue d'améliorer les méthodes de producti<strong>on</strong>• Une Directi<strong>on</strong> Nati<strong>on</strong>ale de la Vulgarisati<strong>on</strong> Agricole est mise en place ausein du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.• Douze Centres Régi<strong>on</strong>aux de Promoti<strong>on</strong> Agro- Pastorale s<strong>on</strong>t créés.• Un Système Nati<strong>on</strong>al de Vulgarisati<strong>on</strong> Agricole a été adopté et mis enoeuvre.Le diagnostic des c<strong>on</strong>traintes de producti<strong>on</strong> est c<strong>on</strong>duit avec la participati<strong>on</strong> desproducteurs pour :• la vulgarisati<strong>on</strong> des technologies pour lever les c<strong>on</strong>traintes identifiées et laformati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tinue des agents et des paysans.• l'utilisati<strong>on</strong> d'outils testés pour dém<strong>on</strong>trer la validité des technologiesproposées et c<strong>on</strong>vaincre les producteurs à leur adopti<strong>on</strong>.Les résultats de la vulgarisati<strong>on</strong> s'apprécient à travers :• La couverture de la vulgarisati<strong>on</strong> qui touche 70% des exploitati<strong>on</strong>s et 32%des producteurs.
87• 53% des producteurs encadrés <strong>on</strong>t adopté au moins un des principaux thèmesvulgarisés.1.3. Promoti<strong>on</strong> de la recherche en matière d'agricultureDepuis 1985 le Burkina Faso a adopté et mis en oeuvre des programmes nati<strong>on</strong>auxde vulgarisati<strong>on</strong> agricole, de recherche agricole et de gesti<strong>on</strong> des terroirs.En 1996, un plan stratégique de la recherche agricole a été adopté.Un institut de l'envir<strong>on</strong>nement et des recherches agricoles est mis en place et larégi<strong>on</strong>alisati<strong>on</strong> de la recherche c<strong>on</strong>cerne cinq régi<strong>on</strong>s du pays.1.4. Introducti<strong>on</strong> de nouvelles techniques de producti<strong>on</strong> et leur méthode de diffusi<strong>on</strong>La vulgarisati<strong>on</strong> introduit et suscite, auprès des producteurs, l'adopti<strong>on</strong> de nouvellestechniques qui améliorent leurs pratiques, leurs producti<strong>on</strong>s et leurs revenus. Pource faire elle procède ainsi qu'il suit :a) Diagnostic des c<strong>on</strong>traintes de producti<strong>on</strong> au niveau de l'exploitati<strong>on</strong>avec la participati<strong>on</strong> des producteurs et qui c<strong>on</strong>siste, à partir des activitésdéveloppées dans l'exploitati<strong>on</strong>, à analyser les pratiques et les résultats.Le résultat du diagnostic est l'identificati<strong>on</strong> des thèmes de vulgarisati<strong>on</strong>comme soluti<strong>on</strong> aux c<strong>on</strong>traintes identifiées.Les c<strong>on</strong>traintes pour lesquelles la vulgarisati<strong>on</strong> n'a pas de soluti<strong>on</strong>, s<strong>on</strong>ttransmises à la Recherche.b) Les agents vulgarisateurs qui élaborent leur programme de travail àpartir de ce diagnostic, s<strong>on</strong>t formés de faç<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tinue sur les technologiesnouvelles corresp<strong>on</strong>dantes aux thèmes définis. Les techniciens spécialiséss<strong>on</strong>t formés par les chercheurs une fois par mois ; les vulgarisateurs debase s<strong>on</strong>t formés par les tests une fois par mois ou par quinzaine.c) L'Agent Vulgarisateur de Base (AVB) organise les producteurs enGroupes de Travail (GT) pédagogiques sel<strong>on</strong> les affinités, la proximité desexploitati<strong>on</strong>s, le niveau technique, les spécialités. L'AVB renc<strong>on</strong>tre chaque
88GT une fois toutes les deux semaines lors d'une séance de travail Activitéde Travail de Groupe (ATG), au cours de laquelle la nouvelle technique estdém<strong>on</strong>trée au niveau d'une parcelle de dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (producti<strong>on</strong> végétale)ou d'un troupeau de dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (producti<strong>on</strong> animale).d) Les producteurs intéressés par la technologie dém<strong>on</strong>trée f<strong>on</strong>tindividuellement des tests comparatifs de pratiques à travers des microparcellesou des troupeaux-tests, pour se c<strong>on</strong>vaincre des avantages certainsqu'offre la nouvelle technique avant de l'adopter. Ces producteursbénéficient de l'appui de l'AVB qui leur rend visite dans leur exploitati<strong>on</strong> àtravers les Activités de Visite des Exploitati<strong>on</strong>s (AVE).e) Outre les dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>duites dans les Parcelles deDém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (PD) et les Troupeaux de Dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (TD), d<strong>on</strong>t lesrésultats s<strong>on</strong>t évalués, la vulgarisati<strong>on</strong> utilise d'autres outils dedém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> de pratiques et de résultats : ce s<strong>on</strong>t les visites commentéeset les journées de dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> qui s<strong>on</strong>t organisées dans l'exploitati<strong>on</strong>d'un paysan dém<strong>on</strong>strateur, sur les tests et essais en milieu paysan ou dansles Points d'Appui de Prévulgarisati<strong>on</strong> et d'Expérimentati<strong>on</strong> Multilocale(PAPEM) au profit des producteurs et des agents.f) Enfin, l'utilisati<strong>on</strong> des médias (radio, affiches, diaporama, filmdocumentaire vidéo etc.) vient en appui aux activités de formati<strong>on</strong> et devulgarisati<strong>on</strong>.1.5. Méthodes de c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des alimentsUn service de technologie alimentaire existe au sein de la Directi<strong>on</strong> de laVulgarisati<strong>on</strong> Agricole et qui travaille étroitement avec le Laboratoire de Biologie etde Technologie Alimentaire du Centre Nati<strong>on</strong>al de la Recherche Scientique etTechnologique.La vulgarisati<strong>on</strong> agricole en matière de technologie alimentaire c<strong>on</strong>duitrégulièrement les activités ci-après :• Le recensement des technologies alimentaires traditi<strong>on</strong>nelles afin d'ensélecti<strong>on</strong>ner pour améliorati<strong>on</strong> et/ou diffusi<strong>on</strong>.
89• La formati<strong>on</strong> des productrices en technologies de séchage de fruits etlégumes.• La formati<strong>on</strong> des femmes organisées en groupement villageois sur latransformati<strong>on</strong> de produits agricoles en général.• La mise au point de méthodes de c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong>.• La mise au point d'unités de transformati<strong>on</strong> et de c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong>.• La formati<strong>on</strong> des femmes membres des groupements villageois féminins surles techniques de transformati<strong>on</strong> de tubercules.• La formati<strong>on</strong> des agents vulgarisateurs et des membres des groupementsvillageois féminins en alimentati<strong>on</strong>-nutriti<strong>on</strong>.Dans ce cadre, une collaborati<strong>on</strong> entre les organisati<strong>on</strong>s paysannes et les ONGoeuvrant dans ce domaine.2. Droit à l'alimentati<strong>on</strong>2.1. Mesures en faveur de la producti<strong>on</strong>2.1.1. Mesures prises aux fins d'améliorer les méthodes de producti<strong>on</strong>La mise en oeuvre des programmes d'alphabétisati<strong>on</strong> et de formati<strong>on</strong> de lapopulati<strong>on</strong> rurale.Ces programmes visent d'une part à améliorer la producti<strong>on</strong> agricole (en quantité eten qualité), et d'autre part à améliorer les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de vie des populati<strong>on</strong>s rurales.Sel<strong>on</strong> le programme nati<strong>on</strong>al de vulgarisati<strong>on</strong> ( campagne 1995/96) <strong>on</strong> dénombre113 492 producteurs alphabétisés (d<strong>on</strong>t 76 795 hommes et 36 697 femmes). Laproporti<strong>on</strong> des pers<strong>on</strong>nes sachant lire ou écrire croît avec la taille des ménages (3pers<strong>on</strong>nes en moyenne dans les ménages de 20 pers<strong>on</strong>nes et plus) soit envir<strong>on</strong>15%(rapport de l'enquête nati<strong>on</strong>ale statistique agricole de 1995).• La mise en oeuvre de formati<strong>on</strong>/c<strong>on</strong>seil au niveau de la populati<strong>on</strong>rurale.Les outils de formati<strong>on</strong> des producteurs s<strong>on</strong>t :• Les activités de travaux de groupe (ATG)
90En producti<strong>on</strong> végétale, 66 584 ATG <strong>on</strong>t été organisés en 1994/95 ayantenregistré 874 543 présences de producteurs. En producti<strong>on</strong> animale 23 759 ATG<strong>on</strong>t été organisés avec 353 721 producteurs.• Les Activités de Suivi-Visite des Exploitati<strong>on</strong>s (ASVE)En producti<strong>on</strong> animale, il y a eu en 1994/95, 20 004 ASVE et 48 897 exploitati<strong>on</strong>svisitées. En producti<strong>on</strong> végétale, il y a eu 70 326 ASVE et 168 164 exploitati<strong>on</strong>svisitées.• Les Groupes de Travail (GT)Il a été organisé en producti<strong>on</strong> végétale 11 796 GT et en producti<strong>on</strong> animale 4 974GT.• Les Parcelles de Dém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (PD) et les Troupeaux deDém<strong>on</strong>strati<strong>on</strong> (TD)En producti<strong>on</strong> animale, il a été mis en place 2 537 TD et en producti<strong>on</strong> végétale 17980 PD.2.1.2. Mesures en vue d'améliorer quantitativement les producti<strong>on</strong>s.• L'Etat encourage l'équipement des producteurs en matériel agricole.Le total des charrues, sel<strong>on</strong> le rapport de l'enquête statistique 1995, est de 337500 tous types c<strong>on</strong>f<strong>on</strong>dus, pour 886 600 ménages. En fait, 72% des ménagesn'<strong>on</strong>t aucune charrue.Plusieurs acti<strong>on</strong>s <strong>on</strong>t été menées par l'Etat pour équiper le plus gr<strong>and</strong> nombre ; <strong>on</strong>peut citer :• L'opérati<strong>on</strong> "30 000"charrue de 1989 à 1994.• L'opérati<strong>on</strong> "50 000 charrues " en cours ;• L'opérati<strong>on</strong> "2000 charrues " en 1997 pour les jeunes exploitants dansleur terroir ;• L'Etat favorise l'utilisati<strong>on</strong> des engrais en subventi<strong>on</strong>nant le coût (pas decharges fiscales). La c<strong>on</strong>sommati<strong>on</strong> annuelle est de 35 000t l'an.Toutefois la quantité d'engrais utilisée par hectare est faible. Elle est del'ordre de 7,5Kg, toutes cultures c<strong>on</strong>f<strong>on</strong>dues.• L'Etat favorise l'utilisati<strong>on</strong> des produits vétérinaires (pas de charges
91fiscales), luttant c<strong>on</strong>tre les maladies aviaires des bovins et des petitsruminants. Toutefois le niveau d'utilisati<strong>on</strong> demeure faible en rais<strong>on</strong> ducoût des produits.2.1.3. Mesures pour diffuser les nouvelles c<strong>on</strong>naissances techniques.• Il est mis en place des mécanismes de f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de recherchevulgarisati<strong>on</strong>-producti<strong>on</strong>-producteur.Le f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des mécanismes est assuré au niveau des directi<strong>on</strong>sdécentralisées de l'Agriculture et des Ressources Animales, des Points d'Appui dePrévulgarisati<strong>on</strong> et d'Expérimentati<strong>on</strong> Multilocale (PAPEM), des comités techniqueset des ateliers d'évaluati<strong>on</strong> de la vulgarisati<strong>on</strong>.Ces mécanismes favorisent les échanges périodiques entre chercheurs, techniciens,producteurs sur le diagnostic des c<strong>on</strong>traintes et les innovati<strong>on</strong>s susceptibles d'êtreapportées.• Les thèmes les plus adoptés s<strong>on</strong>t :En producti<strong>on</strong> végétale :• préparati<strong>on</strong> du sol avant semis 78%• c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des récoltes • 74%En producti<strong>on</strong> animale :• déparasitage interne et externe : 21%• Vaccinati<strong>on</strong> des animaux • 20%Les thèmes les moins adoptés :En producti<strong>on</strong> végétale :• utilisati<strong>on</strong> des semences améliorées 11%• traitements phytosanitaires 13% En producti<strong>on</strong> animale :• culture fourragère 4%
922.2. Mesures prises pour la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des produits et pour prévenir la dégradati<strong>on</strong>des ressources2.2.1 Mesures prises pour la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des produitsUn service des interventi<strong>on</strong>s et de la producti<strong>on</strong> des stocks des produits agricolesexiste, et a pour missi<strong>on</strong>, notamment d'améliorer et de diffuser les c<strong>on</strong>naissancesrelatives aux méthodes de c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des produits.Ce service compte sur l'ensemble du territoire douze bases phytosanitairesrégi<strong>on</strong>ales équipées et dotées de stocks de produits permettant d'atteindrerapidement les z<strong>on</strong>es où l'interventi<strong>on</strong> est nécessaire. Ce service réalise le suivid'un certain nombre de fléaux endémiques comme l'invasi<strong>on</strong> des criquetsmigrateurs, des ravageurs...2.2.2. Mesures en vue de prévenir la dégradati<strong>on</strong> des ressourcesL'Etat a mis en place des programmes visant à la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des sols, à larestaurati<strong>on</strong> des sols et à la gesti<strong>on</strong> des eaux. On peut citer les différents projetsqui exécutent ces programmes :• le Projet c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des eaux et du sol et agroforesterie (provinces duPassoré, du Bam, du Bulkiemdé...)• le Projet Aménagement des Terroirs et C<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des Ressources dansle Plateau Central (PATECORE), c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> et restaurati<strong>on</strong> dessols,(Povinces du Bam, de l'Oubritenga ;• le Projet de Développement Rural Intégré (PDRI) du Sud-Ouest (Provincedu P<strong>on</strong>i)• le Projet de Développement Rural Intégré des provinces du Houet, de laKossi et du Mouhoun• le Projet de Développement Rural Intégré de la province du Bazèga• le Projet de Développement Rural Intégré de la province du Namentenga.
932.3. Mesures destinées à l'améliorati<strong>on</strong> du circuit d'informati<strong>on</strong> sur les marchés, surle système de subventi<strong>on</strong> des produits agricoles et l'aide en faveur des classesdéfavorisées.2.3.1. Mesures en vue de l'améliorati<strong>on</strong> du circuit d'informati<strong>on</strong> sur les marchés.Les moyens audiovisuels s<strong>on</strong>t utilisés pour améliorer l'informati<strong>on</strong> sur les marchés :• Les informati<strong>on</strong>s de la radiodiffusi<strong>on</strong>nati<strong>on</strong>ale : de faç<strong>on</strong>hebdomadaire, des informati<strong>on</strong>s radiodiffusées sur les prix d'achat desproduits, d'abord sur les lieux de producti<strong>on</strong> (en provinces) et ensuitesur les prix de vente dans les centres de commercialisati<strong>on</strong> (en ville).• Des bulletins hebdomadaires s<strong>on</strong>t édités par différentes structures . LaSociété Nati<strong>on</strong>ale de Gesti<strong>on</strong> du Stock de Sécurité Alimentaire(SONAGESS) édite un bulletin relatif aux informati<strong>on</strong>s sur le marchécéréalier. La Directi<strong>on</strong> des Statistiques Agro-pastorale (DSAP) d<strong>on</strong>nehebdomadairement les informati<strong>on</strong>s sur le marché de bétail.2.3.2. Système de subventi<strong>on</strong> des produits agricolesL'Etat intervient dans la subventi<strong>on</strong> des produits agricoles en supprimant la taxe surla valeur ajoutée (TVA) sur les produits agro-pastoraux (céréales, oléagineux,tubercules, bétail, volaille...), au niveau des agriculteurs et des éleveurs. En rappel,l'Etat subventi<strong>on</strong>ne la producti<strong>on</strong> en ex<strong>on</strong>érant les intrants de toutes taxes fiscales.2.3.3. L'aide en faveur des classes défavoriséesLes classes défavorisées s<strong>on</strong>t les plus touchées lors des crises. Aussi, l'Etat a misen place deux organes de précauti<strong>on</strong> et de gesti<strong>on</strong> des crises :• La Société Nati<strong>on</strong>ale de Gesti<strong>on</strong> du Stock de Sécurité Alimentaire d<strong>on</strong>t lerôle est de c<strong>on</strong>tribuer à la sécurité alimentaire du pays, à travers lagesti<strong>on</strong> du stock nati<strong>on</strong>al de sécurité et des aides alimentaires.• Le Comité Nati<strong>on</strong>al de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>(CONASUR) d<strong>on</strong>t la missi<strong>on</strong> est de parer à d'éventuelles calamitésnaturelles à travers des interventi<strong>on</strong>s et des appuis d'urgence.
942.4. Mesures pour relever la qualité de nutriti<strong>on</strong>Un service de technologie alimentaire et de nutriti<strong>on</strong> existe. Il vulgarise notammentun code sur la qualité nutriti<strong>on</strong>nelle des aliments locaux et c<strong>on</strong>court par des moyensaudiovisuels (télévisi<strong>on</strong>, radiodiffusi<strong>on</strong>, presse écrite), à la diffusi<strong>on</strong> des d<strong>on</strong>néespermettant à la populati<strong>on</strong> de savoir " manger mieux ". Il reste encore beaucoup àfaire car les besoins s<strong>on</strong>t importants en matière d'éducati<strong>on</strong> et d'informati<strong>on</strong>alimentaires.2.5. Mesures pour améliorer la qualité des alimentsUn service de c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>nement et du c<strong>on</strong>trôle a été créé et a pour but de veiller à laqualité des aliments. Il c<strong>on</strong>trôle à l'aide de critères alimentaires, les importati<strong>on</strong>s etles exportati<strong>on</strong>s d'aliments à partir de stocks (en gare, aux aéroports et auxfr<strong>on</strong>tières) pour s'assurer de la qualité des aliments et des produits végétaux.D'autre part une inspecti<strong>on</strong> des vi<strong>and</strong>es est assurée par les agents de la santéanimale sur l'ensemble du territoire.L'inspecti<strong>on</strong> des vi<strong>and</strong>es s'effectue au niveau des abattoirs et des marchés desvilles, des départements et des villages. Néanmoins, les tâches s<strong>on</strong>t si vastes faceaux moyens, que des abattages n<strong>on</strong> c<strong>on</strong>trôlés en ville et en milieu rural c<strong>on</strong>cernentune part n<strong>on</strong> négligeable du bétail.Quelques d<strong>on</strong>nées sur les producti<strong>on</strong>s agro-pastorales s<strong>on</strong>t détaillées ci-après :- Evaluati<strong>on</strong> des effectifs des animaux (en milliers).AN NEEBOVINS OVINS/CAPRINS VOLAILLES1991 4 016 21 088 17 3751992 4 096 12 520 17 7221993 4 178 12 967 18 0771994 4 262 13 431 18 4381995 4 347 13 911 18 8071996 4 434 14 409 19 183Source : Les comptes de la nati<strong>on</strong>
95- Evoluti<strong>on</strong> de la producti<strong>on</strong> céréalière (en milliers de t<strong>on</strong>nes).ANNÉE MIL SORGHO MAÏS RIZ1991- 1992 848,5 123,8 315,1 38,61992- 1993 783,5 1292,1 341,3 46,71993 - 1994 899,2 1230,4 350,3 611994- 1995 831,4 1232,4 365,9 811995- 1996 731 1254,7 365,9 81Source : DSAP (Directi<strong>on</strong> des Statistiques agro-pastorales).- Evoluti<strong>on</strong> de la producti<strong>on</strong> des autres produits agricoles (en milliers de t<strong>on</strong>nes)PRODUITS 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995Karité 90, 0 82,8 76,2 10,1Sésame 5,8 9,4 8,2 1,7Arachide 98,9 143,4 206,3 202,9Igname 36,5 12,9 41,7 36,3Patate 16,2 15,0 16,1 11,2Niébé 9,3 16,0 245,9 79,7F<strong>on</strong>io 14,4 13,6 22,5 16,7Wo<strong>and</strong>zou 33,6 30,0 46,1 40,4- Besoins céréaliers de la populati<strong>on</strong>BESOINS 1991 1992 1993 1994 1995 1996Besoins/Tête/Kg 190 190 190 190 190 190Besoins (Milliers/t) 1762,1 1810,3 1860,1 1911,7 1965,3 2020,4Producti<strong>on</strong> disp<strong>on</strong>ible (millier/t) 2075,1 2091,6 2157,1 2099,5 1936,6 2054,6Excédent (+) Déficit (-) Céréalier + 313 + 291 297 +187,8 - 22,7 + 34,2
963.Droit à la santéLe droit à la santé est l'un des droits f<strong>on</strong>damentaux de la pers<strong>on</strong>ne humaine sanslequel, le premier droit humain en l'occurrence le droit à la vie serait compromis. AuBurkina Faso, La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose à s<strong>on</strong> article 26 que « le droit à la santé estrec<strong>on</strong>nu. L'Etat oeuvre à le promouvoir ». L'article 18 stipule également que « ...lasanté, la protecti<strong>on</strong> de la maternité et de l'enfance, l'assistance aux pers<strong>on</strong>nesâgées ou h<strong>and</strong>icapées, aux cas sociaux, c<strong>on</strong>stituent des droits sociaux etculturels rec<strong>on</strong>nus par la présente C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> qui vise à les promouvoir ».Des mesures législatives et administratives s<strong>on</strong>t venues compléter le dispositifjuridique en matière du droit à la santé. En applicati<strong>on</strong> de ces mesures et pour faireface à la situati<strong>on</strong> sanitaire du pays, les autorités compétentes <strong>on</strong>t défini unepolitique sanitaire nati<strong>on</strong>ale d<strong>on</strong>t l'objectif principal est d'améliorer la santé et lebien être des populati<strong>on</strong>s.3.1. Situati<strong>on</strong> sanitaire nati<strong>on</strong>ale.La situati<strong>on</strong> sanitaire du Burkina Faso se caractérise par une morbidité et unemortalité générales élevées imputables en gr<strong>and</strong>e partie aux maladies infectieuses etparasitaires d<strong>on</strong>t le fort potentiel de transmissi<strong>on</strong> est lié à un envir<strong>on</strong>nementphysique hostile c<strong>on</strong>jugué à l'absence d'un minimum de c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s d'hygiène del'eau et du milieu. De plus certains comportements et habitudes de vie renforcentl'impact de ces maladies qui se développent sur un terrain souvent fragilisé par lamalnutriti<strong>on</strong>. Des facteurs défavorables c<strong>on</strong>tribuent à perpétuer cette situati<strong>on</strong>, enparticulier l'analphabétisme, l'insécurité alimentaire, le manque d'eau potable.Les principaux indicateurs sanitaires s<strong>on</strong>t les suivants :• Mortalité maternelle : 566 pour 100.000 naissances vivantes (1994).• Mortalité infantile : 93,7 pour mille (1993).• Mortalité générale : 17,5 pour mille (1995).• Espérance de vie à la naissance : 52,2 ans (1991).• Couverture prénatale : 45,9% (1994).
97• Couverture obstétricale : 26,8% (1994).• Couverture vaccinale infantile : 45% (1995).En 1995, le Burkina Faso disposait de 921 formati<strong>on</strong>s sanitaires comprenant dehaut en bas :• 2 Centres Hospitaliers Nati<strong>on</strong>aux (CHN) ;• 9 Centres Hospitaliers Régi<strong>on</strong>aux (CHR) ;• 16 Centres Médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) sur 43 prévus ;• 59 Centres Médicaux (CM) d<strong>on</strong>t certains s<strong>on</strong>t à transformer en CMA ;• 686 Centres de Santé et de Promoti<strong>on</strong> Sociale (CSPS) ;• 134 dispensaires isolés et 14 maternités isolées.Le ray<strong>on</strong> d'acti<strong>on</strong> moyen théorique des formati<strong>on</strong>s sanitaires était de 10,1 km en1994. Le nombre d'habitants par unité de pers<strong>on</strong>nel médical était en 1994, de 1médecin pour 29.666 habitants, 1 sage-femme pour 28.233 habitants, et 1infirmier d'Etat pour 10.993 habitants.3.2. La politique sanitaire nati<strong>on</strong>ale.Le Burkina Faso a adopté depuis 1979 la stratégie des soins de santé primairecomme base de sa politique sanitaire. Ce choix se justifie par les principessuivants :• La santé est un droit f<strong>on</strong>damental de l'être humain ;• L'équité, la justice sociale et la solidarité doivent guider les choix en matière desanté ;• Tout être humain a le droit et le devoir de participer individuellement etcollectivement à la planificati<strong>on</strong> et à la mise en oeuvre des soins de santé quilui s<strong>on</strong>t destinés ;• L'accès de tous aux soins de santé curatifs et préventifs doit être facilité ;• Le droit à l'informati<strong>on</strong> en matière de santé.A partir de 1993, Le Gouvernement a adopté l'approche de l'Initiative de Bamakoafin de revitaliser les formati<strong>on</strong>s sanitaires périphériques et améliorer ainsi l'accès à
98des soins de qualité pour les communautés de base, notamment les femmes et lesenfants.3.3. Les stratégies et programmes mis en oeuvre.3.3.1. La réorganisati<strong>on</strong> du système de santé.Elle s'est traduite par la révisi<strong>on</strong> du Code de la Santé Publique, la créati<strong>on</strong> de 53districts sanitaires, de 11 régi<strong>on</strong>s sanitaires et d'une Cellule d'Appui à laDécentralisati<strong>on</strong> du Système de Santé (CADSS) par les textes suivants :• Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé Publique ;• Arrêté n°93-146/SASF/SG du 30 novembre 1993 portant organisati<strong>on</strong>,attributi<strong>on</strong>s et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement des districts sanitaires ;• Arrêté n°94-191/MS/SG du 12 août 1994 portant créati<strong>on</strong> d'une Celluled'Appui à la Décentralisati<strong>on</strong> du Système de Santé (CADSS) ;• Décret n°96-234/PRES/PM/MS du 03 juillet 1996 portant organisati<strong>on</strong> duMinistère de la Santé.• Arrêté n°96-195/MS/CAB du 08 août 1996 portant organisati<strong>on</strong> desDirecti<strong>on</strong>s régi<strong>on</strong>ales de la Santé.Le district sanitaire est le niveau opérati<strong>on</strong>nel de planificati<strong>on</strong> et de mise en oeuvredes programmes de santé, t<strong>and</strong>is que la régi<strong>on</strong> sanitaire est le niveau intermédiairede coordinati<strong>on</strong> des politiques et programmes de santé.Cette réorganisati<strong>on</strong> a pour but d'offrir des soins de qualité à l'ensemble desburkinabé en favorisant l'aut<strong>on</strong>omie de gesti<strong>on</strong> des formati<strong>on</strong>s sanitaires, laparticipati<strong>on</strong> communautaire, l'accessibilité géographique et financière aux soins desanté.Cette réorganisati<strong>on</strong> du système de santé s'est traduite également par :• Une améliorati<strong>on</strong> de la couverture sanitaire grâce à un vaste programme dec<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> de formati<strong>on</strong>s sanitaires (CHR, CMA, CSPS, Dépôtspharmaceutiques) ;• une augmentati<strong>on</strong> des effectifs des écoles de formati<strong>on</strong> du pers<strong>on</strong>nel desanté ;
99• un redéploiement du pers<strong>on</strong>nel de santé en 1994 sur la base de la Décisi<strong>on</strong>n°93-304/SASF/SG du 18 octobre 1993 portant normes minimales depers<strong>on</strong>nel des Formati<strong>on</strong>s Sanitaires Périphériques et des Directi<strong>on</strong>sProvinciales de la Santé (DPS).Cependant, cette décentralisati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>naît des difficultés liées aux c<strong>on</strong>traintesinstituti<strong>on</strong>nelles et politico-administratives que le Gouvernement s'attache à leverdans le cadre du processus général de décentralisati<strong>on</strong> en cours dans le pays.3.3.2. Les programmes de protecti<strong>on</strong> des groupes vulnérables.Compte tenu de la précarité de l'état de santé des groupes vulnérables que s<strong>on</strong>t lesfemmes, les adolescents et les jeunes, les travailleurs, le Ministère de la Santé amis en place des programmes spécifiques de protecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> de cesgroupes :• Programme Elargi de Vaccinati<strong>on</strong> (PEV).• Santé de la Reproducti<strong>on</strong> (SR).• Lutte c<strong>on</strong>tre le SIDA et les MST.• Lutte c<strong>on</strong>tre la tuberculose.• Lutte c<strong>on</strong>tre les maladies diarrhéiques et infecti<strong>on</strong>s respiratoires.• Lutte c<strong>on</strong>tre le paludisme.• Santé du travail.• Etc.Pour palier à la verticalité de ces programmes, un effort d'intégrati<strong>on</strong> des activitésest fait au niveau des plans d'acti<strong>on</strong>s des districts sanitaires et surtout dansl'ensemble des formati<strong>on</strong>s sanitaires à travers le Paquet Minimum d'Activités(PMA).3.3.3. La reforme hospitalière.Une réforme du secteur hospitalier a été mise en oeuvre et a aboutit à l'adopti<strong>on</strong>récente de la loi hospitalière qui vise l'améliorati<strong>on</strong> du f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nements deshôpitaux publics et de leur impact sur la santé des populati<strong>on</strong>s. Cette loi comporte
100un important volet relatif au droit des malades.3.3.4. La politique pharmaceutique.Cette politique est basée sur les médicaments essentiels préc<strong>on</strong>isés par l'OMS.Elle a comporté la définiti<strong>on</strong> d'une liste nati<strong>on</strong>ale de médicaments essentiels parniveau de soins, la créati<strong>on</strong> de la Centrale d'Approvisi<strong>on</strong>nement en MédicamentsEssentiels Génériques (CAMEG) par Décret n°92-127/PRES/PM/MSASF du 21 mai1992, la mise en place d'un réseau de distributi<strong>on</strong> des Médicaments EssentielsGénériques par la créati<strong>on</strong> des dépôts dans les districts et toutes les formati<strong>on</strong>ssanitaires.Elle a c<strong>on</strong>sisté également en la promoti<strong>on</strong> du secteur sanitaire privé par :• la suppressi<strong>on</strong> ou la diminuti<strong>on</strong> des taxes douanières sur les produitspharmaceutiques ;• l'autorisati<strong>on</strong> accordée aux pharmaciens d'officine du secteur privé deposséder plusieurs dépôts pharmaceutiques par Arrêté n°94-081/SASF/SG/DSPH du 11 mai 1994.En outre, le Gouvernement a mis en place à partir de 1996, un approvisi<strong>on</strong>nementspécial de tous les hôpitaux dans le pays en médicaments dans le cadre des soinsd'urgences des pers<strong>on</strong>nes démunies. Cette importante dotati<strong>on</strong> est prévue aubudget de l'Etat et renouvelée chaque année.3.3.5. La lutte c<strong>on</strong>tre les épidémies.Suite à la survenue périodique d'épidémies meurtrières de méningite cérébrospinale,de rougeole et de choléra, le Gouvernement a adopté un plan nati<strong>on</strong>al delutte c<strong>on</strong>tre les épidémies et a créé un F<strong>on</strong>ds Nati<strong>on</strong>al de Lutte c<strong>on</strong>tre les Epidémies(FONALEP). Ce plan accorde une place de choix à la surveillance épidémiologique, àla formati<strong>on</strong> du pers<strong>on</strong>nel de la santé impliqué dans la lutte c<strong>on</strong>tre les épidémies, àla promptitude de la réacti<strong>on</strong> en cas d'épidémie et à la collaborati<strong>on</strong> intersectorielle.
1013.3.6. La lutte c<strong>on</strong>tre le SIDA et les MST.L'appariti<strong>on</strong> du SIDA a justifié que le Gouvernement élabore une stratégie visant àc<strong>on</strong>trôler ce fléau et à réduire l'incidence des MST. Un programme nati<strong>on</strong>al etmultisectoriel de lutte c<strong>on</strong>tre le SIDA et les MST a été élaboré et placé sousl'autorité d'un Comité Nati<strong>on</strong>al de Lutte c<strong>on</strong>tre le SIDA (CNLS) d<strong>on</strong>t le SecrétariatPermanent c<strong>on</strong>stitue l'organe de gesti<strong>on</strong>.Ce programme vise essentiellement :• l'éducati<strong>on</strong> des populati<strong>on</strong>s et particulièrement les groupes exposés à desrisques de c<strong>on</strong>taminati<strong>on</strong> afin qu'ils adoptent des comportements susceptiblesd'arrêter la transmissi<strong>on</strong> du VIH et des MST ;• le renforcement de la sécurité transfusi<strong>on</strong>nelle ;• l'améliorati<strong>on</strong> de la prise en charge médicale et sociale des cas de malades duSIDA ;• le renforcement de la surveillance épidémiologique et de la recherche en vued'un meilleur c<strong>on</strong>trôle des MST et du SIDA.3.4. Perspectives.Au regard de l'analyse de la situati<strong>on</strong> et des c<strong>on</strong>traintes identifiées au niveau desdifférents programmes, les objectifs spécifiques <strong>on</strong>t été fixés pour l'horiz<strong>on</strong> 2000 :• Réduire le taux brut de mortalité de 17,5 à 14,1 pour mille.• Réduire le taux de mortalité infantile de 93,7 à 70 pour mille.• Réduire le taux de mortalité maternelle de 566 à 300 pour 100.000naissances vivantes.• Réduire le taux de malnutriti<strong>on</strong> modérée et sévère chez les enfants de 0 à 5ans de 30 à 15%.Pour le l<strong>on</strong>g terme, une nouvelle Politique Sanitaire Nati<strong>on</strong>ale (PSN) et un Plan deDéveloppement Sanitaire Nati<strong>on</strong>al (PDSN) pour la période 2000-2010, s<strong>on</strong>tactuellement en cours d'élaborati<strong>on</strong>.
1024. Droit au logementUn des droits de la pers<strong>on</strong>ne humaine qui semble être le mieux promu au Burkina,surtout du point de vue quantitatif, est le droit au logement. La promoti<strong>on</strong> de cedroit fut l<strong>on</strong>gtemps assurée par les populati<strong>on</strong>s elles-mêmes, sans c<strong>on</strong>coursextérieur. Mais avec l'urbanisati<strong>on</strong> sans cesse croissante, le problème du logementse pose désormais au Burkina. Aussi l'Etat et certaines pers<strong>on</strong>nes physiques oumorales, c<strong>on</strong>tribuent-t-ils à la promoti<strong>on</strong> du droit au logement.Au Ministère des Infrastructures, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le logement en tantque cadre de vie de l'individu mérite une attenti<strong>on</strong> particulière. Mais les difficultéspar les populati<strong>on</strong>s pour se loger, notamment dans les centres urbains, <strong>on</strong>t amenéles pouvoirs publics et le Ministère technique à prendre un certain nombre demesures et d'actes qui s'imposent :• Neuf (9) schémas d'aménagement urbain élaborés pour les villes deOuagadougou, Fada Ngourma, Gaoua, Bobo Dioulasso, Dedougou, Kaya, Léo,Nouna Ouahigouya s<strong>on</strong>t en cours d'exécuti<strong>on</strong> ;• 120.000 parcelles envir<strong>on</strong> <strong>on</strong>t été distribuées entre 1983 et 1988 ;• 3.200 logements <strong>on</strong>t été c<strong>on</strong>struits entre 1983 et 1989.Malgré tous ces efforts louables fournis, beaucoup reste à faire, notamment dansles centres urbains de l'an 2000 d<strong>on</strong>t Ouagadougou et Bobo Dioulasso quicompter<strong>on</strong>t respectivement 1.800.000 et 1.100.000 habitants.Au Burkina Faso le secteur de l'habitat a été retenu comme l'un des facteurs dedéveloppement dans la mesure où il c<strong>on</strong>stitue un champ de régulati<strong>on</strong> important deplus en plus développé avec une dimensi<strong>on</strong> financière particulièrement importante.4.1. Mesures juridiques en faveur du droit au logement.Des mesures <strong>on</strong>t été prises pour amoindrir certaines difficultés que c<strong>on</strong>naît lesecteur de l'habitat. Il s'agit :• Décret n° 84-203/CNR/PRES/ISMEC du 1/6/1984 déterminant le cadrejuridique de « l'opérati<strong>on</strong> lotissement ville de Ouagadougou » et les c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s
103d'octroi et jouissance des parcelles issues de ladite opérati<strong>on</strong>.• RAABO n° 47/CNR/ME/MATS du 13/2/1987, fixant la réglementati<strong>on</strong> desautorisati<strong>on</strong>s de c<strong>on</strong>struire dans les centres aménagés du Burkina Faso.• ARRETE CONJOINT n° 92-0036/TPHU/AT/EAU du 17/12/1992 portantcréati<strong>on</strong>, attributi<strong>on</strong> et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement d'une unité technique de coordinati<strong>on</strong>du projet « Améliorati<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de vie urbaine ».• ARRETE n° 94-20/MAT/PKAD/HC/SG/DE/DA/SAS du 29/08/1994 portantcréati<strong>on</strong> d'un comité provincial de sensibilisati<strong>on</strong> sur la salubrité etl'assainissement du Kadiogo.Au niveau des z<strong>on</strong>es rurales, les types de cultures, les systèmes de producti<strong>on</strong>traditi<strong>on</strong>nelle dans le c<strong>on</strong>texte d'une forte croissance démographique avec un tauxd'occupati<strong>on</strong> du sol dépassant les possibilités d'accueil des terroirs en agriculturetraditi<strong>on</strong>nelle <strong>on</strong>t été pris en compte par la réorganisati<strong>on</strong> agraire et f<strong>on</strong>cière auBurkina Faso.4.2. Mesures éc<strong>on</strong>omiques et sociales en faveur du droit au logement.Sur le plan financier instituti<strong>on</strong>nel du Burkina, les banques et f<strong>on</strong>ds de l'habitat nefinancent qu'une très petite part des investissements dans les logements.Les financements du logement s'effectue d<strong>on</strong>c essentiellement sel<strong>on</strong> de modalitésinformelles, mais tous les besoins en croissance rapide en milieu urbain s<strong>on</strong>t loind'être couverts.Dans cet envir<strong>on</strong>nement éc<strong>on</strong>omique et instituti<strong>on</strong>nel peu favorable, les caissespopulaires, coopératives d'épargne et crédit développées initialement en milieu ruralc<strong>on</strong>naissent actuellement une croissance rapide en milieu urbainDésireuses de développer les services financiers offerts, elle pourraient permettred'augmenter progressivement et solidement les échelles de solidarité financière etc<strong>on</strong>tribuer à l'améliorati<strong>on</strong> du financement de l'habitat urbain.Ainsi, entre 1993 et 1994, plus de cinq caisses f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nent à Ouagadougou etune à Bobo Dioulasso et s<strong>on</strong>t toutes régies par des textes en vigueur qui s<strong>on</strong>t• KITI n° 86-060/CNR/PRES du 18/02/1986 portant créati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> et
109f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement d'un f<strong>on</strong>ds de l'habitat au Burkina Faso ;• KITI n° AN VI 027/FP/EQUIP/SEHU du 8/05/1989 portant créati<strong>on</strong> du f<strong>on</strong>dsde l'habitat en établissement public à caractère administratif.Sur le plan social, la politique du Gouvernement est orientée sur l'accessibilité dulogement pour tous, même si les programmes et les projets sur le logementvalorisent les catégories éc<strong>on</strong>omiquement faibles, tels que les f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nairesmoyens, les secteurs structurés et les m<strong>on</strong>oparentaux pauvres.Malgré ces difficultés qui s'imposent dans le secteur du logement, le Gouvernementa lancé un défi qui c<strong>on</strong>siste à passer nécessairement par la maîtrise de la croissancede la populati<strong>on</strong> urbaine et par une politique équilibrée de l'aménagement duterritoire pour que, à l<strong>on</strong>g terme, tout Burkinabé aie un logement.5. Stratégie de lutte c<strong>on</strong>tre les calamités naturelles.Les gr<strong>and</strong>es sécheresses des années 1970 et 1980 <strong>on</strong>t eu des répercussi<strong>on</strong>snéfastes sur les populati<strong>on</strong>s, l'agriculture, la santé et le logement. Récemmentencore en 1992-1994, le Burkina Faso a fortement souffert des in<strong>on</strong>dati<strong>on</strong>scatastrophiques. Depuis lors, les catastrophes naturelles c<strong>on</strong>stituent unepréoccupati<strong>on</strong> pour les autorités politiques nati<strong>on</strong>ales. C'est à ce titre qu'un ComitéNati<strong>on</strong>al de Secours d'Urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong> a été créé en mars 1993 ; il apour missi<strong>on</strong>s :• L'élaborati<strong>on</strong> et la mise en oeuvre d'un Plan Nati<strong>on</strong>al de Secours d'Urgence etde Réhabilitati<strong>on</strong>,• La définiti<strong>on</strong>, la planificati<strong>on</strong> et la coordinati<strong>on</strong> des activités et tâches ayantpour objectifs de réduire les effets des calamités naturelles sur le plan nati<strong>on</strong>al,• L'organisati<strong>on</strong>, la coordinati<strong>on</strong>, le suivi et l'évaluati<strong>on</strong> des interventi<strong>on</strong>snati<strong>on</strong>ales et/ou extérieures tendant à atténuer les effets des calamitésnaturelles et à réhabiliter les populati<strong>on</strong>s des z<strong>on</strong>es sinistrées ,• La formati<strong>on</strong> du pers<strong>on</strong>nel,• L'informati<strong>on</strong> et la sensibilisati<strong>on</strong> des populati<strong>on</strong>s sur les attitudes à observeren cas de sinistres.• Le CONASUR est démembré à l'échel<strong>on</strong> provincial (COPROSUR),
105départemental (CODESUR), et villageois (COVISUR).Au regard de ses attributi<strong>on</strong>s ci-dessus citées, le CONASUR a mené et c<strong>on</strong>tinue demener des acti<strong>on</strong>s qui c<strong>on</strong>tribuent à la promoti<strong>on</strong> des droits humains essentiels.Avec la survenance des catastrophes naturelles ou anthropiques, les individus et lescommunautés ne s<strong>on</strong>t plus en mesure de satisfaire leurs besoins f<strong>on</strong>damentaux telsl'alimentati<strong>on</strong>, la santé et le logement.Le CONASUR a mobilisé à cet effet les moyens nécessaires pour aider les sinistrésà y faire face. Au titre des acti<strong>on</strong>s récentes, <strong>on</strong> peut citer entre autres :• 1991: Mobilisati<strong>on</strong> et distributi<strong>on</strong> de plus de 50.000 t<strong>on</strong>nes d'aidesalimentaires (céréales) aux populati<strong>on</strong>s des provinces déficitaires.• 1993 : Remise en état des infrastructures socio-éc<strong>on</strong>omiques (barrages,écoles, périmètres agricoles) endommagées. A titre d'exemple, 400.000.000de francs <strong>on</strong>t été débloqués pour les in<strong>on</strong>dati<strong>on</strong>s de 1992.• 1993-1994 : Mobilisati<strong>on</strong> et distributi<strong>on</strong> de 14.000 t<strong>on</strong>nes d'aidesalimentaires (céréales) aux populati<strong>on</strong>s sinistrées des provinces du plateaucentral, du Nord et de l'Est du pays.• 1996: Distributi<strong>on</strong> de 14.000 t<strong>on</strong>nes d'aides alimentaires aux sinistrés de 19provinces.• 1998: Distributi<strong>on</strong> de 13.000 t<strong>on</strong>nes de céréales aux populati<strong>on</strong>s sinistrés de28 provinces.• Mobilisati<strong>on</strong>, chaque année, d'importants matériels de survie (tentes,couvertures nattes) en faveur des victimes d'in<strong>on</strong>dati<strong>on</strong>s et d'incendies.Ces différentes interventi<strong>on</strong>s <strong>on</strong>t permis de sauvegarder certains droitsf<strong>on</strong>damentaux de ces populati<strong>on</strong>s qui se trouvaient dans des situati<strong>on</strong>s dedésolati<strong>on</strong>.La lutte c<strong>on</strong>tre les calamités naturelles a nécessité la mobilisati<strong>on</strong> de la solidariténati<strong>on</strong>ale par la créati<strong>on</strong> :D'une Caisse de Solidarité Nati<strong>on</strong>ale instituée en Mars 1990 et qui est chargée de :• mobiliser, coord<strong>on</strong>ner et gérer, dans le cadre de la politique sociale du
106Gouvernement, des ressources provenant de l'élan de solidarité nati<strong>on</strong>ale etinternati<strong>on</strong>ale,• susciter et promouvoir, par des acti<strong>on</strong>s de sensibilisati<strong>on</strong>, l'élan de solidariténati<strong>on</strong>ale,• appuyer les groupes sociaux défavorisés,• appuyer les populati<strong>on</strong>s victimes des catastrophes et calamités, notammentles victimes du déficit céréalier à travers le CONASUR,• appuyer la mise en oeuvre des projets et programmes de développement duGouvernement, en faveur des groupes défavorisés,• appuyer et susciter l'entraide mutuelle et un esprit fraternel entre lesBurkinabé, au service de leur communauté, de leur pays et du m<strong>on</strong>de entier.La Caisse de Solidarité Nati<strong>on</strong>ale est un instrument très souple, permettant auGouvernement d'intervenir rapidement et efficacement dans les situati<strong>on</strong>s difficileset urgentes.L'<strong>on</strong> perçoit alors aisément l'interdépendance entre la Caisse de Solidarité Nati<strong>on</strong>aleet le Comité Nati<strong>on</strong>al de Secours d'urgence et de Réhabilitati<strong>on</strong>, le sec<strong>on</strong>dbénéficiant des appuis financiers de la première.D'une manière générale, toutes les acti<strong>on</strong>s menées par la Caisse de Solidarité visentà assurer la survie et la protecti<strong>on</strong> des droits de l'homme. La Caisse de Solidaritétravaille en étroite collaborati<strong>on</strong> avec le CONASUR.IV. FAMILLE ET PROTECTION DES GROUPES SOCIAUX SENSIBLES.1. Stratégies de protecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> sociales de l'enfantL'objectif global dans ce sous secteur est d'assurer le mieux être etl'épanouissement des enfants en accordant une haute priorité aux droits desenfants à la survie, à leur protecti<strong>on</strong> et à leur développement, respectant ainsi « lesenfants d'abord ».Dans ce sous secteur, il a été élaboré un plan d'acti<strong>on</strong> nati<strong>on</strong>al pour la survie, laprotecti<strong>on</strong> et le développement de l'enfant au Burkina Faso pour les années 1990.
107Ce plan a fait l'objet d'une évaluati<strong>on</strong> en février 1996, afin de s'assurer que lesobjectifs intermédiaires fixés pour 1995 <strong>on</strong>t été atteints. Ce plan c<strong>on</strong>stitue le cadrede référence des acti<strong>on</strong>s qui se mènent ou se mèneraient autour de l'améliorati<strong>on</strong>de la situati<strong>on</strong> des enfants au Burkina Faso.Les programmes misent en oeuvre c<strong>on</strong>cerne :1.1.L'éducati<strong>on</strong> préscolaire par la créati<strong>on</strong> de structures préscolaires (garderiespopulaires, jardins d'enfants) afin de favoriser l'éveil psychomoteur et intellectuelainsi que la socialisati<strong>on</strong> des enfants de 3 à 6 ans.L'objectif spécifique du Gouvernement est de faire passer le taux depréscolarisati<strong>on</strong> de 0,7% à 2,4% en l'an 2000.Aujourd'hui, <strong>on</strong> compte 78 garderies populaires et 74 jardins d'enfants privés.Dans ce cadre, il est envisagé la mise en place de structures de garded'enfants n<strong>on</strong> formelles qui ser<strong>on</strong>t gérées par les représentants de lacommunauté et permettr<strong>on</strong>t de libérer les fillettes de la garde d'enfants etfaciliter ainsi leur scolarisati<strong>on</strong>.1.2. La sauvegarde de l'enfant en danger à travers le placement en instituti<strong>on</strong>, leplacement familial, le parrainage, l'adopti<strong>on</strong> simple ou plénière par une famille :160 enfants <strong>on</strong>t été adoptés entre 1991 et 1998.160 enfants <strong>on</strong>t été parrainés en 1998, mais des efforts restent à faire car trèspeu de familles se portent vol<strong>on</strong>taires.1.3. La mise en place du service social scolaire.Il s'agit ici de :• l'organisati<strong>on</strong> des activités socio-éducatives extra-scolaires, tellesque : col<strong>on</strong>ies de vacances, clubs de vacances, en vue de favoriserl'épanouissement des élèves pendant les vacances et prévenir la délinquancejuvénile.• l'appui en fournitures scolaires pour les élèves en situati<strong>on</strong> difficile (cassociaux) par la recherche de parrainageEnfin, il faut noter que dans le cadre de la protecti<strong>on</strong> des droits de l'enfant, le
108Burkina Faso a ratifié et adopté différents textes. Ce s<strong>on</strong>t entre autres :Au plan internati<strong>on</strong>al :• C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> relative aux Droits de l'Enfant ratifiée le 23/07/1990• Charte Africaine des Droits et du Bien-être des enfants ratifiée le 03/06/1992• C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> sur la Protecti<strong>on</strong> des Enfants et la Coopérati<strong>on</strong> en matièred'Adopti<strong>on</strong> Internati<strong>on</strong>ale ratifiée le 27/04/1993• C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> sur les Aspects Civils de l'Enlèvement Internati<strong>on</strong>al d'Enfantsratifiée le 04/03/1992• Au plan nati<strong>on</strong>al :. La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du 2 Juin 1991. Le Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la FamilleLe décret N°290/PRES-ET du 17 Juillet 1962 portant mesures préventivesrelatives à l'enfance et la circulati<strong>on</strong> des mineurs.. Le décret N° AN VI-01103/FP/M/J du 1-12-1988 portant organisati<strong>on</strong>, régime etréglementati<strong>on</strong> des établissements pénitentiaires. Le Kiti N°AN VII-0319/FP/SAN-AS du 18-06-1990 portant placement et suivid'enfants.• Le Kiti N° AN VII-0519/FP/SAN-AS/SEAS du 18 mai 1990 réglementant lessorties des enfants au Burkina Faso.2. Stratégies de promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique et de protecti<strong>on</strong> juridique de la femmeDans le domaine de la promoti<strong>on</strong> de la femme, l'objectif est d'assurer laparticipati<strong>on</strong> effective des femmes au processus de développement, en favorisantleur accès aux moyens de producti<strong>on</strong> et en améliorer leur statut social.A ce titre, il faut souligner la créati<strong>on</strong> d'un Ministère de la Promoti<strong>on</strong> de la Femme(MPF) par décret N°97-270 du 10 juin 1997, chargé de mettre en oeuvre lapolitique du Gouvernement en matière de promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique de leFemme, en relati<strong>on</strong> avec les autres Départements ministériels et Instituti<strong>on</strong>sc<strong>on</strong>cernées. Ce Ministère a l'initiative et la resp<strong>on</strong>sabilité de :• suivre les programmes d'éducati<strong>on</strong> et de formati<strong>on</strong> des femmes et des jeunesfilles,
109• promouvoir l'égalité des droits des femmes et leurs droits à la santé de laréproducti<strong>on</strong>,• informer et sensibiliser sur les droits des femmes,• coord<strong>on</strong>ner les acti<strong>on</strong>s en faveur de la femme auprès des partenaires et desstructures c<strong>on</strong>cernées,• suivre et évaluer l'impact des acti<strong>on</strong>s des ONG et Associati<strong>on</strong>s Féminines.2.1. Promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique de la femmeLa stratégie adoptée porte sur la réalisati<strong>on</strong> de c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s favorables à la créati<strong>on</strong>d'activités génératrices de revenus notamment à travers :• l'alphabétisati<strong>on</strong> et la formati<strong>on</strong> technique des femmes,• l'allégement des tâches domestiques,• l'accès au crédit,• l'accès aux techniques appropriées,• l'organisati<strong>on</strong> des femmes en structures pré-coopératives et associatives.Au titre des acti<strong>on</strong>s entreprises sur le plan nati<strong>on</strong>al, il faut citer entre autres :• l'adopti<strong>on</strong> en décembre 1991 des Stratégies Nati<strong>on</strong>ales et le Plan d'Acti<strong>on</strong>(1991-1995) pour le renforcement du rôle des femmes dans le processus dudéveloppement,• l'adopti<strong>on</strong> d'une politique nati<strong>on</strong>ale de promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique de lafemme,• la mise en place du F<strong>on</strong>ds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes(FAARF), en vue de favoriser un plus large accès des femmes aux crédits. LeMinistère de l'Acti<strong>on</strong> Sociale et de la Famille a été chargé par leGouvernement, d'appuyer à travers ses structures périphériques, ladécentralisati<strong>on</strong> des activités du FAARF,• la mise en place des programmes d'Educati<strong>on</strong> à la Vie Familiale (E.V.F) afind'aider les femmes à améliorer la gesti<strong>on</strong> des ressources familiales etl'organisati<strong>on</strong> de leurs tâches domestiques, y compris l'allégement de leurstâches.
110Il faut souligner qu'en plus du Ministère de la Promoti<strong>on</strong> de la Femme, plusieursautres départements Ministériels <strong>on</strong>t mis en place des mécanismes de promoti<strong>on</strong>féminine. On citera en particulier :• le Ministère de l'Acti<strong>on</strong> Sociale et de la Famille,• le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales (MARA) qui a créedepuis 1998, des Bureaux de Promoti<strong>on</strong> des Activités des Femmes (BPAF) ausein des Centres Régi<strong>on</strong>aux de Promoti<strong>on</strong> Agro-Pastorale (CRPA). Ces bureaux<strong>on</strong>t pour vocati<strong>on</strong> la formati<strong>on</strong>, la promoti<strong>on</strong> des activités de transformati<strong>on</strong>et de commercialisati<strong>on</strong> des produits locaux.• le Ministère de l'Eau, de l'Envir<strong>on</strong>nement et du Tourisme ; ce Ministère àtravers le Plan d'Acti<strong>on</strong> pour l'Envir<strong>on</strong>nement, accorde une large place à lapromoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique des femmes dans les différentes z<strong>on</strong>es socioéc<strong>on</strong>omiques.L'acti<strong>on</strong> des structures gouvernementales est complétée et renforcée par celle desONG et associati<strong>on</strong>s féminines oeuvrant pour la promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique de laFemme.2.2. Stratégies de protecti<strong>on</strong> juridique de la femmeEn vue d'assurer à la femme n<strong>on</strong> seulement l'avoir, à travers sa promoti<strong>on</strong>éc<strong>on</strong>omique, mais également l'être, le Gouvernement a pris de nombreuses mesuresvisant à protéger s<strong>on</strong> intégrité morale et physique, ainsi que ses intérêts matérielsaux plans familial, professi<strong>on</strong>nel et dans le domaine f<strong>on</strong>cier.Les stratégies de protecti<strong>on</strong> juridique adoptées s<strong>on</strong>t essentiellement basées sur :• des programmes de sensibilisati<strong>on</strong>, d'éducati<strong>on</strong> des populati<strong>on</strong>s sur lalégislati<strong>on</strong> en faveur des femmes et de la famille ;• la diffusi<strong>on</strong> des droits de la femme et de la famille par la traducti<strong>on</strong> et lavulgarisati<strong>on</strong> du Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille en langues nati<strong>on</strong>ales. Acet effet un projet a démarré en 1995.• l'orientati<strong>on</strong> des femmes vers les autres instituti<strong>on</strong>s compétentes en matièrede protecti<strong>on</strong> juridique.• l'interdicti<strong>on</strong> du mariage forcé, du lévirat et de la dot comme aspects néfastes
111des règles coutumières. Ainsi, les nouvelles dispositi<strong>on</strong>s du Code desPers<strong>on</strong>nes et de la Famille interdisent aux articles 240 le mariage forcée et244, le versement d'une dot.• La ratificati<strong>on</strong> de la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> sur les droits politiques de la femme.• La ratificati<strong>on</strong> de la C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> internati<strong>on</strong>ale sur l'éliminati<strong>on</strong> de toutes lesformes de discriminati<strong>on</strong> à l'égard des femmes.2.2.1. Le mariage f<strong>on</strong>dé sur le c<strong>on</strong>sentement des c<strong>on</strong>joints.L'article 23 de la Charte prévoit que le mariage est f<strong>on</strong>dé sur le libre c<strong>on</strong>sentementde l'homme et de la femme.Dans le c<strong>on</strong>texte social burkinabé ce principe n'est pas toujours respecté. Lapratique du mariage forcé a toujours lieu au niveau de certaines couches sociales ouest tolérée par certaines religi<strong>on</strong>s ou coutumes.L'article 376 du code pénal qui punit d'un empris<strong>on</strong>nement de 6 mois à 2 ansquic<strong>on</strong>que c<strong>on</strong>traint une pers<strong>on</strong>ne au mariage, c<strong>on</strong>tribue à lutter c<strong>on</strong>tre cettepratique qui viole les droits de la femme en particulier.La peine est de six mois à deux ans d'empris<strong>on</strong>nement lorsque la pers<strong>on</strong>nec<strong>on</strong>trainte est majeure.L'empris<strong>on</strong>nement est porté à trois ans qu<strong>and</strong> la victime est mineure.Le maximum de la peine est encourue si la victime est une fille mineure de moins detreize ans.Enfin cet article dispose que quic<strong>on</strong>que c<strong>on</strong>tracte ou favorise ce mariage estcomplice.L'article 379 du code pénal réprime n<strong>on</strong> seulement la pers<strong>on</strong>ne qui exige une dot,mais ainsi celle qui l'accepte.Le code des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille reprend le principe du libre c<strong>on</strong>sentement ens<strong>on</strong> article 234: « le mariage résulte de la vol<strong>on</strong>té libre et c<strong>on</strong>sciente de l'homme etde la femme de se prendre pour époux.
112En c<strong>on</strong>séquence s<strong>on</strong>t interdits :• les mariages forcés, particulièrement les mariages imposés par les familles etceux résultant des règles coutumières qui f<strong>on</strong>t l'obligati<strong>on</strong> au c<strong>on</strong>jointsurvivant d'épouser l'un des parents du défunt ;• les empêchements ou oppositi<strong>on</strong>s au mariages en rais<strong>on</strong> de la caste, de lacouleur ou de la religi<strong>on</strong> ».Ces dispositi<strong>on</strong>s rejettent le mariage forcé et le lévirat.En outre est banni la pratique qui persiste encore dans certaines régi<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>sistantà interdire le mariage entre les pers<strong>on</strong>nes appartenant à des castes différentes.Afin de s'assurer que chacun des c<strong>on</strong>joints a d<strong>on</strong>né effectivement s<strong>on</strong>c<strong>on</strong>sentement pour l'uni<strong>on</strong>, qu'il n'a pas été c<strong>on</strong>traint au mariage, l'article 233 duCode des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille dispose qu'aucun effet n'est attaché auxformes d'uni<strong>on</strong>s autres que celles prévues au présent code notamment les mariagescoutumiers et les mariages religieux.Il ressort des termes de ce code que seul le mariage célébré par l'officier de l'étatcivil est légalement valable.2.2.2. La protecti<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tre l'excisi<strong>on</strong>.Les articles 380 à 382 du Code Pénal s<strong>on</strong>t relatifs aux mutilati<strong>on</strong>s génialesféminines. L'excisi<strong>on</strong> y est sévèrement réprimée.L'ancien Code pénal ne prévoyait pas cette infracti<strong>on</strong>. Les magistrats, pour lutterc<strong>on</strong>tre cette pratique visaient les faits de coups et blessures vol<strong>on</strong>taires et enparticulier l'article 329 relatif aux coups et blessures ayant entraîné l'amputati<strong>on</strong>.En réprimant l'excisi<strong>on</strong> le code pénal lutte c<strong>on</strong>tre cette violati<strong>on</strong> grave des droits dela femme qui est malheureusement encore rép<strong>and</strong>ue au Burkina Faso.Pour la protecti<strong>on</strong> de l'intégrité de la femme, un comité nati<strong>on</strong>al de lutte c<strong>on</strong>tre lapratique de l'excisi<strong>on</strong> a été créé en 1990. Le Comité nati<strong>on</strong>al est chargé de menerdes activités de sensibilisati<strong>on</strong> auprès de toutes les couches sociales du pays. Pour
113appuyer ces activités, des mesures répressives s<strong>on</strong>t prises dans le nouveau Codepénal adopté en novembre 1996 par l'Assemblée des Députés ; notamment en sesarticles 380, 381, 382. L'article 380 stipule que : « est puni d'un empris<strong>on</strong>nementde six mois à trois ans et d'une amende de 150.000 à 900.000 francs ou de l'unede ces deux peines seulement, quic<strong>on</strong>que porte ou tente de porter atteinte àl'intégrité de l'organe génital de la femme par ablati<strong>on</strong> totale, par excisi<strong>on</strong>, parinfibulati<strong>on</strong>, par insensibilisati<strong>on</strong> ou par tout autre moyen. Si la mort en est résultée,la peine est un empris<strong>on</strong>nement de cinq à dix ans ».Par ailleurs, des peines s<strong>on</strong>t prévues pour les coupables du corps médical ouparamédical et les complices, aux les articles 381 et 382.3. Stratégies de protecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> sociales des groupes défavorisésLes acti<strong>on</strong>s engagées en faveur des groupes défavorisés visent à créer desc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s favorables à leur réhabilitati<strong>on</strong> sociale et à leur inserti<strong>on</strong> éc<strong>on</strong>omique.Les groupes qui f<strong>on</strong>t l'objet d'une interventi<strong>on</strong> spécifique s<strong>on</strong>t : les pers<strong>on</strong>nesh<strong>and</strong>icapées, les jeunes de ou dans la rue, les pers<strong>on</strong>nes du troisième âge oupers<strong>on</strong>nes âgées, « les femmes en danger moral », les pers<strong>on</strong>nes en situati<strong>on</strong>particulièrement difficile.Les stratégies d'interventi<strong>on</strong> varient en f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> des groupes cibles et du degré deleur marginalisati<strong>on</strong>. Elles peuvent se résumer comme suit :• l'informati<strong>on</strong> et la sensibilisati<strong>on</strong> des populati<strong>on</strong>s sur les problèmes desgroupes défavorisés et sur leur resp<strong>on</strong>sabilité dans leur résoluti<strong>on</strong>,• l'encadrement dans des structures fermées ou sémi fermées ou ouvertes pourdes activités-éducatives et de producti<strong>on</strong>,• l'encadrement et le soutien aux activités génératrices de revenus,• les placements familiaux et/ou en apprentissage,• l'organisati<strong>on</strong> de cadres d'échange promoti<strong>on</strong>nel, notamment les journéesnati<strong>on</strong>ales• la participati<strong>on</strong> des différents groupes aux manifestati<strong>on</strong>s socio-éc<strong>on</strong>omiqued'envergure nati<strong>on</strong>ale.
114Parmi les acti<strong>on</strong>s entreprises ou en cours de réalisati<strong>on</strong> <strong>on</strong> peut citer au titre de :a - La protecti<strong>on</strong> et promoti<strong>on</strong> sociales des jeunes de/dans la rue.La protecti<strong>on</strong> et la promoti<strong>on</strong> sociale des jeunes de la rue s'est manifestée par :• Adopti<strong>on</strong> par le Gouvernement en 1993 des stratégies d'Acti<strong>on</strong>s Educativesen Milieu Ouvert (AEMO). Un projet exécuté à Ouagadougou permetd'encadrer envir<strong>on</strong> 484 jeunes de /dans la rue. Cette expérience seravulgarisée dans les autres provinces.• réhabilitati<strong>on</strong> et renforcement de deux centres fermés de rééducati<strong>on</strong>, d'unecapacité d'envir<strong>on</strong> 120 enfants chacun en vue de les rendre plus opérati<strong>on</strong>nelset performants• la mise à jour du fichier central des jeunes placés dans les instituti<strong>on</strong>sd'éducati<strong>on</strong> et de formati<strong>on</strong> professi<strong>on</strong>nelle.b - La protecti<strong>on</strong> et promoti<strong>on</strong> sociales des pers<strong>on</strong>nes h<strong>and</strong>icapéesLes autorités politiques du Burkina Faso <strong>on</strong>t adopté le 16 janvier 1986, la Zatu (loi)N°86-005/CNR/PRES du 16/1/1986 portant adopti<strong>on</strong> de mesures sociales enfaveur des pers<strong>on</strong>nes h<strong>and</strong>icapées afin de maximiser leur chance de participer à lavie de la nati<strong>on</strong>.Ces mesures couvrent les domaines de la santé, l'éducati<strong>on</strong>, le transport public, lesloisirs, l'envir<strong>on</strong>nement et la fiscalité.Est bénéficiaire des avantages sociaux, toute pers<strong>on</strong>ne h<strong>and</strong>icapée résidant auBurkina Faso et présentant une carte d'invalidité délivrée par le Ministère de laSanté, en collaborati<strong>on</strong> avec le Ministère de l'Acti<strong>on</strong> Sociale et de la Famille, aprèsexamen médical. Ces avantages sociaux dans divers domaines s<strong>on</strong>t entre autres :• Santé : la réducti<strong>on</strong> des frais de soins dans les structures sanitaires de l'Etat.• Educati<strong>on</strong> : le recul systématique de la limite d'âge lors des inscripti<strong>on</strong>sscolaires et universitaires, l'octroi de bourses d'étude, etc.• Transport public : la réducti<strong>on</strong> des frais de transport public.• Loisirs : la réducti<strong>on</strong> des frais de loisirs.• Envir<strong>on</strong>nement : La c<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> des rampes d'accès dans les édifices publics
115et parapublics.• Fiscalité : le calcul des taux de fiscalité (patente et impôt) en f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> du degréd'invalidité.c - Protecti<strong>on</strong> et promoti<strong>on</strong> sociales des pers<strong>on</strong>nes du troisième âgeUne réflexi<strong>on</strong> est présentement diligentée par le Ministère de l'Acti<strong>on</strong> Sociale et dela Famille en relati<strong>on</strong> avec d'autres départements ministériels, des instituti<strong>on</strong>s etassociati<strong>on</strong>s partenaires. Elle permettra l'élaborati<strong>on</strong> d'une politique nati<strong>on</strong>ale enfaveur des pers<strong>on</strong>nes âgées.
116PARTIE III : LE RESPECT DES DROITS DES PEUPLES.I. L'EGALITE.Les directives de la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> Africaine des Droits de l'Homme et des Peuplesenvisage en matière d'égalité des peuples, la prise des mesures qui visent àprotéger chaque peuple par rapport aux autres ou chaque composante distincte dupeuple.La noti<strong>on</strong> de peuple au Burkina Faso est vue sous l'angle de l'Unité de toutes sescomposantes, communautaires, c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nelles, sociales, etc.Le Burkina Faso est un pays composé richement d'une multitude d'ethnies et decommunautés socio-linguistiques, en plus desquelles <strong>on</strong> peut identifier desdistincti<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nelles et sociales. La préservati<strong>on</strong> de s<strong>on</strong> unité estf<strong>on</strong>damentale à s<strong>on</strong> développement et exclut toute idée et forme de discriminati<strong>on</strong>quelc<strong>on</strong>que, liée à une quelc<strong>on</strong>que appartenance ethnique ou communautaire.La principale base juridique de la préservati<strong>on</strong> de l'égalité des peuples et groupessocio-ethniques et communautaires du Burkina Faso est c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle. Lesprincipales dispositi<strong>on</strong>s dans ce sens s<strong>on</strong>t :■La garantie de l'égalité des droits et devoirs civils par la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. L'articlepremier de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> stipule que « tous les Burkinabé naissent libres etégaux en droits. Tous <strong>on</strong>t une égale vocati<strong>on</strong> à jouir de tous les droits et detoutes les libertés garantis par la présente C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. Les discriminati<strong>on</strong>s detoutes sortes, notamment celles f<strong>on</strong>dées sur la race, l'ethnie, la régi<strong>on</strong>, lacouleur, le sexe, la langue, la religi<strong>on</strong>, la caste, les opini<strong>on</strong>s politiques, la fortuneet la naissance, s<strong>on</strong>t prohibées ».IIII Les mesures et précauti<strong>on</strong>s prises pour freiner la tendance de certains individusou groupes sociaux, à dominer d'autres individus ou groupes sociaux, par laC<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. L'article 13 de la loi f<strong>on</strong>damentale stipule l'égalité de tous les partisou formati<strong>on</strong>s politiques en droits et en devoirs, et interdit «les partis ou
117formati<strong>on</strong>s politiques tribalistes, régi<strong>on</strong>alistes, c<strong>on</strong>fessi<strong>on</strong>nels ou racistes ». Cefaisant la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> évite les possibilités pour tout groupe tribal ou ethnique,régi<strong>on</strong>aliste, religieux ou racial, d'obtenir les moyens de dominati<strong>on</strong> politiques surd'autres.Il. LE DROIT A L'AUTODETERMINATION.Le Burkina Faso, pays issu du processus col<strong>on</strong>ial et c<strong>on</strong>scient des vexati<strong>on</strong>s de ladominati<strong>on</strong> col<strong>on</strong>iale, a toujours apporté un soutien, depuis s<strong>on</strong> indépendance, auprincipe d'autodéterminati<strong>on</strong> des peuples. Ce soutien a pris diverses formes et s'estmanifesté différemment, en f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> de la politique extérieure du pays.1. PRINCIPE GENERAL.Issu de la décol<strong>on</strong>isati<strong>on</strong> et d<strong>on</strong>c de l'applicati<strong>on</strong> du principe d'autodéterminati<strong>on</strong>des peuples, le Burkina Faso a toujours intégré le principe du « droit des peuples àdisposer d'eux-mêmes » dans sa politique extérieure.Il s'est agi de soutenir les acti<strong>on</strong>s internati<strong>on</strong>ales visant à ce que tout peuple ettoute nati<strong>on</strong> puissent se c<strong>on</strong>stituer en Etat, choisir s<strong>on</strong> régime, disposer de lasouveraineté pleine et entière. La politique extérieure en faveur du principe du« droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » découle de l'adhési<strong>on</strong> à certainstextes :• Charte des Nati<strong>on</strong>s Unies• Déclarati<strong>on</strong> Universelle des Droits de l'Homme• Résoluti<strong>on</strong>s des Nati<strong>on</strong>s Unies• Charte de l'OUA2. LES ACTIONS SPECIFIQUES.Au delà d'une orientati<strong>on</strong> générale de sa politique extérieure f<strong>on</strong>dée sur le soutienau « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », le Burkina Faso s'est, danscertaines circ<strong>on</strong>stances, m<strong>on</strong>tré plus offensif quant au soutien à ce principe. Onpeut citer les aspects suivants :• Soutien diplomatique aux mouvements de libérati<strong>on</strong> : ANC - SWAPO. Lutte dupeuple Sahraouie. Ce soutien s'est manifesté par une prise de positi<strong>on</strong> des
118plus hautes pers<strong>on</strong>nalités du Burkina Faso, en faveur de l'acti<strong>on</strong> desditsmouvements.• Discours politiques.• Positi<strong>on</strong> au sein des instances internati<strong>on</strong>ales (ONU,OUA).• Rec<strong>on</strong>naissance politique et diplomatique.• Octroi de l'immunité diplomatique à des hautes pers<strong>on</strong>nalités et leaders desmouvements d'émancipati<strong>on</strong>, à travers l'octroi du passeport diplomatiqueburkinabé.• D<strong>on</strong> symbolique de moyens militaires (armes) aux mouvements de libérati<strong>on</strong>(ANC - SWAPO).• Mobilisati<strong>on</strong> de la société civile et de l'opini<strong>on</strong> publique interne pour un soutiennati<strong>on</strong>al et internati<strong>on</strong>al aux peuples en lutte pour leur émancipati<strong>on</strong>.III. LE DROIT A LA PAIX ET A LA SECURITE.Le Burkina Faso en sa qualité d'Etat membre de la communauté internati<strong>on</strong>ale etafricaine adhère sans réserve aux instruments internati<strong>on</strong>aux qui f<strong>on</strong>de les rapportsentre les nati<strong>on</strong>s. La paix et la sécurité internati<strong>on</strong>ale s<strong>on</strong>t au prix du respect dudroit internati<strong>on</strong>al. C'est à ce titre qu'il est Etat partie à de multiples engagementsinternati<strong>on</strong>aux garantissant la souveraineté des Etats, la n<strong>on</strong> ingérence dans leursaffaires intérieures, l'intangibilité des fr<strong>on</strong>tières des Etats, l'égalité souveraine desEtats, la paix et la sécurité internati<strong>on</strong>ale. On peut citer entre autres, lesc<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s suivantes :■La Charte des Nati<strong>on</strong>s Unies ;■La Charte de l'O.U.A et s<strong>on</strong> principe d'intangibilité des fr<strong>on</strong>tières héritées de lacol<strong>on</strong>isati<strong>on</strong> ;■La C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> de l'O.U.A pour l'éliminati<strong>on</strong> du mercénariat en Afrique du 03mars 1977, ratifiée par le Burkina Faso le 06 juillet 1984 ;■La C<strong>on</strong>venti<strong>on</strong> régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés enAfrique du 10 septembre 1969, ratifiée par le Burkina Faso, le 19 mars 1974.La politique de b<strong>on</strong> voisinage et l'adhési<strong>on</strong> du Burkina Faso à des communautésd'intégrati<strong>on</strong> régi<strong>on</strong>ale telles que l'Uni<strong>on</strong> Ec<strong>on</strong>omique et Régi<strong>on</strong>ale Ouest Africaine
119(UEMOA) et la Communauté Ec<strong>on</strong>omique des Etats de l'Afrique de l'Ouest(CEDEAO), corrobore cette vocati<strong>on</strong> à la paix, au respect de la souveraineté desEtats et à la sécurité nécessaire au développement de la sous régi<strong>on</strong> et duc<strong>on</strong>tinent.Au plan interne, le Burkina Faso veut préserver la paix intérieure par la démocratieet la b<strong>on</strong>ne gouvernance. La protecti<strong>on</strong> des Droits de l'Homme est f<strong>on</strong>damentaledans la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> de la IVème République afin de garantir la paix sociale et lesc<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s du développement.IV. LES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES PEUPLES.1. Droit à un envir<strong>on</strong>nement satisfaisant.La variable « envir<strong>on</strong>nement », ces dernières années est c<strong>on</strong>sidérée comme un faitmajeur d<strong>on</strong>t il faut désormais tenir compte dans la recherche sur le devenir del'humanité.Le Burkina Faso qui se situe dans un c<strong>on</strong>texte de dégradati<strong>on</strong> accélérée de sesressources naturelles du fait des cycles successifs de sécheresse a opté résolumentpour la protecti<strong>on</strong> et la gesti<strong>on</strong> rati<strong>on</strong>nelle de s<strong>on</strong> envir<strong>on</strong>nement.La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du Burkina Faso, dès s<strong>on</strong> préambule a c<strong>on</strong>sacré le droit à unenvir<strong>on</strong>nement sain. Cet engagement ferme de sauvegarder et promouvoir unenvir<strong>on</strong>nement propice à la satisfacti<strong>on</strong> des citoyens est réaffirmé par l'article 29 dela C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>.De ce principe positif édicté par la loi f<strong>on</strong>damentale, le Gouvernement du BurkinaFaso a élaboré une politique envir<strong>on</strong>nementale qui place la lutte c<strong>on</strong>tre ladésertificati<strong>on</strong> au centre des préoccupati<strong>on</strong>s premières. L'objectif principal de cettepolitique est la recherche d'un équilibre socio-écologique et socio-éc<strong>on</strong>omiquesusceptible de c<strong>on</strong>tribuer de manière significative à la sécurité alimentaire etd'offrir les meilleures c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de vie aux populati<strong>on</strong>s.Le Préambule ainsi que l'article 29 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du Burkina Faso <strong>on</strong>t pris encompte les soucis de l'article 24 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme etdes Peuples, relatif au droit à un envir<strong>on</strong>nement satisfaisant.
120La loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l'Envir<strong>on</strong>nement auBurkina Faso précise en s<strong>on</strong> préambule que « la présente loi... a été élaborée pourservir de source d'inspirati<strong>on</strong> de tous les textes qui ser<strong>on</strong>t pris pour rép<strong>on</strong>dre auxaspirati<strong>on</strong>s prof<strong>on</strong>des de notre peuple en matière de préservati<strong>on</strong> del'Envir<strong>on</strong>nement ». L'article 1" de ce Code dispose que « le présent Code vise àétablir les principes f<strong>on</strong>damentaux destinés à préserver l'envir<strong>on</strong>nement et àaméliorer le cadre de vie du Burkina Faso ».L'un des principes f<strong>on</strong>damentaux décrit par l'article 2 de ce même Code estl'assainissement et l'améliorati<strong>on</strong> du cadre de vie des populati<strong>on</strong>s urbaines etrurales. Le titre II du Code de l'Envir<strong>on</strong>nement au Burkina Faso traite de lapréservati<strong>on</strong> de l'Envir<strong>on</strong>nement et de l'améliorati<strong>on</strong> du cadre de vie. Les outils decette préservati<strong>on</strong> s<strong>on</strong>t entre autres, l'instituti<strong>on</strong> d'un cadre de c<strong>on</strong>certati<strong>on</strong>,d'orientati<strong>on</strong>, de suivi d'évaluati<strong>on</strong> ; l'éducati<strong>on</strong> envir<strong>on</strong>nementale ; les études et lesnotices d'impact sur l'Envir<strong>on</strong>nement. Les mesures de préservati<strong>on</strong> del'Envir<strong>on</strong>nement prescrites par le chapitre II du titre II de ce Code portent :• sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ;• sur les déchets urbains et ruraux pour lesquels l'article 31 interdit ladétenti<strong>on</strong>, l'ab<strong>and</strong><strong>on</strong>, dans des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s favorisant le développement defacteurs susceptibles de provoquer des dommages aux pers<strong>on</strong>nes et auxbiens ;• sur les déchets industriels ou assimilés produits sur le territoire nati<strong>on</strong>al(article 36).L'article 39 du Code de l'envir<strong>on</strong>nement interdit tout acte relatif au transit, àl'importati<strong>on</strong>, à l'achat, à la vente, au transport, au traitement, au dépôt et austockage des déchets dangereux. L'article 87 édicte une peine exemplaire pourtoute infracti<strong>on</strong> aux dispositi<strong>on</strong>s de l'article 39. Les polluti<strong>on</strong>s atmosphériques, deseaux et des sols s<strong>on</strong>t réglementées par les articles 47 à 56 du Code.L'améliorati<strong>on</strong> du cadre de vie est traitée par le chapitre III du titre II du Code.Le document de stratégie nati<strong>on</strong>ale du sous-secteur de l'assainissement au BurkinaFaso élaboré par le Gouvernement décrit les méthodes utilisées pour l'évacuati<strong>on</strong>efficace des déchets. La particularité de ces méthodes est la resp<strong>on</strong>sabilisati<strong>on</strong> des
121acteurs du secteur ainsi que leur participati<strong>on</strong> effective à l'assainissement du cadrede vie. Instruit des expériences des plans directeurs d'assainissement mis en placepar de nombreux pays qui <strong>on</strong>t m<strong>on</strong>tré leurs limites objectives à dispenser auxpopulati<strong>on</strong>s, des services d'assainissement adaptés à leurs besoins, le Burkina Fasoa opté pour la démarche de planificati<strong>on</strong> stratégique. Le plan stratégique propose àcourt terme des soluti<strong>on</strong>s technologiques fiables assorties d'arrangementsinstituti<strong>on</strong>nels et financiers à la mesure des besoins et des possibilités de chaquecouche de la populati<strong>on</strong>.2. Vie culturelle, intérêts matériels et moraux des auteurs.La Charte envisage assurer à chacun, le droit de bénéficier de la protecti<strong>on</strong> desintérêts moraux et matériels découlant de toute producti<strong>on</strong> scientifique, littéraire ouartistique d<strong>on</strong>t il est l'auteur. Dans le cadre du Burkina Faso, la principaledispositi<strong>on</strong> en matière de protecti<strong>on</strong> en matière de la propriété intellectuelle estc<strong>on</strong>tenue à l'article 28 de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> en ces termes : « La loi garantit lapropriété intellectuelle. La liberté de créati<strong>on</strong> et les oeuvres artistiques, scientifiqueset techniques s<strong>on</strong>t protégées par la loi. La manifestati<strong>on</strong> de l'activité culturelle,intellectuelle, artistique et scientifique est libre et s'exerce c<strong>on</strong>formément auxtextes en vigueur ».Cette dispositi<strong>on</strong> c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle est aussi une garantie à la liberté de la recherchescientifique et de l'activité créatrice.
122PARTIE IV : LE RESPECT DES DEVOIRS SPECIFIQUES DE LA CHARTE.L LE DEVOIR DE SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA CHARTE.Le Burkina Faso suscite une prise de c<strong>on</strong>science de la Charte Africaine des Droitsde l'Homme et des Peuples, à travers trois aspects de sa politique :■La prise en compte de la Charte dans les normes juridiques nati<strong>on</strong>ales. LePréambule de la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> réaffirme solennellement l'engagement du BurkinaFaso vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Cetengagement est f<strong>on</strong>damental à toute acti<strong>on</strong> dans le sens de la défense des Droitsde l'Homme prévu par ladite Charte. Elle est la base juridique sur laquelles'appuie l'Etat et la République, pour vulgariser le c<strong>on</strong>tenu de la Charte etoeuvrer à s<strong>on</strong> applicati<strong>on</strong> politique et juridique. Dans la loi portant Code de pénal,l'article 5 est ainsi c<strong>on</strong>çu :« Les traités, accords ou c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>s dûment ratifiés et publiés s'imposent auxdispositi<strong>on</strong>s pénales internes ».Sur la base de ces dispositi<strong>on</strong>s, la juridicti<strong>on</strong> répressive burkinabé peut appliquerdirectement le c<strong>on</strong>tenu de la Charte.131 L'acti<strong>on</strong> en faveur des Organisati<strong>on</strong>s N<strong>on</strong> Gouvernementales et des Associati<strong>on</strong>soeuvrant dans le cadre des Droits de l'Homme sur le C<strong>on</strong>tinent Africain.Le Burkina Faso a oeuvré depuis l'avènement de la Quatrième République àl'émergence d'une société civile apte à défendre efficacement les Droits del'Homme, et à les intégrer dans une dimensi<strong>on</strong> sociale quotidienne et domestique.C'est en cela que de nombreuses associati<strong>on</strong>s et Organisati<strong>on</strong>s N<strong>on</strong>Gouvernementales des Droits de l'Homme <strong>on</strong>t été créées et soutenues dans unc<strong>on</strong>texte de démocratie véritable, pour c<strong>on</strong>tribuer à l'éclairage des populati<strong>on</strong>squant à leurs droits et oeuvrer à la prise de c<strong>on</strong>science sur la questi<strong>on</strong> des Droits del'Homme de manière générale et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme etdes Peuples de manière particulière. Ces Associati<strong>on</strong>s s<strong>on</strong>t les suivantes :
123- MBDHP : Mouvement Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples.- GERDDES : Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Démocratie et leDéveloppement Ec<strong>on</strong>omique et Social.- APED - Liberté : Associati<strong>on</strong> pour la Promoti<strong>on</strong> des Droits et Libertés.- Secti<strong>on</strong> Burkinabé d'Amnistie Internati<strong>on</strong>ale.- ACAT/ Burkina : Acti<strong>on</strong> Chrétienne pour l'Aboliti<strong>on</strong> de la Torture.- LDLP : Ligue de Défense de la Liberté de la Presse.■La prise en compte de la questi<strong>on</strong> des Droits de l'Homme dans l'enseignement.Le Burkina Faso a pris un certain nombre de mesures au plan administratif d<strong>on</strong>t lafinalité est de faire respecter les Droits de l'Homme par les différents pers<strong>on</strong>nelsde la police, dans l'exercice de leurs f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s. C'est dans cette perspective queles agents de police reçoivent dans leur formati<strong>on</strong> initiale, des modules sur lesDroits de l'Homme et les libertés publiques. Dans le cadre de ces modules setrouve évoqué le c<strong>on</strong>tenu de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et desPeuples. Au niveau universitaire, des cours de Droits de l'Homme s<strong>on</strong>t accordésaux étudiants des facultés de Droit et de sciences politiques.L'enseignement des Droits de l'Homme est d<strong>on</strong>c un impératif perçu par le BurkinaFaso et qui est mis en oeuvre au fur et à mesure des opportunités et des moyens,au service des forces de l'ordre, des étudiants et des citoyens.La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples affirme les libertésf<strong>on</strong>damentales.Leur mise en oeuvre effective suppose que les pers<strong>on</strong>nes au profit desquelles ceslibertés <strong>on</strong>t été proclamées en soient informées. L'ignorance c<strong>on</strong>stitue un obstaclemajeur à la mise en oeuvre des droits humains.Des séances de formati<strong>on</strong>s, d'informati<strong>on</strong> et de sensibilisati<strong>on</strong> d<strong>on</strong>t le public estbénéficiaire doivent être intensifiées.
124Il. LE DEVOIR DE GARANTIR L'INDEPENDANCE DES TRIBUNAUX.L'article 129 de la c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant. Enapplicati<strong>on</strong> de ces dispositi<strong>on</strong>s une série de textes <strong>on</strong>t été adoptés.1. L'Ord<strong>on</strong>nance n°91-0050/PRES du 26 Août 1991 portant statut du corps de laMagistrature.Le statut particulier de la Magistrature avait été supprimé par le C<strong>on</strong>seil Nati<strong>on</strong>al dela Révoluti<strong>on</strong>. Les magistrats avaient été c<strong>on</strong>f<strong>on</strong>dus à tous les autres agent de laF<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique. Cette situati<strong>on</strong> les plaçait dans un état de dépendance totale visà vis de l'exécutif. L'ord<strong>on</strong>nance n°-91-0050/PRES a mis fin à cet état de fait. Elledispose, en effet, en s<strong>on</strong> article 2 : « les Magistrats s<strong>on</strong>t indépendants... Aucuncompte ne peut être dem<strong>and</strong>é aux juges des décisi<strong>on</strong>s auxquelles ils participent ».De même le principe de l'inamovibilité a été réaffirmé.2. L'ord<strong>on</strong>nance n°-91-0052/PRES du 26 Août 1991 portant créati<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong>et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement du C<strong>on</strong>seil Supérieur de la MagistratureLe C<strong>on</strong>seil Supérieur de la Magistrature avait été supprimé par l'ord<strong>on</strong>nance n°85-44/CNR/PRES du 29 Août 1985. Cet organe c<strong>on</strong>stitue une pièce essentielle del'indépendance de la Magistrature.Cette suppressi<strong>on</strong> c<strong>on</strong>stituait une grave atteinte au principe de l'indépendance de lamagistrature.L'objectif visé était d'écarter le pouvoir judiciaire.Lorsqu'<strong>on</strong> sait qu'il n'existait pas à l'époque un pouvoir législatif, le m<strong>on</strong>opole dupouvoir revenait à l'exécutif.Le rétablissement du C<strong>on</strong>seil Supérieur de la Magistrature par l'Ord<strong>on</strong>nance duC<strong>on</strong>seil Supérieur de la Magistrature par l'Ord<strong>on</strong>nance N°91-052/PRES du 26 Août1991 marque une étape importante dans l'avènement de l'Etat de droit au BurkinaFaso.Lorsqu'il statue en matière disciplinaire, le Chef de l'Etat qui en est le Président et le
125Ministre de la Justice, le Vice Président, n'assistent pas aux séances. Cetteformati<strong>on</strong> est présidée par le Magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Ilen est de même pour la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> d'avancement. Les membres de l'Exécutif s<strong>on</strong>td<strong>on</strong>c écartés de la gesti<strong>on</strong> de la carrière des Magistrats. Le principe de la séparati<strong>on</strong>des pouvoirs se trouve ainsi observé.L'indépendance de la justice est une nécessité envisagée c<strong>on</strong>stamment par leBurkina Faso, comme garant important des Droits de l'Homme et de la Démocratie.Pour le Gouvernement, la réhabilitati<strong>on</strong> de l'image de la justice et l'impérieusenécessité de sa réc<strong>on</strong>ciliati<strong>on</strong> avec les justiciables s<strong>on</strong>t des points focaux qui <strong>on</strong>tété l'objet d'efforts particuliers. La ténue du « Forum nati<strong>on</strong>al sur la justice » enoctobre 1998 a fourni un cadre privilégié d'échanges sur les maux d<strong>on</strong>t souffre lesystème judiciaire et permis d'entrevoir les voies et moyens de leur éradicati<strong>on</strong> pourune justice performante, crédible et accessible à tous, au service de la paix et duprogrès social.Lorsque le système judiciaire c<strong>on</strong>naît une c<strong>on</strong>testati<strong>on</strong> dans sa capacité de garantirl'indépendance des procédures d'instructi<strong>on</strong>s et de jugement, le Gouvernement,dans un souci de préservati<strong>on</strong> des Droits de l'Homme peut prendre des mesuresexcepti<strong>on</strong>nelles mais appropriés au c<strong>on</strong>texte social et politique nati<strong>on</strong>al. C'est le casdes efforts déployés par le Gouvernement dans l'affaire de la mort suspecte duJournaliste Norbert ZONGO, le 13 décembre 1998. C'est à cet effet qu'une<str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> d'enquête indépendante a été instituée le 18 décembre 1998 par leGouvernement, qui a accepté par la suite d'en modifier le compositi<strong>on</strong> et lef<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement pour prendre en compte les propositi<strong>on</strong>s formulées par toutes lesparties éprises de paix et de justice.III. LES DEVOIRS SPECIFIQUES DE TOUS.Les devoirs spécifiques de toutes les composantes de la République peuvent êtreidentifiés en deux aspects :■Les devoirs du citoyen au respect de la loi.La force de la République tient entre autres au respect des devoirs des citoyens vis-
126à-vis de la loi. Chaque individu a des devoirs envers autrui, envers la société, lafamille et la communauté. Le respect des devoirs par les citoyens est indispensableà un ordre de paix et de justice.La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du Burkina Faso envisage à s<strong>on</strong> « titre I », les Droits et Devoirsf<strong>on</strong>damentaux. Les Droits <strong>on</strong>t une c<strong>on</strong>trepartie en devoirs, et leur respect estf<strong>on</strong>damental à l'équilibre social. Au delà de ce principe de devoirs rendus enc<strong>on</strong>trepartie des droits, la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> stipule expressément plusieurs devoirsf<strong>on</strong>damentaux :- Article 10 : « tout citoyen burkinabé a le devoir de c<strong>on</strong>courir à la défense et aumaintien de l'intégrité territoriale. Il est tenu de s'acquitter du service nati<strong>on</strong>allorsqu'il est requis ».- Article 11 : « Le droit de propriété ... ne saurait être exercé c<strong>on</strong>trairement àl'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existenceou à la propriété d'autrui... »- Article 17 : « Le devoir de s'acquitter de ses obligati<strong>on</strong>s fiscales c<strong>on</strong>formément àla loi... »■Les devoirs de l'Etat à la garantie des droits et libertés.
127CONCLUSION GENERALE.Depuis la C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> du 2 juin 1991, il serait fastidieux d'énumérer les actes allantdans le sens d'une mise en place progressive et la c<strong>on</strong>solidati<strong>on</strong> de la démocratie.Des efforts <strong>on</strong>t été fournis pour restaurer l'appareil judiciaire, rétablir l'indépendancede la justice, promouvoir les différents droits de la pers<strong>on</strong>ne humaine. Certes,d'énormes efforts restent à faire, mais cela est caractéristique de tout processusévolutif en cours. L'<strong>on</strong> relèvera seulement à cet égard que, le Burkina Faso est unvaste chantier de c<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> des bases nécessaires pour plus de démocratie, deprotecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> des droits humains.C'est le lieu de porter à la c<strong>on</strong>naissance de la <str<strong>on</strong>g>Commissi<strong>on</strong></str<strong>on</strong>g> et de la Communautéinternati<strong>on</strong>ale, qu'au Burkina Faso, aucun effort ne sera ménagé pour garantir auxcitoyens et à l'ensemble des habitants du pays, la jouissance des droits et l'exercicedes libertés. Aussi, des événements comme ceux de Garango, Pô et Réo, pourlesquels les autorités burkinabé <strong>on</strong>t été interpellées, s<strong>on</strong>t en cours d'examen devantles structures compétentes ou <strong>on</strong>t fait l'objet de règlement judiciaire ouadministratif. Il en est de même des cas des dispariti<strong>on</strong>s et d'attentats qui <strong>on</strong>t eulieu sous la période d'excepti<strong>on</strong> et auxquels le nouvel Etat de droit en c<strong>on</strong>structi<strong>on</strong>s'est d<strong>on</strong>né un devoir de trouver des soluti<strong>on</strong>s appropriées.Somme toute, l'Etat de droit démocratique, respectueux des droits de l'Homme encours de c<strong>on</strong>structi<strong>on</strong> au Burkina Faso, requiert la pleine participati<strong>on</strong> de tous lescitoyens, la collaborati<strong>on</strong> et la compréhensi<strong>on</strong> de toute la Communautéinternati<strong>on</strong>ale. Le Gouvernement, pour sa part, en fait sa première priorité.
128TABLE DES TEXTES JURIDIQUES*CONSTITUTION DU BURKINA1. LOI f<strong>on</strong>damentale adoptée par le référendum du 02 juin 1991 et révisée parla loi n°0002/97/ADP du 27 janvier 1997.*LEGISLATIF2. ORDONNANCE n°68-7/PRES/J portant instituti<strong>on</strong> d'un Code de procédurepénale du 21 février 1968.3. LOI n°13/72/AN du 28 décembre portant Code de Sécurité Sociale duBurkina4. ZATU n°AN VI-0008/FP/TRAV portant Statut général de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publiquedu 26 octobre 1988.5. ZATU n°AN VII-013/FP/PRES portant instituti<strong>on</strong> et applicati<strong>on</strong> du Code desPers<strong>on</strong>nes et de la Famille du 16 novembre 1989.6. ZATU n°AN VII-0050/FP/PRES portant Réglementati<strong>on</strong> de la Professi<strong>on</strong>d'Avocat du 3 août 1990.7. ORDONNANCE n°91-0080/PRES portant Réhabilitati<strong>on</strong> Administrative du 09juin 1991.8. ORDONNANCE n°92-0051/PRES portant compositi<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> etf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de la Cour Suprême du 26 août 1991.9. LOI n°10/92/ADP portant liberté d'associati<strong>on</strong> du 15 décembre 1992.10. LOI n°11/92/ADP portant Code du travail du 22 décembre 1992.11. LOI n°14/92/ADP portant liberté de réuni<strong>on</strong> et de manifestati<strong>on</strong> sur la voiepublique du 23 décembre 1992.12. LOI n°003/93/ADP portant organisati<strong>on</strong> de l'Administrati<strong>on</strong> du territoire auBurkina Faso du 7 mai 1993.13. LOI n°008/93/ADP portant compositi<strong>on</strong>, attributi<strong>on</strong>s et f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement de laChambre des Représentants du 13 mai 1993.14. LOI organique n°009/93/ADP portant créati<strong>on</strong>, compositi<strong>on</strong>, organisati<strong>on</strong> etf<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>nement du C<strong>on</strong>seil Ec<strong>on</strong>omique et Social du 13 mai 1993.15. LOI n°010/93/ADP portant organisati<strong>on</strong> judiciaire au Burkina Faso du 17
129mai 1993.16. LOI n°51/93/ADP portant procédure applicable devant la ChambreCriminelle du 16 décembre 1993.17. LOI n°56/93/ADP portant Code de l'Informati<strong>on</strong> au Burkina Faso du 30décembre 1993.18. LOI n°043/96/ADP portant Code Pénal, du 13 novembre 199619. Loi n°022/97/II/AN du 21 octobre 1997 portant liberté de réuni<strong>on</strong> et demanifestati<strong>on</strong> sur la voie publique.20. LOI n°024/97/II/AN portant Réglementati<strong>on</strong> de la Professi<strong>on</strong> d'Avocat du 04novembre 1997.21. LOI n°021/98/AN portant Code électoral du 7 mai 1998.22. Loi n°013/98/AN du 21 avril 1998 portant régime juridique applicable auxemplois et aux agents de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique. Elle abroge la ZATU n° AN VI-0008/FP/TRAV portant Statut général de la F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> Publique du 26 octobre1988.23. Loi n°044/98/AN du 17 août 1998 portant modificati<strong>on</strong> de l'intitulé duchapitre 203, secti<strong>on</strong> 99 du titre IV du budget de l'Etat, gesti<strong>on</strong> 1998, relatif àla subventi<strong>on</strong> aux partis politiques et sa répartiti<strong>on</strong>.*REGLEMENTAIRE24. KITI n° AN VI-0103/FP/MIJ portant organisati<strong>on</strong>, régime et règlement desEtablissements pénitentiaires au Burkina Faso le 1er décembre 1988.25. DECRET n°94-313/PRES/MAT portant Statut Général des Unités Socio-Ec<strong>on</strong>omiques des Collectivités Territoriales du 02 août 1994.26. DECRET n°96-197/PRES/PM/MATS portant organisati<strong>on</strong> du Ministère del'Administrati<strong>on</strong> Territoriale et de la Sécurité du 11 juin 1996.27. DECRET n°97-551/PRES promulgant la loi n°024/97/II/AN du 04 novembre1997, portant réglementati<strong>on</strong> de la professi<strong>on</strong> d'Avocat du 04 décembre1997.
130TABLE DES MATIERES.SOMMAIRE. 2TABLE DES SIGLES 3INTRODUCTION GENERALE 7PARTIE PRELIMINAIRE : LE BURKINA FASO, ETAT DES LIEUX 9I. HISTOIRE POLITIQUE DU BURKINA FASO. 111. La période précol<strong>on</strong>iale. 112. La période col<strong>on</strong>iale. 123. L'évoluti<strong>on</strong> politique depuis l'indépendance (1960-1998). 14II. REALITE POLITIQUE ACTUELLE. 171. La vie politique sous la Quatrième République. 182. Les instituti<strong>on</strong>s c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelles de la Quatrième République 193. La décentralisati<strong>on</strong> 204. Les partis politiques 215. Le pluralisme syndical et la presse 23III. RÉALITÉS ECONOMIQUES 241. L'agriculture et l'élevage 251. L L'agriculture 251.2. L'élevage 262. L'industrie et l'artisanat 272.1. L'industrie 272.1.1 L'industrie agro-alimentaire 282.1.2 L'industrie manufacturière 282.1.3 L'industrie textile et du cuir 282.1.4 L'industrie du bâtiment et des travaux publics 282.2. L'artisanat 293. Le commerce 293.1. Le commerce intérieur 293.2. Le commerce extérieur 304 Les mines 315. Les communicati<strong>on</strong>s 315.1. Le réseau routier 315.2. Le réseau ferroviaire 315.3. Les transports aériens 315.4. Les télécommunicati<strong>on</strong>s 32
131PARTIE I : LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES 33I. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 331. Le Cadre c<strong>on</strong>venti<strong>on</strong>nel. 332. Le cadre c<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nel. 353. Le système judiciaire. 363.1. La Cour Suprême 363.1.1. Le Président de la Cour Suprême 363.1.2. La Chambre C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>nelle 373.1.3. La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême 383.1.4. la Chambre administrative 383.2. La Cour d'Appel 393.3. Le Tribunal de Gr<strong>and</strong>e Instance 403.4. Le Tribunal Départemental 413.5. Le Tribunal du Travail 414. Le Médiateur du Faso. 42II. MISE EN ŒUVRE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 441. F<strong>on</strong>dements juridiques. 441.1. La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong>. 441.2. Les dispositi<strong>on</strong>s de la Charte face aux juridicti<strong>on</strong>s nati<strong>on</strong>ales. 451.3. Autorités nati<strong>on</strong>ales et applicati<strong>on</strong> des dispositi<strong>on</strong>s de la Charte 451.4. Les autorités judiciaires ou administratives ayant compétence en matière des droits de l'homme. 451.5. Les voies de recours d'un individu victime de la violati<strong>on</strong> de ses droits. 461.6. Droit de toute pers<strong>on</strong>ne à la jouissance des droits et libertés rec<strong>on</strong>nus et garantis par la Charte (art.2). 462. Protecti<strong>on</strong> des droits civils et politiques. 472.1. Droit à la vie et à l'intégrité physique . 472.2. Droit à la liberté et à la sécurité de sa pers<strong>on</strong>ne (art.6) 482.3. L'interdicti<strong>on</strong> de l'arrestati<strong>on</strong> et de la détenti<strong>on</strong> arbitraire. 492.4. Egalité devant la loi et droit a une égale protecti<strong>on</strong> de la loi (art 3 et art 7) 502.5. Aboliti<strong>on</strong> de l'esclavage, de la servitude et des travaux forcés (art. 5). 522.6. Le droit d'être jugé par une juridicti<strong>on</strong> impartiale 522.7. Le droit à un procès équitable, le droit de la défense et la présompti<strong>on</strong> d'innocence. 532.8. Le traitement humain des pers<strong>on</strong>nes arrêtées ou détenues. 542.8.1. Etat des lieux. 552.8.2. La populati<strong>on</strong> carcérale. 552.8.3. Mesures prises ou à prendre pour l'améliorati<strong>on</strong> de la situati<strong>on</strong> carcérale. 572.9. Liberté de c<strong>on</strong>science, d'expressi<strong>on</strong>, de réuni<strong>on</strong> et d'associati<strong>on</strong> (art .8. 10.11) 592.10. Le droit de recevoir et de diffuser des informati<strong>on</strong>s (art.9) 602.11. Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence 622.12. Le droit de participer librement au vote. 63
1322.13. Le droit d'accéder aux f<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s publiques 642.14. L'interdicti<strong>on</strong> de la pris<strong>on</strong> pour une violati<strong>on</strong> d'une simple obligati<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tractuelle 642.15. La protecti<strong>on</strong> de l'intégrité physique 642.16. La protecti<strong>on</strong> de la vie privée 642.17. Eliminati<strong>on</strong> de toutes les formes de discriminati<strong>on</strong> sociale. 652.17.1. Mesures d'ordre législatif 652.17.1.1. La C<strong>on</strong>stituti<strong>on</strong> 652.17.1.2. Le Code des Pers<strong>on</strong>nes et de la Famille 662.17.2. Mesures d'ordre judiciaire 682.18. Autres mesures prises en faveur des droits de l'Homme. 682.19. Garantie des droits des réfugiés. 71PARTIE II : LA PROMOTION DES DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS 73I. PROTECTION DES DROITS ECONOMIQUES. 741. Droit au travail 741.1. Accès aux F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong>s Publiques 741.2 Emploi 742. Droit à des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s de travail équitables et satisfaisantes. 752.1. La F<strong>on</strong>cti<strong>on</strong> publique. 752.2. Les emplois privés. 763. Droit des syndicats. 773.1. Droit de former et de s'affilier à des syndicats. 773.2. Droit de grève 784. Droit à la Sécurité Sociale 79II. DROIT A L'EDUCATION. 791. Généralités 792. Promoti<strong>on</strong> du droit à l'éducati<strong>on</strong> 813. Droit a l'éducati<strong>on</strong> primaire 824. Droit à l'éducati<strong>on</strong> f<strong>on</strong>damentale 844.1. Pour les adultes 844.2. Pour les jeunes 845. Améliorati<strong>on</strong> des c<strong>on</strong>diti<strong>on</strong>s matérielles du corps enseignant 85III. NIVEAU DE VIE, ALIMENTATION, SANTE ET LOGEMENT. 861. Droit à un niveau de vie adéquat 861.1. Mesures prises en vue de développer ou de réformer le système agraire 861.2. Mesures prises en vue d'améliorer les méthodes de producti<strong>on</strong> 861.3. Promoti<strong>on</strong> de la recherche en matière d'agriculture 871.4. Introducti<strong>on</strong> de nouvelles techniques de producti<strong>on</strong> et leur méthode de diffusi<strong>on</strong> 871.5. Méthodes de c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des aliments 88
1332. Droit à l'alimentati<strong>on</strong> 892.1. Mesures en faveur de la producti<strong>on</strong> 892.1.1. Mesures prises aux fins d'améliorer les méthodes de producti<strong>on</strong> 892.1.2. Mesures en vue d'améliorer quantitativement les producti<strong>on</strong>s. 902.1.3. Mesures pour diffuser les nouvelles c<strong>on</strong>naissances techniques. 912.2. Mesures prises pour la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> degproduits et pour prévenir la dégradati<strong>on</strong> des ressources 922.2.1 Mesures prises pour la c<strong>on</strong>servati<strong>on</strong> des produits 922.2.2. Mesures en vue de prévenir la dégradati<strong>on</strong> des ressources 922.3. Mesures destinées à l'améliorati<strong>on</strong> du circuit d'informati<strong>on</strong> sur les marchés, sur le système de subventi<strong>on</strong> des produitsagricoles et l'aide en faveur des classes défavorisées. 932.3.1. Mesures en vue de l'améliorati<strong>on</strong> du circuit d'informati<strong>on</strong> sur les marchés. 932.3.2. Système de subventi<strong>on</strong> des produits agricoles 932.3.3. L'aide en faveur des classes défavorisées 932.4. Mesures pour relever la qualité de nutriti<strong>on</strong> 942.5. Mesures pour améliorer la qualité des aliments 943.Droit à la santé 963.1. Situati<strong>on</strong> sanitaire nati<strong>on</strong>ale. 963.2. La politique sanitaire nati<strong>on</strong>ale. 973.3. Les stratégies et programmes mis en oeuvre. 983.3.1. La réorganisati<strong>on</strong> du système de santé. 983.3.2. Les programmes de protecti<strong>on</strong> des groupes vulnérables. 993.3.3. La reforme hospitalière. 993.3.4. La politique pharmaceutique. 1003.3.5. La lutte c<strong>on</strong>tre les épidémies. 1003.3.6. La lutte c<strong>on</strong>tre le SIDA et les MST. 1013.4. Perspectives. 1014. Droit au logement 1024.1. Mesures iuridiques en faveur du droit au logement. 1024.2. Mesures éc<strong>on</strong>omiques et sociales en faveur du droit au logement. 1035. Stratégie de lutte c<strong>on</strong>tre les calamités naturelles. 104IV. FAMILLE ET PROTECTION DES GROUPES SOCIAUX SENSIBLES. 1061. Stratégies de protecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> sociales de l'enfant 1062. Stratégies de promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique et de protecti<strong>on</strong> juridique de la femme 1082.1. Promoti<strong>on</strong> socio-éc<strong>on</strong>omique de la femme 1092.2. Stratégies de protecti<strong>on</strong> juridique de la femme 1102.2.1. Le mariage f<strong>on</strong>dé sur le c<strong>on</strong>sentement des c<strong>on</strong>ioints. 11 I2.2.2. La protecti<strong>on</strong> c<strong>on</strong>tre l'excisi<strong>on</strong>. 1123. Stratégies de protecti<strong>on</strong> et de promoti<strong>on</strong> sociales des groupes défavorisés 113
134PARTIE III : LE RESPECT DES DROITS DES PEUPLES. 116I. L'EGALITE. 116II. LE DROIT A L'AUTODETERMINATION. 1171. Le principe général. 1172. Les acti<strong>on</strong>s spécifiques. 117III. LE DROIT A LA PAIX ET A LA SECURITE. 118IV. LES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES PEUPLES. 1191. Droit à un envir<strong>on</strong>nement satisfaisant. 1192. Vie culturelle intérêts matériels et moraux des auteurs. 121PARTIE IV : LE RESPECT DES DEVOIRS SPECIFIQUES DE LA CHARTE 122I. LE DEVOIR DE SUSCITER UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA CHARTE. 122II. LE DEVOIR DE GARANTIR L'INDEPENDANCE DES TRIBUNAUX. 124III. LES DEVOIRS SPECIFIQUES DE TOUS. 125CONCLUSION GENERALE 127TABLE DES TEXTES JURIDIQUES 128