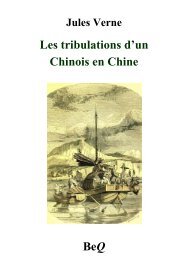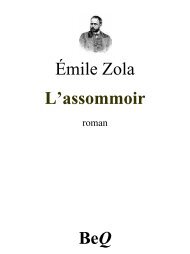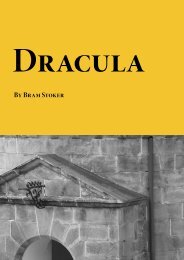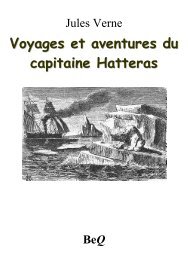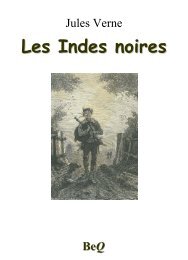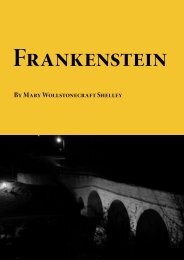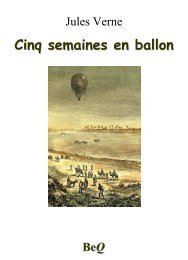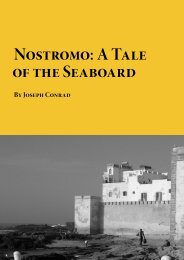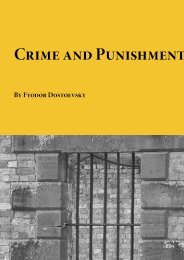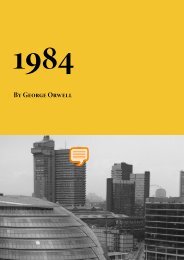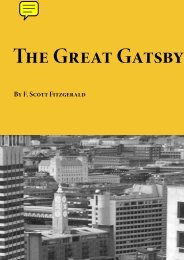You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Marcel ProustÀ la recherche dutemps perduXIII<strong>Albertine</strong> <strong>disparue</strong>BeQ
Marcel Proust(1871-1922)À la recherche du temps perduXIII<strong>Albertine</strong> <strong>disparue</strong>La Bibliothèque électronique du QuébecCollection À tous les ventsVolume 551.: version 1.0
Cette édition numérisée reprend le texte de l’éditionGallimard, Paris, 1946-47, en 15 volumes.:1. Du côté de chez Swann. Première partie.2. Du côté de chez Swann. Deuxième partie.3. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Première partie.4. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Deuxième partie.5. À l’ombre des jeunes filles en fleurs. Troisième partie.6. Le côté de Guermantes. Première partie.7. Le côté de Guermantes. Deuxième partie.8. Le côté de Guermantes. Troisième partie.9. Sodome et Gomorrhe. Première partie.10. Sodome et Gomorrhe. Deuxième partie.11. La Prisonnière. Première partie.12. La Prisonnière. Deuxième partie.13. <strong>Albertine</strong> <strong>disparue</strong>.14. Le temps retrouvé. Première partie.15. Le temps retrouvé. Deuxième partie.
<strong>Albertine</strong> <strong>disparue</strong>
Chapitre premierLe chagrin et l’oubliMademoiselle <strong>Albertine</strong> est partie,! Comme lasouffrance va plus loin en psychologie que lapsychologie,! Il y a un instant, en train de m’analyser,j’avais cru que cette séparation sans s’être revus étaitjustement ce que je désirais, et comparant la médiocritédes plaisirs que me donnait <strong>Albertine</strong> à la richesse desdésirs qu’elle me privait de réaliser, je m’étais trouvésubtil, j’avais conclu que je ne voulais plus la voir, queje ne l’aimais plus. Mais ces mots.: « Mademoiselle<strong>Albertine</strong> est partie » venaient de produire dans moncœur une souffrance telle que je ne pourrais pas yrésister plus longtemps. Ainsi ce que j’avais cru n’êtrerien pour moi, c’était tout simplement toute ma vie.Comme on s’ignore,! Il fallait faire cesserimmédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-mêmecomme ma mère pour ma grand’mère mourante, je medisais, avec cette même bonne volonté qu’on a de nepas laisser souffrir ce qu’on aime.: « Aie une secondede patience, on va te trouver un remède, sois tranquille,on ne va pas te laisser souffrir comme cela. » Ce fut
dans cet ordre d’idées que mon instinct de conservationchercha pour les mettre sur ma blessure ouverte lespremiers calmants.: « Tout cela n’a aucune importanceparce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vaisexaminer les moyens, mais de toute façon elle sera icice soir. Par conséquent inutile de se tracasser. » « Toutcela n’a aucune importance », je ne m’étais pascontenté de me le dire, j’avais tâché d’en donnerl’impression à Françoise en ne laissant pas paraîtredevant elle ma souffrance, parce que, même au momentoù je l’éprouvais avec une telle violence, mon amourn’oubliait pas qu’il lui importait de sembler un amourheureux, un amour partagé, surtout aux yeux deFrançoise qui, n’aimant pas <strong>Albertine</strong>, avait toujoursdouté de sa sincérité. Oui, tout à l’heure, avant l’arrivéede Françoise, j’avais cru que je n’aimais plus <strong>Albertine</strong>,j’avais cru ne rien laisser de côtéi; en exact analyste,j’avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Maisnotre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoirles éléments qui le composent et qui restentinsoupçonnés tant que, de l’état volatil où ils subsistentla plupart du temps, un phénomène capable de les isolerne leur a pas fait subir un commencement desolidification. Je m’étais trompé en croyant voir clairdans mon cœur. Mais cette connaissance que nem’avaient pas donnée les plus fines perceptions del’esprit venait de m’être apportée, dure, éclatante,
étrange, comme un sel cristallisé par la brusque réactionde la douleur. J’avais une telle habitude d’avoir<strong>Albertine</strong> auprès de moi, et je voyais soudain unnouveau visage de l’Habitude. Jusqu’ici je l’avaisconsidérée surtout comme un pouvoir annihilateur quisupprime l’originalité et jusqu’à la conscience desperceptionsi; maintenant je la voyais comme unedivinité redoutable, si rivée à nous, son visageinsignifiant si incrusté dans notre cœur que si elle sedétache, ou si elle se détourne de nous, cette déité quenous ne distinguions presque pas nous inflige dessouffrances plus terribles qu’aucune et qu’alors elle estaussi cruelle que la mort. merdeLe plus pressé était de lire la lettre d’<strong>Albertine</strong>puisque je voulais aviser aux moyens de la faire revenir.Je les sentais en ma possession, parce que, commel’avenir est ce qui n’existe que dans notre pensée, ilnous semble encore modifiable par l’intervention inextremis de notre volonté. Mais, en même temps, je merappelais que j’avais vu agir sur lui d’autres forces quela mienne et contre lesquelles, plus de temps m’eût-ilété donné, je n’aurais rien pu. À quoi sert que l’heuren’ait pas sonné encore si nous ne pouvons rien sur cequi s’y produirai? Quand <strong>Albertine</strong> était à la maison,j’étais bien décidé à garder l’initiative de notreséparation. Et puis elle était partie. J’ouvris la lettred’<strong>Albertine</strong>. Elle était ainsi conçue.:
Ma décision est irrévocable.« MON AMI,» Pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire devive voix les quelques mots qui vont suivre, mais jesuis si lâche, j’ai toujours eu si peur devant vous, que,même en me forçant, je n’ai pas eu le courage de lefaire. Voici ce que j’aurais dû vous dire. Entre nous, lavie est devenue impossible, vous avez d’ailleurs vu parvotre algarade de l’autre soir qu’il y avait quelquechose de changé dans nos rapports. Ce qui a pus’arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dansquelques jours. Il vaut donc mieux, puisque nous avonseu la chance de nous réconcilier, nous quitter bonsamis. C’est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot,et je vous prie d’être assez bon pour me pardonner si jevous fais un peu de chagrin, en pensant à l’immenseque j’aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenirvotre ennemie, il me sera déjà assez dur de vousdevenir peu à peu, et bien vite, indifférentei; aussi madécision étant irrévocable, avant de vous faire remettrecette lettre par Françoise, je lui aurai demandé mesmalles. Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même.» ALBERTINE.Ma décision est irrévocable.« Tout cela ne signifie rien, me dis-je, c’est mêmemeilleur que je ne pensais, car comme elle ne pense
ien de tout cela, elle ne l’a évidemment écrit que pourfrapper un grand coup, afin que je prenne peur et nesois plus insupportable avec elle. Il faut aviser au pluspressé.: qu’<strong>Albertine</strong> soit rentrée ce soir. Il est triste depenser que les Bontemps sont des gens véreux qui seservent de leur nièce pour m’extorquer de l’argent.Mais qu’importei? Dussé-je, pour qu’<strong>Albertine</strong> soit icice soir, donner la moitié de ma fortune à M meBontemps, il nous restera assez, à <strong>Albertine</strong> et à moi,pour vivre agréablement. » Et en même temps, jecalculais si j’avais le temps d’aller ce matin commanderle yacht et la Rolls Royce qu’elle désirait, ne songeantmême plus, toute hésitation ayant disparu, que j’avaispu trouver peu sage de les lui donner. « Même sil’adhésion de M me Bontemps ne suffit pas, si <strong>Albertine</strong>ne veut pas obéir à sa tante et pose comme condition deson retour qu’elle aura désormais sa pleineindépendance, eh bien,! quelque chagrin que cela mefasse, je la lui laisseraii; elle sortira seule, comme ellevoudra. Il faut savoir consentir des sacrifices, sidouloureux qu’ils soient, pour la chose à laquelle ontient le plus et qui, malgré ce que je croyais ce matind’après mes raisonnements exacts et absurdes, estqu’<strong>Albertine</strong> vive ici. » Puis-je dire, du reste, que luilaisser cette liberté m’eût été tout à fait douloureuxi? Jementirais. Souvent déjà j’avais senti que la souffrancede la laisser libre de faire le mal loin de moi était peut-
être moindre encore que ce genre de tristesse qu’ilm’arrivait d’éprouver à la sentir s’ennuyer, avec moi,chez moi. Sans doute, au moment même où elle m’eûtdemandé à partir quelque part, la laisser faire, avecl’idée qu’il y avait des orgies organisées, m’eût étéatroce. Mais lui dire.: prenez notre bateau, ou le train,partez pour un mois, dans tel pays que je ne connaispas, où je ne saurai rien de ce que vous ferez, celam’avait souvent plu par l’idée que par comparaison,loin de moi, elle me préférerait, et serait heureuse auretour. « Ce retour, elle-même le désire sûrementi; ellen’exige nullement cette liberté à laquelle d’ailleurs, enlui offrant chaque jour des plaisirs nouveaux,j’arriverais aisément à obtenir, jour par jour, quelquelimitation. Non, ce qu’<strong>Albertine</strong> a voulu, c’est que je nesois plus insupportable avec elle, et surtout – commeautrefois Odette avec Swann – que je me décide àl’épouser. Une fois épousée, son indépendance, elle n’ytiendra pasi; nous resterons tous les deux ici, siheureux. » Sans doute c’était renoncer à Venise. Maisque les villes les plus désirées comme Venise (à plusforte raison les maîtresses de maison les plus agréables,comme la duchesse de Guermantes, les distractionscomme le théâtre) deviennent pâles, indifférentes,mortes, quand nous sommes liés à un autre cœur par unlien si douloureux qu’il nous empêche de nous éloigner.« <strong>Albertine</strong> a, d’ailleurs, parfaitement raison dans cette
question de mariage. Maman elle-même trouvait tousces retards ridicules. L’épouser, c’est ce que j’aurais dûfaire depuis longtemps, c’est ce qu’il faudra que jefasse, c’est cela qui lui a fait écrire sa lettre dont elle nepense pas un moti; c’est seulement pour faire réussircela qu’elle a renoncé pour quelques heures à ce qu’elledoit désirer autant que je désire qu’elle le fasse.: revenirici. Oui, c’est cela qu’elle a voulu, c’est cela l’intentionde son acte », me disait ma raison compatissantei; maisje sentais qu’en me le disant ma raison se plaçaittoujours dans la même hypothèse qu’elle avait adoptéedepuis le début. Or je sentais bien que c’était l’autrehypothèse qui n’avait jamais cessé d’être vérifiée. Sansdoute cette deuxième hypothèse n’aurait jamais étéassez hardie pour formuler expressément qu’<strong>Albertine</strong>eût pu être liée avec M lle Vinteuil et son amie. Etpourtant, quand j’avais été submergé parl’envahissement de cette nouvelle terrible, au momentoù nous entrions en gare d’Incarville, c’était la secondehypothèse qui s’était déjà trouvée vérifiée. Celle-cin’avait ensuite jamais conçu qu’<strong>Albertine</strong> pût mequitter d’elle-même, de cette façon, sans me prévenir etme donner le temps de l’en empêcher. Mais tout demême, si après le nouveau bond immense que la vievenait de me faire faire, la réalité qui s’imposait à moim’était aussi nouvelle que celle en face de quoi nousmettent la découverte d’un physicien, les enquêtes d’un
juge d’instruction ou les trouvailles d’un historien surles dessous d’un crime ou d’une révolution, cette réalitéen dépassant les chétives prévisions de ma deuxièmehypothèse pourtant les accomplissait. Cette deuxièmehypothèse n’était pas celle de l’intelligence, et la peurpanique que j’avais eue le soir où <strong>Albertine</strong> ne m’avaitpas embrassé, la nuit où j’avais entendu le bruit de lafenêtre, cette peur n’était pas raisonnée. Mais – et lasuite le montrera davantage, comme bien des épisodesont pu déjà l’indiquer – de ce que l’intelligence n’estpas l’instrument le plus subtil, le plus puissant, le plusapproprié pour saisir le vrai, ce n’est qu’une raison deplus pour commencer par l’intelligence et non par unintuitivisme de l’inconscient, par une foi auxpressentiments toute faite. C’est la vie qui peu à peu,cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est leplus important pour notre cœur, ou pour notre esprit, nenous est pas appris par le raisonnement mais par despuissances autres. Et alors, c’est l’intelligence ellemêmequi, se rendant compte de leur supériorité,abdique par raisonnement devant elles et accepte dedevenir leur collaboratrice et leur servante. C’est la foiexpérimentale. Le malheur imprévu avec lequel je metrouvais aux prises, il me semblait l’avoir lui aussi(comme l’amitié d’<strong>Albertine</strong> avec deux Lesbiennes)déjà connu pour l’avoir lu dans tant de signes où(malgré les affirmations contraires de ma raison,
s’appuyant sur les dires d’<strong>Albertine</strong> elle-même) j’avaisdiscerné la lassitude, l’horreur qu’elle avait de vivreainsi en esclave, signes tracés comme avec de l’encreinvisible à l’envers des prunelles tristes et soumisesd’<strong>Albertine</strong>, sur ses joues brusquement enflammées parune inexplicable rougeur, dans le bruit de la fenêtre quis’était brusquement ouverte. Sans doute je n’avais pasosé les interpréter jusqu’au bout et former expressémentl’idée de son départ subit. Je n’avais pensé, d’une âmeéquilibrée par la présence d’<strong>Albertine</strong>, qu’à un départarrangé par moi à une date indéterminée, c’est-à-diresitué dans un temps inexistanti; par conséquent j’avaiseu seulement l’illusion de penser à un départ, commeles gens se figurent qu’ils ne craignent pas la mortquand ils y pensent alors qu’ils sont bien portants, et nefont en réalité qu’introduire une idée purement négativeau sein d’une bonne santé que l’approche de la mortprécisément altérerait. D’ailleurs l’idée du départd’<strong>Albertine</strong> voulu par elle-même eût pu me venir millefois à l’esprit, le plus clairement, le plus nettement dumonde, que je n’aurais pas soupçonné davantage ce queserait relativement à moi, c’est-à-dire en réalité, cedépart, quelle chose originale, atroce, inconnue, quelmal entièrement nouveau. À ce départ, si je l’eusseprévu, j’aurais pu songer sans trêve pendant des années,sans que, mises bout à bout, toutes ces pensées eussenteu le plus faible rapport, non seulement d’intensité mais
de ressemblance, avec l’inimaginable enfer dontFrançoise m’avait levé le voile en me disant.:« Mademoiselle <strong>Albertine</strong> est partie. » Pour sereprésenter une situation inconnue l’imaginationemprunte des éléments connus et à cause de cela ne sela représente pas. Mais la sensibilité, même la plusphysique, reçoit, comme le sillon de la foudre, lasignature originale et longtemps indélébile del’événement nouveau. Et j’osais à peine me dire que, sij’avais prévu ce départ, j’aurais peut-être été incapablede me le représenter dans son horreur, et même,<strong>Albertine</strong> me l’annonçant, moi la menaçant, lasuppliant, de l’empêcher,! Que le désir de Venise étaitloin de moi maintenant,! Comme autrefois à Combraycelui de connaître Madame de Guermantes, quandvenait l’heure où je ne tenais plus qu’à une seule chose,avoir maman dans ma chambre. Et c’était bien, en effet,toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance,qui, à l’appel de l’angoisse nouvelle, avaient accouru larenforcer, s’amalgamer à elle en une masse homogènequi m’étouffait. Certes, ce coup physique au cœur quedonne une telle séparation et qui, par cette terriblepuissance d’enregistrement qu’a le corps, fait de ladouleur quelque chose de contemporain à toutes lesépoques de notre vie où nous avons souffert, certes, cecoup au cœur sur lequel spécule peut-être un peu – tanton se soucie peu de la douleur des autres – la femme
qui désire donner au regret son maximum d’intensité,soit que, n’esquissant qu’un faux départ, elle veuilleseulement demander des conditions meilleures, soitque, partant pour toujours – pour toujours,! – elle désirefrapper, ou pour se venger, ou pour continuer d’êtreaimée, ou dans l’intérêt de la qualité du souvenir qu’ellelaissera, briser violemment ce réseau de lassitudes,d’indifférences, qu’elle avait senti se tisser, – certes, cecoup au cœur, on s’était promis de l’éviter, on s’était ditqu’on se quitterait bien. Mais il est vraiment rare qu’onse quitte bien, car, si on était bien, on ne se quitteraitpas,! Et puis la femme avec qui on se montre le plusindifférent sent tout de même obscurément qu’en sefatiguant d’elle, en vertu d’une même habitude, on s’estattaché de plus en plus à elle, et elle songe que l’un deséléments essentiels pour se quitter bien est de partir enprévenant l’autre. Or elle a peur en prévenantd’empêcher. Toute femme sent que, si son pouvoir surun homme est grand, le seul moyen de s’en aller, c’estde fuir. Fugitive parce que reine, c’est ainsi. Certes, il ya un intervalle inouï entre cette lassitude qu’elleinspirait il y a un instant et, parce qu’elle est partie, cefurieux besoin de la ravoir. Mais à cela, en dehors decelles données au cours de cet ouvrage et d’autres qui leseront plus loin, il y a des raisons. D’abord le départ alieu souvent dans le moment où l’indifférence – réelleou crue – est la plus grande, au point extrême de
l’oscillation du pendule. La femme se dit.: « Non, celane peut plus durer ainsi », justement parce que l’hommene parle que de la quitter, ou y pensei; et c’est elle quiquitte. Alors, le pendule revenant à son autre pointextrême, l’intervalle est le plus grand. En une seconde ilrevient à ce pointi; encore une fois, en dehors de toutesles raisons données, c’est si naturel,! Le cœur bati; etd’ailleurs la femme qui est partie n’est plus la mêmeque celle qui était là. Sa vie auprès de nous, tropconnue, voit tout d’un coup s’ajouter à elle les viesauxquelles elle va inévitablement se mêler, et c’estpeut-être pour se mêler à elles qu’elle nous a quittés. Desorte que cette richesse nouvelle de la vie de la femmeen allée rétroagit sur la femme qui était auprès de nouset peut-être préméditait son départ. À la série des faitspsychologiques que nous pouvons déduire et qui fontpartie de sa vie avec nous, de notre lassitude tropmarquée pour elle, de notre jalousie aussi (et qui faitque les hommes qui ont été quittés par plusieursfemmes l’ont été presque toujours de la même manièreà cause de leur caractère et de réactions toujoursidentiques qu’on peut calculeri; chacun a sa manièrepropre d’être trahi, comme il a sa manière des’enrhumer), à cette série pas trop mystérieuse pournous correspondait sans doute une série de faits quenous avons ignorés. Elle devait depuis quelque tempsentretenir des relations écrites, ou verbales, ou par
messagers, avec tel homme, ou telle femme, attendre telsigne que nous avons peut-être donné nous-mêmes sansle savoir en disant.: « M. X. est venu hier pour mevoir », si elle avait convenu avec M. X. que la veille dujour où elle devrait rejoindre M. X., celui-ci viendraitme voir. Que d’hypothèses possibles,! Possiblesseulement. Je construisais si bien la vérité, mais dans lepossible seulement, qu’ayant un jour ouvert, et parerreur, une lettre adressée à ma maîtresse, cette lettreécrite en style convenu et qui disait.: « Attends toujourssigne pour aller chez le marquis de Saint-Loup,prévenez demain par coup de téléphone », jereconstituai une sorte de fuite projetéei; le nom dumarquis de Saint-Loup n’était là que pour signifierautre chose, car ma maîtresse ne connaissait passuffisamment Saint-Loup, mais m’avait entendu parlerde lui, et, d’ailleurs, la signature était une espèce desurnom, sans aucune forme de langage. Or la lettren’était pas adressée à ma maîtresse, mais à unepersonne de la maison qui portait un nom différent etqu’on avait mal lu. La lettre n’était pas en signesconvenus mais en mauvais français parce qu’elle étaitd’une Américaine, effectivement amie de Saint-Loupcomme celui-ci me l’apprit. Et la façon étrange dontcette Américaine formait certaines lettres avait donnél’aspect d’un surnom à un nom parfaitement réel maisétranger. Je m’étais donc ce jour-là trompé du tout au
tout dans mes soupçons. Mais l’armature intellectuellequi chez moi avait relié ces faits, tous faux, était ellemêmela forme si juste, si inflexible de la vérité quequand trois mois plus tard ma maîtresse, qui alorssongeait à passer toute sa vie avec moi, m’avait quitté,ç’avait été d’une façon absolument identique à celle quej’avais imaginée la première fois. Une lettre vint ayantles mêmes particularités que j’avais faussementattribuées à la première lettre, mais cette fois-ci ayantbien le sens d’un signal. merdeCe malheur était le plus grand de toute ma vie. Etmalgré tout, la souffrance qu’il me causait était peutêtredépassée encore par la curiosité de connaître lescauses de ce malheur qu’<strong>Albertine</strong> avait désiré,retrouvé. Mais les sources des grands événements sontcomme celles des fleuves, nous avons beau parcourir lasurface de la terre, nous ne les retrouvons pas. <strong>Albertine</strong>avait-elle ainsi prémédité depuis longtemps sa fuitei?j’ai dit (et alors cela m’avait paru seulement dumaniérisme et de la mauvaise humeur, ce que Françoiseappelait faire la « tête ») que, du jour où elle avait cesséde m’embrasser, elle avait eu un air de porter le diableen terre, toute droite, figée, avec une voix triste dans lesplus simples choses, lente en ses mouvements, nesouriant plus jamais. Je ne peux pas dire qu’aucun faitprouvât aucune connivence avec le dehors. Françoiseme raconta bien ensuite qu’étant entrée l’avant-veille
du départ dans sa chambre elle n’y avait trouvépersonne, les rideaux fermés, mais sentant à l’odeur del’air et au bruit que la fenêtre était ouverte. Et, en effet,elle avait trouvé <strong>Albertine</strong> sur le balcon. Mais on nevoit pas avec qui elle eût pu, de là, correspondre, et,d’ailleurs, les rideaux fermés sur la fenêtre ouvertes’expliquaient sans doute parce qu’elle savait que jecraignais les courants d’air et que, même si les rideauxm’en protégeaient peu, ils eussent empêché Françoisede voir du couloir que les volets étaient ouverts aussitôt. Non, je ne vois rien sinon un petit fait qui prouveseulement que la veille elle savait qu’elle allait partir.La veille, en effet, elle prit dans ma chambre sans queje m’en aperçusse une grande quantité de papier et detoile d’emballage qui s’y trouvait, et à l’aide desquelselle emballa ses innombrables peignoirs et sauts de littoute la nuit afin de partir le matini; c’est le seul fait, cefut tout. Je ne peux pas attacher d’importance à cequ’elle me rendit presque de force ce soir-là millefrancs qu’elle me devait, cela n’a rien de spécial, carelle était d’un scrupule extrême dans les chosesd’argent. Oui, elle prit les papiers d’emballage la veille,mais ce n’était pas de la veille seulement qu’elle savaitqu’elle partirait,! Car ce n’est pas le chagrin qui la fitpartir, mais la résolution prise de partir, de renoncer à lavie qu’elle avait rêvée qui lui donna cet air chagrin.Chagrin, presque solennellement froid avec moi, sauf le
dernier soir, où, après être restée chez moi plus tardqu’elle ne voulait, dit-elle – remarque qui m’étonnaitvenant d’elle qui voulait toujours prolonger, – elle medit de la porte.: « Adieu, petit, adieu, petit. » Mais jen’y pris pas garde au moment. Françoise m’a dit que lelendemain matin, quand elle lui dit qu’elle partait (mais,du reste, c’est explicable aussi par la fatigue, car elle nes’était pas déshabillée et avait passé toute la nuit àemballer, sauf les affaires qu’elle avait à demander àFrançoise et qui n’étaient pas dans sa chambre et soncabinet de toilette), elle était encore tellement triste,tellement plus droite, tellement plus figée que les joursprécédents que Françoise crut quand elle lui dit.:« Adieu, Françoise » qu’elle allait tomber. Quand onapprend ces choses-là, on comprend que la femme quivous plaisait tellement moins maintenant que toutescelles qu’on rencontre si facilement dans les plussimples promenades, à qui on en voulait de les sacrifierpour elle, soit au contraire celle qu’on préférerait millefois. Car la question ne se pose plus entre un certainplaisir – devenu par l’usage, et peut-être par lamédiocrité de l’objet, presque nul – et d’autres plaisirs,ceux-là tentants, ravissants, mais entre ces plaisirs-là etquelque chose de bien plus fort qu’eux, la pitié pour ladouleur. Ma décision est irrévocable.En me promettant à moi-même qu’<strong>Albertine</strong> seraitici ce soir, j’avais couru au plus pressé et pansé d’une
croyance nouvelle l’arrachement de celle avec laquellej’avais vécu jusqu’ici. Mais si rapidement qu’eût agimon instinct de conservation, j’étais, quand Françoisem’avait parlé, resté une seconde sans secours, et j’avaisbeau savoir maintenant qu’<strong>Albertine</strong> serait là ce soir, ladouleur que j’avais ressentie pendant l’instant où je nem’étais pas encore appris à moi-même ce retour(l’instant qui avait suivi les mots.: « Mademoiselle<strong>Albertine</strong> a demandé ses malles, Mademoiselle<strong>Albertine</strong> est partie »), cette douleur renaissait d’ellemêmeen moi pareille à ce qu’elle avait été, c’est-à-direcomme si j’avais ignoré encore le prochain retourd’<strong>Albertine</strong>. D’ailleurs il fallait qu’elle revînt, maisd’elle-même. Dans toutes les hypothèses, avoir l’air defaire faire une démarche, de la prier de revenir irait àl’encontre du but. Certes je n’avais plus la force derenoncer à elle comme je l’avais eue pour Gilberte. Plusmême que revoir <strong>Albertine</strong>, ce que je voulais c’étaitmettre fin à l’angoisse physique que mon cœur plus malportant que jadis ne pouvait plus tolérer. Puis à force dem’habituer à ne pas vouloir, qu’il s’agît de travail oud’autre chose, j’étais devenu plus lâche. Mais surtoutcette angoisse était incomparablement plus forte pourbien des raisons dont la plus importante n’était peut-êtrepas que je n’avais jamais goûté de plaisir sensuel avecM me de Guermantes et avec Gilberte, mais que, ne lesvoyant pas chaque jour, à toute heure, n’en ayant pas la
possibilité et par conséquent pas le besoin, il y avait enmoins, dans mon amour pour elles, la force immense del’Habitude. Peut-être, maintenant que mon cœur,incapable de vouloir et de supporter de son plein gré lasouffrance, ne trouvait qu’une seule solution possible,le retour à tout prix d’<strong>Albertine</strong>, peut-être la solutionopposée (le renoncement volontaire, la résignationprogressive) m’eût-elle paru une solution de roman,invraisemblable dans la vie, si je n’avais moi-mêmeautrefois opté pour celle-là quand il s’était agi deGilberte. Je savais donc que cette autre solution pouvaitêtre acceptée aussi, et par un seul homme, car j’étaisresté à peu près le même. Seulement le temps avait jouéson rôle, le temps qui m’avait vieilli, le temps aussi quiavait mis <strong>Albertine</strong> perpétuellement auprès de moiquand nous menions notre vie commune. Mais dumoins, sans renoncer à elle, ce qui me restait de ce quej’avais éprouvé pour Gilberte, c’était la fierté de ne pasvouloir être à <strong>Albertine</strong> un jouet dégoûtant en lui faisantdemander de revenir, je voulais qu’elle revînt sans quej’eusse l’air d’y tenir. Je me levai pour ne pas perdre detemps, mais la souffrance m’arrêta.: c’était la premièrefois que je me levais depuis qu’<strong>Albertine</strong> était partie.Pourtant il fallait vite m’habiller afin d’aller m’informerchez son concierge. Ma décision est irrévocable.La souffrance, prolongement d’un choc moralimposé, aspire à changer de formei; on espère la
volatiliser en faisant des projets, en demandant desrenseignementsi; on veut qu’elle passe par sesinnombrables métamorphoses, cela demande moins decourage que de garder sa souffrance franchei; ce litparaît si étroit, si dur, si froid où l’on se couche avec sadouleur. Je me remis donc sur mes jambesi; jen’avançais dans la chambre qu’avec une prudenceinfinie, je me plaçais de façon à ne pas apercevoir lachaise d’<strong>Albertine</strong>, le pianola sur les pédales duquelelle appuyait ses mules d’or, un seul des objets dont elleavait usé et qui tous, dans le langage particulier que leuravaient enseigné mes souvenirs, semblaient vouloir medonner une traduction, une version différente,m’annoncer une seconde fois la nouvelle de son départ.Mais sans les regarder, je les voyais, mes forcesm’abandonnèrent, je tombai assis dans un de cesfauteuils de satin bleu dont, une heure plus tôt, dans leclair-obscur de la chambre anesthésiée par un rayon dejour, le glacis m’avait fait faire des rêvespassionnément caressés alors, si loin de moimaintenant. Hélas,! je ne m’y étais jamais assis, avantcette minute, que quand <strong>Albertine</strong> était encore là. Aussije ne pus y rester, je me levaii; et ainsi à chaque instantil y avait quelqu’un des innombrables et humbles« moi » qui nous composent qui était ignorant encoredu départ d’<strong>Albertine</strong> et à qui il fallait le notifieri; ilfallait – ce qui était plus cruel que s’ils avaient été des
étrangers et n’avaient pas emprunté ma sensibilité poursouffrir – annoncer le malheur qui venait d’arriver àtous ces êtres, à tous ces « moi » qui ne le savaient pasencorei; il fallait que chacun d’eux à son tour entendîtpour la première fois ces mots.: « <strong>Albertine</strong> a demandéses malles » – ces malles en forme de cercueil quej’avais vu charger à Balbec à côté de celles de ma mère,– « <strong>Albertine</strong> est partie ». À chacun j’avais à apprendremon chagrin, le chagrin qui n’est nullement uneconclusion pessimiste librement tirée d’un ensemble decirconstances funestes, mais la reviviscenceintermittente et involontaire d’une impressionspécifique, venue du dehors, et que nous n’avons paschoisie. Il y avait quelques-uns de ces « moi » que jen’avais pas revus depuis assez longtemps. Par exemple(je n’avais pas songé que c’était le jour du coiffeur), le« moi » que j’étais quand je me faisais couper lescheveux. J’avais oublié ce « moi » – là, son arrivée fitéclater mes sanglots, comme à un enterrement, celled’un vieux serviteur retraité qui a connu celle qui vientde mourir. Puis je me rappelai tout d’un coup quedepuis huit jours j’avais par moments été pris de peurspaniques que je ne m’étais pas avouées. À cesmoments-là je discutais pourtant en me disant.:« Inutile, n’est-ce pas, d’envisager l’hypothèse où ellepartirait brusquement. C’est absurde. Si je la confiais àun homme sensé et intelligent (et je l’aurais fait pour
me tranquilliser si la jalousie ne m’eût empêché de fairedes confidences), il me dirait sûrement.: « Mais vousêtes fou. C’est impossible. » Et, en effet, ces derniersjours nous n’avions pas eu une seule querelle. On partpour un motif. On le dit. On vous donne le droit derépondre. On ne part pas comme cela. Non, c’est unenfantillage. C’est la seule hypothèse absurde. » Etpourtant, tous les jours, en la retrouvant là le matinquand je sonnais, j’avais poussé un immense soupir desoulagement. Et quand Françoise m’avait remis la lettred’<strong>Albertine</strong>, j’avais tout de suite été sûr qu’il s’agissaitde la chose qui ne pouvait pas être, de ce départ enquelque sorte perçu plusieurs jours d’avance, malgré lesraisons logiques d’être rassuré. Je me l’étais dit presqueavec une satisfaction de perspicacité dans mondésespoir, comme un assassin qui sait ne pouvoir êtredécouvert, mais qui a peur et qui tout d’un coup voit lenom de sa victime écrit en tête d’un dossier chez le juged’instruction qui l’a fait mander. Tout mon espoir étaitqu’<strong>Albertine</strong> fût partie en Touraine, chez sa tante où, ensomme, elle était assez surveillée et ne pourrait fairegrand’chose jusqu’à ce que je l’en ramenasse. Ma pirecrainte avait été qu’elle fût restée à Paris, partie àAmsterdam ou pour Montjouvain, c’est-à-dire qu’ellese fût échappée pour se consacrer à quelque intriguedont les préliminaires m’avaient échappé. Mais, enréalité, en me disant Paris, Amsterdam, Montjouvain,
c’est-à-dire plusieurs lieux, je pensais à des lieux quin’étaient que possibles. Aussi, quand la concierged’<strong>Albertine</strong> répondit qu’elle était partie en Touraine,cette résidence que je croyais désirer me sembla la plusaffreuse de toutes, parce que celle-là était réelle et quepour la première fois, torturé par la certitude du présentet l’incertitude de l’avenir, je me représentais <strong>Albertine</strong>commençant une vie qu’elle avait voulue séparée demoi, peut-être pour longtemps, peut-être pour toujours,et où elle réaliserait cet inconnu qui autrefois m’avait sisouvent troublé, alors que pourtant j’avais le bonheurde posséder, de caresser ce qui en était le dehors, cedoux visage impénétrable et capté. C’était cet inconnuqui faisait le fond de mon amour. Devant la ported’<strong>Albertine</strong>, je trouvai une petite file pauvre qui meregardait avec de grands yeux et qui avait l’air si bonque je lui demandai si elle ne voulait pas venir chezmoi, comme j’eusse fait d’un chien au regard fidèle.Elle en eut l’air content. À la maison, je la berçaiquelque temps sur mes genoux, mais bientôt saprésence, en me faisant trop sentir l’absenced’<strong>Albertine</strong>, me fut insupportable. Et je la priai de s’enaller, après lui avoir remis un billet de cinq cents francs.Et pourtant, bientôt après, la pensée d’avoir quelqueautre petite fille près de moi, de ne jamais être seul,sans le secours d’une présence innocente, fut le seulrêve qui me permît de supporter l’idée que peut-être
<strong>Albertine</strong> resterait quelque temps sans revenir. Pour<strong>Albertine</strong> elle-même, elle n’existait guère en moi quesous la forme de son nom, qui, sauf quelques raresrépits au réveil, venait s’inscrire dans mon cerveau et necessait plus de le faire. Si j’avais pensé tout haut, jel’aurais répété sans cesse et mon verbiage eût été aussimonotone, aussi limité que si j’eusse été changé enoiseau, en un oiseau pareil à celui de la fable dont lechant redisait sans fin le nom de celle qu’homme, ilavait aimée. On se le dit et, comme on le tait, il semblequ’on l’écrive en soi, qu’il laisse sa trace dans lecerveau et que celui-ci doive finir par être, comme unmur où quelqu’un s’est amusé à crayonner, entièrementrecouvert par le nom, mille fois récrit, de celle qu’onaime. On le récrit tout le temps dans sa pensée tantqu’on est heureux, plus encore quand on estmalheureux. Et de redire ce nom, qui ne nous donnerien de plus que ce qu’on sait déjà, on éprouve le besoinsans cesse renaissant, mais à la longue, une fatigue. Auplaisir charnel je ne pensais même pas en ce momenti;je ne voyais même pas devant ma pensée l’image decette <strong>Albertine</strong>, cause pourtant d’un tel bouleversementdans mon être, je n’apercevais pas son corps, et sij’avais voulu isoler l’idée qui était liée – car il y en abien toujours quelqu’une – à ma souffrance, ç’aurait étéalternativement, d’une part le doute sur les dispositionsdans lesquelles elle était partie, avec ou sans esprit de
etour, d’autre part les moyens de la ramener. Peut-êtrey a-t-il un symbole et une vérité dans la place infimetenue dans notre anxiété par celle à qui nous larapportons. C’est qu’en effet sa personne même y estpour peu de chosei; pour presque tout le processusd’émotions, d’angoisses que tels hasards nous ont faitjadis éprouver à propos d’elle et que l’habitude aattachées à elle. Ce qui le prouve bien c’est, plus encoreque l’ennui qu’on éprouve dans le bonheur, combienvoir ou ne pas voir cette même personne, être estimé ounon d’elle, l’avoir ou non à notre disposition, nousparaîtra quelque chose d’indifférent quand nousn’aurons plus à nous poser le problème (si oiseux quenous ne nous le poserons même plus) que relativementà la personne elle-même – le processus d’émotions etd’angoisses étant oublié, au moins en tant que serattachant à elle, car il a pu se développer à nouveaumais transféré à une autre. Avant cela, quand il étaitencore attaché à elle, nous croyions que notre bonheurdépendait de sa personne.: il dépendait seulement de laterminaison de notre anxiété. Notre inconscient étaitdonc plus clairvoyant que nous-même à ce moment-làen faisant si petite la figure de la femme aimée, figureque nous avions même peut-être oubliée, que nouspouvions connaître mal et croire médiocre, dansl’effroyable drame où de la retrouver pour ne plusl’attendre pourrait dépendre jusqu’à notre vie elle-
même. Proportions minuscules de la figure de lafemme, effet logique et nécessaire de la façon dontl’amour se développe, claire allégorie de la naturesubjective de cet amour.L’esprit dans lequel <strong>Albertine</strong> était partie étaitsemblable sans doute à celui des peuples qui fontpréparer par une démonstration de leur armée l’œuvrede leur diplomatie. Elle n’avait dû partir que pourobtenir de moi de meilleures conditions, plus de liberté,de luxe. Dans ce cas celui qui l’eût emporté de nousdeux, c’eût été moi, si j’eusse eu la force d’attendre,d’attendre le moment où, voyant qu’elle n’obtenait rien,elle fût revenue d’elle-même. Mais si aux cartes, à laguerre, où il importe seulement de gagner, on peutrésister au bluff, les conditions ne sont point les mêmesque font l’amour et la jalousie, sans parler de lasouffrance. Si pour attendre, pour « durer », je laissais<strong>Albertine</strong> rester loin de moi plusieurs jours, plusieurssemaines peut-être, je ruinais ce qui avait été mon butpendant plus d’une année.: ne pas la laisser libre uneheure. Toutes mes précautions se trouvaient devenuesinutiles si je lui laissais le temps, la facilité de metromper tant qu’elle voudrait, et si à la fin elle se rendaitje ne pourrais plus oublier le temps où elle aurait étéseule, et, même l’emportant à la fin, tout de même dansle passé, c’est-à-dire irréparablement, je serais levaincu.
Quant aux moyens de ramener <strong>Albertine</strong>, ils avaientd’autant plus de chance de réussir que l’hypothèse oùelle ne serait partie que dans l’espoir d’être rappeléeavec de meilleures conditions paraîtrait plus plausible.Et sans doute pour les gens qui ne croyaient pas à lasincérité d’<strong>Albertine</strong>, certainement pour Françoise parexemple, cette hypothèse l’était. Mais pour ma raison, àqui la seule explication de certaines mauvaiseshumeurs, de certaines attitudes avait paru, avant que jesache rien, le projet formé par elle d’un départ définitif,il était difficile de croire que, maintenant que ce départs’était produit, il n’était qu’une simulation. Je dis pourma raison, non pour moi. L’hypothèse de la simulationme devenait d’autant plus nécessaire qu’elle était plusimprobable et gagnait en force ce qu’elle perdait envraisemblance. Quand on se voit au bord de l’abîme etqu’il semble que Dieu vous ait abandonné, on n’hésiteplus à attendre de lui un miracle.Je reconnais que dans tout cela je fus le plusapathique quoique le plus douloureux des policiers.Mais la fuite d’<strong>Albertine</strong> ne m’avait pas rendu lesqualités que l’habitude de la faire surveiller par d’autresm’avait enlevées. Je ne pensais qu’à une chose.: chargerun autre de cette recherche. Cet autre fut Saint-Loup,qui consentit. L’anxiété de tant de jours remise à unautre me donna de la joie et je me trémoussai, sûr dusuccès, les mains redevenues brusquement sèches
comme autrefois et n’ayant plus cette sueur dontFrançoise m’avait mouillé en me disant.:« Mademoiselle <strong>Albertine</strong> est partie. »On se souvient que quand je résolus de vivre avec<strong>Albertine</strong> et même de l’épouser, c’était pour la garder,savoir ce qu’elle faisait, l’empêcher de reprendre seshabitudes avec M lle Vinteuil. Ç’avait été, dans ledéchirement atroce de sa révélation à Balbec, quandelle m’avait dit comme une chose toute naturelle et queje réussis, bien que ce fût le plus grand chagrin quej’eusse encore éprouvé dans ma vie, à sembler trouvertoute naturelle, la chose que dans mes piressuppositions je n’aurais jamais été assez audacieux pourimaginer. (C’est étonnant comme la jalousie, qui passeson temps à faire des petites suppositions dans le faux,a peu d’imagination quand il s’agit de découvrir levrai.) Or cet amour né surtout d’un besoin d’empêcher<strong>Albertine</strong> de faire le mal, cet amour avait gardé dans lasuite la trace de son origine. Être avec elle m’importaitpeu pour peu que je pusse empêcher « l’être de fuite »d’aller ici ou là. Pour l’en empêcher je m’en étais remisaux yeux, à la compagnie de ceux qui allaient avec elleet pour peu qu’ils me fissent le soir un bon petit rapportbien rassurant mes inquiétudes s’évanouissaient enbonne humeur.M’étant donné à moi-même l’affirmation que, quoique je dusse faire, <strong>Albertine</strong> serait de retour à la maison
le soir même, j’avais suspendu la douleur que Françoisem’avait causée en me disant qu’<strong>Albertine</strong> était partie(parce qu’alors mon être pris de court avait cru uninstant que ce départ était définitif). Mais après uneinterruption, quand d’un élan de sa vie indépendante lasouffrance initiale revenait spontanément en moi, elleétait toujours aussi atroce parce que antérieure à lapromesse consolatrice que je m’étais faite de ramener lesoir même <strong>Albertine</strong>. Cette phrase qui l’eût calmée, masouffrance l’ignorait. Pour mettre en œuvre les moyensd’amener ce retour, une fois encore, non pas qu’unetelle attitude m’eût jamais très bien réussi, mais parceque je l’avais toujours prise depuis que j’aimais<strong>Albertine</strong>, j’étais condamné à faire comme si je nel’aimais pas, ne souffrais pas de son départ, j’étaiscondamné à continuer de lui mentir. Je pourrais êtred’autant plus énergique dans les moyens de la fairerevenir que personnellement j’aurais l’air d’avoirrenoncé à elle. Je me proposais d’écrire à <strong>Albertine</strong> unelettre d’adieux où je considérerais son départ commedéfinitif, tandis que j’enverrais Saint-Loup exercer surM me Bontemps, et comme à mon insu, la pression laplus brutale pour qu’<strong>Albertine</strong> revînt au plus vite. Sansdoute j’avais expérimenté avec Gilberte le danger deslettres d’une indifférence qui, feinte d’abord, finit pardevenir vraie. Et cette expérience aurait dû m’empêcherd’écrire à <strong>Albertine</strong> des lettres du même caractère que
celles que j’avais écrites à Gilberte. Mais ce qu’onappelle expérience n’est que la révélation à nos propresyeux d’un trait de notre caractère qui naturellementreparaît, et reparaît d’autant plus fortement que nousl’avons déjà mis en lumière pour nous-même une fois,de sorte que le mouvement spontané qui nous avaitguidé la première fois se trouve renforcé par toutes lessuggestions du souvenir. Le plagiat humain auquel il estle plus difficile d’échapper, pour les individus (et mêmepour les peuples qui persévèrent dans leurs fautes etvont les aggravant), c’est le plagiat de soi-même.Saint-Loup que je savais à Paris avait été mandé parmoi à l’instant mêmei; il accourut rapide et efficacecomme il était jadis à Doncières et consentit à partiraussitôt pour la Touraine. Je lui soumis la combinaisonsuivante. Il devait descendre à Châtellerault, se faireindiquer la maison de M me Bontemps, attendrequ’<strong>Albertine</strong> fût sortie, car elle aurait pu le reconnaître.« Mais la jeune fille dont tu parles me connaît donci? »me dit-il. Je lui dis que je ne le croyais pas. Le projet decette démarche me remplit d’une joie infinie. Elle étaitpourtant en contradiction absolue avec ce que je m’étaispromis au début.: m’arranger à ne pas avoir l’air defaire chercher <strong>Albertine</strong>i; et cela en aurait l’airinévitablement, mais elle avait sur « ce qu’il auraitfallu » l’avantage inestimable qu’elle me permettait deme dire que quelqu’un envoyé par moi allait voir
<strong>Albertine</strong>, sans doute la ramener. Et si j’avais su voirclair dans mon cœur au début, c’est cette solution,cachée dans l’ombre et que je trouvais déplorable, quej’aurais pu prévoir qui prendrait le pas sur les solutionsde patience et que j’étais décidé à vouloir, par manquede volonté. Comme Saint-Loup avait déjà l’air un peusurpris qu’une jeune fille eût habité chez moi tout unhiver sans que je lui en eusse rien dit, comme d’autrepart il m’avait souvent reparlé de la jeune fille deBalbec et que je ne lui avais jamais répondu.: « Maiselle habite ici », il eût pu être froissé de mon manque deconfiance. Il est vrai que peut-être M me Bontemps luiparlerait de Balbec. Mais j’étais trop impatient de sondépart, de son arrivée, pour vouloir, pour pouvoirpenser aux conséquences possibles de ce voyage. Quantà ce qu’il reconnût <strong>Albertine</strong> (qu’il avait d’ailleurssystématiquement évité de regarder quand il l’avaitrencontrée à Doncières), elle avait, au dire de tous,tellement changé et grossi que ce n’était guèreprobable. Il me demanda si je n’avais pas un portraitd’<strong>Albertine</strong>. Je répondis d’abord que non, pour qu’iln’eût pas, d’après ma photographie, faite à peu près dutemps de Balbec, le loisir de reconnaître <strong>Albertine</strong>, quepourtant il n’avait qu’entrevue dans le wagon. Mais jeréfléchis que sur la dernière elle serait déjà aussidifférente de l’<strong>Albertine</strong> de Balbec que l’étaitmaintenant l’<strong>Albertine</strong> vivante, et qu’il ne la
econnaîtrait pas plus sur la photographie que dans laréalité. Pendant que je la lui cherchais, il me passaitdoucement la main sur le front, en manière de meconsoler. J’étais ému de la peine que la douleur qu’ildevinait en moi lui causait. D’abord il avait beau s’êtreséparé de Rachel, ce qu’il avait éprouvé alors n’étaitpas encore si lointain qu’il n’eût une sympathie, unepitié particulière pour ce genre de souffrances, commeon se sent plus voisin de quelqu’un qui a la mêmemaladie que vous. Puis il avait tant d’affection pour moique la pensée de mes souffrances lui étaitinsupportable. Aussi en concevait-il pour celle qui meles causait un mélange de rancune et d’admiration. Il sefigurait que j’étais un être si supérieur qu’il pensait que,pour que je fusse soumis à une autre créature, il fallaitque celle-là fût tout à fait extraordinaire. Je pensais bienqu’il trouverait la photographie d’<strong>Albertine</strong> jolie, maiscomme, tout de même, je ne m’imaginais pas qu’elleproduirait sur lui l’impression d’Hélène sur lesvieillards troyens, tout en cherchant je disaismodestement.: « Oh,! tu sais, ne te fais pas d’idées,d’abord la photo est mauvaise, et puis elle n’est pasétonnante, ce n’est pas une beauté, elle est surtout biengentille. – Oh,! si, elle doit être merveilleuse », dit-ilavec un enthousiasme naïf et sincère en cherchant à sereprésenter l’être qui pouvait me jeter dans un désespoiret une agitation pareils. « Je lui en veux de te faire mal,
mais aussi c’était bien à supposer qu’un être artistejusqu’au bout des ongles comme toi, toi qui aimes entout la beauté et d’un tel amour, tu étais prédestiné àsouffrir plus qu’un autre quand tu la rencontrerais dansune femme. » Enfin je venais de trouver laphotographie. « Elle est sûrement merveilleuse »,continuait à dire Robert, qui n’avait pas vu que je luitendais la photographie. Soudain il l’aperçut, il la tintun instant dans ses mains. Sa figure exprimait unestupéfaction qui allait jusqu’à la stupidité. « C’est ça lajeune fille que tu aimesi? » finit-il par me dire d’un tonoù l’étonnement était maté par la crainte de me fâcher.Il ne fit aucune observation, il avait pris l’airraisonnable, prudent, forcément un peu dédaigneuxqu’on a devant un malade – eût-il été jusque-là unhomme remarquable et votre ami – mais qui n’est plusrien de tout cela car, frappé de folie furieuse, il vousparle d’un être céleste qui lui est apparu et continue à levoir à l’endroit où vous, homme sain, vous n’apercevezqu’un édredon. Je compris tout de suite l’étonnement deRobert, et que c’était celui où m’avait jeté la vue de samaîtresse, avec la seule différence que j’avais trouvé enelle une femme que je connaissais déjà, tandis que luicroyait n’avoir jamais vu <strong>Albertine</strong>. Mais sans doute ladifférence entre ce que nous voyions l’un et l’autred’une même personne était aussi grande. Le temps étaitloin où j’avais bien petitement commencé à Balbec par
ajouter aux sensations visuelles quand je regardais<strong>Albertine</strong>, des sensations de saveur, d’odeur, detoucher. Depuis, des sensations plus profondes, plusdouces, plus indéfinissables s’y étaient ajoutées, puisdes sensations douloureuses. Bref <strong>Albertine</strong> n’était,comme une pierre autour de laquelle il a neigé, que lecentre générateur d’une immense construction quipassait par le plan de mon cœur. Robert, pour qui étaitinvisible toute cette stratification de sensations, nesaisissait qu’un résidu qu’elle m’empêchait au contraired’apercevoir. Ce qui avait décontenancé Robert quandil avait aperçu la photographie d’<strong>Albertine</strong> était non lesaisissement des vieillards troyens voyant passerHélène et disant.: « Notre mal ne vaut pas un seul deses regards », mais celui exactement inverse et qui faitdire.: « Comment, c’est pour ça qu’il a pu se faire tantde bile, tant de chagrin, faire tant de folies,! » Il fautbien avouer que ce genre de réaction à la vue de lapersonne qui a causé les souffrances, bouleversé la vie,quelquefois amené la mort de quelqu’un que nousaimons, est infiniment plus fréquent que celui desvieillards troyens et, pour tout dire, habituel. Ce n’estpas seulement parce que l’amour est individuel, niparce que, quand nous ne le ressentons pas, le trouverévitable et philosopher sur la folie des autres nous estnaturel. Non, c’est que, quand il est arrivé au degré où ilcause de tels maux, la construction des sensations
interposées entre le visage de la femme et les yeux del’amant – l’énorme œuf douloureux qui l’engaine et ledissimule autant qu’une couche de neige une fontaine –est déjà poussée assez loin pour que le point oùs’arrêtent les regards de l’amant, point où il rencontreson plaisir et ses souffrances, soit aussi loin du point oùles autres le voient qu’est loin le soleil véritable del’endroit où sa lumière condensée nous le faitapercevoir dans le ciel. Et de plus, pendant ce temps,sous la chrysalide de douleurs et de tendresses qui rendinvisibles à l’amant les pires métamorphoses de l’êtreaimé, le visage a eu le temps de vieillir et de changer.De sorte que si le visage que l’amant a vu la premièrefois est fort loin de celui qu’il voit depuis qu’il aime etsouffre, il est, en sens inverse, tout aussi loin de celuique peut voir maintenant le spectateur indifférent.(Qu’aurait-ce été si, au lieu de la photographie de cellequi était une jeune fille, Robert avait vu la photographied’une vieille maîtressei?) Et même, nous n’avons pasbesoin de voir pour la première fois celle qui a causétant de ravages pour avoir cet étonnement. Souventnous la connaissions comme mon grand-oncleconnaissait Odette. Alors la différence d’optiques’étend non seulement à l’aspect physique, mais aucaractère, à l’importance individuelle. Il y a beaucoupde chances pour que la femme qui fait souffrir celui quil’aime ait toujours été bonne fille avec quelqu’un qui ne
se souciait pas d’elle, comme Odette, si cruelle pourSwann, avait été la prévenante « dame en rose » de mongrand-oncle, ou bien que l’être dont chaque décision estsupputée d’avance, avec autant de crainte que celled’une Divinité, par celui qui l’aime, apparaisse commeune personne sans conséquence, trop heureuse de fairetout ce qu’on veut, aux yeux de celui qui ne l’aime pas,comme la maîtresse de Saint-Loup pour moi qui nevoyais en elle que cette « Rachel Quand du Seigneur »qu’on m’avait tant de fois proposée. Je me rappelais, lapremière fois que je l’avais vue avec Saint-Loup, mastupéfaction à la pensée qu’on pût être torturé de ne passavoir ce qu’une telle femme avait fait, de ne pas savoirce qu’elle avait pu dire tout bas à quelqu’un, pourquoielle avait eu un désir de rupture. Or je sentais que toutce passé, mais d’<strong>Albertine</strong>, vers lequel chaque fibre demon cœur, de ma vie, se dirigeait avec une souffrance,vibratile et maladroite, devait paraître tout aussiinsignifiant à Saint-Loup qu’il me le deviendrait peutêtreun jour à moi-même. Je sentais que je passeraispeut-être peu à peu, touchant l’insignifiance ou lagravité du passé d’<strong>Albertine</strong>, de l’état d’esprit quej’avais en ce moment à celui qu’avait Saint-Loup, car jene me faisais pas d’illusions sur ce que Saint-Louppouvait penser, sur ce que tout autre que l’amant peutpenser. Et je n’en souffrais pas trop. Laissons les joliesfemmes aux hommes sans imagination. Je me rappelais
cette tragique explication de tant de nous qu’est unportrait génial et pas ressemblant comme celui d’Odettepar Elstir et qui est moins le portrait d’une amante quedu déformant amour. Il n’y manquait – ce que tant deportraits ont – que d’être à la fois d’un grand peintre etd’un amant (et encore disait-on qu’Elstir l’avait étéd’Odette). Cette dissemblance, toute la vie d’un amant– d’un amant dont personne ne comprend les folies –toute la vie d’un Swann la prouve. Mais que l’amant sedouble d’un peintre comme Elstir et alors le mot del’énigme est proféré, vous avez enfin sous les yeux ceslèvres que le vulgaire n’a jamais aperçues dans cettefemme, ce nez que personne ne lui a connu, cette allureinsoupçonnée. Le portrait dit.: « Ce que j’ai aimé, cequi m’a fait souffrir, ce que j’ai sans cesse vu, c’estceci. » Par une gymnastique inverse, moi qui avaisessayé par la pensée d’ajouter à Rachel tout ce queSaint-Loup lui avait ajouté de lui-même, j’essayaisd’ôter mon apport cardiaque et mental dans lacomposition d’<strong>Albertine</strong> et de me la représenter tellequ’elle devait apparaître à Saint-Loup, comme à moiRachel. Ces différences-là, quand même nous lesverrions nous-même, quelle importance y ajouterionsnousi?Quand autrefois à Balbec <strong>Albertine</strong> m’attendaitsous les arcades d’Incarville et sautait dans ma voiture,non seulement elle n’avait pas encore « épaissi », maisà la suite d’excès d’exercice elle avait trop fondui;
maigre, enlaidie par un vilain chapeau qui ne laissaitdépasser qu’un petit bout de vilain nez et voir de côtédes joues blanches comme des vers blancs, je retrouvaisbien peu d’elle, assez cependant pour qu’au saut qu’ellefaisait dans ma voiture je susse que c’était elle, qu’elleavait été exacte au rendez-vous et n’était pas alléeailleursi; et cela suffiti; ce qu’on aime est trop dans lepassé, consiste trop dans le temps perdu ensemble pourqu’on ait besoin de toute la femmei; on veut seulementêtre sûr que c’est elle, ne pas se tromper sur l’identité,autrement importante que la beauté pour ceux quiaimenti; les joues peuvent se creuser, le corpss’amaigrir, même pour ceux qui ont été d’abord le plusorgueilleux aux yeux des autres, de leur domination surune beauté, ce petit bout de museau, ce signe où serésume la personnalité permanente d’une femme, cetextrait algébrique, cette constance, cela suffit pourqu’un homme attendu dans le plus grand monde, et quil’aimerait, ne puisse disposer d’une seule de ses soiréesparce qu’il passe son temps à peigner et à dépeigner,jusqu’à l’heure de s’endormir, la femme qu’il aime, ousimplement à rester auprès d’elle, pour être avec elle,ou pour qu’elle soit avec lui, ou seulement pour qu’ellene soit pas avec d’autres.« Tu es sûr, me dit Robert, que je peux offrir commecela à cette femme trente mille francs pour le comitéélectoral de son marii? Elle est malhonnête à ce point-
lài? Si tu ne te trompes pas, trois mille francssuffiraient. – Non, je t’en prie, n’économise pas pourune chose qui me tient tant à cœur. Tu dois dire ceci, oùil y a du reste une part de vérité.: « Mon ami avaitdemandé ces trente mille francs à un parent pour lecomité de l’oncle de sa fiancée. C’est à cause de cetteraison de fiançailles qu’on les lui avait donnés. Et ilm’avait prié de vous les porter pour qu’<strong>Albertine</strong> n’ensût rien. Et puis voici qu’<strong>Albertine</strong> le quitte. Il ne saitplus que faire. Il est obligé de rendre les trente millefrancs s’il n’épouse pas <strong>Albertine</strong>. Et s’il l’épouse, ilfaudrait qu’au moins pour la forme elle revîntimmédiatement, parce que cela ferait trop mauvais effetsi la fugue se prolongeait. » Tu crois que c’est inventéexprèsi? – Mais non », me répondit Saint-Loup parbonté, par discrétion et puis parce qu’il savait que lescirconstances sont souvent plus bizarres qu’on ne croit.Après tout, il n’y avait aucune impossibilité à ce quedans cette histoire des trente mille francs il y eût,comme je le lui disais, une grande part de vérité. C’étaitpossible, mais ce n’était pas vrai et cette part de véritéétait justement un mensonge. Mais nous nous mentions,Robert et moi, comme dans tous les entretiens où unami désire sincèrement aider son ami en proie à undésespoir d’amour. L’ami conseil, appui, consolateur,peut plaindre la détresse de l’autre, non la ressentir, etmeilleur il est pour lui, plus il ment. Et l’autre lui avoue
ce qui est nécessaire pour être aidé, mais, justementpeut-être pour être aidé, cache bien des choses. Etl’heureux est tout de même celui qui prend de la peine,qui fait un voyage, qui remplit une mission, mais quin’a pas de souffrance intérieure. J’étais en ce momentcelui qu’avait été Robert à Doncières quand il s’étaitcru quitté par Rachel. « Enfin, comme tu voudrasi; sij’ai une avanie, je l’accepte d’avance pour toi. Et puiscela a beau me paraître un peu drôle, ce marché si peuvoilé, je sais bien que dans notre monde il y a desduchesses, et même des plus bigotes, qui feraient pourtrente mille francs des choses plus difficiles que de direà leur nièce de ne pas rester en Touraine. Enfin je suisdoublement content de te rendre service, puisqu’il fautcela pour que tu consentes à me voir. Si je me marie,ajouta-t-il, est-ce que nous ne nous verrons pasdavantage, est-ce que tu ne feras pas un peu de mamaison la tiennei?... » Il s’arrêta, ayant tout à couppensé, supposai-je alors, que si moi aussi je me mariais<strong>Albertine</strong> ne pourrait pas être pour sa femme unerelation intime. Et je me rappelai ce que les Cambremerm’avaient dit de son mariage probable avec la fille duprince de Guermantes. L’indicateur consulté, il vit qu’ilne pourrait partir que le soir. Françoise me demanda.:« Faut-il ôter du cabinet de travail le lit de M lle<strong>Albertine</strong>i? – Au contraire, dis-je, il faut le faire. »J’espérais qu’elle reviendrait d’un jour à l’autre et je ne
voulais même pas que Françoise pût supposer qu’il yavait doute. Il fallait que le départ d’<strong>Albertine</strong> eût l’aird’une chose convenue entre nous, qui n’impliquaitnullement qu’elle m’aimât moins. Mais Françoise meregarda avec un air sinon d’incrédulité, du moins dedoute. Elle aussi avait ses deux hypothèses. Ses narinesse dilataient, elle flairait la brouille, elle devait la sentirdepuis longtemps. Et si elle n’en était pas absolumentsûre, c’est peut-être seulement parce que, comme moi,elle se défiait de croire entièrement ce qui lui aurait faittrop de plaisir. Maintenant le poids de l’affaire nereposait plus sur mon esprit surmené mais sur Saint-Loup. Une allégresse me soulevait parce que j’avaispris une décision, parce que je me disais.: « J’airépondu du tac au tac, j’ai agi. » Saint-Loup devait êtreà peine dans le train que je me croisai dans monantichambre avec Bloch que je n’avais pas entendusonner, de sorte que force me fut de le recevoir uninstant. Il m’avait dernièrement rencontré avec<strong>Albertine</strong> (qu’il connaissait de Balbec) un jour où elleétait de mauvaise humeur. « J’ai dîné avec M.Bontemps, me dit-il, et comme j’ai une certaineinfluence sur lui, je lui ai dit que je m’étais attristé quesa nièce ne fût pas plus gentille avec toi, qu’il fallaitqu’il lui adressât des prières en ce sens. » J’étouffais decolère, ces prières et ces plaintes détruisaient tout l’effetde la démarche de Saint-Loup et me mettaient
directement en cause auprès d’<strong>Albertine</strong> que j’avaisl’air d’implorer. Pour comble de malheur Françoiserestée dans l’antichambre entendit tout cela. Je fis tousles reproches possibles à Bloch, lui disant que je nel’avais nullement chargé d’une telle commission et que,du reste, le fait était faux. Bloch à partir de ce momentlàne cessa plus de sourire, moins, je crois, de joie quede gêne de m’avoir contrarié. Il s’étonnait en riant desoulever une telle colère. Peut-être le disait-il pour ôterà mes yeux de l’importance à son indiscrète démarche,peut-être parce qu’il était d’un caractère lâche et vivantgaiement et paresseusement dans les mensonges,comme les méduses à fleur d’eau, peut-être parce que,même eût-il été d’une autre race d’hommes, les autres,ne pouvant se placer au même point de vue que nous,ne comprennent pas l’importance du mal que lesparoles dites au hasard peuvent nous faire. Je venais dele mettre à la porte, ne trouvant aucun remède àapporter à ce qu’il avait fait, quand on sonna denouveau et Françoise me remit une convocation chez lechef de la Sûreté. Les parents de la petite fille quej’avais amenée une heure chez moi avaient vouludéposer contre moi une plainte en détournement demineure. Il y a des moments de la vie où une sorte debeauté naît de la multiplicité des ennuis qui nousassaillent, entrecroisés comme des leitmotivewagnériens, de la notion aussi, émergente alors, que les
événements ne sont pas situés dans l’ensemble desreflets peints dans le pauvre petit miroir que portedevant elle l’intelligence et qu’elle appelle l’avenir,qu’ils sont en dehors et surgissent aussi brusquementque quelqu’un qui vient constater un flagrant délit.Déjà, laissé à lui-même, un événement se modifie, soitque l’échec nous l’amplifie ou que la satisfaction leréduise. Mais il est rarement seul. Les sentimentsexcités par chacun se contrarient, et c’est dans unecertaine mesure, comme je l’éprouvai en allant chez lechef de la Sûreté, un révulsif au moins momentané etassez agissant des tristesses sentimentales que la peur.Je trouvai à la Sûreté les parents qui m’insultèrent enme disant.: « Nous ne mangeons pas de ce pain-là », merendirent les cinq cents francs que je ne voulais pasreprendre, et le chef de la Sûreté qui, se proposantcomme inimitable exemple la facilité des présidentsd’assises à « reparties », prélevait un mot de chaquephrase que je disais, mot qui lui servait à en faire unespirituelle et accablante réponse. De mon innocencedans le fait il ne fut même pas question, car c’est laseule hypothèse que personne ne voulut admettre uninstant. Néanmoins les difficultés de l’inculpation firentque je m’en tirai avec un savon extrêmement violent,tant que les parents furent là. Mais dès qu’ils furentpartis, le chef de la Sûreté, qui aimait les petites filles,changea de ton et me réprimanda comme un compère.:
« Une autre fois, il faut être plus adroit. Dame, on nefait pas des levages aussi brusquement que ça, ou çarate. D’ailleurs vous trouverez partout des petites fillesmieux que celle-là et pour bien moins cher. La sommeétait follement exagérée. » Je sentais tellement qu’il neme comprendrait pas si j’essayais de lui expliquer lavérité que je profitai sans mot dire de la permissionqu’il me donna de me retirer. Tous les passants, jusqu’àce que je fusse rentré, me parurent des inspecteurschargés d’épier mes faits et gestes. Mais ce leitmotiv-là,de même que celui de la colère contre Bloch,s’éteignirent pour ne plus laisser place qu’à celui dudépart d’<strong>Albertine</strong>. Or celui-là reprenait, mais sur unmode presque joyeux depuis que Saint-Loup était parti.Depuis qu’il s’était chargé d’aller voir M me Bontemps,mes souffrances avaient été dispersées. Je croyais quec’était pour avoir agi, je le croyais de bonne foi, car onne sait jamais ce qui se cache dans notre âme. Au fond,ce qui me rendait heureux, ce n’était pas de m’êtredéchargé de mes indécisions sur Saint-Loup, comme jele croyais. Je ne me trompais pas du reste absolumenti;le spécifique pour guérir un événement malheureux (lestrois quarts des événements le sont) c’est une décisioni;car elle a pour effet, par un brusque renversement denos pensées, d’interrompre le flux de celles quiviennent de l’événement passé et en prolongent lavibration, de le briser par un flux inverse de pensées
inverses, venu du dehors, de l’avenir. Mais ces penséesnouvelles nous sont surtout bienfaisantes (et c’était lecas pour celles qui m’assiégeaient en ce moment) quanddu fond de cet avenir c’est une espérance qu’elles nousapportent. Ce qui au fond me rendait si heureux, c’étaitla certitude secrète que, la mission de Saint-Loup nepouvant échouer, <strong>Albertine</strong> ne pouvait manquer derevenir. Je le comprisi; car n’ayant pas reçu dès lepremier jour de réponse de Saint-Loup, je recommençaià souffrir. Ma décision, ma remise à lui de mes pleinspouvoirs, n’étaient donc pas la cause de ma joie quisans cela eût duré, mais le « la réussite est sûre » quej’avais pensé quand je disais « Advienne que pourra ».Et la pensée, éveillée par son retard, qu’en effet autrechose que la réussite pouvait advenir, m’était si odieuseque j’avais perdu ma gaîté. C’est en réalité notreprévision, notre espérance d’événements heureux quinous gonfle d’une joie que nous attribuons à d’autrescauses et qui cesse pour nous laisser retomber dans lechagrin si nous ne sommes plus si assurés que ce quenous désirons se réalisera. C’est toujours cette invisiblecroyance qui soutient l’édifice de notre monde sensitif,et privé de quoi il chancelle. Nous avons vu qu’ellefaisait pour nous la valeur ou la nullité des êtres,l’ivresse ou l’ennui de les voir. Elle fait de même lapossibilité de supporter un chagrin qui nous semblemédiocre simplement parce que nous sommes
persuadés qu’il va y être mis fin, ou son brusqueagrandissement jusqu’à ce qu’une présence vailleautant, parfois même plus que notre vie. Une chose, dureste, acheva de rendre ma douleur au cœur aussi aiguëqu’elle avait été la première minute et qu’il faut bienavouer qu’elle n’était plus. Ce fut de relire une phrasede la lettre d’<strong>Albertine</strong>. Nous avons beau aimer lesêtres, la souffrance de les perdre, quand dansl’isolement nous ne sommes plus qu’en face d’elle, àqui notre esprit donne dans une certaine mesure laforme qu’il veut, cette souffrance est supportable etdifférente de celle moins humaine, moins nôtre, aussiimprévue et bizarre qu’un accident dans le mondemoral et dans la région du cœur, – qui a pour causemoins directement les êtres eux-mêmes que la façondont nous avons appris que nous ne les verrions plus.<strong>Albertine</strong>, je pouvais penser à elle en pleurantdoucement, en acceptant de ne pas plus la voir ce soirqu’hieri; mais relire « ma décision est irrévocable »,c’était autre chose, c’était comme prendre unmédicament dangereux, qui m’eût donné une crisecardiaque à laquelle on peut ne pas survivre. Il y a dansles choses, dans les événements, dans les lettres derupture, un péril particulier qui amplifie et dénature ladouleur même que les êtres peuvent nous causer. Maiscette souffrance dura peu. J’étais malgré tout si sûr dusuccès, de l’habileté de Saint-Loup, le retour
d’<strong>Albertine</strong> me paraissait une chose si certaine que jeme demandais si j’avais eu raison de le souhaiter.Pourtant je m’en réjouissais. Malheureusement pourmoi qui croyais l’affaire de la Sûreté finie, Françoisevint m’annoncer qu’un inspecteur était venu s’informersi je n’avais pas l’habitude d’avoir des jeunes filleschez moii; que le concierge, croyant qu’on parlaitd’<strong>Albertine</strong>, avait répondu que si, et que depuis cemoment la maison semblait surveillée. Dès lors il meserait à jamais impossible de faire venir une petite filledans mes chagrins pour me consoler, sans risquerd’avoir la honte devant elle qu’un inspecteur surgît etqu’elle me prît pour un malfaiteur. Et du même coup jecompris combien on vit plus pour certains rêves qu’onne croit, car cette impossibilité de bercer jamais unepetite fille me parut ôter à la vie toute valeur, mais deplus je compris combien il est compréhensible que lesgens aisément refusent la fortune et risquent la mort,alors qu’on se figure que l’intérêt et la peur de mourirmènent le monde. Car si j’avais pensé que même unepetite fille inconnue pût avoir, par l’arrivée d’unhomme de la police, une idée honteuse de moi, combienj’aurais mieux aimé me tuer. Il n’y avait même pas decomparaison possible entre les deux souffrances. Ordans la vie les gens ne réfléchissent jamais que ceux àqui ils offrent de l’argent, qu’ils menacent de mort,peuvent avoir une maîtresse, ou même simplement un
camarade, à l’estime de qui ils tiennent, même si cen’est pas à la leur propre. Mais tout à coup, par uneconfusion dont je ne m’avisai pas (je ne songeai pas, eneffet, qu’<strong>Albertine</strong>, étant majeure, pouvait habiter chezmoi et même être ma maîtresse), il me sembla que ledétournement de mineures pouvait s’appliquer aussi à<strong>Albertine</strong>. Alors la vie me parut barrée de tous les côtés.Et en pensant que je n’avais pas vécu chastement avecelle, je trouvai, dans la punition qui m’était infligéepour avoir forcé une petite fille inconnue à accepter del’argent, cette relation qui existe presque toujours dansles châtiments humains et qui fait qu’il n’y a presquejamais ni condamnation juste, ni erreur judiciaire, maisune espèce d’harmonie entre l’idée fausse que se fait lejuge d’un acte innocent et les faits coupables qu’il aignorés. Mais alors, en pensant que le retourd’<strong>Albertine</strong> pouvait amener pour moi unecondamnation infamante qui me dégraderait à ses yeuxet peut-être lui ferait à elle-même un tort qu’elle ne mepardonnerait pas, je cessai de souhaiter ce retour, ilm’épouvanta. J’aurais voulu lui télégraphier de ne pasrevenir. Et aussitôt, noyant tout le reste, le désirpassionné qu’elle revînt m’envahit. C’est qu’ayantenvisagé un instant la possibilité de lui dire de ne pasrevenir et de vivre sans elle, tout d’un coup je me sentisau contraire prêt à sacrifier tous les voyages, tous lesplaisirs, tous les travaux, pour qu’<strong>Albertine</strong> revînt,!
Ah,! combien mon amour pour <strong>Albertine</strong>, dont j’avaiscru que je pourrais prévoir le destin d’après celui quej’avais eu pour Gilberte, s’était développé en parfaitcontraste avec ce dernier,! Combien rester sans la voirm’était impossible,! Et pour chaque acte, même le plusminime, mais qui baignait auparavant dansl’atmosphère heureuse qu’était la présence d’<strong>Albertine</strong>,il me fallait chaque fois, à nouveaux frais, avec lamême douleur, recommencer l’apprentissage de laséparation. Puis la concurrence des autres formes de lavie rejeta dans l’ombre cette nouvelle douleur, etpendant ces jours-là, qui furent les premiers duprintemps, j’eus même, en attendant que Saint-Loup pûtvoir M me Bontemps, à imaginer Venise et de bellesfemmes inconnues, quelques moments de calmeagréable. Dès que je m’en aperçus, je sentis en moi uneterreur panique. Ce calme que je venais de goûter,c’était la première apparition de cette grande forceintermittente, qui allait lutter en moi contre la douleur,contre l’amour, et finirait par en avoir raison. Ce dont jevenais d’avoir l’avant-goût et d’apprendre le présage,c’était pour un instant seulement ce qui plus tard seraitchez moi un état permanent, une vie où je ne pourraisplus souffrir pour <strong>Albertine</strong>, où je ne l’aimerais plus. Etmon amour qui venait de reconnaître le seul ennemi parlequel il pût être vaincu, l’Oubli, se mit à frémir,comme un lion qui dans la cage où on l’a enfermé a
aperçu tout d’un coup le serpent python qui le dévorera.Je pensais tout le temps à <strong>Albertine</strong>, et jamaisFrançoise en entrant dans ma chambre ne me disaitassez vite.: « Il n’y a pas de lettres », pour abrégerl’angoisse. Mais de temps en temps je parvenais, enfaisant passer tel ou tel courant d’idées au travers demon chagrin, à renouveler, à aérer un peu l’atmosphèreviciée de mon cœuri; mais le soir, si je parvenais àm’endormir, alors c’était comme si le souvenird’<strong>Albertine</strong> avait été le médicament qui m’avait procuréle sommeil, et dont l’influence, en cessant m’éveillerait.Je pensais tout le temps à <strong>Albertine</strong> en dormant. C’étaitun sommeil spécial à elle, qu’elle me donnait et où, dureste, je n’aurais plus été libre comme pendant la veillede penser à autre chose. Le sommeil, son souvenir,c’étaient les deux substances mêlées qu’on nous faitprendre à la fois pour dormir. Réveillé, du reste, masouffrance allait en augmentant chaque jour au lieu dediminuer, non que l’oubli n’accomplît son œuvre, mais,là même, il favorisait l’idéalisation de l’image regrettéeet par là l’assimilation de ma souffrance initiale àd’autres souffrances analogues qui la renforçaient.Encore cette image était-elle supportable. Mais si toutd’un coup je pensais à sa chambre, à sa chambre où lelit restait vide, à son piano, à son automobile, je perdaistoute force, je fermais les yeux, j’inclinais ma tête surl’épaule comme ceux qui vont défaillir. Le bruit des
portes me faisait presque aussi mal parce que ce n’étaitpas elle qui les ouvrait.Quand il put y avoir un télégramme de Saint-Loup,je n’osai pas demander.: « Est-ce qu’il y a untélégrammei? » Il en vint un enfin, mais qui ne faisaitque tout reculer, me disant.: « Ces dames sont partiespour trois jours. » Sans doute, si j’avais supporté lesquatre jours qu’il y avait déjà depuis qu’elle était partie,c’était parce que je me disais.: « Ce n’est qu’une affairede temps, avant la fin de la semaine elle sera là. » Maiscette raison n’empêchait pas que pour mon cœur, pourmon corps, l’acte à accomplir était le même.: vivre sanselle, rentrer chez moi sans la trouver, passer devant laporte de sa chambre – l’ouvrir, je n’avais pas encore lecourage – en sachant qu’elle n’y était pas, me couchersans lui avoir dit bonsoir, voilà les choses que moncœur avait dû accomplir dans leur terrible intégralité ettout de même que si je n’avais pas dû revoir <strong>Albertine</strong>.Or qu’il l’eût accompli déjà quatre fois prouvait qu’ilétait maintenant capable de continuer à l’accomplir. Etbientôt peut-être la raison qui m’aidait à continuer ainsià vivre – le prochain retour d’<strong>Albertine</strong> – je cesseraisd’en avoir besoin (je pourrais me dire.: « Elle nereviendra jamais », et vivre tout de même commej’avais déjà fait pendant quatre jours) comme un blesséqui a repris l’habitude de la marche et peut se passer deses béquilles. Sans doute le soir en rentrant je trouvais
encore, m’ôtant la respiration, m’étouffant du vide de lasolitude, les souvenirs, juxtaposés en une interminablesérie, de tous les soirs où <strong>Albertine</strong> m’attendaiti; maisdéjà je trouvais ainsi le souvenir de la veille, de l’avantveilleet des deux soirs précédents, c’est-à-dire lesouvenir des quatre soirs écoulés depuis le départd’<strong>Albertine</strong>, pendant lesquels j’étais resté sans elle,seul, où cependant j’avais vécu, quatre soirs déjà,faisant une bande de souvenirs bien mince à côté del’autre, mais que chaque jour qui s’écoulerait allaitpeut-être étoffer. Je ne dirai rien de la lettre dedéclaration que je reçus à ce moment-là d’une nièce deM me de Guermantes, qui passait pour la plus jolie jeunefille de Paris, ni de la démarche que fit auprès de moi leduc de Guermantes de la part des parents résignés pourle bonheur de leur fille à l’inégalité du parti, à unesemblable mésalliance. De tels incidents qui pourraientêtre sensibles à l’amour-propre sont trop douloureuxquand on aime. On aurait le désir et on n’aurait pasl’indélicatesse de les faire connaître à celle qui porte surnous un jugement moins favorable, qui ne serait dureste pas modifié si elle apprenait qu’on peut êtrel’objet d’un tout différent. Ce que m’écrivait la nièce duduc n’eût pu qu’impatienter <strong>Albertine</strong>. Comme depuisle moment où j’étais éveillé et où je reprenais monchagrin à l’endroit où j’en étais resté avant dem’endormir, comme un livre un instant fermé et qui ne
me quitterait plus jusqu’au soir, ce ne pouvait jamaisêtre qu’à une pensée concernant <strong>Albertine</strong> que venait seraccorder pour moi toute sensation, qu’elle me vînt dudehors ou du dedans. On sonnait.: c’est une lettre d’elle,c’est elle-même peut-être,! Si je me sentais bienportant, pas trop malheureux, je n’étais plus jaloux, jen’avais plus de griefs contre elle, j’aurais voulu vite larevoir, l’embrasser, passer gaiement toute ma vie avecelle. Lui télégraphier.: « Venez vite » me semblaitdevenu une chose toute simple comme si mon humeurnouvelle avait changé non pas seulement mesdispositions, mais les choses hors de moi, les avaitrendues plus faciles. Si j’étais d’humeur sombre, toutesmes colères contre elle renaissaient, je n’avais plusenvie de l’embrasser, je sentais l’impossibilité d’êtrejamais heureux par elle, je ne voulais plus que lui fairedu mal et l’empêcher d’appartenir aux autres. Mais deces deux humeurs opposées le résultat était identique, ilfallait qu’elle revînt au plus tôt. Et pourtant, quelquejoie que pût me donner au moment même ce retour, jesentais que bientôt les mêmes difficultés seprésenteraient et que la recherche du bonheur dans lasatisfaction du désir moral était quelque chose d’aussinaïf que l’entreprise d’atteindre l’horizon en marchantdevant soi. Plus le désir avance, plus la possessionvéritable s’éloigne. De sorte que si le bonheur, ou dumoins l’absence de souffrances, peut être trouvé, ce
n’est pas la satisfaction, mais la réduction progressive,l’extinction finale du désir qu’il faut chercher. Oncherche à voir ce qu’on aime, on devrait chercher à nepas le voir, l’oubli seul finit par amener l’extinction dudésir. Et j’imagine que si un écrivain émettait desvérités de ce genre, il dédierait le livre qui lescontiendrait à une femme, dont il se plairait ainsi à serapprocher, lui disant.: ce livre est le tien. Et ainsi,disant des vérités dans son livre, il mentirait dans sadédicace, car il ne tiendra à ce que le livre soit à cettefemme que comme à cette pierre qui vient d’elle et quine lui sera chère qu’autant qu’il aimera la femme. Lesliens entre un être et nous n’existent que dans notrepensée. La mémoire en s’affaiblissant les relâche, etmalgré l’illusion dont nous voudrions être dupes, etdont par amour, par amitié, par politesse, par respecthumain, par devoir, nous dupons les autres, nousexistons seuls. L’homme est l’être qui ne peut sortir desoi, qui ne connaît les autres qu’en soi, et, en disant lecontraire, ment. Et j’aurais eu si peur, si on avait étécapable de le faire, qu’on m’ôtât ce besoin d’elle, cetamour d’elle, que je me persuadais qu’il était précieuxpour ma vie. Pouvoir entendre prononcer sans charmeet sans souffrance les noms des stations par où le trainpassait pour aller en Touraine m’eût semblé unediminution de moi-même (simplement au fond parceque cela eût prouvé qu’<strong>Albertine</strong> me devenait
indifférente)i; il était bien, me disais-je, qu’en medemandant sans cesse ce qu’elle pouvait faire, penser,vouloir, à chaque instant, si elle comptait, si elle allaitrevenir, je tinsse ouverte cette porte de communicationque l’amour avait pratiquée en moi, et sentisse la vied’une autre submerger par des écluses ouvertes leréservoir qui n’aurait pas voulu redevenir stagnant.Bientôt, le silence de Saint-Loup se prolongeant,une anxiété secondaire – l’attente d’un nouveautélégramme, d’un téléphonage de Saint-Loup – masquala première, l’inquiétude du résultat, savoir si <strong>Albertine</strong>reviendrait. Épier chaque bruit dans l’attente dutélégramme me devenait si intolérable qu’il mesemblait que, quel qu’il fût, l’arrivée de ce télégramme,qui était la seule chose à laquelle je pensais maintenant,mettrait fin à mes souffrances. Mais quand j’eus reçuenfin un télégramme de Robert où il me disait qu’ilavait vu M me Bontemps, mais, malgré toutes sesprécautions, avait été vu par <strong>Albertine</strong>, que cela avaitfait tout manquer, j’éclatai de fureur et de désespoir, carc’était là ce que j’avais voulu avant tout éviter. Connud’<strong>Albertine</strong>, le voyage de Saint-Loup me donnait un airde tenir à elle qui ne pouvait que l’empêcher de reveniret dont l’horreur d’ailleurs était tout ce que j’avaisgardé de la fierté que mon amour avait au temps deGilberte et qu’il avait perdue. Je maudissais Robert.Puis me dis que si ce moyen avait échoué, j’en
prendrais un autre. Puisque l’homme peut agir sur lemonde extérieur, comment, en faisant jouer la ruse,l’intelligence, l’intérêt, l’affection, n’arriverais-je pas àsupprimer cette chose atroce.: l’absence d’<strong>Albertine</strong>i?On croit que selon son désir on changera autour de soiles choses, on le croit parce que, hors de là, on ne voitaucune solution favorable. On ne pense pas à celle quise produit le plus souvent et qui est favorable aussi.:nous n’arrivons pas à changer les choses selon notredésir, mais peu à peu notre désir change. La situationque nous espérions changer parce qu’elle nous étaitinsupportable nous devient indifférente. Nous n’avonspas pu surmonter l’obstacle, comme nous le voulionsabsolument, mais la vie nous l’a fait tourner, dépasser,et c’est à peine alors si en nous retournant vers lelointain du passé nous pouvons l’apercevoir, tant il estdevenu imperceptible. J’entendis à l’étage au-dessus dunôtre des airs joués par une voisine. J’appliquais leursparoles que je connaissais à <strong>Albertine</strong> et à moi et je fusrempli d’un sentiment si profond que je me mis àpleurer. C’était.:Hélas, l’oiseau qui fuit ce qu’il croit l’esclavage,D’un vol désespéré revient battre au vitrageet la mort de Manon.:
avant même qu’il fût revenu selon mes instructions,c’est d’<strong>Albertine</strong> elle-même que je reçus cette lettre.:« Mon ami, vous avez envoyé votre ami Saint-Loupà ma tante, ce qui était insensé. Mon cher ami, si vousaviez besoin de moi pourquoi ne pas m’avoir écritdirectementi? J’aurais été trop heureuse de reveniri; nerecommencez plus ces démarches absurdes. » « J’auraisété trop heureuse de revenir,! » Si elle disait cela, c’estdonc qu’elle regrettait d’être partie, qu’elle ne cherchaitqu’un prétexte pour revenir. Donc je n’avais qu’à fairece qu’elle me disait, à lui écrire que j’avais besoind’elle, et elle reviendrait. J’allais donc la revoir, elle,l’<strong>Albertine</strong> de Balbec (car, depuis son départ, elle l’étaitredevenue pour moii; comme un coquillage auquel onne fait plus attention quand on l’a toujours sur sacommode, une fois qu’on s’en est séparé pour ledonner, ou l’ayant perdu, et qu’on pense à lui, ce qu’onne faisait plus, elle me rappelait toute la beauté joyeusedes montagnes bleues de la mer). Et ce n’est passeulement elle qui était devenue un être d’imagination,c’est-à-dire désirable, mais la vie avec elle qui étaitdevenue une vie imaginaire, c’est-à-dire affranchie detoutes difficultés, de sorte que je me disais.: « Commenous allons être heureux,! » Mais du moment quej’avais l’assurance de ce retour, il ne fallait pas avoirl’air de le hâter, mais au contraire effacer le mauvaiseffet de la démarche de Saint-Loup que je pourrais
toujours plus tard désavouer en disant qu’il avait agi delui-même, parce qu’il avait toujours été partisan de cemariage. Cependant, je relisais sa lettre et j’étais tout demême déçu du peu qu’il y a d’une personne dans unelettre. Sans doute les caractères tracés expriment notrepensée, ce que font aussi nos traits.: c’est toujours enprésence d’une pensée que nous nous trouvons. Maistout de même, dans la personne, la pensée ne nousapparaît qu’après s’être diffusée dans cette corolle duvisage épanouie comme un nymphéa. Cela la modifietout de même beaucoup. Et c’est peut-être une descauses de nos perpétuelles déceptions en amour que cesperpétuelles déviations qui font qu’à l’attente de l’êtreidéal que nous aimons, chaque rendez-vous nousapporte, en réponse, une personne de chair qui tientdéjà si peu de notre rêve. Et puis quand nous réclamonsquelque chose de cette personne, nous recevons d’elleune lettre où même de la personne il reste très peu,comme, dans les lettres de l’algèbre, il ne reste plus ladétermination des chiffres de l’arithmétique, lesquelsdéjà ne contiennent plus les qualités des fruits ou desfleurs additionnés. Et pourtant, l’amour, l’être aimé, seslettres, sont peut-être tout de même des traductions (siinsatisfaisant qu’il soit de passer de l’un à l’autre) de lamême réalité, puisque la lettre ne nous sembleinsuffisante qu’en la lisant, mais que nous suons mort etpassion tant qu’elle n’arrive pas, et qu’elle suffit à
tentation. Mais je n’ai pas grand mérite à y résister.Vous savez l’être inconstant que je suis et commej’oublie vite. Vous me l’avez dit souvent, je suis surtoutun homme d’habitudes. Celles que je commence àprendre sans vous ne sont pas encore bien fortes.Évidemment, en ce moment, celles que j’avais avecvous et que votre départ a troublées sont encore les plusfortes. Elles ne le seront plus bien longtemps. Même, àcause de cela, j’avais pensé à profiter de ces quelquesderniers jours où nous voir ne serait pas encore pourmoi ce que ce sera dans une quinzaine, plus tôt peutêtre(pardonnez-moi ma franchise).: un dérangement, –j’avais pensé à en profiter, avant l’oubli final, pourrégler avec vous de petites questions matérielles oùvous auriez pu, bonne et charmante amie, rendre serviceà celui qui s’est cru cinq minutes votre fiancé. Commeje ne doutais pas de l’approbation de ma mère, comme,d’autre part, je désirais que nous ayons chacun toutecette liberté dont vous m’aviez trop gentiment etabondamment fait un sacrifice qui se pouvait admettrepour une vie en commun de quelques semaines, maisqui serait devenu aussi odieux à vous qu’à moimaintenant que nous devions passer toute notre vieensemble (cela me fait presque de la peine, en vousécrivant, de penser que cela a failli être, qu’il s’en estfallu de quelques secondes), j’avais pensé à organisernotre existence de la façon la plus indépendante
possible, et pour commencer j’avais voulu que vouseussiez ce yacht où vous auriez pu voyager pendantque, trop souffrant, je vous eusse attendue au port(j’avais écrit à Elstir pour lui demander conseil, commevous aimez son goût), et pour la terre j’avais voulu quevous eussiez votre automobile à vous, rien qu’à vous,dans laquelle vous sortiriez, vous voyageriez à votrefantaisie. Le yacht était déjà presque prêt, il s’appelle,selon votre désir exprimé à Balbec, le Cygne. Et merappelant que vous préfériez à toutes les autres lesvoitures Rolls, j’en avais commandé une. Ormaintenant que nous ne nous verrons plus jamais,comme je n’espère pas vous faire accepter le bateau nila voiture (pour moi ils ne pourraient servir à rien),j’avais pensé – comme je les avais commandés à unintermédiaire, mais en donnant votre nom – que vouspourriez peut-être en les décommandant, vous, m’éviterle yacht et cette voiture devenus inutiles. Mais pourcela, et pour bien d’autres choses, il aurait fallu causer.Or je trouve que tant que je suis susceptible de vousréaimer, ce qui ne durera plus longtemps, il serait fou,pour un bateau à voiles et une Rolls Royce, de nousvoir et de jouer le bonheur de votre vie puisque vousestimez qu’il est de vivre loin de moi. Non, je préfèregarder la Rolls et même le yacht. Et comme je ne meservirai pas d’eux et qu’ils ont chance de restertoujours, l’un au port, désarmé, l’autre à l’écurie, je
ferai graver sur le... (mon Dieu, je n’ose pas mettre unnom de pièce inexact et commettre une hérésie qui vouschoquerait) du yacht ces vers de Mallarmé que vousaimiez.:Un cygne d’autrefois se souvient que c’est luiMagnifique mais qui sans espoir se délivrePour n’avoir pas chanté la région où vivreQuand du stérile hiver a resplendi l’ennui.» Vous vous rappelez – c’est le poème quicommence par.: Le vierge, le vivace et le belaujourd’hui... Hélas, « aujourd’hui » n’est plus nivierge, ni beau. Mais ceux qui comme moi savent qu’ilsen feront bien vite un « demain » supportable ne sontguère supportables. Quant à la Rolls, elle eût méritéplutôt ces autres vers du même poète que vous disiez nepouvoir comprendre.:Dis si je ne suis pas joyeuxTonnerre et rubis aux moyeuxDe voir en l’air que ce feu troueAvec des royaumes éparsComme mourir pourpre la roueDu seul vespéral de mes chars.
» Adieu pour toujours, ma petite <strong>Albertine</strong>, et merciencore de la bonne promenade que nous fîmesensemble la veille de notre séparation. J’en garde unbien bon souvenir. »« P.-S. – Je ne réponds pas à ce que vous me ditesde prétendues propositions que Saint-Loup (que je necrois d’ailleurs nullement en Touraine) aurait faites àvotre tante. C’est du Sherlock Holmes. Quelle idée vousfaites-vous de moii? »Sans doute, de même que j’avais dit autrefois à<strong>Albertine</strong>.: « Je ne vous aime pas », pour qu’ellem’aimâti; « J’oublie quand je ne vois pas les gens »,pour qu’elle me vît très souventi; « J’ai décidé de vousquitter », pour prévenir toute idée de séparation,maintenant c’était parce que je voulais absolumentqu’elle revînt dans les huit jours que je lui disais.:« Adieu pour toujours »i; c’est parce que je voulais larevoir que je lui disais.: « Je trouverais dangereux devous voir »i; c’est parce que vivre séparé d’elle mesemblait pire que la mort que je lui écrivais.: « Vousavez eu raison, nous serions malheureux ensemble. »Hélas, cette lettre feinte, en l’écrivant pour avoir l’airde ne pas tenir à elle et aussi pour la douceur de direcertaines choses qui ne pouvaient émouvoir que moi et
non elle, j’aurais dû d’abord prévoir qu’il était possiblequ’elle eût pour effet une réponse négative, c’est-à-direconsacrant ce que je disaisi; qu’il était même probableque ce serait, car <strong>Albertine</strong> eût-elle été moinsintelligente qu’elle n’était, elle n’eût pas douté uninstant que ce que je disais était faux. Sans s’arrêter, eneffet, aux intentions que j’énonçais dans cette lettre, leseul fait que je l’écrivisse, n’eût-il même pas succédé àla démarche de Saint-Loup, suffisait pour lui prouverque je désirais qu’elle revînt et pour lui conseiller de melaisser m’enferrer dans l’hameçon de plus en plus. Puis,après avoir prévu la possibilité d’une réponse négative,j’aurais dû toujours prévoir que brusquement cetteréponse me rendrait dans sa plus extrême vivacité monamour pour <strong>Albertine</strong>. Et j’aurais dû, toujours avantd’envoyer ma lettre, me demander si, au cas où<strong>Albertine</strong> répondrait sur le même ton et ne voudrait pasrevenir, je serais assez maître de ma douleur pour meforcer à rester silencieux, à ne pas lui télégraphier.:« Revenez » ou à ne pas lui envoyer quelque autreémissaire, ce qui, après lui avoir écrit que nous ne nousreverrions pas, était lui montrer avec la dernièreévidence que je ne pouvais me passer d’elle, etaboutirait à ce qu’elle refusât plus énergiquementencore, à ce que, ne pouvant plus supporter monangoisse, je partisse chez elle, qui saiti? peut-être à ceque je n’y fusse pas reçu. Et sans doute c’eût été, après
trois énormes maladresses, la pire de toutes, aprèslaquelle il n’y avait plus qu’à me tuer devant sa maison.Mais la manière désastreuse dont est construit l’universpsycho-pathologique veut que l’acte maladroit, l’actequ’il faudrait avant tout éviter, soit justement l’actecalmant, l’acte qui, ouvrant pour nous, jusqu’à ce quenous en sachions le résultat, de nouvelles perspectivesd’espérance, nous débarrasse momentanément de ladouleur intolérable que le refus a fait naître en nous. Desorte que, quand la douleur est trop forte, nous nousprécipitons dans la maladresse qui consiste à écrire, àfaire prier par quelqu’un, à aller voir, à prouver qu’onne peut se passer de celle qu’on aime. Mais je ne prévisrien de tout cela. Le résultat de cette lettre me paraissaitêtre au contraire de faire revenir <strong>Albertine</strong> au plus vite.Aussi en pensant à ce résultat, avais-je eu une grandedouceur à l’écrire. Mais en même temps je n’avaiscessé en écrivant de pleureri; d’abord un peu de lamême manière que le jour où j’avais joué la fausseséparation, parce que, ces mots me représentant l’idéequ’ils m’exprimaient quoiqu’ils tendissent à un butcontraire (prononcés mensongèrement pour ne pas, parfierté, avouer que j’aimais), ils portaient en eux leurtristesse, mais aussi parce que je sentais que cette idéeavait de la vérité.Le résultat de cette lettre me paraissant certain, jeregrettai de l’avoir envoyée. Car en me représentant le
etour, en somme si aisé, d’<strong>Albertine</strong>, brusquementtoutes les raisons qui rendaient notre mariage une chosemauvaise pour moi revinrent avec toute leur force.J’espérai qu’elle refuserait de revenir. J’étais en train decalculer que ma liberté, tout l’avenir de ma vie étaientsuspendus à son refusi; que j’avais fait une folied’écrirei; que j’aurais dû reprendre ma lettre hélaspartie, quand Françoise en me donnant aussi le journalqu’elle venait de monter me la rapporta. Elle ne savaitpas avec combien de timbres elle devait l’affranchir.Mais aussitôt je changeai d’avisi; je souhaitaisqu’<strong>Albertine</strong> ne revînt pas, mais je voulais que cettedécision vînt d’elle pour mettre fin à mon anxiété, et jerésolus de rendre la lettre à Françoise. J’ouvris lejournal, il annonçait une représentation de la Berma.Alors je me souvins des deux façons différentes dontj’avais écouté Phèdre, et ce fut maintenant d’unetroisième que je pensai à la scène de la déclaration. Ilme semblait que ce que je m’étais si souvent récité àmoi-même, et que j’avais écouté au théâtre, c’étaitl’énoncé des lois que je devais expérimenter dans mavie. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous nesavons pas combien nous tenons. Ou bien si nousvivons sans elles, c’est parce que nous remettons dejour en jour, par peur d’échouer, ou de souffrir, d’entreren leur possession. C’est ce qui m’était arrivé pourGilberte quand j’avais cru renoncer à elle. Qu’avant le
moment où nous sommes tout à fait détachés de ceschoses – moment bien postérieur à celui où nous nousen croyons détachés – la jeune fille que nous aimons,par exemple, se fiance, nous sommes fous, nous nepouvons plus supporter la vie qui nous paraissait simélancoliquement calme. Ou bien si la chose est ennotre possession, nous croyons qu’elle nous est àcharge, que nous nous en déferions volontiers. C’est cequi m’était arrivé pour <strong>Albertine</strong>. Mais que par undépart l’être indifférent nous soit retiré, et nous nepouvons plus vivre. Or l’« argument » de Phèdre neréunissait-il pas les deux casi? Hippolyte va partir.Phèdre qui jusque-là a pris soin de s’offrir à soninimitié, par scrupule, dit-elle, ou plutôt lui fait dire lepoète, parce qu’elle ne voit pas à quoi elle arriverait etqu’elle ne se sent pas aimée, Phèdre n’y tient plus. Ellevient lui avouer son amour, et c’est la scène que jem’étais si souvent récitée.: « On dit qu’un promptdépart vous éloigne de nous. » Sans doute cette raisondu départ d’Hippolyte est accessoire, peut-on penser, àcôté de celle de la mort de Thésée. Et de même quand,quelques vers plus loin, Phèdre fait un instant semblantd’avoir été mal comprise.: « Aurais-je perdu tout le soinde ma gloire », on peut croire que c’est parcequ’Hippolyte a repoussé sa déclaration.: « Madame,oubliez-vous que Thésée est mon père, et qu’il est votreépouxi? » Mais il n’aurait pas eu cette indignation, que,
devant le bonheur atteint, Phèdre aurait pu avoir lemême sentiment qu’il valait peu de chose. Mais dèsqu’elle voit qu’il n’est pas atteint, qu’Hippolyte croitavoir mal compris et s’excuse, alors, comme moivoulant rendre à Françoise ma lettre, elle veut que lerefus vienne de lui, elle veut pousser jusqu’au bout sachance.: « Ah,! cruel, tu m’as trop entendue. » Et il n’ya pas jusqu’aux duretés qu’on m’avait racontées deSwann envers Odette, ou de moi à l’égard d’<strong>Albertine</strong>,duretés qui substituèrent à l’amour antérieur un nouvelamour, fait de pitié, d’attendrissement, de besoind’effusion et qui ne faisait que varier le premier, qui nese trouvent aussi dans cette scène.: « Tu me haïssaisplus, je ne t’aimais pas moins. Tes malheurs teprêtaient encor de nouveaux charmes. » La preuve quele « soin de sa gloire » n’est pas ce à quoi tient le plusPhèdre, c’est qu’elle pardonnerait à Hippolyte ets’arracherait aux conseils d’Oenone si elle n’apprenait àce moment qu’Hippolyte aime Aricie. Tant la jalousie,qui en amour équivaut à la perte de tout bonheur, estplus sensible que la perte de la réputation. C’est alorsqu’elle laisse Oenone (qui n’est que le nom de la pirepartie d’elle-même) calomnier Hippolyte sans secharger « du soin de le défendre » et envoie ainsi celuiqui ne veut pas d’elle à un destin dont les calamités nela consolent d’ailleurs nullement elle-même, puisque samort volontaire suit de près la mort d’Hippolyte. C’est
du moins ainsi, en réduisant la part de tous les scrupules« jansénistes », comme eût dit Bergotte, que Racine adonnés à Phèdre pour la faire paraître moins coupable,que m’apparaissait cette scène, sorte de prophétie desépisodes amoureux de ma propre existence. Cesréflexions n’avaient d’ailleurs rien changé à madétermination, et je rendis ma lettre à Françoise pourqu’elle la mît enfin à la poste, afin de réaliser auprèsd’<strong>Albertine</strong> cette tentative qui me paraissaitindispensable depuis que j’avais appris qu’elle nes’était pas effectuée. Et sans doute, nous avons tort decroire que l’accomplissement de notre désir soit peu dechose, puisque dès que nous croyons qu’il peut ne passe réaliser nous y tenons de nouveau, et ne trouvonsqu’il ne valait pas la peine de le poursuivre que quandnous sommes bien sûrs de ne le manquer pas. Etpourtant on a raison aussi. Car si cet accomplissement,si le bonheur ne paraissent petits que par la certitude,cependant ils sont quelque chose d’instable d’où nepeuvent sortir que des chagrins. Et les chagrins serontd’autant plus forts que le désir aura été pluscomplètement accompli, plus impossibles à supporterque le bonheur aura été, contre la loi de nature, quelquetemps prolongé, qu’il aura reçu la consécration del’habitude. Dans un autre sens aussi, les deuxtendances, dans l’espèce celle qui me faisait tenir à ceque ma lettre partît, et, quand je la croyais partie, à la
egretter, ont l’une et l’autre en elles leur vérité. Pour lapremière, il est trop compréhensible que nous courionsaprès notre bonheur – ou notre malheur – et qu’enmême temps nous souhaitions de placer devant nous,par cette action nouvelle qui va commencer à déroulerses conséquences, une attente qui ne nous laisse pasdans le désespoir absolu, en un mot que nouscherchions à faire passer par d’autres formes que nousnous imaginons devoir nous être moins cruelles le maldont nous souffrons. Mais l’autre tendance n’est pasmoins importante, car, née de la croyance au succès denotre entreprise, elle est tout simplement lecommencement anticipé de la désillusion que nouséprouverions bientôt en présence de la satisfaction dudésir, le regret d’avoir fixé pour nous, aux dépens desautres qui se trouvent exclues, cette forme du bonheur.J’avais donné la lettre à Françoise en lui demandantd’aller vite la mettre à la poste. Dès que ma lettre futpartie je conçus de nouveau le retour d’<strong>Albertine</strong>comme imminent. Il ne laissait pas de mettre dans mapensée de gracieuses images qui neutralisaient bien unpeu par leur douceur les dangers que je voyais à ceretour. La douceur, perdue depuis si longtemps, del’avoir auprès de moi m’enivrait.Le temps passe, et peu à peu tout ce qu’on disait parmensonge devient vrai, je l’avais trop expérimenté avecGilbertei; l’indifférence que j’avais feinte quand je ne
cessais de sangloter avait fini par se réaliseri; peu à peula vie, comme je le disais à Gilberte en une formulemensongère et qui rétrospectivement était devenuevraie, la vie nous avait séparés. Je me le rappelais, jeme disais.: « Si <strong>Albertine</strong> laisse passer quelques mois,mes mensonges deviendront une vérité. Et maintenantque le plus dur est passé, ne serait-il pas à souhaiterqu’elle laissât passer ce moisi? Si elle revient, jerenoncerai à la vie véritable que, certes, je ne suis pasen état de goûter encore, mais qui progressivementpourra commencer à présenter pour moi des charmestandis que le souvenir d’<strong>Albertine</strong> ira ens’affaiblissant. »J’ai dit que l’oubli commençait à faire son œuvre.Mais un des effets de l’oubli était précisément – enfaisant que beaucoup des aspects déplaisantsd’<strong>Albertine</strong>, des heures ennuyeuses que je passais avecelle, ne se représentaient plus à ma mémoire, cessaientdonc d’être des motifs à désirer qu’elle ne fût plus làcomme je le souhaitais quand elle y était encore – deme donner d’elle une image sommaire, embellie de toutce que j’avais éprouvé d’amour pour d’autres. Souscette forme particulière, l’oubli, qui pourtant travaillaità m’habituer à la séparation, me faisait, en me montrant<strong>Albertine</strong> plus douce, souhaiter davantage son retour.Depuis qu’elle était partie, bien souvent, quand ilme semblait qu’on ne pouvait pas voir que j’avais
pleuré, je sonnais Françoise et je lui disais.: « Il faudravoir si Mademoiselle <strong>Albertine</strong> n’a rien oublié. Pensezà faire sa chambre, pour qu’elle soit bien en état quandelle viendra. » Ou simplement.: « Justement l’autre jourMademoiselle <strong>Albertine</strong> me disait, tenez justement laveille de son départ... » Je voulais diminuer chezFrançoise le détestable plaisir que lui causait le départd’<strong>Albertine</strong> en lui faisant entrevoir qu’il serait court. Jevoulais aussi montrer à Françoise que je ne craignaispas de parler de ce départ, le montrer – comme fontcertains généraux qui appellent des reculs forcés uneretraite stratégique et conforme à un plan préparé –comme voulu, comme constituant un épisode dont jecachais momentanément la vraie signification,nullement comme la fin de mon amitié avec <strong>Albertine</strong>.En la nommant sans cesse, je voulais enfin faire rentrer,comme un peu d’air, quelque chose d’elle dans cettechambre où son départ avait fait le vide et où je nerespirais plus. Puis on cherche à diminuer lesproportions de sa douleur en la faisant entrer dans lelangage parlé entre la commande d’un costume et desordres pour le dîner.En faisant la chambre d’<strong>Albertine</strong>, Françoise,curieuse, ouvrit le tiroir d’une petite table en bois derose où mon amie mettait les objets intimes qu’elle negardait pas pour dormir. « Oh,! Monsieur,Mademoiselle <strong>Albertine</strong> a oublié de prendre ses bagues,
elles sont restées dans le tiroir. » Mon premiermouvement fut de dire.: « Il faut les lui renvoyer. »Mais cela avait l’air de ne pas être certain qu’ellereviendrait. « Bien, répondis-je après un instant desilence, cela ne vaut guère la peine de les lui renvoyerpour le peu de temps qu’elle doit être absente. Donnezles-moi,je verrai. » Françoise me les remit avec unecertaine méfiance. Elle détestait <strong>Albertine</strong>, mais, mejugeant d’après elle-même, elle se figurait qu’on nepouvait me remettre une lettre écrite par mon amie sanscraindre que je l’ouvrisse. Je pris les bagues. « QueMonsieur y fasse attention de ne pas les perdre, ditFrançoise, on peut dire qu’elles sont belles,! Je ne saispas qui les lui a données, si c’est Monsieur ou un autre,mais je vois bien que c’est quelqu’un de riche et qui adu goût,! – Ce n’est pas moi, répondis-je à Françoise, etd’ailleurs ce n’est pas de la même personne queviennent les deux, l’une lui a été donnée par sa tante etelle a acheté l’autre. – Pas de la même personne,!s’écria Françoise, Monsieur veut rire, elles sontpareilles, sauf le rubis qu’on a ajouté sur l’une, il y a lemême aigle sur les deux, les mêmes initiales àl’intérieur... » Je ne sais pas si Françoise sentait le malqu’elle me faisait, mais elle commença à ébaucher unsourire qui ne quitta plus ses lèvres. « Comment, lemême aiglei? Vous êtes folle. Sur celle qui n’a pas derubis il y a bien un aigle, mais sur l’autre c’est une
espèce de tête d’homme qui est ciselée. – Une têted’hommei? où Monsieur a vu çai? Rien qu’avec meslorgnons j’ai tout de suite vu que c’était une des ailes del’aiglei; que Monsieur prenne sa loupe, il verra l’autreaile sur l’autre côté, la tête et le bec au milieu. On voitchaque plume. Ah,! c’est un beau travail. » L’anxieuxbesoin de savoir si <strong>Albertine</strong> m’avait menti me fitoublier que j’aurais dû garder quelque dignité enversFrançoise et lui refuser le plaisir méchant qu’elle avait,sinon à me torturer, du moins à nuire à mon amie. Jehaletais tandis que Françoise allait chercher ma loupe,je la pris, je demandai à Françoise de me montrerl’aigle sur la bague au rubis, elle n’eut pas de peine àme faire reconnaître les ailes, stylisées de la mêmefaçon que dans l’autre bague, le relief de chaque plume,la tête. Elle me fit remarquer aussi des inscriptionssemblables, auxquelles, il est vrai, d’autres étaientjointes dans la bague au rubis. Et à l’intérieur des deuxle chiffre d’<strong>Albertine</strong>. « Mais cela m’étonne queMonsieur ait eu besoin de tout cela pour voir que c’étaitla même bague, me dit Françoise. Même sans lesregarder de près on sent bien la même façon, la mêmemanière de plisser l’or, la même forme. Rien qu’à lesapercevoir j’aurais juré qu’elles venaient du mêmeendroit. Ça se reconnaît comme la cuisine d’une bonnecuisinière. » Et en effet, à sa curiosité de domestiqueattisée par la haine et habituée à noter des détails avec
une effrayante précision, s’était joint, pour l’aider danscette expertise, ce goût qu’elle avait, ce même goût eneffet qu’elle montrait dans la cuisine et qu’avivait peutêtre,comme je m’en étais aperçu, en partant pourBalbec dans sa manière de s’habiller, sa coquetterie defemme qui a été jolie, qui a regardé les bijoux et lestoilettes des autres. Je me serais trompé de boîte demédicament et, au lieu de prendre quelques cachets devéronal un jour où je sentais que j’avais bu trop detasses de thé, j’aurais pris autant de cachets de caféine,que mon cœur n’eût pas pu battre plus violemment. Jedemandai à Françoise de sortir de la chambre. J’auraisvoulu voir <strong>Albertine</strong> immédiatement. À l’horreur de sonmensonge, à la jalousie pour l’inconnu, s’ajoutait ladouleur qu’elle se fût laissé ainsi faire des cadeaux. Jelui en faisais plus, il est vrai, mais une femme que nousentretenons ne nous semble pas une femme entretenuetant que nous ne savons pas qu’elle l’est par d’autres. Etpourtant, puisque je n’avais cessé de dépenser pour elletant d’argent, je l’avais prise malgré cette bassessemoralei; cette bassesse je l’avais maintenue en elle, jel’avais peut-être accrue, peut-être créée. Puis, commenous avons le don d’inventer des contes pour bercernotre douleur, comme nous arrivons, quand nousmourons de faim, à nous persuader qu’un inconnu. vanous laisser une fortune de cent millions, j’imaginai<strong>Albertine</strong> dans mes bras, m’expliquant d’un mot que
c’était à cause de la ressemblance de la fabricationqu’elle avait acheté l’autre bague, que c’était elle qui yavait fait mettre ses initiales. Mais cette explicationétait encore fragile, elle n’avait pas encore eu le tempsd’enfoncer dans mon esprit ses racines bienfaisantes, etma douleur ne pouvait être si vite apaisée. Et jesongeais que tant d’hommes qui disent aux autres queleur maîtresse est bien gentille souffrent de pareillestortures. C’est ainsi qu’ils mentent aux autres et à euxmêmes.Ils ne mentent pas tout à faiti; ils ont avec cettefemme des heures vraiment doucesi; mais songez à toutce que cette gentillesse qu’elles ont pour eux devantleurs amis et qui leur permet de se glorifier, et à tout ceque cette gentillesse qu’elles ont seules avec leursamants et qui lui permet de les bénir, recouvrentd’heures inconnues où l’amant a souffert, douté, faitpartout d’inutiles recherches pour savoir la vérité. C’està de telles souffrances qu’est liée la douceur d’aimer, des’enchanter des propos les plus insignifiants d’unefemme qu’on sait insignifiants, mais qu’on parfume deson odeur. En ce moment, je ne pouvais plus medélecter à respirer par le souvenir celle d’<strong>Albertine</strong>.Atterré, les deux bagues à la main, je regardais cet aigleimpitoyable dont le bec me tenaillait le cœur, dont lesailes aux plumes en relief avaient emporté la confianceque je gardais dans mon amie, et sous les serres duquelmon esprit meurtri ne pouvait pas échapper un instant
aux questions posées sans cesse relativement à cetinconnu dont l’aigle symbolisait sans doute le nom sanspourtant me le laisser lire, qu’elle avait aimé sans douteautrefois, et qu’elle avait revu sans doute il n’y avaitpas longtemps, puisque c’est le jour si doux, si familial,de la promenade ensemble au Bois, que j’avais vu, pourla première fois, la seconde bague, celle où l’aigle avaitl’air de tremper son bec dans la nappe de sang clair durubis.Du reste si, du matin au soir, je ne cessais de souffrirdu départ d’<strong>Albertine</strong>, cela ne signifie pas que je nepensais qu’à elle. D’une part, son charme ayant depuislongtemps gagné de proche en proche des objets quifinissaient par en être très éloignés, mais n’étaient pasmoins électrisés par la même émotion qu’elle medonnait, si quelque chose me faisait penser à Incarvilleou aux Verdurin, ou à un nouveau rôle de Léa, un fluxde souffrance venait me frapper. D’autre part, moimême,ce que j’appelais penser à <strong>Albertine</strong> c’étaitpenser aux moyens de la faire revenir, de la rejoindre,de savoir ce qu’elle faisait. De sorte que si, pendant cesheures de martyre incessant, un graphique avait pureprésenter les images qui accompagnaient messouffrances, on eût aperçu celles de la gare d’Orsay, desbillets de banque offerts à M me Bontemps, de Saint-Loup penché sur le pupitre incliné d’un bureau detélégraphe où il remplissait une formule de dépêche
pour moi, jamais l’image d’<strong>Albertine</strong>. De même quedans tout le cours de notre vie notre égoïsme voit tout letemps devant lui les buts précieux pour notre moi, maisne regarde jamais ce Je lui-même qui ne cesse de lesconsidérer, de même le désir qui dirige nos actesdescend vers eux, mais ne remonte pas à soi, soit que,trop utilitaire, il se précipite dans l’action et dédaigne laconnaissance, soit que nous recherchions l’avenir pourcorriger les déceptions du présent, soit que la paresse del’esprit le pousse à glisser sur la pente aisée del’imagination plutôt qu’à remonter la pente abrupte del’introspection. En réalité, dans ces heures de crise oùnous jouerions toute notre vie, au fur et à mesure quel’être dont elle dépend révèle mieux l’immensité de laplace qu’il occupe pour nous, en ne laissant rien dans lemonde qui ne soit bouleversé par lui,proportionnellement l’image de cet être décroît jusqu’àne plus être perceptible. En toutes choses nous trouvonsl’effet de sa présence par l’émotion que nousressentonsi; lui-même, la cause, nous ne le trouvonsnulle part. Je fus pendant ces jours-là si incapable deme représenter <strong>Albertine</strong> que j’aurais presque pu croireque je ne l’aimais pas, comme ma mère, dans lesmoments de désespoir où elle fut incapable de sereprésenter jamais ma grand’mère (sauf une fois dans larencontre fortuite d’un rêve dont elle sentait tellementle prix, quoique endormie, qu’elle s’efforçait, avec ce
qui lui restait de forces dans le sommeil, de le fairedurer), aurait pu s’accuser et s’accusait en effet de nepas regretter sa mère, dont la mort la tuait mais dont lestraits se dérobaient à son souvenir.Pourquoi eussé-je cru qu’<strong>Albertine</strong> n’aimait pas lesfemmesi? Parce qu’elle avait dit, surtout les dernierstemps, ne pas les aimer.: mais notre vie ne reposait-ellepas sur un perpétuel mensongei? Jamais elle ne m’avaitdit une fois.: « Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortirlibrementi? pourquoi demandez-vous aux autres ce queje faisi? » Mais c’était, en effet, une vie trop singulièrepour qu’elle ne me l’eût pas demandé si elle n’avait pascompris pourquoi. Et à mon silence sur les causes de saclaustration, n’était-il pas compréhensible quecorrespondît de sa part un même et constant silence surses perpétuels désirs, ses souvenirs innombrables, sesinnombrables désirs et espérancesi? Françoise avaitl’air de savoir que je mentais quand je faisais allusionau prochain retour d’<strong>Albertine</strong>. Et sa croyance semblaitfondée sur un peu plus que sur cette vérité qui guidaitd’habitude notre domestique, que les maîtres n’aimentpas à être humiliés vis-à-vis de leurs serviteurs et neleur font connaître de la réalité que ce qui ne s’écartepas trop d’une action flatteuse, propre à entretenir lerespect. Cette fois-ci la croyance de Françoise avaitl’air fondée sur autre chose, comme si elle eût ellemêmedéjà entretenu la méfiance dans l’esprit
d’<strong>Albertine</strong>, surexcité sa colère, bref l’eût poussée aupoint où elle aurait pu prédire comme inévitable sondépart. Si c’était vrai, ma version d’un départmomentané, connu et approuvé par moi, n’avait purencontrer qu’incrédulité chez Françoise. Mais l’idéequ’elle se faisait de la nature intéressée d’<strong>Albertine</strong>,l’exaspération avec laquelle, dans sa haine, ellegrossissait le « profit » qu’<strong>Albertine</strong> était censée tirer demoi, pouvaient dans une certaine mesure faire échec àsa certitude. Aussi quand devant elle je faisais allusion,comme à une chose toute naturelle, au retour prochaind’<strong>Albertine</strong>, Françoise regardait-elle ma figure pourvoir si je n’inventais pas, de la même façon que, quandle mettre d’hôtel pour l’ennuyer lui lisait, en changeantles mots, une nouvelle politique qu’elle hésitait à croire,par exemple la fermeture des églises et la déportationdes curés, même du bout de la cuisine et sans pouvoirlire, elle fixait instinctivement et avidement le journal,comme si elle eût pu voir si c’était vraiment écrit.Quand Françoise vit qu’après avoir écrit une longuelettre j’y mettais l’adresse de M me Bontemps, cet effroijusque-là si vague qu’<strong>Albertine</strong> revînt grandit chez elle.Il se doubla d’une véritable consternation quand, unmatin, elle dut me remettre dans mon courrier une lettresur l’enveloppe de laquelle elle avait reconnu l’écritured’<strong>Albertine</strong>. Elle se demandait si le départ d’<strong>Albertine</strong>n’avait pas été une simple comédie, supposition qui la
désolait doublement, comme assurant définitivementpour l’avenir la vie d’<strong>Albertine</strong> à la maison et commeconstituant pour moi, c’est-à-dire, en tant que j’étais lemaître de Françoise, pour elle-même l’humiliationd’avoir été joué par <strong>Albertine</strong>. Quelque impatience quej’eusse de lire la lettre de celle-ci, je ne pus n’empêcherde considérer un instant les yeux de Françoise d’où tousles espoirs s’étaient enfuis, en induisant de ce présagel’imminence du retour d’<strong>Albertine</strong>, comme un amateurde sports d’hiver conclut avec joie que les froids sontproches en voyant le départ des hirondelles. EnfinFrançoise partit, et quand je me fus assuré qu’elle avaitrefermé la porte, j’ouvris sans bruit, pour n’avoir pasl’air anxieux, la lettre que voici.:« Mon ami, merci de toutes les bonnes choses quevous me dites, je suis à vos ordres pour décommanderla Rolls si vous croyez que j’y puisse quelque chose, etje le crois. Vous n’avez qu’à m’écrire le nom de votreintermédiaire. Vous vous laisseriez monter le coup parces gens qui ne cherchent qu’une chose, c’est à vendrei;et que feriez-vous d’une auto, vous qui ne sortezjamaisi? Je suis très touchée que vous ayez gardé unbon souvenir de notre dernière promenade. Croyez quede mon côté je n’oublierai pas cette promenade deuxfois crépusculaire (puisque la nuit venait et que nousallions nous quitter) et qu’elle ne s’effacera de monesprit qu’avec la nuit complète. »
Je sentis que cette dernière phrase n’était qu’unephrase et qu’<strong>Albertine</strong> n’aurait pas pu garder, pourjusqu’à sa mort, un si doux souvenir de cettepromenade où elle n’avait certainement eu aucun plaisirpuisqu’elle était impatiente de me quitter. Maisj’admirai aussi comme la cycliste, la golfeuse deBalbec, qui n’avait rien lu qu’Esther avant de meconnaître, était douée et combien j’avais eu raison detrouver qu’elle s’était chez moi enrichie de qualitésnouvelles qui la faisaient différente et plus complète. Etainsi, la phrase que je lui avait dite à Balbec.: « Je croisque mon amitié vous serait précieuse, que je suisjustement la personne qui pourrait vous apporter ce quivous manque » – je lui avais mis comme dédicace surune photographie.: « avec la certitude d’êtreprovidentiel », – cette phrase, que je disais sans y croireet uniquement pour lui faire trouver bénéfice à me voiret passer sur l’ennui qu’elle y pouvait trouver, cettephrase se trouvait, elle aussi, avoir été vraie. De même,en somme, quand je lui avais dit que je ne voulais pas lavoir par peur de l’aimer, j’avais dit cela parce qu’aucontraire je savais que dans la fréquentation constantemon amour s’amortissait et que la séparation l’exaltait,mais en réalité la fréquentation constante avait faitnaître un besoin d’elle infiniment plus fort que l’amourdes premiers temps de Balbec.La lettre d’<strong>Albertine</strong> n’avançait en rien les choses.
Elle ne me parlait que d’écrire à l’intermédiaire. Ilfallait sortir de cette situation, brusquer les choses, etj’eus l’idée suivante. Je fis immédiatement porter àAndrée une lettre où je lui disais qu’<strong>Albertine</strong> était chezsa tante, que je me sentais bien seul, qu’elle me feraitun immense plaisir en venant s’installer chez moi pourquelques jours et que, comme je ne voulais faire aucunecachotterie, je la priais d’en avertir <strong>Albertine</strong>. Et enmême temps j’écrivis à <strong>Albertine</strong> comme si je n’avaispas encore reçu sa lettre.: « Mon amie, pardonnez-moice que vous comprendrez si bien, je déteste tant lescachotteries que j’ai voulu que vous fussiez avertie parelle et par moi. J’ai, à vous avoir eue si doucement chezmoi, pris la mauvaise habitude de ne pas être seul.Puisque nous avons décidé que vous ne reviendriez pas,j’ai pensé que la personne qui vous remplacerait lemieux, parce que c’est celle qui me changerait le moins,qui vous rappellerait le plus, c’était Andrée, et je lui aidemandé de venir. Pour que tout cela n’eût pas l’airtrop brusque, je ne lui ai parlé que de quelques jours,mais entre nous je pense bien que cette fois-ci c’est unechose de toujours. Ne croyez-vous pas que j’aieraisoni? Vous savez que votre petit groupe de jeunesfilles de Balbec a toujours été la cellule sociale qui aexercé sur moi le plus grand prestige, auquel j’ai été leplus heureux d’être un jour agrégé. Sans doute c’est ceprestige qui se fait encore sentir. Puisque la fatalité de
nos caractères et la malchance de la vie a voulu que mapetite <strong>Albertine</strong> ne pût pas être ma femme, je crois quej’aurai tout de même une femme – moins charmantequ’elle, mais à qui des conformités plus grandes denature permettront peut-être d’être plus heureuse avecmoi – dans Andrée. » Mais après avoir fait partir cettelettre, le soupçon me vint tout à coup que, quand<strong>Albertine</strong> m’avait écrit.: « J’aurais été trop heureuse derevenir si vous me l’aviez écrit directement », elle neme l’avait dit que parce que je ne lui avais pas écritdirectement et que, si je l’avais fait, elle ne serait pasrevenue tout de même, qu’elle serait contente de voirAndrée chez moi, puis ma femme, pourvu qu’elle,<strong>Albertine</strong>, fût libre, parce qu’elle pouvait maintenant,depuis déjà huit jours, détruisant les précautions dechaque heure que j’avais prises pendant plus de sixmois à Paris, se livrer à ses vices et faire ce que minutepar minute j’avais empêché. Je me disais queprobablement elle usait mal, là-bas, de sa liberté, et sansdoute cette idée que je formais me semblait triste maisrestait générale, ne me montrant rien de particulier, et,par le nombre indéfini des amantes possibles qu’elle mefaisait supposer, ne me laissait m’arrêter à aucune,entraînait mon esprit dans une sorte de mouvementperpétuel non exempt de douleur, mais d’une douleurqui, par le défaut d’une image concrète, étaitsupportable. Pourtant cette douleur cessa de le
demeurer et devint atroce quand Saint-Loup arriva.Avant de dire pourquoi les paroles qu’il me dit merendirent si malheureux, je dois relater un incident queje place immédiatement avant sa visite et dont lesouvenir me troubla ensuite tellement qu’il affaiblit,sinon l’impression pénible que me produisit maconversation avec Saint-Loup, du moins la portéepratique de cette conversation. Cet incident consista enceci. Brûlant d’impatience de voir Saint-Loup, jel’attendais (ce que je n’aurais pu faire si ma mère avaitété là, car c’est ce qu’elle détestait le plus au mondeaprès « parler par la fenêtre ») quand j’entendis lesparoles suivantes.: « Comment,! vous ne savez pas fairerenvoyer quelqu’un qui vous déplaîti? Ce n’est pasdifficile. Vous n’avez, par exemple, qu’à cacher leschoses qu’il faut qu’il apporte. Alors, au moment où sespatrons sont pressés, l’appellent, il ne trouve rien, ilperd la tête. Ma tante vous dira, furieuse après lui.:« Mais qu’est-ce qu’il faiti? » Quand il arrivera, enretard, tout le monde sera en fureur et il n’aura pas cequ’il faut. Au bout de quatre ou cinq fois vous pouvezêtre sûr qu’il sera renvoyé, surtout si vous avez soin desalir en cachette ce qu’il doit apporter de propre, etmille autres trucs comme cela. » Je restais muet destupéfaction car ces paroles machiavéliques et cruellesétaient prononcées par la voix de Saint-Loup. Or jel’avais toujours considéré comme un être si bon, si
pitoyable aux malheureux, que cela me faisait le mêmeeffet que s’il avait récité un rôle de Satan.: ce nepouvait être en son nom qu’il parlait. « Mais il faut bienque chacun gagne sa vie », dit son interlocuteur quej’aperçus alors et qui était un des valets de pied de laduchesse de Guermantes. « Qu’est-ce que ça vous fichedu moment que vous serez bieni? réponditméchamment Saint-Loup. Vous aurez en plus le plaisird’avoir un souffre-douleur. Vous pouvez très bienrenverser des encriers sur sa livrée au moment où ilviendra servir un grand dîner, enfin ne pas lui laisserune minute de repos jusqu’à ce qu’il finisse par préférers’en aller. Du reste, moi je pousserai à la roue, je dirai àma tante que j’admire votre patience de servir avec unlourdaud pareil et aussi mal tenu. » Je me montrai,Saint-Loup vint à moi, mais ma confiance en lui étaitébranlée depuis que je venais de l’entendre tellementdifférent de ce que je connaissais. Et je me demandai siquelqu’un qui était capable d’agir aussi cruellementenvers un malheureux n’avait pas joué le rôle d’untraître vis-à-vis de moi, dans sa mission auprès de M meBontemps. Cette réflexion servit surtout à ne pas mefaire considérer son insuccès comme une preuve que jene pouvais pas réussir, une fois qu’il m’eut quitté. Maispendant qu’il fut auprès de moi, c’était pourtant auSaint-Loup d’autrefois, et surtout à l’ami qui venait dequitter M me Bontemps, que je pensais. Il me dit
d’abord.: « Tu trouves que j’aurais dû te téléphonerdavantage, mais on disait toujours que tu n’étais paslibre. » Mais où ma souffrance devint insupportable, cefut quand il me dit.: « Pour commencer par où madernière dépêche t’a laissé, après avoir passé par uneespèce de hangar, j’entrai dans la maison, et au boutd’un long couloir on me fit entrer dans un salon. » Àces mots de hangar, de couloir, de salon, et avant mêmequ’ils eussent fini d’être prononcés, mon cœur futbouleversé avec plus de rapidité que par un courantélectrique, car la force qui fait le plus de fois le tour dela terre en une seconde, ce n’est pas l’électricité, c’est ladouleur. Comme je les répétai, renouvelant le choc àplaisir, ces mots de hangar, de couloir, de salon, quandSaint-Loup fut parti,! Dans un hangar on peut secoucher avec une amie. Et dans ce salon, qui sait cequ’<strong>Albertine</strong> faisait quand sa tante n’était pas lài? Etquoii? Je m’étais donc représenté la maison où ellehabitait comme ne pouvant posséder ni hangar, nisaloni? Non, je ne me l’étais pas représentée du tout,sinon comme un lieu vague. J’avais souffert unepremière fois quand s’était individualiségéographiquement le lieu où était <strong>Albertine</strong>. Quandj’avais appris qu’au lieu d’être dans deux ou troisendroits possibles, elle était en Touraine, ces mots de saconcierge avaient marqué dans mon cœur comme surune carte la place où il fallait enfin souffrir. Mais une
fois habitué à cette idée qu’elle était dans une maisonde Touraine, je n’avais pas vu la maison. Jamais nem’était venue à l’imagination cette affreuse idée desalon, de hangar, de couloir, qui me semblaient face àmoi sur la rétine de Saint-Loup qui les avait vues, cespièces dans lesquelles <strong>Albertine</strong> allait, passait, vivait,ces pièces-là en particulier et non une infinité de piècespossibles qui s’étaient détruites l’une l’autre. Avec lesmots de hangar, de couloir, de salon, ma foliem’apparut d’avoir laissé <strong>Albertine</strong> huit jours dans celieu maudit dont l’existence (et non la simplepossibilité) venait de m’être révélée. Hélas,! quandSaint-Loup me dit aussi que dans ce salon il avaitentendu chanter à tue-tête d’une chambre voisine et quec’était <strong>Albertine</strong> qui chantait, je compris avec désespoirque, débarrassée enfin de moi, elle était heureuse,! Elleavait reconquis sa liberté. Et moi qui pensais qu’elleallait venir prendre la place d’Andrée. Ma douleur sechangea en colère contre Saint-Loup. « C’est tout ceque je t’avais demandé d’éviter, qu’elle sût que tuvenais. – Si tu crois que c’était facile,! On m’avaitassuré qu’elle n’était pas là. Oh,! je sais bien que tun’es pas content de moi, je l’ai bien senti dans tesdépêches. Mais tu n’es pas juste, j’ai fait ce que j’aipu. » Lâchée de nouveau, ayant quitté la cage d’où chezmoi je restais des jours entiers sans la faire venir dansma chambre, <strong>Albertine</strong> avait repris pour moi toute sa
valeur, elle était redevenue celle que tout le mondesuivait, l’oiseau merveilleux des premiers jours. « Enfinrésumons-nous. Pour la question d’argent, je ne sais quete dire, j’ai parlé à une femme qui m’a paru si délicateque je craignais de la froisser. Or elle n’a pas fait oufquand j’ai parlé de l’argent. Même, un peu plus tard,elle m’a dit qu’elle était touchée de voir que nous nouscomprenions si bien. Pourtant tout ce qu’elle a ditensuite était si délicat, si élevé, qu’il me semblaitimpossible qu’elle eût dit pour l’argent que je luioffrais.: « Nous nous comprenons si bien », car au fondj’agissais en mufle. – Mais peut-être n’a-t-elle pascompris, elle n’a peut-être pas entendu, tu aurais dû lelui répéter, car c’est cela sûrement qui aurait fait toutréussir. – Mais comment veux-tu qu’elle n’ait pasentendui? Je le lui ai dit comme je te parle là, elle n’estni sourde, ni folle. – Et elle n’a fait aucune réflexioni? –Aucune. – Tu aurais dû lui redire une fois. – Commentvoulais-tu que je lui redisei? Dès qu’en entrant j’ai vul’air qu’elle avait, je me suis dit que tu t’étais trompé,que tu me faisais faire une immense gaffe, et c’étaitterriblement difficile de lui offrir cet argent ainsi. Je l’aifait pourtant pour t’obéir, persuadé qu’elle allait mefaire mettre dehors. – Mais elle ne l’a pas fait. Donc ouelle n’avait pas entendu, et il fallait recommencer, ouvous pouviez continuer sur ce sujet. – Tu dis.: « Ellen’avait pas entendu » parce que tu es ici, mais je te
épète, si tu avais assisté à notre conversation, il n’yavait aucun bruit, je l’ai dit brutalement, il n’est paspossible qu’elle n’ait pas compris. – Mais enfin elle estbien persuadée que j’ai toujours voulu épouser saniècei? – Non, ça, si tu veux mon avis, elle ne croyaitpas que tu eusses du tout l’intention d’épouser. Elle m’adit que tu avais dit toi-même à sa nièce que tu voulais laquitter. Je ne sais même pas si maintenant elle est bienpersuadée que tu veuilles épouser. » Ceci me rassuraitun peu en me montrant que j’étais moins humilié, doncplus capable d’être encore aimé, plus libre de faire unedémarche décisive. Pourtant j’étais tourmenté. « Je suisennuyé parce que je vois que tu n’es pas content. – Si,je suis touché, reconnaissant de ta gentillesse, mais ilme semble que tu aurais pu... – J’ai fait de mon mieux.Un autre n’eût pu faire davantage ni même autant.Essaie d’un autre. – Mais non, justement, si j’avais su,je ne t’aurais pas envoyé, mais ta démarche avortéem’empêche d’en faire une autre. » Je lui faisais desreproches.: il avait cherché à me rendre service etn’avait pas réussi. Saint-Loup en s’en allant avait croisédes jeunes filles qui entraient. J’avais déjà fait souventla supposition qu’<strong>Albertine</strong> connaissait des jeunes fillesdans le paysi; mais c’est la première fois que j’enressentais la torture. Il faut vraiment croire que la naturea donné à notre esprit de sécréter un contre-poisonnaturel qui annihile les suppositions que nous faisons à
la fois sans trêve et sans danger. Mais rien nem’immunisait contre ces jeunes filles que Saint-Loupavait rencontrées. Tous ces détails, n’était-ce pasjustement ce que j’avais cherché à obtenir de chacunsur <strong>Albertine</strong>i? n’était-ce pas moi qui, pour lesconnaître plus précisément, avais demandé à Saint-Loup, rappelé par son colonel, de passer coûte quecoûte chez moii? n’était-ce donc pas moi qui les avaissouhaités, moi, ou plutôt ma douleur affamée, avide decroître et de se nourrir d’euxi? Enfin Saint-Loupm’avait dit avoir eu la bonne surprise de rencontrer toutprès de là, seule figure de connaissance et qui lui avaitrappelé le passé, une ancienne amie de Rachel, une jolieactrice qui villégiaturait dans le voisinage. Et le nom decette actrice suffit pour que je me dise.: « C’est peutêtreavec celle-là »i; cela suffisait pour que je visse,dans les bras mêmes d’une femme que je ne connaissaispas, <strong>Albertine</strong> souriante et rouge de plaisir. Et, au fond,pourquoi cela n’eût-il pas étéi? M’étais-je fait faute depenser à des femmes depuis que je connaissais<strong>Albertine</strong>i? Le soir où j’avais été pour la première foischez la princesse de Guermantes, quand j’étais rentré,n’était-ce pas beaucoup moins en pensant à cettedernière qu’à la jeune fille dont Saint-Loup m’avaitparlé et qui allait dans les maisons de passe, et à lafemme de chambre de M me Putbusi? N’est-ce pas pourcette dernière que j’étais retourné à Balbec et, plus
écemment, avais bien eu envie d’aller à Venisei?pourquoi <strong>Albertine</strong> n’eût-elle pas eu envie d’aller enTourainei? Seulement, au fond, je m’en apercevaismaintenant, je ne l’aurais pas quittée, je ne serais pasallé à Venise. Même au fond de moi-même, tout en medisant.: « Je la quitterai bientôt », je savais que je ne laquitterais plus, tout aussi bien que je savais que je neme mettrais plus à travailler, ni à vivre d’une façonhygiénique, ni à rien faire de ce que chaque jour je mepromettais pour le lendemain. Seulement, quoi que jecrusse au fond, j’avais trouvé plus habile de la laisservivre sous la menace d’une perpétuelle séparation. Etsans doute, grâce à ma détestable habileté, je l’avaistrop bien convaincue. En tous cas maintenant cela nepouvait plus durer ainsi, je ne pouvais pas la laisser enTouraine avec ces jeunes filles, avec cette actricei; je nepouvais supporter la pensée de cette vie quim’échappait. J’écrirais et j’attendrais sa réponse à malettre.: si elle faisait le mal, hélas,! un jour de plus ou demoins ne faisait rien (et peut-être je me disais cela parceque, n’ayant plus l’habitude de me faire rendre comptede chacune de ses minutes, dont une seule où elle eûtété libre m’eût jadis affolé, ma jalousie n’avait plus lamême division du temps). Mais aussitôt sa réponsereçue, si elle ne revenait pas j’irais la chercheri; de gréou de force je l’arracherais à ses amies. D’ailleurs nevalait-il pas mieux que j’y allasse moi-même,
maintenant que j’avais découvert la méchanceté,jusqu’ici insoupçonnée de moi, de Saint-Loupi? qui saits’il n’avait pas organisé tout un complot pour meséparer d’<strong>Albertine</strong>i?Et cependant, comme j’aurais menti maintenant si jelui avais écrit, comme je le lui disais à Paris, que jesouhaitais qu’il ne lui arrivât aucun accident,! Ah,! s’illui en était arrivé un, ma vie, au lieu d’être à jamaisempoisonnée par cette jalousie incessante, eût aussitôtretrouvé sinon le bonheur, du moins le calme par lasuppression de la souffrance.La suppression de la souffrancei? Ai-je pu vraimentle croirei? croire que la mort ne fait que biffer ce quiexiste et laisser le reste en étati; qu’elle enlève ladouleur dans le cœur de celui pour qui l’existence del’autre n’est plus qu’une cause de douleursi; qu’elleenlève la douleur et n’y met rien à la placei? Lasuppression de la douleur,! Parcourant les faits diversdes journaux, je regrettais de ne pas avoir le courage deformer le même souhait que Swann. Si <strong>Albertine</strong> avaitpu être victime d’un accident, vivante, j’aurais eu unprétexte pour courir auprès d’elle, morte j’auraisretrouvé, comme disait Swann, la liberté de vivre. Je lecroyaisi? Il l’avait cru, cet homme si fin et qui croyaitse bien connaître. Comme on sait peu ce qu’on a dans lecœur. Comme, un peu plus tard, s’il avait été encorevivant, j’aurais pu lui apprendre que son souhait, autant
que criminel, était absurde, que la mort de celle qu’ilaimait ne l’eût délivré de rien.Je laissai toute fierté vis-à-vis d’<strong>Albertine</strong>, je luienvoyai un télégramme désespéré lui demandant derevenir à n’importe quelles conditions, qu’elle feraittout ce qu’elle voudrait, que je demandais seulement àl’embrasser une minute trois fois par semaine avantqu’elle se couche. Et elle eût dit une fois seulement, quej’eusse accepté une fois. Elle ne revint jamais. Montélégramme venait de partir que j’en reçus un. Il était deM me Bontemps. Le monde n’est pas créé une fois pourtoutes pour chacun de nous. Il s’y ajoute au cours de lavie des choses que nous ne soupçonnions pas. Ah,! cene fut pas la suppression de la souffrance queproduisirent. en moi les deux premières lignes dutélégramme.: « Mon pauvre ami, notre petite <strong>Albertine</strong>n’est plus, pardonnez-moi de vous dire cette choseaffreuse, vous qui l’aimiez tant. Elle a été jetée par soncheval contre un arbre pendant une promenade. Tousnos efforts n’ont pu la ranimer. Que ne suis-je morte àsa place. » Non, pas la suppression de la souffrance,mais une souffrance inconnue, celle d’apprendre qu’ellene reviendrait pas. Mais ne m’étais-je pas dit plusieursfois qu’elle ne reviendrait peut-être pasi? Je me l’étaisdit, en effet, mais je m’apercevais maintenant que pasun instant je ne l’avais cru. Comme j’avais besoin de saprésence, de ses baisers pour supporter le mal que me
faisaient mes soupçons, j’avais pris depuis Balbecl’habitude d’être toujours avec elle. Même quand elleétait sortie, quand j’étais seul, je l’embrassais encore.J’avais continué depuis qu’elle était en Touraine.J’avais moins besoin de sa fidélité que de son retour. Etsi ma raison pouvait impunément le mettre quelquefoisen doute, mon imagination ne cessait pas un instant deme le représenter. Instinctivement je passai ma main surmon cou, sur mes lèvres qui se voyaient embrassés parelle depuis qu’elle était partie, et qui ne le seraientjamais plusi; je passai ma main sur eux, comme mamanm’avait caressé à la mort de ma grand’mère en medisant.: « Mon pauvre petit, ta grand’mère qui t’aimaittant ne t’embrassera plus. » Toute ma vie à venir setrouvait arrachée de mon cœur. Ma vie à veniri? Jen’avais donc pas pensé quelquefois à la vivre sans<strong>Albertine</strong>i? Mais non,! Depuis longtemps je lui avaisdonc voué toutes les minutes de ma vie jusqu’à mamorti? Mais bien sûr,! Cet avenir indissoluble d’elle jen’avais pas su l’apercevoir, mais maintenant qu’ilvenait d’être descellé, je sentais la place qu’il tenaitdans mon cœur béant. Françoise qui ne savait encorerien entra dans ma chambrei; d’un air furieux, je luicriai.: « Qu’est-ce qu’il y ai? » Alors (il y a quelquefoisdes mots qui mettent une réalité différente à la mêmeplace que celle qui est près de nous, ils nousétourdissent tout autant qu’un vertige) elle me dit.:
« Monsieur n’a pas besoin d’avoir l’air fâché. Il va êtreau contraire bien content. Ce sont deux lettres demademoiselle <strong>Albertine</strong>. » Je sentis, après, que j’avaisdû avoir les yeux de quelqu’un dont l’esprit perdl’équilibre. Je ne fus même pas heureux, ni incrédule.J’étais comme quelqu’un qui voit la même place de sachambre occupée par un canapé et par une grotte.: rienne lui paraissant plus réel, il tombe par terre. Les deuxlettres d’<strong>Albertine</strong> avaient dû être écrites à quelquesheures de distance, peut-être en même temps, et peu detemps avant la promenade où elle était morte. Lapremière disait.: « Mon ami, je vous remercie de lapreuve de confiance que vous me donnez en me disantvotre intention de faire venir Andrée chez vous. Je saisqu’elle acceptera avec joie et je crois que ce sera trèsheureux pour elle. Douée comme elle est, elle sauraprofiter de la compagnie d’un homme tel que vous et del’admirable influence que vous savez prendre sur unêtre. Je crois que vous avez eu là une idée d’où peutnaître autant de bien pour elle que pour vous. Aussi, sielle faisait l’ombre d’une difficulté (ce que je ne croispas), télégraphiez-moi, je me charge d’agir sur elle. »La seconde était datée d’un jour plus tard. En réalité,elle avait dû les écrire à peu d’instants l’une de l’autre,peut-être ensemble, et antidater la première. Car tout letemps j’avais imaginé dans l’absurde ses intentions quin’avaient été que de revenir auprès de moi et que
quelqu’un de désintéressé dans la chose, un hommesans imagination, le négociateur d’un traité de paix, lemarchand qui examine une transaction, eussent mieuxjugées que moi. Elle ne contenait que ces mots.:« Serait-il trop tard que je revienne chez vousi? Si vousn’avez pas encore écrit à Andrée, consentiriez-vous àme reprendrei? Je m’inclinerai devant votre décision, jevous supplie de ne pas tarder à me la faire connaître,vous pensez avec quelle impatience je l’attends. Sic’était que je revienne, je prendrais le trainimmédiatement. De tout cœur à vous, <strong>Albertine</strong>. »Pour que la mort d’<strong>Albertine</strong> eût pu supprimer messouffrances, il eût fallu que le choc l’eût tuée nonseulement en Touraine, mais en moi. Jamais elle n’yavait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a étéobligé de prendre la forme, de se plier au cadre dutempsi; ne nous apparaissant que par minutessuccessives, il n’a jamais pu nous livrer de lui qu’unseul aspect à la fois, nous débiter de lui qu’une seulephotographie. Grande faiblesse sans doute pour un êtrede consister en une simple collection de momentsi;grande force aussii; il relève de la mémoire, et lamémoire d’un moment n’est pas instruite de tout ce quis’est passé depuisi; ce moment qu’elle a enregistré dureencore, vit encore, et avec lui l’être qui s’y profilait. Etpuis cet émiettement ne fait pas seulement vivre lamorte, il la multiplie. Pour me consoler ce n’est pas
une, ce sont d’innombrables <strong>Albertine</strong> que j’aurais dûoublier. Quand j’étais arrivé à supporter le chagrind’avoir perdu celle-ci, c’était à recommencer avec uneautre, avec cent autres.Alors ma vie fut entièrement changée. Ce qui enavait fait, et non à cause d’<strong>Albertine</strong>, parallèlement àelle, quand j’étais seul, la douceur, c’était justement, àl’appel de moments identiques, la perpétuellerenaissance de moments anciens. Par le bruit de la pluiem’était rendue l’odeur des lilas de Combrayi; par lamobilité du soleil sur le balcon, les pigeons desChamps-Élyséesi; par l’assourdissement des bruits dansla chaleur de la matinée, la fraîcheur des cerisesi; ledésir de la Bretagne ou de Venise par le bruit du vent etle retour de Pâques. L’été venait, les jours étaient longs,il faisait chaud. C’était le temps où de grand matinélèves et professeurs vont dans les jardins publicspréparer les derniers concours sous les arbres, pourrecueillir la seule goutte de fraîcheur que laisse tomberun ciel moins enflammé que dans l’ardeur du jour, maisdéjà aussi stérilement pur. De ma chambre obscure,avec un pouvoir d’évocation égal à celui d’autrefoismais qui ne me donnait plus que de la souffrance, jesentais que dehors, dans la pesanteur de l’air, le soleildéclinant mettait sur la verticalité des maisons, deséglises, un fauve badigeon. Et si Françoise en revenantdérangeait sans le vouloir les plis des grands rideaux,
j’étouffais un cri à la déchirure que venait de faire enmoi ce rayon de soleil ancien qui m’avait fait paraîtrebelle la façade neuve de Bricqueville l’Orgueilleuse,quand <strong>Albertine</strong> m’avait dit.: « Elle est restaurée. » Nesachant comment expliquer mon soupir à Françoise, jelui disais.: « Ah,! j’ai soif. » Elle sortait, rentrait, maisje me détournais violemment, sous la déchargedouloureuse d’un des mille souvenirs invisibles qui àtout moment éclataient autour de moi dans l’ombre.: jevenais de voir qu’elle avait apporté du cidre et descerises qu’un garçon de ferme nous avait apportés dansla voiture, à Balbec, espèces sous lesquelles j’auraiscommunié le plus parfaitement, jadis, avec l’arc-en-cieldes salles à manger obscures par les jours brûlants.Alors je pensai pour la première fois à la ferme desÉcorres, et je me dis que certains jours où <strong>Albertine</strong> medisait à Balbec ne pas être libre, être obligée de sortiravec sa tante, elle était peut-être avec telle de ses amiesdans une ferme où elle savait que je n’avais pas meshabitudes, et que pendant qu’à tout hasard je l’attendaisà Marie-Antoinette où on m’avait dit.: « Nous nel’avons pas vue aujourd’hui », elle usait avec son amiedes mêmes mots qu’avec moi quand nous sortions tousles deux.: « Il n’aura pas l’idée de nous chercher ici etcomme cela nous ne serons plus dérangées. » Je disais àFrançoise de refermer les rideaux pour ne plus voir cerayon de soleil. Mais il continuait à filtrer, aussi
corrosif, dans ma mémoire. « Elle ne me plaît pas, elleest restaurée, mais nous irons demain à Saint-Martin leVêtu, après-demain à... » Demain, après-demain, c’étaitun avenir de vie commune, peut-être pour toujours, quicommençait, mon cœur s’élança vers lui, mais il n’estplus là, <strong>Albertine</strong> est morte.Je demandais l’heure à Françoise. Six heures. Enfin,Dieu merci, allait disparaître cette lourde chaleur dontautrefois je me plaignais avec <strong>Albertine</strong>, et que nousaimions tant. La journée prenait fin. Mais qu’est-ce quej’y gagnaisi? La fraîcheur du soir se levait, c’était lecoucher du soleili; dans ma mémoire, au bout d’uneroute que nous prenions ensemble pour rentrer,j’apercevais, plus loin que le dernier village, commeune station distante, inaccessible pour le soir même oùnous nous arrêterions à Balbec, toujours ensemble.Ensemble alors, maintenant il fallait s’arrêter courtdevant ce même abîme, elle était morte. Ce n’était plusassez de fermer les rideaux, je tâchais de boucher lesyeux et les oreilles de ma mémoire, pour ne pas voircette bande orangée du couchant, pour ne pas entendreces invisibles oiseaux qui se répondaient d’un arbre àl’autre de chaque côté de moi, qu’embrassait alors sitendrement celle qui maintenant était morte. Je tâchaisd’éviter ces sensations que donnent l’humidité desfeuilles dans le soir, la montée et la descente des routesà dos d’âne. Mais déjà ces sensations m’avaient
essaisi, ramené assez loin du moment actuel, afinqu’eût tout le recul, tout l’élan nécessaire pour mefrapper de nouveau, l’idée qu’<strong>Albertine</strong> était morte.Ah,! jamais je n’entrerais plus dans une forêt, je ne mepromènerais plus entre des arbres. Mais les grandesplaines me seraient-elles moins cruellesi? Que de foisj’avais traversé pour aller chercher <strong>Albertine</strong>, que defois j’avais repris au retour avec elle la grande plaine deCricqueville, tantôt par des temps brumeux oùl’inondation du brouillard nous donnait l’illusion d’êtreentourés d’un lac immense, tantôt par des soirs limpidesoù le clair de lune, dématérialisant la terre, la faisantparaître à deux pas céleste, comme elle n’est, pendant lejour, que dans les lointains, enfermait les champs, lesbois, avec le firmament auquel il les avait assimilés,dans l’agate arborisée d’un seul azur.Françoise devait être heureuse de la mortd’<strong>Albertine</strong>, et il faut lui rendre la justice que par unesorte de convenance et de tact elle ne simulait pas latristesse. Mais les lois non écrites de son antique codeet sa tradition de paysanne médiévale qui pleure commeaux chansons de geste étaient plus anciennes que sahaine d’<strong>Albertine</strong> et même d’Eulalie. Aussi une de cesfins d’après-midi-là, comme je ne cachais pas assezrapidement ma souffrance, elle aperçut mes larmes,servie par son instinct d’ancienne petite paysanne quiautrefois lui faisait capturer et faire souffrir les
animaux, n’éprouver que de la gaîté à étrangler lespoulets et à faire cuire vivants les homards et, quandj’étais malade, à observer, comme les blessures qu’elleeût infligées à une chouette, ma mauvaise mine, qu’elleannonçait ensuite sur un ton funèbre et comme unprésage de malheur. Mais son « coutumier » deCombray ne lui permettait pas de prendre légèrementles larmes, le chagrin, choses qu’elle jugeait aussifunestes que d’ôter sa flanelle ou de manger à contrecœur.« Oh,! non, Monsieur, il ne faut pas pleurercomme cela, cela vous ferait mal,! » Et en voulantarrêter mes larmes elle avait l’air aussi inquiet que sic’eût été des flots de sang. Malheureusement je pris unair froid qui coupa court aux effusions qu’elle espéraitet qui, du reste, eussent peut-être été sincères. Peut-êtreen était-il pour elle d’<strong>Albertine</strong> comme d’Eulalie, etmaintenant que mon amie ne pouvait plus tirer de moiaucun profit, Françoise avait-elle cessé de la haïr. Elletint à me montrer pourtant qu’elle se rendait biencompte que je pleurais et que, suivant seulement lefuneste exemple des miens, je ne voulais pas « fairevoir ». « Il ne faut pas pleurer, Monsieur », me dit-elled’un ton cette fois plus calme, et plutôt pour memontrer sa clairvoyance que pour me témoigner sapitié. Et elle ajouta.: « Ça devait arriver, elle était tropheureuse, la pauvre, elle n’a pas su connaître sonbonheur. »
Que le jour est lent à mourir par ces soirs démesurésde l’été,! Un pâle fantôme de la maison d’en facecontinuait indéfiniment à aquareller sur le ciel sablancheur persistante. Enfin il faisait nuit dansl’appartement, je me cognais aux meubles del’antichambre, mais dans la porte de l’escalier, aumilieu du noir que je croyais total, la partie vitrée étaittranslucide et bleue, d’un bleu de fleur, d’un bleu d’ailed’insecte, d’un bleu qui m’eût semblé beau si je n’avaissenti qu’il était un dernier reflet, coupant comme unacier, un coup suprême que dans sa cruauté infatigableme portait encore le jour. L’obscurité complète finissaitpourtant par venir, mais alors il suffisait d’une étoilevue à côté de l’arbre de la cour pour me rappeler nosdéparts en voiture, après le dîner, pour les bois deChantepie, tapissés par le clair de lune. Et même dansles rues, il m’arrivait d’isoler sur le dos d’un banc, derecueillir la pureté naturelle d’un rayon de lune aumilieu des lumières artificielles de Paris – de Paris surlequel il faisait régner, en faisant rentrer un instant,pour mon imagination, la ville dans la nature, avec lesilence infini des champs évoqués le souvenirdouloureux des promenades que j’y avais faites avec<strong>Albertine</strong>. Ah,! quand la nuit finirait-ellei? Mais à lapremière fraîcheur de l’aube je frissonnais, car celle-ciavait ramené en moi la douceur de cet été où, de Balbecà Incarville, d’Incarville à Balbec, nous nous étions tant
de fois reconduits l’un l’autre jusqu’au petit jour. Jen’avais plus qu’un espoir pour l’avenir – espoir bienplus déchirant qu’une crainte, – c’était d’oublier<strong>Albertine</strong>. Je savais que je l’oublierais un jour, j’avaisbien oublié Gilberte, M me de Guermantes, j’avais bienoublié ma grand’mère. Et c’est notre plus juste et pluscruel châtiment de l’oubli si total, paisible comme ceuxdes cimetières, par quoi nous nous sommes détachés deceux que nous n’aimons plus, que nous entrevoyions cemême oubli comme inévitable à l’égard de ceux quenous aimons encore. À vrai dire nous savons qu’il estun état non douloureux, un état d’indifférence. Mais nepouvant penser à la fois à ce que j’étais et à ce que jeserais, je pensais avec désespoir à tout ce tégument decaresses, de baisers, de sommeils amis, dont il faudraitbientôt me laisser dépouiller pour jamais. L’élan de cessouvenirs si tendres, venant se briser contre l’idéequ’<strong>Albertine</strong> était morte, m’oppressait par l’entrechocde flux si contrariés que je ne pouvais rester immobilei;je me levais, mais tout d’un coup je m’arrêtais,terrasséi; le même petit jour que je voyais, au momentoù je venais de quitter <strong>Albertine</strong>, encore radieux etchaud de ses baisers, venait tirer au-dessus des rideauxsa lame maintenant sinistre, dont la blancheur froide,implacable et compacte entrait, me donnant comme uncoup de couteau.Bientôt les bruits de la rue allaient commencer,
permettant de lire à l’échelle qualitative de leurssonorités le degré de la chaleur sans cesse accrue où ilsretentiraient. Mais dans cette chaleur qui quelquesheures plus tard s’imbiberait de l’odeur des cerises, ceque je trouvais (comme dans un remède que leremplacement d’une des parties composantes par uneautre suffit pour rendre, d’un euphorique et d’unexcitatif qu’il était, un déprimant), ce n’était plus ledésir des femmes mais l’angoisse du départ d’<strong>Albertine</strong>.D’ailleurs le souvenir de tous mes désirs était aussiimprégné d’elle, et de souffrance, que le souvenir desplaisirs. Cette Venise où j’avais cru que sa présence meserait importune (sans doute parce que je sentaisconfusément qu’elle m’y serait nécessaire), maintenantqu’<strong>Albertine</strong> n’était plus, j’aimais mieux n’y pas aller.<strong>Albertine</strong> m’avait semblé un obstacle interposé entremoi et toutes choses, parce qu’elle était pour moi leurcontenant et que c’est d’elle, comme d’un vase, que jepouvais les recevoir. Maintenant que ce vase étaitdétruit, je ne me sentais plus le courage de les saisiri; iln’y en avait plus une seule dont je ne me détournasse,abattu, préférant n’y pas goûter. De sorte que maséparation d’avec elle n’ouvrait nullement pour moi lechamp des plaisirs possibles que j’avais cru m’êtrefermé par sa présence. D’ailleurs l’obstacle que saprésence avait peut-être été, en effet, pour moi àvoyager, à jouir de la vie, m’avait seulement, comme il
arrive toujours, masqué les autres obstacles, quireparaissaient intacts maintenant que celui-là avaitdisparu. C’est de cette façon qu’autrefois, quandquelque visite aimable m’empêchait de travailler, si lelendemain je restais seul je ne travaillais pas davantage.Qu’une maladie, un duel, un cheval emporté, nousfassent voir la mort de près, nous aurions joui richementde la vie, de la volupté, de pays inconnus dont nousallons être privés. Et une fois le danger passé, ce quenous retrouverons c’est la même vie morne où rien detout cela n’existait pour nous.Sans doute ces nuits si courtes durent peu. L’hiverfinirait par revenir, où je n’aurais plus à craindre lesouvenir des promenades avec elle jusqu’à l’aube troptôt levée. Mais les premières gelées ne merapporteraient-elles elles pas, conservé dans leur glace,le germe de mes premiers désirs, quand à minuit je lafaisais chercher, que le temps me semblait si longjusqu’à son coup de sonnette que je pourrais maintenantattendre éternellement en vaini? Ne me rapporteraientellespas le germe de mes premières inquiétudes, quanddeux fois je crus qu’elle ne viendrait pasi? Dans cetemps-là je ne la voyais que rarementi; mais même cesintervalles qu’il y avait alors entre ses visites qui lafaisaient surgir, au bout de plusieurs semaines, du seind’une vie inconnue que je n’essayais pas de posséder,assuraient mon calme en empêchant les velléités sans
cesse interrompues de ma jalousie de se conglomérer,de faire bloc dans mon cœur. Autant ils eussent pu êtreapaisants dans ce temps-là, autant, rétrospectivement,ils étaient empreints de souffrance depuis que ce qu’elleavait pu faire d’inconnu pendant leur durée avait cesséde m’être indifférent, et surtout maintenant qu’aucunevisite d’elle ne viendrait plus jamaisi; de sorte que cessoirs de janvier où elle venait, et qui par là m’avaientété si doux, me souffleraient maintenant dans leur biseaigre une inquiétude que je ne connaissais pas alors, etme rapporteraient, mais devenu pernicieux, le premiergerme de mon amour. Et en pensant que je verraisrecommencer ce temps froid qui, depuis Gilberte et mesjeux aux Champs-Élysées, m’avait toujours paru sitristei; quand je pensais que reviendraient des soirspareils à ce soir de neige où j’avais vainement, touteune partie de la nuit, attendu <strong>Albertine</strong>, alors, commeun malade se plaçant bien au point de vue du corps poursa poitrine, moi, moralement, à ces moments-là, ce queje redoutais encore le plus pour mon chagrin, pour moncœur, c’était le retour des grands froids, et je me disaisque ce qu’il y aurait de plus dur à passer ce serait peutêtrel’hiver. Lié qu’il était à toutes les saisons, pour queje perdisse le souvenir d’<strong>Albertine</strong> il aurait fallu que jeles oubliasse toutes, quitte à recommencer à lesconnaître, comme un vieillard frappé d’hémiplégie etqui rapprend à lirei; il aurait fallu que je renonçasse à
tout l’univers. Seule, me disais-je, une véritable mort demoi-même serait capable (mais elle est impossible) deme consoler de la sienne. Je ne songeais pas que la mortde soi-même n’est ni impossible, ni extraordinairei; ellese consomme à notre insu, au besoin contre notre gré,chaque jour, et je souffrirais de la répétition de toutessortes de journées que non seulement la nature, maisdes circonstances factices, un ordre plus conventionnelintroduisent dans une saison. Bientôt reviendrait la dateoù j’étais allé à Balbec l’autre été et où mon amour, quin’était pas encore inséparable de la jalousie et qui nes’inquiétait pas de ce qu’<strong>Albertine</strong> faisait toute lajournée, devait subir tant d’évolutions avant de devenircet amour des derniers temps, si particulier, que cetteannée finale, où avait commencé de changer et oùs’était terminée la destinée d’<strong>Albertine</strong>, m’apparaissaitremplie, diverse, vaste comme un siècle. Puis ce seraitle souvenir de jours plus tardifs, mais dans des annéesantérieures, les dimanches de mauvais temps, oùpourtant tout le monde était sorti, dans le vide del’après-midi, où le bruit du vent et de la pluie m’eûtinvité jadis à rester à faire le « philosophe sous lestoits »i; avec quelle anxiété je verrais approcher l’heureoù <strong>Albertine</strong>, si peu attendue, était venue me voir,m’avait caressé pour la première fois, s’interrompantpour Françoise qui avait apporté la lampe, en ce tempsdeux fois mort où c’était <strong>Albertine</strong> qui était curieuse de
moi, où ma tendresse pour elle pouvait légitimementavoir tant d’espérance. Même, à une saison plusavancée, ces soirs glorieux où les offices, lespensionnats, entr’ouverts comme des chapelles, baignésd’une poussière dorée, laissent la rue se couronner deces demi-déesses qui, causant non loin de nous avecleurs pareilles, nous donnent la fièvre de pénétrer dansleur existence mythologique, ne me rappelaient plusque la tendresse d’<strong>Albertine</strong> qui, à côté de moi, m’étaitun empêchement à m’approcher d’elles.D’ailleurs au souvenir des heures même purementnaturelles s’ajouterait forcément le paysage moral quien fait quelque chose d’unique. Quand j’entendrais plustard le cornet à bouquin du chevrier, par un premierbeau temps, presque italien, le même jour mélangeraittour à tour à sa lumière l’anxiété de savoir <strong>Albertine</strong> auTrocadéro, peut-être avec Léa et les deux jeunes filles,puis la douceur familiale et domestique, presquecommune, d’une épouse qui me semblait alorsembarrassante et que Françoise allait me ramener. Cemessage téléphonique de Françoise qui m’avaittransmis l’hommage obéissant d’<strong>Albertine</strong> revenantavec elle, j’avais cru qu’il m’enorgueillissait. Je m’étaistrompé. S’il m’avait enivré, c’est parce qu’il m’avaitfait sentir que celle que j’aimais était bien à moi, nevivait bien que pour moi, et même à distance, sans quej’eusse besoin de m’occuper d’elle, me considérait
comme son époux et son maître, revenant sur un signede moi. Et ainsi ce message téléphonique avait été uneparcelle de douceur, venant de loin, émise de cequartier du Trocadéro où il se trouvait y avoir pour moides sources de bonheur dirigeant vers moi d’apaisantesmolécules, des baumes calmants me rendant enfin unesi douce liberté d’esprit que je n’avais plus eu – melivrant sans la restriction d’un seul souci à la musiquede Wagner – qu’à attendre l’arrivée certained’<strong>Albertine</strong>, sans fièvre, avec un manque entierd’impatience où je n’avais pas su reconnaître lebonheur. Et ce bonheur qu’elle revînt, qu’elle m’obéîtet m’appartînt, la cause en était dans l’amour, non dansl’orgueil. Il m’eût été bien égal maintenant d’avoir àmes ordres cinquante femmes revenant, sur un signe demoi, non pas du Trocadéro mais des Indes. Mais cejour-là, en sentant <strong>Albertine</strong> qui, tandis que j’étais seuldans ma chambre à faire de la musique, venaitdocilement vers moi, j’avais respiré, disséminée commeun poudroiement dans le soleil, une de ces substancesqui, comme d’autres sont salutaires au corps, font dubien à l’âme. Puis ç’avait été, une demi-heure après,l’arrivée d’<strong>Albertine</strong>, puis la promenade avec <strong>Albertine</strong>arrivée, promenade que j’avais crue ennuyeuse parcequ’elle était pour moi accompagnée de certitude, mais,à cause de cette certitude même, qui avait, à partir dumoment où Françoise m’avait téléphoné qu’elle la
amenait, coulé un calme d’or dans les heures quiavaient suivi, en avaient fait comme une deuxièmejournée bien différente de la première, parce qu’elleavait un tout autre dessous moral, un dessous moral quien faisait une journée originale, qui venait s’ajouter à lavariété de celles que j’avais connues jusque-là, journéeque je n’eusse jamais pu imaginer – comme nous nepourrions imaginer le repos d’un jour d’été si de telsjours n’existaient pas dans la série de ceux que nousavons vécus, – journée dont je ne pouvais pas direabsolument que je me la rappelais, car à ce calmes’ajoutait maintenant une souffrance que je n’avais pasressentie alors. Mais bien plus tard, quand je traversaipeu à peu, en sens inverse, les temps par lesquelsj’avais passé avant d’aimer tant <strong>Albertine</strong>, quand moncœur cicatrisé put se séparer sans souffranced’<strong>Albertine</strong> morte, alors je pus me rappeler enfin sanssouffrance ce jour où <strong>Albertine</strong> avait été faire descourses avec Françoise au lieu de rester au Trocadéroi;je me rappelai avec plaisir ce jour comme appartenant àune saison morale que je n’avais pas connuejusqu’alorsi; je me le rappelai enfin exactement sansplus y ajouter de souffrance et au contraire comme onse rappelle certains jours d’été qu’on a trouvés tropchauds quand on les a vécus, et dont, après coupsurtout, on extrait le titre sans alliage d’or fin etd’indestructible azur.
De sorte que ces quelques années n’imposaient passeulement au souvenir d’<strong>Albertine</strong>, qui les rendait sidouloureuses, la couleur successive, les modalitésdifférentes de leurs saisons ou de leurs heures, des finsd’après-midi de juin aux soirs d’hiver, des clairs de lunesur la mer à l’aube en rentrant à la maison, de la neigede Paris aux feuilles mortes de Saint-Cloud, maisencore de l’idée particulière que je me faisaissuccessivement d’<strong>Albertine</strong>, de l’aspect physique souslequel je me la représentais à chacun de ces moments,de la fréquence plus ou moins grande avec laquelle je lavoyais cette saison-là, laquelle s’en trouvait commeplus dispersée ou plus compacte, des anxiétés qu’elleavait pu m’y causer par l’attente, du désir que j’avais àtel moment pour elle, d’espoirs formés, puis perdusi;tout cela modifiait le caractère de ma tristesserétrospective tout autant que les impressions de lumièreou de parfums qui lui étaient associées, et complétaitchacune des années solaires que j’avais vécues – et qui,rien qu’avec leurs printemps, leurs arbres, leurs brises,étaient déjà si tristes à cause du souvenir inséparabled’elle – en la doublant d’une sorte d’année sentimentaleoù les heures n’étaient pas définies par la position dusoleil, mais par l’attente d’un rendez-vousi; où lalongueur des jours, où les progrès de la température,étaient mesurés par l’essor de mes espérances, leprogrès de notre intimité, la transformation progressive
de son visage, les voyages qu’elle avait faits, lafréquence et le style des lettres qu’elle m’avaitadressées pendant une absence, sa précipitation plus oumoins grande à me voir au retour. Et enfin, ceschangements de temps, ces jours différents, s’ils merendaient chacun une autre <strong>Albertine</strong>, ce n’était passeulement par l’évocation des moments semblables.Mais l’on se rappelle que toujours, avant même quej’aimasse, chacune avait fait de moi un hommedifférent, ayant d’autres désirs parce qu’il avait d’autresperceptions et qui, de n’avoir rêvé que tempêtes etfalaises la veille, si le jour indiscret du printemps avaitglissé une odeur de roses dans la clôture mal jointe deson sommeil entrebâillé, s’éveillait en partance pourl’Italie. Même dans mon amour l’état changeant de monatmosphère morale, la pression modifiée de mescroyances n’avaient-ils pas, tel jour, diminué lavisibilité de mon propre amour, ne l’avaient-ils pas, teljour, indéfiniment étendue, tel jour embellie jusqu’ausourire, tel jour contractée jusqu’à l’oragei? On n’estque par ce qu’on possède, on ne possède que ce quivous est réellement présent, et tant de nos souvenirs, denos humeurs, de nos idées partent faire des voyages loinde nous-même, où nous les perdons de vue,! Alors nousne pouvons plus les faire entrer en ligne de compte dansce total qui est notre être. Mais ils ont des cheminssecrets pour rentrer en nous. Et certains soirs m’étant
endormi sans presque plus regretter <strong>Albertine</strong> – on nepeut regretter que ce qu’on se rappelle – au réveil jetrouvais toute une flotte de souvenirs qui étaient venuscroiser en moi dans ma plus claire conscience, et que jedistinguais à merveille. Alors je pleurais ce que jevoyais si bien et qui, la veille, n’était pour moi quenéant. Puis, brusquement, le nom d’<strong>Albertine</strong>, sa mortavaient changé de sensi; ses trahisons avaient soudainrepris toute leur importance.Comment m’avait-elle paru morte, quandmaintenant pour penser à elle je n’avais à madisposition que les mêmes images dont quand elle étaitvivante je revoyais l’une ou l’autre.: rapide et penchéesur la roue mythologique de sa bicyclette, sanglée lesjours de pluie sous la tunique guerrière de caoutchoucqui faisait bomber ses seins, la tête enturbannée etcoiffée de serpents, elle semait la terreur dans les ruesde Balbeci; les soirs où nous avions emporté duchampagne dans les bois de Chantepie, la voixprovocante et changée, elle avait au visage cette chaleurblême rougissant seulement aux pommettes que, ladistinguant mal dans l’obscurité de la voiture,j’approchais du clair de lune pour la mieux voir et quej’essayais maintenant en vain de me rappeler, de revoirdans une obscurité qui ne finirait plus. Petite statuettedans la promenade vers l’île, calme figure grosse à grosgrains près du pianola, elle était ainsi tour à tour
pluvieuse et rapide, provocante et diaphane, immobileet souriante, ange de la musique. Chacune était ainsiattachée à un moment, à la date duquel je me trouvaisreplacé quand je la revoyais. Et les moments du passéne sont pas immobilesi; ils gardent dans notre mémoirele mouvement qui les entraînait vers l’avenir – vers unavenir devenu lui-même le passé, – nous y entraînantnous-même. Jamais je n’avais caressé l’<strong>Albertine</strong>encaoutchoutée des jours de pluie, je voulais luidemander d’ôter cette armure, ce serait connaître avecelle l’amour des camps, la fraternité du voyage. Mais cen’était plus possible, elle était morte. Jamais non plus,par peur de la dépraver, je n’avais fait semblant decomprendre, les soirs où elle semblait m’offrir desplaisirs que sans cela elle n’eût peut-être pas demandésà d’autres, et qui excitaient maintenant en moi un désirfurieux. Je ne les aurais pas éprouvés semblables auprèsd’une autre, mais celle qui me les aurait donnés, jepouvais courir le monde sans la rencontrer puisque<strong>Albertine</strong> était morte. Il semblait que je dusse choisirentre deux faits, décider quel était le vrai, tant celui dela mort d’<strong>Albertine</strong> – venu pour moi d’une réalité que jen’avais pas connue.: sa vie en Touraine – était encontradiction avec toutes mes pensées relatives à<strong>Albertine</strong>, mes désirs, mes regrets, monattendrissement, ma fureur, ma jalousie. Une tellerichesse de souvenirs empruntés au répertoire de sa vie,
une telle profusion de sentiments évoquant, impliquantsa vie, semblaient rendre incroyable qu’<strong>Albertine</strong> fûtmorte. Une telle profusion de sentiments, car mamémoire, en conservant ma tendresse, lui laissait toutesa variété. Ce n’était pas <strong>Albertine</strong> seule qui n’étaitqu’une succession de moments, c’était aussi moi-même.Mon amour pour elle n’avait pas été simple.: à lacuriosité de l’inconnu s’était ajouté un désir sensuel, età un sentiment d’une douceur presque familiale, tantôtl’indifférence, tantôt une fureur jalouse. Je n’étais pasun seul homme, mais le défilé heure par heure d’unearmée composite où il y avait, selon le moment, despassionnés, des indifférents, des jaloux – des jalouxdont pas un n’était jaloux de la même femme. Et sansdoute ce serait de là qu’un jour viendrait la guérisonque je ne souhaiterais pas. Dans une foule, ces élémentspeuvent, un par un, sans qu’on s’en aperçoive, êtreremplacés par d’autres, que d’autres encore éliminentou renforcent, si bien qu’à la fin un changement s’estaccompli qui ne se pourrait concevoir si l’on était un.La complexité de mon amour, de ma personne,multipliait, diversifiait mes souffrances. Pourtant ellespouvaient se ranger toujours sous les deux groupes dontl’alternance avait fait toute la vie de mon amour pour<strong>Albertine</strong>, tour à tour livré à la confiance et au soupçonjaloux.Si j’avais peine à penser qu’<strong>Albertine</strong>, si vivante en
moi (portant comme je faisais le double harnais duprésent et du passé), était morte, peut-être était-il aussicontradictoire que ce soupçon de fautes, dont <strong>Albertine</strong>,aujourd’hui dépouillée de la chair qui en avait joui, del’âme qui avait pu les désirer, n’était plus capable, niresponsable, excitât en moi une telle souffrance, quej’aurais seulement bénie si j’avais pu y voir le gage dela réalité morale d’une personne matériellementinexistante, au lieu du reflet, destiné à s’éteindre luimême,d’impressions qu’elle m’avait autrefois causées.Une femme qui ne pouvait plus éprouver de plaisirsavec d’autres n’aurait plus dû exciter ma jalousie, siseulement ma tendresse avait pu se mettre à jour. Maisc’est ce qui était impossible puisqu’elle ne pouvaittrouver son objet, <strong>Albertine</strong>, que dans des souvenirs oùcelle-ci était vivante. Puisque, rien qu’en pensant à elle,je la ressuscitais, ses trahisons ne pouvaient jamais êtrecelles d’une mortei; l’instant où elle les avait commisesdevenant l’instant actuel, non pas seulement pour<strong>Albertine</strong>, mais pour celui de mes « moi » subitementévoqué qui la contemplait. De sorte qu’aucunanachronisme ne pouvait jamais séparer le coupleindissoluble où, à chaque coupable nouvelle, s’appariaitaussitôt un jaloux lamentable et toujours contemporain.Je l’avais, les derniers mois, tenue enfermée dans mamaison. Mais dans mon imagination maintenant,<strong>Albertine</strong> était libre, elle usait mal de cette liberté, elle
se prostituait aux unes, aux autres. Jadis je songeaissans cesse à l’avenir incertain qui était déployé devantnous, j’essayais d’y lire. Et maintenant ce qui était enavant de moi, comme un double de l’avenir – aussipréoccupant qu’un avenir puisqu’il était aussi incertain,aussi difficile à déchiffrer, aussi mystérieuxi; plus cruelencore parce que je n’avais pas comme pour l’avenir lapossibilité ou l’illusion d’agir sur lui, et aussi parcequ’il se déroulerait aussi long que ma vie elle-même,sans que ma compagne fût là pour calmer lessouffrances qu’il me causait, – ce n’était plus l’Avenird’<strong>Albertine</strong>, c’était son Passé. Son Passéi? C’est maldire puisque pour la jalousie il n’est ni passé ni aveniret que ce qu’elle imagine est toujours le Présent.Les changements de l’atmosphère en provoquentd’autres dans l’homme intérieur, réveillent des « moi »oubliés, contrarient l’assoupissement de l’habitude,redonnent de la force à tels souvenirs, à tellessouffrances. Combien plus encore pour moi si ce tempsnouveau qu’il faisait me rappelait celui par lequel<strong>Albertine</strong>, à Balbec, sous la pluie menaçante, parexemple, était allée faire, Dieu sait pourquoi, degrandes promenades, dans le maillot collant de soncaoutchouc. Si elle avait vécu, sans doute aujourd’hui,par ce temps si semblable, partirait-elle faire enTouraine une excursion analogue. Puisqu’elle ne lepouvait plus, je n’aurais pas dû souffrir de cette idéei;
mais, comme aux amputés, le moindre changement detemps renouvelait mes douleurs dans le membre quin’existait plus.Tout d’un coup c’était un souvenir que je n’avaispas revu depuis bien longtemps – car il était restédissous dans la fluide et invisible étendue de mamémoire – qui se cristallisait. Ainsi il y avait plusieursannées, comme on parlait de son peignoir de douche,<strong>Albertine</strong> avait rougi. À cette époque-là je n’étais pasjaloux d’elle. Mais depuis, j’avais voulu lui demander sielle pouvait se rappeler cette conversation et me direpourquoi elle avait rougi. Cela m’avait d’autant pluspréoccupé qu’on m’avait dit que les deux jeunes fillesamies de Léa allaient dans cet établissement balnéairede l’hôtel et, disait-on, pas seulement pour prendre desdouches. Mais, par peur de fâcher <strong>Albertine</strong> ouattendant une époque meilleure, j’avais toujours remisde lui en parler, puis je n’y avais plus pensé. Et toutd’un coup, quelque temps après la mort d’<strong>Albertine</strong>,j’aperçus ce souvenir, empreint de ce caractère à la foisirritant et solennel qu’ont les énigmes laissées à jamaisinsolubles par la mort du seul être qui eût pu leséclaircir. Ne pourrais-je pas du moins tâcher de savoirsi <strong>Albertine</strong> n’avait jamais rien fait de mal dans cetétablissement de douchesi? En envoyant quelqu’un àBalbec j’y arriverais peut-être. Elle vivante, je n’eussesans doute pu rien apprendre. Mais les langues se
délient étrangement et racontent facilement une fautequand on n’a plus à craindre la rancune de la coupable.Comme la constitution de l’imagination, restéerudimentaire, simpliste (n’ayant pas passé par lesinnombrables transformations qui remédient auxmodèles primitifs des inventions humaines, à peinereconnaissables, qu’il s’agisse de baromètre, de ballon,de téléphone, etc., dans leurs perfectionnementsultérieurs), ne nous permet de voir que fort peu dechoses à la fois, le souvenir de l’établissement dedouches occupait tout le champ de ma vision intérieure.Parfois je me heurtais dans les rues obscures dusommeil à un de ces mauvais rêves, qui ne sont pas biengraves pour une première raison, c’est que la tristessequ’ils engendrent ne se prolonge guère qu’une heureaprès le réveil, pareille à ces malaises que cause unemanière d’endormir artificielle. Pour une autre raisonaussi, c’est qu’on ne les rencontre que très rarement, àpeine tous les deux ou trois ans. Encore reste-t-ilincertain qu’on les ait déjà rencontrés et qu’ils n’aientpas plutôt cet aspect de ne pas être vus pour la premièrefois que projette sur eux une illusion, une subdivision(car dédoublement ne serait pas assez dire).Sans doute, puisque j’avais des doutes sur la vie, surla mort d’<strong>Albertine</strong>, j’aurais dû depuis bien longtempsme livrer à des enquêtes, mais la même fatigue, lamême lâcheté qui m’avaient fait me soumettre à
<strong>Albertine</strong> quand elle était là, m’empêchaient de rienentreprendre depuis que je ne la voyais plus. Et pourtantde la faiblesse traînée pendant des années un éclaird’énergie surgit parfois. Je me décidai à cette enquête,au moins toute naturelle. On eût dit qu’il n’y eût rien eud’autre dans toute la vie d’<strong>Albertine</strong>. Je me demandaisqui je pourrais bien envoyer tenter une enquête surplace, à Balbec. Aimé me parut bien choisi. Outre qu’ilconnaissait admirablement les lieux, il appartenait àcette catégorie de gens du peuple soucieux de leurintérêt, fidèles à ceux qu’ils servent, indifférents à touteespèce de morale et dont – parce que, si nous les payonsbien, dans leur obéissance à notre volonté ilssuppriment tout ce qui l’entraverait d’une manière oude l’autre, se montrant aussi incapables d’indiscrétion,de mollesse ou d’improbité que dépourvus de scrupules– nous disons.: « Ce sont de braves gens. » En ceux-lànous pouvons avoir une confiance absolue. QuandAimé fut parti, je pensai combien il eût mieux valu quece qu’il allait essayer d’apprendre là-bas, je pusse ledemander maintenant à <strong>Albertine</strong> elle-même. Etaussitôt l’idée de cette question que j’aurais voulu, qu’ilme semblait que j’allais lui poser, ayant amené<strong>Albertine</strong> à mon côté – non grâce à un effort derésurrection mais comme par le hasard d’une de cesrencontres qui, comme cela se passe dans lesphotographies qui ne sont pas « posées », dans les
instantanés, laissent toujours la personne plus vivante –en même temps que j’imaginais notre conversation j’ensentais l’impossibilitéi; je venais d’aborder par unenouvelle face cette idée qu’<strong>Albertine</strong> était morte,<strong>Albertine</strong> qui m’inspirait cette tendresse qu’on a pourles absentes dont la vue ne vient pas rectifier l’imageembellie, inspirant aussi la tristesse que cette absencefût éternelle et que la pauvre petite fût privée à jamaisde la douceur de la vie. Et aussitôt, par un brusquedéplacement, de la torture de la jalousie je passais audésespoir de la séparation.Ce qui remplissait mon cœur maintenant était, aulieu de haineux soupçons, le souvenir attendri desheures de tendresse confiante passées avec la sœur quesa mort m’avait réellement fait perdre, puisque monchagrin se rapportait, non à ce qu’<strong>Albertine</strong> avait étépour moi, mais à ce que mon cœur désireux departiciper aux émotions les plus générales de l’amourm’avait peu à peu persuadé qu’elle étaiti; alors je merendais compte que cette vie qui m’avait tant ennuyé –du moins je le croyais – avait été au contrairedélicieusei; aux moindres moments passés à parler avecelle de choses même insignifiantes, je sentaismaintenant qu’était ajoutée, amalgamée une volupté quialors n’avait, il est vrai, pas été perçue par moi, maisqui était déjà cause que ces moments-là je les avaistoujours si persévéramment recherchés à l’exclusion de
tout le restei; les moindres incidents que je merappelais, un mouvement qu’elle avait fait en voitureauprès de moi, ou pour s’asseoir en face de moi dans sachambre, propageaient dans mon âme un remous dedouceur et de tristesse qui de proche en proche lagagnait tout entière.Cette chambre où nous dînions ne m’avait jamaisparu jolie, je disais seulement qu’elle l’était à <strong>Albertine</strong>pour que mon amie fût contente d’y vivre. Maintenantles rideaux, les sièges, les livres avaient cessé de m’êtreindifférents. L’art n’est pas seul à mettre du charme etdu mystère dans les choses les plus insignifiantesi; cemême pouvoir de les mettre en rapport intime avecnous est dévolu aussi à la douleur. Au moment même jen’avais prêté aucune attention à ce dîner que nousavions fait ensemble au retour du Bois, avant quej’allasse chez les Verdurin, et vers la beauté, la gravedouceur duquel je tournais maintenant des yeux pleinsde larmes. Une impression de l’amour est hors deproportion avec les autres impressions de la vie, mais cen’est pas perdue au milieu d’elles qu’on peut s’enrendre compte. Ce n’est pas d’en bas, dans le tumultede la rue et la cohue des maisons avoisinantes, c’estquand on s’est éloigné que des pentes d’un coteauvoisin, à une distance où toute la ville a disparu, ou neforme plus au ras de terre qu’un amas confus, qu’onpeut, dans le recueillement de la solitude et du soir,
évaluer, unique, persistante et pure, la hauteur d’unecathédrale. Je tâchais d’embrasser l’image d’<strong>Albertine</strong> àtravers mes larmes en pensant à toutes les chosessérieuses et justes qu’elle avait dites ce soir-là.Un matin je crus voir la forme oblongue d’unecolline dans le brouillard, sentir la chaleur d’une tassede chocolat, pendant que m’étreignait horriblement lecœur ce souvenir de l’après-midi où <strong>Albertine</strong> étaitvenue me voir et où je l’avais embrassée pour lapremière fois.: c’est que je venais d’entendre le hoquetdu calorifère à eau qu’on venait de rallumer. Et je jetaiavec colère une invitation que Françoise apporta deM me Verdurini; combien l’impression que j’avais eue,en allant dîner pour la première fois à la Raspelière, quela mort ne frappe pas tous les êtres au même âges’imposait à moi avec plus de force maintenantqu’<strong>Albertine</strong> était morte, si jeune, et que Brichotcontinuait à dîner chez M me Verdurin qui recevaittoujours et recevrait peut-être pendant beaucoupd’années encore. Aussitôt ce nom de Brichot merappela la fin de cette même soirée où il m’avaitreconduit, où j’avais vu d’en bas la lumière de la lamped’<strong>Albertine</strong>. J’y avais déjà repensé d’autres fois, mais jen’avais pas abordé le souvenir par le même côté. Alors,en pensant au vide que je trouverais maintenant enrentrant chez moi, que je ne verrais plus d’en bas lachambre d’<strong>Albertine</strong> d’où la lumière s’était éteinte à
jamais, je compris combien ce soir où, en quittantBrichot, j’avais cru éprouver de l’ennui, du regret de nepouvoir aller me promener et faire l’amour ailleurs, jecompris combien je m’étais trompé, et que c’étaitseulement parce que le trésor dont les reflets venaientd’en haut jusqu’à moi, je m’en croyais la possessionentièrement assurée, que j’avais négligé d’en calculer lavaleur, ce qui faisait qu’il me paraissait forcémentinférieur à des plaisirs, si petits qu’ils fussent, mais que,cherchant à les imaginer, j’évaluais. Je compriscombien cette lumière qui me semblait venir d’uneprison contenait pour moi de plénitude, de vie et dedouceur, et qui n’était que la réalisation de ce quim’avait un instant enivré, puis paru à jamaisimpossible.: je comprenais que cette vie que j’avaismenée à Paris dans un chez-moi qui était son chez-elle,c’était justement la réalisation de cette paix profondeque j’avais rêvée le soir où <strong>Albertine</strong> avait couché sousle même toit que moi, à Balbec. La conversation quej’avais eue avec <strong>Albertine</strong> en rentrant du Bois avantcette dernière soirée Verdurin, je ne me fusse pasconsolé qu’elle n’eût pas eu lieu, cette conversation quiavait un peu mêlé <strong>Albertine</strong> à la vie de mon intelligenceet en certaines parcelles nous avait faits identiques l’unà l’autre. Car sans doute son intelligence, sa gentillessepour moi, si j’y revenais avec attendrissement, ce n’estpas qu’elles eussent été plus grandes que celles d’autres
personnes que j’avais connues. M me de Cambremer nem’avait-elle pas dit à Balbec.: « Comment,! vouspourriez passer vos journées avec Elstir qui est unhomme de génie et vous les passez avec votrecousine,! » L’intelligence d’<strong>Albertine</strong> me plaisait parceque, par association, elle éveillait en moi ce quej’appelais sa douceur, comme nous appelons douceurd’un fruit une certaine sensation qui n’est que dansnotre palais. Et de fait, quand je pensais à l’intelligenced’<strong>Albertine</strong>, mes lèvres s’avançaient instinctivement etgoûtaient un souvenir dont j’aimais mieux que la réalitéme fût extérieure et consistât dans la supérioritéobjective d’un être. Il est certain que j’avais connu despersonnes d’intelligence plus grande. Mais l’infini del’amour, ou son égoïsme, fait que les êtres que nousaimons sont ceux dont la physionomie intellectuelle etmorale est pour nous le moins objectivement définie,nous les retouchons sans cesse au gré de nos désirs etde nos craintes, nous ne les séparons pas de nous, ils nesont qu’un lieu immense et vague où s’extériorisent nostendresses. Nous n’avons pas de notre propre corps, oùaffluent perpétuellement tant de malaises et de plaisirs,une silhouette aussi nette que celle d’un arbre, ou d’unemaison, ou d’un passant. Et ç’avait peut-être été montort de ne pas chercher davantage à connaître <strong>Albertine</strong>en elle-même. De même qu’au point de vue de soncharme, je n’avais longtemps considéré que les
positions différentes qu’elle occupait dans monsouvenir dans le plan des années, et que j’avais étésurpris de voir qu’elle s’était spontanément enrichie demodifications qui ne tenaient pas qu’à la différence desperspectives, de même j’aurais dû chercher àcomprendre son caractère comme celui d’une personnequelconque et peut-être, m’expliquant alors pourquoielle s’obstinait à me cacher son secret, j’aurais évité deprolonger entre nous, avec cet acharnement étrange, ceconflit qui avait amené la mort d’<strong>Albertine</strong>. Et j’avaisalors, avec une grande pitié d’elle, la honte de luisurvivre. Il me semblait, en effet, dans les heures où jesouffrais le moins, que je bénéficiais en quelque sortede sa mort, car une femme est d’une plus grande utilitépour notre vie si elle y est, au lieu d’un élément debonheur, un instrument de chagrin, et il n’y en a pasune seule dont la possession soit aussi précieuse quecelle des vérités qu’elle nous découvre en nous faisantsouffrir. Dans ces moments-là, rapprochant la mort dema grand’mère et celle d’<strong>Albertine</strong>, il me semblait quema vie était souillée d’un double assassinat que seule lalâcheté du monde pouvait me pardonner. J’avais rêvéd’être compris d’<strong>Albertine</strong>, de ne pas être méconnu parelle, croyant que c’était pour le grand bonheur d’êtrecompris, de ne pas être méconnu, alors que tant d’autreseussent mieux pu le faire. On désire être compris parcequ’on désire être aimé, et on désire être aimé parce
qu’on aime. La compréhension des autres estindifférente et leur amour importun. Ma joie d’avoirpossédé un peu de l’intelligence d’<strong>Albertine</strong> et de soncœur ne venait pas de leur valeur intrinsèque, mais dece que cette possession était un degré de plus dans lapossession totale d’<strong>Albertine</strong>, possession qui avait étémon but et ma chimère depuis le premier jour où jel’avais vue. Quand nous parlons de la « gentillesse »d’une femme nous ne faisons peut-être que projeterhors de nous le plaisir que nous éprouvons à la voir,comme les enfants quand ils disent.: « Mon cher petitlit, mon cher petit oreiller, mes chères petitesaubépines. » Ce qui explique, par ailleurs, que leshommes ne disent jamais d’une femme qui ne lestrompe pas.: « Elle est si gentille » et le disent sisouvent d’une femme par qui ils sont trompés. M me deCambremer trouvait avec raison que le charme spiritueld’Elstir était plus grand. Mais nous ne pouvons pasjuger de la même façon celui d’une personne qui est,comme toutes les autres, extérieure à nous, peinte àl’horizon de notre pensée, et celui d’une personne qui,par suite d’une erreur de localisation consécutive àcertains accidents mais tenace, s’est logée dans notrepropre corps au point que de nous demanderrétrospectivement si elle n’a pas regardé une femme uncertain jour dans le couloir d’un petit chemin de fermaritime nous fait éprouver les mêmes souffrances
qu’un chirurgien qui chercherait une balle dans notrecœur. Un simple croissant, mais que nous mangeons,nous fait éprouver plus de plaisir que tous les ortolans,lapereaux et bartavelles qui furent servis à Louis XV, etla pointe de l’herbe qui à quelques centimètres frémitdevant notre œil, tandis que nous sommes couchés surla montagne, peut nous cacher la vertigineuse aiguilled’un sommet si celui-ci est distant de plusieurs lieues.D’ailleurs notre tort n’est pas de priserl’intelligence, la gentillesse d’une femme que nousaimons, si petites que soient celles-ci. Notre tort est derester indifférent à la gentillesse, à l’intelligence desautres. Le mensonge ne recommence à nous causerl’indignation, et la bonté la reconnaissance qu’ilsdevraient toujours exciter en nous, que s’ils viennentd’une femme que nous aimons, et le désir physique a cemerveilleux pouvoir de rendre son prix à l’intelligenceet des bases solides à la vie morale. Jamais je neretrouverais cette chose divine.: un être avec qui jepusse causer de tout, à qui je pusse me confier. Meconfieri? Mais d’autres êtres ne me montraient-ils pasplus de confiance qu’<strong>Albertine</strong>i? Avec d’autres n’avaisjepas des causeries plus étenduesi? C’est que laconfiance, la conversation, choses médiocres,qu’importe qu’elles soient plus ou moins imparfaites, sis’y mêle seulement l’amour, qui seul est divin. Jerevoyais <strong>Albertine</strong> s’asseyant à son pianola, rose sous
ses cheveux noirsi; je sentais, sur mes lèvres qu’elleessayait d’écarter, sa langue, sa langue maternelle,incomestible, nourricière et sainte dont la flamme et larosée secrètes faisaient que, même quand <strong>Albertine</strong> lafaisait seulement glisser à la surface de mon cou, demon ventre, ces caresses superficielles mais en quelquesorte faites par l’intérieur de sa chair, extériorisécomme une étoffe qui montrerait sa doublure,prenaient, même dans les attouchements les plusexternes, comme la mystérieuse douceur d’unepénétration.Tous ces instants si doux que rien ne me rendraitjamais, je ne peux même pas dire que ce que me faisaitéprouver leur perte fût du désespoir. Pour êtredésespérée, cette vie qui ne pourra plus être quemalheureuse, il faut encore y tenir. J’étais désespéré àBalbec quand j’avais vu se lever le jour et que j’avaiscompris que plus un seul ne pourrait être heureux pourmoi. J’étais resté aussi égoïste depuis lors, mais le« moi » auquel j’étais attaché maintenant, le « moi » quiconstituait ces vives réserves qui mettait en jeul’instinct de conservation, ce « moi » n’était plus dansla viei; quand je pensais à mes forces, à ma puissancevitale, à ce que j’avais de meilleur, je pensais à certaintrésor que j’avais possédé (que j’avais été seul àposséder puisque les autres ne pouvaient connaîtreexactement le sentiment, caché en moi, qu’il m’avait
inspiré) et que personne ne pouvait plus m’enleverpuisque je ne le possédais plus.Et, à vrai dire, je ne l’avais jamais possédé queparce que j’avais voulu me figurer que je le possédais.Je n’avais pas commis seulement l’imprudence, enregardant <strong>Albertine</strong> et en la logeant dans mon cœur, dele faire vivre au-dedans de moi, ni cette autreimprudence de mêler un amour familial au plaisir dessens. J’avais voulu aussi me persuader que nos rapportsétaient l’amour, que nous pratiquions mutuellement lesrapports appelés amour, parce qu’elle me donnaitdocilement les baisers que je lui donnais, et, pour avoirpris l’habitude de le croire, je n’avais pas perduseulement une femme que j’aimais mais une femme quim’aimait, ma sœur, mon enfant, ma tendre maîtresse.Et, en somme, j’avais eu un bonheur et un malheur queSwann n’avait pas connus, car justement, tout le tempsqu’il avait aimé Odette et en avait été si jaloux, il l’avaità peine vue, pouvant si difficilement, à certains jours oùelle le décommandait au dernier moment, aller chezelle. Mais après il l’avait eue à lui, devenue sa femme,et jusqu’à ce qu’il mourût. Moi, au contraire, tandis quej’étais si jaloux d’<strong>Albertine</strong>, plus heureux que Swann jel’avais eue chez moi. J’avais réalisé en vérité ce queSwann avait rêvé si souvent et qu’il n’avait réalisématériellement que quand cela lui était indifférent. Maisenfin <strong>Albertine</strong>, je ne l’avais pas gardée comme il avait
gardé Odette. Elle s’était enfuie, elle était morte. Carjamais rien ne se répète exactement et les existences lesplus analogues et que, grâce à la parenté des caractèreset à la similitude des circonstances, on peut choisir pourles présenter comme symétriques l’une à l’autre restenten bien des points opposées.En perdant la vie je n’aurais pas perdu grand’chosei;je n’aurais plus perdu qu’une forme vide, le cadre vided’un chef-d’œuvre. Indifférent à ce que je pouvaisdésormais y faire entrer, mais heureux et fier de penserà ce qu’il avait contenu, je m’appuyais au souvenir deces heures si douces, et ce soutien moral mecommuniquait un bien-être que l’approche même de lamort n’aurait pas rompu.Comme elle accourait vite me voir, à Balbec, quandje la faisais chercher, se retardant seulement à verser del’odeur dans ses cheveux pour me plaire,! Ces imagesde Balbec et de Paris, que j’aimais ainsi à revoir,c’étaient les pages encore si récentes, et si vite tournées,de sa courte vie. Tout cela, qui n’était pour moi quesouvenir, avait été pour elle action, action précipités,comme celle d’une tragédie, vers une mort rapide. Lesêtres ont un développement en nous, mais un autre horsde nous (je l’avais bien senti dans ces soirs où jeremarquais en <strong>Albertine</strong> un enrichissement de qualitésqui ne tenait pas qu’à ma mémoire) et qui ne laissentpas d’avoir des réactions l’un sur l’autre. J’avais eu
eau, en cherchant à connaître <strong>Albertine</strong>, puis à laposséder tout entière, n’obéir qu’au besoin de réduirepar l’expérience à des éléments mesquinementsemblables à ceux de notre « moi » le mystère de toutêtre, je ne l’avais pu sans influer à mon tour sur la vied’<strong>Albertine</strong>. Peut-être ma fortune, les perspectives d’unbrillant mariage l’avaient attiréei; ma jalousie l’avaitretenuei; sa bonté, ou son intelligence, ou le sentimentde sa culpabilité, ou les adresses de sa ruse, lui avaientfait accepter, et m’avaient amené à rendre de plus enplus dure une captivité forgée simplement par ledéveloppement interne de mon travail mental, mais quin’en avait pas moins eu sur la vie d’<strong>Albertine</strong> descontre-coups destinés eux-mêmes à poser, par choc enretour, des problèmes nouveaux et de plus en plusdouloureux à ma psychologie, puisque de ma prisonelle s’était évadée pour aller se tuer sur un cheval quesans moi elle n’eût pas possédé, en me laissant, mêmemorte, des soupçons dont la vérification, si elle devaitvenir, me serait peut-être plus cruelle que la découverte,à Balbec, qu’<strong>Albertine</strong> avait connu M lle Vinteuil,puisque <strong>Albertine</strong> ne serait plus là pour m’apaiser. Sibien que cette longue plainte de l’âme qui croit vivreenfermée en elle-même n’est un monologue qu’enapparence, puisque les échos de la réalité la font dévieret que telle vie est comme un essai de psychologiesubjective spontanément poursuivi, mais qui fournit à
quelque distance son « action » au roman purementréaliste d’une autre réalité, d’une autre existence, dont àleur tour les péripéties viennent infléchir la courbe etchanger la direction de l’essai psychologique. Commel’engrenage avait été serré, comme l’évolution de notreamour avait été rapide et, malgré quelquesretardements, interruptions et hésitations du début,comme dans certaines nouvelles de Balzac ou quelquesballades de Schumann, le dénouement précipité,! C’estdans le cours de cette dernière année, longue pour moicomme un siècle – tant <strong>Albertine</strong> avait changé depositions par rapport à ma pensée depuis Balbec jusqu’àson départ de Paris, et aussi, indépendamment de moi etsouvent à mon insu, changé en elle-même – qu’il fallaitplacer toute cette bonne vie de tendresse qui avait si peuduré et qui pourtant m’apparaissait avec une plénitude,presque une immensité, à jamais impossible et pourtantqui m’était indispensable. Indispensable sans avoirpeut-être été en soi et tout d’abord quelque chose denécessaire, puisque je n’aurais pas connu <strong>Albertine</strong> si jen’avais pas lu dans un traité d’archéologie ladescription de l’église de Balbeci; si Swann, en medisant que cette église était presque persane, n’avait pasorienté mes désirs vers le normand byzantini; si unesociété de palaces, en construisant à Balbec un hôtelhygiénique et confortable, n’avait pas décidé mesparents à exaucer mon souhait et à m’envoyer à Balbec.
Certes, en ce Balbec depuis si longtemps désiré, jen’avais pas trouvé l’église persane que je rêvais ni lesbrouillards éternels. Le beau train d’une heure trentecinqlui-même n’avait pas répondu à ce que je m’enfigurais. Mais, en échange de ce que l’imaginationlaisse attendre et que nous nous donnons inutilementtant de peine pour essayer de découvrir, la vie nousdonne quelque chose que nous étions bien loind’imaginer. Qui m’eût dit à Combray, quand j’attendaisle bonsoir de ma mère avec tant de tristesse, que cesanxiétés guériraient, puis renaîtraient un jour, non pourma mère, mais pour une jeune fille qui ne seraitd’abord, sur l’horizon de la mer, qu’une fleur que mesyeux seraient chaque jour sollicités de venir regarder,mais une fleur pensante et dans l’esprit de qui jesouhaitais si puérilement de tenir une grande place, queje souffrirais qu’elle ignorât que je connaissais M me deVilleparisis. Oui, c’est le bonsoir, le baiser d’une telleétrangère pour lequel, au bout de quelques années, jedevais souffrir autant qu’enfant quand ma mère nedevait pas venir me voir. Or cette <strong>Albertine</strong> sinécessaire, de l’amour de qui mon âme était maintenantpresque uniquement composée, si Swann ne m’avaitpas parlé de Balbec je ne l’aurais jamais connue. Sa vieeût peut-être été plus longue, la mienne aurait étédépourvue de ce qui en faisait maintenant le martyre. Etainsi il me semblait que, par ma tendresse uniquement
égoïste, j’avais laissé mourir <strong>Albertine</strong> comme j’avaisassassiné ma grand’mère. Même plus tard, mêmel’ayant déjà connue à Balbec, j’aurais pu ne pas l’aimercomme je fis ensuite. Quand je renonçai à Gilberte etsavais que je pourrais aimer un jour une autre femme,j’osais à peine avoir un doute si en tous cas pour lepassé je n’eusse pu aimer que Gilberte. Or pour<strong>Albertine</strong> je n’avais même plus de doute, j’étais sûr queç’aurait pu ne pas être elle que j’eusse aimée, que c’eûtpu être une autre. Il eût suffi pour cela que M lle deStermaria, le soir où je devais dîner avec elle dans l’îledu Bois, ne se fût pas décommandée. Il était encoretemps alors, et c’eût été pour M lle de Stermaria que sefût exercée cette activité de l’imagination qui nous faitextraire d’une femme une telle notion de l’individuelqu’elle nous paraît unique en soi et pour nousprédestinée et nécessaire. Tout au plus, en me plaçant àun point de vue presque physiologique, pouvais-je direque j’aurais pu avoir ce même amour exclusif pour uneautre femme, mais non pour toute autre femme. Car<strong>Albertine</strong>, grosse et brune, ne ressemblait pas àGilberte, élancée et rousse, mais pourtant elles avaientla même étoffe de santé, et dans les mêmes jouessensuelles toutes les deux un regard dont on saisissaitdifficilement la signification. C’étaient de ces femmesque n’auraient pas regardées des hommes qui de leurcôté auraient fait des folies pour d’autres qui « ne me
disaient rien ». Je pouvais presque croire que lapersonnalité sensuelle et volontaire de Gilberte avaitémigré dans le corps d’<strong>Albertine</strong>, un peu différent, il estvrai, mais présentant, maintenant que j’y réfléchissaisaprès coup, des analogies profondes. Un homme apresque toujours la même manière de s’enrhumer, detomber malade, c’est-à-dire qu’il lui faut pour cela uncertain concours de circonstancesi; il est naturel quequand il devient amoureux ce soit à propos d’un certaingenre de femmes, genre d’ailleurs très étendu. Lespremiers regards d’<strong>Albertine</strong> qui m’avaient fait rêvern’étaient pas absolument différents des premiersregards de Gilberte. Je pouvais presque croire quel’obscure personnalité, la sensualité, la naturevolontaire et rusée de Gilberte étaient revenues metenter, incarnées cette fois dans le corps d’<strong>Albertine</strong>,tout autre et non pourtant sans analogies. Pour<strong>Albertine</strong>, grâce à une vie toute différente ensemble etoù n’avait pu se glisser, dans un bloc de pensées où unedouloureuse préoccupation maintenait une cohésionpermanente, aucune fissure de distraction et d’oubli,son corps vivant n’avait point, comme celui de Gilberte,cessé un jour d’être celui où je trouvais ce que jereconnaissais après coup être pour moi (et qui n’eût pasété pour d’autres) les attraits féminins. Mais elle étaitmorte. Je l’oublierais. Qui sait si alors les mêmesqualités de sang riche, de rêverie inquiète ne
eviendraient pas un jour jeter le trouble en moi, maisincarnées cette fois en quelle forme féminine, je nepouvais le prévoir. À l’aide de Gilberte j’aurais pu aussipeu me figurer <strong>Albertine</strong>, et que je l’aimerais, que lesouvenir de la sonate de Vinteuil ne m’eût permis deme figurer son septuor. Bien plus, même les premièresfois où j’avais vu <strong>Albertine</strong>, j’avais pu croire que c’étaitd’autres que j’aimerais. D’ailleurs, elle eût même pu meparaître, si je l’avais connue une année plus tôt, aussiterne qu’un ciel gris où l’aurore n’est pas levée. Sij’avais changé à son égard, elle-même avait changéaussi, et la jeune fille qui était venue vers mon lit le jouroù j’avais écrit à M lle de Stermaria n’était plus la mêmeque j’avais connue à Balbec, soit simple explosion de lafemme qui apparaît au moment de la puberté, soit parsuite de circonstances que je n’ai jamais pu connaître.En tous cas, même si celle que j’aimerais un jour devaitdans une certaine mesure lui ressembler, c’est-à-dire simon choix d’une femme n’était pas entièrement libre,cela faisait tout de même que, dirigé d’une façon peutêtrenécessaire, il l’était sur quelque chose de plus vastequ’un individu, sur un genre de femmes, et cela ôtaittoute nécessité à mon amour pour <strong>Albertine</strong>. La femmedont nous avons le visage devant nous plusconstamment que la lumière elle-même, puisque, mêmeles yeux fermés, nous ne cessons pas un instant dechérir ses beaux yeux, son beau nez, d’arranger tous les
moyens pour les revoir, cette femme unique, noussavons bien que c’eût été une autre qui l’eût été pournous si nous avions été dans une autre ville que celle oùnous l’avons rencontrée, si nous nous étions promenésdans d’autres quartiers, si nous avions fréquenté unautre salon. Unique, croyons-nousi? elle estinnombrable. Et pourtant elle est compacte,indestructible devant nos yeux qui l’aiment,irremplaçable pendant très longtemps par une autre.C’est que cette femme n’a fait que susciter par dessortes d’appels magiques mille éléments de tendresseexistant en nous à l’état fragmentaire et qu’elle aassemblés, unis, effaçant toute cassure entre eux, c’estnous-même qui en lui donnant ses traits avons fournitoute la matière solide de la personne aimée. De là vientque, même si nous ne sommes qu’un entre mille pourelle et peut-être le dernier de tous, pour nous elle est laseule et celle vers qui tend toute notre vie. Certesmême, j’avais bien senti que cet amour n’était pasnécessaire, non seulement parce qu’il eût pu se formeravec M lle de Stermaria, mais même sans cela, en leconnaissant lui-même, en le retrouvant trop pareil à cequ’il avait été pour d’autres, et aussi en le sentant plusvaste qu’<strong>Albertine</strong>, l’enveloppant, ne la connaissantpas, comme une marée autour d’un mince brisant. Maispeu à peu, à force de vivre avec <strong>Albertine</strong>, les chaînesque j’avais forgées moi-même, je ne pouvais plus m’en
dégageri; l’habitude d’associer la personne d’<strong>Albertine</strong>au sentiment qu’elle n’avait pas inspiré me faisaitpourtant croire qu’il était spécial à elle, commel’habitude donne à la simple association d’idées entredeux phénomènes, à ce que prétend une certaine écolephilosophique, la force, la nécessité illusoires d’une loide causalité. J’avais cru que mes relations, ma fortune,me dispenseraient de souffrir, et peut-être tropefficacement puisque cela me semblait me dispenser desentir, d’aimer, d’imagineri; j’enviais une pauvre fillede campagne à qui l’absence de relations, même detélégraphe, donne de longs mois de rêve après unchagrin qu’elle ne peut artificiellement endormir. Or jeme rendais compte maintenant que si, pour M me deGuermantes comblée de tout ce qui pouvait rendreinfinie la distance entre elle et moi, j’avais vu cettedistance brusquement supprimée par l’opinion que lesavantages sociaux ne sont que matière inerte ettransformable, d’une façon semblable, quoique inverse,mes relations, ma fortune, tous les moyens matérielsdont tant ma situation que la civilisation de mon époqueme faisaient profiter, n’avaient fait que reculerl’échéance de la lutte corps à corps avec la volontécontraire, inflexible d’<strong>Albertine</strong>, sur laquelle aucunepression n’avait agi. Sans doute j’avais pu échanger desdépêches, des communications téléphoniques avecSaint-Loup, être en rapports constants avec le bureau de
Tours, mais leur attente n’avait-elle pas été inutile, leurrésultat nuli? Et les filles de la campagne, sansavantages sociaux, sans relations, ou les humains avantles perfectionnements de la civilisation ne souffrent-ilspas moins, parce qu’on désire moins, parce qu’onregrette moins ce qu’on a toujours su inaccessible et quiest resté à cause de cela comme irréeli? On désire plusla personne qui va se donneri; l’espérance anticipe lapossessioni; mais le regret aussi est un amplificateur dudésir. Le refus de M lle de Stermaria de venir dîner à l’îledu Bois est ce qui avait empêché que ce fût elle quej’aimasse. Cela eût pu suffire aussi à me la faire aimer,si ensuite je l’avais revue à temps. Aussitôt que j’avaissu qu’elle ne viendrait pas, envisageant l’hypothèseinvraisemblable – et qui s’était réalisée – que peut-êtrequelqu’un était jaloux d’elle et l’éloignait des autres,que je ne la reverrais jamais, j’avais tant souffert quej’aurais tout donné pour la voir, et c’est une des plusgrandes angoisses que j’eusse connues, que l’arrivée deSaint-Loup avait apaisée. Or à partir d’un certain âgenos amours, nos maîtresses sont filles de notreangoissei; notre passé, et les lésions physiques où ils’est inscrit, déterminent notre avenir. Pour <strong>Albertine</strong>en particulier, qu’il ne fût pas nécessaire que ce fût elleque j’aimasse était, même sans ces amours voisines,inscrit dans l’histoire de mon amour pour elle, c’est-àdirepour elle et ses amies. Car ce n’était même pas un
amour comme celui pour Gilberte, mais créé pardivision entre plusieurs jeunes filles. Que ce fût à caused’elle et parce qu’elles me paraissaient quelque chosed’analogue à elle que je me fusse plu avec ses amies, ilétait possible. Toujours est-il que pendant bienlongtemps l’hésitation entre toutes fut possible, monchoix se promenant de l’une à l’autre, et quand jecroyais préférer celle-ci, il suffisait que celle-là melaissât attendre, refusât de me voir pour que j’eussepour elle un commencement d’amour. Bien des fois àcette époque lorsque Andrée devait venir me voir àBalbec, si, un peu avant la visite d’Andrée, <strong>Albertine</strong>me manquait de parole, mon cœur ne cessait plus debattre, je croyais ne jamais la revoir et c’était elle quej’aimais. Et quand Andrée venait, c’était sérieusementque je lui disais (comme je le lui dis à Paris après quej’eus appris qu’<strong>Albertine</strong> avait connu M lle Vinteuil), cequ’elle pouvait croire dit exprès, sans sincérité, ce quiaurait été dit en effet, et dans les mêmes termes, sij’avais été heureux la veille avec <strong>Albertine</strong>.: « Hélas, sivous étiez venue plus tôt, maintenant j’en aime uneautre. » Encore dans ce cas d’Andrée, remplacée par<strong>Albertine</strong> quand j’avais appris que celle-ci avait connuM lle Vinteuil, l’amour avait été alternatif et parconséquent, en somme, il n’y en avait eu qu’un à lafois. Mais il s’était produit tel cas auparavant où jem’étais à demi brouillé avec deux des jeunes filles.
Celle qui ferait les premiers pas me rendrait le calme,c’est l’autre que j’aimerais si elle restait brouillée, cequi ne veut pas dire que ce n’est pas avec la premièreque je me lierais définitivement, car elle me consolerait– bien qu’inefficacement – de la dureté de la seconde,de la seconde que je finirais par oublier si elle nerevenait plus. Or il arrivait que, persuadé que l’une oul’autre au moins allait revenir à moi, aucune des deuxpendant quelque temps ne le faisait. Mon angoisse étaitdonc double, et double mon amour, me réservant decesser d’aimer celle qui reviendrait, mais souffrantjusque-là par toutes les deux. C’est le lot d’un certainâge, qui peut venir très tôt, qu’on soit rendu moinsamoureux par un être que par un abandon où de cet êtreon finit par ne plus savoir qu’une chose, sa figure étantobscurcie, son âme inexistante, votre préférence touterécente et inexpliquée.: c’est qu’on aurait besoin pourne plus souffrir qu’il vous fît dire.: « Me recevriezvousi?» Ma séparation d’avec <strong>Albertine</strong>, le jour oùFrançoise m’avait dit.: « Mademoiselle <strong>Albertine</strong> estpartie », était comme une allégorie de tant d’autresséparations. Car bien souvent pour que nousdécouvrions que nous sommes amoureux, peut-êtremême pour que nous le devenions, il faut qu’arrive lejour de la séparation. Dans ce cas, où c’est une attentevaine, un mot de refus qui fixe un choix, l’imaginationfouettée par la souffrance va si vite dans son travail,
fabrique avec une rapidité si folle un amour à peinecommencé et qui restait informe, destiné à rester à l’étatd’ébauche depuis des mois, que par instantsl’intelligence, qui n’a pu rattraper le cœur, s’étonne,s’écrie.: « Mais tu es fou, dans quelles penséesnouvelles vis-tu si douloureusementi? Tout cela n’estpas la vie réelle. » Et, en effet, à ce moment-là, si onn’était pas relancé par l’infidèle, de bonnes distractionsqui nous calmeraient physiquement le cœur suffiraientpour faire avorter l’amour. En tous cas, si cette vie avec<strong>Albertine</strong> n’était pas, dans son essence, nécessaire, ellem’était devenue indispensable. J’avais tremblé quandj’avais aimé M me de Guermantes parce que je me disaisqu’avec ses trop grands moyens de séduction, nonseulement de beauté mais de situation, de richesse, elleserait trop libre d’être à trop de gens, que j’aurais troppeu de prise sur elle. <strong>Albertine</strong> étant pauvre, obscure,devait être désireuse de m’épouser. Et pourtant jen’avais pu la posséder pour moi seul. Que ce soient lesconditions sociales, les prévisions de la sagesse, envérité, on n’a pas de prises sur la vie d’un autre être.Pourquoi ne m’avait-elle pas dit.: « J’ai ces goûts »i?J’aurais cédé, je lui aurais permis de les satisfaire. Dansun roman que j’avais lu il y avait une femme qu’aucuneobjurgation de l’homme qui l’aimait ne pouvait déciderà parler. En le lisant j’avais trouvé cette situationabsurdei; j’aurais, moi, me disais-je, forcé la femme à
parler d’abord, ensuite nous nous serions entendusi; àquoi bon ces malheurs inutilesi? Mais je voyaismaintenant que nous ne sommes pas libres de ne pasnous les forger et que nous avons beau connaître notrevolonté, les autres êtres ne lui obéissent pas.Et pourtant ces douloureuses, ces inéluctablesvérités qui nous dominaient et pour lesquelles nousétions aveugles, vérité de nos sentiments, vérité denotre destin, combien de fois sans le savoir, sans levouloir, nous les avions dites en des paroles, crues sansdoute mensongères par nous mais auxquellesl’événement avait donné après coup leur valeurprophétique. Je me rappelais bien des mots que l’un etl’autre nous avions prononcés sans savoir alors la véritéqu’ils contenaient, même que nous avions dits encroyant nous jouer la comédie et dont la fausseté étaitbien mince, bien peu intéressante, toute confinée dansnotre pitoyable insincérité, auprès de ce qu’ilscontenaient à notre insu. Mensonges, erreurs en deçà dela réalité profonde que nous n’apercevions pas, véritéau delà, vérité de nos caractères dont les loisessentielles nous échappent et demandent le temps pourse révéler, vérité de nos destins aussi. J’avais cru mentirquand je lui avais dit, à Balbec.: « Plus je vous verrai,plus je vous aimerai » (et pourtant c’était cette intimitéde tous les instants qui, par le moyen de la jalousie,m’avait tant attaché à elle), « je sens que je pourrais être
utile à votre esprit »i; à Paris.: « Tâchez d’être prudente.Pensez, s’il vous arrivait un accident je ne m’enconsolerais pas », et elle.: « Mais il peut m’arriver unaccident »i; à Paris, le soir où j’avais fait semblant devouloir la quitter.: « Laissez-moi vous regarder encorepuisque bientôt je ne vous verrai plus, et que ce serapour jamais. » Et elle, quand ce même soir elle avaitregardé autour d’elle.: « Dire que je ne verrai plus cettechambre, ces livres, ce pianola, toute cette maison, je nepeux pas le croire, et pourtant c’est vrai. » Dans sesdernières lettres enfin, quand elle avait écrit –probablement en se disant « Je fais du chiqué ».: – « Jevous laisse le meilleur de moi-même » (et n’était-ce pasen effet maintenant à la fidélité, aux forces, fragileshélas aussi, de ma mémoire qu’étaient confiées sonintelligence, sa bonté, sa beautéi?) et.: « cet instant,deux fois crépusculaire puisque le jour tombait et quenous allions nous quitter, ne s’effacera de mon espritque quand il sera envahi par la nuit complète », cettephrase écrite la veille du jour où, en effet, son espritavait été envahi par la nuit complète et où peut-êtrebien, dans ces dernières lueurs si rapides mais quel’anxiété du moment divise jusqu’à l’infini, elle avaitpeut-être bien revu notre dernière promenade, et danscet instant où tout nous abandonne et où on se crée unefoi, comme les athées deviennent chrétiens sur lechamp de bataille, elle avait peut-être appelé au secours
l’ami si souvent maudit mais si respecté par elle, quilui-même – car toutes les religions se ressemblent –avait la cruauté de souhaiter qu’elle eût eu aussi letemps de se reconnaître, de lui donner sa dernièrepensée, de se confesser enfin à lui, de mourir en lui.Mais à quoi bon, puisque si même, alors, elle avait eu letemps de se reconnaître, nous n’avions compris l’un etl’autre où était notre bonheur, ce que nous aurions dûfaire, que quand ce bonheur, que parce que ce bonheurn’était plus possible, que nous ne pouvions plus leréaliser. Tant que les choses sont possibles on lesdiffère, et elles ne peuvent prendre cette puissanced’attraits et cette apparente aisance de réalisation quequand, projetées dans le vide idéal de l’imagination,elles sont soustraites à la submersion alourdissante,enlaidissante du milieu vital. L’idée qu’on mourra estplus cruelle que mourir, mais moins que l’idée qu’unautre est morti; que, redevenue plane après avoirenglouti un être, s’étend, sans même un remous à cetteplace-là, une réalité d’où cet être est exclu, où n’existeplus aucun vouloir, aucune connaissance, et de laquelleil est aussi difficile de remonter à l’idée que cet être avécu, qu’il est difficile, du souvenir encore tout récentde sa vie, de penser qu’il est assimilable aux imagessans consistance, aux souvenirs laissés par lespersonnages d’un roman qu’on a lu.Du moins j’étais heureux qu’avant de mourir elle
m’eût écrit cette lettre, et surtout envoyé la dernièredépêche qui me prouvait qu’elle fût revenue si elle eûtvécu. Il me semblait que c’était non seulement plusdoux, mais plus beau aussi, que l’événement eût étéincomplet sans ce télégramme, eût eu moins figure d’artet de destin. En réalité il l’eût eue tout autant s’il eût étéautrei; car tout événement est comme un moule d’uneforme particulière, et, quel qu’il soit, il impose, à lasérie des faits qu’il est venu interrompre et sembleconclure, un dessin que nous croyons le seul possibleparce que nous ne connaissons pas celui qui eût pu luiêtre substitué. Je me répétais.: « Pourquoi ne m’avaitellepas dit.: « J’ai ces goûts »i? J’aurais cédé, je luiaurais permis de les satisfaire, en ce moment jel’embrasserais encore. » Quelle tristesse d’avoir à merappeler qu’elle m’avait ainsi menti en me jurant, troisjours avant de me quitter, qu’elle n’avait jamais eu avecl’amie de M lle Vinteuil ces relations qu’au moment où<strong>Albertine</strong> me le jurait sa rougeur avait confessées.Pauvre petite, elle avait eu du moins l’honnêteté de nepas vouloir jurer que le plaisir de revoir M lle Vinteuiln’entrait pour rien dans son désir d’aller ce jour-là chezles Verdurin. Pourquoi n’était-elle pas allée jusqu’aubout de son aveu, et avait-elle inventé alors ce romaninimaginablei? Peut-être, du reste, était-ce un peu mafaute si elle n’avait jamais, malgré toutes mes prièresqui venaient se briser à sa dénégation, voulu me dire.:
« J’ai ces goûts. » C’était peut-être un peu ma fauteparce que à Balbec, le jour où après la visite de M me deCambremer j’avais eu ma première explication avec<strong>Albertine</strong> et où j’étais si loin de croire qu’elle pût avoiren tous cas autre chose qu’une amitié trop passionnéeavec Andrée, j’avais exprimé avec trop de violencemon dégoût pour ce genre de mœurs, je les avaiscondamnées d’une façon trop catégorique. Je nepouvais me rappeler si <strong>Albertine</strong> avait rougi quandj’avais naïvement proclamé mon horreur de cela, je nepouvais me le rappeler, car ce n’est souvent quelongtemps après que nous voudrions bien savoir quelleattitude eut une personne à un moment où nous n’yfîmes nullement attention et qui, plus tard, quand nousrepensons à notre conversation, éclaircirait unedifficulté poignante. Mais dans notre mémoire il y a unelacune, il n’y a pas trace de cela. Et bien souvent nousn’avons pas fait assez attention, au moment même, auxchoses qui pouvaient déjà nous paraître importantes,nous n’avons pas bien entendu une phrase, nousn’avons pas noté un geste, ou bien nous les avonsoubliés. Et quand plus tard, avides de découvrir unevérité, nous remontons de déduction en déduction,feuilletant notre mémoire comme un recueil detémoignages, quand nous arrivons à cette phrase, à cegeste, impossible de nous rappeler, nous recommençonsvingt fois le même trajet, mais inutilement.: le chemin
ne va pas plus loin. Avait-elle rougii? Je ne sais si elleavait rougi, mais elle n’avait pas pu ne pas entendre, etle souvenir de ces paroles l’avait plus tard arrêtée quandpeut-être elle avait été sur le point de se confesser àmoi. Et maintenant elle n’était plus nulle part, j’auraispu parcourir la terre d’un pôle à l’autre sans rencontrer<strong>Albertine</strong>. La réalité, qui s’était refermée sur elle, étaitredevenue unie, avait effacé jusqu’à la trace de l’êtrequi avait coulé à fond. Elle n’était plus qu’un nom,comme cette M me de Charlus dont disaient avecindifférence.: « Elle était délicieuse » ceux qui l’avaientconnue. Mais je ne pouvais pas concevoir plus d’uninstant l’existence de cette réalité dont <strong>Albertine</strong> n’avaitpas conscience, car en moi mon amie existait trop, enmoi où tous les sentiments, toutes les pensées serapportaient à sa vie. Peut-être, si elle l’avait su, eût-elleété touchée de voir que son ami ne l’oubliait pas,maintenant que sa vie à elle était finie, et elle eût étésensible à des choses qui auparavant l’eussent laisséeindifférente. Mais comme on voudrait s’abstenird’infidélités, si secrètes fussent-elles, tant on craint quecelle qu’on aime ne s’en abstienne pas, j’étais effrayéde penser que, si les morts vivent quelque part, magrand’mère connaissait aussi bien mon oubliqu’<strong>Albertine</strong> mon souvenir. Et tout compte fait, mêmepour une même morte, est-on sûr que la joie qu’onaurait d’apprendre qu’elle sait certaines choses
alancerait l’effroi de penser qu’elle les sait toutesi? et,si sanglant que soit le sacrifice, ne renoncerions-nouspas quelquefois à garder après leur mort comme amisceux que nous avons aimés de peur de les avoir aussipour jugesi?Mes curiosités jalouses de ce qu’avait pu faire<strong>Albertine</strong> étaient infinies. J’achetai combien de femmesqui ne m’apprirent rien. Si ces curiosités étaient sivivaces, c’est que l’être ne meurt pas tout de suite pournous, il reste baigné d’une espèce d’aura de vie qui n’arien d’une immortalité véritable mais qui fait qu’ilcontinue à occuper nos pensées de la même manièreque quand il vivait. Il est comme en voyage. C’est unesurvie très païenne. Inversement, quand on a cesséd’aimer, les curiosités que l’être excite meurent avantque lui-même soit mort. Ainsi je n’eusse plus fait unpas pour savoir avec qui Gilberte se promenait uncertain soir dans les Champs-Élysées. Or je sentais bienque ces curiosités étaient absolument pareilles, sansvaleur en elles-mêmes, sans possibilité de durer, mais jecontinuais à tout sacrifier à la cruelle satisfaction de cescuriosités passagères, bien que je susse d’avance quema séparation forcée d’avec <strong>Albertine</strong>, du fait de samort, me conduirait à la même indifférence qu’avait faitma séparation volontaire d’avec Gilberte.Si elle avait pu savoir ce qui allait arriver, elle seraitrestée auprès de moi. Mais cela revenait à dire qu’une
fois qu’elle se fût vue morte elle eût mieux aimé, auprèsde moi, rester en vie. Par la contradiction même qu’elleimpliquait, une telle supposition était absurde. Maiscela n’était pas inoffensif, car en imaginant combien<strong>Albertine</strong>, si elle pouvait savoir, si elle pouvaitrétrospectivement comprendre, serait heureuse derevenir auprès de moi, je l’y voyais, je voulaisl’embrasseri; et hélas c’était impossible, elle nereviendrait jamais, elle était morte. Mon imagination lacherchait dans le ciel, par les soirs où nous l’avionsregardé encore ensemble, au delà de ce clair de lunequ’elle aimait, je tâchais de hisser jusqu’à elle matendresse pour qu’elle lui fût une consolation de ne plusvivre, et cet amour pour un être devenu si lointain étaitcomme une religion, mes pensées montaient vers ellecomme des prières. Le désir est bien fort, il engendre lacroyance, j’avais cru qu’<strong>Albertine</strong> ne partirait pas parceque je le désirais. Parce que je le désirais je crus qu’ellen’était pas mortei; je me mis à lire des livres sur lestables tournantes, je commençai à croire possiblel’immortalité de l’âme. Mais elle ne me suffisait pas. Ilfallait qu’après ma mort je la retrouvasse avec soncorps, comme si l’éternité ressemblait à la vie. Que disjeà la vie,! J’étais plus exigeant encore. J’aurais voulune pas être à tout jamais privé par la mort des plaisirsque pourtant elle n’est pas seule à nous ôter. Car sanselle ils auraient fini par s’émousser, ils avaient déjà
commencé de l’être par l’action de l’habitude ancienne,des nouvelles curiosités. Puis, dans la vie, <strong>Albertine</strong>,même physiquement, eût peu à peu changé, jour parjour je me serais adapté à ce changement. Mais monsouvenir, n’évoquant d’elle que des moments,demandait de la revoir telle qu’elle n’aurait déjà plusété si elle avait vécui; ce qu’il voulait c’était un miraclequi satisfît aux limites naturelles et arbitraires de lamémoire, qui ne peut sortir du passé. Avec la naïvetédes théologiens antiques, je l’imaginais m’accordant lesexplications, non pas même qu’elle eût pu me donnermais, par une contradiction dernière, celles qu’ellem’avait toujours refusées pendant sa vie. Et ainsi, samort étant une espèce de rêve, mon amour luisemblerait un bonheur inespéréi; je ne retenais de lamort que la commodité et l’optimisme d’undénouement qui simplifie, qui arrange tout. Quelquefoisce n’était pas si loin, ce n’était pas dans un autre mondeque j’imaginais notre réunion. De même qu’autrefois,quand je ne connaissais Gilberte que pour jouer avecelle aux Champs-Élysées, le soir à la maison je mefigurais que j’allais recevoir une lettre d’elle où ellem’avouerait son amour, qu’elle allait entrer, une mêmeforce de désir, ne s’embarrassant pas plus des loisphysiques qui le contrariaient que, la première fois, ausujet de Gilberte – où, en somme, il n’avait pas eu tortpuisqu’il avait eu le dernier mot – me faisait penser
maintenant que j’allais recevoir un mot d’<strong>Albertine</strong>,m’apprenant qu’elle avait bien eu un accident decheval, mais que pour des raisons romanesques (etcomme, en somme, il est quelquefois arrivé pour despersonnages qu’on a crus longtemps morts) elle n’avaitpas voulu que j’apprisse qu’elle avait guéri et,maintenant repentante, demandait à venir vivre pourtoujours avec moi. Et, me faisant très bien comprendrece que peuvent être certaines folies douces de personnesqui par ailleurs semblent raisonnables, je sentaiscoexister en moi la certitude qu’elle était morte etl’espoir incessant de la voir entrer.Je n’avais pas encore reçu de nouvelles d’Aimé quipourtant devait être arrivé à Balbec. Sans doute monenquête portait sur un point secondaire et bienarbitrairement choisi. Si la vie d’<strong>Albertine</strong> avait étévraiment coupable, elle avait dû contenir bien deschoses autrement importantes, auxquelles le hasard nem’avait pas permis de toucher, comme il l’avait faitpour cette conversation sur le peignoir grâce à larougeur d’<strong>Albertine</strong>. C’était tout à fait arbitrairementque j’avais fait un sort à cette journée-là, que plusieursannées après je tâchais de reconstituer. Si <strong>Albertine</strong>avait aimé les femmes, il y avait des milliers d’autresjournées de sa vie dont je ne connaissais pas l’emploi etqui pouvaient être aussi intéressantes pour moi àconnaîtrei; j’aurais pu envoyer Aimé dans bien d’autres
endroits de Balbec, dans bien d’autres villes queBalbec. Mais précisément ces journées-là, parce que jen’en savais pas l’emploi, elles ne se représentaient pas àmon imagination. Elles n’avaient pas d’existence. Leschoses, les êtres ne commençaient à exister pour moique quand ils prenaient dans mon imagination uneexistence individuelle. S’il y en avait des milliersd’autres pareils, ils devenaient pour moi représentatifsdu reste. Si j’avais le désir depuis longtemps de savoir,en fait de soupçons à l’égard d’<strong>Albertine</strong>, ce qu’il enétait pour la douche, c’est de la même manière que, enfait de désirs de femmes, et quoique je susse qu’il yavait un grand nombre de jeunes filles et de femmes dechambre qui pouvaient les valoir et dont le hasard auraittout aussi bien pu me faire entendre parler, je voulaisconnaître – puisque c’était celles-là dont Saint-Loupm’avait parlé, celles-là qui existaient individuellementpour moi – la jeune fille qui allait dans les maisons depasse et la femme de chambre de M me Putbus. Lesdifficultés que ma santé, mon indécision, ma« procrastination », comme disait Saint-Loup, mettaientà réaliser n’importe quoi, m’avaient fait remettre dejour en jour, de mois en mois, d’année en année,l’éclaircissement de certains soupçons commel’accomplissement de certains désirs. Mais je lesgardais dans ma mémoire en me promettant de ne pasoublier d’en connaître la réalité, parce que seuls ils
m’obsédaient (puisque les autres n’avaient pas de formeà mes yeux, n’existaient pas), et aussi parce que lehasard même qui les avait choisis au milieu de la réalitém’était un garant que c’était bien en eux, avec un peude réalité, de la vie véritable et convoitée, quej’entrerais en contact.Et puis, un seul petit fait, s’il est certain, ne peut-on,comme le savant qui expérimente, dégager la véritépour tous les ordres de faits semblablesi? Un seul petitfait, s’il est bien choisi, ne suffit-il pas àl’expérimentateur pour décider d’une loi générale quifera connaître la vérité sur des milliers de faitsanaloguesi?<strong>Albertine</strong> avait beau n’exister dans ma mémoirequ’à l’état où elle m’était successivement apparue aucours de la vie, c’est-à-dire subdivisée suivant une sériede fractions de temps, ma pensée, rétablissant en ellel’unité, en refaisait un être, et c’est sur cet être que jevoulais porter un jugement général, savoir si ellem’avait menti, si elle aimait les femmes, si c’est pouren fréquenter librement qu’elle m’avait quitté. Ce quedirait la doucheuse pourrait peut-être trancher à jamaismes doutes sur les mœurs d’<strong>Albertine</strong>.Mes doutes,! Hélas, j’avais cru qu’il me seraitindifférent, même agréable de ne plus voir <strong>Albertine</strong>,jusqu’à ce que son départ m’eût révélé mon erreur. De
même sa mort m’avait appris combien je me trompaisen croyant souhaiter quelquefois sa mort et supposerqu’elle serait ma délivrance. Ce fut de même que,quand je reçus la lettre d’Aimé, je compris que, si jen’avais pas jusque-là souffert trop cruellement de mesdoutes sur la vertu d’<strong>Albertine</strong>, c’est qu’en réalité cen’était nullement des doutes. Mon bonheur, ma vieavaient besoin qu’<strong>Albertine</strong> fût vertueuse, ils avaientposé une fois pour toutes qu’elle l’était. Muni de cettecroyance préservatrice, je pouvais sans danger laissermon esprit jouer tristement avec des suppositionsauxquelles il donnait une forme mais n’ajoutait pas foi.Je me disais.: « Elle aime peut-être les femmes »,comme on se dit.: « Je peux mourir ce soir »i; on se ledit, mais on ne le croit pas, on fait des projets pour lelendemain. C’est ce qui explique que, me croyant, àtort, incertain si <strong>Albertine</strong> aimait ou non les femmes, etpar conséquent qu’un fait coupable à l’actif d’<strong>Albertine</strong>ne m’apporterait rien que je n’eusse souvent envisagé,j’aie pu éprouver devant les images, insignifiantes pourd’autres, que m’évoquait la lettre d’Aimé, unesouffrance inattendue, la plus cruelle que j’eusseressentie encore, et qui forma avec ces images, avecl’image hélas, d’<strong>Albertine</strong> elle-même, une sorte deprécipité comme on dit en chimie, où tout étaitindivisible et dont le texte de la lettre d’Aimé, que jesépare d’une façon toute conventionnelle, ne peut
donner aucunement l’idée, puisque chacun des mots quila composent était aussitôt transformé, coloré à jamaispar la souffrance qu’il venait d’exciter.« MONSIEUR,» Monsieur voudra bien me pardonner si je n’ai pasplus tôt écrit à Monsieur. La personne que Monsieurm’avait chargé de voir s’était absentée pour deux jourset, désireux de répondre à la confiance que Monsieuravait mise en moi, je ne voulais pas revenir les mainsvides. Je viens de causer enfin avec cette personne quise rappelle très bien (M lle A.). » Aimé, qui avait uncertain commencement de culture, voulait mettre.:« M lle A. » en italique ou entre guillemets. Mais quandil voulait mettre des guillemets il traçait une parenthèse,et quand il voulait mettre quelque chose entreparenthèses il le mettait entre guillemets. C’est ainsique Françoise disait que quelqu’un restait dans ma ruepour dire qu’il y demeurait, et qu’on pouvait demeurerdeux minutes pour rester, les fautes des gens du peupleconsistant seulement très souvent à interchanger –comme a fait d’ailleurs la langue française – des termesqui au cours des siècles ont pris réciproquement laplace l’un de l’autre. « D’après elle la chose quesupposait Monsieur est absolument certaine. D’abordc’était elle qui soignait (M lle A.) chaque fois que celle-
ci venait aux bains. (M lle A.) venait très souvent prendresa douche avec une grande femme plus âgée qu’elle,toujours habillée en gris, et que la doucheuse sanssavoir son nom connaissait pour l’avoir vue souventrechercher des jeunes filles. Mais elle ne faisait plusattention aux autres depuis qu’elle connaissait (M lle A.).Elle et (M lle A.) s’enfermaient toujours dans la cabine,restaient très longtemps, et la dame en gris donnait aumoins dix francs de pourboire à la personne avec quij’ai causé. Comme m’a dit cette personne, vous pensezbien que si elles n’avaient fait qu’enfiler des perles,elles ne m’auraient pas donné dix francs de pourboire.(M lle A.) venait aussi quelquefois avec une femme trèsnoire de peau, qui avait un face-à-main. Mais (M lle A.)venait le plus souvent avec des jeunes filles plus jeunesqu’elle, surtout une très rousse. Sauf la dame en gris,les personnes que (M lle A.) avait l’habitude d’amenern’étaient pas de Balbec et devaient même souvent venird’assez loin. Elles n’entraient jamais ensemble, mais(M lle A.) entrait, en disant de laisser la porte de lacabine ouverte – qu’elle attendait une amie, et lapersonne avec qui j’ai parlé savait ce que cela voulaitdire. Cette personne n’a pu me donner d’autres détailsne se rappelant pas très bien, « ce qui est facile àcomprendre après si longtemps ». Du reste, cettepersonne ne cherchait pas à savoir, parce qu’elle est trèsdiscrète et que c’était son intérêt car (M lle A.) lui faisait
gagner gros. Elle a été très sincèrement touchéed’apprendre qu’elle était morte. Il est vrai que si jeunec’est un grand malheur pour elle et pour les siens.J’attends les ordres de Monsieur pour savoir si je peuxquitter Balbec où je ne crois pas que j’apprendrai riendavantage. Je remercie encore Monsieur du petitvoyage que Monsieur m’a ainsi procuré et qui m’a ététrès agréable d’autant plus que le temps est on ne peutplus favorable. La saison s’annonce bien pour cetteannée. On espère que Monsieur viendra faire cet été unepetite apparition.» Je ne vois plus rien d’intéressant à dire àMonsieur », etc...Pour comprendre à quelle profondeur ces motsentraient en moi, il faut se rappeler que les questionsque je me posais à l’égard d’<strong>Albertine</strong> n’étaient pas desquestions accessoires, indifférentes, des questions dedétails, les seules en réalité que nous nous posions àl’égard de tous les êtres qui ne sont pas nous, ce quinous permet de cheminer, revêtus d’une penséeimperméable, au milieu de la souffrance, du mensonge,du vice et de la mort. Non, pour <strong>Albertine</strong>, c’était desquestions d’essence.: En son fond qu’était-ellei? À quoipensait-ellei? Qu’aimait-ellei? Me mentait-ellei? Mavie avec elle a-t-elle été aussi lamentable que celle de
Swann avec Odettei? Aussi ce qu’atteignait la réponsed’Aimé, bien qu’elle ne fût pas une réponse générale,mais particulière – et justement à cause de cela – c’étaitbien <strong>Albertine</strong>, en moi, les profondeurs.Enfin je voyais devant moi, dans cette arrivéed’<strong>Albertine</strong> à la douche par la petite rue avec la dameen gris, un fragment de ce passé qui ne me semblait pasmoins mystérieux, moins effroyable que je ne leredoutais quand je l’imaginais enfermé dans lesouvenir, dans le regard d’<strong>Albertine</strong>. Sans doute, toutautre que moi eût pu trouver insignifiants ces détailsauxquels l’impossibilité où j’étais, maintenantqu’<strong>Albertine</strong> était morte, de les faire réfuter par elleconférait l’équivalent d’une sorte de probabilité. Il estmême probable que pour <strong>Albertine</strong>, même s’ils avaientété vrais, ses propres fautes, si elle les avait avouées,que sa conscience les eût trouvées innocentes oublâmables, que sa sensualité les eût trouvées délicieusesou assez fades, eussent été dépourvues de cetteinexprimable impression d’horreur dont je ne lesséparais pas. Moi-même, à l’aide de mon amour desfemmes et quoiqu’elles ne dussent pas avoir été pour<strong>Albertine</strong> la même chose, je pouvais un peu imaginer cequ’elle éprouvait. Et certes c’était déjà uncommencement de souffrance que de me la représenterdésirant comme j’avais si souvent désiré, me mentantcomme je lui avais si souvent menti, préoccupée par
telle ou telle jeune fille, faisant des frais pour elle,comme moi pour M lle de Stermaria, pour tant d’autresou pour les paysannes que je rencontrais dans lacampagne. Oui, tous mes désirs m’aidaient àcomprendre dans une certaine mesure les siensi; c’étaitdéjà une grande souffrance où tous les désirs, plus ilsavaient été vifs, étaient changés en tourments d’autantplus cruelsi; comme si dans cette algèbre de lasensibilité ils reparaissaient avec le même coefficientmais avec le signe moins au lieu du signe plus. Pour<strong>Albertine</strong>, autant que je pouvais en juger par moimême,ses fautes, quelque volonté qu’elle eût de me lescacher – ce qui me faisait supposer qu’elle se jugeaitcoupable ou avait peur de me chagriner – ses fautes,parce qu’elle les avait préparées à sa guise dans la clairelumière de l’imagination où se joue le désir, luiparaissaient tout de même des choses de même natureque le reste de la vie, des plaisirs pour elle qu’ellen’avait pas eu le courage de se refuser, des peines pourmoi qu’elle avait cherché à éviter de me faire en me lescachant, mais des plaisirs et des peines qui pouvaientfigurer au milieu des autres plaisirs et peines de la vie.Mais moi, c’est du dehors, sans que je fusse prévenu,sans que je pusse moi-même les élaborer, c’est de lalettre d’Aimé que m’étaient venues les imagesd’<strong>Albertine</strong> arrivant à la douche et préparant sonpourboire.
Sans doute c’est parce que dans cette arrivéesilencieuse et délibérée d’<strong>Albertine</strong> avec la femme engris je lisais le rendez-vous qu’elles avaient pris, cetteconvention de venir faire l’amour dans un cabinet dedouches, qui impliquait une expérience de lacorruption, l’organisation bien dissimulée de toute unedouble existence, c’est parce que ces imagesm’apportaient la terrible nouvelle de la culpabilitéd’<strong>Albertine</strong> qu’elles m’avaient immédiatement causéune douleur physique dont elles ne se sépareraient plus.Mais aussitôt la douleur avait réagi sur elles.: un faitobjectif, tel qu’une image, est différent selon l’étatintérieur avec lequel on l’aborde. Et la douleur est unaussi puissant modificateur de la réalité qu’est l’ivresse.Combinée avec ces images, la souffrance en avait faitaussitôt quelque chose d’absolument différent de ce quepeuvent être pour toute autre personne une dame engris, un pourboire, une douche, la rue où avait lieul’arrivée délibérée d’<strong>Albertine</strong> avec la dame en gris.Toutes ces images – échappée sur une vie demensonges et de fautes telle que je ne l’avais jamaisconçue – ma souffrance les avait immédiatementaltérées en leur matière même, je ne les voyais pas dansla lumière qui éclaire les spectacles de la terre, c’était lefragment d’un autre monde, d’une planète inconnue etmaudite, une vue de l’Enfer. L’Enfer c’était tout ceBalbec, tous ces pays avoisinants d’où, d’après la lettre
d’Aimé, elle faisait venir souvent les filles plus jeunesqu’elle amenait à la douche. Ce mystère que j’avaisjadis imaginé dans le pays de Balbec et qui s’y étaitdissipé quand j’y avais vécu, que j’avais ensuite espéréressaisir en connaissant <strong>Albertine</strong> parce que, quand je lavoyais passer sur la plage, quand j’étais assez fou pourdésirer qu’elle ne fût pas vertueuse, je pensais qu’elledevait l’incarner, comme maintenant tout ce quitouchait à Balbec s’en imprégnait affreusement,! Lesnoms de ces stations, Toutainville, Evreville, Incarville,devenus si familiers, si tranquillisants, quand je lesentendais le soir en revenant de chez les Verdurin,maintenant que je pensais qu’<strong>Albertine</strong> avait habitél’une, s’était promenée jusqu’à l’autre, avait pu souventaller à bicyclette à la troisième, excitaient en moi uneanxiété plus cruelle que la première fois, où je lesvoyais avec tant de trouble avant d’arriver à Balbec queje ne connaissais pas encore. C’est un des pouvoirs dela jalousie de nous découvrir combien la réalité des faitsextérieurs et les sentiments de l’âme sont quelque chosed’inconnu qui prête à mille suppositions. Nous croyonssavoir exactement ce que sont les choses et ce quepensent les gens, pour la simple raison que nous nenous en soucions pas. Mais dés que nous avons le désirde savoir, comme a le jaloux, alors c’est un vertigineuxkaléidoscope où nous ne distinguons plus rien.<strong>Albertine</strong> m’avait-elle trompéi? avec quii? dans quelle
maisoni? quel jouri? celui où elle m’avait dit tellechosei? où je me rappelais que j’avais dans la journéedit ceci ou celai? je n’en savais rien. Je ne savais pasdavantage quels étaient ses sentiments pour moi, s’ilsétaient inspirés par l’intérêt, par la tendresse. Et toutd’un coup je me rappelais tel incident insignifiant, parexemple qu’<strong>Albertine</strong> avait voulu aller à Saint-Martinle-Vêtu,disant que ce nom l’intéressait, et peut-êtresimplement parce qu’elle avait fait la connaissance dequelque paysanne qui était là-bas. Mais ce n’était rienqu’Aimé m’eût appris tout cela par la doucheuse,puisque <strong>Albertine</strong> devait éternellement ignorer qu’il mel’avait appris, le besoin de savoir ayant toujours étésurpassé, dans mon amour pour <strong>Albertine</strong>, par le besoinde lui montrer que je savaisi; car cela faisait tomberentre nous la séparation d’illusions différentes, tout enn’ayant jamais eu pour résultat de me faire aimer d’elledavantage, au contraire. Or voici que, depuis qu’elleétait morte, le second de ces besoins était amalgamé àl’effet du premier.: je tâchais de me représenterl’entretien où je lui aurais fait part de ce que j’avaisappris, aussi vivement que l’entretien où je lui auraisdemandé ce que je ne savais pasi; c’est-à-dire la voirprès de moi, l’entendre me répondant avec bonté, voirses joues redevenir grosses, ses yeux perdre leur maliceet prendre de la tristesse, c’est-à-dire l’aimer encore etoublier la fureur de ma jalousie dans le désespoir de
mon isolement. Le douloureux mystère de cetteimpossibilité de jamais lui faire savoir ce que j’avaisappris et d’établir nos rapports sur la vérité de ce que jevenais seulement de découvrir (et que je n’avais peutêtrepu découvrir que parce qu’elle était morte)substituait sa tristesse au mystère plus douloureux de saconduite. Quoii? Avoir tant désiré qu’<strong>Albertine</strong> sût quej’avais appris l’histoire de la salle de douches, <strong>Albertine</strong>qui n’était plus rien,! C’était là encore une desconséquences de cette impossibilité où nous sommes,quand nous avons à raisonner sur la mort, de nousreprésenter autre chose que la vie. <strong>Albertine</strong> n’était plusrien. Mais pour moi c’était la personne qui m’avaitcaché qu’elle eût des rendez-vous avec des femmes àBalbec, qui s’imaginait avoir réussi à me le faireignorer. Quand nous raisonnons sur ce qui se passeaprès notre propre mort, n’est-ce pas encore nous vivantque par erreur nous projetons à ce moment-lài? Et est-ilbeaucoup plus ridicule, en somme, de regretter qu’unefemme qui n’est plus rien ignore que nous ayons apprisce qu’elle faisait il y a six ans que de désirer que denous-même, qui serons mort, le public parle encoreavec faveur dans un sièclei? S’il y a plus de fondementréel dans le second cas que dans le premier, les regretsde ma jalousie rétrospective n’en procédaient pas moinsde la même erreur d’optique que chez les autreshommes le désir de la gloire posthume. Pourtant cette
impression de ce qu’il y avait de solennellementdéfinitif dans ma séparation d’avec <strong>Albertine</strong>, si elles’était substituée un moment à l’idée de ses fautes, nefaisait qu’aggraver celles-ci en leur conférant uncaractère irrémédiable.Je me voyais perdu dans la vie comme sur une plageillimitée où j’étais seul et où, dans quelque sens quej’allasse, je ne la rencontrerais jamais. Heureusement jetrouvai fort à propos dans ma mémoire – comme il y atoujours toutes espèces de choses, les unes dangereuses,les autres salutaires dans ce fouillis où les souvenirs nes’éclairent qu’un à un – je découvris, comme un ouvrierl’objet qui pourra servir à ce qu’il veut faire, une parolede ma grand’mère. Elle m’avait dit à propos d’unehistoire invraisemblable que la doucheuse avaitracontée à M me de Villeparisis.: « C’est une femme quidoit avoir la maladie du mensonge. » Ce souvenir mefut d’un grand secours. Quelle portée pouvait avoir cequ’avait dit la doucheuse à Aiméi? D’autant plus qu’ensomme elle n’avait rien vu. On peut venir prendre desdouches avec des amies sans penser à mal pour cela.Peut-être pour se vanter la doucheuse exagérait-elle lepourboire. J’avais bien entendu Françoise soutenir unefois que ma tante Léonie avait dit devant elle qu’elleavait « un million à manger par mois », ce qui était dela foliei; une autre fois qu’elle avait vu ma tante Léoniedonner à Eulalie quatre billets de mille francs, alors
qu’un billet de cinquante francs plié en quatre meparaissait déjà peu vraisemblable. Et ainsi je cherchais– et je réussis peu à peu – à me défaire de ladouloureuse certitude que je m’étais donné tant de malà acquérir, ballotté que j’étais toujours entre le désir desavoir et la peur de souffrir. Alors ma tendresse putrenaître, mais, aussitôt avec cette tendresse, unetristesse d’être séparé d’<strong>Albertine</strong>, durant laquellej’étais peut-être encore plus malheureux qu’aux heuresrécentes où c’était par la jalousie que j’étais torturé.Mais cette dernière renaquit soudain en pensant àBalbec, à cause de l’image soudain revue (et quijusque-là ne m’avait jamais fait souffrir et me paraissaitmême une des plus inoffensives de ma mémoire) de lasalle à manger de Balbec le soir, avec, de l’autre côtédu vitrage, toute cette population entassée dans l’ombrecomme devant le vitrage lumineux d’un aquarium, enfaisant se frôler (je n’y avais jamais pensé) dans saconglomération les pêcheurs et les filles du peuplecontre les petites bourgeoises jalouses de ce luxe,nouveau à Balbec, ce luxe que sinon la fortune, dumoins l’avarice et la tradition interdisaient à leursparents, petites bourgeoises parmi lesquelles il y avaitsûrement presque chaque soir <strong>Albertine</strong>, que je neconnaissais pas encore et qui sans doute levait làquelque fillette qu’elle rejoignait quelques minutes plustard dans la nuit, sur le sable, ou bien dans une cabine
abandonnée, au pied de la falaise. Puis c’était matristesse qui renaissait, je venais d’entendre, comme unecondamnation à l’exil, le bruit de l’ascenseur qui, aulieu de s’arrêter à mon étage, montait au-dessus.Pourtant la seule personne dont j’eusse pu souhaiter lavisite ne viendrait plus jamais, elle était morte. Etmalgré cela, quand l’ascenseur s’arrêtait à mon étagemon cœur battait, un instant je me disais.: « Si tout demême cela n’était qu’un rêve,! C’est peut-être elle, elleva sonner, elle revient, Françoise va entrer me dire avecplus d’effroi que de colère – car elle est plussuperstitieuse encore que vindicative et craindrait moinsla vivante que ce qu’elle croira peut-être un revenant.: –« Monsieur ne devinera jamais qui est là. » J’essayaisde ne penser à rien, de prendre un journal. Mais lalecture m’était insupportable de ces articles écrits pardes gens qui n’éprouvent pas de réelle douleur. D’unechanson insignifiante l’un disait.: « C’est à pleurer »tandis que moi-je l’aurais écoutée avec tant d’allégressesi <strong>Albertine</strong> avait vécu. Un autre, grand écrivaincependant, parce qu’il avait été acclamé à sa descented’un train, disait qu’il avait reçu là des témoignagesinoubliables, alors que moi, si maintenant je les avaisreçus, je n’y aurais même pas pensé un instant. Et untroisième assurait que sans la fâcheuse politique la viede Paris serait « tout à fait délicieuse », alors que jesavais bien que, même sans politique, cette vie ne
pouvait m’être qu’atroce et m’eût semblé délicieuse,même avec la politique, si j’eusse retrouvé <strong>Albertine</strong>.Le chroniqueur cynégétique disait (on était au mois demai).: « Cette époque est vraiment douloureuse, disonsmieux, sinistre, pour le vrai chasseur, car il n’y a rien,absolument rien à tirer », et le chroniqueur du« Salon ».: « Devant cette manière d’organiser uneexposition on se sent pris d’un immensedécouragement, d’une tristesse infinie... » Si la force dece que je sentais me faisait paraître mensongères etpâles les expressions de ceux qui n’avaient pas de vraisbonheurs ou malheurs, en revanche les lignes les plusinsignifiantes qui, de si loin que ce fût, pouvaient serattacher ou à la Normandie, ou à la Touraine, ou auxétablissements hydrothérapiques, ou à la Berma, ou à laprincesse de Guermantes, ou à l’amour, ou à l’absence,ou à l’infidélité, remettaient brusquement devant moi,sans que j’eusse eu le temps de me détourner, l’imaged’<strong>Albertine</strong>, et je me remettais à pleurer. D’ailleurs,d’habitude, ces journaux je ne pouvais même pas leslire, car le simple geste d’en ouvrir un me rappelait à lafois que j’en accomplissais de semblables quand<strong>Albertine</strong> vivait, et qu’elle ne vivait plusi; je les laissaisretomber sans avoir la force de les déplier jusqu’aubout. Chaque impression évoquait une impressionidentique mais blessée parce qu’en avait été retranchéel’existence d’<strong>Albertine</strong>, de sorte que je n’avais jamais le
courage de vivre jusqu’au bout ces minutes mutilées.Même, quand peu à peu <strong>Albertine</strong> cessa d’être présenteà ma pensée et toute-puissante sur mon cœur, jesouffrais tout d’un coup s’il me fallait, comme au tempsoù elle était là, entrer dans sa chambre, chercher de lalumière, m’asseoir près du pianola. Divisée en petitsdieux familiers, elle habita longtemps la flamme de labougie, le bouton de la porte, le dossier d’une chaise, etd’autres domaines plus immatériels, comme une nuitd’insomnie ou l’émoi que me donnait la première visited’une femme qui m’avait plu. Malgré cela, le peu dephrases que mes yeux lisaient dans une journée ou quema pensée se rappelait avoir lues excitaient souvent enmoi une jalousie cruelle. Pour cela elles avaient moinsbesoin de me fournir un argument valable del’immoralité des femmes que de me rendre uneimpression ancienne liée à l’existence d’<strong>Albertine</strong>.Transporté alors dans un moment oublié dont l’habituded’y penser n’avait pas pour moi émoussé la force, et où<strong>Albertine</strong> vivait encore, ses fautes prenaient quelquechose de plus voisin, de plus angoissant, de plus atroce.Alors je me redemandais s’il était certain que lesrévélations de la doucheuse fussent fausses. Une bonnemanière de savoir la vérité serait d’envoyer Aimé enTouraine, passer quelques jours dans le voisinage de lavilla de M me Bontemps. Si <strong>Albertine</strong> aimait les plaisirsqu’une femme prend avec les femmes, si c’est pour
n’être pas plus longtemps privée d’eux qu’elle m’avaitquitté, elle avait dû, aussitôt libre, essayer de s’y livreret y réussir, dans un pays qu’elle connaissait et où ellen’aurait pas choisi de se retirer si elle n’avait pas penséy trouver plus de facilités que chez moi. Sans doute, iln’y avait rien d’extraordinaire à ce que la mortd’<strong>Albertine</strong> eût si peu changé mes préoccupations.Quand notre maîtresse est vivante, une grande partiedes pensées qui forment ce que nous appelons notreamour nous viennent pendant les heures où elle n’estpas à côté de nous. Ainsi l’on prend l’habitude d’avoirpour objet de sa rêverie un être absent, et qui, même s’ilne le reste que quelques heures, pendant ces heures-làn’est qu’un souvenir. Aussi la mort ne change-t-elle pasgrand-chose. Quand Aimé revint, je lui demandai departir pour Châtellerault, et ainsi non seulement par mespensées, mes tristesses, l’émoi que me donnait un nomrelié, de si loin que ce fût, à un certain être, mais encorepar toutes mes actions, par les enquêtes auxquelles jeprocédais, par l’emploi que je faisais de mon argent,tout entier destiné à connaître les actions d’<strong>Albertine</strong>, jepeux dire que toute cette année-là ma vie resta rempliepar un amour, par une véritable liaison. Et celle qui enétait l’objet était une morte. On dit quelquefois qu’ilpeut subsister quelque chose d’un être après sa mort sicet être était un artiste et mettait un peu de soi dans sonœuvre. C’est peut-être de la même manière qu’une sorte
de bouture prélevée sur un être, et greffée au cœur d’unautre, continue à y poursuivre sa vie, même quand l’êtred’où elle avait été détachée a péri. Aimé alla loger àcôté de la villa de M me Bontempsi; il fit la connaissanced’une femme de chambre, d’un loueur de voitures chezqui <strong>Albertine</strong> allait souvent en prendre une pour lajournée. Les gens n’avaient rien remarqué. Dans uneseconde lettre, Aimé me disait avoir appris d’une petiteblanchisseuse de la ville qu’<strong>Albertine</strong> avait une manièreparticulière de lui serrer le bras quand celle-ci luirapportait le linge. « Mais, disait-elle, cette demoisellene lui avait jamais fait autre chose. » J’envoyai à Aimél’argent qui payait son voyage, qui payait le mal qu’ilvenait de me faire par sa lettre, et cependant jem’efforçais de le guérir en me disant que c’était là unefamiliarité qui ne prouvait aucun désir vicieux quand jereçus un télégramme d’Aimé.: « Ai appris les choses lesplus intéressantes. Ai plein de nouvelles pour prouver.Lettre suit. » Le lendemain vint une lettre dontl’enveloppe suffit à me faire frémiri; j’avais reconnuqu’elle était d’Aimé, car chaque personne même la plushumble, a sous sa dépendance ces petits êtres familiers,à la fois vivants et couchés dans une espèced’engourdissement sur le papier, les caractères de sonécriture que lui seul possède. « D’abord la petiteblanchisseuse n’a rien voulu me dire, elle assurait queM lle <strong>Albertine</strong> n’avait jamais fait que lui pincer le bras.
Mais pour la faire parler je l’ai emmenée dîner, je l’aifait boire. Alors elle m’a raconté que M lle <strong>Albertine</strong> larencontrait souvent au bord de la Loire, quand elle allaitse baigneri; que M lle <strong>Albertine</strong>, qui avait l’habitude dese lever de grand matin pour aller se baigner, avaitl’habitude de la retrouver au bord de l’eau, à un endroitoù les arbres sont si épais que personne ne peut vousvoir, et d’ailleurs il n’y a personne qui peut vous voir àcette heure-là. Puis la blanchisseuse amenait ses petitesamies et elles se baignaient et après, comme il faisaittrès chaud déjà là-bas et que ça tapait dur même sousles arbres, elles restaient dans l’herbe à se sécher, àjouer, à se caresser. La petite blanchisseuse m’a avouéqu’elle aimait beaucoup à s’amuser avec ses petitesamies, et que voyant M lle <strong>Albertine</strong> qui se frottaittoujours contre elle dans son peignoir, elle le lui avaitfait enlever et lui faisait des caresses avec sa langue lelong du cou et des bras, même sur la plante des piedsque M lle <strong>Albertine</strong> lui tendait. La blanchisseuse sedéshabillait aussi, et elles jouaient à se pousser dansl’eaui; là elle ne n’a rien dit de plus, mais, tout dévoué àvos ordres et voulant faire n’importe quoi pour vousfaire plaisir, j’ai emmené coucher avec moi la petiteblanchisseuse. Elle m’a demandé si je voulais qu’elleme fit ce qu’elle faisait à M lle <strong>Albertine</strong> quand celle-ciôtait son costume de bain. Et elle m’a dit.: « Si vousaviez vu comme elle frétillait, cette demoiselle, elle me
disait.: (ah,! tu me mets aux anges) et elle était siénervée qu’elle ne pouvait s’empêcher de me mordre. »J’ai vu encore la trace sur le bras de la petiteblanchisseuse. Et je comprends le plaisir de M lle<strong>Albertine</strong> car cette petite-là est vraiment très habile. »J’avais bien souffert à Balbec quand <strong>Albertine</strong>m’avait dit son amitié pour M lle Vinteuil. Mais<strong>Albertine</strong> était là pour me consoler. Puis quand, pouravoir trop cherché à connaître les actions d’<strong>Albertine</strong>,j’avais réussi à la faire partir de chez moi, quandFrançoise m’avait annoncé qu’elle n’était plus là, et queje m’étais trouvé seul, j’avais souffert davantage. Maisdu moins l’<strong>Albertine</strong> que j’avais aimée restait dans moncœur. Maintenant, à sa place – pour me punir d’avoirpoussé plus loin une curiosité à laquelle, contrairementà ce que j’avais supposé, la mort n’avait pas mis fin –ce que je trouvais c’était une jeune fille différente,multipliant les mensonges et les tromperies là où l’autrem’avait si doucement rassuré en me jurant n’avoirjamais connu ces plaisirs que, dans l’ivresse de saliberté reconquise, elle était partie goûter jusqu’à lapâmoison, jusqu’à mordre cette petite blanchisseusequ’elle retrouvait au soleil levant, sur le bord de laLoire, et à qui elle disait.: « Tu me mets aux anges. »Une <strong>Albertine</strong> différente, non pas seulement dans lesens où nous entendons le mot différent quand il s’agitdes autres. Si les autres sont différents de ce que nous
avons cru, cette différence ne nous atteignant pasprofondément, et le pendule de l’intuition ne pouvantprojeter hors de lui qu’une oscillation égale à celle qu’ila exécutée dans le sens intérieur, ce n’est que dans lesrégions superficielles d’eux-mêmes que nous situonsces différences. Autrefois, quand j’apprenais qu’unefemme aimait les femmes, elle ne me paraissait paspour cela une femme autre, d’une essence particulière.Mais s’il s’agit d’une femme qu’on aime, pour sedébarrasser de la douleur qu’on éprouve à l’idée quecela peut être on cherche à savoir non seulement cequ’elle a fait, mais ce qu’elle ressentait en le faisant,quelle idée elle avait de ce qu’elle faisaiti; alorsdescendant de plus en plus avant, par la profondeur dela douleur, on atteint au mystère, à l’essence. Jesouffrais jusqu’au fond de moi-même, jusque dans moncorps, dans mon cœur – bien plus que ne m’eût faitsouffrir la peur de perdre la vie – de cette curiosité àlaquelle collaboraient toutes les forces de monintelligence et de mon inconscienti; et ainsi c’est dansles profondeurs mêmes d’<strong>Albertine</strong> que je projetaismaintenant tout ce que j’apprenais d’elle. Et la douleurqu’avait ainsi fait pénétrer en moi, à une telleprofondeur, la réalité du vice d’<strong>Albertine</strong> me rendit bienplus tard un dernier office. Comme le mal que j’avaisfait à ma grand’mère, le mal que m’avait fait <strong>Albertine</strong>fut un dernier lien entre elle et moi et qui survécut
même au souvenir, car, avec la conservation d’énergieque possède tout ce qui est physique, la souffrance n’amême pas besoin des leçons de la mémoire. Ainsi unhomme qui a oublié les belles nuits passées au clair delune dans les bois souffre encore des rhumatismes qu’ily a pris. Ces goûts niés par elle et qu’elle avait, cesgoûts dont la découverte était venue à moi, non dans unfroid raisonnement mais dans la brûlante souffranceressentie à la lecture de ces mots.: « Tu me mets auxanges », souffrance qui leur donnait une particularitéqualitative, ces goûts ne s’ajoutaient pas seulement àl’image d’<strong>Albertine</strong> comme s’ajoute au bernardl’ermitela coquille nouvelle qu’il traîne après lui, maisbien plutôt comme un sel qui entre en contact avec unautre sel, en change la couleur, bien plus, la nature.Quand la petite blanchisseuse avait dû dire à ses petitesamies.: « Imaginez-vous, je ne l’aurais pas cru, eh bien,la demoiselle c’en est une aussi », pour moi ce n’étaitpas seulement un vice d’abord insoupçonné d’ellesqu’elles ajoutaient à la personne d’<strong>Albertine</strong>, mais ladécouverte qu’elle était une autre personne, unepersonne comme elles, parlant la même langue, ce qui,en la faisant compatriote d’autres, me la rendait encoreplus étrangère à moi, prouvait que ce que j’avais eud’elle, ce que je portais dans mon cœur, ce n’était qu’untout petit peu d’elle, et que le reste qui prenait tantd’extension de ne pas être seulement cette chose si
mystérieusement importante, un désir individuel, maisde lui être commune avec d’autres, elle me l’avaittoujours caché, elle m’en avait tenu à l’écart, commeune femme qui m’eût caché qu’elle était d’un paysennemi et espionne, et qui même eût agi plustraîtreusement encore qu’une espionne, car celle-ci netrompe que sur sa nationalité, tandis qu’<strong>Albertine</strong>c’était sur son humanité la plus profonde, sur ce qu’ellen’appartenait pas à l’humanité commune, mais à unerace étrange qui s’y mêle, s’y cache et ne s’y fondjamais. J’avais justement vu deux peintures d’Elstir oùdans un paysage touffu il y a des femmes nues. Dansl’une d’elles, l’une des jeunes filles lève le pied comme<strong>Albertine</strong> devait faire quand elle l’offrait à lablanchisseuse. De l’autre pied elle pousse à l’eau l’autrejeune fille qui gaiement résiste, la cuisse levée, son piedtrempant à peine dans l’eau bleue. Je me rappelaismaintenant que la levée de la cuisse y faisait le mêmeméandre de cou de cygne avec l’angle du genou, quefaisait la chute de la cuisse d’<strong>Albertine</strong> quand elle étaità côté de moi sur le lit, et j’avais voulu souvent lui direqu’elle me rappelait ces peintures. Mais je ne l’avaispas fait pour ne pas éveiller en elle l’image de corps nusde femmes. Maintenant je la voyais à côté de lablanchisseuse et de ses amies, recomposer le groupeque j’avais tant aimé quand j’étais assis au milieu desamies d’<strong>Albertine</strong> à Balbec. Et si j’avais été un amateur
sensible à la seule beauté j’aurais reconnu qu’<strong>Albertine</strong>le recomposait mille fois plus beau, maintenant que leséléments en étaient les statues nues de déesses commecelles que les grands sculpteurs éparpillaient àVersailles sous les bosquets ou donnaient dans lesbassins à laver et à polir aux caresses du flot.Maintenant je la voyais à côté de la blanchisseuse,jeunes filles au bord de l’eau, dans leur double nuditéde marbres féminins, au milieu d’une touffe devégétations et trempant dans l’eau comme des basreliefsnautiques. Me souvenant de ce qu’<strong>Albertine</strong> étaitsur mon lit, je croyais voir sa cuisse recourbée, je lavoyais, c’était un col de cygne, il cherchait la bouche del’autre jeune fille. Alors je ne voyais même plus unecuisse, mais le col hardi d’un cygne, comme celui quidans une étude frémissante cherche la bouche d’uneLéda qu’on voit dans toute la palpitation spécifique duplaisir féminin, parce qu’il n’y a qu’un cygne et qu’ellesemble plus seule, de même qu’on découvre autéléphone les inflexions d’une voix qu’on ne distinguepas tant qu’elle n’est pas dissociée d’un visage où l’onobjective son expression. Dans cette étude, le plaisir, aulieu d’aller vers la face qui l’inspire et qui est absente,remplacée par un cygne inerte, se concentre dans cellequi le ressent. Par instant la communication étaitinterrompue entre mon cœur et ma mémoire. Cequ’<strong>Albertine</strong> avait fait avec la blanchisseuse ne m’était
plus signifié que par des abréviations quasi algébriquesqui ne me représentaient plus rieni; mais cent fois parheure le courant interrompu était rétabli, et mon cœurétait brûlé sans pitié par un feu d’enfer, tandis que jevoyais <strong>Albertine</strong> ressuscitée par ma jalousie, vraimentvivante, se raidir sous les caresses de la petiteblanchisseuse à qui elle disait.: « Tu me mets auxanges. » Comme elle était vivante au moment où ellecommettait ses fautes, c’est-à-dire au moment où moimêmeje me trouvais, il ne me suffisait pas de connaîtrecette faute, j’aurais voulu qu’elle sût que je laconnaissais. Aussi, si dans ces moments-là je regrettaisde penser que je ne la reverrais jamais, ce regret portaitla marque de ma jalousie et, tout différent du regretdéchirant des moments où je l’aimais, n’était que leregret de ne pas pouvoir lui dire.: « Tu croyais que je nesaurais jamais ce que tu as fait après m’avoir quitté, ehbien je sais tout, la blanchisseuse au bord de la Loire, tului disais.: « Tu me mets aux anges », j’ai vu lamorsure. » Sans doute je me disais.: « Pourquoi metourmenteri? Celle qui a eu du plaisir avec lablanchisseuse n’est plus rien, donc n’était pas unepersonne dont les actions gardent de la valeur. Elle nese dit pas que je sais. Mais elle ne se dit pas non plusque je ne sais pas puisqu’elle ne se dit rien. » Mais ceraisonnement me persuadait moins que la vue de sonplaisir qui me ramenait au moment où elle l’avait
éprouvé. Ce que nous sentons existe seul pour nous, etnous le projetons dans le passé, dans l’avenir, sans nouslaisser arrêter par les barrières fictives de la mort. Simon regret qu’elle fût morte subissait dans cesmoments-là l’influence de ma jalousie et prenait cetteforme si particulière, cette influence s’étendait à mesrêves d’occultisme, d’immortalité qui n’étaient qu’uneffort pour tâcher de réaliser ce que je désirais. Aussi, àces moments-là, si j’avais pu réussir à l’évoquer enfaisant tourner une table comme autrefois Bergottecroyait que c’était possible, ou à la rencontrer dansl’autre vie comme le pensait l’abbé X., je ne l’auraissouhaité que pour lui répéter.: « Je sais pour lablanchisseuse. Tu lui disais.: tu me mets aux angesi; j’aivu la morsure. » Ce qui vint à mon secours contre cetteimage de la blanchisseuse, ce fut – certes quand elle eutun peu duré – cette image elle-même parce que nous neconnaissons vraiment que ce qui est nouveau, ce quiintroduit brusquement dans notre sensibilité unchangement de ton qui nous frappe, ce à quoi l’habituden’a pas encore substitué ses pâles fac-similés. Mais cefut surtout ce fractionnement d’<strong>Albertine</strong> en denombreux fragments, en de nombreuses <strong>Albertine</strong>s, quiétait son seul mode d’existence en moi. Des momentsrevinrent où elle n’avait été que bonne, ou intelligente,ou sérieuse, ou même aimant plus que tout les sports. Etce fractionnement, n’était-il pas, au fond, juste qu’il me
calmâti? Car s’il n’était pas en lui-même quelque chosede réel, s’il tenait à la forme successive des heures oùelle m’était apparue, forme qui restait celle de mamémoire comme la courbure des projections de malanterne magique tenait à la courbure des verrescolorés, ne représentait-il pas à sa manière une vérité,bien objective celle-là, à savoir que chacun de nousn’est pas un, mais contient de nombreuses personnesqui n’ont pas toutes la même valeur morale, et que, sil’<strong>Albertine</strong> vicieuse avait existé, cela n’empêchait pasqu’il y en eût eu d’autres, celle qui aimait à causer avecmoi de Saint-Simon dans sa chambrei; celle qui, le soiroù je lui avais dit qu’il fallait nous séparer, avait dit sitristement.: « Ce pianola, cette chambre, penser que jene reverrai jamais tout cela » et, quand elle avait vul’émotion que mon mensonge avait fini par mecommuniquer, s’était écriée avec une pitié si sincère.:« Oh,! non, tout plutôt que de vous faire de la peine,c’est entendu, je ne chercherai pas à vous revoir. »Alors je ne fus plus seuli; je sentis disparaître cettecloison qui nous séparait. Du moment que cette<strong>Albertine</strong> bonne était revenue, j’avais retrouvé la seulepersonne à qui je pusse demander l’antidote dessouffrances qu’<strong>Albertine</strong> me causait. Certes je désiraistoujours lui parler de l’histoire de la blanchisseuse,mais ce n’était plus en manière de cruel triomphe etpour lui montrer méchamment ce que je savais. Comme
je l’aurais fait si <strong>Albertine</strong> avait été vivante, je luidemandai tendrement si l’histoire de la blanchisseuseétait vraie. Elle me jura que non, qu’Aimé n’était pastrès véridique et que, voulant paraître avoir bien gagnél’argent que je lui avais donné, il n’avait pas voulurevenir bredouille et avait fait dire ce qu’il avait voulu àla blanchisseuse. Sans doute <strong>Albertine</strong> n’avait cessé deme mentir. Pourtant, dans le flux et le reflux de sescontradictions je sentais qu’il y avait eu une certaineprogression à moi due. Qu’elle ne m’eût même pas fait,au début, des confidences (peut-être, il est vrai,involontaires dans une phrase qui échappe) je n’eneusse pas juré. Je ne me rappelais plus. Et puis elleavait de si bizarres façons d’appeler certaines chosesque cela pouvait signifier cela ou non, mais le sentimentqu’elle avait eu de ma jalousie l’avait ensuite portée àrétracter avec horreur ce qu’elle avait d’abordcomplaisamment avoué. D’ailleurs, <strong>Albertine</strong> n’avaitmême pas besoin de me dire cela. Pour être persuadé deson innocence il me suffisait de l’embrasser, et je lepouvais maintenant qu’était tombée la cloison qui nousséparait, pareille à celle impalpable et résistante quiaprès une brouille s’élève entre deux amoureux etcontre laquelle se briseraient les baisers. Non, ellen’avait besoin de rien me dire. Quoi qu’elle eût fait,quoi qu’elle eût voulu, la pauvre petite, il y avait dessentiments en lesquels, par-dessus ce qui nous divisait,
nous pouvions nous unir. Si l’histoire était vraie, et si<strong>Albertine</strong> m’avait caché ses goûts, c’était pour ne pasme faire de chagrin. J’eus la douceur de l’entendre direà cette <strong>Albertine</strong>-là. D’ailleurs en avais-je jamais connuune autrei? Les deux plus grandes causes d’erreur dansnos rapports avec un autre être sont.: avoir soi-mêmebon cœur, ou bien, cet autre être, l’aimer. On aime surun sourire, sur un regard, sur une épaule. Cela suffiti;alors, dans les longues heures d’espérance ou detristesse on fabrique une personne, on compose uncaractère. Et quand plus tard on fréquente la personneaimée on ne peut pas plus, devant quelque cruelleréalité qu’on soit placé, ôter ce caractère bon, cettenature de femme nous aimant, à l’être qui a tel regard,telle épaule que nous ne pouvons, quand elle vieillit,ôter son premier visage à une personne que nousconnaissons depuis sa jeunesse. J’évoquai le beauregard bon et pitoyable de cette <strong>Albertine</strong>-là, sesgrosses joues, son cou aux larges grains. C’était l’imaged’une morte, mais, comme cette morte vivait, il me futaisé de faire immédiatement ce que j’eusse faitinfailliblement si elle avait été auprès de moi de sonvivant (ce que je ferais si je devais jamais la retrouverdans une autre vie), je lui pardonnai.Les instants que j’avais vécus auprès de cette<strong>Albertine</strong>-là m’étaient si précieux que j’eusse voulun’en avoir laissé échapper aucun. Or parfois, comme on
attrape les bribes d’une fortune dissipée, j’enretrouvais qui avaient semblé perdus.: en nouant unfoulard derrière mon cou au lieu de devant, je merappelai une promenade à laquelle je n’avais jamaisrepensé et où, pour que l’air froid ne pût venir sur magorge, <strong>Albertine</strong> me l’avait arrangé de cette manièreaprès m’avoir embrassé. Cette promenade si simple,restituée à ma mémoire par un geste si humble, me fit leplaisir de ces objets intimes ayant appartenu à unemorte chérie, que nous rapporte la vieille femme dechambre et qui ont tant de prix pour nousi; mon chagrins’en trouvait enrichi, et d’autant plus que, ce foulard, jen’y avais jamais repensé.Maintenant <strong>Albertine</strong>, lâchée de nouveau, avaitrepris son voli; des hommes, des femmes la suivaient.Elle vivait en moi. Je me rendais compte que ce grandamour prolongé pour <strong>Albertine</strong> était comme l’ombre dusentiment que j’avais eu pour elle, en reproduisait lesdiverses parties et obéissait aux mêmes lois que laréalité sentimentale qu’il reflétait au-delà de la mort.Car je sentais bien que si je pouvais entre mes penséespour <strong>Albertine</strong> mettre quelque intervalle, d’autre part, sij’en avais mis trop, je ne l’aurais plus aiméei; elle mefût par cette coupure devenue indifférente, comme mel’était maintenant ma grand’mère. Trop de temps passésans penser à elle eût rompu dans mon souvenir lacontinuité, qui est le principe même de la vie, qui
pourtant peut se ressaisir après un certain intervalle detemps. N’en avait-il pas été ainsi de mon amour pour<strong>Albertine</strong> quand elle vivait, lequel avait pu se renoueraprès un assez long intervalle dans lequel j’étais restésans penser à ellei? Or mon souvenir devait obéir auxmêmes lois, ne pas pouvoir supporter de plus longsintervalles, car il ne faisait, comme une aurore boréale,que refléter après la mort d’<strong>Albertine</strong> le sentiment quej’avais eu pour elle, il était comme l’ombre de monamour.D’autres fois mon chagrin prenait tant de formesque parfois je ne le reconnaissais plusi; je souhaitaisd’avoir un grand amour, je voulais chercher unepersonne qui vivrait auprès de moi, cela me semblait lesigne que je n’aimais plus <strong>Albertine</strong> quand c’était celuique je l’aimais toujoursi; car le besoin d’éprouver ungrand amour n’était, tout autant que le désird’embrasser les grosses joues d’<strong>Albertine</strong>, qu’une partiede mon regret. C’est quand je l’aurais oubliée que jepourrais trouver plus sage, plus heureux de vivre sansamour. Ainsi le regret d’<strong>Albertine</strong>, parce que c’était luiqui faisait naître en moi le besoin d’une sœur, le rendaitinassouvissable. Et au fur et à mesure que mon regretd’<strong>Albertine</strong> s’affaiblirait, le besoin d’une sœur, lequeln’était qu’une forme inconsciente de ce regret,deviendrait moins impérieux. Et pourtant ces deuxreliquats de mon amour ne suivirent pas dans leur
décroissance une marche également rapide. Il y avaitdes heures où j’étais décidé à me marier, tant le premiersubissait une profonde éclipse, le second au contrairegardant une grande force. Et, en revanche, plus tard messouvenirs jaloux s’étant éteints, tout d’un coup parfoisune tendresse me remontait au cœur pour <strong>Albertine</strong>, etalors, pensant à mes amours pour d’autres femmes, jeme disais qu’elle les aurait compris, partagées – et sonvice devenait comme une cause d’amour. Parfois majalousie renaissait dans des moments où je ne mesouvenais plus d’<strong>Albertine</strong>, bien que ce fût d’elle alorsque j’étais jaloux. Je croyais l’être d’Andrée à proposde qui on m’apprit à ce moment-là une aventure qu’elleavait. Mais Andrée n’était pour moi qu’un prête-nom,qu’un chemin de raccord, qu’une prise de courant quine reliait indirectement à <strong>Albertine</strong>. C’est ainsi qu’enrêve on donne un autre visage, un autre nom, à unepersonne sur l’identité profonde de laquelle on ne setrompe pas pourtant. En somme, malgré les flux et lesreflux qui contrariaient dans ces cas particuliers cetteloi générale, les sentiments que m’avait laissés<strong>Albertine</strong> eurent plus de peine à mourir que le souvenirde leur cause première. Non seulement les sentiments,mais les sensations. Différent en cela de Swann qui,lorsqu’il avait commencé à ne plus aimer Odette,n’avait même plus pu recréer en lui la sensation de sonamour, je me sentais encore revivant un passé qui
n’était plus que l’histoire d’un autrei; mon « moi » enquelque sorte mi-partie, tandis que son extrémitésupérieure était déjà dure et refroidie, brûlait encore àsa base chaque fois qu’une étincelle y refaisait passerl’ancien courant, même quand depuis longtemps monesprit avait cessé de concevoir <strong>Albertine</strong>. Et aucuneimage d’elle n’accompagnant les palpitations cruelles,les larmes qu’apportait à mes yeux un vent froidsoufflant, comme à Balbec, sur les pommiers déjàroses, j’en arrivais à me demander si la renaissance dema douleur n’était pas due à des causes toutespathologiques et si ce que je prenais pour lareviviscence d’un souvenir et la dernière période d’unamour n’était pas plutôt le début d’une maladie decœur.Il y a, dans certaines affections, des accidentssecondaires que le malade est trop porté à confondreavec la maladie elle-même. Quand ils cessent, il estétonné de se trouver moins éloigné de la guérison qu’iln’avait cru. Telle avait été la souffrance causée – lacomplication amenée – par les lettres d’Aimérelativement à l’établissement de douches et à la petiteblanchisseuses. Mais un médecin de l’âme qui m’eûtvisité eût trouvé que, pour le reste, mon chagrin luimêmeallait mieux. Sans doute en moi, comme j’étaisun homme, un de ces êtres amphibies qui sontsimultanément plongés dans le passé et dans la réalité
actuelle, il existait toujours une contradiction entre lesouvenir vivant d’<strong>Albertine</strong> et la connaissance quej’avais de sa mort. Mais cette contradiction était enquelque sorte l’inverse de ce qu’elle était autrefois.L’idée qu’<strong>Albertine</strong> était morte, cette idée qui, lespremiers temps, venait battre si furieusement en moil’idée qu’elle était vivante, que j’étais obligé de mesauver devant elle comme les enfants à l’arrivée de lavague, cette idée de sa mort, à la faveur même de cesassauts incessants, avait fini par conquérir en moi laplace qu’y occupait récemment encore l’idée de sa vie.Sans que je m’en rendisse compte, c’était maintenantcette idée de la mort d’<strong>Albertine</strong> – non plus le souvenirprésent de sa vie – qui faisait pour la plus grande partiele fond de mes inconscientes songeries, de sorte que, sije les interrompais tout à coup pour réfléchir sur moimême,ce qui me causait de l’étonnement, ce n’étaitpas, comme les premiers jours, qu’<strong>Albertine</strong> si vivanteen moi pût n’exister plus sur la terre, pût être morte,mais qu’<strong>Albertine</strong>, qui n’existait plus sur la terre, quiétait morte, fût restée si vivante en moi. Maçonné par lacontiguïté des souvenirs qui se suivent l’un l’autre, lenoir tunnel sous lequel ma pensée rêvassait depuis troplongtemps pour qu’elle prît même plus garde à luis’interrompait brusquement d’un intervalle de soleil,laissant voir au loin un univers souriant et bleu où<strong>Albertine</strong> n’était plus qu’un souvenir indifférent et plein
de charme. Est-ce celle-là, me disais-je, qui est la vraie,ou bien l’être qui, dans l’obscurité où je roulais depuissi longtemps, me semblait la seule réalitéi? Lepersonnage que j’avais été il y a si peu de temps encoreet qui ne vivait que dans la perpétuelle attente dumoment où <strong>Albertine</strong> viendrait lui dire bonsoir etl’embrasser, une sorte de multiplication de moi-mêmeme faisait paraître ce personnage comme n’étant plusqu’une faible partie, à demi dépouillée, de moi, etcomme une fleur qui s’entr’ouvre j’éprouvais lafraîcheur rajeunissante d’une exfoliation. Au reste, cesbrèves illuminations ne me faisaient peut-être quemieux prendre conscience de mon amour pour<strong>Albertine</strong>, comme il arrive pour toutes les idées tropconstantes, qui ont besoin d’une opposition pours’affirmer. Ceux qui ont vécu pendant la guerre de1870, par exemple, disent que l’idée de la guerre avaitfini par leur sembler naturelle, non parce qu’ils nepensaient pas assez à la guerre mais parce qu’ils ypensaient toujours. Et pour comprendre combien c’estun fait étrange et considérable que la guerre, il fallait,quelque chose les arrachant à leur obsessionpermanente, qu’ils oubliassent un instant que la guerrerégnait, se retrouvassent pareils à ce qu’ils étaientquand on était en paix, jusqu’à ce que tout à coup sur leblanc momentané se détachât, enfin distincte, la réalitémonstrueuse que depuis longtemps ils avaient cessé de
voir, ne voyant pas autre chose qu’elle.Si encore ce retrait en moi des différents souvenirsd’<strong>Albertine</strong> s’était au moins fait, non pas par échelons,mais simultanément, également, de front, sur toute laligne de ma mémoire, les souvenirs de ses trahisonss’éloignant en même temps que ceux de sa douceur,l’oubli m’eût apporté de l’apaisement. Il n’en était pasainsi. Comme sur une plage où la marée descendirrégulièrement, j’étais assailli par la morsure de tel demes soupçons quand déjà l’image de sa douce présenceétait retirée trop loin de moi pour pouvoir m’apporterson remède. Pour les trahisons j’en avais souffert, parceque, en quelque année lointaine qu’elles eussent eu lieu,pour moi elles n’étaient pas anciennesi; mais j’ensouffris moins quand elles le devinrent, c’est-à-direquand je me les représentai moins vivement, carl’éloignement d’une chose est proportionné plutôt à lapuissance visuelle de la mémoire qui regarde, qu’à ladistance réelle des jours écoulés, comme le souvenird’un rêve de la dernière nuit, qui peut nous paraître pluslointain dans son imprécision et son effacement qu’unévénement qui date de plusieurs années. Mais bien quel’idée de la mort d’<strong>Albertine</strong> fit des progrès en moi, lereflux de la sensation qu’elle était vivante, s’il ne lesarrêtait pas, les contrecarrait cependant et empêchaitqu’ils fussent réguliers. Et je me rends comptemaintenant que, pendant cette période-là (sans doute à
cause de cet oubli des heures où elle avait été cloîtréechez moi et qui, à force d’effacer chez moi lasouffrance de fautes qui me semblaient presqueindifférentes parce que je savais qu’elle ne lescommettait pas, étaient devenues comme autant depreuves d’innocence), j’eus le martyre de vivrehabituellement avec une idée tout aussi nouvelle quecelle qu’<strong>Albertine</strong> était morte (jusque-là je partaistoujours de l’idée qu’elle était vivante), avec une idéeque j’aurais crue tout aussi impossible à supporter etqui, sans que je m’en aperçusse, formant peu à peu lefond de ma conscience, s’y substituait à l’idéequ’<strong>Albertine</strong> était innocente.: c’était l’idée qu’elle étaitcoupable. Quand je croyais douter d’elle, je croyais aucontraire en ellei; de même je pris pour point de départde mes autres idées la certitude – souvent démentiecomme l’avait été l’idée contraire – la certitude de saculpabilité tout en m’imaginant que je doutais encore.Je dus souffrir beaucoup pendant cette période-là, maisje me rends compte qu’il fallait que ce fût ainsi. On neguérit d’une souffrance qu’à condition de l’éprouverpleinement. En protégeant <strong>Albertine</strong> de tout contact, enme forgeant l’illusion qu’elle était innocente, aussi bienque plus tard en prenant pour base de mesraisonnements la pensée qu’elle vivait, je ne faisais queretarder l’heure de la guérison, parce que je retardais leslongues heures qui devaient se dérouler préalablement à
la fin des souffrances nécessaires. Or sur ces idées de laculpabilité d’<strong>Albertine</strong>, l’habitude, quand elles’exercerait, le ferait suivant les mêmes lois que j’avaisdéjà éprouvées au cours de ma vie. De même que lenom de Guermantes avait perdu la signification et lecharme d’une route bordée de fleurs aux grappesviolettes et rougeâtres et du vitrail de Gilbert leMauvais, la présence d’<strong>Albertine</strong>, celle desvallonnements bleus de la mer, les noms de Swann, dulift, de la princesse de Guermantes et de tant d’autres,tout ce qu’ils avaient signifié pour moi, ce charme etcette signification laissant en moi un simple mot qu’ilstrouvaient assez grand pour vivre tout seul, commequelqu’un qui vient mettre en train un serviteur lemettra au courant et après quelques semaines se retire,de même la puissance douloureuse de la culpabilitéd’<strong>Albertine</strong> serait renvoyée hors de moi par l’habitude.D’ailleurs d’ici là, comme au cours d’une attaque faitede deux côtés à la fois, dans cette action de l’habitudedeux alliés se prêteraient réciproquement main forte.C’est parce que cette idée de la culpabilité d’<strong>Albertine</strong>deviendrait pour moi une idée plus probable, plushabituelle, qu’elle deviendrait moins douloureuse.Mais, d’autre part, parce qu’elle serait moinsdouloureuse, les objections faites à la certitude de cetteculpabilité et qui n’étaient inspirées à mon intelligenceque par mon désir de ne pas trop souffrir tomberaient
une à une, et, chaque action précipitant l’autre, jepasserais assez rapidement de la certitude del’innocence d’<strong>Albertine</strong> à la certitude de sa culpabilité.Il fallait que je vécusse avec l’idée de la mortd’<strong>Albertine</strong>, avec l’idée de ses fautes, pour que cesidées me devinssent habituelles, c’est-à-dire pour que jepusse oublier ces idées et enfin oublier <strong>Albertine</strong> ellemême.Je n’en étais pas encore là. Tantôt c’était mamémoire rendue plus claire par une excitationintellectuelle – telle une lecture – qui renouvelait monchagrin, d’autres fois c’était au contraire mon chagrinqui était soulevé, par exemple par l’angoisse d’untemps orageux qui portait plus haut, plus près de lalumière, quelque souvenir de notre amour.D’ailleurs ces reprises de mon amour pour <strong>Albertine</strong>morte pouvaient se produire après un intervalled’indifférence semé d’autres curiosités, comme après lelong intervalle qui avait commencé après le baiserrefusé de Balbec et pendant lequel je m’étais bien plussoucié de M me de Guermantes, d’Andrée, de M lle deStermariai; il avait repris quand j’avais recommencé àla voir souvent. Or, même maintenant, despréoccupations différentes pouvaient réaliser uneséparation – d’avec une morte, cette fois – où elle medevenait plus indifférente. Et même plus tard, quand jel’aimai moins, cela resta pourtant pour moi un de ces
désirs dont on se fatigue vite, mais qui reprennentquand on les a laissés reposer quelque temps. Jepoursuivais une vivante, puis une autre, puis je revenaisà ma morte. Souvent c’était dans les parties les plusobscures de moi-même, quand je ne pouvais plus meformer aucune idée nette d’<strong>Albertine</strong>, qu’un nom venaitpar hasard exciter chez moi des réactions douloureusesque je ne croyais plus possibles, comme ces mourantschez qui le cerveau ne pense plus et dont on fait secontracter un membre en y enfonçant une aiguille. Et,pendant de longues périodes, ces excitations setrouvaient m’arriver si rarement que j’en venais àrechercher moi-même les occasions d’un chagrin, d’unecrise de jalousie, pour tâcher de me rattacher au passé,de mieux me souvenir d’elle. Comme le regret d’unefemme n’est qu’un amour reviviscent et reste soumisaux mêmes lois que lui, la puissance de mon regret étaitaccrue par les mêmes causes qui du vivant d’<strong>Albertine</strong>eussent augmenté mon amour pour elle et au premierrang desquelles avaient toujours figuré la jalousie et ladouleur. Mais le plus souvent ces occasions – car unemaladie, une guerre, peuvent durer bien au delà de ceque la sagesse la plus prévoyante avait supputé –naissaient à mon insu et me causaient des chocs siviolents que je songeais bien plus à me protéger contrela souffrance qu’à leur demander un souvenir.D’ailleurs un mot n’avait même pas besoin, comme
Chaumont, de se rapporter à un soupçon (même unesyllabe commune à deux noms différents suffisait à mamémoire – comme à un électricien qui se contente dumoindre corps bon conducteur – pour rétablir le contactentre <strong>Albertine</strong> et mon cœur) pour qu’il réveillât cesoupçon, pour être le mot de passe, le magique sésameentr’ouvrant la porte d’un passé dont on ne tenait pluscompte parce que, ayant assez de le voir, à la lettre onne le possédait plusi; on avait été diminué de lui, onavait cru de par cette ablation sa propre personnalitéchangée en sa forme, comme une figure qui perdraitavec un angle un côtéi; certaines phrases, par exemple,où il y avait le nom d’une rue, d’une route où <strong>Albertine</strong>avait pu se trouver suffisaient pour incarner une jalousievirtuelle, inexistante, à la recherche d’un corps, d’unedemeure, de quelque fixation matérielle, de quelqueréalisation particulière. Souvent c’était tout simplementpendant mon sommeil que, par ces « reprises », ces « dacapo » du rêve qui tournent d’un seul coup plusieurspages de la mémoire, plusieurs feuillets du calendrierme ramenaient, me faisaient rétrograder à uneimpression douloureuse mais ancienne, qui depuislongtemps avait cédé la place à d’autres et quiredevenait présente. D’habitude, elle s’accompagnait detoute une mise en scène maladroite mais saisissante,qui, me faisant illusion, mettait sous mes yeux, faisaitentendre à mes oreilles ce qui désormais datait de cette
nuit-là. D’ailleurs, dans l’histoire d’un amour et de sesluttes contre l’oubli, le rêve ne tient-il pas une placeplus grande même que la veille, lui qui ne tient pascompte des divisions infinitésimales du temps,supprime les transitions, oppose les grands contrastes,défait en un instant le travail de consolation silentement tissé pendant le jour et nous ménage, la nuit,une rencontre avec celle que nous aurions fini paroublier à condition toutefois de ne pas la revoiri? Car,quoi qu’on dise, nous pouvons avoir parfaitement enrêve l’impression que ce qui se passe est réel. Cela neserait impossible que pour des raisons tirées de notreexpérience qui à ce moment-là nous est cachée. Desorte que cette vie invraisemblable nous semble vraie.Parfois, par un défaut d’éclairage intérieur lequel,vicieux, faisait manquer la pièce, mes souvenirs bienmis en scène me donnant l’illusion de la vie, je croyaisvraiment avoir donné rendez-vous à <strong>Albertine</strong>, laretrouveri; mais alors je me sentais incapable demarcher vers elle, de proférer les mots que je voulais luidire, de rallumer pour la voir le flambeau qui s’étaitéteint – impossibilités qui étaient simplement, dans monrêve, l’immobilité, le mutisme, la cécité du dormeur –comme brusquement on voit dans la projectionmanquée d’une lanterne magique une grande ombre,qui devrait être cachée, effacer la silhouette despersonnages, et qui est celle de la lanterne elle-même,
ou celle de l’opérateur. D’autres fois <strong>Albertine</strong> setrouvait dans mon rêve, et voulait de nouveau mequitter sans que sa résolution parvînt à m’émouvoir.C’est que de ma mémoire avait pu filtrer dansl’obscurité de mon sommeil un rayon avertisseur, et cequi, logé en <strong>Albertine</strong>, ôtait à ses actes futurs, au départqu’elle annonçait, toute importance, c’était l’idéequ’elle était morte. Souvent ce souvenir qu’<strong>Albertine</strong>était morte se combinait sans la détruire avec lasensation qu’elle était vivante. Je causais avec ellei;pendant que je parlais ma grand’mère allait et venaitdans le fond de la chambre. Une partie de son mentonétait tombée en miettes, comme un marbre rongé, maisje ne trouvais à cela rien d’extraordinaire. Je disais à<strong>Albertine</strong> que j’aurais des questions à lui poserrelativement à l’établissement de douches de Balbec età une certaine blanchisseuse de Touraine, mais jeremettais cela à plus tard puisque nous avions tout letemps et que rien ne pressait plus. Elle me promettaitqu’elle ne faisait rien de mal et qu’elle avait seulement,« Commenti? elle est icii? – Oui, il est même temps queje vous quitte, car je dois aller la voir tout à l’heure. »Et comme, depuis qu’<strong>Albertine</strong> était morte, je ne latenais plus prisonnière chez moi comme dans lesm’inquiétait. Je ne voulais pas le laisser voir. <strong>Albertine</strong>la veille, embrassé sur les lèvres M lle Vinteuil.derniers temps de sa vie, sa visite à M lle Vinteuil
me disait qu’elle n’avait fait que l’embrasser, mais elledevait recommencer à mentir comme au temps où elleniait tout. Tout à l’heure elle ne se contenteraitprobablement pas d’embrasser M lle Vinteuil. Sansdoute, à un certain peint de vue j’avais tort de m’eninquiéter ainsi, puisque, à ce qu’on dit, les morts nepeuvent rien sentir, rien faire. On le dit, mais celan’empêchait pas que ma grand’mère qui était mortecontinuait pourtant à vivre depuis plusieurs années, eten ce moment allait et venait dans la chambre. Et sansdoute, une fois que j’étais réveillé, cette idée d’unemorte qui continue à vivre aurait dû me devenir aussiimpossible à comprendre qu’elle me l’est à l’expliquer.Mais je l’avais déjà formée tant de fois, au cours de cespériodes passagères de folie que sont nos rêves quej’avais fini par me familiariser avec ellei; la mémoiredes rêves peut devenir durable s’ils se répètent assezsouvent. Et longtemps après, mon rêve fini, je restaistourmenté de ce baiser qu’<strong>Albertine</strong> m’avait dit avoirdonné en des paroles que je croyais entendre encore. Et,en effet, elles avaient dû passer bien près de mesoreilles puisque c’est moi-même qui les avaisprononcées.Toute la journée, je continuais à causer avec<strong>Albertine</strong>, je l’interrogeais, je lui pardonnais, je réparaisl’oubli des choses que j’avais toujours voulu lui dirependant sa vie. Et tout d’un coup j’étais effrayé de
penser qu’à l’être évoqué par la mémoire, à quis’adressaient tous ces propos, aucune réalité necorrespondît plus, que fussent détruites les différentesparties du visage auxquelles la poussée continue de lavolonté de vivre, aujourd’hui anéantie, avait seuledonné l’unité d’une personne. D’autres fois, sans quej’eusse rêvé, dès mon réveil je sentais que le vent avaittourné en moii; il soufflait froid et continu d’une autredirection venue du fond du passé, me rapportant lasonnerie d’heures lointaines, des sifflements de départque je n’entendais pas d’habitude. Un jour j’essayai deprendre un livre, un roman de Bergotte que j’avaisparticulièrement aimé. Les personnages sympathiquesm’y plaisaient beaucoup, et bien vite repris par lecharme du livre, je me mis à souhaiter comme un plaisirpersonnel que la femme méchante fût puniei; mes yeuxse mouillèrent quand le bonheur des fiancés fut assuré.« Mais alors, m’écriai-je avec désespoir, de ce quej’attache tant d’importance à ce qu’a pu faire <strong>Albertine</strong>je ne peux pas conclure que sa personnalité est quelquechose de réel qui ne peut être aboli, que je la retrouveraiun jour pareil au ciel, si j’appelle de tant de vœux,attends avec tant d’impatience, accueille avec tant delarmes le succès d’une personne qui n’a jamais existéque dans l’imagination de Bergotte, que je n’ai jamaisvue, dont je suis libre de me figurer à mon gré levisage,! » D’ailleurs, dans ce roman il y avait des
jeunes filles séduisantes, des correspondancesamoureuses, des allées désertes où l’on se rencontre,cela me rappelait qu’on peut aimer clandestinement,cela réveillait ma jalousie, comme si <strong>Albertine</strong> avaitencore pu se promener dans des allées désertes. Et il yétait aussi question d’un homme qui revoit aprèscinquante ans une femme qu’il a aimée jeune, ne lareconnaît pas, s’ennuie auprès d’elle. Et cela merappelait que l’amour ne dure pas toujours et mebouleversait comme si j’étais destiné à être séparéd’<strong>Albertine</strong> et à la retrouver avec indifférence dans mesvieux jours. Si j’apercevais une carte de France mesyeux effrayés s’arrangeaient à ne pas rencontrer laTouraine pour que je ne fusse pas jaloux, et, pour que jene fusse pas malheureux, la Normandie où étaientmarqués au moins Balbec et Doncières, entre lesquelsje situais tous ces chemins que nous avions couvertstant de fois ensemble. Au milieu d’autres noms de villesou de villages de France, noms qui n’étaient quevisibles ou audibles, le nom de Tours, par exemple,semblait composé différemment, non plus d’imagesimmatérielles, mais de substances vénéneuses quiagissaient de façon immédiate sur mon cœur dont ellesaccéléraient et rendaient douloureux les battements. Etsi cette force s’étendait jusqu’à certains noms, devenuspar elle si différents des autres, comment en restant plusprès de moi, en me bornant à <strong>Albertine</strong> elle-même,
pouvais-je m’étonner, qu’émanant d’une filleprobablement pareille à toute autre, cette forceirrésistible sur moi, et pour la production de laquellen’importe quelle autre femme eût pu servir, eût été lerésultat d’un enchevêtrement et de la mise en contact derêves, de désirs, d’habitudes, de tendresses, avecl’interférence requise de souffrances et de plaisirsalternési? Et cela continuait après sa mort, la mémoiresuffisant à entretenir la vie réelle, qui est mentale. Je merappelais <strong>Albertine</strong> descendant de wagon et me disantqu’elle avait envie d’aller à Saint-Martin-le-Vêtu, et jela revoyais aussi avant avec son polo abaissé sur sesjouesi; je retrouvais des possibilités de bonheur verslesquelles je m’élançais me disant.: « Nous aurions pualler ensemble jusqu’à Incarville, jusqu’à Doncières. »Il n’y avait pas une station près de Balbec où je ne larevisse, de sorte que cette terre, comme un paysmythologique conservé, me rendait vivantes et cruellesles légendes les plus anciennes, les plus charmantes, lesplus effacées par ce qui avait suivi de mon amour. Ah,!quelle souffrance s’il me fallait jamais coucher ànouveau dans ce lit de Balbec, autour du cadre decuivre duquel, comme autour d’un pivot immuable,d’une barres fixe, s’était déplacée, avait évolué ma vie,appuyant successivement à lui de gaies conversationsavec ma grand’mère, l’horreur de sa mort, les doucescaresses d’<strong>Albertine</strong>, la découverte de son vice, et
maintenant une vie nouvelle où, apercevant lesbibliothèques vitrées où se reflétait la mer, je savaisqu’<strong>Albertine</strong> n’entrerait jamais plus,! N’était-il pas, cethôtel de Balbec, comme cet unique décor de maison desthéâtres de province, où l’on joue depuis des années lespièces les plus différentes, qui a servi pour unecomédie, pour une première tragédie, pour unedeuxième, pour une pièce purement poétique, cet hôtelqui remontait déjà assez loin dans mon passéi? Le faitque cette seule partie restât toujours la même, avec sesmurs, ses bibliothèques, sa glace, au cours de nouvellesépoques de ma vie, me faisait mieux sentir que, dans letotal, c’était le reste, c’était moi-même qui avaischangé, et me donnait ainsi cette impression que lesmystères de la vie, de l’amour, de la mort, auxquels lesenfants croient dans leur optimisme ne pas participer,ne sont pas des parties réservées, mais qu’on s’aperçoitavec une douloureuse fierté qu’ils ont fait corps aucours des années avec votre propre vie.J’essayais parfois de prendre les journaux. Mais lalecture des journaux m’en était odieuse, et de plus ellen’était pas inoffensive. En effet, en nous de chaqueidée, comme d’un carrefour dans une forêt, partent tantde routes différentes, qu’au moment où je m’y attendaisle moins je me trouvais devant un nouveau souvenir. Letitre de la mélodie de Fauré, le Secret, m’avait mené au« secret du Roi » du duc de Broglie, le nom de Broglie
à celui de Chaumont, ou bien le mot de Vendredi-Saintm’avait fait penser au Golgotha, le Golgotha àl’étymologie de ce mot qui paraît l’équivalent deCalvus mons, Chaumont. Mais, par quelque chemin queje fusse arrivé à Chaumont, à ce moment j’étais frappéd’un choc si cruel que dès lors je ne pensais plus qu’àme garer contre la douleur. Quelques instants après lechoc, l’intelligence qui, comme le bruit du tonnerre, nevoyage pas aussi vite m’en apportait la raison.Chaumont m’avait fait penser aux Buttes-Chaumont oùM me Bontemps m’avait dit qu’Andrée allait souventavec <strong>Albertine</strong>, tandis qu’<strong>Albertine</strong> m’avait dit n’avoirjamais vu les Buttes-Chaumont. À partir d’un certainâge nos souvenirs sont tellement entre-croisés les unsavec les autres que la chose à laquelle on pense, le livrequ’on lit n’a presque plus d’importance. On a mis desoi-même partout, tout est fécond, tout est dangereux, eton peut faire d’aussi précieuses découvertes que dansles Pensées de Pascal dans une réclame pour un savon.Sans doute, un fait comme celui des Buttes-Chaumont, qui à l’époque m’avait paru futile, était enlui-même, contre <strong>Albertine</strong>, bien moins grave, moinsdécisif que l’histoire de la doucheuse ou de lablanchisseuse. Mais d’abord un souvenir qui vientfortuitement à nous trouve en nous une puissanceintacte d’imaginer, c’est-à-dire, dans ce cas, de souffrir,que nous avons usée en partie, quand c’est nous au
contraire qui avons volontairement appliqué notre esprità recréer un souvenir. Mais ces derniers (les souvenirsconcernant la doucheuse et la blanchisseuse), toujoursprésents quoique obscurcis dans ma mémoire, commeces meubles placés dans la pénombre d’une galerie etauxquels, sans les distinguer, on évite pourtant de secogner, je m’étais habitué à eux. Au contraire il y avaitlongtemps que je n’avais pensé aux Buttes-Chaumont,ou, par exemple, au regard d’<strong>Albertine</strong> dans la glace ducasino de Balbec, ou au retard inexpliqué d’<strong>Albertine</strong> lesoir où je l’avais tant attendue après la soiréeGuermantes, à toutes ces parties de sa vie qui restaienthors de mon cœur et que j’aurais voulu connaître pourqu’elles pussent s’assimiler, s’annexer à lui, y rejoindreles souvenirs plus doux qu’y formaient une <strong>Albertine</strong>intérieure et vraiment possédée. Soulevant un coin duvoile lourd de l’habitude (l’habitude abêtissante quipendant tout le cours de notre vie nous cache à peu prèstout l’univers, et, dans une nuit profonde, sous leurétiquette inchangée, substitue aux poisons les plusdangereux ou les plus enivrants de la vie quelque chosed’anodin qui ne procure pas de délices), un tel souvenirme revenait comme au premier jour, avec cette fraîcheet perçante nouveauté d’une saison reparaissante, d’unchangement dans la routine de nos heures, qui, dans ledomaine des plaisirs aussi, si nous montons en voiturepar un premier beau jour de printemps, ou sortons de
chez nous au lever du soleil, nous font remarquer nosactions insignifiantes avec une exaltation lucide qui faitprévaloir cette intense minute sur le total des joursantérieurs. Je me retrouvais au sortir de la soirée chez laprincesse de Guermantes, attendant l’arrivéed’<strong>Albertine</strong>. Les jours anciens recouvrent peu à peuceux qui les ont précédés, sont eux-mêmes ensevelissous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien estresté déposé en nous comme, dans une bibliothèqueimmense où il y a de plus vieux livres, un exemplaireque sans doute personne n’ira jamais demander.Pourtant que ce jour ancien, traversant la transluciditédes époques suivantes, remonte à la surface et s’étendeen nous qu’il couvre tout entier, alors, pendant unmoment, les noms reprennent leur anciennesignification, les êtres leur ancien visage, nous notreâme d’alors, et nous sentons, avec une souffrance vaguemais devenue supportable et qui ne durera pas, lesproblèmes devenus depuis longtemps insolubles et quinous angoissaient tant alors. Notre « moi » est fait de lasuperposition de nos états successifs. Mais cettesuperposition n’est pas immuable comme lastratification d’une montagne. Perpétuellement dessoulèvements font affleurer à la surface des couchesanciennes. Je me retrouvais après la soirée chez laprincesse de Guermantes, attendant l’arrivéed’<strong>Albertine</strong>. Qu’avait-elle fait cette nuit-lài? M’avait-
elle trompéi? Avec quii? Les révélations d’Aimé, mêmesi je les acceptais, ne diminuaient en rien pour moil’intérêt anxieux, désolé, de cette question inattendue,comme si chaque <strong>Albertine</strong> différente, chaque souvenirnouveau, posait un problème de jalousie particulierauquel les solutions des autres ne pouvaient pass’appliquer. Mais je n’aurais pas voulu savoirseulement avec quelle femme elle avait passé cette nuitlà,mais quel plaisir particulier cela lui représentait, cequi se passait à ce moment-là en elle. Quelquefois, àBalbec, Françoise était allée la chercher, m’avait ditl’avoir trouvée penchée à sa fenêtre, l’air inquiet,chercheur, comme si elle attendait quelqu’un. Mettonsque j’apprisse que la jeune fille attendue était Andrée,quel était l’état d’esprit dans lequel <strong>Albertine</strong>l’attendait, cet état d’esprit caché derrière le regardinquiet et chercheuri? Ce goût, quelle importance avaitilpour <strong>Albertine</strong>i? quelle place tenait-il dans sespréoccupationsi? Hélas, en me rappelant mes propresagitations chaque fois que j’avais remarqué une jeunefille qui me plaisait, quelquefois seulement quandj’avais entendu parler d’elle sans l’avoir vue, mon soucide me faire beau, d’être avantagé, mes sueurs froides, jen’avais pour me torturer qu’à imaginer ce mêmevoluptueux émoi chez <strong>Albertine</strong>. Et déjà c’était assezpour me torturer, pour me dire qu’à côté de cela desconversations sérieuses avec moi sur Stendhal et Victor
Hugo avaient dû bien peu peser pour elle, pour sentirson cœur attiré vers d’autres êtres, se détacher du mien,s’incarner ailleurs. Mais l’importance même que cedésir devait avoir pour elle et les réserves qui seformaient autour de lui ne pouvaient pas me révéler ceque, qualitativement, il était, bien plus, comment elle lequalifiait quand elle s’en parlait à elle-même. Dans lasouffrance physique au moins nous n’avons pas àchoisir nous-même notre douleur. La maladie ladétermine et nous l’impose. Mais dans la jalousie ilnous faut essayer en quelque sorte des souffrances detout genre et de toute grandeur, avant de nous arrêter àcelle qui nous paraît pouvoir convenir. Et quelledifficulté plus grande quand il s’agit d’une souffrancecomme de sentir celle qu’on aimait éprouvant du plaisiravec des êtres différents de nous, qui lui donnent dessensations que nous ne sommes pas capables de luidonner, ou qui du moins, par leur configuration, leuraspect, leurs façons, lui représentent tout autre choseque nous. Ah,! qu’<strong>Albertine</strong> n’avait-elle aimé Saint-Loup,! comme il me semble que j’eusse moinssouffert,! Certes nous ignorons la sensibilité particulièrede chaque être, mais d’habitude nous ne savons mêmepas que nous l’ignorons, car cette sensibilité des autresnous est indifférente. Pour ce qui concernait <strong>Albertine</strong>,mon malheur ou mon bonheur eût dépendu de cequ’était cette sensibilitéi; je savais bien qu’elle m’était
inconnue, et qu’elle me fût inconnue m’était déjà unedouleur. Les désirs, les plaisirs inconnus que ressentait<strong>Albertine</strong>, une fois j’eus l’illusion de les voir quand,quelque temps après la mort d’<strong>Albertine</strong>, Andrée vintchez moi.Pour la première fois elle me semblait belle, je medisais que ces cheveux presque crépus, ces yeuxsombres et cernés, c’était sans doute ce qu’<strong>Albertine</strong>avait tant aimé, la matérialisation devant moi de cequ’elle portait dans sa rêverie amoureuse, de ce qu’ellevoyait par les regards anticipateurs du désir le jour oùelle avait voulu si précipitamment revenir de Balbec.Comme une sombre fleur inconnue qui m’était pardelà le tombeau rapportée des profondeurs d’un être oùje n’avais pas su la découvrir, il me semblait,exhumation inespérée d’une relique inestimable, voirdevant moi le désir incarné d’<strong>Albertine</strong> qu’Andrée étaitpour moi, comme Vénus était le désir de Jupiter.Andrée regrettait <strong>Albertine</strong>, mais je sentis tout de suitequ’elle ne lui manquait pas. Éloignée de force de sonamie par la mort, elle semblait avoir pris aisément sonparti d’une séparation définitive, que je n’eusse pas osélui demander quand <strong>Albertine</strong> était vivante, tant j’auraiscraint de ne pas arriver à obtenir le consentementd’Andrée. Elle semblait au contraire accepter sansdifficulté ce renoncement, mais précisément au momentoù il ne pouvait plus me profiter. Andrée
m’abandonnait <strong>Albertine</strong>, mais morte, et ayant perdupour moi non seulement sa vie mais, rétrospectivement,un peu de sa réalité, puisque je voyais qu’elle n’étaitpas indispensable, unique pour Andrée qui avait pu laremplacer par d’autres.Du vivant d’<strong>Albertine</strong>, je n’eusse pas osé demanderà Andrée des confidences sur le caractère de leur amitiéentre elles et avec l’amie de M lle Vinteuil, n’étant pascertain, sur la fin, qu’Andrée ne répétât pas à <strong>Albertine</strong>tout ce que je lui disais. Maintenant un telinterrogatoire, même s’il devait être sans résultat, seraitau moins sans danger. Je parlai à Andrée, non sur unton interrogatif mais comme si je l’avais su de touttemps, peut-être par <strong>Albertine</strong>, du goût qu’elle-mêmeAndrée avait pour les femmes et de ses propresrelations avec M lle Vinteuil. Elle avoua tout cela sansaucune difficulté, en souriant. De cet aveu je pouvaistirer de cruelles conséquencesi; d’abord parcequ’Andrée, si affectueuse et coquette avec bien desjeunes gens à Balbec, n’aurait donné lieu pour personneà la supposition d’habitudes qu’elle ne niait nullement,de sorte que, par voie d’analogie, en découvrant cetteAndrée nouvelle je pouvais penser qu’<strong>Albertine</strong> les eûtconfessées avec la même facilité à tout autre qu’à moi,qu’elle sentait jaloux. Mais, d’autre part, Andrée ayantété la meilleure amie d’<strong>Albertine</strong>, et celle pour laquellecelle-ci était probablement revenue exprès de Balbec,
maintenant qu’Andrée avait ces goûts, la conclusion quidevait s’imposer à mon esprit était qu’<strong>Albertine</strong> etAndrée avaient toujours eu des relations ensemble.Certes, comme en présence d’une personne étrangèreon n’ose pas toujours prendre connaissance du présentqu’elle vous remet et dont on ne défera l’enveloppe quequand ce donataire sera parti, tant qu’Andrée fut là jene rentrai pas en moi-même pour y examiner la douleurqu’elle m’apportait, et que je sentais bien causer déjà àmes serviteurs physiques, les nerfs, le cœur, de grandstroubles dont par bonne éducation je feignais de ne pasm’apercevoir, parlant au contraire le plusgracieusement du monde avec la jeune fille que j’avaispour hôte sans détourner mes regards vers ces incidentsintérieurs. Il me fut particulièrement pénible d’entendreAndrée me dire en parlant d’<strong>Albertine</strong>.: « Ah,! oui, elleaimait bien qu’on allât se promener dans la vallée deChevreuse. » À l’univers vague et inexistant où sepassaient les promenades d’<strong>Albertine</strong> et d’Andrée, il mesemblait que celle-ci venait, par une créationpostérieure et diabolique, d’ajouter une vallée maudite.Je sentais qu’Andrée allait me dire tout ce qu’ellefaisait avec <strong>Albertine</strong>, et, tout en essayant par politesse,par habileté, par amour-propre, peut-être parreconnaissance, de me montrer de plus en plusaffectueux, tandis que l’espace que j’avais pu concéderencore à l’innocence d’<strong>Albertine</strong> se rétrécissait de plus
en plus, il me semblait m’apercevoir que, malgré mesefforts, je gardais l’aspect figé d’un animal autourduquel un cercle progressivement resserré est lentementdécrit par l’oiseau fascinateur, qui ne se presse pasparce qu’il est sûr d’atteindre quand il le voudra lavictime qui ne lui échappera plus. Je la regardaispourtant, et avec ce qui reste d’enjouement, de naturelet d’assurance aux personnes qui veulent faire semblantde ne pas craindre qu’on les hypnotise en les fixant, jedis à Andrée cette phrase incidente.: « Je ne vous enavais jamais parlé de peur de vous fâcher, mais,maintenant qu’il nous est doux de parler d’elle, je puisbien vous dire que je savais depuis bien longtemps lesrelations de ce genre que vous aviez avec <strong>Albertine</strong>.D’ailleurs, cela vous fera plaisir quoique vous lesachiez déjà.: <strong>Albertine</strong> vous adorait. » Je dis à Andréeque c’eût été une grande curiosité pour moi si elle avaitvoulu me laisser la voir, même simplement en sebornant à des caresses qui ne la gênassent pas tropdevant moi, faire cela avec celles des amies d’<strong>Albertine</strong>qui avaient ces goûts, et je nommai Rosemonde, Berthe,toutes les amies d’<strong>Albertine</strong>, pour savoir. « Outre quepour rien au monde je ne ferais ce que vous dites devantvous, me répondit Andrée, je ne crois pas qu’aucune decelles que vous dites ait ces goûts. » Me rapprochantmalgré moi du monstre qui m’attirait, je répondis.:« Comment,! vous n’allez pas me faire croire que de
toute votre bande il n’y avait qu’<strong>Albertine</strong> avec quivous fissiez cela,! – Mais je ne l’ai jamais fait avec<strong>Albertine</strong>. – Voyons, ma petite Andrée, pourquoi nierdes choses que je sais depuis au moins trois ansi; je n’ytrouve rien de mal, au contraire. Justement, à propos dusoir où elle voulait tant aller le lendemain avec vouschez M me Verdurin, vous vous souvenez peut-être... »Avant que j’eusse continué ma phrase, je vis dans lesyeux d’Andrée, qu’il faisait pointus comme ces pierresqu’à cause de cela les joailliers ont de la peine àemployer, passer un regard préoccupé, comme ces têtesde privilégiés qui soulèvent un coin du rideau avantqu’une pièce soit commencée et qui se sauvent aussitôtpour ne pas être aperçus. Ce regard inquiet disparut,tout était rentré dans l’ordre, mais je sentais que tout ceque je verrais maintenant ne serait plus qu’arrangéfacticement pour moi. À ce moment je m’aperçus dansla glacei; je fus frappé d’une certaine ressemblanceentre moi et Andrée. Si je n’avais pas cessé depuislongtemps de me raser et que je n’eusse eu qu’uneombre de moustache, cette ressemblance eût étépresque complète. C’était peut-être en regardant, àBalbec, ma moustache qui repoussait à peinequ’<strong>Albertine</strong> avait subitement eu ce désir impatient,furieux, de revenir à Paris. « Mais je ne peux pourtantpas dire ce qui n’est pas vrai pour la simple raison quevous ne le trouveriez pas mal. Je vous jure que je n’ai
jamais rien fait avec <strong>Albertine</strong>, et j’ai la convictionqu’elle détestait ces choses-là. Les gens qui vous ont ditcela vous ont menti, peut-être dans un but intéressé »,me dit-elle d’un air interrogateur et méfiant. « Enfinsoit, puisque vous ne voulez pas me le dire », répondisje.Je préférais avoir l’air de ne pas vouloir donner unepreuve que je ne possédais pas. Pourtant je prononçaivaguement et à tout hasard le nom des Buttes-Chaumont. « J’ai pu aller aux Buttes-Chaumont avec<strong>Albertine</strong>, mais est-ce un endroit qui a quelque chose departiculièrement mali? » Je lui demandai si elle nepourrait pas en parler à Gisèle qui, à une certaineépoque, avait intimement connu <strong>Albertine</strong>. MaisAndrée me déclara, qu’après une infamie que venait delui faire dernièrement Gisèle, lui demander un serviceétait la seule chose qu’elle refuserait toujours de fairepour moi. « Si vous la voyez, ajouta-t-elle, ne lui ditespas ce que je vous ai dit d’elle, inutile de m’en faire uneennemie. Elle sait ce que je pense d’elle, mais j’aitoujours mieux aimé éviter avec elle les brouillesviolentes qui n’amènent que des raccommodements. Etpuis elle est dangereuse. Mais vous comprenez que,quand on a lu la lettre que j’ai eue il y a huit jours sousles yeux et où elle mentait avec une telle perfidie, rien,même les plus belles actions du monde, ne peuventeffacer le souvenir de cela. » En somme, si Andréeayant ces goûts au point de ne s’en cacher nullement, et
<strong>Albertine</strong> ayant eu pour elle la grande affection que trèscertainement elle avait, malgré cela Andrée n’avaitjamais eu de relations charnelles avec <strong>Albertine</strong> et avaittoujours ignoré qu’<strong>Albertine</strong> eût de tels goûts, c’estqu’<strong>Albertine</strong> ne les avait pas, et n’avait eu avecpersonne les relations que plus qu’avec aucune autreelle aurait eues avec Andrée. Aussi quand Andrée futpartie, je m’aperçus que son affirmation si nette m’avaitapporté du calme. Mais peut-être était-elle dictée par ledevoir, auquel Andrée se croyait obligée envers lamorte dont le souvenir existait encore en elle, de ne paslaisser croire ce qu’<strong>Albertine</strong> lui avait sans doute,pendant sa vie, demandé de nier.Les romanciers prétendent souvent, dans uneintroduction, qu’en voyageant dans un pays ils ontrencontré quelqu’un qui leur a raconté la vie d’unepersonne. Ils laissent alors la parole à cet ami derencontre, et le récit qu’il leur fait, c’est précisémentleur roman. Ainsi la vie de Fabrice del Dongo futracontée à Stendhal par un chanoine de Padoue.Combien nous voudrions, quand nous aimons, c’est-àdirequand l’existence d’une autre personne noussemble mystérieuse, trouver un tel narrateur informé,!Et certes il existe. Nous-même, ne racontons-nous passouvent, sans aucune passion, la vie de telle ou tellefemme à un de nos amis, ou à un étranger, qui neconnaissaient rien de ses amours et nous écoutent avec
curiositéi? L’homme que j’étais quand je parlais àBloch de la princesse de Guermantes, de M me Swann,cet être-là existait qui eût pu me parler d’<strong>Albertine</strong>, cetêtre-là existe toujours... mais nous ne le rencontronsjamais. Il me semblait que, si j’avais pu trouver desfemmes qui l’eussent connue, j’eusse appris tout ce quej’ignorais. Pourtant, à des étrangers il eût dû semblerque personne autant que moi ne pouvait connaître savie. Même ne connaissais-je pas sa meilleure amie,Andréei? C’est ainsi que l’on croit que l’ami d’unministre doit savoir la vérité sur certaines affaires ou nepourra pas être impliqué dans un procès. Seul, à l’user,l’ami a appris que, chaque fois qu’il parlait politique auministre, celui-ci restait dans des généralités et lui disaittout au plus ce qu’il y avait dans les journaux, ou que,s’il a eu quelque ennui, ses démarches multipliéesauprès du ministre ont abouti chaque fois à un « cen’est pas en mon pouvoir » sur lequel l’ami est luimêmesans pouvoir. Je me disais.: « Si j’avais puconnaître tels témoins,! » desquels, si je les avaisconnus, je n’aurais probablement pas pu obtenir plusque d’Andrée, dépositaire elle-même d’un secretqu’elle ne voulait pas livrer. Différant en cela encore deSwann qui, quand il ne fut plus jaloux, cessa d’êtrecurieux de ce qu’Odette avait pu faire avec Forcheville,même, après ma jalousie passée, connaître lablanchisseuse d’<strong>Albertine</strong>, des personnes de son
quartier, y reconstituer sa vie, ses intrigues, cela seulavait du charme pour moi. Et comme le désir vienttoujours d’un prestige préalable, comme il était advenupour Gilberte, pour la duchesse de Guermantes, cefurent, dans ces quartiers où avait autrefois vécu<strong>Albertine</strong>, les femmes de son milieu que je recherchai etdont seules j’eusse pu désirer la présence. Même sansrien pouvoir en apprendre, c’étaient les seules femmesvers lesquelles je me sentais attiré, étant cellesqu’<strong>Albertine</strong> avait connues ou qu’elle aurait puconnaître, femmes de son milieu ou des milieux où ellese plaisait, en un mot celles qui avaient pour moi leprestige de lui ressembler ou d’être de celles qui luieussent plu. Me rappelant ainsi soit <strong>Albertine</strong> ellemême,soit le type pour lequel elle avait sans doute unepréférence, ces femmes éveillaient en moi un sentimentcruel de jalousie ou de regret, qui plus tard, quand monchagrin s’apaisa, se mua en une curiosité non exemptede charme. Et parmi ces dernières, surtout les filles dupeuple, à cause de cette vie si différente de celle que jeconnaissais, et qui est la leur. Sans doute, c’estseulement par la pensée qu’on possède des choses, et onne possède pas un tableau parce qu’on l’a dans sa salleà manger si on ne sait pas le comprendre, ni un paysparce qu’on y réside sans même le regarder. Mais enfinj’avais autrefois l’illusion de ressaisir Balbec quand, àParis, <strong>Albertine</strong> venait me voir et que je la tenais dans
mes bras. De même je prenais un contact, bien étroit etfurtif d’ailleurs, avec la vie d’<strong>Albertine</strong>, l’atmosphèredes ateliers, une conversation de comptoir, l’âme destaudis, quand j’embrassais une ouvrière. Andrée, cesautres femmes, tout cela par rapport à <strong>Albertine</strong> –comme <strong>Albertine</strong> avait été elle-même par rapport àBalbec – étaient de ces substituts de plaisirs seremplaçant l’un l’autre en dégradations successives, quinous permettent de nous passer de celui que nous nepouvons plus atteindre, voyage à Balbec ou amourd’<strong>Albertine</strong> (comme le fait d’aller au Louvre voir unTitien qui y fut jadis console de ne pouvoir aller àVenise), de ces plaisirs qui, séparés les uns des autrespar des nuances indiscernables, font de notre viecomme une suite de zones concentriques, contiguës,harmoniques et dégradées, autour d’un désir premierqui a donné le ton, éliminé ce qui ne se fond pas aveclui et répandu la teinte maîtresse (comme cela m’étaitarrivé aussi, par exemple, pour la duchesse deGuermantes et pour Gilberte). Andrée, ces femmes,étaient pour le désir, que je savais ne plus pouvoirexaucer, d’avoir auprès de moi <strong>Albertine</strong> ce qu’un soir,avant que je connusse <strong>Albertine</strong> autrement que de vue,avait été l’ensoleillement tortueux et frais d’une grappede raisin.Associées maintenant au souvenir de mon amour,les particularités physiques et sociales d’<strong>Albertine</strong>,
malgré lesquelles je l’avais aimée, orientaient aucontraire mon désir vers ce qu’il eût autrefois le moinsnaturellement choisi.: des brunes de la petitebourgeoisie. Certes, ce qui commençait partiellement àrenaître en moi, c’était cet immense désir que monamour pour <strong>Albertine</strong> n’avait pu assouvir, cet immensedésir de connaître la vie que j’éprouvais autrefois surles routes de Balbec, dans les rues de Paris, ce désir quim’avait fait tant souffrir quand, supposant qu’il existaitaussi au cœur d’<strong>Albertine</strong>, j’avais voulu la priver desmoyens de le contenter avec d’autres que moi.Maintenant que je pouvais supporter l’idée de son désir,comme cette idée était aussitôt éveillée par le mien cesdeux immenses appétits coïncidaient, j’aurais voulu quenous pussions nous y livrer ensemble, je me disais.:« cette fille lui aurait plu », et par ce brusque détourpensant à elle et à sa mort, je me sentais trop triste pourpouvoir poursuivre plus loin mon désir. Commeautrefois le côté de Méséglise et celui de Guermantesavaient établi les assises de mon goût pour la campagneet m’eussent empêché de trouver un charme profonddans un pays où il n’y aurait pas eu de vieille église, debleuets, de boutons d’or, c’est de même en lesrattachant en moi à un passé plein de charme que monamour pour <strong>Albertine</strong> me faisait exclusivementrechercher un certain genre de femmesi; jerecommençais, comme avant de l’aimer, à avoir besoin
d’harmoniques d’elle qui fussent interchangeables avecmon souvenir devenu peu à peu moins exclusif. Jen’aurais pu me plaire maintenant auprès d’une blonde etfière duchesse, parce qu’elle n’eût éveillé en moiaucune des émotions qui partaient d’<strong>Albertine</strong>, de mondésir d’elle, de la jalousie que j’avais eue de sesamours, de mes souffrances, de sa mort. Car nossensations pour être fortes ont besoin de déclencher ennous quelque chose de différent d’elles, un sentimentqui ne pourra pas trouver dans le plaisir de satisfactionmais qui s’ajoute au désir, l’enfle, le fait s’accrocherdésespérément au plaisir. Au fur et à mesure quel’amour qu’avait éprouvé <strong>Albertine</strong> pour certainesfemmes ne me faisait plus souffrir, il rattachait cesfemmes à mon passé, leur donnait quelque chose deplus réel, comme aux boutons d’or, aux aubépines lesouvenir de Combray donnait plus de réalité qu’auxfleurs nouvelles. Même d’Andrée, je ne me disais plusavec rage.: « <strong>Albertine</strong> l’aimait », mais au contraire,pour m’expliquer à moi-même mon désir, d’un airattendri.: « <strong>Albertine</strong> l’aimait bien ». Je comprenaismaintenant les veufs qu’on croit consolés et quiprouvent au contraire qu’ils sont inconsolables, parcequ’ils se remarient avec leur belle-sœur. Ainsi monamour finissant semblait rendre possible pour moi denouvelles amours, et <strong>Albertine</strong>, comme ces femmeslongtemps aimées pour elles-mêmes qui plus tard,
sentant le goût de leur amant s’affaiblir, conservent leurpouvoir en se contentant du rôle d’entremetteuses,parait pour moi, comme la Pompadour pour Louis XV,de nouvelles fillettes. Même autrefois, mon temps étaitdivisé par périodes où je désirais telle femme, ou telleautre. Quand les plaisirs violents donnés par l’uneétaient apaisés, je souhaitais celle qui donnait unetendresse presque pure, jusqu’à ce que le besoin decaresses plus savantes ramenât le désir de la première.Maintenant ces alternances avaient pris fin, ou dumoins l’une des périodes se prolongeait indéfiniment.Ce que j’aurais voulu, c’est que la nouvelle venue vînthabiter chez moi et me donnât le soir avant de mequitter un baiser familial de sœur. De sorte que j’auraispu croire – si je n’avais fait l’expérience de la présenceinsupportable d’une autre – que je regrettais plus unbaiser que certaines lèvres, un plaisir qu’un amour, unehabitude qu’une personne. J’aurais voulu aussi que lesnouvelles venues pussent me jouer du Vinteuil comme<strong>Albertine</strong>, causer comme elle avec moi d’Elstir. Toutcela était impossible. Leur amour ne vaudrait pas lesien, pensais-je, soit qu’un amour auquel s’annexaienttous ces épisodes, des visites aux musées, des soirées auconcert, toute une vie compliquée qui permet descorrespondances, des conversations, un flirtpréliminaire aux relations elles-mêmes, une amitiégrave après, possédât plus de ressources qu’un amour
pour une femme qui ne sait que se donner, comme unorchestre plus qu’un pianoi; soit que, plusprofondément, mon besoin du même genre de tendresseque me donnait <strong>Albertine</strong>, la tendresse d’une fille assezcultivée et qui fût en même temps une sœur, ne fût –comme le besoin de femmes du même milieuqu’<strong>Albertine</strong> – qu’une reviviscence du souvenird’<strong>Albertine</strong>, du souvenir de mon amour pour elle. Etune fois de plus j’éprouvais d’abord que le souvenirn’est pas inventif, qu’il est impuissant à désirer riend’autre, même rien de mieux que ce que nous avonspossédéi; ensuite qu’il est spirituel, de sorte que laréalité ne peut lui fournir l’état qu’il cherchei; enfinque, s’appliquant à une personne morte, la renaissancequ’il incarne est moins celle du besoin d’aimer, auquelil fait croire, que celle du besoin de l’absente. De sorteque la ressemblance avec <strong>Albertine</strong>, de la femme quej’avais choisie, la ressemblance même, si j’arrivais àl’obtenir, de sa tendresse avec celle d’<strong>Albertine</strong>, ne mefaisaient que mieux sentir l’absence de ce que j’avais,sans le savoir, cherché, de ce qui était indispensablepour que renaquît mon bonheur, c’est-à-dire <strong>Albertine</strong>elle-même, le temps que nous avions vécu ensemble, lepassé à la recherche duquel j’étais sans le savoir.Certes, par les jours clairs, Paris m’apparaissaitinnombrablement fleuri de toutes les fillettes, non queje désirais, mais qui plongeaient leurs racines dans
l’obscurité du désir et des soirées inconnuesd’<strong>Albertine</strong>. C’était telle de celles dont elle m’avait dittout au début, quand elle ne se méfiait pas de moi.:« Elle est ravissante, cette petite, comme elle a de jolischeveux,! » Toutes les curiosités que j’avais euesautrefois de sa vie, quand je ne la connaissais encoreque de vue, et, d’autre part, tous mes désirs de la vie seconfondaient en cette seule curiosité, voir <strong>Albertine</strong>avec d’autres femmes, peut-être parce que ainsi, ellesparties, je serais resté seul avec elle, le dernier et lemaître. Et en voyant ses hésitations, son incertitude ense demandant s’il valait la peine de passer la soirée avectelle ou telle, sa satiété quand l’autre était partie, peutêtresa déception, j’eusse éclairé, j’eusse ramené à dejustes proportions la jalousie que m’inspirait <strong>Albertine</strong>,parce que, la voyant ainsi les éprouver, j’aurais pris lamesure et découvert la limite de ses plaisirs. Decombien de plaisirs, de quelle douce vie elle nous aprivés, me disais-je, par cette farouche obstination ànier son goût,! Et comme une fois de plus je cherchaisquelle avait pu être la raison de cette obstination, toutd’un coup le souvenir me revint d’une phrase que je luiavais dite à Balbec le jour où elle m’avait donné uncrayon. Comme je lui reprochais de ne pas m’avoirlaissé l’embrasser, je lui avais dit que je trouvais celaaussi naturel que je trouvais ignoble qu’une femme eûtdes relations avec une autre femme. Hélas, peut-être
<strong>Albertine</strong> s’était-elle toujours rappelé cette phraseimprudente.Je ramenais avec moi les filles qui m’eussent lemoins plu, je lissais des bandeaux à la vierge,j’admirais un petit nez bien modelé, une pâleurespagnole. Certes autrefois, même pour une femme queje ne faisais qu’apercevoir sur une route de Balbec,dans une rue de Paris, j’avais senti ce que mon désiravait d’individuel, et que c’était le fausser que dechercher à l’assouvir avec un autre objet. Mais la vie,en me découvrant peu à peu la permanence de nosbesoins, m’avait appris que faute d’un être il faut secontenter d’un autre, – et je sentais que ce que j’avaisdemandé à <strong>Albertine</strong>, une autre, M lle de Stermaria, eûtpu me le donner. Mais ç’avait été <strong>Albertine</strong>i; et entre lasatisfaction de mes besoins de tendresse et lesparticularités de son corps un entrelacement desouvenirs s’était fait tellement inextricable que je nepouvais plus arracher à un désir de tendresse toute cettebroderie des souvenirs du corps d’<strong>Albertine</strong>. Elle seulepouvait me donner ce bonheur. L’idée de son unicitén’était plus un a priori métaphysique puisé dans cequ’<strong>Albertine</strong> avait d’individuel, comme jadis pour lespassantes, mais un a posteriori constitué parl’imbrication contingente et indissoluble de messouvenirs. Je ne pouvais plus désirer une tendresse sansavoir besoin d’elle, sans souffrir de son absence. Aussi
la ressemblance même de la femme choisie, de latendresse demandée, avec le bonheur que j’avais connu,ne me faisait que mieux sentir tout ce qui leur manquaitpour qu’il pût renaître. Ce même vide que je sentaisdans ma chambre depuis qu’<strong>Albertine</strong> était partie, etque j’avais cru combler en serrant des femmes contremoi, je le retrouvais en elles. Elles ne m’avaient jamaisparlé, elles, de la musique de Vinteuil, des Mémoires deSaint-Simon, elles n’avaient pas mis un parfum tropfort pour venir me voir, elles n’avaient pas joué à mêlerleurs cils aux miens, toutes choses importantes parcequ’elles permettent, semble-t-il, de rêver autour del’acte sexuel lui-même et de se donner l’illusion del’amour, mais en réalité parce qu’elles faisaient partiedu souvenir d’<strong>Albertine</strong> et que c’était elle que j’auraisvoulu trouver. Ce que ces femmes avaient d’<strong>Albertine</strong>me faisait mieux ressentir ce que d’elle il leur manquait,et qui était tout, et qui ne serait plus jamais puisque<strong>Albertine</strong> était morte. Et ainsi mon amour pour<strong>Albertine</strong>, qui m’avait attiré vers ces femmes, me lesrendait indifférentes, et peut-être mon regretd’<strong>Albertine</strong> et la persistance de ma jalousie, qui avaientdéjà dépassé par leur durée mes prévisions les pluspessimistes, n’auraient sans doute jamais changébeaucoup, si leur existence, isolée du reste de ma vie,avait seulement été soumise au jeu de mes souvenirs,aux actions et réactions d’une psychologie applicable à
des états immobiles, et n’avait pas été entraînée vers unsystème plus vaste où les âmes se meuvent dans letemps comme les corps dans l’espace. Comme il y aune géométrie dans l’espace, il y a une psychologiedans le temps, où les calculs d’une psychologie planene seraient plus exacts parce qu’on n’y tiendrait pascompte du temps et d’une des formes qu’il revêt,l’oublii; l’oubli dont je commençais à sentir la force etqui est un si puissant instrument d’adaptation à laréalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le passésurvivant qui est en constante contradiction avec elle.Et j’aurais vraiment bien pu deviner plus tôt qu’un jourje n’aimerais plus <strong>Albertine</strong>. Quand j’avais compris, parla différence qu’il y avait entre ce que l’importance desa personne et de ses actions était pour moi et pour lesautres, que mon amour était moins un amour pour ellequ’un amour en moi, j’aurais pu déduire diversesconséquences de ce caractère subjectif de mon amour,et, qu’étant un état mental, il pouvait notammentsurvivre assez longtemps à la personne, mais aussi quen’ayant avec cette personne aucun lien véritable,n’ayant aucun soutien en dehors de soi, il devrait,comme tout état mental, même les plus durables, setrouver un jour hors d’usage, être « remplacé », et quece jour-là tout ce qui semblait m’attacher si doucement,indissolublement, au souvenir d’<strong>Albertine</strong> n’existeraitplus pour moi. C’est le malheur des êtres de n’être pour
nous que des planches de collections fort usables dansnotre pensée. Justement à cause de cela on fonde sureux des projets qui ont l’ardeur de la penséei; mais lapensée se fatigue, le souvenir se détruit, le jourviendrait où je donnerais volontiers à la première venuela chambre d’<strong>Albertine</strong>, comme j’avais sans aucunchagrin donné à <strong>Albertine</strong> la bille d’agate ou d’autresprésents de Gilberte.
Chapitre IIMademoiselle de ForchevilleCe n’était pas que je n’aimasse encore <strong>Albertine</strong>,nais déjà pas de la même façon que les derniers temps.Non, c’était à la façon des temps plus anciens où tout cequi se rattachait à elle, lieux et gens, me faisait éprouverune curiosité où il y avait plus de charme que desouffrance. Et, en effet, je sentais bien maintenantqu’avant de l’oublier tout à fait, avant d’atteindre àl’indifférence initiale, il me faudrait, comme unvoyageur qui revient par la même route au point d’où ilest parti, traverser en sens inverse tous les sentimentspar lesquels j’avais passé avant d’arriver à mon grandamour. Mais ces fragments, ces moments du passé nesont pas immobiles, ils ont gardé la force terrible,l’ignorance heureuse de l’espérance qui s’élançait alorsvers un temps devenu aujourd’hui le passé, mais qu’unehallucination nous fait un instant prendrerétrospectivement pour l’avenir. Je lisais une lettred’<strong>Albertine</strong> où elle m’avait annoncé sa visite pour lesoir et j’avais une seconde la joie de l’attente. Dans cesretours par la même ligne d’un pays où l’on ne
etournera jamais, où l’on reconnaît le nom, l’aspect detoutes les stations par où on a déjà passé à l’aller, ilarrive que, tandis qu’on est arrêté à l’une d’elles, engare, on a un instant l’illusion qu’on repart, mais dansla direction du lieu d’où l’on vient, comme l’on avaitfait la première fois. Tout de suite l’illusion cesse, maisune seconde on s’était senti de nouveau emporté.: telleest la cruauté du souvenir.Parfois la lecture d’un roman un peu triste meramenait brusquement en arrière, car certains romanssont comme de grands deuils momentanés, abolissentl’habitude, nous remettent en contact avec la réalité dela vie, mais pour quelques heures seulement, comme uncauchemar, puisque les forces de l’habitude, l’oubliqu’elles produisent, la gaîté qu’elles ramènent parl’impuissance du cerveau à lutter contre elles et àrecréer le vrai, l’emportent infiniment sur la suggestionpresque hypnotique d’un beau livre qui, comme toutesles suggestions, a des effets très courts.Et pourtant, s’il ne peut pas, avant de revenir àl’indifférence d’où on était parti, se dispenser decouvrir en sens inverse les distances qu’on avaitfranchies pour arriver à l’amour, le trajet, la ligne qu’onsuit, ne sont pas forcément les mêmes. Ils ont decommun de ne pas être directs parce que l’oubli pasplus que l’amour ne progresse régulièrement. Mais ilsn’empruntent pas forcément les mêmes voies. Et dans
celle que je suivis au retour, il y eut, au milieu d’unvoyage confus, trois arrêts, dont je me souviens à causede la lumière qu’il y avait autour de moi alors quej’étais déjà bien près de l’arrivée, étapes que je merappelle particulièrement, sans doute parce que j’yaperçus des choses qui ne faisaient pas partie de monamour d’<strong>Albertine</strong>, ou du moins qui ne s’y rattachaientque dans la mesure où ce qui était déjà dans notre âmeavant un grand amour s’associe à lui, soit en lenourrissant, soit en le combattant, soit en faisant aveclui, pour notre intelligence qui analyse, contrasted’image.La première de ces étapes commença au début del’hiver, un beau dimanche de Toussaint où j’étais sorti.Tout en approchant du Bois, je me rappelais avectristesse le retour d’<strong>Albertine</strong> venant me chercher duTrocadéro, car c’était la même journée, mais sans<strong>Albertine</strong>. Avec tristesse et pourtant non sans plaisirtout de même, car la reprise en mineur, sur un tondésolé, du même motif qui avait empli ma journéed’autrefois, l’absence même de ce téléphonage deFrançoise, de cette arrivée d’<strong>Albertine</strong>, qui n’était pasquelque chose de négatif mais la suppression dans laréalité de ce que je me rappelais et qui donnait à lajournée quelque chose de douloureux, en faisait quelquechose de plus beau qu’une journée unie et simple parceque ce qui n’y était plus, ce qui en avait été arraché, y
estait imprimé comme en creux.Au Bois, je fredonnais des phrases de la sonate deVinteuil. Je ne souffrais plus beaucoup de penserqu’<strong>Albertine</strong> me l’avait jouée, car presque tous messouvenirs d’elle étaient entrés dans ce second étatchimique où ils ne causent plus d’anxieuse oppressionau cœur, mais de la douceur. Par moment, dans lespassages qu’elle jouait le plus souvent, où elle avaitl’habitude de faire telle réflexion qui me paraissait alorscharmante, de suggérer telle réminiscence, je medisais.: « Pauvre petite », mais sans tristesse, enajoutant seulement au passage musical une valeur deplus, une valeur en quelque sorte historique et decuriosité, comme celle que le tableau de Charles I er parVan Dyck, déjà si beau par lui-même, acquiert encoredu fait qu’il est entré dans les collections nationales, parla volonté de M me du Barry d’impressionner le Roi.Quand la petite phrase, avant de disparaître tout à fait,se défit en ses divers éléments, où elle flotta encore uninstant éparpillée, ce ne fut pas pour moi, comme pourSwann, une messagère d’<strong>Albertine</strong> qui disparaissait. Cen’était pas tout à fait les mêmes associations d’idéeschez moi que chez Swann que la petite phrase avaitéveillées. J’avais été surtout sensible à l’élaboration,aux essais, aux reprises, au « devenir » d’une phrase quise faisait durant la sonate comme cet amour s’était faitdurant ma vie. Et maintenant, sachant combien chaque
jour un élément de plus de mon amour s’en allait, lecôté jalousie, puis tel autre, revenant, en somme, peu àpeu dans un vague souvenir à la faible amorce du début,c’était mon amour qu’il me semblait, en la petite phraseéparpillée, voir se désagréger devant moi.Comme je suivais les allées séparées d’un sous-bois,tendues d’une gaze chaque jour amincie, le souvenird’une promenade où <strong>Albertine</strong> était à côté de moi dansla voiture, où elle était rentrée avec moi, où je sentaisqu’elle enveloppait ma vie, flotter maintenant autour demoi, dans la brume incertaine des branches assombriesau milieu desquelles le soleil couchant faisait briller,comme suspendue dans le vide, l’horizontalitéclairsemée des feuillages d’or, D’ailleurs, je tressaillaisde moment en moment, comme tous ceux pour lesquelsune idée fixe donne à toute femme arrêtée au coin d’uneallée la ressemblance, l’identité possible avec celle àqui on pense. « C’est peut-être elle,! » On se retourne,la voiture continue à avancer et on ne revient pas enarrière. Ces feuillages, je ne me contentais pas de lesvoir avec les yeux de la mémoire, ils m’intéressaient,me touchaient comme ces pages purement descriptivesau milieu desquelles un artiste, pour les rendre pluscomplètes, introduit une fiction, tout un romani; et cettenature prenait ainsi le seul charme de mélancolie quipouvait aller jusqu’à mon cœur. La raison de ce charmeme parut être que j’aimais toujours autant <strong>Albertine</strong>,
tandis que la raison véritable était au contraire quel’oubli continuait à faire en moi des progrès que lesouvenir d’<strong>Albertine</strong> ne m’était plus cruel, c’est-à-direavait changéi; mais nous avons beau voir clair dans nosimpressions, comme je crus alors voir clair dans laraison de ma mélancolie, nous ne savons pas remonterjusqu’à leur signification plus éloignée. Comme cesmalaises dont le médecin écoute son malade luiraconter l’histoire et à l’aide desquels il remonte à unecause plus profonde, ignorée du patient, de même nosimpressions, nos idées, n’ont qu’une valeur desymptômes. Ma jalousie étant tenue à l’écart parl’impression de charme et de douce tristesse que jeressentais, mes sens se réveillaient. Une fois de plus,comme lorsque j’avais cessé de voir Gilberte, l’amourde la femme s’élevait de moi, débarrassé de touteassociation exclusive avec une certaine femme déjàaimée, et flottait comme ces essences qu’ont libéréesdes destructions antérieures et qui errent en suspensdans l’air printanier, ne demandant qu’à s’unir à unenouvelle créature. Nulle part il ne germe autant defleurs, s’appelassent-elles « ne m’oubliez pas », quedans un cimetière. Je regardais les jeunes files dont étaitinnombrablement fleuri ce beau jour, comme j’eussefait jadis de la voiture de M me de Villeparisis ou de celleoù j’étais, par un même dimanche, venu avec <strong>Albertine</strong>.Aussitôt, au regard que je venais de poser sur telle ou
telle d’entre elles s’appariait immédiatement le regardcurieux, furtif, entreprenant, reflétant d’insaisissablespensées, que leur eût à la dérobée jeté <strong>Albertine</strong> et qui,géminant le mien d’une aile mystérieuse, rapide etbleuâtre, faisait passer dans ces allées, jusque-là sinaturelles, le frisson d’un inconnu dont mon propredésir n’eût pas suffi à les renouveler s’il fût demeuréseul, car lui, pour moi, n’avait rien d’étranger.D’ailleurs, à Balbec, quand j’avais désiré connaître<strong>Albertine</strong> la première fois, n’était-ce pas parce qu’ellem’avait semblé représentative de ces jeunes filles dontla vue m’avait si souvent arrêté dans les rues, sur lesroutes, et que pour moi elle pouvait résumer leur viei?Et n’était-il pas naturel que maintenant l’étoilefinissante de mon amour, dans lequel elles s’étaientcondensées, se dispersât de nouveau en cette poussièredisséminée de nébuleusesi? Toutes me semblaient des<strong>Albertine</strong> – l’image que je portais en moi me la faisantretrouver partout – et même, au détour d’une allée,l’une d’elles qui remontait dans une automobile me larappela tellement, était si exactement de la mêmecorpulence, que je me demandai un instant si ce n’étaitpas elle que je venais de voir, si on ne m’avait pastrompé en me faisant le récit de sa mort. Je la revoyaisainsi dans un angle d’allée, peut-être à Balbec,remontant en voiture de la même manière, alors qu’elleavait tant de confiance dans la vie. Et l’acte de cette
jeune fille de remonter en automobile, je ne leconstatais pas seulement avec mes yeux, comme lasuperficielle apparence qui se déroule si souvent aucours d’une promenade.: devenu une sorte d’actedurable, il me semblait s’étendre aussi dans le passé parce côté qui venait de lui être surajouté et qui s’appuyaitsi voluptueusement, si tristement contre mon cœur.Mais déjà la jeune fille avait disparu.Un peu plus loin je vis un groupe de trois jeunesfilles un peu plus âgées, peut-être des jeunes femmes,dont l’allure élégante et énergique correspondait si bienà ce qui m’avait séduit le premier jour où j’avais aperçu<strong>Albertine</strong> et ses amies que j’emboîtai le pas à ces troisnouvelles jeunes filles et, au moment où elles prirentune voiture, j’en cherchai désespérément une autre danstous les sens. Je la trouvai, mais trop tard. Je ne lesrejoignis pas. Mais quelques jours plus tard, comme jerentrais, j’aperçus, sortant de sous la voûte de notremaison, les trois jeunes filles que j’avais suivies auBois. C’était tout à fait, les deux brunes surtout, et unpeu plus âgées seulement, de ces jeunes filles du mondequi souvent, vues de ma fenêtre, ou croisées dans la rue,m’avaient fait faire mille projets, aimer la vie, et que jen’avais pu connaître. La blonde avait un air un peu plusdélicat, presque souffrant, qui me plaisait moins. Ce futpourtant elle qui fut cause que je ne me contentai pas deles considérer un instant, mais, qu’ayant pris racine, je
les contemplai avec ces regards qui, par leur fixitéimpossible à distraire, leur application comme à unproblème, semblent avoir conscience qu’il s’agit d’allerbien au delà de ce qu’on voit. Je les aurais sans doutelaissé disparaître comme tant d’autres si, au moment oùelles passèrent devant moi, la blonde – était-ce parceque je les contemplais avec cette attentioni? – ne m’eûtlancé furtivement un premier regard, puis, m’ayantdépassé et retournant la tête vers moi, un second quiacheva de m’enflammer. Cependant, comme elle cessade s’occuper de moi et se remit à causer avec ses amies,mon ardeur eût sans doute fini par tomber si elle n’avaitété centuplée par le fait suivant. Ayant demandé auconcierge qui elles étaient.: « Elles ont demandé M me laDuchesse, me dit-il. Je crois qu’il n’y en a qu’une qui laconnaisse et que les autres l’avaient seulementaccompagnée jusqu’à la porte. Voici le nom, je ne saispas si j’ai bien écrit. » Et je lus.: M lle Déporcheville,que je rétablis aisément.: d’Éporcheville, c’est-à-dire lenom ou à peu près, autant que je me souvenais, de lajeune fille d’excellente famille et apparentée vaguementaux Guermantes dont Robert m’avait parlé pour l’avoirrencontrée dans une maison de passe et avec laquelle ilavait eu des relations. Je comprenais maintenant lasignification de son regard, pourquoi elle s’étaitretournée et cachée de ses compagnes. Que de foisj’avais pensé à elle, me l’imaginant d’après le nom que
m’avait dit Robert. Et voici que je venais de la voir,nullement différente de ses amies, sauf par ce regarddissimulé qui ménageait entre moi et elle une entréesecrète dans des parties de sa vie qui, évidemment,étaient cachées à ses amies, et qui me la faisaientparaître plus accessible – presque à demi mienne – plusdouce que ne sont d’habitude les jeunes filles del’aristocratie. Dans l’esprit de celle-ci, entre elle et moiil y avait d’avance de commun les heures que nousaurions pu passer ensemble si elle avait la liberté de medonner un rendez-vous. N’était-ce pas ce que sonregard avait voulu m’exprimer avec une éloquence quine fut claire que pour moii? Mon cœur battait de toutesses forces, je n’aurais pas pu dire exactement commentétait faite M lle d’Éporcheville, je revoyais vaguement unblond visage aperçu de côté, mais j’étais amoureux foud’elle. Tout d’un coup je m’avisai que je raisonnaiscomme si, entre les trois, M lle d’Éporcheville étaitprécisément la blonde qui s’était retournée et m’avaitregardée deux fois. Or le concierge ne me l’avait pasdit. Je revins à sa loge, l’interrogeai à nouveau, il me ditqu’il ne pouvait me renseigner là-dessus, mais qu’ilallait le demander à sa femme qui les avait déjà vuesune autre fois. Elle était en train de faire l’escalier deservice. Qui n’a eu, au cours de sa vie, de cesincertitudes plus ou moins semblables à celles-là, etdélicieusesi? Un ami charitable à qui on a décrit une
jeune fille qu’on a vue au bal en conclut qu’elle devaitêtre une de ses amies et vous invite avec elle. Mais,entre tant d’autres et sur un simple portrait parlé, n’yaura-t-ilpas eu d’erreur commisei? La jeune fille quevous allez voir tout à l’heure ne sera-t-elle pas une autreque celle que vous désirezi? Ou au contraire n’allezvouspas voir vous tendre la main en souriantprécisément celle que vous souhaitiez qu’elle fûti? Cedernier cas, assez fréquent, sans être justifié toujourspar un raisonnement aussi probant que celui quiconcernait M lle d’Éporcheville, résulte d’une sorted’intuition et aussi de ce souffle de chance qui parfoisnous favorise. Alors, en la voyant, nous nous disons.:« C’était bien elle. » Je me rappelle que, dans la petitebande de jeunes filles se promenant au bord de la mer,j’avais deviné juste celle qui s’appelait <strong>Albertine</strong>Simonet. Ce souvenir me causa une douleur aiguë maisbrève, et tandis que le concierge cherchait sa femme, jesongeais surtout – pensant à M lle d’Éporcheville etcomme dans ces minutes d’attente où un nom, unrenseignement qu’on a, on ne sait pourquoi, adapté à unvisage se trouve un instant libre et flotte, prêt, s’iladhère à un nouveau visage, à rendre rétrospectivementle premier sur lequel il vous avait renseigné inconnu,innocent, insaisissable – que la concierge allait peutêtrem’apprendre que M lle d’Éporcheville était aucontraire une des deux brunes. Dans ce cas
s’évanouissait l’être à l’existence duquel je croyais, quej’aimais déjà, que je ne songeais plus qu’à posséder,cette blonde et sournoise M lle d’Éporcheville que lafatale réponse allait alors dissocier en deux élémentsdistincts, que j’avais arbitrairement unis à la façon d’unromancier qui fond ensemble divers élémentsempruntés à la réalité pour créer un personnageimaginaire, et qui, pris chacun à part – le nom necorroborant pas l’intention du regard – perdaient toutesignification. Dans ce cas mes arguments se trouvaientdétruits, mais combien ils se trouvèrent au contrairefortifiés quand le concierge revint me dire que M lled’Éporcheville était bien la blonde.Dès lors je ne pouvais plus croire à une homonymie.Le hasard eût été trop grand que sur ces trois jeunesfilles l’une s’appelât M lle d’Éporcheville, que ce fûtjustement (ce qui était la première vérification typiquede ma supposition) celle qui m’avait regardé de cettefaçon, presque en me souriant, et que ce ne fût pas cellequi allait dans les maisons de passe.Alors commença une journée d’une folle agitation.Avant même de partir acheter tout ce que je croyaispropre à me parer pour produire une meilleureimpression quand j’irais voir M me de Guermantes lesurlendemain, jour où la jeune fille devait, m’avait ditle concierge, revenir voir la duchesse, chez qui jetrouverais ainsi une jeune fille facile et prendrais
endez-vous avec elle (car je trouverais bien le moyende l’entretenir un instant dans un coin du salon), j’allaipour plus de sûreté télégraphier à Robert pour luidemander le nom exact et la description de la jeunefille, espérant avoir sa réponse avant le surlendemain(je ne pensais pas une seconde à autre chose, même pasà <strong>Albertine</strong>), décidé, quoi qu’il pût m’arriver d’ici là,dussé-je m’y faire descendre en chaise à porteur sij’étais malade, à faire une visite prolongée à laduchesse. Si je télégraphiais à Saint-Loup, ce n’est pasqu’il me restât des doutes sur l’identité de la personne,et que la jeune fille vue et celle dont il m’avait parléfussent encore distinctes pour moi. Je ne doutais pasqu’elles n’en fissent qu’une seule. Mais dans monimpatience d’attendre le surlendemain, il m’était doux,c’était déjà pour moi comme un pouvoir secret sur elle,de recevoir une dépêche la concernant, pleine dedétails. Au télégraphe, tout en rédigeant ma dépêcheavec l’animation de l’homme qu’échauffe l’espérance,je remarquai combien j’étais moins désarmé maintenantque dans mon enfance, et vis-à-vis de M lled’Éporcheville que de Gilberte. À partir du moment oùj’avais pris seulement la peine d’écrire ma dépêche,l’employé n’avait plus qu’à la prendre, les réseaux lesplus rapides de communication électrique à latransmettre à l’étendue de la France et de laMéditerranée, et tout le passé noceur de Robert allait
être appliqué à identifier la personne que je venais derencontrer, se trouver au service du roman que je venaisd’ébaucher et auquel je n’avais même plus besoin depenser, car la réponse allait se charger de le conclureavant que vingt-quatre heures fussent accomplies.Tandis qu’autrefois, ramené des Champs-Élysées parFrançoise, nourrissant seul à la maison d’impuissantsdésirs, ne pouvant user des moyens pratiques de lacivilisation, j’aimais comme un sauvage ou même, carje n’avais pas la liberté de bouger, comme une fleur. Àpartir de ce moment mon temps se passa dans la fièvrei;une absence de quarante-huit heures que mon père medemanda de faire avec lui et qui m’eût fait manquer lavisite chez la duchesse me mit dans une rage et undésespoir tels que ma mère s’interposa et obtint de monpère de me laisser à Paris. Mais pendant plusieursheures ma colère ne put s’apaiser, tandis que mon désirde M lle d’Éporcheville avait été centuplé par l’obstaclequ’on avait mis entre nous, par la crainte que j’avaiseue un instant que ces heures, auxquelles je souriaisd’avance sans trêve, de ma visite chez M me deGuermantes, comme à un bien certain que nul nepourrait m’enlever, n’eussent pas lieu. Certainsphilosophes disent que le monde extérieur n’existe paset que c’est en nous-même que nous développons notrevie. Quoi qu’il en soit, l’amour, même en ses plushumbles commencements, est un exemple frappant du
peu qu’est la réalité pour nous. M’eût-il fallu dessinerde mémoire un portrait de M lle d’Éporcheville, donnersa description, son signalement, cela m’eût étéimpossible. Je l’avais aperçue de profil, bougeante, ellem’avait semblé jolie, simple, grande et blonde, jen’aurais pas pu en dire davantage. Mais toutes lesréactions du désir, de l’anxiété, du coup mortel frappépar la peur de ne pas la voir si mon père m’emmenait,tout cela, associé à une image qu’en somme je neconnaissais pas et dont il suffisait que je la susseagréable, constituait déjà un amour. Enfin le lendemainmatin, après une nuit d’insomnie heureuse, je reçus ladépêche de Saint-Loup.: « de l’Orgeville, de particule,orge la graminée, comme du seigle, ville comme uneville, petite, brune, boulotte, est en ce moment enSuisse. » Ce n’était pas elle,!Un instant avant que Françoise m’apportât ladépêche, ma mère était entrée dans ma chambre avec lecourrier, l’avait posé sur mon lit avec négligence, enayant l’air de penser à autre chose. Et se retirantaussitôt pour me laisser seul, elle avait souri en partant.Et moi, connaissant les ruses de ma chère maman etsachant qu’on pouvait toujours lire dans son visage sanscrainte de se tromper, si l’on prenait comme clef ledésir de faire plaisir aux autres, je souris et pensai.: « Ily a quelque chose d’intéressant pour moi dans lecourrier, et maman a affecté cet air indifférent et distrait
pour que ma surprise soit complète et pour ne pas fairecomme les gens qui vous ôtent la moitié de votre plaisiren vous l’annonçant. Et elle n’est pas restée là parcequ’elle a craint que par amour-propre je dissimule leplaisir que j’aurais et ainsi le ressente moinsvivement. » Cependant, en allant vers la porte poursortir elle avait rencontré Françoise qui entrait chezmoi, la dépêche à la main. Dès qu’elle me l’eut donnée,ma mère avait forcé Françoise à rebrousser chemin etl’avait entraînée dehors, effarouchée, offensée etsurprise. Car Françoise considérait que sa chargecomportait le privilège de pénétrer à toute heure dansma chambre et d’y rester s’il lui plaisait. Mais déjà, surson visage, l’étonnement et la colère avaient disparusous le sourire noirâtre et gluant d’une pitiétranscendante et d’une ironie philosophique, liqueurvisqueuse que sécrétait, pour guérir sa blessure, sonamour-propre lésé. Pour ne pas se sentir méprisée, ellenous méprisait. Aussi bien pensait-elle que nous étionsdes maîtres, c’est-à-dire des êtres capricieux, qui nebrillent pas par l’intelligence et qui trouvent leur plaisirà imposer par la peur à des personnes spirituelles, à desdomestiques, pour bien montrer qu’ils sont les maîtres,des devoirs absurdes comme de faire bouillir l’eau entemps d’épidémie, de balayer ma chambre avec unlinge mouillé, et d’en sortir au moment où on avaitjustement l’intention d’y rester. Maman avait posé le
courrier tout près de moi, pour qu’il ne pût pasm’échapper. Mais je sentis que ce n’était que desjournaux. Sans doute y avait-il quelque article d’unécrivain que j’aimais et qui, écrivant rarement, seraitpour moi une surprise. J’allai à la fenêtre, j’écartai lesrideaux. Au-dessus du jour blême et brumeux, le cielétait tout rose comme, à cette heure, dans les cuisines,les fourneaux qu’on allume, et cette vue me remplitd’espérance et du désir de passer la nuit et de m’éveillerà la petite station campagnarde où j’avais vu la laitièreaux joues roses.Pendant ce temps-là j’entendais Françoise qui,indignée qu’on l’eût chassée de ma chambre où elleconsidérait qu’elle avait ses grandes entrées,grommelait.: « Si c’est pas malheureux, un enfant qu’ona vu naître. Je ne l’ai pas vu quand sa mère le faisait,bien sûr. Mais quand je l’ai connu, pour bien dire, il n’yavait pas cinq ans qu’il était naquis,! »J’ouvris le Figaro. Quel ennui,! Justement lepremier article avait le même titre que celui que j’avaisenvoyé et qui n’avait pas paru, mais pas seulement lemême titre, ... voici quelques mots absolument pareils.Cela, c’était trop fort. J’enverrais une protestation. Maisce n’étaient pas que quelques mots, c’était tout, c’étaitma signature. C’était mon article qui avait enfin paru,!Mais ma pensée qui, déjà à cette époque, avaitcommencé à vieillir et à se fatiguer un peu, continua un
instant encore à raisonner comme si elle n’avait pascompris que c’était mon article, comme ces vieillardsqui sont obligés de terminer jusqu’au bout unmouvement commencé, même s’il est devenu inutile,même si un obstacle imprévu devant lequel il faudraitse retirer immédiatement, le rend dangereux. Puis jeconsidérai le pain spirituel qu’est un journal encorechaud et humide de la presse récente dans le brouillarddu matin où on le distribue, dès l’aurore, aux bonnesqui l’apportent à leur maître avec le café au lait, painmiraculeux, multipliable, qui est à la fois un et dixmille, qui reste le même pour chacun tout en pénétrantinnombrable, à la fois dans toutes les maisons.Ce que je tenais en main, ce n’est pas un certainexemplaire du journal, c’est l’un quelconque des dixmillei; ce n’est pas seulement ce qui a été écrit pourmoi, c’est ce qui a été écrit pour moi et pour tous. Pourapprécier exactement le phénomène qui se produit en cemoment dans les autres maisons, il faut que je lise cetarticle non en auteur, mais comme un des autreslecteurs du journal. Car ce que je tenais en main n’étaitpas seulement ce que j’avais écrit, mais était le symbolede l’incarnation dans tant d’esprits. Aussi pour le lire,fallait-il que je cessasse un moment d’en être l’auteur,que je fusse l’un quelconque des lecteurs du Figaro.Mais d’abord une première inquiétude. Le lecteur nonprévenu verrait-il cet articlei? Je déplie distraitement le
journal comme ferait ce lecteur non prévenu, ayantmême sur ma figure l’air d’ignorer ce qu’il y a ce matindans mon journal et d’avoir hâte de regarder lesnouvelles mondaines et la politique. Mais mon articleest si long que mon regard, qui l’évite (pour rester dansla vérité et ne pas mettre la chance de mon côté, commequelqu’un qui attend compte trop lentement exprès), enaccroche un morceau au passage. Mais beaucoup deceux qui aperçoivent le premier article et même qui lelisent ne regardent pas la signaturei; moi-même je seraisbien incapable de dire de qui était le premier article dela veille. Et je me promets maintenant de les liretoujours et le nom de leur auteur, mais comme unamant jaloux qui ne trompe pas sa maîtresse pour croireà sa fidélité, je songe tristement que mon attentionfuture ne forcera pas en retour celle des autres. Et puisil y a ceux qui vont partir pour la chasse, ceux qui sontsortis brusquement de chez eux. Enfin, quelques-unstout de même le liront. Je fais comme ceux-là, jecommence. J’ai beau savoir que bien des gens qui lirontcet article le trouveront détestable, au moment où je lisce que je vois dans chaque mot me semble être sur lepapier, je ne peux pas croire que chaque personne enouvrant les yeux ne verra pas directement les imagesque je vois, croyant que la pensée de l’auteur estdirectement perçue par le lecteur, tandis que c’est uneautre pensée qui se fabrique dans son esprit, avec la
même naïveté que ceux qui croient que c’est la parolemême qu’on a prononcée qui chemine telle quelle lelong des fils du téléphonei; au moment même où jeveux être un lecteur, mon esprit refait en auteur letravail de ceux qui liront mon article. Si M. deGuermantes ne comprenait pas telle phrase que Blochaimerait, en revanche il pourrait s’amuser de telleréflexion que Bloch dédaignerait. Ainsi pour chaquepartie que le lecteur précédent semblait délaisser, unnouvel amateur se présentant, l’ensemble de l’article setrouvait élevé aux nues par une foule et s’imposait ainsià ma propre défiance de moi-même qui n’avais plusbesoin de le détruire. C’est qu’en réalité, il en est de lavaleur d’un article, si remarquable qu’il puisse être,comme de ces phrases des comptes rendus de laChambre où les mots « Nous verrons bien », prononcéspar le ministre, ne prennent toute leur importancequ’encadrés ainsi.: LE PRÉSIDENT DU CONSEIL,MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DES CULTES.: « Nousverrons bien. » (Vives exclamations à l’extrême-gauche.Très bien,! sur quelques bancs à gauche et au centre ) –la plus grande partie de leur beauté réside dans l’espritdes lecteurs. Et c’est la tare originelle de ce genre delittérature, dont ne sont pas exceptés les célèbresLundis, que leur valeur réside dans l’impression qu’elleproduit sur les lecteurs. C’est une Vénus collective,dont on n’a qu’un membre mutilé si l’on s’en tient à la
pensée de l’auteur, car elle ne se réalise complète quedans l’esprit de ses lecteurs. En eux elle s’achève. Etcomme une foule, fût-elle une élite, n’est pas artiste, cecachet dernier qu’elle lui donne garde toujours quelquechose d’un peu commun. Ainsi Sainte-Beuve, le lundi,pouvait se représenter M me de Boigne dans son lit à huitcolonnes lisant son article du Constitutionnel,appréciant telle jolie pensée dans laquelle il s’étaitlongtemps complu et qui ne serait peut-être jamaissortie de lui s’il n’avait jugé à propos d’en bourrer sonfeuilleton pour que le coup en portât plus loin. Sansdoute le chancelier, le lisant de son côté, en parlerait àsa vieille amie dans la visite qu’il lui ferait un peu plustard. Et en l’emmenant ce soir dans sa voiture, le duc deNoailles en pantalon gris lui dirait ce qu’on en avaitpensé dans la société, si un mot de M me d’Herbouvillene le lui avait déjà appris.Je voyais ainsi à cette même heure, pour tant degens, ma pensée, ou même à défaut de ma pensée pourceux qui ne pouvaient la comprendre, la répétition demon nom et comme une évocation embellie de mapersonne, briller sur eux, en une aurore qui meremplissait de plus de force et de joie triomphante quel’aurore innombrable qui en même temps se montraitrose à toutes les fenêtres.Je voyais Bloch, M. de Guermantes, Legrandin, tirerchacun à son tour de chaque phrase les images qu’il y
enfermei; au moment même où j’essaie d’être unlecteur quelconque, je lis en auteur, mais pas en auteurseulement. Pour que l’être impossible que j’essaied’être réunisse tous les contraires qui peuvent m’être leplus favorables, si je lis en auteur je me juge en lecteur,sans aucune des exigences que peut avoir pour un écritcelui qui y confronte l’idéal qu’il a voulu y exprimer.Ces phrases de mon article, lorsque je les écrivis,étaient si pâles auprès de ma pensée, si compliquées etopaques auprès de ma vision harmonieuse ettransparente, si pleines de lacunes que je n’étais pasarrivé à remplir, que leur lecture était pour moi unesouffrance, elles n’avaient fait qu’accentuer en moi lesentiment de mon impuissance et de mon manqueincurable de talent. Mais maintenant, en m’efforçantd’être lecteur, si je me déchargeais sur les autres dudevoir douloureux de me juger, je réussissais du moinsà faire table rase de ce que j’avais voulu faire en lisantce que j’avais fait. Je lisais l’article en m’efforçant deme persuader qu’il était d’un autre. Alors toutes mesimages, toutes mes réflexions, toutes mes épithètesprises en elles-mêmes et sans le souvenir de l’échecqu’elles représentaient pour mes visées, me charmaientpar leur éclat, leur ampleur, leur profondeur. Et quandje sentais une défaillance trop grande, me réfugiantdans l’âme du lecteur quelconque émerveillé, je medisais.: « Bah,! comment un lecteur peut-il s’apercevoir
de celai? Il manque quelque chose là, c’est possible.Mais, sapristi, s’ils ne sont pas contents,! Il y a assez dejolies choses comme cela, plus qu’ils n’en ontd’habitude. » Et m’appuyant sur ces dix milleapprobations qui me soutenaient, je puisais autant desentiment de ma force et d’espoir de talent dans lalecture que je faisais à ce moment que j’y avais puisé dedéfiance quand ce que j’avais écrit ne s’adressait qu’àÀ peine eus-je fini cette lecture réconfortante, quemoi, qui n’avais pas eu le courage de relire monimmédiatement, car il n’y a rien comme un vieil articlede soi dont on puisse dire que « quand on l’a lu on peutle relire ». Je me promis d’en faire acheter d’autresexemplaires par Françoise, pour donner à des amis, luidirais-je, en réalité pour toucher du doigt le miracle dela multiplication de ma pensée, et lire, comme si j’étaisun autre Monsieur qui vient d’ouvrir le Figaro, dans unautre numéro les mêmes phrases. Il y avait justement untemps infini que je n’avais vu les Guermantes, je devaisleur faire, le lendemain, cette visite que j’avais projetéed’Éporcheville, lorsque je télégraphiais à Saint-Loup. Jeme rendrais compte par eux de l’opinion qu’on avait demon article. Je pensais à telle lectrice dans la chambrede qui j’eusse tant aimé pénétrer et à qui le journalmoi.manuscrit, je souhaitai de la recommenceravec tant d’agitation afin de rencontrer M lle
apporterait sinon ma pensée, qu’elle ne pourraitcomprendre, du moins mon nom, comme une louangede moi. Mais les louanges décernées à ce qu’on n’aimepas n’enchantent pas plus le cœur que les pensées d’unesprit qu’on ne peut pénétrer n’atteignent l’esprit. Pourd’autres amis, je me disais que, si l’état de ma santécontinuait à s’aggraver et si je ne pouvais plus les voir,il serait agréable de continuer à écrire pour avoir encorepar là accès auprès d’eux, pour leur parler entre leslignes, les faire penser à mon gré, leur plaire, être reçudans leur cœur. Je me disais cela parce que, les relationsmondaines ayant eu jusqu’ici une place dans ma viequotidienne, un avenir où elles ne figureraient plusm’effrayait, et que cet expédient qui me permettrait deretenir sur moi l’attention de mes amis, peut-êtred’exciter leur admiration, jusqu’au jour où je seraisassez bien pour recommencer à les voir, me consolait.Je me disais cela, mais je sentais bien que ce n’était pasvrai, que si j’aimais à me figurer leur attention commel’objet de mon plaisir, ce plaisir était un plaisirintérieur, spirituel, ultime, qu’eux ne pouvaient medonner et que je pouvais trouver non en causant aveceux, mais en écrivant loin d’eux, et que, si jecommençais à écrire pour les voir indirectement, pourqu’ils eussent une meilleure idée de moi, pour mepréparer une meilleure situation dans le monde, peutêtreécrire m’ôterait l’envie de les voir, et que la
situation que la littérature m’aurait peut-être faite dansle monde, je n’aurais plus envie d’en jouir, car monplaisir ne serait plus dans le monde mais dans lalittérature.Après le déjeuner, quand j’allai chez M me deGuermantes, ce fut moins pour M lle d’Éporcheville, quiavait perdu, du fait de la dépêche de Saint-Loup, lemeilleur de sa personnalité, que pour voir en laduchesse elle-même une de ces lectrices de mon articlequi pourraient me permettre d’imaginer ce qu’avait pupenser le public – abonnés et acheteurs – du Figaro. Cen’est pas, du reste, sans plaisir que j’allais chez M me deGuermantes. J’avais beau me dire que ce quidifférenciait pour moi ce salon des autres, c’était le longstage qu’il avait fait dans mon imagination, enconnaissant les causes de cette différence je nel’abolissais pas. Il existait, d’ailleurs, pour moiplusieurs noms de Guermantes. Si celui que mamémoire n’avait inscrit que comme dans un livred’adresses ne s’accompagnait d’aucune poésie, de plusanciens, ceux qui remontaient au temps où je neconnaissais pas M me de Guermantes, étaientsusceptibles de se reformer en moi, surtout quand il yavait longtemps que je ne l’avais vue et que la clartécrue de la personne au visage humain n’éteignait pas lesrayons mystérieux du nom. Alors de nouveau je meremettais à penser à la demeure de M me de Guermantes
comme à quelque chose qui eût été au delà du réel, dela même façon que je me remettais à penser au Balbecbrumeux de mes premiers rêves et, comme si depuis jen’avais pas fait ce voyage, au train de une heurecinquante comme si je ne l’avais pas pris. J’oubliais uninstant la connaissance que j’avais que tout celan’existait pas, comme on pense quelquefois à un êtreaimé en oubliant pendant un instant qu’il est mort. Puisl’idée de la réalité revint en entrant dans l’antichambrede la duchesse. Mais je me consolai en me disantqu’elle était malgré tout pour moi le véritable pointd’intersection entre la réalité et le rêve.En entrant dans le salon, je vis la jeune fille blondeque j’avais crue pendant vingt-quatre heures être celledont Saint-Loup m’avait parlé. Ce fut elle-même quidemanda à la duchesse de me « représenter » à elle. Eten effet, depuis que j’étais rentré, j’avais uneimpression de très bien la connaître, mais que dissipa laduchesse en me disant.: « Ah,! vous avez déjà rencontréM lle de Forchevillei? » Or, au contraire, j’étais certainde n’avoir jamais été présenté à aucune jeune fille de cenom, lequel m’eût certainement frappé, tant il étaitfamilier à ma mémoire depuis qu’on m’avait fait unrécit rétrospectif des amours d’Odette et de la jalousiede Swann. En soi ma double erreur de nom, de m’êtrerappelé de l’Orgeville comme étant d’Éporcheville etd’avoir reconstitué en Éporcheville ce qui était en
éalité Forcheville, n’avait rien d’extraordinaire. Notretort est de croire que les choses se présententhabituellement telles qu’elles sont en réalité, les nomstels qu’ils sont écrits, les gens tels que la photographieet la psychologie donnent d’eux une notion immobile.En fait ce n’est pas du tout cela que nous percevonsd’habitude. Nous voyons, nous entendons, nousconcevons le monde tout de travers. Nous répétons unnom tel que nous l’avons entendu jusqu’à ce quel’expérience ait rectifié notre erreur, ce qui n’arrive pastoujours. Tout le monde à Combray parla pendantvingt-cinq ans à Françoise de M me Sazerat et Françoisecontinua à dire M me Sazerin, non par cette volontaire etorgueilleuse persévérance dans ses erreurs qui étaithabituelle chez elle, se renforçait de notre contradictionet était tout ce qu’elle avait ajouté chez elle à la Francede Saint-André-des-Champs (des principes égalitairesde 1789 elle ne réclamait qu’un droit du citoyen, celuide ne pas prononcer comme nous et de maintenirqu’hôtel, été et air étaient du genre féminin), mais parcequ’en réalité elle continua toujours d’entendre Sazerin.Cette perpétuelle erreur, qui est précisément la « vie »,ne donne pas ses mille formes seulement à l’universvisible et à l’univers audible, mais à l’univers social, àl’univers sentimental, à l’univers historique, etc. Laprincesse de Luxembourg n’a qu’une situation decocotte pour la femme du Premier Président, ce qui, du
este, est de peu de conséquencei; ce qui en a un peuplus, Odette est une femme difficile pour Swann, d’oùil bâtit tout un roman qui ne devient que plusdouloureux quand il comprend son erreuri; ce qui en aencore davantage, les Français ne rêvent que larevanche aux yeux des Allemands. Nous n’avons del’univers que des visions informes, fragmentées et quenous complétons par des associations d’idéesarbitraires, créatrice de dangereuses suggestions. Jen’aurais donc pas eu lieu d’être étonné en entendant lenom de Forcheville (et déjà je me demandais si c’étaitune parente du Forcheville dont j’avais tant entenduparler) si la jeune fille blonde ne m’avait dit aussitôt,désireuse sans doute de prévenir avec tact des questionsqui lui eussent été désagréables.: « Vous ne voussouvenez pas que vous m’avez beaucoup connueautrefois, ... vous veniez à la maison, ... votre amieGilberte. J’ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas.Moi je vous ai bien reconnu tout de suite. » (Elle ditcela comme si elle m’avait reconnu tout de suite dans lesalon, mais la vérité est qu’elle m’avait reconnu dans larue et m’avait dit bonjour, et plus tard M me deGuermantes me dit qu’elle lui avait raconté comme unechose très drôle et extraordinaire que je l’avais suivie etfrôlée, la prenant pour une cocotte.) Je ne sus qu’aprèsson départ pourquoi elle s’appelait M lle de Forcheville.Après la mort de Swann, Odette, qui étonna tout le
monde par une douleur profonde, prolongée et sincère,se trouvait être une veuve très riche. Forchevillel’épousa, après avoir entrepris une longue tournée dechâteaux et s’être assuré que sa famille recevrait safemme. (Cette famille fit quelques difficultés, maiscéda devant l’intérêt de ne plus avoir à subvenir auxdépenses d’un parent besogneux qui allait passer d’unequasi-misère à l’opulence.) Peu après, un oncle deSwann, sur la tête duquel la disparition successive denombreux parents avait accumulé un énorme héritage,mourut, laissant toute cette fortune à Gilberte quidevenait ainsi une des plus riches héritières de France.Mais c’était le moment où des suites de l’affaireDreyfus était né un mouvement antisémite parallèle àun mouvement plus abondant de pénétration du mondepar les Israélites. Les politiciens n’avaient pas eu tort enpensant que la découverte de l’erreur judiciaire porteraitun coup à l’antisémitisme. Mais, provisoirement aumoins, un antisémitisme mondain s’en trouvait aucontraire accru et exaspéré. Forcheville, qui, comme lemoindre noble, avait puisé dans des conversations defamille la certitude que son nom était plus ancien quecelui de La Rochefoucauld, considérait qu’en épousantla veuve d’un juif il avait accompli le même acte decharité qu’un millionnaire qui ramasse une prostituéedans la rue et la tire de la misère et de la fangei; il étaitprêt à étendre sa bonté jusqu’à la personne de Gilberte
dont tant de millions aideraient, mais dont cet absurdenom de Swann gênerait le mariage. Il déclara qu’ill’adoptait. On sait que M me de Guermantes, àl’étonnement – qu’elle avait d’ailleurs le goût etl’habitude de provoquer – de sa société, s’était, quandSwann s’était marié, refusée à recevoir sa fille aussibien que sa femme. Ce refus avait été en apparenced’autant plus cruel que ce qu’avait pendant longtempsreprésenté à Swann son mariage possible avec Odette,c’était la présentation de sa fille à M me de Guermantes.Et sans doute il eût dû savoir, lui qui avait déjà tantvécu, que ces tableaux qu’on se fait ne se réalisentjamais pour différentes raisons. Parmi celles-là il en estune qui fit qu’il pensa peu à regretter cette présentation.Cette raison est que, quelle que soit l’image, depuis latruite à manger au coucher du soleil qui décide unhomme sédentaire à prendre le train, jusqu’au désir depouvoir étonner un soir une orgueilleuse caissière ens’arrêtant devant elle en somptueux équipage, quidécide un homme sans scrupules à commettre unassassinat ou à souhaiter la mort et l’héritage des siens,selon qu’il est plus brave ou plus paresseux, qu’il vaplus loin dans la suite de ses idées ou reste à en caresserle premier chaînon, l’acte qui est destiné à nouspermettre d’atteindre l’image, que cet acte soit levoyage, le mariage, le crime, ... cet acte nous modifieassez profondément pour que nous n’attachions plus
d’importance à la raison qui nous a fait l’accomplir. Ilse peut même que ne vienne plus une seule fois à sonesprit l’image que se formait celui qui n’était pasencore un voyageur, ou un mari, ou un criminel, ou unisolé (qui s’est mis au travail pour la gloire et s’est dumême coup détaché du désir de la gloire). D’ailleurs,missions-nous de l’obstination à ne pas avoir voulu agiren vain, il est probable que l’effet de soleil ne seretrouverait pasi; qu’ayant froid à ce moment-là, noussouhaiterions un potage au coin du feu et non une truiteen plein airi; que notre équipage laisserait indifférentela caissière qui peut-être avait, pour des raisons toutautres, une grande considération pour nous et dont cettebrusque richesse exciterait la méfiance. Bref nous avonsvu Swann marié attacher surtout de l’importance auxrelations de sa femme et de sa fille avec M me Bontemps.À toutes les raisons, tirées de la façon Guermantesde comprendre la vie mondaine, qui avaient décidé laduchesse à ne jamais se laisser présenter M me et M lleSwann, on peut ajouter aussi cette assurance heureuseavec laquelle les gens qui n’aiment pas se tiennent àl’écart de ce qu’ils blâment chez les amoureux et quel’amour de ceux-ci explique. « Oh,! je ne me mêle pas àtout çai; si ça amuse le pauvre Swann de faire desbêtises et de ruiner son existence, c’est son affaire, maison ne sait pas avec ces choses-là, tout ça peut très malfinir, je les laisse se débrouiller. » C’est le Suave mari
magno que Swann lui-même me conseillait à l’égarddes Verdurin, quand il avait depuis longtemps cesséd’être amoureux d’Odette et ne tenait plus au petit clan.C’est tout ce qui rend si sages les jugements des tierssur les passions qu’ils n’éprouvent pas et lescomplications de conduite qu’elles entraînent.M me de Guermantes avait même mis à exclure M meet M lle Swann une persévérance qui avait étonné. QuandM me Molé, M me de Marsantes avaient commencé de selier avec M me Swann et de mener chez elle un grandnombre de femmes du monde, non seulement M me deGuermantes était restée intraitable, mais elle s’étaitarrangée pour couper les ponts et que sa cousine laprincesse de Guermantes l’imitât. Un des jours les plusgraves de la crise où, pendant le ministère Rouvier, oncrut qu’il allait y avoir la guerre entre la France etl’Allemagne, comme je dînais seul chez M me deGuermantes avec M. de Bréauté, j’avais trouvé à laduchesse l’air soucieux. J’avais cru, comme elle semêlait volontiers de politique, qu’elle voulait montrerpar là sa crainte de la guerre, comme un jour où elleétait venue à table si soucieuse, répondant à peine parmonosyllabesi; à quelqu’un qui l’interrogeaittimidement sur l’objet de son souci elle avait répondud’un air grave.: « La Chine m’inquiète. » Or, au boutd’un moment, M me de Guermantes, expliquant ellemêmel’air soucieux que j’avais attribué à la crainte
d’une déclaration de guerre, avait dit à M. de Bréauté.:« On dit que M me Aynard veut faire une position auxSwann. Il faut absolument que j’aille demain matin voirMarie-Gilbert pour qu’elle m’aide à empêcher ça. Sanscela il n’y a plus de société. C’est très joli l’affaireDreyfus. Mais alors l’épicière du coin n’a qu’à se direnationaliste et à vouloir en échange être reçue cheznous. » Et j’avais eu de ce propos, si frivole auprès decelui que j’attendais, l’étonnement du lecteur qui,cherchant dans le Figaro, à la place habituelle, lesdernières nouvelles de la guerre russo-japonaise, tombeau lieu de cela sur la liste des personnes qui ont fait descadeaux de noce à M lle de Mortemart, l’importanced’un mariage aristocratique ayant fait reculer à la fin dujournal les batailles sur terre et sur mer. La duchessefinissait d’ailleurs par éprouver de sa persévérancepoursuivie au delà de toute mesure une satisfactiond’orgueil qu’elle ne manquait pas une occasiond’exprimer. « Bébel, disait-elle, prétend que noussommes les deux personnes les plus élégantes de Paris,parce qu’il n’y a que moi et lui qui ne nous laissions passaluer par M me et M lle Swann. Or il assure quel’élégance est de ne pas connaître M me Swann. » Et laduchesse riait de tout son cœur.Cependant, quand Swann fut mort, il arriva que ladécision de ne pas recevoir sa fille avait fini de donnerà M me de Guermantes toutes les satisfactions d’orgueil,
d’indépendance, de self-government, de persécutionqu’elle était susceptible d’en tirer et auxquelles avaitmis fin la disparition de l’être qui lui donnait lasensation délicieuse qu’elle lui résistait, qu’il neparvenait pas à lui faire rapporter ses décrets.Alors la duchesse avait passé à la promulgationd’autres décrets qui, s’appliquant à des vivants, pussentlui faire sentir qu’elle était maîtresse de faire ce qui bonlui semblait. Elle ne pensait pas à la petite Swann, maisquand on lui parlait d’elle la duchesse ressentait unecuriosité, comme d’un endroit nouveau, que ne venaitplus lui masquer à elle-même le désir de résister à laprétention de Swann. D’ailleurs, tant de sentimentsdifférents peuvent contribuer à en former un seul qu’onne saurait pas dire s’il n’y avait pas quelque chosed’affectueux pour Swann dans cet intérêt. Sans doute –car à tous les étages de la société une vie mondaine etfrivole paralyse la sensibilité et ôte le pouvoir deressusciter les morts – la duchesse était de celles qui ontbesoin de la présence – de cette présence qu’en vraieGuermantes elle excellait à prolonger – pour aimervraiment, mais aussi, chose plus rare, pour détester unpeu. De sorte que souvent ses bons sentiments pour lesgens, suspendus de leur vivant par l’irritation que telsou tels de leurs actes lui causaient, renaissaient aprèsleur mort. Elle avait presque alors un désir deréparation, parce qu’elle ne les imaginait plus – très
vaguement d’ailleurs – qu’avec leurs qualités etdépourvus des petites satisfactions, des petitesprétentions qui l’agaçaient en eux quand ils vivaient.Cela donnait parfois, malgré la frivolité de M me deGuermantes, quelque chose d’assez noble – mêlé àbeaucoup de bassesse – à sa conduite. Tandis que lestrois quarts des humains flattent les vivants et netiennent plus aucun compte des morts, elle faisaitsouvent après leur mort ce qu’auraient désiré ceuxqu’elle avait mal traités, vivants.Quant à Gilberte, toutes les personnes qui l’aimaientet avaient un peu d’amour-propre pour elle n’eussent puse réjouir du changement de dispositions de la duchesseà son égard qu’en pensant que Gilberte, en repoussantdédaigneusement des avances qui venaient après vingtcinqans d’outrages, dût enfin venger ceux-ci.Malheureusement, les réflexes moraux ne sont pastoujours identiques à ce que le bon sens imagine. Telqui par une injure mal à propos a cru perdre à toutjamais ses ambitions auprès d’une personne à qui iltient les sauve au contraire par là. Gilberte, assezindifférente aux personnes qui étaient aimables pourelle, ne cessait de penser avec admiration à l’insolenteM me de Guermantes, à se demander les raisons de cetteinsolencei; même une fois, ce qui eût fait mourir dehonte pour elle tous les gens qui lui témoignaient unpeu d’amitié, elle avait voulu écrire à la duchesse pour
lui demander ce qu’elle avait contre une jeune fille quine lui avait rien fait. Les Guermantes avaient pris à sesyeux des proportions que leur noblesse eût étéimpuissante à leur donner. Elle les mettait au-dessusnon seulement de toute la noblesse, mais même detoutes les familles royales.D’anciennes amies de Swann s’occupaient beaucoupde Gilberte. Quand on apprit dans l’aristocratie ledernier héritage qu’elle venait de faire, on commença àremarquer combien elle était bien élevée et quellefemme charmante elle ferait. On prétendait qu’unecousine de M me de Guermantes, la princesse de Nièvre,pensait à Gilberte pour son fils. M me de Guermantesdétestait M me de Nièvre. Elle dit qu’un tel mariageserait un scandale. M me de Nièvre effrayée assuraqu’elle n’y avait jamais pensé. Un jour, après déjeuner,comme il faisait beau et que M. de Guermantes devaitsortir avec sa femme, M me de Guermantes arrangeaitson chapeau dans la glace, ses yeux bleus se regardaienteux-mêmes et regardaient ses cheveux encore blonds, lafemme de chambre tenait à la main diverses ombrellesentre lesquelles sa maîtresse choisirait. Le soleil entraità flots par la fenêtre et ils avaient décidé de profiter dela belle journée pour aller faire une visite à Saint-Cloud,et M. de Guermantes tout prêt, en gants gris perle et letube sur la tête, se disait.: « Oriane est vraiment encoreétonnante. Je la trouve délicieuse », et voyant que sa
femme avait l’air bien disposée.: « À propos, dit-il,j’avais une commission à vous faire de M me de Virelef.Elle voulait vous demander de venir lundi à l’Opéra,mais comme elle a la petite Swann, elle n’osait pas etm’a prié de tâter le terrain. Je n’émets aucun avis, jevous transmets tout simplement. Mon Dieu, il mesemble que nous pourrions... », ajouta-t-il évasivement,car leur disposition à l’égard d’une personne étant unedisposition collective et naissant identique en chacund’eux, il savait par lui-même que l’hostilité de safemme à l’égard de M lle Swann était tombée et qu’elleétait curieuse de la connaître. M me de Guermantesacheva d’arranger son voile et choisit une ombrelle.« Mais comme vous voudrez, que voulez-vous que çame fassei? Je ne vois aucun inconvénient à ce que nousconnaissions cette petite. Vous savez bien que je n’aijamais rien eu contre elle. Simplement je ne voulais pasque nous ayons l’air de recevoir les faux ménages demes amis. Voilà tout. – Et vous aviez parfaitementraison, répondit le duc. Vous êtes la sagesse même,Madame, et vous êtes, de plus, ravissante avec cechapeau. – Vous êtes fort aimable », dit M me deGuermantes en souriant à son mari et en se dirigeantvers la porte. Mais avant de monter en voiture, elle tintà lui donner encore quelques explications.:« Maintenant il y a beaucoup de gens qui voient lamère, d’ailleurs elle a le bon esprit d’être malade les
trois quarts de l’année... Il paraît que la petite est trèsgentille. Tout le monde sait que nous aimions beaucoupSwann. On trouvera cela tout naturel », et ils partirentensemble pour Saint-Cloud.Un mois après, la petite Swann, qui ne s’appelait pasencore Forcheville, déjeunait chez les Guermantes. Onparla de mille chosesi; à la fin du déjeuner, Gilberte dittimidement.: « Je crois que vous avez très bien connumon père. – Mais je crois bien », dit M me deGuermantes sur un ton mélancolique qui prouvaitqu’elle comprenait le chagrin de la fille et avec unexcès d’intensité voulu qui lui donnait l’air dedissimuler qu’elle n’était pas sûre de se rappeler trèsexactement le père. « Nous l’avons très bien connu, jeme le rappelle très bien. » (Et elle pouvait se le rappeleren effet, il était venu la voir presque tous les jourspendant vingt-cinq ans.) « Je sais très bien qui c’était, jevais vous dire, ajouta-t-elle comme si elle avait vouluexpliquer à la fille qui elle avait eu pour père et donnerà cette jeune fille des renseignements sur lui, c’était ungrand ami à ma belle-mère et aussi il était très lié avecmon beau-frère Palamède. – Il venait aussi ici, ildéjeunait même ici, ajouta M. de Guermantes parostentation de modestie et scrupule d’exactitude. Vousvous rappelez, Oriane. Quel brave homme que votrepère,! Comme on sentait qu’il devait être d’une famillehonnête,! Du reste j’ai aperçu autrefois son père et sa
mère. Eux et lui, quelles bonnes gens,! »On sentait que s’ils avaient été, les parents et le fils,encore en vie, le duc de Guermantes n’eût pas eud’hésitation à les recommander pour une place dejardiniers,! Et voilà comment le faubourg Saint-Germain parle à tout bourgeois des autres bourgeois,soit pour le flatter de l’exception faite – le temps qu’oncause – en faveur de l’interlocuteur ou del’interlocutrice, soit plutôt, et en même temps, pourl’humilier. C’est ainsi qu’un antisémite dit à un Juif,dans le moment même où il le couvre de son affabilité,du mal des Juifs, d’une façon générale qui permetted’être blessant sans être grossier.Mais sachant vraiment vous combler quand ellevous voyait, ne pouvant alors se résoudre à vous laisserpartir, M me de Guermantes était aussi l’esclave de cebesoin de la présence. Swann avait pu parfois, dansl’ivresse de la conversation, donner à la duchessel’illusion qu’elle avait de l’amitié pour lui, il ne lepouvait plus. « Il était charmant », dit la duchesse avecun sourire triste en posant sur Gilberte un regard trèsdoux qui, à tout hasard, pour le cas où cette jeune filleserait sensible, lui montrerait qu’elle était comprise etque M me de Guermantes, si elle se fût trouvée seuleavec elle et si les circonstances l’eussent permis, eûtaimé lui dévoiler toute la profondeur de sa sensibilité.Mais M. de Guermantes, soit qu’il pensât précisément
que les circonstances s’opposaient à de telles effusions,soit qu’il considérât que toute exagération de sentimentétait l’affaire des femmes et que les hommes n’avaientpas plus à y voir que dans leurs autres attributions, saufla cuisine et les vins, qu’il s’était réservés, y ayant plusde lumières que la duchesse, crut bien faire de ne pasalimenter, en s’y mêlant, cette conversation qu’ilécoutait avec une visible impatience.Du reste, M me de Guermantes, cet accès desensibilité passé, ajouta avec une frivolité mondaine, ens’adressant à Gilberte.: « Tenez, c’était non seulementun grand ami à mon beau-frère Charlus, mais aussi ilétait très ami avec Voisenon (le château du prince deGuermantes) », comme si le fait de connaître M. deCharlus et le prince avait été pour Swann un hasard,comme si le beau-frère et le cousin de la duchesseavaient été deux hommes avec qui Swann se fût trouvélié dans une certaine circonstance, alors que Swannétait lié avec tous les gens de cette même société, etcomme si M me de Guermantes avait voulu fairecomprendre à Gilberte qui était à peu près son père, lelui « situer » par un de ces traits caractéristiques à l’aidedesquels, quand on veut expliquer comment on setrouve en relations avec quelqu’un qu’on n’aurait pas àconnaître, ou pour singulariser son récit, on invoque leparrainage particulier d’une certaine personne.Quant à Gilberte, elle fut d’autant plus heureuse de
voir tomber la conversation qu’elle ne cherchaitprécisément qu’à en changer, ayant hérité de Swann sontact exquis avec un charme d’intelligence quereconnurent et goûtèrent le duc et la duchesse quidemandèrent à Gilberte de revenir bientôt. D’ailleurs,avec la minutie des gens dont la vie est sans but, tour àtour ils s’apercevaient, chez les gens avec qui ils seliaient, des qualités les plus simples, s’exclamantdevant elles avec l’émerveillement naïf d’un citadin quifait à la campagne la découverte d’un brin d’herbe, ou,au contraire, grossissant comme avec un microscope,commentant sans fin, prenant en grippe les moindresdéfauts, et souvent tour à tour chez une même personne.Pour Gilberte ce furent d’abord ses agréments surlesquels s’exerça la perspicacité oisive de M. et de M mede Guermantes.: « Avez-vous remarqué la manière dontelle dit certains mots, dit après son départ la duchesse àson mari, c’était bien du Swann, je croyais l’entendre. –J’allais faire la même remarque que vous, Oriane. –Elle est spirituelle, c’est tout à fait le tour de son père. –Je trouve qu’elle lui est même très supérieure.Rappelez-vous comme elle a bien raconté cette histoirede bains de mer, elle a un brio que Swann n’avait pas. –Oh,! il était pourtant bien spirituel. – Mais je ne dis pasqu’il n’était pas spirituel. Je dis qu’il n’avait pas debrio », dit M. de Guermantes d’un ton gémissant, car sagoutte le rendait nerveux et, quand il n’avait personne
d’autre à qui témoigner son agacement, c’est à laduchesse qu’il le manifestait. Mais incapable d’en biencomprendre les causes, il préférait prendre un airincompris.Ces bonnes dispositions du duc et de la duchessefirent que dorénavant on eût au besoin dit quelquefois àGilberte un « votre pauvre père » qui ne put, d’ailleurs,servir, Forcheville ayant précisément vers cette époqueadopté la jeune fille. Elle disait.: « mon père » àForcheville, charmait les douairières par sa politesse etsa distinction, et on reconnaissait que, si Forchevilles’était admirablement conduit avec elle, la petite avaitbeaucoup de cœur et savait l’en récompenser. Sansdoute, parce qu’elle pouvait parfois et désirait montrerbeaucoup d’aisance, elle s’était fait reconnaître par moi,et devant moi avait parlé de son véritable père. Maisc’était une exception et on n’osait plus devant elleprononcer le nom de Swann.Justement je venais de remarquer dans le salon deuxdessins d’Elstir qui autrefois étaient relégués dans uncabinet d’en haut où je ne les avais vus que par hasard.Elstir était maintenant à la mode. M me de Guermantesne se consolait pas d’avoir donné tant de tableaux de luià sa cousine, non parce qu’ils étaient à la mode, maisparce qu’elle les goûtait maintenant. La mode est faiteen effet de l’engouement d’un ensemble de gens dontles Guermantes sont représentatifs. Mais elle ne pouvait
songer à acheter d’autres tableaux de lui, car ils étaientmontés depuis quelque temps à des prix follementélevés. Elle voulait au moins avoir quelque chosed’Elstir dans son salon et y avait fait descendre cesdeux dessins qu’elle déclarait « préférer à sa peinture ».Gilberte reconnut cette facture. « On dirait desElstir, dit-elle. – Mais oui, répondit étourdiment laduchesse, c’est précisément vot... ce sont de nos amisqui nous les ont fait acheter. C’est admirable. À monavis, c’est supérieur à sa peinture. » Moi qui n’avais pasentendu ce dialogue, j’allai regarder le dessin. « Tiens,c’est l’Elstir que... » Je vis les signes désespérés de M mede Guermantes. « Ah,! oui, l’Elstir que j’admirais enhaut. Il est bien mieux que dans ce couloir. À proposd’Elstir je l’ai nommé hier dans un article du Figaro.Est-ce que vous l’avez lui? – Vous avez écrit un articledans le Figaroi? s’écria M. de Guermantes avec lamême violence que s’il s’était écrié.: « Mais c’est macousine. » – Oui, hier. – Dans le Figaro, vous êtes sûri?Cela m’étonnerait bien. Car nous avons chacun notreFigaro, et s’il avait échappé à l’un de nous l’autrel’aurait vu. N’est-ce pas, Oriane, il n’y avait rien. » Leduc fit chercher le Figaro et se rendit qu’à l’évidence,comme si, jusque-là, il y eût eu plutôt chance quej’eusse fait erreur sur le journal où j’avais écrit.« Quoii? je ne comprends pas, alors vous avez fait unarticle dans le Figaroi? » me dit la duchesse, faisant
effort pour parler d’une chose qui ne l’intéressait pas.« Mais voyons, Basin, vous lirez cela plus tard. – Maisnon, le duc est très bien comme cela avec sa grandebarbe sur le journal, dit Gilberte. Je vais lire cela tout desuite en rentrant. – Oui, il porte la barbe maintenant quetout le monde est rasé, dit la duchesse, il ne fait jamaisrien comme personne. Quand nous nous sommesmariés, il se rasait non seulement la barbe mais lamoustache. Les paysans qui ne le connaissaient pas necroyaient pas qu’il était français. Il s’appelait à cemoment le prince des Laumes. – Est-ce qu’il y a encoreun prince des Laumesi? » demanda Gilberte qui étaitintéressée par tout ce qui touchait des gens quin’avaient pas voulu lui dire bonjour pendant silongtemps. « Mais non, répondit avec un regardmélancolique et caressant la duchesse. – Un si jolititre,! Un des plus beaux titres français,! » dit Gilberte,un certain ordre de banalités venant inévitablement,comme l’heure sonne, dans la bouche de certainespersonnes intelligentes. « Hé bien oui, je regrette aussi.Basin voudrait que le fils de sa sœur le relevât, mais cen’est pas la même chose, au fond ça pourrait être parceque ce n’est pas forcément le fils aîné, cela peut passerde l’aîné au cadet. Je vous disais que Basin était alorstout raséi; un jour à un pèlerinage, vous rappelez-vous,mon petit, dit-elle à son mari, à ce pèlerinage à Parayle-Monial,mon beau-frère Charlus, qui aime assez
causer avec les paysans, disait à l’un, à l’autre.: « D’oùes-tu, toii? » et comme il est très généreux, il leurdonnait quelque chose, les emmenait boire. Carpersonne n’est à la fois plus simple et plus haut queMémé. Vous le verrez ne pas vouloir saluer uneduchesse qu’il ne trouve pas assez duchesse et comblerun valet de chiens. Alors, je dis à Basin.: « Voyons,Basin, parlez-leur un peu aussi. » Mon mari qui n’estpas toujours très inventif... – Merci, Oriane, dit le ducsans s’interrompre de la lecture de mon article où ilétait plongé – ... avisa un paysan et lui répétatextuellement la question de son frère.: « Et toi, d’où estui?– Je suis des Laumes. – Tu es des Laumesi? Hébien, je suis ton prince. » Alors le paysan regarda lafigure toute glabre de Basin et lui répondit.: « Pas vrai.Vous, vous êtes un english 1 . » On voyait ainsi dans cespetits récits de la duchesse ces grands titres éminents,comme celui de prince des Laumes, surgir à leur placevraie, dans leur état ancien et leur couleur locale,comme dans certains livres d’heures on reconnaît, aumilieu de la foule de l’époque, la flèche de Bourges.On apporta des cartes qu’un valet de pied venait dedéposer. « Je ne sais pas ce qui lui prend, je ne laconnais pas. C’est à vous que je dois ça, Basin. Ça ne1 Anecdote racontée avec une variante par M me de Guermantes ausujet du prince de Léon. Cf. La Prisonnière. (Note du D r Robert Proust.)
vous a pourtant pas si bien réussi ce genre de relations,mon pauvre ami », et se tournant vers Gilberte.: « Je nesaurais même pas vous expliquer qui c’est, vous ne laconnaissez certainement pas, elle s’appelle Lady RufusIsraël. »Gilberte rougit vivement.: « Je ne la connais pas,dit-elle (ce qui était d’autant plus faux que Lady Israëls’était, deux ans avant la mort de Swann, réconciliéeavec lui et qu’elle appelait Gilberte par son prénom),mais je sais très bien, par d’autres, qui est la personneque vous voulez dire. » C’est que Gilberte était devenuetrès snob. C’est ainsi qu’une jeune fille ayant un jour,soit méchamment, soit maladroitement, demandé quelétait le nom de son père, non pas adoptif mais véritable,dans son trouble et pour dénaturer un peu ce qu’elleavait à dire, elle avait prononcé au lieu de Souann,Svann, changement qu’elle s’aperçut un peu après êtrepéjoratif, puisque cela faisait de ce nom d’origineanglaise un nom allemand. Et même elle avait ajouté,s’avilissant pour se rehausser.: « On a raconté beaucoupde choses très différentes sur ma naissance, moi, je doistout ignorer. »« Si honteuse que Gilberte dût être à certainsinstants, en pensant à ses parents (car même M meSwann représentait pour elle et était une bonne mère),d’une pareille façon d’envisager la vie, il fautmalheureusement penser que les éléments en étaient
sans doute empruntés à ses parents car nous ne nousfaisons pas de toutes pièces nous-même. Mais à unecertaine somme d’égoïsme qui existe chez la mère, unégoïsme différent, inhérent à la famille du père, vients’ajouter, ce qui ne veut pas toujours dire s’additionner,ni même justement servir de multiple, mais créer unégoïsme nouveau infiniment plus puissant etredoutable. Et depuis le temps que le monde dure, quedes familles où existe tel défaut sous une forme s’allientà des familles où le même défaut existe sous une autre,ce qui crée une variété particulièrement complexe etdétestable chez l’enfant, les égoïsmes accumulés (pourne parler ici que de l’égoïsme) prendraient unepuissance telle que l’humanité entière serait détruite, sidu mal même ne naissaient, capables de le ramener à dejustes proportions, des restrictions naturelles analoguesà celles qui empêchent la prolifération infinie desinfusoires d’anéantir notre planète, la fécondationunisexuée des plantes d’amener l’extinction du règnevégétal, etc. De temps à autre une vertu vient composeravec cet égoïsme une puissance nouvelle etdésintéressée.Les combinaisons par lesquelles, au cours desgénérations, la chimie morale fixe ainsi et rendinoffensifs les éléments qui devenaient trop redoutablessont infinies et donneraient une passionnante variété àl’histoire des familles. D’ailleurs, avec ces égoïsmes
accumulés, comme il devait y en avoir en Gilberte,coexiste telle vertu charmante des parentsi; elle vient unmoment faire toute seule un intermède, jouer son rôletouchant avec une sincérité complète.Sans doute, Gilberte n’allait pas toujours aussi loinque quand elle insinuait qu’elle était peut-être la fillenaturelle de quelque grand personnage, mais elledissimulait le plus souvent ses origines. Peut-être luiétait-il simplement trop désagréable de les confesser, etpréférait-elle qu’on les apprît par d’autres. Peut-êtrecroyait-elle vraiment les cacher, de cette croyanceincertaine qui n’est pourtant pas le doute, qui réserveune possibilité à ce qu’on souhaite et dont Mussetdonne un exemple quand il parle de l’Espoir en Dieu.« Je ne la connais pas personnellement », repritGilberte. Avait-elle pourtant, en se faisant appeler M llede Forcheville, l’espoir qu’on ignorât qu’elle était lafille de Swanni? Peut-être pour certaines personnesqu’elle espérait devenir, avec le temps, presque tout lemonde. Elle ne devait pas se faire de grandes illusionssur leur nombre actuel, et elle savait sans doute quebien des gens devaient chuchoter.: « C’est la fille deSwann. » Mais elle ne le savait que de cette mêmescience qui nous parle de gens se tuant par misèrependant que nous allons au bal, c’est-à-dire une sciencelointaine et vague, à laquelle nous ne tenons pas àsubstituer une connaissance plus précise, due à une
impression directe. Gilberte appartenait, ou du moinsappartint, pendant ces années-là, à la variété la plusrépandue des autruches humaines, celles qui cachentleur tête dans l’espoir, non de ne pas être vues, cequ’elles croient peu vraisemblable, mais de ne pas voirqu’on les voit, ce qui leur paraît déjà beaucoup et leurpermet de s’en remettre à la chance pour le reste.Comme l’éloignement rend les choses plus petites, plusincertaines, moins dangereuses, Gilberte préférait nepas être près des personnes au moment où celles-cifaisaient la découverte qu’elle était née Swann.Et comme on est près des personnes qu’on sereprésente, comme on peut se représenter les gens lisantleur journal, Gilberte préférait que les journauxl’appelassent M lle de Forcheville. Il est vrai que pour lesécrits dont elle avait elle-même la responsabilité, seslettres, elle ménagea quelque temps la transition ensignant G. S. Forcheville. La véritable hypocrisie danscette signature était manifestée par la suppression bienmoins des autres lettres du nom de Swann que de cellesdu nom de Gilberte. En effet, en réduisant le prénominnocent à un simple G, M lle de Forcheville semblaitinsinuer à ses amis que la même amputation appliquéeau nom de Swann n’était due aussi qu’à des motifsd’abréviation. Même elle donnait une importanceparticulière à l’S, et en faisait une sorte de longue queuequi venait barrer le G, mais qu’on sentait transitoire et
destinée à disparaître comme celle qui, encore longuechez le singe, n’existe plus chez l’homme.Malgré cela, dans son snobisme il y avait del’intelligente curiosité de Swann. Je me souviens quecet après-midi-là elle demanda à M me de Guermantes sielle ne pouvait pas connaître M. du Lau, et la duchesseayant répondu qu’il était souffrant et ne sortait pas,Gilberte demanda comment il était, car, ajouta-t-elle enrougissant légèrement, elle en avait beaucoup entenduparler. (Le marquis du Lau avait été, en effet, un desamis les plus intimes de Swann avant le mariage decelui-ci, et peut-être même Gilberte l’avait-elle entrevu,mais à un moment où elle ne s’intéressait pas à cettesociété.) « Est-ce que M. de Bréauté ou le princed’Agrigente peuvent m’en donner une idéei? demandat-elle.– Oh,! pas du tout », s’écria M me de Guermantes,qui avait un sentiment vif de ces différencesprovinciales et faisait des portraits sobres, mais coloréspar sa voix dorée et rauque, sous le doux fleurissementde ses yeux de violette. « Non, pas du tout. Du Lauc’était le gentilhomme du Périgord, charmant, avectoutes les belles manières et le sans-gêne de saprovince. À Guermantes, quand il y avait le Roid’Angleterre, avec qui du Lau était très ami, il y avaitaprès la chasse un goûter... C’était l’heure où du Lauavait l’habitude d’aller ôter ses bottines et mettre degros chaussons de laine. Hé bien, la présence du Roi
Edouard et de tous les grands-ducs ne le gênait en rien,il descendait dans le grand salon de Guermantes avecses chaussons de laine, il trouvait qu’il était le marquisdu Lau d’Ollemans qui n’avait en rien à se contraindrepour le Roi d’Angleterre. Lui et ce charmantQuasimodo de Breteuil, c’était les deux que j’aimais leplus. C’étaient, du reste, des grands amis à... (elle allaitdire à votre père et s’arrêta net). Non, ça n’a aucunrapport, ni avec Gri-Gri ni avec Bréauté. C’est le vraigrand seigneur du Périgord. Du reste, Mémé cite unepage de Saint-Simon sur un marquis d’Ollemans, c’esttout à fait ça. » Je citai les premiers mots du portrait.:« M. d’Ollemans, qui était un homme fort distinguéparmi la noblesse du Périgord, par la sienne et par sonmérite, et y était considéré par tout ce qui y vivaitcomme un arbitre général à qui chacun avait recourspour sa probité, sa capacité et la douceur de sesmanières, et comme un coq de province... – Oui, il y ade cela, dit M me de Guermantes, d’autant que du Lau atoujours été rouge comme un coq. – Oui, je me rappelleavoir entendu citer ce portrait », dit Gilberte, sansajouter que c’était par son père, lequel était, en effet,grand admirateur de Saint-Simon.Elle aimait aussi parler du prince d’Agrigente et deM. de Bréauté pour une autre raison. Le princed’Agrigente l’était par héritage de la maison d’Aragon,mais sa seigneurie était poitevine. Quant à son château,
celui du moins où il résidait, ce n’était pas un châteaude sa famille mais de la famille d’un premier mari de samère, et il était situé à peu près à égale distance deMartinville et de Guermantes. Aussi Gilberte parlaitellede lui et de M. de Bréauté comme de voisins decampagne qui lui rappelaient sa vieille province.Matériellement, il y avait une part de mensonge dansces paroles, puisque ce n’est qu’à Paris, par la comtesseMolé, qu’elle avait connu M. de Bréauté, d’ailleursvieil ami de son père. Quant au plaisir de parler desenvirons de Tansonville, il pouvait être sincère. Lesnobisme est pour certaines personnes analogue à cesbreuvages agréables auxquels elles mêlent dessubstances utiles. Gilberte s’intéressait à telle femmeélégante parce qu’elle avait de superbes livres et desNattiers que mon ancienne amie n’eût sans doute pasété voir à la Bibliothèque nationale et au Louvre, et jeme figure que, malgré la proximité plus grande encore,l’influence attrayante de Tansonville se fût moinsexercée pour Gilberte sur M me Sazerat ou M me Goupilque sur M. d’Agrigente.« Oh,! pauvre Bébel et pauvre Gri-Gri, dit M me deGuermantes, ils sont bien plus malades que du Lau, jecrains qu’ils n’en aient pas pour longtemps, ni l’un nil’autre. »Quand M. de Guermantes eut terminé la lecture demon article, il m’adressa des compliments, d’ailleurs
mitigés. Il regrettait la forme un peu poncive de ce styleoù il y avait « de l’emphase, des métaphores commedans la prose démodée de Chateaubriand »i; par contreil me félicita sans réserve de « m’occuper ».: « J’aimequ’on fasse quelque chose de ses dix doigts. Je n’aimepas les inutiles qui sont toujours des importants ou desagités. Sotte engeance,! »Gilberte, qui prenait avec une rapidité extrême lesmanières du monde, déclara combien elle allait êtrefière de dire qu’elle était l’amie d’un auteur. « Vouspensez si je vais dire que j’ai le plaisir, l’honneur devous connaître. »« Vous ne voulez pas venir avec nous, demain, àl’Opéra-Comiquei? » me dit la duchesse, et je pensaique c’était sans doute dans cette même baignoire où jel’avais vue la première fois et qui m’avait semblé alorsinaccessible comme le royaume sous-marin desNéréides. Mais je répondis d’une voix triste.: « Non, jene vais pas au théâtre, j’ai perdu une amie que j’aimaisbeaucoup. » J’avais presque les larmes aux yeux en ledisant, mais pourtant, pour la première fois, cela mefaisait un certain plaisir d’en parler. C’est à partir de cemoment-là que je commençai à écrire à tout le mondeque je venais d’avoir un grand chagrin, et à cesser de leressentir.Quand Gilberte fut partie, M me de Guermantes me
dit.: « Vous n’avez pas compris mes signes, c’était pourque vous ne parliez pas de Swann. » Et comme jem’excusais.: « Mais je vous comprends très bien. Moimême,j’ai failli le nommer, je n’ai eu que le temps deme rattraper, c’est épouvantable, heureusement que jeme suis arrêtée à temps. Vous savez que c’est trèsgênant », dit-elle à son mari pour diminuer un peu mafaute en ayant l’air de croire que j’avais obéi à unepropension commune à tous et à laquelle il étaitdifficile de résister. « Que voulez-vous que j’y fassei?répondit le duc. Vous n’avez qu’à dire qu’on remetteces dessins en haut, puisqu’ils vous font penser àSwann. Si vous ne pensez pas à Swann, vous neparlerez pas de lui. »Le lendemain je reçus deux lettres de félicitation quim’étonnèrent beaucoup, l’une de M me Goupil que jen’avais pas revue depuis tant d’années et à qui, même àCombray, je n’avais pas trois fois adressé la parole. Uncabinet de lecture lui avait communiqué le Figaro.Ainsi, quand quelque chose vous arrive dans la vie quiretentit un peu, des nouvelles nous viennent depersonnes situées si loin de nos relations et dont lesouvenir est déjà si ancien que ces personnes semblentsituées à une grande distance, surtout dans le sens de laprofondeur. Une amitié de collège oubliée, et qui avaitvingt occasions de se rappeler à vous, vous donne signede vie, non sans compensation d’ailleurs. C’est ainsi
que Bloch, dont j’eusse tant aimé savoir ce qu’il pensaitde mon article, ne m’écrivit pas. Il est vrai qu’il avait lucet article et devait me l’avouer plus tard, mais par unchoc en retour. En effet, il écrivit lui-même quelquesannées plus tard un article dans le Figaro et désira mesignaler immédiatement cet événement. Comme ilcessait d’être jaloux de ce qu’il considérait comme unprivilège, puisqu’il lui était aussi échu, l’envie qui luiavait fait feindre d’ignorer mon article cessait, commeun compresseur se soulèvei; il m’en parla, mais toutautrement qu’il ne désirait m’entendre parler du sien.:« J’ai su que toi aussi, me dit-il, avais fait un article.Mais je n’avais pas cru devoir t’en parler, craignant det’être désagréable, car on ne doit pas parler à ses amisdes choses humiliantes qui leur arrivent. Et c’en est uneévidemment que d’écrire dans le journal du sabre et dugoupillon, des five o’clock, sans oublier le bénitier. »Son caractère restait le même, mais son style étaitdevenu moins précieux, comme il arrive à certainsécrivains qui quittent le maniérisme quand, ne faisantplus de poèmes symbolistes, ils écrivent des romansfeuilletons.Pour me consoler de son silence, je relus la lettre deM me Goupili; mais elle était sans chaleur, car sil’aristocratie a certaines formules qui font palissadesentre elles, entre le Monsieur du début et les sentimentsdistingués de la fin, des cris de joie, d’admiration,
peuvent jaillir comme des fleurs, et des gerbes pencherpar-dessus la palissade leur parfum odorant. Mais leconventionnalisme bourgeois enserre l’intérieur mêmedes lettres dans un réseau de « votre succès silégitime », au maximum « votre beau succès ». Desbelles-sœurs fidèles à l’éducation reçue et réservéesdans leur corsage comme il faut, croient s’êtreépanchées dans le malheur et l’enthousiasme si elles ontécrit « mes meilleures pensées ». « Mère se joint àmoi » est un superlatif dont on est rarement gâté.Je reçus une autre lettre que celle de M me Goupil,mais le nom du signataire m’était inconnu. C’était uneécriture populaire, un langage charmant. Je fus navré dene pouvoir découvrir qui m’avait écrit.Comme je me demandais si Bergotte eût aimé cetarticle, M me de Forcheville m’avait répondu qu’ill’aurait infiniment admiré et n’aurait pu le lire sansenvie. Mais elle me l’avait dit pendant que je dormais.:c’était un rêve.Presque tous nos rêves répondent ainsi auxquestions que nous nous posons par des affirmationscomplexes, des mises en scène à plusieurs personnages,mais qui n’ont pas de lendemain.Quant à M lle de Forcheville, je ne pouvaism’empêcher de penser à elle avec désolation. Quoii?fille de Swann qui eût tant aimé la voir chez les
Guermantes, que ceux-ci avaient refusé à leur grandami de recevoir, ils l’avaient ensuite spontanémentrecherchée, le temps ayant passé qui renouvelle toutpour nous, insuffle une autre personnalité, d’après cequ’on dit d’eux, aux êtres que nous n’avons pas vusdepuis longtemps, depuis que nous avons fait nousmêmepeau neuve et pris d’autres goûts. Je pensais qu’àcette fille Swann disait parfois, en la serrant contre luiet en l’embrassant.: « C’est bon, ma chérie, d’avoir unefille comme toii; un jour, quand je ne serai plus là, si onparle encore de ton pauvre papa, ce sera seulement avectoi et à cause de toi. » Swann, en mettant ainsi pouraprès sa mort un craintif et anxieux espoir desurvivance dans sa fille, se trompait autant que le vieuxbanquier qui, ayant fait un testament pour une petitedanseuse qu’il entretient et qui a très bonne tenue, se ditqu’il n’est pour elle qu’un grand ami, mais qu’ellerestera fidèle à son souvenir. Elle avait très bonne tenuetout en faisant du pied sous la table aux amis du vieuxbanquier qui lui plaisaient, mais tout cela très caché,avec d’excellents dehors. Elle portera le deuil del’excellent homme, s’en sentira débarrassée, profiteranon seulement de l’argent liquide, mais des propriétés,des automobiles qu’il lui a laissées, fera partout effacerle chiffre de l’ancien propriétaire qui lui cause un peude honte, et à la jouissance du don n’associera jamais leregret du donateur. Les illusions de l’amour paternel ne
sont peut-être pas moindres que celles de l’autrei; biendes filles ne considèrent leur père que comme levieillard qui leur laisse sa fortune. La présence deGilberte dans un salon, au lieu d’être une occasionqu’on parlât encore quelquefois de son père, était unobstacle à ce qu’on saisît celles, de plus en plus rares,qu’on aurait pu avoir encore de le faire. Même à proposdes mots qu’il avait dits, des objets qu’il avait donnés,on prit l’habitude de ne plus le nommer, et celle quiaurait dû rajeunir, sinon perpétuer sa mémoire, setrouva hâter et consommer l’œuvre de la mort et del’oubli.Et ce n’est pas seulement à l’égard de Swann queGilberte consommait peu à peu l’œuvre de l’oubli, elleavait hâté en moi cette œuvre de l’oubli à l’égardd’<strong>Albertine</strong>.Sous l’action du désir, par conséquent du désir debonheur que Gilberte avait excité en moi pendant lesquelques heures où je l’avais crue une autre, un certainnombre de souffrances, de préoccupationsdouloureuses, lesquelles il y a peu de temps encoreobsédaient ma pensée, s’étaient échappées de moi,entraînant avec elles tout un bloc de souvenirs,probablement effrités depuis longtemps et précaires,relatifs à <strong>Albertine</strong>. Car, si bien des souvenirs, quiétaient reliés à elle, avaient d’abord contribué àmaintenir en moi le regret de sa mort, en retour le regret
lui-même avait fixé les souvenirs. De sorte que lamodification de mon état sentimental, préparée sansdoute obscurément jour par jour par les désagrégationscontinues de l’oubli, mais réalisée brusquement dansson ensemble, me donna cette impression, que je merappelle avoir éprouvée ce jour-là pour la première fois,du vide, de la suppression en moi de toute une portionde mes associations d’idées, qu’éprouve un hommedont une artère cérébrale depuis longtemps usée s’estrompue et chez lequel toute une partie de la mémoireest abolie ou paralysée.La disparition de ma souffrance, et de tout ce qu’elleemmenait avec elle, me laissait diminué commesouvent la guérison d’une maladie qui tenait dans notrevie une grande place. Sans doute c’est parce que lessouvenirs ne restent pas toujours vrais que l’amourn’est pas éternel, et parce que la vie est faite duperpétuel renouvellement des cellules. Mais cerenouvellement, pour les souvenirs, est tout de mêmeretardé par l’attention qui arrête et fixe un moment quidoit changer. Et puisqu’il en est du chagrin comme dudésir des femmes, qu’on grandit en y pensant, avoirbeaucoup à faire rendrait plus facile, aussi bien que lachasteté, l’oubli.Par une autre réaction (bien que ce fût la distraction– le désir de M lle d’Éporcheville – qui m’eût rendu toutd’un coup l’oubli apparent et sensible), s’il reste que
c’est le temps qui amène progressivement l’oubli,l’oubli n’est pas sans altérer profondément la notion dutemps. Il y a des erreurs optiques dans le temps commeil y en a dans l’espace. La persistance en moi d’unevelléité ancienne de travailler, de réparer le tempsperdu, de changer de vie, ou plutôt de commencer devivre, me donnait l’illusion que j’étais toujours aussijeunei; pourtant le souvenir de tous les événements quis’étaient succédé dans ma vie (et aussi de ceux quis’étaient succédé dans mon cœur, car, lorsqu’on abeaucoup changé, on est induit à supposer qu’on a pluslongtemps vécu), au cours de ces derniers mois del’existence d’<strong>Albertine</strong>, me les avait fait paraîtrebeaucoup plus longs qu’une année, et maintenant cetoubli de tant de choses, me séparant, par des espacesvides, d’événements tout récents qu’ils me faisaientparaître anciens, puisque j’avais eu ce qu’on appelle« le temps » de les oublier, par son interpolationfragmentée, irrégulière, au milieu de ma mémoire –comme une brume épaisse sur l’océan, qui supprime lespoints de repère des choses – détraquait, disloquait monsentiment des distances dans le temps, là rétrécies, icidistendues, et me faisait me croire tantôt beaucoup plusloin, tantôt beaucoup plus près des choses que je nel’étais en réalité. Et comme dans les nouveaux espaces,encore non parcourus, qui s’étendaient devant moi, iln’y aurait pas plus de traces de mon amour pour
<strong>Albertine</strong> qu’il n’y en avait eu, dans les temps perdusque je venais de traverser, de mon amour pour magrand’mère, ma vie m’apparut – offrant une successionde périodes dans lesquelles, après un certain intervalle,rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plusdans celle qui la suivait – comme quelque chose de sidépourvu du support d’un moi individuel identique etpermanent, quelque chose de si inutile dans l’avenir etde si long dans le passé, que la mort pourrait aussi bienterminer le cours ici ou là sans nullement le conclure,que ces cours d’histoire de France qu’en rhétorique onarrête indifféremment, selon la fantaisie desprogrammes ou des professeurs, à la Révolution de1830, à celle de 1848, ou à la fin du second Empire.Peut-être alors la fatigue et la tristesse que jeressentais vinrent-elles moins d’avoir aimé inutilementce que déjà j’oubliais que de commencer à me plaireavec de nouveaux vivants, de purs gens du monde, desimples amis des Guermantes, si peu intéressants pareux-mêmes. Je me consolais peut-être plus aisément deconstater que celle que j’avais aimée n’était plus, aubout d’un certain temps, qu’un pâle souvenir que deretrouver en moi cette vaine activité qui nous fait perdrele temps à tapisser notre vie d’une végétation humainevivace mais parasite, qui deviendra le néant aussi quandelle sera morte, qui déjà est étrangère à tout ce que nousavons connu et à laquelle pourtant cherche à plaire
notre sénilité bavarde, mélancolique et coquette. L’êtrenouveau qui supporterait aisément de vivre sans<strong>Albertine</strong> avait fait son apparition en moi, puisquej’avais pu parler d’elle chez M me de Guermantes enparoles affligées, sans souffrance profonde. Cesnouveaux « moi » qui devraient porter un autre nomque le précédent, leur venue possible, à cause de leurindifférence à ce que j’aimais, m’avait toujoursépouvanté, jadis à propos de Gilberte quand son pèreme disait que si j’allais vivre en Océanie je ne voudraisplus revenir, tout récemment quand j’avais lu avec untel serrement de cœur le passage du roman de Bergotteoù il est question de ce personnage qui, séparé, par lavie, d’une femme qu’il avait adorée jeune homme,vieillard la rencontre sans plaisir, sans envie de larevoir. Or, au contraire, il m’apportait avec l’oubli unesuppression presque complète de la souffrance, unepossibilité de bien-être, cet être si redouté, si bienfaisantet qui n’était autre qu’un de ces « moi » de rechangeque la destinée tient en réserve pour nous et que, sansplus écouter nos prières qu’un médecin clairvoyant etd’autant plus autoritaire, elle substitue malgré nous, parune intervention opportune, au « moi » vraiment tropblessé. Ce rechange, au reste, elle l’accomplit de tempsen temps, comme l’usure et la réfection des tissus, maisnous n’y prenons garde que si l’ancien « moi »contenait une grande douleur, un corps étranger et
lessant, que nous nous étonnons de ne plus retrouver,dans notre émerveillement d’être devenu un autre pourqui la souffrance de son prédécesseur n’est plus que lasouffrance d’autrui, celle dont on peut parler avecapitoiement parce qu’on ne la ressent pas. Même celanous est égal d’avoir passé par tant de souffrances, carnous ne nous rappelons que confusément les avoirsouffertes. Il est possible que, de même, noscauchemars, la nuit, soient effroyables. Mais au réveilnous sommes une autre personne qui ne se soucie guèreque celle à qui elle succède ait eu à fuir en dormantdevant des assassins.Sans doute, ce « moi » avait gardé quelque contactavec l’ancien, comme un ami, indifférent à un deuil, enparle pourtant aux personnes présentes avec la tristesseconvenable, et retourne de temps en temps dans lachambre où le veuf qui l’a chargé de recevoir pour luicontinue à faire entendre ses sanglots. J’en poussaisencore quand je redevenais pour un moment l’ancienami d’<strong>Albertine</strong>. Mais c’est dans un personnagenouveau que je tendais à passer tout entier. Ce n’est pasparce que les autres sont morts que notre affection poureux s’affaiblit, c’est parce que nous mourons nousmêmes.<strong>Albertine</strong> n’avait rien à reprocher à son ami.Celui qui en usurpait le nom n’en était que l’héritier.On ne peut être fidèle qu’à ce dont on se souvient, onne se souvient que de ce qu’on a connu. Mon « moi »
nouveau, tandis qu’il grandissait à l’ombre de l’ancien,l’avait souvent entendu parler d’<strong>Albertine</strong>i; à traverslui, à travers les récits qu’il en recueillait, il croyait laconnaître, elle lui était sympathique, il l’aimait, mais cen’était qu’une tendresse de seconde main.Une autre personne chez qui l’œuvre de l’oubli ence qui concernait <strong>Albertine</strong> se fit probablement plusrapide à cette époque, et me permit par contre-coup deme rendre compte un peu plus tard d’un nouveauprogrès que cette œuvre avait fait chez moi (et c’est làmon souvenir d’une seconde étape avant l’oublidéfinitif), ce fut Andrée. Je ne puis guère, en effet, nepas donner l’oubli d’<strong>Albertine</strong> comme cause sinonunique, sinon même principale, au moins comme causeconditionnante et nécessaire, d’une conversationqu’Andrée eut avec moi à peu près six mois après celleque j’ai rapportée et où ses paroles furent si différentesde ce qu’elle m’avait dit la première fois. Je merappelle que c’était dans ma chambre parce qu’à cemoment-là j’avais plaisir à avoir de demi-relationscharnelles avec elle, à cause du côté collectif qu’avaiteu au début et que reprenait maintenant mon amourpour les jeunes filles de la petite bande, longtempsindivis entre elles, et un moment uniquement associé àla personne d’<strong>Albertine</strong> pendant les derniers mois quiavaient précédé et suivi sa mort.Nous étions dans ma chambre pour une autre raison
encore qui me permet de situer très exactement cetteconversation. C’est que j’étais expulsé du reste del’appartement parce que c’était le jour de maman.Malgré que ce fût son jour, et après avoir hésité, mamanétait allée déjeuner chez M me Sazerat, pensant que,comme M me Sazerat savait toujours vous inviter avecdes gens ennuyeux, elle pourrait, sans manquer aucunplaisir, rentrer tôt. Elle était, en effet, revenue à tempset sans regrets, M me Sazerat n’ayant eu chez elle quedes gens assommants que glaçait déjà la voixparticulière qu’elle prenait quand elle avait du monde,ce que maman appelait sa voix du mercredi. Ma mère,du reste, l’aimait bien, la plaignait de son infortune –suite des fredaines de son père ruiné par la duchesse deX... – infortune qui la forçait à vivre presque toutel’année à Combray, avec quelques semaines chez sacousine à Paris et un grand « voyage d’agrément » tousles dix ans.Je me rappelle que la veille, sur ma prière répétéedepuis des mois, et parce que la princesse la réclamaittoujours, maman était allée voir la princesse de Parmequi, elle, ne faisait pas de visites et chez qui on secontentait d’habitude de s’inscrire, mais qui avaitinsisté pour que ma mère vînt la voir, puisque leprotocole empêchait qu’Elle vînt chez nous. Ma mèreétait revenue très mécontente.: « Tu m’as fait faire unpas de clerc, me dit-elle, la princesse de Parme m’a à
peine dit bonjour, elle s’est retournée vers les damesavec qui elle causait sans s’occuper de moi, et au boutde dix minutes, comme elle ne m’avait pas adressé laparole, je suis partie sans qu’elle me tendît même lamain. J’étais très ennuyéei; en revanche, devant laporte, en m’en allant, j’ai rencontré la duchesse deGuermantes qui a été très aimable et qui m’a beaucoupparlé de toi. Quelle singulière idée tu as eue de luiparler d’<strong>Albertine</strong>. Elle m’a raconté que tu lui avais ditque sa mort avait été un tel chagrin pour toi. Je neretournerai jamais chez la princesse de Parme. Tu m’asfait faire une bêtise. »Or le lendemain, jour de ma mère, comme je l’ai dit,Andrée vint me voir. Elle n’avait pas grand temps, carelle devait aller chercher Gisèle avec qui elle tenaitbeaucoup à dîner. « Je connais ses défauts, mais c’esttout de même ma meilleure amie et l’être pour qui j’aile plus d’affection », me dit-elle. Et elle parut mêmeavoir quelque effroi à l’idée que je pourrais luidemander de dîner avec elles. Elle était avide des êtres,et un tiers qui la connaissait trop bien, comme moi, enl’empêchant de se livrer, l’empêchait du coup de goûterauprès d’eux un plaisir complet.Le souvenir d’<strong>Albertine</strong> était devenu chez moi sifragmentaire qu’il ne me causait plus de tristesse etn’était plus qu’une transition à de nouveaux désirs,comme un accord qui prépare des changements
d’harmonie. Et même cette idée de caprice sensuel etpassager étant écartée en tant que j’étais encore fidèleau souvenir d’<strong>Albertine</strong>, j’étais plus heureux d’avoirauprès de moi Andrée que je ne l’aurais été d’avoir<strong>Albertine</strong> miraculeusement retrouvée. Car Andréepouvait me dire plus de choses sur <strong>Albertine</strong> que nem’en aurait dit <strong>Albertine</strong> elle-même. Or les problèmesrelatifs à <strong>Albertine</strong> restaient encore dans mon espritalors que ma tendresse pour elle, tant physique quemorale, avait déjà disparu. Et mon désir de connaître savie, parce qu’il avait moins diminué, était maintenantcomparativement plus grand que le besoin de saprésence. D’autre part, l’idée qu’une femme avait peutêtreeu des relations avec <strong>Albertine</strong> ne me causait plusque le désir d’en avoir moi aussi avec cette femme. Jele dis à Andrée tout en la caressant. Alors sans chercherle moins du monde à mettre ses paroles d’accord aveccelles d’il y avait quelques mois, Andrée me dit ensouriant à demi.: « Ah,! oui, mais vous êtes un homme.Aussi nous ne pouvons pas faire ensemble tout à fait lesmêmes choses que je faisais avec <strong>Albertine</strong>. » Et soitqu’elle pensât que cela accroissait mon désir (dansl’espoir de confidences je lui avais dit que j’aimeraisavoir des relations avec une femme en ayant eu avec<strong>Albertine</strong>) ou mon chagrin, ou peut-être détruisait unsentiment de supériorité sur elle qu’elle pouvait croireque j’éprouvais d’avoir été le seul à entretenir des
elations avec <strong>Albertine</strong>.: « Ah,! nous avons passétoutes les deux de bonnes heures, elle était sicaressante, si passionnée. Du reste ce n’était passeulement avec moi qu’elle aimait prendre du plaisir.Elle avait rencontré chez M me Verdurin un joli garçon,Morel. Tout de suite ils s’étaient compris. Il sechargeait, ayant d’elle la permission d’y prendre aussison plaisir, car il aimait les petites novices, de lui enprocurer. Sitôt qu’il les avait mises sur le mauvaischemin, il les laissait. Il se chargeait ainsi de plaire à depetites pêcheuses d’une plage éloignée, à de petitesblanchisseuses, qui s’amourachaient d’un garçon maisn’eussent pas répondu aux avances d’une jeune fille.Aussitôt que la petite était bien sous sa domination, il lafaisait venir dans un endroit tout à fait sûr, où il lalivrait à <strong>Albertine</strong>. Par peur de perdre Morel, qui s’ymêlait du reste, la petite obéissait toujours, et d’ailleurselle le perdait tout de même, car, par peur desconséquences et aussi parce qu’une ou deux fois luisuffisaient, il filait en laissant une fausse adresse. Il eutune fois l’audace d’en mener une, ainsi qu’<strong>Albertine</strong>,dans une maison de femmes à Corliville, où quatre oucinq la prirent ensemble ou successivement. C’était sapassion, comme c’était aussi celle d’<strong>Albertine</strong>. Mais<strong>Albertine</strong> avait après d’affreux remords. Je crois quechez vous elle avait dompté sa passion et remettait dejour en jour de s’y livrer. Puis son amitié pour vous
était si grande, qu’elle avait des scrupules. Mais il étaitbien certain que si jamais elle vous quittait ellerecommencerait. Elle espérait que vous la sauveriez,que vous l’épouseriez. Au fond, elle sentait que c’étaitune espèce de folie criminelle, et je me suis souventdemandé si ce n’était pas après une chose comme cela,ayant amené un suicide dans une famille, qu’elle s’étaitelle-même tuée. Je dois avouer que, tout à fait au débutde son séjour chez vous, elle n’avait pas entièrementrenoncé à ses jeux avec moi. Il y avait des jours où ellesemblait en avoir besoin, tellement qu’une fois, alorsque c’eût été si facile dehors, elle ne se résigna pas àme dire au revoir avant de m’avoir mise auprès d’elle,chez vous. Nous n’eûmes pas de chance, nous avonsfailli être prises. Elle avait profité de ce que Françoiseétait descendue faire une course, et que vous n’étiez pasrentré. Alors elle avait tout éteint pour que quand vousouvririez avec votre clef vous perdiez un peu de tempsavant de trouver le bouton, et elle n’avait pas fermé laporte de sa chambre. Nous vous avons entendu monter,je n’eus que le temps de m’arranger, de descendre.Précipitation bien inutile, car par un hasard incroyablevous aviez oublié votre clef et avez été obligé desonner. Mais nous avons tout de même perdu la tête desorte que, pour cacher notre gêne, toutes les deux, sansavoir pu nous consulter, nous avions eu la même idée.:faire semblant de craindre l’odeur du seringa, que nous
adorions au contraire. Vous rapportiez avec vous unelongue branche de cet arbuste, ce qui me permit dedétourner la tête et de cacher mon trouble. Cela nem’empêcha pas de vous dire avec une maladresseabsurde que peut-être Françoise était remontée etpourrait vous ouvrir, alors qu’une seconde avant, jevenais de vous faire le mensonge que nous venionsseulement de rentrer de promenade et qu’à notre arrivéeFrançoise n’était pas encore descendue et allait partirfaire une course. Mais le malheur fut – croyant quevous aviez votre clef – d’éteindre la lumière, car nouseûmes peur qu’en remontant vous ne la vissiez serallumer, ou du moins nous hésitâmes trop. Et pendanttrois nuits <strong>Albertine</strong> ne put fermer l’œil parce qu’elleavait tout le temps peur que vous n’ayez de la méfianceet ne demandiez à Françoise pourquoi elle n’avait pasallumé avant de partir. Car <strong>Albertine</strong> vous craignaitbeaucoup, et par moments assurait que vous étiezfourbe, méchant, la détestant au fond. Au bout de troisjours elle comprit à votre calme que vous n’aviez riendemandé à Françoise et elle put retrouver le sommeil.Mais elle ne reprit plus ses relations avec moi, soit parpeur, soit par remords, car elle prétendait vous aimerbeaucoup, ou bien aimait-elle quelqu’un d’autre. Entous cas on n’a plus pu jamais parler de seringa devantelle sans qu’elle devînt écarlate et passât la main sur safigure en pensant cacher sa rougeur. »
Comme certains bonheurs, il y a certains malheursqui viennent trop tard, ils ne prennent pas en nous toutela grandeur qu’ils auraient eue quelque temps plus tôt.Tel le malheur qu’était pour moi la terrible révélationd’Andrée. Sans doute, même quand de mauvaisesnouvelles doivent nous attrister, il arrive que dans ledivertissement, le jeu équilibré de la conversation, ellespassent devant nous sans s’arrêter, et que nous,préoccupés de mille choses à répondre, transformés, parle désir de plaire aux personnes présentes, en quelqu’und’autre protégé pour quelques instants dans ce cyclenouveau contre les affections, les souffrances qu’il aquittées pour y entrer et qu’il retrouvera quand le courtenchantement sera brisé, nous n’ayons pas le temps deles accueillir. Pourtant, si ces affections, ces souffrancessont trop prédominantes, nous n’entrons que distraitsdans la zone d’un monde nouveau et momentané, où,trop fidèles à la souffrance, nous ne pouvons devenirautres, et alors les paroles se mettent immédiatement enrapport avec notre cœur qui n’est pas resté hors de jeu.Mais depuis quelque temps les paroles concernant<strong>Albertine</strong>, comme un poison évaporé, n’avaient plusleur pouvoir toxique. Elle m’était déjà trop lointaine.Comme un promeneur voyant, l’après-midi, uncroissant nuageux dans le ciel se dit.: « C’est cela,l’immense lune », je me disais.: « Comment,! cettevérité que j’ai tant cherchée, tant redoutée, c’est
seulement ces quelques mots dits dans uneconversation, auxquels on ne peut même pas pensercomplètement parce qu’on n’est pas seul,! » Puis elleme prenait vraiment au dépourvu, je m’étais beaucoupfatigué avec Andrée. Vraiment, une pareille vérité,j’aurais voulu avoir plus de force à lui consacreri; elleme restait extérieure, mais c’est que je ne lui avais pasencore trouvé une place dans mon cœur. On voudraitque la vérité nous fût révélée par des signes nouveaux,non par une phrase pareille à celles qu’on s’était ditestant de fois. L’habitude de penser empêche parfoisd’éprouver le réel, immunise contre lui, le fait paraîtrede la pensée encore.Il n’y a pas une idée qui ne porte en elle saréfutation possible, un mot, le mot contraire. En toutcas, si tout cela était vrai, quelle inutile vérité sur la vied’une maîtresse qui n’est plus, remontant desprofondeurs et apparaissant une fois que nous nepouvons plus rien en faire,! Alors, pensant sans doute àquelque autre que nous aimons maintenant et à l’égardde qui la même chose pourrait arriver (car de cellequ’on a oubliée on ne se soucie plus), on se désole. Onse dit.: « Si elle vivait,! » On se dit.: « Si celle qui vitpouvait comprendre tout cela et que, quand elle seramorte, je saurai tout ce qu’elle me cache,! » Mais c’estun cercle vicieux. Si j’avais pu faire qu’<strong>Albertine</strong> vécût,du même coup j’eusse fait qu’Andrée ne m’eût rien
évélé. C’est la même chose que l’éternel « Vous verrezquand je ne vous aimerai plus », qui est si vrai et siabsurde, puisque, en effet, on obtiendrait beaucoup sion n’aimait plus, mais qu’on ne se soucierait pasd’obtenir. C’est tout à fait la même chose. Car la femmequ’on revoit quand on ne l’aime plus, si elle nous dittout, c’est qu’en effet ce n’est plus elle, ou que ce n’estplus vous.: l’être qui aimait n’existe plus. Là aussi il y ala mort qui a passé, a rendu tout aisé et tout inutile. Jefaisais ces réflexions, me plaçant dans l’hypothèse oùAndrée était véridique – ce qui était possible – etamenée à la sincérité envers moi précisément parcequ’elle avait maintenant des relations avec moi, par cecôté Saint-André-des-Champs qu’avait eu, au début,avec moi, <strong>Albertine</strong>. Elle y était aidée dans ce cas par lefait qu’elle ne craignait plus <strong>Albertine</strong>, car la réalité desêtres ne survit pour nous que peu de temps après leurmort, et au bout de quelques années ils sont comme cesdieux des religions abolies qu’on offense sans crainteparce qu’on a cessé de croire à leur existence. Maisqu’Andrée ne crût plus à la réalité d’<strong>Albertine</strong> pouvaitavoir pour effet qu’elle ne redoutât plus (aussi bien quede trahir une vérité qu’elle avait promis de ne pasrévéler) d’inventer un mensonge qui calomniaitrétrospectivement sa prétendue complice. Cette absencede crainte lui permettait-elle de révéler enfin, en medisant cela, la vérité, ou bien d’inventer un mensonge,
si, pour quelque raison, elle me croyait plein debonheur et d’orgueil et voulait me peiner. Peut-êtreavait-elle de l’irritation contre moi (irritation suspenduetant qu’elle m’avait vu malheureux, inconsolé) parceque j’avais eu des relations avec <strong>Albertine</strong> et qu’ellem’enviait peut-être – croyant que je me jugeais à causede cela plus favorisé qu’elle – un avantage qu’ellen’avait peut-être pas obtenu, ni même souhaité. C’estainsi que je l’avais souvent vue dire qu’ils avaient l’airtrès malades à des gens dont la bonne mine, et surtout laconscience qu’ils avaient de leur bonne mine,l’exaspérait, et dire, dans l’espoir de les fâcher, qu’ellemêmeallait très bien, ce qu’elle ne cessa de proclamerquand elle était le plus malade, jusqu’au jour où, dans ledétachement de la mort, il ne lui soucia plus que lesheureux allassent bien et sussent qu’elle-même semourait. Mais ce jour-là était encore loin. Peut-êtreétait-elle contre moi 1 , je ne savais pour quelle raison,dans une de ces rages comme jadis elle en avait eucontre le jeune homme si savant dans les choses desport, si ignorant du reste, que nous avions rencontré àBalbec et qui depuis vivait avec Rachel et sur le comptede qui Andrée se répandait en propos diffamatoires,souhaitant être poursuivie en dénonciation calomnieuse1 Il manque ici possiblement un mot. Dans une autre édition : « Peutêtreétait-elle irritée contre moi... »
pour pouvoir articuler contre son père des faitsdéshonorants dont il n’aurait pu prouver la fausseté. Orpeut-être cette rage contre moi la reprenait seulement,ayant sans doute cessé quand elle me voyait si triste. Eneffet, ceux-là mêmes qu’elle avait, les yeux étincelantsde rage, souhaité déshonorer, tuer, faire condamner, fûtcesur faux témoignages, si seulement elle les savaittristes, humiliés, elle ne leur voulait plus aucun mal,elle était prête à les combler de bienfaits. Car ellen’était pas foncièrement mauvaise, et si sa nature nonapparente, un peu profonde, n’était pas la gentillessequ’on croyait d’abord d’après ses délicates attentions,mais plutôt l’envie et l’orgueil, sa troisième nature, plusprofonde encore, la vraie, mais pas entièrement réalisée,tendait vers la bonté et l’amour du prochain. Seulementcomme tous les êtres qui dans un certain état en désirentun meilleur mais, ne le connaissant que par le désir, necomprennent pas que la première condition est derompre avec le premieri; comme les neurasthéniques oules morphinomanes qui voudraient bien être guéris maispourtant qu’on ne les privât pas de leurs manies ou deleur morphinei; comme les cœurs religieux ou lesesprits artistes attachés au monde qui souhaitent lasolitude mais veulent se la représenter pourtant commen’impliquant pas un renoncement absolu à leur vieantérieure – Andrée était prête à aimer toutes lescréatures, mais à condition d’avoir réussi d’abord à ne
pas se les représenter comme triomphantes, et pour celade les avoir humiliées préalablement. Elle necomprenait pas qu’il fallait aimer même les orgueilleuxet vaincre leur orgueil par l’amour et non par un pluspuissant orgueil. Mais c’est qu’elle était comme lesmalades qui veulent la guérison par les moyens mêmesqui entretiennent la maladie, qu’ils aiment et qu’ilscesseraient aussitôt d’aimer s’ils les renonçaient. Maison veut apprendre à nager et pourtant garder un pied àterre. En ce qui concerne le jeune sportif, neveu desVerdurin, que j’avais rencontré dans mes deux séjours àBalbec, il faut dire, accessoirement et par anticipation,que quelque temps après la visite d’Andrée, visite dontle récit va être repris dans un instant, il arriva des faitsqui causèrent une assez grande impression. D’abord cejeune homme (peut-être par souvenir d’<strong>Albertine</strong> que jene savais pas alors qu’il avait aimée) se fiança avecAndrée et l’épousa, malgré le désespoir de Rachel dontil ne tint aucun compte. Andrée ne dit plus alors (c’està-direquelques mois après la visite dont je parle) qu’ilétait un misérable, et je m’aperçus plus tard qu’ellen’avait dit qu’il l’était que parce qu’elle était folle de luiet qu’elle croyait qu’il ne voulait pas d’elle. Mais unautre fait me frappa davantage. Ce jeune homme fitreprésenter des petits sketches, dans des décors et avecdes costumes de lui qui ont amené dans l’artcontemporain une révolution au moins égale à celle
accomplie par les Ballets russes. Bref les juges les plusautorisés considérèrent ses œuvres comme quelquechose de capital, presque des œuvres de génie, et jepense d’ailleurs comme eux, ratifiant ainsi, à monpropre étonnement, l’ancienne opinion de Rachel. Lespersonnes qui l’avaient connu à Balbec, attentifseulement à savoir si la coupe des vêtements des gensqu’il avait à fréquenter était élégante ou non, quil’avaient vu passer tout son temps au baccara, auxcourses, au golf ou au polo, qui savaient que dans sesclasses il avait toujours été un cancre et s’était mêmefait renvoyer du lycée (pour ennuyer ses parents, il avaitété habiter deux mois la grande maison de femmes oùM. de Charlus avait cru surprendre Morel), pensèrentque peut-être ses œuvres étaient d’Andrée qui, paramour, voulait lui en laisser la gloire, ou que plusprobablement il payait, avec sa grande fortunepersonnelle que ses folies avaient seulement ébréchée,quelque professionnel génial et besogneux pour lesfaire. Ce genre de société riche, non décrassée par lafréquentation de l’aristocratie et n’ayant aucune idée dece qu’est un artiste – lequel est seulement figuré poureux, soit par un acteur qu’ils font venir débiter desmonologues pour les fiançailles de leur fille, en luiremettant tout de suite son cachet discrètement dans unsalon voisin, soit par un peintre chez qui ils la fontposer une fois qu’elle est mariée, avant les enfants et
quand elle est encore à son avantage – croientvolontiers que tous les gens du monde qui écrivent,composent ou peignent, font faire leurs œuvres etpayent pour avoir une réputation d’auteur commed’autres pour s’assurer un siège de député. Mais toutcela était faux, et ce jeune homme était bien l’auteur deces œuvres admirables. Quand je le sus, je fus obligéd’hésiter entre diverses suppositions. Ou bien il avaitété, en effet, pendant de longues années la « bruteépaisse » qu’il paraissait, et quelque cataclysmephysiologique avait éveillé en lui le génie assoupicomme la Belle au bois dormanti; ou bien à cetteépoque de sa rhétorique orageuse, de ses recalages aubachot, de ses grosses pertes de jeu de Balbec, de sacrainte de monter dans le « tram » avec des fidèles de satante Verdurin à cause de leur vilain habillement, il étaitdéjà un homme de génie, peut-être distrait de son génie,l’ayant laissé la clef sous la porte dans l’effervescencede passions juvénilesi; ou bien, même homme de géniedéjà conscient, et dernier en classe parce que, pendantque le professeur disait des banalités sur Cicéron, luilisait Rimbaud ou Gœthe. Certes, rien ne laissaitsoupçonner cette hypothèse quand je le rencontrai àBalbec, où ses préoccupations me parurent s’attacheruniquement à la correction des attelages et à lapréparation des cocktails. Mais ce n’est pas encore uneobjection irréfutable. Il pouvait être très vaniteux, ce
qui peut s’allier au génie, et chercher à briller de lamanière qu’il savait propre à éblouir dans le monde oùil vivait et qui n’était nullement de prouver uneconnaissance approfondie des affinités électives, maisbien plutôt de conduire à quatre. D’ailleurs je ne suispas sûr que plus tard, quand il fut devenu l’auteur deces belles œuvres si originales, il eût beaucoup aimé,hors des théâtres où il était connu, à dire bonjour àquelqu’un qui n’aurait pas été en smoking, comme lesfidèles dans leur première manière, ce qui prouveraitchez lui non de la bêtise mais de la vanité, et même uncertain sens pratique, une certaine clairvoyance àadapter sa vanité à la mentalité des imbéciles, à l’estimede qui il tenait et pour lesquels le smoking brille peutêtred’un plus vif éclat que le regard d’un penseur. Quisait si, vu du dehors, tel homme de talent, ou même unhomme sans talent mais aimant les choses de l’esprit,moi par exemple, n’eût pas fait, à qui l’eût rencontré àRivebelle, à l’Hôtel de Balbec, ou sur la digue deBalbec, l’effet du plus parfait et prétentieux imbécilei?Sans compter que pour Octave les choses de l’artdevaient être quelque chose de si intime, de vivanttellement dans les plus secrets replis de lui-même, qu’iln’eût sans doute pas eu l’idée d’en parler, comme eûtfait Saint-Loup par exemple, pour qui les arts avaient leprestige que les attelages avaient pour Octave. Puis ilpouvait avoir la passion du jeu, et on dit qu’il l’a
gardée. Tout de même, si la piété qui fit revivre l’œuvreinconnue de Vinteuil est sortie du milieu si trouble deMontjouvain, je ne fus pas moins frappé de penser queles chefs-d’œuvre peut-être les plus extraordinaires denotre époque sont sortis non du concours général, d’uneéducation modèle, académique, à la Broglie, mais de lafréquentation des « pesages » et des grands bars. Entous cas, à cette époque, à Balbec, les raisons quifaisaient désirer à moi de le connaître, à <strong>Albertine</strong> et sesamies que je ne le connusse pas, étaient égalementétrangères à sa valeur, et auraient pu seulement mettreen lumière l’éternel malentendu d’un « intellectuel »(représenté en l’espèce par moi) et des gens du monde(représentés par la petite bande) au sujet d’une personnemondaine (le jeune joueur de golf). Je ne pressentaisnullement son talent, et son prestige à mes yeux, dumême genre qu’autrefois celui de M me Blatin, étaitd’être – quoi qu’elles prétendissent – l’ami de mesamies, et plus de leur bande que moi. D’autre part,<strong>Albertine</strong> et Andrée, symbolisant en cela l’incapacitédes gens du monde à porter un jugement valable sur leschoses de l’esprit et leur propension à s’attacher danscet ordre à de faux-semblants, non seulement n’étaientpas loin de me trouver stupide parce que j’étais curieuxd’un tel imbécile, mais s’étonnaient surtout que, joueurde golf pour joueur de golf, mon choix se fût justementporté sur le plus insignifiant. Si encore j’avais voulu me
lier avec le jeune Gilbert de Bellœuvrei; en dehors dugolf c’était un garçon qui avait de la conversation, quiavait eu un accessit au concours général et faisaitagréablement les vers (or il était, en réalité, plus bêtequ’aucun). Ou alors si mon but était de « faire uneétude pour un livre », Guy Saumoy, qui étaitcomplètement fou, avait enlevé deux jeunes filles, étaitau moins un type curieux qui pouvait « m’intéresser ».Ces deux-là, on me les eût « permis », mais l’autre, quelagrément pouvais-je lui trouveri? c’était le type de la« grande brute », de la « brute épaisse ». Pour revenir àla visite d’Andrée, après la révélation qu’elle venait deme faire sur ses relations avec <strong>Albertine</strong> elle ajouta quela principale raison pour laquelle <strong>Albertine</strong> m’avaitquitté, c’était à cause de ce que pouvaient penser sesamies de la petite bande, et d’autres encore, de la voirainsi habiter chez un jeune homme avec qui elle n’étaitpas mariée.: « Je sais bien que c’était chez votre mère.Mais cela ne fait rien. Vous ne savez pas ce que c’estque tout ce monde de jeunes filles, ce qu’elles secachent les unes des autres, comme elles craignentl’opinion des autres. J’en ai vu d’une sévérité terribleavec des jeunes gens, simplement parce qu’ilsconnaissaient leurs amies et qu’elles craignaient quecertaines choses ne fussent répétées, et celles-là même,le hasard me les a montrées tout autres, bien contre leurgré. » Quelques mois plus tôt, ce savoir que paraissait
posséder Andrée des mobiles auxquels obéissent lesfilles de la petite bande m’eût paru le plus précieux dumonde. Peut-être ce qu’elle disait suffisait-il à expliquerqu’<strong>Albertine</strong>, qui s’était donnée à moi ensuite à Paris,se fût refusée à Balbec où je voyais constamment sesamies, ce que j’avais l’absurdité de croire un telavantage pour être au mieux avec elle. Peut-être mêmeétait-ce de voir quelques mouvements de confiance demoi avec Andrée, ou que j’eusse imprudemment dit àcelle-ci qu’<strong>Albertine</strong> allait coucher au Grand Hôtel, quifaisait qu’<strong>Albertine</strong> qui peut-être, une heure avant, étaitprête à me laisser prendre certains plaisirs comme lachose la plus simple, avait eu un revirement et avaitmenacé de sonner. Mais alors, elle avait dû être facileavec bien d’autres. Cette idée réveilla ma jalousie et jedis à Andrée qu’il y avait une chose que je voulais luidemander. « Vous faisiez cela dans l’appartementinhabité de votre grand’mèrei? – Oh,! non, jamais, nousaurions été dérangées. – Tiens, je croyais, il mesemblait... – D’ailleurs, <strong>Albertine</strong> aimait surtout fairecela à la campagne. – Où çai? – Autrefois, quand ellen’avait pas le temps d’aller très loin, nous allions auxButtes-Chaumont. Elle connaissait là une maison. Oubien sous les arbres, il n’y a personnei; dans la grotte dupetit Trianon aussi. – Vous voyez bien, comment vouscroirei? Vous m’aviez juré, il n’y a pas un an, n’avoirrien fait aux Buttes-Chaumont. – J’avais peur de vous
faire de la peine. » Comme je l’ai dit, je pensai,beaucoup plus tard seulement, qu’au contraire, cetteseconde fois, le jour des aveux, Andrée avait cherché àme faire de la peine. Et j’en aurais eu tout de suite,pendant qu’elle parlait, l’idée, parce que j’en auraiséprouvé le besoin si j’avais encore autant aimé<strong>Albertine</strong>. Mais les paroles d’Andrée ne me faisaientpas assez mal pour qu’il me fût indispensable de lesjuger immédiatement mensongères. En somme, si ceque disait Andrée était vrai, et je n’en doutai pasd’abord, l’<strong>Albertine</strong> réelle que je découvrais, aprèsavoir connu tant d’apparences diverses d’<strong>Albertine</strong>,différait fort peu de la fille orgiaque surgie et devinée,le premier jour, sur la digue de Balbec et qui m’avaitsuccessivement offert tant d’aspects, comme modifietour à tour la disposition de ses édifices, jusqu’àécraser, à effacer le monument capital qu’on voyait seuldans le lointain, une ville dont on approche, mais dontfinalement, quand on la connaît bien et qu’on la jugeexactement, les proportions vraies étaient celles que laperspective du premier coup d’œil avait indiquées, lereste, par où on avait passé, n’étant que cette sériesuccessive de lignes de défense que tout être élèvecontre notre vision et qu’il faut franchir l’une aprèsl’autre, au prix de combien de souffrances, avantd’arriver au cœur. D’ailleurs, si je n’eus pas besoin decroire absolument à l’innocence d’<strong>Albertine</strong>, parce que
ma souffrance avait diminué, je peux dire que,réciproquement, si je ne souffris pas trop de cetterévélation, c’est que, depuis quelque temps, à lacroyance que je m’étais forgée de l’innocenced’<strong>Albertine</strong> s’était substituée peu à peu, et sans que jem’en rendisse compte, la croyance, toujours présente enmoi, en sa culpabilité. Or si je ne croyais plus àl’innocence d’<strong>Albertine</strong>, c’est que je n’avais déjà plusle besoin, le désir passionné d’y croire. C’est le désirqui engendre la croyance, et si nous ne nous en rendonspas compte d’habitude, c’est que la plupart des désirscréateurs de croyances ne finissent – contrairement àcelui qui m’avait persuadé qu’<strong>Albertine</strong> était innocente– qu’avec nous-même. À tant de preuves quicorroboraient ma version première j’avais stupidementpréféré de simples affirmations d’<strong>Albertine</strong>. Pourquoil’avoir cruei? Le mensonge est essentiel à l’humanité. Ily joue peut-être un aussi grand rôle que la recherche duplaisir, et d’ailleurs, est commandé par cette recherche.On ment pour protéger son plaisir ou son honneur si ladivulgation du plaisir est contraire à l’honneur. Onment toute sa vie, même surtout, peut-être seulement, àceux qui nous aiment. Ceux-là seuls, en effet, nous fontcraindre pour notre plaisir et désirer leur estime. J’avaisd’abord cru <strong>Albertine</strong> coupable, et seul mon désir,employant à une œuvre de doute les forces de monintelligence, m’avait fait faire fausse route. Peut-être
vivons-nous entourés d’indications électriques,sismiques, qu’il nous faut interpréter de bonne foi pourconnaître la vérité des caractères. S’il faut le dire, sitriste malgré tout que je fusse des paroles d’Andrée, jetrouvais plus beau que la réalité se trouvât enfinconcorder avec ce que mon instinct avait d’abordpressenti plutôt qu’avec le misérable optimisme auquelj’avais lâchement cédé par la suite. J’aimais mieux quela vie fût à la hauteur de nos intuitions. Celles-ci, dureste, que j’avais eues le premier jour sur la plage,quand j’avais cru que ces jeunes filles incarnaient lafrénésie du plaisir, le vice, et aussi le soir où j’avais vul’institutrice d’<strong>Albertine</strong> faire rentrer cette fillepassionnée dans la petite villa, comme on pousse danssa cage un fauve que rien plus tard, malgré lesapparences, ne pourra domestiquer, ne s’accordaientellespas à ce que m’avait dit Bloch quand il m’avaitrendu la terre si belle en m’y montrant, me faisantfrissonner dans toutes mes promenades, à chaquerencontre, l’universalité du désiri? Peut-être malgrétout, ces intuitions premières, valait-il mieux que je neles rencontrasse à nouveau vérifiées que maintenant.Tandis que durait tout mon amour pour <strong>Albertine</strong>, ellesm’eussent trop fait souffrir et il eût été mieux qu’iln’eût subsisté d’elles qu’une trace, mon perpétuelsoupçon de choses que je ne voyais pas et qui pourtantse passaient continuellement si près de moi, et peut-être
une autre trace encore, antérieure, plus vaste, qui étaitmon amour lui-même. N’était-ce pas, en effet, malgrétoutes les dénégations de ma raison, connaître danstoute sa hideur <strong>Albertine</strong>, que la choisir, l’aimeri? etmême dans les moments où la méfiance s’assoupit,l’amour n’en est-il pas la persistance et unetransformationi? n’est-il pas une preuve de clairvoyance(preuve inintelligible à l’amant lui-même) puisque ledésir, allant toujours vers ce qui nous est le plus opposé,nous force d’aimer ce qui nous fera souffriri? Il entrecertainement dans le charme d’un être, dans l’attrait deses yeux, de sa bouche, de sa taille, les éléments,inconnus de nous, qui sont susceptibles de nous rendrele plus malheureux, si bien que nous sentir attiré verscet être, commencer à l’aimer, c’est, si innocent quenous le prétendions, lire déjà, dans une versiondifférente, toutes ses trahisons et ses fautes. Et cescharmes qui, pour m’attirer, matérialisaient ainsi lesparties nocives, dangereuses, mortelles, d’un être, peutêtreétaient-ils avec ces secrets poisons dans un rapportde cause à effet plus direct que ne le sont la luxurianceséductrice et le suc empoisonné de certaines fleursvénéneusesi? C’est peut-être, me disais-je, le vice luimêmed’<strong>Albertine</strong>, cause de mes souffrances futures,qui avait produit chez elle ces manières bonnes etfranches, donnant l’illusion qu’on avait avec elle lamême camaraderie loyale et sans restriction qu’avec un
homme, comme un vice parallèle avait produit chez M.de Charlus une finesse féminine de sensibilité etd’esprit. Au milieu du plus complet aveuglement, laperspicacité subsiste sous la forme même de laprédilection et de la tendresse. De sorte qu’on a tort deparler en amour de mauvais choix puisque, dès qu’il y achoix, il ne peut être que mauvais. « Est-ce que cespromenades aux Buttes-Chaumont eurent lieu quandvous veniez la chercher à la maisoni? dis-je à Andrée. –Oh,! non, du jour où <strong>Albertine</strong> fut revenue de Balbecavec vous, sauf ce que je vous ai dit, elle ne fit plusjamais rien avec moi. Elle ne me permettait même plusde lui parler de ces choses. – Mais, ma petite Andrée,pourquoi mentir encorei? Par le plus grand des hasards,car je ne cherche jamais à rien connaître, j’ai appris,jusque dans les détails les plus précis, des choses de cegenre qu’<strong>Albertine</strong> faisait, je peux vous préciser, aubord de l’eau, avec une blanchisseuse, quelques jours àpeine avant sa mort. – Ah,! peut-être après vous avoirquitté, cela je ne sais pas. Elle sentait qu’elle n’avait pu,ne pourrait plus jamais regagner votre confiance. » Cesderniers mots m’accablèrent. Puis je repensai au soir dela branche de seringa, je me rappelai qu’environ quinzejours après, comme ma jalousie changeaitsuccessivement d’objet, j’avais demandé à <strong>Albertine</strong> sielle n’avait jamais eu de relations avec Andrée, etqu’elle m’avait répondu.: « Oh,! jamais, certes j’adore
Andréei; j’ai pour elle une affection profonde, maiscomme pour une sœur, et même si j’avais les goûts quevous semblez croire, c’est la dernière personne à quij’aurais pensé pour cela. Je peux vous le jurer sur toutce que vous voudrez, sur ma tante, sur la tombe de mapauvre mère. » Je l’avais crue. Et pourtant, même si jen’avais pas été mis en méfiance par la contradictionentre ses demi-aveux d’autrefois relativement àcertaines choses et la netteté avec laquelle elle les avaitniées ensuite dès qu’elle avait vu que cela ne m’étaitpas égal, j’aurais dû me rappeler Swann persuadé duplatonisme des amitiés de M. de Charlus et mel’affirmant le soir même du jour où j’avais vu le giletieret le baron dans la cour. J’aurais dû penser qu’il y a l’undevant l’autre deux mondes, l’un constitué par leschoses que les êtres les meilleurs, les plus sincères,disent, et derrière lui le monde composé par lasuccession de ce que ces mêmes êtres fonti; si bien quequand une femme mariée vous dit d’un jeune homme.:« Oh,! c’est parfaitement vrai que j’ai une immenseamitié pour lui, mais c’est quelque chose de trèsinnocent, de très pur, je pourrais le jurer sur le souvenirde mes parents », on devrait soi-même, au lieu d’avoirune hésitation, se jurer qu’elle sort probablement ducabinet de toilette où, après chaque rendez-vous qu’ellea eu avec ce jeune homme, elle se précipite pourn’avoir pas d’enfants. La branche de seringa me rendait
mortellement triste, et aussi qu’<strong>Albertine</strong> m’eût cru,m’eût dit fourbe et la détestanti; plus que tout peut-être,des mensonges si inattendus que j’avais peine à lesassimiler à ma pensée. Un jour <strong>Albertine</strong> m’avaitraconté qu’elle avait été à un camp d’aviation, qu’elleétait amie de l’aviateur (sans doute pour détourner monsoupçon des femmes, pensant que j’étais moins jalouxdes hommes), que c’était amusant de voir commeAndrée était émerveillée devant cet aviateur, devanttous les hommages qu’il rendait à <strong>Albertine</strong>, au pointqu’Andrée avait voulu faire une promenade en avionavec lui. Or cela était inventé de toutes pièces, jamaisAndrée n’était allée dans ce camp d’aviation.Quand Andrée fut partie, l’heure du dîner étaitarrivée. « Tu ne devineras jamais qui m’a fait une visited’au moins trois heures, me dit ma mère. Je comptetrois heures, c’est peut-être plus, elle était arrivéepresque en même temps que la première personne, quiétait M me Cottard, a vu successivement, sans bouger,entrer et sortir mes différentes visites – et j’en ai eu plusde trente – et ne m’a quittée qu’il y a un quart d’heure.Si tu n’avais pas eu ton amie Andrée, je t’aurais faitappeler. – Mais enfin qui était-cei? – Une personne quine fait jamais de visites. – La princesse de Parmei? –Décidément, j’ai un fils plus intelligent que je necroyais. Ce n’est pas un plaisir de te faire chercher unnom, car tu trouves tout de suite. – Elle ne s’est pas
excusée de sa froideur d’hieri? – Non, ça aurait étéstupide, sa visite était justement cette excuse. Ta pauvregrand’mère aurait trouvé cela très bien. Il paraît qu’elleavait fait demander vers deux heures par un valet depied si j’avais un jour. On lui a répondu que c’étaitjustement aujourd’hui, et elle est montée. » Mapremière idée, que je n’osai pas dire à maman, fut quela princesse de Parme, entourée la veille de personnesbrillantes avec qui elle était très liée et avec qui elleaimait à causer, avait ressenti de voir entrer ma mère undépit qu’elle n’avait pas cherché à dissimuler. Et c’étaittout à fait dans le genre des grandes dames allemandes,qu’avaient, du reste, beaucoup adopté les Guermantes,cette morgue qu’on croyait réparer par une scrupuleuseamabilité. Mais ma mère crut, et j’ai cru ensuite commeelle, que tout simplement la princesse de Parme, nel’avait pas reconnue, n’avait pas cru devoir s’occuperd’elle, qu’elle avait appris après le départ de ma mèrequi elle était, soit par la duchesse de Guermantes quema mère avait rencontrée en bas, soit par la liste desvisiteuses auxquelles les huissiers avant qu’ellesentrassent demandaient leur nom pour l’inscrire sur unregistre. Elle avait trouvé peu aimable de faire dire oude dire à ma mère.: « Je ne vous ai pas reconnue »,mais, ce qui n’était pas moins conforme à la politessedes cours allemandes et aux façons Guermantes que mapremière version, avait pensé qu’une visite, chose
exceptionnelle de la part de l’Altesse, et surtout unevisite de plusieurs heures, fournirait à ma mère, sousune forme indirecte et tout aussi persuasive, cetteexplication, ce qui arriva en effet. Mais je ne m’attardaipas à demander à ma mère un récit de la visite de laprincesse, car je venais de me rappeler plusieurs faitsrelatifs à <strong>Albertine</strong> sur lesquels je voulais et j’avaisoublié d’interroger Andrée. Combien peu, d’ailleurs, jesavais, je saurais jamais de cette histoire d’<strong>Albertine</strong>, laseule histoire qui m’eût particulièrement intéressé, dumoins qui recommençait à m’intéresser à certainsmoments. Car l’homme est cet être sans âge fixe, cetêtre qui a la faculté de redevenir en quelques secondesde beaucoup d’années plus jeune, et qui entouré desparois du temps où il a vécu, y flotte, mais comme dansun bassin dont le niveau changerait constamment et lemettrait à portée tantôt d’une époque, tantôt d’uneautre. J’écrivis à Andrée de revenir. Elle ne le putqu’une semaine plus tard. Presque dès le début de savisite, je lui dis.: « En somme, puisque vous prétendezqu’<strong>Albertine</strong> ne faisait plus ce genre de choses quandelle vivait ici, d’après vous, c’est pour les faire pluslibrement qu’elle m’a quitté, mais pour quelle amiei? –Sûrement pas, ce n’est pas du tout pour cela. – Alorsparce que j’étais trop désagréablei? – Non, je ne croispas. Je crois qu’elle a été forcée de vous quitter par satante qui avait des vues pour elle sur cette canaille, vous
savez, ce jeune homme que vous appeliez « je suis dansles choux », ce jeune homme qui aimait <strong>Albertine</strong> etl’avait demandée. Voyant que vous ne l’épousiez pas,ils ont eu peur que la prolongation choquante de sonséjour chez vous n’empêchât ce jeune homme del’épouser. M me Bontemps, sur qui le jeune homme necessait de faire agir, a rappelé <strong>Albertine</strong>. <strong>Albertine</strong>, aufond, avait besoin de son oncle et de sa tante et quandelle a su qu’on lui mettait le marché en mains, elle vousa quitté. » Je n’avais jamais dans ma jalousie pensé àcette explication, mais seulement aux désirs d’<strong>Albertine</strong>pour les femmes et à ma surveillance, j’avais oubliéqu’il y avait aussi M me Bontemps qui pouvait trouverétrange un peu plus tard ce qui avait choqué ma mèredés le début. Du moins M me Bontemps craignait quecela ne choquât ce fiancé possible qu’elle lui gardaitcomme une poire pour la soif, si je ne l’épousais pas.Ce mariage était-il vraiment la raison du départd’<strong>Albertine</strong>, et par amour-propre, pour ne pas avoir l’airde dépendre de sa tante, ou de me forcer à l’épouser,n’avait-elle pas voulu le direi? Je commençais à merendre compte que le système des causes nombreusesd’une seule action, dont <strong>Albertine</strong> était adepte dans sesrapports avec ses amies quand elle laissait croire àchacune que c’était pour elle qu’elle était venue, n’étaitqu’une sorte de symbole artificiel, voulu, des différentsaspects que prend une action selon le point de vue où
on se place. L’étonnement et l’espèce de honte que jeressentais de ne pas m’être une seule fois ditqu’<strong>Albertine</strong> était chez moi dans une position fausse quipouvait ennuyer sa tante, cet étonnement, ce n’était pasla première fois, ce ne fut pas la dernière fois, que jel’éprouvai. Que de fois il m’est arrivé, après avoircherché à comprendre les rapports de deux êtres et lescrises qu’ils amènent, d’entendre tout d’un coup untroisième m’en parler à son point de vue à lui, car il ades rapports plus grands encore avec l’un des deux,point de vue qui a peut-être été la cause de la crise. Et siles actes restent ainsi incertains, comment les personneselles-mêmes ne le seraient-elles pasi? À entendre lesgens qui prétendaient qu’<strong>Albertine</strong> était une roublardequi avait cherché à se faire épouser par tel ou tel, iln’est pas difficile de supposer comment ils eussentdéfini sa vie chez moi. Et pourtant, à mon avis elle avaitété une victime, une victime peut-être pas tout à faitpure, mais dans ce cas coupable pour d’autres raisons, àcause de vices dont on ne parlait point. Mais il fautsurtout se dire ceci.: d’une part, le mensonge estsouvent un trait de caractèrei; d’autre part, chez desfemmes qui ne seraient pas sans cela menteuses, il estune défense naturelle, improvisée, puis de mieux enmieux organisée, contre ce danger subit et qui seraitcapable de détruire toute vie.: l’amour. D’autre part, cen’est pas l’effet du hasard si les êtres intellectuels et
sensibles se donnent toujours à des femmes insensibleset inférieures, et tiennent cependant à elles au point quela preuve qu’ils ne sont pas aimés ne les guéritnullement de tout sacrifier à conserver près d’eux unetelle femme. Si je dis que de tels hommes ont besoin desouffrir, je dis une chose exacte, en supprimant lesvérités préliminaires qui font de ce besoin –involontaire en un sens – de souffrir une conséquenceparfaitement compréhensible de ces vérités. Sanscompter que, les natures complètes étant rares, un êtretrès sensible et très intellectuel aura généralement peude volonté, sera le jouet de l’habitude et de cette peurde souffrir dans la minute qui vient, qui voue auxsouffrances perpétuelles – et que dans ces conditions ilne voudra jamais répudier la femme qui ne l’aime pas.On s’étonnera qu’il se contente de si peu d’amour, maisil faudra plutôt se représenter la douleur que peut luicauser l’amour qu’il ressent. Douleur qu’il ne faut pastrop plaindre, car il en est de ces terribles commotionsque nous donnent l’amour malheureux, le départ, lamort d’une amante, comme de ces attaques de paralysiequi nous foudroient d’abord, mais après lesquelles lesmuscles tendent peu à peu à reprendre leur élasticité,leur énergie vitales. De plus cette douleur n’est pas sanscompensation. Ces êtres intellectuels et sensibles sontgénéralement peu enclins au mensonge. Celui-ci lesprend d’autant plus au dépourvu que, même très
intelligents, ils vivent dans le monde des possibles,réagissent peu, vivent dans la douleur qu’une femmevient de leur infliger plutôt que dans la claire perceptionde ce qu’elle voulait, de ce qu’elle faisait, de celuiqu’elle aimait, perception donnée surtout aux naturesvolontaires et qui ont besoin de cela pour parer àl’avenir au lieu de pleurer le passé. Donc ces êtres sesentent trompés sans trop savoir comment. Par là lafemme médiocre, qu’on s’étonnait de les voir aimer,leur enrichit bien plus l’univers que n’eût fait unefemme intelligente. Derrière chacune de ses paroles, ilssentent un mensongei; derrière chaque maison où elledit être allée, une autre maisoni; derrière chaque action,chaque être une autre action, un autre être. Sans douteils ne savent pas lesquels, n’ont pas l’énergie,n’auraient peut-être pas la possibilité d’arriver à lesavoir. Une femme menteuse, avec un trucextrêmement simple, peut leurrer, sans se donner lapeine de le changer, des quantités de personnes et, quiplus est, la même, qui aurait dû le découvrir. Tout celacrée, en face de l’intellectuel sensible, un univers touten profondeurs que sa jalousie voudrait sonder et quin’est pas sans intéresser son intelligence.Sans être précisément de ceux-là j’allais peut-être,maintenant qu’<strong>Albertine</strong> était morte, savoir le secret desa vie. Mais cela, ces indiscrétions qui ne se produisentqu’après que la vie terrestre d’une personne est finie, ne
prouvent-elles pas que personne ne croit, au fond, à unevie futurei? Si ces indiscrétions sont vraies, on devraitredouter le ressentiment de celle dont on dévoile lesactions, autant pour le jour où on la rencontrera au ciel,qu’on le redoutait tant qu’elle vivait, lorsqu’on secroyait tenu à cacher son secret. Et si ces indiscrétionssont fausses, inventées parce qu’elle n’est plus là pourdémentir, on devrait craindre plus encore la colère de lamorte si on croyait au ciel. Mais personne n’y croit. Desorte qu’il était possible qu’un long drame se fût jouédans le cœur d’<strong>Albertine</strong> entre rester et me quitter, maisque me quitter fût à cause de sa tante, ou de ce jeunehomme, et pas à cause de femmes auxquelles peut-êtreelle n’avait jamais pensé. Le plus grave pour moi futqu’Andrée, qui n’avait pourtant plus rien à me cachersur les mœurs d’<strong>Albertine</strong>, me jura qu’il n’y avaitpourtant rien eu de ce genre entre <strong>Albertine</strong> d’une part,M lle Vinteuil et son amie d’autre part (<strong>Albertine</strong> ignoraitelle-même ses propres goûts quand elle les avaitconnues, et celles-ci, par cette peur de se tromper dansle sens qu’on désire, qui engendre autant d’erreurs quele désir lui-même, la considéraient comme très hostile àces choses. Peut-être bien, plus tard, avaient-elles apprissa conformité de goûts avec elles, mais alors ellesconnaissaient trop <strong>Albertine</strong> et <strong>Albertine</strong> les connaissaittrop pour qu’elles pussent songer à faire celaensemble). En somme, je ne comprenais toujours pas
davantage pourquoi <strong>Albertine</strong> m’avait quitté. Si lafigure d’une femme est difficilement saisissable auxyeux qui ne peuvent s’appliquer à toute cette surfacemouvante, aux lèvres, plus encore à la mémoire, si desnuages la modifient selon sa position sociale, selon lahauteur où l’on est situé, quel rideau plus épais encoreest tiré entre les actions de celle que nous voyons et sesmobiles. Les mobiles sont dans un plan plus profond,que nous n’apercevons pas, et engendrent d’ailleursd’autres actions que celles que nous connaissons etsouvent en absolue contradiction avec elles. À quelleépoque n’y a-t-il pas eu d’homme public, cru un saintpar ses amis, et qui soit découvert avoir fait des faux,volé l’État, trahi sa patriei? Que de fois un grandseigneur est volé par un intendant qu’il a élevé, dont ileût juré qu’il était un brave homme, et qui l’était peutêtrei?Or ce rideau tiré sur les mobiles d’autrui,combien devient-il plus impénétrable si nous avons del’amour pour cette personne, car il obscurcit notrejugement et les actions aussi de celle qui, se sentantaimée, cesse tout d’un coup d’attacher du prix à ce quien aurait eu sans cela pour elle, comme la fortune parexemple. Peut-être aussi est-elle poussée à feindre enpartie ce dédain de la fortune dans l’espoir d’obtenirplus en faisant souffrir. Le marchandage peut aussi semêler au reste. De même, des faits positifs de sa vie,une intrigue qu’elle n’a confiée à personne de peur
qu’elle ne nous fût révélée, que beaucoup malgré celaauraient peut-être connue s’ils avaient eu de laconnaître le même désir passionné que nous, en gardantplus de liberté d’esprit, en éveillant chez l’intéresséemoins de suspicions, une intrigue que certains peut-êtren’ont pas ignorée – mais certains que nous neconnaissons pas et que nous ne saurions où trouver. Etparmi toutes les raisons d’avoir avec nous une attitudeinexplicable, il faut faire entrer ces singularités ducaractère qui poussent un être, soit par négligence deson intérêt, soit par haine, soit par amour de la liberté,soit par de brusques impulsions de colère, ou par craintede ce que penseront certaines personnes, à faire lecontraire de ce que nous pensions. Et puis il y a lesdifférences de milieu, d’éducation, auxquelles on neveut pas croire parce que, quand on cause tous les deux,on les efface par les paroles, mais qui se retrouvent,quand on est seul, pour diriger les actes de chacun d’unpoint de vue si opposé qu’il n’y a pas de véritablerencontre possible. « Mais, ma petite Andrée, vousmentez encore. Rappelez-vous – vous-même me l’avezavoué – je vous ai téléphoné la veille, vous rappelezvous,qu’<strong>Albertine</strong> avait tant voulu, et en me le cachantcomme quelque chose que je ne devais pas savoir, allerà la matinée Verdurin où M lle Vinteuil devait venir. –Oui, mais <strong>Albertine</strong> ignorait absolument que M lleVinteuil dût y venir. – Commenti? Vous-même m’avez
dit que quelques jours avant elle avait rencontré M meVerdurin. D’ailleurs Andrée, inutile de nous tromperl’un l’autre. J’ai trouvé un papier un matin dans lachambre d’<strong>Albertine</strong>, un mot de M me Verdurin lapressant de venir à la matinée. » Et je lui montrai le motqu’en effet Françoise s’était arrangée pour me faire voiren le plaçant tout au-dessus des affaires d’<strong>Albertine</strong>quelques jours avant son départ, et, je le crains, en lelaissant là pour faire croire à <strong>Albertine</strong> que j’avaisfouillé dans ses affaires, pour lui faire savoir en tous casque j’avais vu ce papier. Et je m’étais souvent demandési cette ruse de Françoise n’avait pas été pour beaucoupdans le départ d’<strong>Albertine</strong> qui, voyant qu’elle nepouvait plus rien me cacher, se sentait découragée,vaincue. Je lui montrai le papier.: « Je n’ai aucunremords, tout excusée par ce sentiment si familial... »« Vous savez bien, Andrée, qu’<strong>Albertine</strong> avait toujoursdit que l’amie de M lle Vinteuil était, en effet, pour elleune mère, une sœur. – Mais vous avez mal compris cebillet. La personne que M me Verdurin voulait ce jour-làfaire rencontrer chez elle avec <strong>Albertine</strong>, ce n’était pasdu tout l’amie de M lle Vinteuil, c’était le fiancé « je suisdans les choux », et le sentiment familial est celui queM me Verdurin portait à cette crapule qui est, en effet,son neveu. Pourtant je crois qu’ensuite <strong>Albertine</strong> a suque M lle Vinteuil devait venir, M me Verdurin avait pu lelui faire savoir accessoirement. Certainement l’idée
qu’elle reverrait son amie lui avait fait plaisir, luirappelait un passé agréable, mais comme vous seriezcontent, si vous deviez aller dans un endroit, de savoirqu’Elstir y est, mais pas plus, pas même autant. Non, si<strong>Albertine</strong> ne voulait pas dire pourquoi elle voulait allerchez M me Verdurin, c’est qu’il y avait une répétition oùM me Verdurin avait convoqué très peu de personnes,parmi lesquelles ce neveu à elle que vous aviezrencontré à Balbec, que M me Bontemps voulait faireépouser à <strong>Albertine</strong> et avec qui <strong>Albertine</strong> voulait parler.C’est une jolie canaille. » Ainsi <strong>Albertine</strong>,contrairement à ce qu’avait cru autrefois la mèred’Andrée, avait eu, somme toute, un beau partibourgeois. Et quand elle avait voulu voir M me Verdurin,quand elle lui avait parlé en secret, quand elle avait étési fâchée que j’y fusse allé en soirée sans la prévenir,l’intrigue qu’il y avait entre elle et M me Verdurin avaitpour objet de lui faire rencontrer non M lle Vinteuil, maisle neveu qui aimait <strong>Albertine</strong> et pour qui M me Verdurins’entremettait, avec cette satisfaction de travailler à laréalisation d’un de ces mariages qui surprennent de lapart de certaines familles dans la mentalité de qui onn’entre pas complètement, croyant qu’elles tiennent àun mariage riche. Or jamais je n’avais repensé à ceneveu qui avait peut-être été le déniaiseur grâce auquelj’avais été embrassé la première fois par elle. Et à toutle plan des mobiles d’<strong>Albertine</strong> que j’avais construit il
fallait en substituer un autre, ou le lui superposer, carpeut-être il ne l’excluait pas, le goût pour les femmesn’empêchant pas de se marier. « Et puis, il n’y a pasbesoin de chercher tant d’explications, ajouta Andrée.Dieu sait combien j’aimais <strong>Albertine</strong> et quelle bonnecréature c’était, mais surtout depuis qu’elle avait eu lafièvre typhoïde (une année avant que vous ayez faitnotre connaissance à toutes), c’était un vrai cerveaubrûlé. Tout à coup elle se dégoûtait de ce qu’elle faisait,il fallait changer à la minute même, et elle ne savaitsans doute pas elle-même pourquoi. Vous rappelezvousla première année où vous êtes venu à Balbec,l’année où vous nous avez connuesi? Un beau jour elles’est fait envoyer une dépêche qui la rappelait à Paris,c’est à peine si on a eu le temps de faire ses malles. Orelle n’avait aucune raison de partir. Tous les prétextesqu’elle a donnés étaient faux. Paris était assommantpour elle à ce moment-là. Nous étions toutes encore àBalbec. Le golf n’était pas fermé, et même les épreuvespour la grande coupe, qu’elle avait tant désirée,n’étaient pas finies. Sûrement c’est elle qui l’aurait eue.Il n’y avait que huit jours à attendre. Eh bien, elle estpartie au galop,! Souvent je lui en avais reparlé depuis.Elle disait elle-même qu’elle ne savait pas pourquoi elleétait partie, que c’était le mal du pays (le pays, c’estParis, vous pensez si c’est probable), qu’elle sedéplaisait à Balbec, qu’elle croyait qu’il y avait des
gens qui se moquaient d’elle. » Et je me disais qu’il yavait cela de vrai dans ce que disait Andrée que, si desdifférences entre les esprits expliquent les impressionsdifférentes produites sur telle ou telle personne par unemême œuvre, les différences de sentiment,l’impossibilité de persuader une personne qui ne vousaime pas, il y a aussi les différences entre les caractères,les particularités d’un caractère qui sont aussi une caused’action. Puis je cessais de songer à cette explication etje me disais combien il est difficile de savoir la véritédans la vie. J’avais bien remarqué le désir et ladissimulation d’<strong>Albertine</strong> pour aller chez M me Verdurinet je ne m’étais pas trompé. Mais alors même qu’ontient ainsi un fait, des autres on ne perçoit quel’apparencei; car l’envers de la tapisserie, l’envers réelde l’action, de l’intrigue – aussi bien que celui del’intelligence, du cœur – se dérobe et nous ne voyonspasser que des silhouettes plates dont nous nousdisons.: c’est ceci, c’est celai; c’est à cause d’elle, ou detelle autre. La révélation que M lle Vinteuil devait venirm’avait paru l’explication d’autant plus logiquequ’<strong>Albertine</strong>, allant au-devant, m’en avait parlé. Et plustard n’avait-elle pas refusé de me jurer que la présencede M lle Vinteuil ne lui faisait aucun plaisiri? Et ici, àpropos de ce jeune homme, je me rappelai ceci quej’avais oublié.: peu de temps auparavant, pendantqu’<strong>Albertine</strong> habitait chez moi, je l’avais rencontré et il
avait été, contrairement à son attitude à Balbec,excessivement aimable, même affectueux avec moi,m’avait supplié de le laisser venir me voir, ce quej’avais refusé pour beaucoup de raisons. Or maintenantje comprenais que, tout bonnement, sachantqu’<strong>Albertine</strong> habitait la maison, il avait voulu se mettrebien avec moi pour avoir toutes facilités de la voir et deme l’enlever, et je conclus que c’était un misérable.Quelque temps après, lorsque furent jouées devant moiles premières œuvres de ce jeune homme, sans doute jecontinuai à penser que s’il avait tant voulu venir chezmoi, c’était à cause d’<strong>Albertine</strong>, et tout en trouvant celacoupable, je me rappelai que jadis si j’étais parti pourDoncières, voir Saint-Loup, c’était en réalité parce quej’aimais M me de Guermantes. Il est vrai que le casn’était pas le même, Saint-Loup n’aimant pas M me deGuermantes, si bien qu’il y avait dans ma tendressepeut-être un peu de duplicité, mais nulle trahison. Maisje songeai ensuite que cette tendresse qu’on éprouvepour celui qui détient le bien que vous désirez, onl’éprouve aussi si, ce bien, celui-là le détient même enl’aimant pour lui-même. Sans doute, il faut alors luttercontre une amitié qui conduira tout droit à la trahison.Et je crois que c’est ce que j’ai toujours fait. Mais pourceux qui n’en ont pas la force, on ne peut pas dire quechez eux l’amitié qu’ils affectent pour le détenteur soitune pure rusei; ils l’éprouvent sincèrement et à cause de
cela la manifestent avec une ardeur qui, une fois latrahison accomplie, fait que le mari ou l’amant trompépeut dire avec une indignation stupéfiée.: « Si vousaviez entendu les protestations d’affection que meprodiguait ce misérable,! Qu’on vienne voler un hommede son trésor, je le comprends encore. Mais qu’onéprouve le besoin diabolique de l’assurer d’abord deson amitié, c’est un degré d’ignominie et de perversitéqu’on ne peut imaginer. » Or il n’y a pas là une telleperversité, ni même mensonge tout à fait lucide.L’affection de ce genre que m’avait manifestée ce jourlàle pseudo-fiancé d’<strong>Albertine</strong> avait encore une autreexcuse, étant plus complexe qu’un simple dérivé del’amour pour <strong>Albertine</strong>. Ce n’est que depuis peu qu’ilse savait, qu’il s’avouait, qu’il voulait être proclamé unintellectuel. Pour la première fois les valeurs autres quesportives ou noceuses existaient pour lui. Le fait quej’eusse été estimé d’Elstir, de Bergotte, qu’<strong>Albertine</strong> luieût peut-être parlé de la façon dont je jugeais lesécrivains et dont elle se figurait que j’aurais pu écriremoi-même, faisait que tout d’un coup j’étais devenupour lui (pour l’homme nouveau qu’il s’apercevaitenfin être) quelqu’un d’intéressant avec qui il eût euplaisir à être lié, à qui il eût voulu confier ses projets,peut-être demander de le présenter à Elstir. De sortequ’il était sincère en demandant à venir chez moi, enm’exprimant une sympathie où des raisons
intellectuelles en même temps qu’un reflet d’<strong>Albertine</strong>mettaient de la sincérité. Sans doute ce n’était pas pourcela qu’il tenait tant à venir chez moi, et il eût toutlâché pour cela. Mais cette raison dernière, qui nefaisait guère qu’élever à une sorte de paroxysmepassionné les deux premières, il l’ignorait peut-être luimême,et les deux autres existaient réellement, commeavait pu réellement exister chez <strong>Albertine</strong>i; quand elleavait voulu aller, l’après-midi de la répétition, chez M meVerdurin, le plaisir parfaitement honnête qu’elle auraiteu à revoir des amies d’enfance qui pour elle n’étaientpas plus vicieuses qu’elle n’était pour celles-ci, à causeravec elles, à leur montrer, par sa seule présence chez lesVerdurin, que la pauvre petite fille qu’elles avaientconnue était maintenant invitée dans un salon marquant,le plaisir aussi qu’elle aurait peut-être eu à entendre dela musique de Vinteuil. Si tout cela était vrai, la rougeurqui était venue au visage d’<strong>Albertine</strong> quand j’avaisparlé de M lle Vinteuil venait de ce que je l’avais fait àpropos de cette matinée qu’elle avait voulu me cacher àcause de ce projet de mariage que je ne devais passavoir. Le refus d’<strong>Albertine</strong> de me jurer qu’elle n’auraiteu aucun plaisir à revoir à cette matinée M lle Vinteuilavait à ce moment-là augmenté mon tourment, fortifiémes soupçons, mais me prouvait rétrospectivementqu’elle avait tenu à être sincère, et même pour unechose innocente, peut-être justement parce que c’était
une chose innocente. Il restait ce qu’Andrée m’avait ditsur ses relations avec <strong>Albertine</strong>. Peut-être pourtant,même sans aller jusqu’à croire qu’Andrée les inventaitentièrement pour que je ne fusse pas heureux et nepusse pas me croire supérieur à elle, pouvais-je encoresupposer qu’elle avait un peu exagéré ce qu’elle faisaitavec <strong>Albertine</strong>, et qu’<strong>Albertine</strong>, par restriction mentale,diminuait aussi un peu ce qu’elle avait fait avec Andrée,se servant systématiquement de certaines définitionsque stupidement j’avais formulées sur ce sujet, trouvantque ses relations avec Andrée ne rentraient pas dans cequ’elle devait m’avouer et qu’elle pouvait les nier sansmentir. Mais pourquoi croire que c’était plutôt ellequ’Andrée qui mentaiti? La vérité et la vie sont bienardues, et il me restait d’elles, sans qu’en somme je lesconnusse, une impression où la tristesse était peut-êtreencore dominée par la fatigue.Quant à la troisième fois où je me souviens d’avoireu conscience que j’approchais de l’indifférenceabsolue à l’égard d’<strong>Albertine</strong> (et, cette dernière fois,jusqu’à sentir que j’y étais tout à fait arrivé), ce fut unjour, à Venise, assez longtemps après la dernière visited’Andrée.
Chapitre IIISéjour à VeniseMa mère m’avait emmené passer quelques semainesà Venise et – comme il peut y avoir de la beauté aussibien que dans les choses les plus humbles dans les plusprécieuses – j’y goûtais des impressions analogues àcelles que j’avais si souvent ressenties autrefois àCombray, mais transposées selon un mode entièrementdifférent et plus riche. Quand, à dix heures du matin, onvenait ouvrir mes volets, je voyais flamboyer, au lieudu marbre noir que devenaient en resplendissant lesardoises de Saint-Hilaire, l’Ange d’Or du campanile deSaint-Marc. Rutilant d’un soleil qui le rendait presqueimpossible à fixer, il me faisait avec ses bras grandsouverts, pour quand je serais, une demi-heure plus tard,sur la piazzetta, une promesse de joie plus certaine quecelle qu’il put être jadis chargé d’annoncer aux hommesde bonne volonté. Je ne pouvais apercevoir que lui tantque j’étais couché, mais comme le monde n’est qu’unvaste cadran solaire où un seul segment ensoleillé nouspermet de voir l’heure qu’il est, dès le premier matin jepensai aux boutiques de Combray sur la place de
l’Église, qui, le dimanche, étaient sur le point de fermerquand j’arrivais à la messe, tandis que la paille dumarché sentait fort sous le soleil déjà chaud. Mais dèsle second jour, ce que je vis en m’éveillant, ce pourquoije me levai (parce que cela s’était substitué dans mamémoire et dans mon désir aux souvenirs de Combray),ce furent les impressions de ma première sortie dumatin à Venise, à Venise où la vie quotidienne n’étaitpas moins réelle qu’à Combray, où comme à Combrayle dimanche matin on avait bien le plaisir de descendredans une rue en fête, mais où cette rue était toute en uneeau de saphir, rafraîchie de souffles tièdes, et d’unecouleur si résistante que mes yeux fatigués pouvaient,pour se détendre et sans craindre qu’elle fléchît, yappuyer leurs regards. Comme à Combray les bonnesgens de la rue de l’Oiseau, dans cette nouvelle vie aussiles habitants sortaient bien des maisons alignées l’une àcôté de l’autre dans la grande rue, mais ce rôle demaisons projetant un peu d’ombre à leurs pieds était, àVenise, confié à des palais de porphyre et de jaspe, audessusde la porte cintrée desquels la tête d’un Dieubarbu (en dépassant l’alignement, comme le marteaud’une porte à Combray) avait pour résultat de rendreplus foncé par son reflet, non le brun du sol mais le bleusplendide de l’eau. Sur la piazza l’ombre qu’eussentdéveloppée à Combray la toile du magasin denouveautés et l’enseigne du coiffeur, c’étaient les
petites fleurs bleues que sème à ses pieds sur le désertdu dallage ensoleillé le relief d’une façade Renaissance,non pas que, quand le soleil tapait fort, on ne fût obligé,à Venise comme à Combray, de baisser, au bord ducanal, des stores, mais ils étaient tendus entre lesquadrilobes et les rinceaux de fenêtres gothiques. J’endirai autant de celle de notre hôtel devant les balustresde laquelle ma mère m’attendait en regardant le canalavec une patience qu’elle n’eût pas montrée autrefois àCombray, en ce temps où, mettant en moi desespérances qui depuis n’avaient pas été réalisées, ellene voulait pas me laisser voir combien elle m’aimait.Maintenant elle sentait bien que sa froideur apparenten’eût plus rien changé, et la tendresse qu’elle meprodiguait était comme ces aliments défendus qu’on nerefuse plus aux malades quand il est assuré qu’ils nepeuvent guérir. Certes, les humbles particularités quifaisaient individuelle la fenêtre de la chambre de matante Léonie, sur la rue de l’Oiseau, son asymétrie àcause de la distance inégale entre les deux fenêtresvoisines, la hauteur excessive de son appui de bois, et labarre coudée qui servait à ouvrir les volets, les deuxpans de satin bleu et glacé qu’une embrasse divisait etretenait écartés, l’équivalent de tout cela existait à cethôtel de Venise où j’entendais aussi ces mots siparticuliers, si éloquents qui nous font reconnaître deloin la demeure où nous rentrons déjeuner, et plus tard
estent dans notre souvenir comme un témoignage quependant un certain temps cette demeure fut la nôtrei;mais le soin de les dire était, à Venise, dévolu, noncomme il l’était à Combray et comme il l’est un peupartout, aux choses les plus simples, voire les pluslaides, mais à l’ogive encore à demi arabe d’une façadequi est reproduite, dans tous les musées de moulages ettous les livres d’art illustrés, comme un des chefsd’œuvrede l’architecture domestique au moyen âgei;de bien loin et quand j’avais à peine dépassé Saint-Georges le Majeur, j’apercevais cette ogive qui m’avaitvu, et l’élan de ses arcs brisés ajoutait à son sourire debienvenue la distinction d’un regard plus élevé, etpresque incompris. Et parce que, derrière ses balustresde marbre de diverses couleurs, maman lisait enm’attendant, le visage contenu dans une voilette de tulled’un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux,pour moi qui sentais que ma mère l’avait, en cachantses larmes, ajoutée à son chapeau de paille, un peu pouravoir l’air « habillée » devant les gens de l’hôtel, maissurtout pour me paraître moins en deuil, moins triste,presque consolée de la mort de ma grand’mère, parceque, ne m’ayant pas reconnu tout de suite, dès que de lagondole je l’appelais elle envoyait vers moi, du fond deson cœur, son amour qui ne s’arrêtait que là où il n’yavait plus de matière pour le soutenir à la surface de sonregard passionné qu’elle faisait aussi proche de moi que
possible, qu’elle cherchait à exhausser, à l’avancée deses lèvres, en un sourire qui semblait m’embrasser, dansle cadre et sous le dais du sourire plus discret de l’ogiveilluminée par le soleil de midii; à cause de cela, cettefenêtre a pris dans ma mémoire la douceur des chosesqui eurent en même temps que nous, à côté de nous,leur part dans une certaine heure qui sonnait, la mêmepour nous et pour ellesi; et si pleins de formesadmirables que soient ses meneaux, cette fenêtre illustregarde pour moi l’aspect intime d’un homme de génieavec qui nous aurions passé un mois dans une mêmevillégiature, qui y aurait contracté pour nous quelqueamitié, et si depuis, chaque fois que je vois le moulagede cette fenêtre dans un musée, je suis obligé de retenirmes larmes, c’est tout simplement parce qu’elle me ditla chose qui peut le plus me toucher.: « Je me rappelletrès bien votre mère. »Et pour aller chercher maman qui avait quitté lafenêtre, j’avais bien en laissant la chaleur du plein aircette sensation de fraîcheur, jadis éprouvée à Combrayquand je montais dans ma chambrei; mais à Venisec’était un courant d’air marin qui l’entretenait, non plusdans un petit escalier de bois aux marches rapprochéesmais sur les nobles surfaces de degrés de marbre,éclaboussées à tout moment d’un éclair de soleilglauque, et qui à l’utile leçon de Chardin, reçueautrefois, ajoutaient celle de Véronèse. Et puisque à
Venise ce sont des œuvres d’art, des chosesmagnifiques, qui sont chargées de nous donner lesimpressions familières de la vie, c’est esquiver lecaractère de cette ville, sous prétexte que la Venise decertains peintres est froidement esthétique dans sapartie la plus célèbre, qu’en représenter seulement(exceptons les superbes études de Maxime Dethomas)les aspects misérables, là où ce qui fait sa splendeurs’efface, et pour rendre Venise plus intime et plus vraielui donner de la ressemblance avec Aubervilliers. Ce futle tort de très grands artistes, par une réaction biennaturelle contre la Venise factice des mauvais peintres,de s’être attachés uniquement à la Venise, qu’ilstrouvèrent plus réaliste, des humbles campi, des petitsrii abandonnés. C’était elle que j’explorais souventl’après-midi, si je ne sortais pas avec ma mère. J’ytrouvais plus facilement, en effet, de ces femmes dupeuple, les allumettières, les enfileuses de perles, lestravailleuses du verre ou de la dentelle, les petitesouvrières aux grands châles noirs à franges. Magondole suivait les petits canauxi; comme la mainmystérieuse d’un génie qui m’aurait conduit dans lesdétours de cette ville d’Orient, ils semblaient, au fur et àmesure que j’avançais, me pratiquer un chemin creuséen plein cœur d’un quartier qu’ils divisaient en écartantà peine d’un mince sillon arbitrairement tracé les hautesmaisons aux petites fenêtres mauresquesi; et, comme si
le guide magique avait tenu une bougie entre ses doigtset m’eût éclairé au passage, ils faisaient briller devanteux un rayon de soleil à qui ils frayaient sa route.On sentait qu’entre les pauvres demeures que lepetit canal venait de séparer et qui eussent sans celaformé un tout compact, aucune place n’avait étéréservée. De sorte que le campanile de l’église ou lestreilles des jardins surplombaient à pic le rio commedans une ville inondée. Mais pour les églises commepour les jardins, grâce à la même transposition que dansle Grand Canal, la mer se prêtait si bien à faire lafonction de voie de communication, de rue grande oupetite, que de chaque côté du canaletto les églisesmontaient de l’eau en ce vieux quartier populaire,devenues des paroisses humbles et fréquentées, portantsur elles le cachet de leur nécessité, de la fréquentationde nombreuses petites gensi; que les jardins traverséspar la percée du canal laissaient traîner dans l’eau leursfeuilles ou leurs fruits étonnés, et que, sur le rebord dela maison dont le grès grossièrement fendu était encorerugueux comme s’il venait d’être brusquement scié, desgamins surpris et gardant leur équilibre laissaientpendre leurs jambes bien d’aplomb, à la façon dematelots assis sur un pont mobile dont les deux moitiésviennent de s’écarter et ont permis à la mer de passerentre elles.Parfois apparaissait un monument plus beau, qui se
trouvait là comme une surprise dans une boîte que nousviendrions d’ouvrir, un petit temple d’ivoire avec sesordres corinthiens et sa statue allégorique au fronton, unpeu dépaysé parmi les choses usuelles au milieudesquelles il traînait, et le péristyle que lui réservait lecanal gardait l’air d’un quai de débarquement pourmaraîchers.Le soleil était encore haut dans le ciel quand j’allaisretrouver ma mère sur la piazzetta. Nous remontions leGrand Canal en gondole, nous regardions la file despalais entre lesquels nous passions refléter la lumière etl’heure sur leurs flancs rosés et changer avec elles,moins à la façon d’habitations privées et de monumentscélèbres que comme une chaîne de falaises de marbreau pied de laquelle on va se promener le soir en barquepour voir se coucher le soleil. Telles, les demeuresdisposées des deux côtés du chenal faisaient penser àdes sites de la nature, mais d’une nature qui aurait crééses œuvres avec une imagination humaine. Mais enmême temps (à cause du caractère des impressionstoujours urbaines que Venise donne presque en pleinemer, sur ces flots où le flux et le reflux se font sentirdeux fois par jour, et qui tour à tour recouvrent à maréehaute et découvrent à marée basse les magnifiquesescaliers extérieurs des palais), comme nous l’eussionsfait à Paris sur les boulevards, dans les Champs-Élysées, au Bois, dans toute large avenue à la mode,
parmi la lumière poudroyante du soir, nous croisions lesfemmes les plus élégantes, presque toutes étrangères, etqui, mollement appuyées sur les coussins de leuréquipage flottant, prenaient la file, s’arrêtaient devantun palais où elles avaient une amie à aller voir, faisaientdemander si elle était lài; et, tandis qu’en attendant laréponse elles préparaient à tout hasard leur carte pour lalaisser, comme elles eussent fait à la porte de l’hôtel deGuermantes, elles cherchaient dans leur guide de quelleépoque, de quel style était le palais, non sans êtresecouées comme au sommet d’une vague bleue, par leremous de l’eau étincelante et cabrée, qui s’effaraitd’être resserrée entre la gondole dansante et le marbreretentissant. Et ainsi les promenades, même rien quepour aller faire des visites ou des courses, étaient tripleset uniques dans cette Venise où les simples allées etvenues mondaines prennent en même temps la forme etle charme d’une visite à un musée et d’une bordée enmer.Plusieurs des palais du Grand Canal étaienttransformés en hôtels, et, par goût du changement oupar amabilité pour M me Sazerat que nous avionsretrouvée – la connaissance imprévue et inopportunequ’on rencontre chaque fois qu’on voyage – et quemaman avait invitée, nous voulûmes un soir essayer dedîner dans un hôtel qui n’était pas le nôtre et où l’onprétendait que la cuisine était meilleure. Tandis que ma
mère payait le gondolier et entrait avec M me Sazeratdans le salon qu’elle avait retenu, je voulus jeter uncoup d’œil sur la grande salle du restaurant aux beauxpiliers de marbre et jadis couverte tout entière defresques, depuis mal restaurées. Deux garçons causaienten un italien que je traduis.:« Est-ce que les vieux mangent dans leur chambrei?Ils ne préviennent jamais. C’est assommant, je ne saisjamais si je dois garder leur table (« non so se bisognaconservar loro la tavola »). Et puis, tant pis s’ilsdescendent et qu’ils la trouvent prise,! Je ne comprendspas qu’on reçoive des forestieri comme ça dans un hôtelaussi chic. C’est pas le monde d’ici. »Malgré son dédain, le garçon aurait voulu savoir cequ’il devait décider relativement à la table, et il allaitfaire demander au liftier de monter s’informer à l’étagequand, avant qu’il en eût le temps, la réponse lui futdonnée.: il venait d’apercevoir la vieille dame quientrait. Je n’eus pas de peine, malgré l’air de tristesse etde fatigue que donne l’appesantissement des années etmalgré une sorte d’eczéma, de lèpre rouge qui couvraitsa figure, à reconnaître sous son bonnet, dans sa cottenoire faite chez W..., mais, pour les profanes, pareille àcelle d’une vieille concierge, la marquise deVilleparisis. Le hasard fit que l’endroit où j’étais,debout, en train d’examiner les vestiges d’une fresque,se trouvait, le long des belles parois de marbre,
exactement derrière la table où venait de s’asseoir M mede Villeparisis.« Alors M. de Villeparisis ne va pas tarder àdescendre. Depuis un mois qu’ils sont ici ils n’ontmangé qu’une fois l’un sans l’autre », dit le garçon.Je me demandais quel était celui de ses parents aveclequel elle voyageait et qu’on appelait M. deVilleparisis, quand je vis, au bout de quelques instants,s’avancer vers la table et s’asseoir à côté d’elle son vieilamant, M. de Norpois.Son grand âge avait affaibli la sonorité de sa voix,mais donné en revanche à son langage, jadis si plein deréserve, une véritable intempérance. Peut-être fallait-ilen chercher la cause dans des ambitions qu’il sentait neplus avoir grand temps pour réaliser et qui leremplissaient d’autant plus de véhémence et de fouguei;peut-être dans le fait que, laissé à l’écart d’une politiqueoù il brûlait de rentrer, il croyait, dans la naïveté de sondésir, faire mettre à la retraite, par les sanglantescritiques qu’il dirigeait contre eux, ceux qu’il se faisaitfort de remplacer. Ainsi voit-on des politiciens assurésque le cabinet dont ils ne font pas partie n’en a pas pourtrois jours. Il serait, d’ailleurs, exagéré de croire que M.de Norpois avait perdu entièrement les traditions dulangage diplomatique. Dès qu’il était question de« grandes affaires » il se retrouvait, on va le voir,
l’homme que nous avons connu, mais le reste du tempsil s’épanchait sur l’un et sur l’autre avec cette violencesénile de certains octogénaires qui les jette sur desfemmes à qui ils ne peuvent plus faire grand mal.M me de Villeparisis garda, pendant quelquesminutes, le silence d’une vieille femme à qui la fatiguede la vieillesse a rendu difficile de remonter duressouvenir du passé au présent. Puis, dans cesquestions toutes pratiques où s’empreint leprolongement d’un mutuel amour.:– Êtes-vous passé chez Salviatii?– Oui.– Enverront-ils demaini?– J’ai rapporté moi-même la coupe. Je vous lamontrerai après le dîner. Voyons le menu.– Avez-vous donné l’ordre de bourse pour mesSuezi?– Non, l’attention de la Bourse est retenue en cemoment par les valeurs de pétrole. Mais il n’y a pas lieude se presser étant donné les excellentes dispositions dumarché. Voilà le menu. Il y a comme entrée desrougets. Voulez-vous que nous en prenionsi?– Moi, oui, mais vous, cela vous est défendu.Demandez à la place du risotto. Mais ils ne savent pasle faire.
– Cela ne fait rien. Garçon, apportez-nous d’aborddes rougets pour Madame et un risotto pour moi.Un nouveau et long silence.« Tenez, je vous apporte des journaux, le Corrieredella Sera, la Gazzetta del Popolo, etc. Est-ce que voussavez qu’il est fortement question d’un mouvementdiplomatique dont le premier bouc émissaire seraitPaléologue, notoirement insuffisant en Serbiei? Il seraitpeut-être remplacé par Lozé et il y aurait à pourvoir auposte de Constantinople. Mais, s’empressa d’ajouteravec âcreté M. de Norpois, pour une ambassade d’unetelle envergure et où il est de toute évidence que laGrande-Bretagne devra toujours, quoi qu’il arrive, avoirla première place à la table des délibérations, il seraitprudent de s’adresser à des hommes d’expériencemieux outillés pour résister aux embûches des ennemisde notre alliée britannique que des diplomates de lajeune école qui donneraient tête baissée dans lepanneau. » La volubilité irritée avec laquelle M. deNorpois prononça ces dernières paroles venait surtoutde ce que les journaux, au lieu de prononcer son nomcomme il leur avait recommandé de le faire, donnaientcomme « grand favori » un jeune ministre des Affairesétrangères. « Dieu sait si les hommes d’âge sontéloignés de se mettre, à la suite de je ne sais quellesmanœuvres tortueuses, aux lieu et place de plus oumoins incapables recrues,! J’en ai beaucoup connu de
tous ces prétendus diplomates de la méthode empirique,qui mettaient tout leur espoir dans un ballon d’essai queje ne tardais pas à dégonfler. Il est hors de doute, si legouvernement a le manque de sagesse de remettre lesrênes de l’État en des mains turbulentes, qu’à l’appel dudevoir un conscrit répondra toujours.: présent. Mais quisait (et M. de Norpois avait l’air de très bien savoir dequi il parlait) s’il n’en serait pas de même le jour oùl’on irait chercher quelque vétéran plein de savoir etd’adressei? À mon sens, chacun peut avoir sa manièrede voir, le poste de Constantinople ne devrait êtreaccepté qu’après un règlement de nos difficultéspendantes avec l’Allemagne. Nous ne devons rien àpersonne, et il est inadmissible que tous les six mois onvienne nous réclamer, par des manœuvres dolosives et ànotre corps défendant, je ne sais quel quitus, toujoursmis en avant par une presse de sportulaires. Il faut quecela finisse, et naturellement un homme de haute valeuret qui a fait ses preuves, un homme qui aurait, si je puisdire, l’oreille de l’empereur, jouirait de plus d’autoritéque quiconque pour mettre le point final au conflit. »Un monsieur qui finissait de dîner salua M. deNorpois.– Ah,! mais c’est le prince Foggi, dit le marquis.– Ah,! je ne sais pas au juste qui vous voulez dire,soupira M me de Villeparisis.
– Mais parfaitement si. C’est le prince Odon. C’estle propre beau-frère de votre cousine Doudeauville.Vous vous rappelez bien que j’ai chassé avec lui àBonnétablei?– Ah,! Odon, c’est celui qui faisait de la peinturei?– Mais pas du tout, c’est celui qui a épousé la sœurdu grand-duc N...M. de Norpois disait tout cela sur le ton assezdésagréable d’un professeur mécontent de son élève et,de ses yeux bleus, regardait fixement M me deVilleparisis.Quand le prince eut fini son café et quitta sa table,M. de Norpois se leva, marcha avec empressement verslui et, d’un geste majestueux, il s’écarta, et, s’effaçantlui-même, le présenta à M me de Villeparisis. Et pendantles quelques minutes que le prince demeura deboutauprès d’eux, M. de Norpois ne cessa un instant desurveiller M me de Villeparisis de sa pupille bleue, parcomplaisance ou sévérité de vieil amant, et surtout dansla crainte qu’elle ne se livrât à un des écarts de langagequ’il avait goûtés, mais qu’il redoutait. Dès qu’elledisait au prince quelque chose d’inexact il rectifiait lepropos et fixait les yeux de la marquise accablée etdocile, avec l’intensité continue d’un magnétiseur.Un garçon vint me dire que ma mère m’attendait, jela rejoignis et m’excusai auprès de M me Sazerat en
disant que cela m’avait amusé de voir M me deVilleparisis. À ce nom, M me Sazerat pâlit et sembla prèsde s’évanouir. Cherchant à se dominer.:– M me de Villeparisis, M lle de Bouilloni? me dit-elle.– Oui.– Est-ce que je ne pourrais pas l’apercevoir unesecondei? C’est le rêve de ma vie.– Alors ne perdez pas trop de temps, Madame, carelle ne tardera pas à avoir fini de dîner. Mais commentpeut-elle tant vous intéresseri?– Mais M me de Villeparisis, c’était en premièresnoces la duchesse d’Havré, belle comme un ange,méchante comme un démon, qui a rendu fou mon père,l’a ruiné et abandonné aussitôt après. Eh bien,! elle abeau avoir agi avec lui comme la dernière des filles,avoir été cause que j’ai dû, moi et les miens, vivrepetitement à Combray, maintenant que mon père estmort, ma consolation c’est qu’il ait aimé la plus bellefemme de son époque, et comme je ne l’ai jamais vue,malgré tout ce sera une douceur...Je menai M me Sazerat, tremblante d’émotion,jusqu’au restaurant et je lui montrai M me de Villeparisis.Mais comme les aveugles qui dirigent leurs yeuxailleurs qu’où il faut, M me Sazerat n’arrêta pas sesregards à la table où dînait M me de Villeparisis, et,cherchant un autre point de la salle.:
– Mais elle doit être partie, je ne la vois pas où vousme dites.Et elle cherchait toujours, poursuivant la visiondétestée, adorée, qui habitait son imagination depuis silongtemps.– Mais si, à la seconde table.– C’est que nous ne comptons pas à partir du mêmepoint. Moi, comme je compte, la seconde table, c’estune table où il y a seulement, à côté d’un vieuxmonsieur, une petite bossue, rougeaude, affreuse.– C’est elle,!Cependant, M me de Villeparisis ayant demandé à M.de Norpois de faire asseoir le prince Foggi, une aimableconversation suivit entre eux trois, on parla politique, leprince déclara qu’il était indifférent au sort du cabinet,et qu’il resterait encore une bonne semaine à Venise. Ilespérait que d’ici là toute crise ministérielle seraitévitée. Le prince Foggi crut au premier instant que cesquestions de politique n’intéressaient pas M. deNorpois, car celui-ci, qui jusque-là s’était exprimé avectant de véhémence, s’était mis soudain à garder unsilence presque angélique qui semblait ne pouvoirs’épanouir, si la voix revenait, qu’en un chant innocentet mélodieux de Mendelssohn ou de César Franck. Leprince pensait aussi que ce silence était dû à la réserved’un Français qui, devant un Italien, ne veut pas parler
des affaires de l’Italie. Or l’erreur du prince étaitcomplète. Le silence, l’air d’indifférence étaient restéschez M. de Norpois non la marque de la réserve mais leprélude coutumier d’une immixtion dans des affairesimportantes. Le marquis n’ambitionnait rien moins,comme nous l’avons vu, que Constantinople, avec unrèglement préalable des affaires allemandes, pourlequel il comptait forcer la main au cabinet de Rome.Le marquis jugeait, en effet, que de sa part un acted’une portée internationale pouvait être le dignecouronnement de sa carrière, peut-être même lecommencement de nouveaux honneurs, de fonctionsdifficiles auxquelles il n’avait pas renoncé. Car lavieillesse nous rend d’abord incapables d’entreprendremais non de désirer. Ce n’est que dans une troisièmepériode que ceux qui vivent très vieux ont renoncé audésir, comme ils ont dû abandonner l’action. Ils ne seprésentent même plus à des élections futiles où ilstentèrent si souvent de réussir, comme celle deprésident de la République. Ils se contentent de sortir,de manger, de lire les journaux, ils se survivent à euxmêmes.Le prince, pour mettre le marquis à l’aise et luimontrer qu’il le considérait comme un compatriote, semit à parler des successeurs possibles du président duConseil actuel. Successeurs dont la tâche serait difficile.Quand le prince Foggi eut cité plus de vingt noms
d’hommes politiques qui lui semblaient ministrables,noms que l’ancien ambassadeur écouta les paupières àdemi abaissées sur ses yeux bleus et sans faire unmouvement, M. de Norpois rompit enfin le silence pourprononcer ces mots qui devaient pendant vingt ansalimenter la conversation des chancelleries, et ensuite,quand on les crut oubliées, être exhumés par quelquepersonnalité signant « un Renseigné » ou « Testis » ou« Machiavel » dans un journal où l’oubli même où ilsétaient tombés leur vaut le bénéfice de faire à nouveausensation. Donc le prince Foggi venait de citer plus devingt noms devant le diplomate aussi immobile et muetqu’un homme sourd, quand M. de Norpois levalégèrement la tête et, dans la forme où avaient étérédigées ses interventions diplomatiques les plusgrosses de conséquence, quoique cette fois-ci avec uneaudace accrue et une brièveté moindre, demandafinement.: « Et est-ce que personne n’a prononcé lenom de M. Giolitti » À ces mots les écailles du princeFoggi tombèrenti; il entendit un murmure céleste. Puisaussitôt M. de Norpois se mit à parler de choses etautres, ne craignit pas de faire quelque bruit, comme,lorsque la dernière note d’un sublime aria de Bach estterminée, on ne craint plus de parler à haute voix,d’aller chercher ses vêtements au vestiaire. Il renditmême la cassure plus nette en priant le prince de mettreses hommages aux pieds de Leurs Majestés le Roi et la
Reine quand il aurait l’occasion de les voir, phrase dedépart qui correspondait à ce qu’est, à la fin d’unconcert, ces mots hurlés.: « Le cocher Auguste de la ruede Belloy ». Nous ignorons quelles furent exactementles impressions du prince Foggi. Il était assurément ravid’avoir entendu ce chef-d’œuvre.: « Et M. Giolitti, estceque personne n’a prononcé son nomi? » Car M. deNorpois, chez qui l’âge avait éteint ou désordonné lesqualités les plus belles, en revanche avait perfectionnéen vieillissant les « airs de bravoure », comme certainsmusiciens âgés, en déclin pour tout le reste, acquièrentjusqu’au dernier jour, pour la musique de chambre, unevirtuosité parfaite qu’ils ne possédaient pas jusque-là.Toujours est-il que le prince Foggi, qui comptaitpasser quinze jours à Venise, rentra à Rome le jourmême et fut reçu quelques jours après en audience parle Roi au sujet de propriétés que, nous croyons l’avoirdéjà dit, le prince possédait en Sicile. Le cabinet végétaplus longtemps qu’on n’aurait cru. À sa chute, le Roiconsulta divers hommes d’État sur le chef qu’ilconvenait de donner au nouveau cabinet. Puis il fitappeler M. Giolitti, qui accepta. Trois mois après, unjournal raconta l’entrevue du prince Foggi avec M. deNorpois. La conversation était rapportée comme nousl’avons fait, avec la différence qu’au lieu de dire « M.de Norpois demanda finement », on lisait.: « dit avec cefin et charmant sourire qu’on lui connaît ». M. de
Norpois jugea que « finement » avait déjà une forceexplosive suffisante pour un diplomate et que cetteadjonction était pour le moins intempestive. Il avaitbien demandé que le quai d’Orsay démentîtofficiellement, mais le quai d’Orsay ne savait où donnerde la tête. En effet, depuis que l’entrevue avait étédévoilée, M. Barrère télégraphiait plusieurs fois parheure avec Paris pour se plaindre qu’il y eût unambassadeur officieux au Quirinal et pour rapporter lemécontentement que ce fait avait produit dans l’Europeentière. Ce mécontentement n’existait pas, mais lesdivers ambassadeurs étaient trop polis pour démentir M.Barrère leur assurant que sûrement tout le monde étaitrévolté. M. Barrère, n’écoutant que sa pensée, prenaitce silence courtois pour une adhésion. Aussitôt iltélégraphiait à Paris.: « Je me suis entretenu une heuredurant avec le marquis Visconti-Venosta, etc. » Sessecrétaires étaient sur les dents.Pourtant M. de Norpois avait à sa dévotion un trèsancien journal français et qui même en 1870, quand ilétait ministre de France dans un pays allemand, lui avaitrendu grand service. Ce journal était (surtout le premierarticle, non signé) admirablement rédigé. Mais ilintéressait mille fois davantage quand ce premier article(dit premier-Paris dans ces temps lointains, et appeléaujourd’hui, on ne sait pourquoi, « éditorial ») était aucontraire mal tourné, avec des répétitions de mots
infinies. Chacun sentait alors avec émotion que l’articleavait été « inspiré ». Peut-être par M. de Norpois, peutêtrepar tel autre grand maître de l’heure. Pour donnerune idée anticipée des événements d’Italie, montronscomment M. de Norpois se servit de ce journal en 1870,inutilement trouvera-t-on, puisque la guerre eut lieu toutde mêmei; très efficacement, pensait M. de Norpois,dont l’axiome était qu’il faut avant tout préparerl’opinion. Ses articles, où chaque mot était pesé,ressemblaient à ces notes optimistes que suitimmédiatement la mort du malade. Par exemple, à laveille de la déclaration de guerre, en 1870, quand lamobilisation était presque achevée, M. de Norpois(restant dans l’ombre naturellement) avait cru devoirenvoyer à ce journal fameux, l’éditorial suivant.:« L’opinion semble prévaloir dans les cerclesautorisés que, depuis hier, dans le milieu de l’aprèsmidi,la situation, sans avoir, bien entendu, un caractèrealarmant, pourrait être envisagée comme sérieuse etmême, par certains côtés, comme susceptible d’êtreconsidérée comme critique. M. le marquis de Norpoisaurait eu plusieurs entretiens avec le ministre de Prusseafin d’examiner dans un esprit de fermeté et deconciliation, et d’une façon tout à fait concrète, lesdifférents motifs de friction existants, si l’on peut parlerainsi. La nouvelle n’a malheureusement pas été reçuepar nous, à l’heure où nous mettons sous presse, que
Leurs Excellences aient pu se mettre d’accord sur uneformule pouvant servir de base à un instrumentdiplomatique. »Dernière heure.: « On a appris avec satisfactiondans les cercles bien informés, qu’une légère détentesemble s’être produite dans les rapports francoprussiens.On attacherait une importance touteparticulière au fait que M. de Norpois aurait rencontré« unter den Linden » le ministre d’Angleterre, avec quiil s’est entretenu une vingtaine de minutes. Cettenouvelle est considérée comme satisfaisante. » (Onavait ajouté entre parenthèses, après satisfaisante, lemot allemand équivalent.: befriedigend.) Et lelendemain on lisait dans l’éditorial.: « Il semblerait,malgré toute la souplesse de M. de Norpois, à qui toutle monde se plaît à rendre hommage pour l’habileénergie avec laquelle il a su défendre les droitsimprescriptibles de la France, qu’une rupture n’a pluspour ainsi dire presque aucune chance d’être évitée. »Le journal ne pouvait pas se dispenser de fairesuivre un pareil éditorial de quelques commentaires,envoyés, bien entendu, par M. de Norpois. On a peutêtreremarqué dans les pages précédentes que le« conditionnel » était une des formes grammaticalespréférées de l’ambassadeur, dans la littératurediplomatique. (« On attacherait une importanceparticulière », pour « il paraît qu’on attache une
importance particulière ».) Mais le présent de l’indicatifpris non pas dans son sens habituel mais dans celui del’ancien optatif n’était pas moins cher à M. de Norpois.Les commentaires qui suivaient l’éditorial étaient ceuxci.:« Jamais le public n’a fait preuve d’un calme aussiadmirable. » (M. de Norpois aurait bien voulu que cefût vrai, mais craignait tout le contraire.) « Il est las desagitations stériles et a appris avec satisfaction que legouvernement de Sa Majesté prendrait sesresponsabilités selon les éventualités qui pourraient seproduire. Le public n’en demande « (optatif) » pasdavantage. À son beau sang-froid, qui est déjà un indicede succès, nous ajouterons encore une nouvelle bienfaite pour rassurer l’opinion publique, s’il en étaitbesoin. On assure, en effet, que M. de Norpois, qui,pour raison de santé, devait depuis longtemps venirfaire à Paris une petite cure, aurait quitté Berlin où il nejugeait plus sa présence utile. » Dernière heure. « SaMajesté l’Empereur a quitté ce matin Compiègne pourParis afin de conférer avec le marquis de Norpois, leministre de la Guerre et le maréchal Bazaine en quil’opinion publique a une confiance particulière. S. M.l’Empereur a décommandé le dîner qu’il devait offrir àsa belle-sœur la duchesse d’Albe. Cette mesure aproduit partout, dès qu’elle a été connue, uneimpression particulièrement favorable. L’Empereur a
passé en revue les troupes, dont l’enthousiasme estindescriptible. Quelques corps, sur un ordre demobilisation lancé dès l’arrivée des souverains à Paris,sont, à toute éventualité, prêts à partir dans la directiondu Rhin. »* * *Parfois, au crépuscule, en rentrant à l’hôtel je sentaisque l’<strong>Albertine</strong> d’autrefois, invisible à moi-même, étaitpourtant enfermée au fond de moi comme aux plombsd’une Venise intérieure, dont parfois un incident faisaitglisser le couvercle durci jusqu’à me donner uneouverture sur ce passé.Ainsi, par exemple, un soir une lettre de moncoulissier rouvrit un instant pour moi les portes de laprison où <strong>Albertine</strong> était en moi vivante, mais si loin, siprofondément qu’elle me restait inaccessible. Depuis samort je ne m’étais plus occupé des spéculations quej’avais faites afin d’avoir plus d’argent pour elle. Or letemps avait passéi; de grandes sagesses de l’époqueprécédente étaient démenties par celle-ci, comme il étaitarrivé autrefois de M. Thiers disant que les chemins defer ne pourraient jamais réussir. Les titres dont M. deNorpois nous avait dit.: « Leur revenu n’est pas trèsélevé sans doute, mais du moins le capital ne sera
jamais déprécié », étaient le plus souvent ceux quiavaient le plus baissé. Il me fallait payer des différencesconsidérables et d’un coup de tête je me décidai à toutvendre et me trouvai ne plus posséder que le cinquièmeà peine de ce que j’avais du vivant d’<strong>Albertine</strong>. On lesut à Combray dans ce qui restait de notre famille et denos relations, et, comme on savait que je fréquentais lemarquis de Saint-Loup et les Guermantes, on se dit.:« Voilà où mènent les idées de grandeur. » On y eût étébien étonné d’apprendre que c’était pour une jeune fillede condition aussi modeste qu’<strong>Albertine</strong> que j’avais faitces spéculations. D’ailleurs, dans cette vie de Combrayoù chacun est à jamais classé suivant les revenus qu’onlui connaît, comme dans une caste indienne, on n’eût puse faire une idée de cette grande liberté qui régnait dansle monde des Guermantes, où on n’attachait aucuneimportance à la fortune et où la pauvreté étaitconsidérée comme aussi désagréable, mais nullementplus diminuante et n’affectant pas plus la situationsociale, qu’une maladie d’estomac. Sans doute sefigurait-on au contraire, à Combray que Saint-Loup etM. de Guermantes devaient être des nobles ruinés, auxchâteaux hypothéqués, à qui je prêtais de l’argent,tandis que si j’avais été ruiné ils eussent été lespremiers à m’offrir vraiment de me venir en aide. Quantà ma ruine relative, j’en étais d’autant plus ennuyé quemes curiosités vénitiennes s’étaient concentrées depuis
peu sur une jeune marchande de verrerie, à la carnationde fleur qui fournissait aux yeux ravis toute une gammede tons orangés et me donnait un tel désir de la revoirchaque jour que, sentant que nous quitterions bientôtVenise, ma mère et moi, j’étais résolu à tâcher de luifaire à Paris une situation quelconque qui me permît dene pas me séparer d’elle. La beauté de ses dix-sept ansétait si noble, si radieuse, que c’était un vrai Titien àacquérir avant de s’en aller. Et le peu qui me restait defortune suffirait-il à la tenter assez pour qu’elle quittâtson pays et vînt vivre à Paris pour moi seuli? Maiscomme je finissais la lettre du coulissier, une phrase oùil disait.: « Je soignerai vos reports » me rappela uneexpression presque aussi hypocritement professionnelleque la baigneuse de Balbec avait employée en parlant àAimé d’<strong>Albertine</strong>.: « C’est moi qui la soignais », avaitelledit, et ces mots, qui ne m’étaient jamais revenus àl’esprit, firent jouer comme un Sésame les gonds ducachot. Mais au bout d’un instant ils se refermèrent surl’emmurée – que je n’étais pas coupable de ne pasvouloir rejoindre, puisque je ne parvenais plus à la voir,à me la rappeler, et que les êtres n’existent pour nousque par l’idée que nous avons d’eux – que m’avait uninstant rendue si touchante le délaissement, quepourtant elle ignorait, que j’avais, l’espace d’un éclair,envié le temps déjà lointain où je souffrais nuit et jourdu compagnonnage de son souvenir. Une autre fois, à
San Giorgio dei Schiavoni, un aigle auprès d’un desapôtres et stylisé de la même façon réveilla le souveniret presque la souffrance causée par les deux baguesdont Françoise m’avait découvert la similitude et dontje n’avais jamais su qui les avait données à <strong>Albertine</strong>.Un soir enfin, une circonstance telle se produisit qu’ilsembla que mon amour aurait dû renaître. Au momentoù notre gondole s’arrêta aux marches de l’hôtel, leportier me remit une dépêche que l’employé dutélégraphe était déjà venu trois fois pour m’apporter,car, à cause de l’inexactitude du nom du destinataire(que je compris pourtant, à travers les déformations desemployés italiens, être le mien), on demandait unaccusé de réception certifiant que le télégramme étaitbien pour moi. Je l’ouvris dès que je fus dans machambre, et, jetant un coup d’œil sur ce libellé remplide mots mal transmis, je pus lire néanmoins.: « Monami, vous me croyez morte, pardonnez-moi, je suis trèsvivante, je voudrais vous voir, vous parler mariage,quand revenez-vousi? Tendrement, <strong>Albertine</strong>. » Alors ilse passa, d’une façon inverse, la même chose que pourma grand’mère.: quand j’avais appris en fait que magrand’mère était morte, je n’avais d’abord eu aucunchagrin. Et je n’avais souffert effectivement de sa mortque quand des souvenirs involontaires l’avaient renduevivante pour moi. Maintenant qu’<strong>Albertine</strong> dans mapensée ne vivait plus pour moi, la nouvelle qu’elle était
vivante ne me causa pas la joie que j’aurais cru.<strong>Albertine</strong> n’avait été pour moi qu’un faisceau depensées, elle avait survécu à sa mort matérielle tant queces pensées vivaient en moii; en revanche, maintenantque ces pensées étaient mortes, <strong>Albertine</strong> ne ressuscitaitnullement pour moi avec son corps. Et en m’apercevantque je n’avais pas de joie qu’elle fût vivante, que je nel’aimais plus, j’aurais dû être plus bouleversé quequelqu’un qui, se regardant dans une glace après desmois de voyage ou de maladie, s’aperçoit qu’il a descheveux blancs et une figure nouvelle d’homme mûr oude vieillard. Cela bouleverse parce que cela veut dire.:l’homme que j’étais, le jeune homme blond n’existeplus, je suis un autre. Or l’impression que j’éprouvaisne prouvait-elle pas un changement aussi profond, unemort aussi totale du moi ancien et la substitution aussicomplète d’un moi nouveau à ce moi ancien, que la vued’un visage ridé surmonté d’une perruque blancheremplaçant le visage de jadisi? Mais on ne s’afflige pasplus d’être devenu un autre, les années ayant passé etdans l’ordre de la succession des temps, qu’on nes’afflige à une même époque d’être tour à tour les êtrescontradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, lemufle, le désintéressé, l’ambitieux qu’on est tour à tourchaque journée. Et la raison pour laquelle on ne s’enafflige pas est la même, c’est que le moi éclipsé –momentanément dans le dernier cas et quand il s’agit
du caractère, pour toujours dans le premier cas et quandil s’agit des passions – n’est pas là pour déplorerl’autre, l’autre qui est à ce moment-là, ou désormais,tout vousi; le mufle sourit de sa muflerie car il est lemufle, et l’oublieux ne s’attriste pas de son manque demémoire, précisément parce qu’il a oublié.J’aurais été incapable de ressusciter <strong>Albertine</strong> parceque je l’étais de me ressusciter moi-même, deressusciter mon moi d’alors. La vie, selon son habitudequi est, par des travaux incessants d’infiniment petits,de changer la face du monde, ne m’avait pas dit aulendemain de la mort d’<strong>Albertine</strong>.: « Sois un autre »,mais, par des changements trop imperceptibles pour mepermettre de me rendre compte du fait même duchangement, avait presque tout renouvelé en moi, desorte que ma pensée était déjà habituée à son nouveaumaître – mon nouveau moi – quand elle s’aperçut qu’ilétait changéi; c’était à celui-ci qu’elle tenait. Matendresse pour <strong>Albertine</strong>, ma jalousie tenaient, on l’avu, à l’irradiation par association d’idées de certainesimpressions douces ou douloureuses, au souvenir deM lle Vinteuil à Montjouvain, aux doux baisers du soirqu’<strong>Albertine</strong> me donnait dans le cou. Mais au fur et àmesure que ces impressions s’étaient affaiblies,l’immense champ d’impressions qu’elles coloraientd’une teinte angoissante ou douce avait repris des tonsneutres. Une fois que l’oubli se fut emparé de quelques
points dominants de souffrance et de plaisir, larésistance de mon amour était vaincue, je n’aimais plus<strong>Albertine</strong>. J’essayais de me la rappeler. J’avais eu unjuste pressentiment quand, deux jours après le départd’<strong>Albertine</strong>, j’avais été épouvanté d’avoir pu vivrequarante-huit heures sans elle. Il en avait été de mêmequand j’avais écrit autrefois à Gilberte en me disant.: sicela continue deux ans, je ne l’aimerai plus. Et si,quand Swann m’avait demandé de revoir Gilberte, celam’avait paru l’incommodité d’accueillir une morte,pour <strong>Albertine</strong> la mort – ou ce que j’avais cru la mort –avait fait la même œuvre que pour Gilberte la ruptureprolongée. La mort n’agit que comme l’absence. Lemonstre à l’apparition duquel mon amour avaitfrissonné, l’oubli, avait bien, comme je l’avais cru, finipar le dévorer. Non seulement cette nouvelle qu’elleétait vivante ne réveilla pas mon amour, non seulementelle me permit de constater combien était déjà avancémon retour vers l’indifférence, mais elle lui fitinstantanément subir une accélération si brusque que jeme demandai rétrospectivement si jadis la nouvellecontraire, celle de la mort d’<strong>Albertine</strong>, n’avait pasinversement, en parachevant l’œuvre de son départ,exalté mon amour et retardé son déclin. Et maintenantque la savoir vivante et pouvoir être réuni à elle me larendait tout d’un coup si peu précieuse, je medemandais si les insinuations de Françoise, la rupture
elle-même, et jusqu’à la mort (imaginaire mais crueréelle) n’avaient pas prolongé mon amour, tant lesefforts des tiers, et même du destin, nous séparant d’unefemme, ne font que nous attacher à elle. Maintenantc’était le contraire qui se produisait. D’ailleurs,j’essayai de me la rappeler, et peut-être parce que jen’avais plus qu’un signe à faire pour l’avoir à moi, lesouvenir qui me vint fut celui d’une fille fort grosse,hommasse, dans le visage fané de laquelle saillait déjà,comme une graine, le profil de M me Bontemps. Cequ’elle avait pu faire avec Andrée ou d’autres nem’intéressait plus. Je ne souffrais plus du mal quej’avais cru si longtemps inguérissable, et, au fond,j’aurais pu le prévoir. Certes, le regret d’une maîtresse,la jalousie survivante sont des maladies physiques aumême titre que la tuberculose ou la leucémie. Pourtant,entre les maux physiques il y a lieu de distinguer ceuxqui sont causés par un agent purement physique et ceuxqui n’agissent sur le corps que par l’intermédiaire del’intelligence. Si la partie de l’intelligence qui sert delien de transmission est la mémoire – c’est-à-dire si lacause est anéantie ou éloignée – si cruelle que soit lasouffrance, si profond que paraisse le trouble apportédans l’organisme, il est bien rare, la pensée ayant unpouvoir de renouvellement ou plutôt une impuissancede conservation que n’ont pas les tissus, que lepronostic ne soit pas favorable. Au bout du même
temps où un malade atteint de cancer sera mort, il estbien rare qu’un veuf, un père inconsolables ne soientpas guéris. Je l’étais. Est-ce pour cette fille que jerevoyais en ce moment si bouffie et qui avaitcertainement vieilli comme avaient vieilli les fillesqu’elle avait aimées, est-ce pour elle qu’il fallaitrenoncer à l’éclatante fille qui était mon souvenird’hier, mon espoir de demain (à qui je ne pourrais riendonner, non plus qu’à aucune autre, si j’épousais<strong>Albertine</strong>), renoncer à cette <strong>Albertine</strong> nouvelle, nonpoint « telle que l’ont vue les enfers » mais fidèle, et« même un peu farouche »i? C’était elle qui étaitmaintenant ce qu’<strong>Albertine</strong> avait été autrefois.: monamour pour <strong>Albertine</strong> n’avait été qu’une formepassagère de ma dévotion à la jeunesse. Nous croyonsaimer une jeune fille, et nous n’aimons hélas,! en elleque cette aurore dont son visage reflètemomentanément la rougeur. La nuit passa. Au matin jerendis la dépêche au portier de l’hôtel en disant qu’onme l’avait remise par erreur et qu’elle n’était pas pourmoi. Il me dit que maintenant qu’elle avait été ouverteil aurait des difficultés, qu’il valait mieux que je lagardassei; je la remis dans ma poche, mais je promis defaire comme si je ne l’avais jamais reçue. J’avaisdéfinitivement cessé d’aimer <strong>Albertine</strong>. De sorte quecet amour, après s’être tellement écarté de ce quej’avais prévu d’après mon amour pour Gilberte, après
m’avoir fait faire un détour si long et si douloureux,finissait lui aussi, après y avoir fait exception, parrentrer, tout comme mon amour pour Gilberte, dans latoi générale de l’oubli.Mais alors je songeai.: je tenais à <strong>Albertine</strong> plusqu’à moi-mêmei; je ne tiens plus à elle maintenantparce que pendant un certain temps j’ai cessé de la voir.Mais mon désir de ne pas être séparé de moi-même parla mort, de ressusciter après la mort, ce désir-là n’étaitpas comme le désir de ne jamais être séparéd’<strong>Albertine</strong>, il durait toujours. Cela tenait-il à ce que jeme croyais plus précieux qu’elle, à ce que quand jel’aimais je m’aimais davantagei? Non, cela tenait à ceque cessant de la voir j’avais cessé de l’aimer, et que jen’avais pas cessé de m’aimer parce que mes liensquotidiens avec moi-même n’avaient pas été rompuscomme l’avaient été ceux avec <strong>Albertine</strong>. Mais si ceuxavec mon corps, avec moi-même, l’étaient aussi...i?Certes il en serait de même. Notre amour de la vie n’estqu’une vieille liaison dont nous ne savons pas nousdébarrasser. Sa force est dans sa permanence. Mais lamort qui la rompt nous guérira du désir del’immortalité.Après le déjeuner, quand je n’allais pas errer seuldans Venise, je montais me préparer dans ma chambrepour sortir avec ma mère. Aux brusques à-coups descoudes du mur qui lui faisaient rentrer ses angles, je
sentais les restrictions édictées par la mer, laparcimonie du sol. Et en descendant pour rejoindremaman qui m’attendait, à cette heure où à Combray ilfaisait si bon goûter le soleil tout proche, dansl’obscurité conservée par les volets clos, ici, du haut enbas de l’escalier de marbre dont on ne savait pas plusque dans une peinture de la Renaissance s’il était dressédans un palais ou sur une galère, la même fraîcheur et lemême sentiment de la splendeur du dehors étaientdonnés grâce au velum qui se mouvait devant lesfenêtres perpétuellement ouvertes et par lesquelles,dans un incessant courant d’air, l’ombre tiède et lesoleil verdâtre filaient comme sur une surface flottanteet évoquaient le voisinage mobile, l’illumination, lamiroitante instabilité du flot.Le soir, je sortais seul, au milieu de la villeenchantée où je me trouvais au milieu de quartiersnouveaux comme un personnage des Mille et une Nuits.Il était bien rare que je ne découvrisse pas au hasard demes promenades quelque place inconnue et spacieusedont aucun guide, aucun voyageur ne m’avait parlé.Je m’étais engagé dans un réseau de petites ruelles,de calli divisant en tous sens, de leurs rainures, lemorceau de Venise découpé entre un canal et la lagune,comme s’il avait cristallisé suivant ces formesinnombrables, ténues et minutieuses. Tout à coup, aubout d’une de ces petites rues, il semblait que dans la
matière cristallisée se fût produite une distension. Unvaste et somptueux campo à qui je n’eusse assurémentpas, dans ce réseau de petites rues, pu deviner cetteimportance, ni même trouver une place, s’étendaitdevant moi entouré de charmants palais pâles de clairde lune. C’était un de ces ensembles architecturaux verslesquels, dans une autre ville, les rues se dirigent, vousconduisent et le désignent. Ici, il semblait exprès cachédans un entre-croisement de ruelles, comme ces palaisdes contes orientaux où on mène la nuit un personnagequi, ramené chez lui avant le jour, ne doit pas pouvoirretrouver la demeure magique où il finit par croire qu’iln’est allé qu’en rêve.Le lendemain je partais à la recherche de ma belleplace nocturne, je suivais des calli qui se ressemblaienttoutes et se refusaient à me donner le moindrerenseignement, sauf pour m’égarer mieux. Parfois unvague indice que je croyais reconnaître me faisaitsupposer que j’allais voir apparaître, dans saclaustration, sa solitude et son silence, la belle placeexilée. À ce moment, quelque mauvais génie qui avaitpris l’apparence d’une nouvelle calle me faisaitrebrousser chemin malgré moi, et je me trouvaisbrusquement ramené au Grand Canal. Et comme il n’ya pas, entre le souvenir d’un rêve et le souvenir d’uneréalité, de grandes différences, je finissais par medemander si ce n’était pas pendant mon sommeil que
s’était produit, dans un sombre morceau decristallisation vénitienne, cet étrange flottement quioffrait une vaste place, entourée de palais romantiques,à la méditation du clair de lune.La veille de notre départ, nous voulûmes pousserjusqu’à Padoue où se trouvaient ces Vices et ces Vertusdont Swann m’avait donné les reproductionsi; aprèsavoir traversé en plein soleil le jardin de l’Arena,j’entrai dans la chapelle des Giotto, où la voûte entièreet le fond des fresques sont si bleus qu’il semble que laradieuse journée ait passé le seuil, elle aussi, avec levisiteur et soit venue un instant mettre à l’ombre et aufrais son ciel pur, à peine un peu plus foncé d’êtredébarrassé des dorures de la lumière, comme en cescourts répits dont s’interrompent les plus beaux joursquand, sans qu’on ait vu aucun nuage, le soleil ayanttourné son regard ailleurs pour un moment, l’azur, plusdoux encore, s’assombrit. Dans ce ciel, sur la pierrebleuie, des anges volaient avec une telle ardeur céleste,ou au moins enfantine, qu’ils semblaient des volatilesd’une espèce particulière ayant existé réellement, ayantdû figurer dans l’histoire naturelle des temps bibliqueset évangéliques, et qui ne manquent pas de volterdevant les saints quand ceux-ci se promènenti; il y en atoujours quelques-uns de lâchés au-dessus d’eux, et,comme ce sont des créatures réelles et effectivementvolantes, on les voit s’élevant, décrivant des courbes,
mettant la plus grande aisance à exécuter des loopings,fondant vers le sol la tête en bas à grand renfort d’ailesqui leur permettent de se maintenir dans des conditionscontraires aux lois de la pesanteur, et ils font beaucoupplutôt penser à une variété d’oiseaux ou à de jeunesélèves de Garros s’exerçant au vol plané qu’aux angesde l’art de la Renaissance et des époques suivantes,dont les ailes ne sont plus que des emblèmes et dont lemaintien est habituellement le même que celui depersonnages célestes qui ne seraient pas ailés.* * *Quand j’appris, le jour même où nous allions rentrerà Paris, que M me Putbus, et par conséquent sa femme dechambre, venaient d’arriver à Venise, je demandai à mamère de remettre notre départ de quelques joursi; l’airqu’elle eut de ne pas prendre ma prière en considérationni même au sérieux réveilla dans mes nerfs excités parle printemps vénitien ce vieux désir de résistance à uncomplot imaginaire tramé contre moi par mes parents(qui se figuraient que je serais bien forcé d’obéir), cettevolonté de lutte, ce désir qui me poussait jadis àimposer brusquement ma volonté à ceux que j’aimais leplus, quitte à me conformer à la leur après que j’avaisréussi à les faire céder. Je dis à ma mère que je ne
partirais pas, mais elle, croyant plus habile de ne pasavoir l’air de penser que je disais cela sérieusement, neme répondit même pas. Je repris qu’elle verrait bien sic’était sérieux ou non. Et quand fut venue l’heure où,suivie de toutes mes affaires, elle partit pour la gare, jeme fis apporter une consommation sur la terrasse,devant le canal, et m’y installai, regardant se coucher lesoleil tandis que sur une barque arrêtée en face del’hôtel un musicien chantait « sole mio ».Le soleil continuait de descendre. Ma mère ne devaitpas être loin de la gare. Bientôt, elle serait partie, jeserais seul à Venise, seul avec la tristesse de la savoirpeinée par moi, et sans sa présence pour me consoler.L’heure du train approchait. Ma solitude irrévocableétait si prochaine qu’elle me semblait déjà commencéeet totale. Car je me sentais seul. Les choses m’étaientdevenues étrangères. Je n’avais plus assez de calmepour sortir de mon cœur palpitant et introduire en ellesquelque stabilité. La ville que j’avais devant moi avaitcessé d’être Venise. Sa personnalité, son nom, mesemblaient comme des fictions menteuses que jen’avais plus le courage d’inculquer aux pierres. Lespalais m’apparaissaient réduits à leurs simples parties,quantités de marbre pareilles à toutes les autres, et l’eaucomme une combinaison d’hydrogène et d’oxygène,éternelle, aveugle, antérieure et extérieure à Venise,ignorante des Doges et de Turner. Et cependant ce lieu
quelconque était étrange comme un lieu où on vientd’arriver, qui ne vous connaît pas encore – comme unlieu d’où l’on est parti et qui vous a déjà oublié. Je nepouvais plus rien lui dire de moi, je ne pouvais rienlaisser de moi poser sur lui, il me laissait contracté, jen’étais plus qu’un cœur qui battait et qu’une attentionsuivant anxieusement le développement de « solemio ». J’avais beau raccrocher désespérément mapensée à la belle coudée caractéristique du Rialto, ilm’apparaissait, avec la médiocrité de l’évidence,comme un pont non seulement inférieur, mais aussiétranger à l’idée que j’avais de lui qu’un acteur dont,malgré sa perruque blonde et son vêtement noir, noussavons bien qu’en son essence il n’est pas Hamlet. Telsles palais, le Canal, le Rialto, se trouvaient dévêtus del’idée qui faisait leur individualité et dissous en leursvulgaires éléments matériels. Mais en même temps celieu médiocre me semblait lointain. Dans le bassin del’arsenal, à cause d’un élément scientifique lui aussi, lalatitude, il y avait cette singularité des choses qui,même semblables en apparence à celles de notre pays,se révèlent étrangères, en exil sous d’autres cieuxi; jesentais que cet horizon si voisin, que j’aurais puatteindre en une heure, c’était une courbure de la terretout autre que celle des mers de France, une courburelointaine qui se trouvait, par l’artifice du voyage,amarrée près de moii; si bien que ce bassin de l’arsenal,
à la fois insignifiant et lointain, me remplissait de cemélange de dégoût et d’effroi que j’avais éprouvé toutenfant la première fois que j’accompagnai ma mère auxbains Delignyi; en effet, dans le site fantastiquecomposé par une eau sombre que ne couvraient pas leciel ni le soleil et que cependant, borné par des cabines,on sentait communiquer avec d’invisibles profondeurscouvertes de corps humains en caleçon, je m’étaisdemandé si ces profondeurs, cachées aux mortels pardes baraquements qui ne les laissaient pas soupçonnerde la rue, n’étaient pas l’entrée des mers glaciales quicommençaient là, si les pôles n’y étaient pas compris, etsi cet étroit espace n’était pas précisément la mer libredu pôle. Cette Venise sans sympathie pour moi, oùj’allais rester seul, ne me semblait pas moins isolée,moins irréelle, et c’était ma détresse que le chant de« sole moi », s’élevant comme une déploration de laVenise que j’avais connue, semblait prendre à témoin.Sans doute il aurait fallu cesser de l’écouter si j’avaisvoulu pouvoir rejoindre encore ma mère et prendre letrain avec ellei; il aurait fallu décider sans perdre uneseconde que je partais, mais c’est justement ce que je nepouvais pasi; je restais immobile, sans être capable nonseulement de me lever mais même de décider que je melèverais.Ma pensée, sans doute pour ne pas envisager unerésolution à prendre, s’occupait tout entière à suivre le
déroulement des phrases successives de « sole moi » enchantant mentalement avec le chanteur, à prévoir pourchacune d’elles l’élan qui allait l’emporter, à m’ylaisser aller avec elle, avec elle aussi à retomberSans doute ce chant insignifiant, entendu cent fois,ne m’intéressait nullement. Je ne pouvais faire plaisir àreligieusement jusqu’au bout. Enfin aucun des motifs,connues d’avance par moi, de cette vulgaire romance nepouvait me fournir la résolution dont j’avais besoini;bien plus, chacune de ces phrases, quand elle passait àson tour, devenait un obstacle à prendre efficacementcette résolution, ou plutôt elle m’obligeait à larésolution contraire de ne pas partir, car elle me faisaitpasser l’heure. Par là cette occupation sans plaisir enelle-même d’écouter « sole moi » se chargeait d’unetristesse profonde, presque désespérée. Je sentais bienqu’en réalité, c’était la résolution de ne pas partir que jeprenais par le fait de rester là sans bougeri; mais medire.: « Je ne pars pas », qui ne m’était pas possiblesous cette forme directe, me le devenait sous cetteautre.: « Je vais entendre encore une phrase de « solemio »i; mais la signification pratique de ce langagefiguré ne m’échappait pas et, tout en me disant.: « Je nefais en somme qu’écouter une phrase de plus », jesavais que cela voulait dire.: « Je resterai seul àensuite.personne ni à moi-même en l’écoutant aussi
Venise. » Et c’est peut-être cette tristesse, comme unesorte de froid engourdissant, qui faisait le charmedésespéré mais fascinateur de ce chant. Chaque noteque lançait la voix du chanteur avec une force et uneostentation presque musculaires venait me frapper enplein cœuri; quand la phrase était consommée et que lemorceau semblait fini, le chanteur n’en avait pas assezet reprenait plus haut comme s’il avait besoin deproclamer une fois de plus ma solitude et mondésespoir.Ma mère devait être arrivée à la gare. Bientôt elleserait partie. J’étais étreint par l’angoisse que mecausait, avec la vue du canal devenu tout petit depuisque l’âme de Venise s’en était échappée, de ce Rialtobanal qui n’était plus le Rialto, ce chant de désespoirque devenait « sole mio » et qui, ainsi clamé devant lespalais inconsistants, achevait de les mettre en miettes etconsommait la ruine de Venisei; j’assistais à la lenteréalisation de mon malheur, construit artistement, sanshâte, note par note, par le chanteur que regardait avecétonnement le soleil arrêté derrière Saint-Georges leMajeur, si bien que cette lumière crépusculaire devaitfaire à jamais dans ma mémoire, avec le frisson de monémotion et la voix de bronze du chanteur, un alliageéquivoque, immuable et poignant.Ainsi restais-je immobile, avec une volontédissoute, sans décision apparentei; sans doute à ces
moments-là elle est déjà prise.: nos amis eux-mêmespeuvent souvent la prévoir. Mais nous, nous ne lepouvons pas, sans quoi tant de souffrances nousseraient épargnées.Mais enfin, d’antres plus obscurs que ceux d’oùs’élance la comète qu’on peut prédire – grâce àl’insoupçonnable puissance défensive de l’habitudeinvétérée, grâce aux réserves cachées que par uneimpulsion subite elle jette au dernier moment dans lamêlée – mon action surgit enfin.: je pris mes jambes àmon cou et j’arrivai, les portières déjà fermées, mais àtemps pour retrouver ma mère rouge d’émotion, seretenant pour ne pas pleurer, car elle croyait que je neviendrais plus. Puis le train partit et nous vîmes Padoueet Vérone venir au-devant de nous, nous dire adieupresque jusqu’à la gare et, quand nous nous fûmeséloignés, regagner – elles qui ne partaient pas et allaientreprendre leur vie – l’une sa plaine, l’autre sa colline.Les heures passaient. Ma mère ne se pressait pas delire deux lettres qu’elle tenait à la main et avaitseulement ouvertes et tâchait que moi-même je netirasse pas tout de suite mon portefeuille pour y prendrecelle que le concierge de l’hôtel m’avait remise. Mamère craignait toujours que je ne trouvasse les voyagestrop longs, trop fatigants, et reculait le plus tardpossible, pour m’occuper pendant les dernières heures,le moment où elle chercherait pour moi de nouvelles
distractions, déballerait les œufs durs, me passerait lesjournaux, déferait le paquet de livres qu’elle avaitachetés sans me le dire. Nous avions traversé Milandepuis longtemps lorsqu’elle se décida à lire lapremière des deux lettres. Je regardai d’abord ma mère,qui la lisait avec étonnement, puis levait la tête, et sesyeux semblaient se poser tour à tour sur des souvenirsdistincts, incompatibles, et qu’elle ne pouvait parvenir àrapprocher. Cependant j’avais reconnu l’écriture deGilberte sur l’enveloppe que je venais de prendre dansmon portefeuille. Je l’ouvris. Gilberte m’annonçait sonmariage avec Robert de Saint-Loup. Elle me disaitqu’elle m’avait télégraphié à ce sujet à Venise et n’avaitpas eu de réponse. Je me rappelai comme on m’avait ditque le service des télégraphes y était mal fait. Je n’avaisjamais eu sa dépêche. Peut-être ne voudrait-elle pas lecroire. Tout d’un coup, je sentis dans mon cerveau unfait, qui y était installé à l’état de souvenir, quitter saplace et la céder à un autre. La dépêche que j’avaisreçue dernièrement et que j’avais crue d’<strong>Albertine</strong> étaitde Gilberte. Comme l’originalité assez factice del’écriture de Gilberte consistait principalement, quandelle écrivait une ligne, à faire figurer dans la lignesupérieure les barres de T qui avaient l’air de soulignerles mots, ou les points sur les I qui avaient l’aird’interrompre les phrases de la ligne d’au-dessus, et enrevanche à intercaler dans la ligne d’au-dessous les
queues et arabesques des mots qui leur étaientsuperposés, il était tout naturel que l’employé dutélégraphe eût lu les boucles d’s ou de z de la lignesupérieure comme un « ine » finissant le mot deGilberte. Le point sur l’i de Gilberte était monté audessusfaire point de suspension. Quand à son G, ilavait l’air d’un A gothique. Qu’en dehors de cela deuxou trois mots eussent été mal lus, pris les uns dans lesautres (certains, d’ailleurs, m’avaient paruincompréhensibles), cela était suffisant pour expliquerles détails de mon erreur et n’était même pas nécessaire.Combien de lettres lit dans un mot une personnedistraite et surtout prévenue, qui part de l’idée que lalettre est d’une certaine personnei? combien de motsdans la phrasei? On devine en lisant, on créei; tout partd’une erreur initialei; celles qui suivent (et ce n’est passeulement dans la lecture des lettres et destélégrammes, pas seulement dans toute lecture), siextraordinaires qu’elles puissent paraître à celui qui n’apas le même point de départ, sont toutes naturelles. Unebonne partie de ce que nous croyons (et jusque dans lesconclusions dernières c’est ainsi) avec un entêtement etune bonne foi égales vient d’une première méprise surles prémisses.
Chapitre IVNouvel aspect de Robert de Saint-Loup« Oh,! c’est inouï, me dit ma mère. Écoute, on nes’étonne plus de rien à mon âge, mais je t’assure qu’iln’y a rien de plus inattendu que la nouvelle quem’annonce cette lettre. – Écoute bien, répondis-je, je nesais pas ce que c’est, mais, si étonnant que cela puisseêtre, cela ne peut pas l’être autant que ce quem’apprend celle-ci. C’est un mariage. C’est Robert deSaint-Loup qui épouse Gilberte Swann. – Ah,! me ditma mère, alors c’est sans doute ce que m’annoncel’autre lettre, celle que je n’ai pas encore ouverte, carj’ai reconnu l’écriture de ton ami. » Et ma mère mesourit avec cette légère émotion dont, depuis qu’elleavait perdu sa mère, se revêtait pour elle toutévénement, si mince qu’il fût, qui intéressait descréatures humaines capables de douleur, de souvenir, etayant, elles aussi, leurs morts. Ainsi ma mère me souritet me parla d’une voix douce, comme si elle eût craint,en traitant légèrement ce mariage, de méconnaître cequ’il pouvait éveiller d’impressions mélancoliques chezla fille et la veuve de Swann, chez la mère de Robert
prête à se séparer de son fils, et auxquelles ma mère parbonté, par sympathie à cause de leur bonté pour moi,prêtait sa propre émotivité filiale, conjugale, etmaternelle. « Avais-je raison de te dire que tu netrouverais rien de plus étonnanti? lui dis-je. – Hé biensi,! répondit-elle d’une voix douce, c’est moi quidétiens la nouvelle la plus extraordinaire, je ne te diraipas la plus grande, la plus petite, car cette situation deSévigné faite par tous les gens qui ne savent que celad’elle écœurait ta grand’mère autant que « la jolie choseque c’est de fumer ». Nous ne daignons pas ramasser ceSévigné de tout le monde. Cette lettre-ci m’annonce lemariage du petit Cambremer. – Tiens,! dis-je avecindifférence, avec quii? Mais en tous cas la personnalitédu fiancé ôte déjà à ce mariage tout caractèresensationnel. – À moins que celle de la fiancée ne le luidonne. – Et qui est cette fiancéei? – Ah,! si je te dis toutde suite il n’y a pas de mérite, voyons, cherche unpeu », me dit ma mère qui, voyant qu’on n’était pasencore à Turin, voulait me laisser un peu de pain sur laplanche et une poire pour la soif. « Mais commentveux-tu que je sachei? Est-ce avec quelqu’un debrillanti? Si Legrandin et sa sœur sont contents, nouspouvons être sûrs que c’est un mariage brillant. –Legrandin, je ne sais pas, mais la personne quim’annonce le mariage dit que M me de Cambremer estravie. Je ne sais pas si tu appelleras cela un mariage
illant. Moi, cela me fait l’effet d’un mariage du tempsoù les rois épousaient les bergères, et encore la bergèreest-elle moins qu’une bergère, mais d’ailleurscharmante. Cela eût stupéfié ta grand’mère et ne lui eûtpas déplu. – Mais enfin qui est-ce cette fiancéei? –C’est M lle d’Oloron. – Cela m’a l’air immense et pasbergère du tout, mais je ne vois pas qui cela peut être.C’est un titre qui était dans la famille des Guermantes.– Justement, et M. de Charlus l’a donné, en l’adoptant,à la nièce de Jupien. C’est elle qui épouse le petitCambremer. – La nièce de Jupien,! Ce n’est paspossible,! – C’est la récompense de la vertu. C’est unmariage à la fin d’un roman de M me Sand », dit mamère. « C’est le prix du vice, c’est un mariage à la find’un roman de Balzac », pensai-je. « Après tout, dis-jeà ma mère, en y réfléchissant, c’est assez naturel. Voilàles Cambremer ancrés dans ce clan des Guermantes oùils n’espéraient pas pouvoir jamais planter leur tentei;de plus, la petite, adoptée par M. de Charlus, aurabeaucoup d’argent, ce qui était indispensable depuisque les Cambremer ont perdu le leuri; et, en somme,elle est la fille adoptive et, selon les Cambremer,probablement la fille véritable – la fille naturelle – dequelqu’un qu’ils considèrent comme un prince du sang.Un bâtard de maison presque royale, cela a toujours étéconsidéré comme une alliance flatteuse par la noblessefrançaise et étrangère. Sans remonter même si loin, tout
près de nous, pas plus tard qu’il y a six mois, tu terappelles le mariage de l’ami de Robert avec cette jeunefille dont la seule raison d’être sociale était qu’on lasupposait, à tort ou à raison, fille naturelle d’un princesouverain. » Ma mère, tout en maintenant le côté castesde Combray, qui eût fait que ma grand’mère eût dû êtrescandalisée de ce mariage, voulant avant tout montrer lavaleur du jugement de sa mère, ajouta.: « D’ailleurs, lapetite est parfaite, et ta chère grand’mère n’aurait pas eubesoin de son immense bonté, de son indulgence infiniepour ne pas être sévère au choix du jeune Cambremer.Te souviens-tu combien elle avait trouvé cette petitedistinguée, il y a bien longtemps, un jour qu’elle étaitentrée se faire recoudre sa jupei? Ce n’était qu’uneenfant alors. Et maintenant, bien que très montée engraine et vieille fille, elle est une autre femme, millefois plus parfaite. Mais ta grand’mère d’un coup d’œilavait discerné tout cela. Elle avait trouvé la petite nièced’un giletier plus « noble » que le duc de Guermantes. »Mais plus encore que louer grand’mère, il fallait à mamère trouver « mieux » pour elle qu’elle ne fût plus là.C’était la suprême finalité de sa tendresse et comme sicela lui épargnait un dernier chagrin. « Et pourtant,crois-tu tout de même, me dit ma mère, si le pèreSwann – que tu n’as pas connu, il est vrai – avait pupenser qu’il aurait un jour un arrière-petit-fils ou unearrière-petite-fille où couleraient confondus le sang de
la mère Moser qui disait.: « Ponchour Mezieurs » et lesang du duc de Guise,! – Mais remarque, maman, quec’est beaucoup plus étonnant que tu ne dis. Car lesSwann étaient des gens très bien et, avec la situationqu’avait leur fils, sa fille, s’il avait fait un bon mariage,aurait pu en faire un très beau. Mais tout était retombé àpied d’œuvre puisqu’il avait épousé une cocotte. – Oh,!une cocotte, tu sais, on était peut-être méchant, je n’aijamais tout cru. – Si, une cocotte, je te ferai même desrévélations sensationnelles un autre jour. » Perdue danssa rêverie, ma mère disait.: « La fille d’une femme queton père n’aurait jamais permis que je salue épousant leneveu de M me de Villeparisis que ton père ne mepermettait pas, au commencement, d’aller voir parcequ’il la trouvait d’un monde trop brillant pour moi,! »Puis.: « Le fils de M me de Cambremer, pour quiLegrandin craignait tant d’avoir à nous donner unerecommandation parce qu’il ne nous trouvait pas assezchic, épousant la nièce d’un homme qui n’aurait jamaisosé monter chez nous que par l’escalier de service,!...Tout de même, ta pauvre grand’mère avait raison – tu terappelles – quand elle disait que la grande aristocratiefaisait des choses qui choqueraient de petits bourgeois,et que la reine Marie-Amélie lui était gâtée par lesavances qu’elle avait faites à la maîtresse du prince deCondé pour qu’elle le fît tester en faveur du ducd’Aumale. Tu te souviens, elle était choquée que,
depuis des siècles, des filles de la maison de Gramont,qui furent de véritables saintes, aient porté le nom deCorisande en mémoire de la liaison d’une aïeule avecHenri IV. Ce sont des choses qui se font peut-être aussidans la bourgeoisie, mais on les cache davantage.Crois-tu que cela l’eût amusée, ta pauvregrand’mère,! » disait maman avec tristesse – car lesjoies dont nous souffrions que ma grand’mère fûtécartée, c’étaient les joies les plus simples de la vie, unenouvelle, une pièce, moins que cela une « imitation »,qui l’eussent amusée. – « Crois-tu qu’elle eût étéétonnée,! Je suis sûre pourtant que cela eût choqué tagrand’mère, ces mariages, que cela lui eût été pénible,je crois qu’il vaut mieux qu’elle ne les ait pas sus »,reprit ma mère, car en présence de tout événement elleaimait à penser que ma grand’mère en eût reçu uneimpression toute particulière qui eût tenu à lamerveilleuse singularité de sa nature et qui avait uneimportance extraordinaire. Devant tout événement tristequ’on n’eût pu prévoir autrefois, la disgrâce ou la ruined’un de nos vieux amis, quelque calamité publique, uneépidémie, une guerre, une révolution, ma mère se disaitque peut-être valait-il mieux que grand’mère n’eût rienvu de tout cela, que cela lui eût fait trop de peine, quepeut-être elle n’eût pu le supporter. Et quand ils’agissait d’une chose choquante comme celle-ci, mamère, par le mouvement du cœur inverse de celui des
méchants, qui se plaisent à supposer que ceux qu’ilsn’aiment pas ont plus souffert qu’on ne croit, ne voulaitpas dans sa tendresse pour ma grand’mère admettre querien de triste, de diminuant eût pu lui arriver. Elle sefigurait toujours ma grand’mère comme au-dessus desatteintes même de tout mal qui n’eût pas dû se produire,et se disait que la mort de ma grand’mère avait peutêtreété, en somme, un bien en épargnant le spectacletrop laid du temps présent à cette nature si noble quin’aurait pas su s’y résigner. Car l’optimisme est laphilosophie du passé. Les événements qui ont eu lieuétant, entre tous ceux qui étaient possibles, les seuls quenous connaissions, le mal qu’ils ont causé nous sembleinévitable, et le peu de bien qu’ils n’ont pas pu ne pasamener avec eux, c’est à eux que nous en faisonshonneur, et nous nous imaginons que sans eux il ne sefût pas produit. Mais elle cherchait en même temps àmieux deviner ce que ma grand’mère eût éprouvé enapprenant ces nouvelles et à croire en même temps quec’était impossible à deviner pour nos esprits moinsélevés que le sien. « Crois-tu,! me dit d’abord ma mère,combien ta pauvre grand’mère eût été étonnée,! » Et jesentais que ma mère souffrait de ne pas pouvoir le luiapprendre, regrettait que ma grand’mère ne pût lesavoir, et trouvait quelque chose d’injuste à ce que lavie amenât au jour des faits que ma grand’mère n’auraitpu croire, rendant ainsi rétrospectivement la
connaissance, que celle-ci avait emportée des êtres et dela société, fausse et incomplète, le mariage de la petiteJupien avec le neveu de Legrandin ayant été de nature àmodifier les notions générales de ma grand’mère, autantque la nouvelle – si ma mère avait pu la lui faireparvenir – qu’on était arrivé à résoudre le problème, crupar ma grand’mère insoluble, de la navigation aérienneet de la télégraphie sans fil.Le train entrait en gare de Paris que nous parlionsencore avec ma mère de ces deux nouvelles que, pourque la route ne me parût pas trop longue, elle eût vouluréserver pour la seconde partie du voyage et ne m’avaitlaissé apprendre qu’après Milan. Et ma mère continuaitquand nous fûmes rentrés à la maison.: « Crois-tu, cepauvre Swann qui désirait tant que sa Gilberte fût reçuechez les Guermantes, serait-il assez heureux s’il pouvaitvoir sa fille devenir une Guermantes,! – Sous un autrenom que le sien, conduite à l’autel comme M lle deForchevillei; crois-tu qu’il en serait si heureuxi? – Ah,!c’est vrai, je n’y pensais pas. – C’est ce qui fait que jene peux pas me réjouir pour cette petite « rosse »i; cettepensée qu’elle a eu le cœur de quitter le nom de sonpère qui était si bon pour elle. – Oui, tu as raison, toutcompte fait, il est peut-être mieux qu’il ne l’ait pas su. »Tant pour les morts que pour les vivants, on ne peutsavoir si une chose leur ferait plus de joie ou plus depeine. « Il paraît que les Saint-Loup vivront à
Tansonville. Le père Swann, qui désirait tant montrerson étang à ton pauvre grand-père, aurait-il jamais pusupposer que le duc de Guermantes le verrait souvent,surtout s’il avait su le mariage de son filsi? Enfin, toiqui as tant parlé à Saint-Loup des épines roses, des lilaset des iris de Tansonville, il te comprendra mieux. C’estlui qui les possédera. » Ainsi se déroulait dans notresalle à manger, sous la lumière de la lampe dont ellessont amies, une de ces causeries où la sagesse, non desnations mais des familles, s’emparant de quelqueévénement, mort, fiançailles, héritage, ruine, et leglissant sous le verre grossissant de la mémoire, luidonne tout son relief, dissocie, recule une surface, etsitue en perspective à différents points de l’espace et dutemps ce qui, pour ceux qui n’ont pas vécu cetteépoque, semble amalgamé sur une même surface, lesnoms des décédés, les adresses successives, les originesde la fortune et ses changements, les mutations depropriété. Cette sagesse-là n’est-elle pas inspirée par laMuse qu’il convient de méconnaître le plus longtempspossible si l’on veut garder quelque fraîcheurd’impressions et quelque vertu créatrice, mais queceux-là mêmes qui l’ont ignorée rencontrent au soir deleur vie dans la nef de la vieille église provinciale, àl’heure où tout à coup ils se sentent moins sensibles à labeauté éternelle exprimée par les sculptures de l’autelqu’à la conception des fortunes diverses qu’elles
subirent, passant dans une illustre collectionparticulière, dans une chapelle, de là dans un musée,puis ayant fait retour à l’églisei; ou qu’à sentir, quandils y foulent un pavé presque pensant, qu’il recouvre ladernière poussière d’Arnauld ou de Pascali; ou toutsimplement qu’à déchiffrer, imaginant peut-être l’imaged’une fraîche paroissienne, sur la plaque de cuivre duprie-Dieu de bois, les noms des filles du hobereau ou dunotable. La Muse qui a recueilli tout ce que les musesplus hautes de la philosophie et de l’art ont rejeté, toutce qui n’est pas fondé en vérité, tout ce qui n’est quecontingent mais révèle aussi d’autres lois, c’estl’Histoire.Ce que je devais apprendre par la suite – car jen’avais pu assister à tout cela de Venise – c’est que M llede Forcheville avait été demandée d’abord par le princede Silistrie, cependant que Saint-Loup cherchait àépouser M lle d’Entragues, fille du duc de Luxembourg.Voici ce qui s’était passé. M lle de Forcheville ayant centmillions, M me de Marsantes avait pensé que c’était unexcellent mariage pour son fils. Elle eut le tort de direque cette jeune fille était charmante, qu’elle ignoraitabsolument si elle était riche ou pauvre, qu’elle nevoulait pas le savoir mais que, même sans dot, ce seraitune chance pour le jeune homme le plus difficiled’avoir une femme pareille. C’était beaucoup d’audacepour une femme tentée seulement par les cent millions
qui lui fermaient les yeux sur le reste. Aussitôt oncomprit qu’elle y pensait pour son fils. La princesse deSilistrie jeta partout les hauts cris, se répandit sur lesgrandeurs de Saint-Loup, et clama que si Saint-Loupépousait la fille d’Odette et d’un juif, il n’y avait plusde faubourg Saint-Germain. M me de Marsantes, si sûred’elle-même qu’elle fût, n’osa pas pousser alors plusloin et se retira devant les cris de la princesse deSilistrie, qui fit aussitôt faire la demande pour sonpropre fils. Elle n’avait crié qu’afin de se réserverGilberte. Cependant M me de Marsantes, ne voulant pasrester sur un échec, s’était aussitôt tournée vers M lled’Entragues, fille du duc de Luxembourg. N’ayant quevingt millions, celle-ci lui convenait moins, mais elledit à tout le monde qu’un Saint-Loup ne pouvaitépouser une M lle Swann (il n’était même plus questionde Forcheville). Quelque temps après, quelqu’un disantétourdiment que le duc de Châtellerault pensait àépouser M lle d’Entragues, M me de Marsantes, qui étaitpointilleuse plus que personne, le prit de haut, changeases batteries, revint à Gilberte, fit faire la demande pourSaint-Loup, et les fiançailles eurent lieuimmédiatement. Ces fiançailles excitèrent de vifscommentaires dans les mondes les plus différents.D’anciennes amies de ma mère, plus ou moins deCombray, vinrent la voir pour lui parler du mariage deGilberte, lequel ne les éblouissait nullement. « Vous
savez ce que c’est que M lle de Forcheville, c’est toutsimplement M lle Swann. Et le témoin de son mariage, le« Baron » de Charlus, comme il se fait appeler, c’est cevieux qui entretenait déjà la mère autrefois au vu et ausu de Swann qui y trouvait son intérêt. – Mais qu’est-ceque vous ditesi? protestait ma mère, Swann, d’abord,était extrêmement riche. – Il faut croire qu’il ne l’étaitpas tant que ça pour avoir besoin de l’argent des autres.Mais qu’est-ce qu’elle a donc, cette femme-là, pourtenir ainsi ses anciens amantsi? Elle a trouvé le moyende se faire épouser par le troisième et elle retire à moitiéde la tombe le deuxième pour qu’il serve de témoin à lafille qu’elle a eue du premier ou d’un autre, carcomment se reconnaître dans la quantitéi? elle n’en saitplus rien elle-même,! Je dis le troisième, c’est le troiscentième qu’il faudrait dire. Du reste, vous savez que sielle n’est pas plus Forcheville que vous et moi, cela vabien avec le mari qui, naturellement, n’est pas noble.Vous pensez bien qu’il n’y a qu’un aventurier pourépouser cette fille-là. Il paraît que c’est un MonsieurDupont ou Durand quelconque. S’il n’y avait pasmaintenant un maire radical à Combray, qui ne saluemême pas le curé, j’aurais su le fin de la chose. Parceque, vous comprenez bien, quand on a publié les bans,il a bien fallu dire le vrai nom. C’est très joli, pour lesjournaux ou pour le papetier qui envoie les lettres defaire-part, de se faire appeler le marquis de Saint-Loup.
Ça ne fait mal à personne, et si ça peut leur faire plaisirà ces bonnes gens, ce n’est pas moi qui y trouverai àredire,! en quoi ça peut-il me gêneri? Comme je nefréquenterai jamais la fille d’une femme qui a fait parlerd’elle, elle peut bien être marquise long comme le braspour ses domestiques. Mais dans les actes de l’état civilce n’est pas la même chose. Ah,! si mon cousin Sazeratétait encore premier adjoint, je lui aurais écrit, à moi ilm’aurait dit sous quel nom il avait fait faire lespublications. »D’autres amies de ma mère, qui avaient vu Saint-Loup à la maison, vinrent à son « jour » ets’informèrent si le fiancé était bien celui qui était monami. Certaines personnes allaient jusqu’à prétendre, ence qui concernait l’autre mariage, qu’il ne s’agissait pasdes Cambremer-Legrandin. On le tenait de bonnesource, car la marquise, née Legrandin, l’avait démentila veille même du jour où les fiançailles furent publiées.Je me demandais de mon côté pourquoi M. de Charlusd’une part, Saint-Loup de l’autre, lesquels avaient eul’occasion de m’écrire peu auparavant, m’avaient parléde projets amicaux et de voyages dont la réalisation eûtdû exclure la possibilité de ces cérémonies, et nem’avaient rien dit. J’en concluais, sans songer au secretque l’on garde jusqu’à la fin sur ces sortes de choses,que j’étais moins leur ami que je n’avais cru, ce qui,pour ce qui concernait Saint-Loup, me peinait. Aussi
pourquoi, ayant remarqué que l’amabilité, le côté plainpied,« pair à compagnon » de l’aristocratie était unecomédie, m’étonnais-je d’en être exceptéi? Dans lamaison de femmes – où on procurait de plus en plus deshommes – où M. de Charlus avait surpris Morel et où la« sous-maîtresse », grande lectrice du Gaulois,commentait les nouvelles mondaines, cette patronne,parlant à un gros Monsieur qui venait chez elle, sansarrêter, boire du Champagne avec des jeunes gens,parce que, déjà très gros, il voulait devenir assez obèsepour être certain de ne pas être « pris » si jamais il yavait une guerre, déclara.: « Il paraît que le petit Saint-Loup est comme « ça » et le petit Cambremer aussi.Pauvres épouses,! – En tout cas, si vous connaissez cesfiancés, il faut nous les envoyer, ils trouveront ici toutce qu’ils voudront, et il y a beaucoup d’argent à gagneravec eux. » Sur quoi le gros Monsieur, bien qu’il fûtlui-même comme « ça », se récria, répliqua, étant unpeu snob, qu’il rencontrait souvent Cambremer et Saint-Loup chez ses cousins d’Ardouvillers, et qu’ils étaientgrands amateurs de femmes et tout le contraire de« ça ». « Ah,! » conclut la sous-maîtresse d’un tonsceptique, mais ne possédant aucune preuve, etpersuadée qu’en notre siècle la perversité des mœurs ledisputait à l’absurdité calomniatrice des cancans.Certaines personnes, que je ne vis pas, m’écrivirent etme demandèrent « ce que je pensais » de ces deux
mariages, absolument comme si elles eussent ouvertune enquête sur la hauteur des chapeaux des femmes authéâtre ou sur le roman psychologique. Je n’eus pas lecourage de répondre à ces lettres. De ces deux mariagesje ne pensais rien, mais j’éprouvais une immensetristesse, comme quand deux parties de votre existencepassée, amarrées auprès de vous, et sur lesquelles onfonde peut-être paresseusement au jour le jour, quelqueespoir inavoué, s’éloignent définitivement, avec unclaquement joyeux de flammes, pour des destinationsétrangères, comme deux vaisseaux. Pour les intéresséseux-mêmes, ils eurent à l’égard de leur propre mariageune opinion bien naturelle, puisqu’il s’agissait non desautres mais d’eux. Ils n’avaient jamais eu assez derailleries pour ces « grands mariages » fondés sur unetare secrète. Et même les Cambremer, de maison siancienne et de prétentions si modestes, eussent été lespremiers à oublier Jupien et à se souvenir seulement desgrandeurs inouïes de la maison d’Oloron, si uneexception ne s’était produite en la personne qui eût dûêtre le plus flattée de ce mariage, la marquise deCambremer-Legrandin. Mais, méchante de nature, ellefaisait passer le plaisir d’humilier les siens avant celuide se glorifier elle-même. Aussi, n’aimant pas son fils,et ayant tôt fait de prendre en grippe sa future bellefille,déclara-t-elle qu’il était malheureux pour unCambremer d’épouser une personne qui sortait on ne
savait d’où, en somme, et avait des dents si malrangées. Quant au jeune Cambremer, qui avait déjà unecertaine propension à fréquenter des gens de lettres, onpense bien qu’une si brillante alliance n’eut pas poureffet de le rendre plus snob, mais que, se sentantmaintenant le successeur des ducs d’Oloron – « princessouverains » comme disaient les journaux – il étaitsuffisamment persuadé de sa grandeur pour pouvoirfrayer avec n’importe qui. Et il délaissa la petitenoblesse pour la bourgeoisie intelligente les jours où ilne se consacrait pas aux Altesses. Les notes desjournaux, surtout en ce qui concernait Saint-Loup,donnèrent à mon ami, dont les ancêtres royaux étaienténumérés, une grandeur nouvelle mais qui ne fit quem’attrister – comme s’il était devenu quelqu’un d’autre,le descendant de Robert le Fort, plutôt que l’ami quis’était mis si peu de temps auparavant sur le strapontinde la voiture afin que je fusse mieux au fondi; le fait den’avoir pas soupçonné d’avance son mariage avecGilberte, dont la réalité m’était apparue soudain, dansune lettre, si différente de ce que je pouvais penser dechacun d’eux la veille, et qu’il ne m’eût pas averti mefaisait souffrir, alors que j’eusse dû penser qu’il avait eubeaucoup à faire et que, d’ailleurs, dans le monde lesmariages se font souvent ainsi tout d’un coup,fréquemment pour se substituer à une combinaisondifférente qui a échoué – inopinément – comme un
précipité chimique. Et la tristesse, morne comme undéménagement, amère comme une jalousie, que mecausèrent par la brusquerie, par l’accident de leur choc,ces deux mariages fut si profonde, que plus tard on mela rappela, en m’en faisant absurdement gloire, commeayant été tout le contraire de ce qu’elle fut au momentmême, un double, triple, et même quadruplepressentiment.Les gens du monde qui n’avaient fait aucuneattention à Gilberte me dirent d’un air gravementintéressé.: « Ah,! c’est elle qui épouse le marquis deSaint-Loupi? » et jetaient sur elle le regard attentif desgens non seulement friands des événements de la vieparisienne, mais aussi qui cherchent à s’instruire etcroient à la profondeur de leur regard. Ceux quin’avaient, au contraire, connu que Gilberte regardèrentSaint-Loup avec une extrême attention, medemandèrent (souvent des gens qui me connaissaient àpeine) de les présenter et revenaient de la présentationau fiancé parés des joies de la fatuité en me disant.: « Ilest très bien de sa personne. » Gilberte était convaincueque le nom de marquis de Saint-Loup était plus grandmille fois que celui de duc d’Orléans.« Il paraît que c’est la princesse de Parme qui a faitle mariage du petit Cambremer », me dit maman. Etc’était vrai. La princesse de Parme connaissait depuislongtemps, par les œuvres, d’une part Legrandin qu’elle
trouvait un homme distingué, de l’autre M me deCambremer qui changeait la conversation quand laprincesse lui demandait si elle était bien la sœur deLegrandin. La princesse savait le regret qu’avait M me deCambremer d’être restée à la porte de la haute sociétéaristocratique, où personne ne la recevait. Quand laprincesse de Parme, qui s’était chargée de trouver unparti pour M lle d’Oloron, demanda à M. de Charlus s’ilsavait qui était un homme aimable et instruit quis’appelait Legrandin de Méséglise (c’était ainsi que sefaisait appeler maintenant Legrandin), le baron réponditd’abord que non, puis tout d’un coup un souvenir luirevint d’un voyageur avec qui il avait fait connaissanceen wagon, une nuit, et qui lui avait laissé sa carte. Il eutun vague sourire. « C’est peut-être le même », se dit-il.Quand il apprit qu’il s’agissait du fils de la sœur deLegrandin, il dit.: « Tiens, ce serait vraimentextraordinaire,! S’il tenait de son oncle, après tout, cene serait pas pour m’effrayer, j’ai toujours dit qu’ilsfaisaient les meilleurs maris. – Qui ilsi? demanda laprincesse. – Oh,! Madame, je vous expliquerais bien sinous nous voyions plus souvent. Avec vous on peutcauser. Votre Altesse est si intelligente », dit Charluspris d’un besoin de confidence qui pourtant n’alla pasplus loin. Le nom de Cambremer lui plut, bien qu’iln’aimât pas les parents, mais il savait que c’était unedes quatre baronnies de Bretagne et tout ce qu’il
pouvait espérer de mieux pour sa fille adoptivei; c’étaitun nom vieux, respecté, avec de solides alliances danssa province. Un prince eût été impossible et, d’ailleurs,peu désirable. C’était ce qu’il fallait. La princesse fitensuite venir Legrandin. Il avait physiquementpassablement changé, et assez à son avantage, depuisquelque temps. Comme les femmes qui sacrifientrésolument leur visage à la sveltesse de leur taille et nequittent plus Marienbad, Legrandin avait pris l’aspectdésinvolte d’un officier de cavalerie. Au fur et à mesureque M. de Charlus s’était alourdi et abruti, Legrandinétait devenu plus élancé et rapide, effet contraire d’unemême cause. Cette vélocité avait d’ailleurs des raisonspsychologiques. Il avait l’habitude d’aller dans certainsmauvais lieux où il aimait qu’on ne le vît ni entrer, nisortir.: il s’y engouffrait. Legrandin s’était mis au tennisà cinquante-cinq ans. Quand la princesse de Parme luiparla des Guermantes, de Saint-Loup, il déclara qu’illes avait toujours connus, faisant une espèce demélange entre le fait d’avoir toujours connu de nom leschâtelains de Guermantes et d’avoir rencontré, chez matante, Swann, le père de la future M me de Saint-Loup,Swann dont Legrandin d’ailleurs ne voulait à Combrayfréquenter ni la femme ni la fille. « J’ai même voyagédernièrement avec le frère du duc de Guermantes, M.de Charlus. Il a spontanément engagé la conversation,ce qui est toujours bon signe, car cela prouve que ce
n’est ni un sot gourmé, ni un prétentieux. Oh,! je saistout ce qu’on dit de lui. Mais je ne crois jamais ceschoses-là. D’ailleurs, la vie privée des autres ne meregarde pas. Il m’a fait l’effet d’un cœur sensible, d’unhomme bien cultivé. » Alors la princesse de Parmeparla de M lle d’Oloron. Dans le milieu des Guermanteson s’attendrissait sur la noblesse de cœur de M. deCharlus qui, bon comme il avait toujours été, faisait lebonheur d’une jeune fille pauvre et charmante. Et le ducde Guermantes, souffrant de la réputation de son frère,laissait entendre que, si beau que cela fût, c’était fortnaturel. « Je ne sais si je me fais bien entendre, tout estnaturel dans l’affaire », disait-il maladroitement à forced’habileté. Mais son but était d’indiquer que la jeunefille était une enfant de son frère qu’il reconnaissait. Dumême coup cela expliquait Jupien. La princesse deParme insinua cette version pour montrer à Legrandinqu’en somme le jeune Cambremer épouserait quelquechose comme M lle de Nantes, une de ces bâtardes deLouis XIV qui ne furent dédaignées ni par le ducd’Orléans, ni par le prince de Conti.Ces deux mariages dont nous parlions déjà avec mamère dans le train qui nous ramenait à Paris eurent surcertains des personnages qui ont figuré jusqu’ici dansce récit des effets assez remarquables. D’abord surLegrandini; inutile de dire qu’il entra en ouragan dansl’hôtel de M. de Charlus, absolument comme dans une
maison mal famée où il ne faut pas être vu, et aussi toutà la fois pour montrer sa bravoure et cacher son âge –car nos habitudes nous suivent même là où elles nenous servent plus à rien – et presque personne neremarqua qu’en lui disant bonjour M. de Charlus luiadressa un sourire difficile à percevoir, plus encore àinterpréteri; ce sourire était pareil en apparence, et aufond était exactement l’inverse, de celui que deuxhommes qui ont l’habitude de se voir dans la bonnesociété échangent si par hasard ils se rencontrent dansce qu’ils trouvent un mauvais lieu (par exemplel’Élysée où le général de Froberville, quand il yrencontrait jadis Swann, avait en l’apercevant le regardd’ironique et mystérieuse complicité de deux habituésde la princesse des Laumes qui se commettaient chezM. Grévy). Legrandin cultivait obscurément depuisbien longtemps – et dès le temps où j’allais tout enfantpasser à Combray mes vacances – des relationsaristocratiques, productives tout au plus d’uneinvitation isolée à une villégiature inféconde. Tout àcoup, le mariage de son neveu étant venu rejoindreentre eux ces tronçons lointains, Legrandin eut unesituation mondaine à laquelle rétroactivement sesrelations anciennes avec des gens qui ne l’avaientfréquenté que dans le particulier, mais intimement,donnèrent une sorte de solidité. Des dames à qui oncroyait le présenter racontaient que depuis vingt ans il
passait quinze jours à la campagne chez elles, et quec’était lui qui leur avait donné le beau baromètre anciendu petit salon. Il avait par hasard été pris dans des« groupes » où figuraient des ducs qui lui étaientapparentés. Or dès qu’il eut cette situation mondaine ilcessa d’en profiter. Ce n’est pas seulement parce que,maintenant qu’on le savait reçu, il n’éprouvait plus deplaisir à être invité, c’est que des deux vices qui sel’étaient longtemps disputé, le moins naturel, lesnobisme, cédait la place à un autre moins factice,puisqu’il marquait du moins une sorte de retour, mêmedétourné, vers la nature. Sans doute ils ne sont pasincompatibles, et l’exploration d’un faubourg peut sepratiquer en quittant le raout d’une duchesse. Mais lerefroidissement de l’âge détournait Legrandin decumuler tant de plaisirs, de sortir autrement qu’à bonescient, et aussi rendait pour lui ceux de la nature assezplatoniques, consistant surtout en amitiés, en causeriesqui prennent du temps, et lui faisaient passer presquetout le sien dans le peuple, lui en laissant peu pour lavie de société. M me de Cambremer elle-même devintassez indifférente à l’amabilité de la duchesse deGuermantes. Celle-ci, obligée de fréquenter lamarquise, s’était aperçue, comme il arrive chaque foisqu’on vit davantage avec des êtres humains, c’est-à-diremêlés de qualités qu’on finit par découvrir et de défautsauxquels on finit par s’habituer, que M me de
Cambremer était une femme douée d’une intelligence etpourvue d’une culture que, pour ma part, j’appréciaispeu, mais qui parurent remarquables à la duchesse. Ellevint donc souvent, à la tombée du jour, voir M me deCambremer et lui faire de longues visites. Mais lecharme merveilleux que celle-ci se figurait exister chezla duchesse de Guermantes s’évanouit dès qu’elle s’envit recherchée, et elle la recevait plutôt par politesse quepar plaisir. Un changement plus frappant se manifestachez Gilberte, à la fois symétrique et différent de celuiqui s’était produit chez Swann marié. Certes, lespremiers mois Gilberte avait été heureuse de recevoirchez elle la société la plus choisie. Ce n’est sans doutequ’à cause de l’héritage qu’on invitait les amies intimesauxquelles tenait sa mère, mais à certains joursseulement où il n’y avait qu’elles, enfermées à part, loindes gens chics, et comme si le contact de M meBontemps ou de M me Cottard avec la princesse deGuermantes ou la princesse de Parme eût pu, commecelui de deux poudres instables, produire descatastrophes irréparables. Néanmoins les Bontemps, lesCottard et autres, quoique déçus de dîner entre eux,étaient fiers de pouvoir dire.: « Nous avons dîné chez lamarquise de Saint-Loup », d’autant plus qu’on poussaitquelquefois l’audace jusqu’à inviter avec eux M me deMarsantes, qui se montrait véritable grande dame, avecun éventail d’écaille et de plumes, toujours dans
l’intérêt de l’héritage. Elle avait seulement soin de fairede temps en temps l’éloge des gens discrets qu’on nevoit jamais que quand on leur fait signe, avertissementmoyennant lequel elle adressait aux bons entendeurs dugenre Cottard, Bontemps, etc., son plus gracieux ethautain salut. Peut-être j’eusse préféré être de cesséries-là. Mais Gilberte, pour qui j’étais maintenantsurtout un ami de son mari et des Guermantes (et qui –peut-être bien dès Combray, où mes parents nefréquentaient pas sa mère – m’avait, à l’âge où nousn’ajoutons pas seulement tel ou tel avantage aux chosesmais où nous les classons par espèces, doué de ceprestige qu’on ne perd plus ensuite), considérait cessoirées-là comme indignes de moi et quand je partaisme disait.: « J’ai été très contente de vous voir, maisvenez plutôt après-demain, vous verrez ma tanteGuermantes, M me de Poixi; aujourd’hui c’était desamies de maman, pour faire plaisir à maman. » Maisceci ne dura que quelques mois, et très vite tout futchangé de fond en comble. Était-ce parce que la viesociale de Gilberte devait présenter les mêmescontrastes que celle de Swanni? En tout cas, Gilberten’était que depuis peu de temps marquise de Saint-Loup(et bientôt après, comme on le verra, duchesse deGuermantes) que, ayant atteint ce qu’il y avait de pluséclatant et de plus difficile, elle pensait que le nom deSaint-Loup s’était maintenant incorporé à elle comme
un émail mordoré et que, qui qu’elle fréquentât,désormais elle resterait pour tout le monde marquise deSaint-Loup, ce qui était une erreur, car la valeur d’untitre de noblesse, aussi bien que de bourse, monte quandon le demande et baisse quand on l’offre. Tout ce quinous semble impérissable tend à la destructioni; unesituation mondaine, tout comme autre chose, n’est pascréée une fois pour toutes, mais, aussi bien que lapuissance d’un empire, se reconstruit à chaque instantpar une sorte de création perpétuellement continue, cequi explique les anomalies apparentes de l’histoiremondaine ou politique au cours d’un demi-siècle. Lacréation du monde n’a pas eu lieu au début, elle a lieutous les jours. La marquise de Saint-Loup se disait.:« Je suis la marquise de Saint-Loup », elle savaitqu’elle avait refusé la veille trois dîners chez desduchesses. Mais si, dans une certaine mesure, son nomrelevait le milieu aussi peu aristocratique que possiblequ’elle recevait, par un mouvement inverse le milieuque recevait la marquise dépréciait le nom qu’elleportait. Rien ne résiste à de tels mouvements, les plusgrands noms finissent par succomber. Swann n’avait-ilpas connu une duchesse de la maison de France dont lesalon, parce que n’importe qui y était reçu, était tombéau dernier rangi? Un jour que la princesse des Laumesétait allée par devoir passer un instant chez cetteAltesse, où elle n’avait trouvé que des gens de rien, en
entrant ensuite chez M me Leroi elle avait dit à Swann etau marquis de Modène.: « Enfin je me retrouve en paysami. Je viens de chez M me la duchesse de X..., il n’yavait pas trois figures de connaissance. » Partageant, enun mot, l’opinion de ce personnage d’opérette quidéclare.: « Mon nom me dispense, je pense, d’en direplus long », Gilberte se mit à afficher son mépris pource qu’elle avait tant désiré, à déclarer que tous les gensdu faubourg Saint-Germain étaient idiots,infréquentables, et, passant de la parole à l’action, cessade les fréquenter. Des gens qui n’ont fait saconnaissance qu’après cette époque, et pour leursdébuts auprès d’elle, l’ont entendue, devenue duchessede Guermantes, se moquer drôlement du monde qu’elleeût pu si aisément voir, la voyant ne pas recevoir uneseule personne de cette société, et si l’une, voire la plusbrillante, s’aventurait chez elle, lui bâiller ouvertementau nez, rougissent rétrospectivement d’avoir pu, eux,trouver quelque prestige au grand monde, et n’oseraientjamais confier ce secret humiliant de leurs faiblessespassées à une femme qu’ils croient, par une élévationessentielle de sa nature, avoir été de tout tempsincapable de comprendre celles-ci. Ils l’entendentrailler avec tant de verve les ducs, et la voient, choseplus significative, mettre si complètement sa conduiteen accord avec ses railleries,! Sans doute ne songent-ilspas à rechercher les causes de l’accident qui fit de M lle
Swann M lle de Forcheville, et de M lle de Forcheville lamarquise de Saint-Loup, puis la duchesse deGuermantes. Peut-être ne songent-ils pas non plus quecet accident ne servirait pas moins par ses effets que parses causes à expliquer l’attitude ultérieure de Gilberte,la fréquentation des roturiers n’étant pas tout à faitconçue de la même façon qu’elle l’eût été par M lleSwann par une dame à qui tout le monde dit « Madamela Duchesse » et ces duchesses qui l’ennuient « macousine ». On dédaigne volontiers un but qu’on n’a pasréussi à atteindre, ou qu’on a atteint définitivement. Etce dédain nous paraît faire partie des gens que nous neconnaissions pas encore. Peut-être, si nous pouvionsremonter le cours des années, les trouverions-nousdéchirés, plus frénétiquement que personne, par cesmêmes défauts qu’ils ont réussi si complètement àmasquer ou à vaincre que nous les estimons incapablesnon seulement d’en avoir jamais été atteints euxmêmes,mais même de les excuser jamais chez lesautres, faute d’être capables de les concevoir.D’ailleurs, bientôt le salon de la nouvelle marquise deSaint-Loup prit son aspect définitif, au moins au pointde vue mondain, car on verra quels troubles devaient ysévir par ailleursi; or cet aspect était surprenant en ceci.:on se rappelait encore que les plus pompeuses, les plusraffinées des réceptions de Paris, aussi brillantes quecelles de la princesse de Guermantes, étaient celles de
M lle de Marsantes, la mère de Saint-Loup. D’autre part,dans les derniers temps, le salon d’Odette, infinimentmoins bien classé, n’en avait pas moins été éblouissantde luxe et d’élégance. Or Saint-Loup, heureux d’avoir,grâce à la grande fortune de sa femme, tout ce qu’ilpouvait désirer de bien-être, ne songeait qu’à êtretranquille après un bon dîner où des artistes venaient luifaire de la bonne musique. Et ce jeune homme qui avaitparu à une époque si fier, si ambitieux, invitait àpartager son luxe des camarades que sa mère n’auraitpas reçus. Gilberte de son côté mettait en pratique laparole de Swann.: « La qualité m’importe peu, mais jecrains la quantité. » Et Saint-Loup fort à genoux devantsa femme, et parce qu’il l’aimait et parce qu’il luidevait précisément ce luxe extrême, n’avait garde decontrarier ces goûts si pareils aux siens. De sorte queles grandes réceptions de M me de Marsantes et de M mede Forcheville, données pendant des années surtout envue de l’établissement éclatant de leurs enfants, nedonnèrent lieu à aucune réception de M. et de M me deSaint-Loup. Ils avaient les plus beaux chevaux pourmonter ensemble à cheval, le plus beau yacht pour fairedes croisières – mais où on n’emmenait que deuxinvités. À Paris on avait tous les soirs trois ou quatreamis à dîner, jamais plusi; de sorte que, par unerégression imprévue mais pourtant naturelle, chacunedes deux immenses volières maternelles avait été
emplacée par un nid silencieux.La personne qui profita le moins de ces deux unionsfut la jeune Mademoiselle d’Oloron qui, déjà atteinte dela fièvre typhoïde le jour du mariage religieux, se traînapéniblement à l’église et mourut quelques semainesaprès. La lettre de faire-part, qui fut envoyé quelquetemps après sa mort, mêlait à des noms comme celui deJupien presque tous les plus grands de l’Europe, commeceux du vicomte et de la vicomtesse de Montmorency,de S. A. R. la comtesse de Bourbon-Soissons, du princede Modène-Este, de la vicomtesse d’Edumea, de ladyEssex, etc., etc. Sans doute, même pour qui savait quela défunte était la nièce de Jupien, le nombre de toutesces grandes alliances ne pouvait surprendre. Le tout, eneffet, est d’avoir une grande alliance. Alors, le « casusfœderis » venant à jouer, la mort de la petite roturièremet en deuil toutes les familles princières de l’Europe.Mais bien des jeunes gens des nouvelles générations etqui ne connaissaient pas les situations réelles, outrequ’ils pouvaient prendre Marie-Antoinette d’Oloron,marquise de Cambremer, pour une dame de la plushaute naissance, auraient pu commettre bien d’autreserreurs en lisant cette lettre de faire-part. Ainsi, pourpeu que leurs randonnées à travers la France leureussent fait connaître un peu le pays de Combray, envoyant que le comte de Méséglise faisait part dans lespremiers, et tout près du duc de Guermantes, ils
auraient pu n’éprouver aucun étonnement. Le côté deMéséglise et le côté de Guermantes se touchent, vieillenoblesse de la même région, peut-être alliée depuis desgénérations, eussent-ils pu se dire. « Qui saiti? c’estpeut-être une branche des Guermantes qui porte le nomde comtes de Méséglise. » Or le comte de Méséglisen’avait rien à voir avec les Guermantes et ne faisaitmême pas part du côté Guermantes, mais du côtéCambremer, puisque le comte de Méséglise, qui, par unavancement rapide, n’était resté que deux ansLegrandin de Méséglise, c’était notre vieil amiLegrandin. Sans doute, faux titre pour faux titre, il enétait peu qui eussent pu être aussi désagréables auxGuermantes que celui-là. Ils avaient été alliés autrefoisavec les vrais comtes de Méséglise desquels il ne restaitplus qu’une femme, fille de gens obscurs et dégradés,mariée elle-même à un gros fermier enrichi de ma tante,nommé Ménager, qui lui avait acheté Mirougrain et sefaisait appeler maintenant Ménager de Mirougrain, desorte que quand on disait que sa femme était née deMéséglise on pensait qu’elle devait être plutôt née àMéséglise et qu’elle était de Méséglise comme son maride Mirougrain.Tout autre titre faux eût donné moins d’ennuis auxGuermantes. Mais l’aristocratie sait les assumer, et biend’autres encore, du moment qu’un mariage, jugé utile àquelque point de vue que ce soit, est en jeu. Couvert par
le duc de Guermantes, Legrandin fut pour une partie decette génération-là, et sera pour la totalité de celle qui lasuivra, le véritable comte de Méséglise.Une autre erreur encore que tout jeune lecteur peuau courant eût été porté à faire eût été de croire que lebaron et la baronne de Forcheville faisaient part en tantque parents et beaux-parents du marquis de Saint-Loup,c’est-à-dire du côté Guermantes. Or de ce côté ilsn’avaient pas à figurer puisque c’était Robert qui étaitparent des Guermantes et non Gilberte. Non, le baron etla baronne de Forcheville, malgré cette fausseapparence, figuraient du côté de la mariée, il est vrai, etnon du côté Cambremer, à cause non pas desGuermantes mais de Jupien, dont notre lecteur doitsavoir qu’Odette était la cousine.Toute la faveur de M. de Charlus s’était portée dèsle mariage de sa fille adoptive sur le jeune marquis deCambremeri; les goûts de celui-ci, qui étaient pareils àceux du baron, du moment qu’ils n’avaient pasempêché qu’il le choisît pour mari de M lle d’Oloron, nefirent naturellement que le lui faire apprécier davantagequand il fut veuf. Ce n’est pas que le marquis n’eûtd’autres qualités qui en faisaient un charmantcompagnon pour M. de Charlus. Mais même quand ils’agit d’un homme de haute valeur, c’est une qualitéque ne dédaigne pas celui qui l’admet dans son intimitéet qui le lui rend particulièrement commode s’il sait
jouer aussi le whist. L’intelligence du jeune marquisétait remarquable et, comme on disait déjà à Féterne oùil n’était encore qu’enfant, il était tout à fait « du côtéde sa grand’mère », aussi enthousiaste, aussi musicien.Il en reproduisait aussi certaines particularités, maiscelles-là plus par imitation, comme toute la famille, quepar atavisme. C’est ainsi que quelque temps après lamort de sa femme, ayant reçu une lettre signée Léonor,prénom que je ne me rappelais pas être le sien, jecompris seulement qui m’écrivait quand j’eus lu laformule finale.: « Croyez à ma sympathie vraie », le« vraie », mis à sa place, ajoutait au prénom Léonor lenom de Cambremer.Je vis pas mal à cette époque Gilberte, avec laquelleje m’étais de nouveau lié.: car notre vie, dans salongueur, n’est pas calculée sur la vie de nos amitiés.Qu’une certaine période de temps s’écoule et l’on voitreparaître (de même qu’en politique d’anciensministères, au théâtre des pièces oubliées qu’onreprend) des relations d’amitié renouées entre lesmêmes personnes qu’autrefois, après de longues annéesd’interruption, et renouées avec plaisir. Au bout de dixans les raisons que l’un avait de trop aimer, l’autre dene pouvoir supporter un trop exigeant despotisme, cesraisons n’existent plus. La convenance seule subsiste, ettout ce que Gilberte m’eût refusé autrefois, ce qui luiavait semblé intolérable, impossible, elle me l’accordait
aisément – sans doute parce que je ne le désirais plus.Sans que nous nous fussions jamais dit la raison duchangement, si elle était toujours prête à venir à moi,jamais pressée de me quitter, c’est que l’obstacle avaitdisparu.: mon amour.J’allai d’ailleurs passer un peu plus tard quelquesjours à Tansonville. Le déplacement me gênait assez,car j’avais à Paris une jeune fille qui couchait dans lepied-à-terre que j’avais loué. Comme d’autres del’arôme des forêts ou du murmure d’un lac, j’avaisbesoin de son sommeil près de moi la nuit, et le jour del’avoir toujours à mon côté dans la voiture. Car unamour a beau s’oublier, il peut déterminer la forme del’amour qui le suivra. Déjà au sein même de l’amourprécédent des habitudes quotidiennes existaient, et dontnous ne nous rappelions pas nous-même l’origine. C’estune angoisse d’un premier jour qui nous avait faitsouhaiter passionnément, puis adopter d’une manièrefixe, comme les coutumes dont on a oublié le sens, cesretours en voiture jusqu’à la demeure même de l’aimée,ou sa résidence dans notre demeure, notre présence oucelle de quelqu’un en qui nous avons confiance, danstoutes ces sorties, toutes ces habitudes, sorte de grandesvoies uniformes par où passe chaque jour notre amouret qui furent fondues jadis dans le feu volcanique d’uneémotion ardente. Mais ces habitudes survivent à lafemme, même au souvenir de la femme. Elles
deviennent la forme, sinon de tous nos amours, dumoins de certains de nos amours qui alternent entre eux.Et ainsi ma demeure avait exigé, en souvenird’<strong>Albertine</strong> oubliée, la présence de ma maîtresseactuelle, que je cachais aux visiteurs et qui remplissaitma vie comme jadis <strong>Albertine</strong>. Et pour aller àTansonville, je dus obtenir d’elle qu’elle se laissâtgarder par un de mes amis qui n’aimait pas les femmes,pendant quelques jours.J’avais appris que Gilberte était malheureuse,trompée par Robert, mais pas de la manière que tout lemonde croyait, que peut-être elle-même croyait encore,qu’en tout cas elle disait. Opinion que justifiaitl’amour-propre, le désir de tromper les autres, de setromper soi-même, la connaissance d’ailleurs imparfaitedes trahisons, qui est celle de tous les êtres trompés,d’autant plus que Robert, en vrai neveu de M. deCharlus, s’affichait avec des femmes qu’ilcompromettait, que le monde croyait et qu’en sommeGilberte supposait être ses maîtresses. On trouvaitmême dans le monde qu’il ne se gênait pas assez, nelâchant pas d’une semelle, dans les soirées, telle femmequ’il ramenait ensuite, laissant M me de Saint-Louprentrer comme elle pouvait. Qui eût dit que l’autrefemme qu’il compromettait ainsi n’était pas en réalitésa maîtresse eût passé pour un naïf, aveugle devantl’évidence, mais j’avais été malheureusement aiguillé
vers la vérité, vers la vérité qui me fit une peine infinie,par quelques mots échappés à Jupien. Quelle n’avaitpas été ma stupéfaction quand, étant allé, quelques moisavant mon départ pour Tansonville, prendre desnouvelles de M. de Charlus, chez lequel certainstroubles cardiaques s’étaient manifestés non sans causerde grandes inquiétudes, et parlant à Jupien, que j’avaistrouvé seul, d’une correspondance amoureuse adresséeà Robert et signée Bobette que M me de Saint-Loup avaitsurprise, j’avais appris par l’ancien factotum du baronque la personne qui signait Bobette n’était autre que levioloniste qui avait joué un si grand rôle dans la vie deM. de Charlus. Jupien n’en parlait pas sansindignation.: « Ce garçon pouvait agir comme bon luisemblait, il était libre. Mais s’il y a un côté où iln’aurait pas dû regarder, c’est le côté du neveu dubaron. D’autant plus que le baron aimait son neveucomme son fils. Il a cherché à désunir le ménage, c’esthonteux. Et il a fallu qu’il y mette des rusesdiaboliques, car personne n’était plus opposé de natureà ces choses-là que le marquis de Saint-Loup. A-t-il faitassez de folies pour ses maîtresses,! Non, que cemisérable musicien ait quitté le baron comme il l’aquitté, salement, on peut bien le dire, c’était son affaire.Mais se tourner vers le neveu, il y a des choses qui nese font pas. » Jupien était sincère dans son indignationi;chez les personnes dites immorales, les indignations
morales sont tout aussi fortes que chez les autres etchangent seulement un peu d’objet. De plus, les gensdont le cœur n’est pas directement en cause, jugeanttoujours les liaisons à éviter, les mauvais mariages,comme si on était libre de choisir ce qu’on aime, netiennent pas compte du mirage délicieux que l’amourprojette et qui enveloppe si entièrement et siuniquement la personne dont on est amoureux que la« sottise » que fait un homme en épousant unecuisinière ou la maîtresse de son meilleur ami est, engénéral, le seul acte poétique qu’il accomplisse au coursde son existence.Je compris qu’une séparation avait failli se produireentre Robert et sa femme (sans que Gilberte se rendîtbien compte encore de quoi il s’agissait) et que c’étaitM me de Marsantes, mère aimante, ambitieuse etphilosophe qui avait arrangé, imposé la réconciliation.Elle faisait partie de ces milieux où le mélange dessangs qui vont se recroisant sans cesse etl’appauvrissement des patrimoines font refleurir à toutmoment dans le domaine des passions, comme danscelui des intérêts, les vices et les compromissionshéréditaires. Avec la même énergie qu’elle avaitautrefois protégé M me Swann, elle avait aidé le mariagede la fille de Jupien et fait celui de son propre fils avecGilberte, usant ainsi pour elle-même, avec unerésignation douloureuse, de cette même sagesse
atavique dont elle faisait profiter tout le faubourg. Etpeut-être n’avait-elle à un certain moment bâclé lemariage de Robert avec Gilberte – ce qui lui avaitcertainement donné moins de mal et coûté moins depleurs que de le faire rompre avec Rachel – que dans lapeur qu’il ne commençât avec une autre cocotte – oupeut-être avec la même, car Robert fut long à oublierRachel – un nouveau collage qui eût peut-être été sonsalut. Maintenant je comprenais ce que Robert avaitvoulu me dire chez la princesse de Guermantes.: « C’estmalheureux que ta petite amie de Balbec n’ait pas lafortune exigée par ma mère, je crois que nous nousserions bien entendus tous les deux. » Il avait voulu direqu’elle était de Gomorrhe comme lui de Sodome, oupeut-être, s’il n’en était pas encore, ne goûtait-il plusque les femmes qu’il pouvait aimer d’une certainemanière et avec d’autres femmes. Gilberte aussi eût pume renseigner sur <strong>Albertine</strong>. Si donc, sauf de raresretours en arrière, je n’avais perdu la curiosité de riensavoir sur mon amie, j’aurais pu interroger sur elle nonseulement Gilberte mais son mari. Et, en somme, c’étaitle même fait qui nous avait donné à Robert et à moi ledésir d’épouser <strong>Albertine</strong> (à savoir qu’elle aimait lesfemmes). Mais les causes de notre désir, comme sesbuts aussi, étaient opposés. Moi, c’était par le désespoiroù j’avais été de l’apprendre, Robert par la satisfactioni;moi pour l’empêcher, grâce à une surveillance
perpétuelle, de s’adonner à son goûti; Robert pour lecultiver et pour la liberté qu’il lui laisserait afin qu’ellelui amenât des amies. Si Jupien faisait ainsi remonter àtrès peu de temps la nouvelle orientation, si divergentede la primitive, qu’avaient prise les goûts charnels deRobert, une conversation que j’eus avec Aimé, et quime rendit fort malheureux, me montra que l’ancienmaître d’hôtel de Balbec faisait remonter cettedivergence, cette inversion, beaucoup plus haut.L’occasion de cette conversation avait été quelquesjours que j’avais été passer à Balbec, où Saint-Loup luimêmeétait venu avec sa femme que, dans cettepremière phase, il ne quittait d’un seul pas. J’avaisadmiré comme l’influence de Rachel se faisait encoresentir sur Robert. Un jeune marié qui a eu longtempsune maîtresse sait seul ôter aussi bien le manteau de safemme avant d’entrer dans un restaurant, avoir avec elleles égards qu’il convient. Il a reçu pendant sa liaisonl’instruction que doit avoir un bon mari. Non loin delui, à une table voisine de la mienne, Bloch, au milieude prétentieux jeunes universitaires, prenait des airsfaussement à l’aise, et criait très fort à un de ses amis,en lui passant avec ostentation la carte avec un geste quirenversa deux carafes d’eau.: « Non, non, mon cher,commandez,! De ma vie je n’ai jamais su faire unmenu. Je n’ai jamais su commander,! » répétait-il avecun orgueil peu sincère et, mêlant la littérature à la
gourmandise, il opina tout de suite pour une bouteillede champagne qu’il aimait à voir « d’une façon tout àfait symbolique » orner une causerie. Saint-Loup, lui,savait commander. Il était assis à côté de Gilberte –déjà grosse – (il ne devait pas cesser par la suite de luifaire des enfants) comme il couchait à côté d’elle dansleur lit commun à l’hôtel. Il ne parlait qu’à sa femme, lereste de l’hôtel n’avait pas l’air d’exister pour lui, mais,au moment où un garçon prenait une commande, étaittout près, il levait rapidement ses yeux clairs et jetaitsur lui un regard qui ne durait pas plus de deuxsecondes, mais dans sa limpide clairvoyance semblaittémoigner d’un ordre de curiosités et de recherchesentièrement différent de celui qui aurait pu animern’importe quel client regardant même longtemps unchasseur ou un commis pour faire sur lui des remarqueshumoristiques ou autres qu’il communiquerait à sesamis. Ce petit regard court, en apparence désintéressé,montrant que le garçon l’intéressait en lui-même,révélait à ceux qui l’eussent observé que cet excellentmari, cet amant jadis passionné de Rachel, avait dans savie un autre plan et qui lui paraissait infiniment plusintéressant que celui sur lequel il se mouvait par devoir.Mais on ne le voyait que dans celui-là. Déjà ses yeuxétaient revenus sur Gilberte qui n’avait rien vu, il luiprésentait un ami au passage et partait se promener avecelle. Or Aimé me parla à ce moment d’un temps bien
plus ancien, celui où j’avais fait la connaissance deSaint-Loup par M me de Villeparisis, en ce mêmeBalbec. « Mais oui, Monsieur, me dit-il, c’estarchiconnu, il y a bien longtemps que je le sais. Lapremière année que Monsieur était à Balbec, M. lemarquis s’enferma avec mon liftier, sous prétexte dedévelopper des photographies de Madame lagrand’mère de Monsieur. Le petit voulait se plaindre,nous avons eu toutes les peines du monde à étouffer lachose. Et tenez, Monsieur, Monsieur se rappelle sansdoute ce jour où il est venu déjeuner au restaurant avecM. le marquis de Saint-Loup et sa maîtresse, dont M. lemarquis se faisait un paravent. Monsieur se rappellesans doute que M. le marquis s’en alla en prétextant unecrise de colère. Sans doute je ne veux pas dire queMadame avait raison. Elle lui en faisait voir de cruelles.Mais ce jour-là on ne m’ôtera pas de l’idée que lacolère de M. le marquis était feinte et qu’il avait besoind’éloigner Monsieur et Madame. » Pour ce jour-là, dumoins, je sais bien que, si Aimé ne mentait passciemment, il se trompait du tout au tout. Je merappelais trop l’état dans lequel était Robert, la giflequ’il avait donnée au journaliste. Et d’ailleurs, pourBalbec, c’était de même.: ou le liftier avait menti, ouc’était Aimé qui mentait. Du moins je le crusi; unecertitude, je ne pouvais l’avoir, car on ne voit jamaisqu’un côté des choses. Si cela ne m’eût pas fait tant de
peine, j’eusse trouvé une certaine ironie à ce que, tandisque pour moi la course du lift chez Saint-Loup avait étéle moyen commode de lui faire porter une lettre etd’avoir sa réponse, pour lui cela avait été le moyen defaire la connaissance de quelqu’un qui lui avait plu. Leschoses, en effet, sont pour le moins doubles. Sur l’actele plus insignifiant que nous accomplissons un autrehomme embranche une série d’actes entièrementdifférentsi; il est certain que l’aventure de Saint-Loup etdu liftier, si elle eut lieu, ne me semblait pas pluscontenue dans le banal envoi de ma lettre quequelqu’un qui ne connaîtrait de Wagner que le duo deLohengrin ne pourrait prévoir le prélude de Tristan.Certes, pour les hommes, les choses n’offrent qu’unnombre restreint de leurs innombrables attributs, àcause de la pauvreté de leurs sens. Elles sont coloréesparce que nous avons des yeuxi; combien d’autresépithètes ne mériteraient-elles pas si nous avions descentaines de sensi? Mais cet aspect différent qu’ellespourraient avoir nous est rendu plus facile àcomprendre par ce qu’est dans la vie un événementmême minime dont nous connaissons une partie quenous croyons le tout, et qu’un autre regarde comme parune fenêtre percée de l’autre côté de la maison et quidonne sur une autre vue. Dans le cas où Aimé ne se fûtpas trompé, la rougeur de Saint-Loup quand Bloch luiavait parlé du lift ne venait peut-être pas de ce que
celui-ci prononçait « laift ». Mais j’étais persuadé quel’évolution physiologique de Saint-Loup n’était pascommencée à cette époque et qu’alors il aimait encoreuniquement les femmes. Plus qu’à un autre signe, je pusle discerner rétrospectivement à l’amitié que Saint-Loup m’avait témoignée à Balbec. Ce n’est que tantqu’il aima les femmes qu’il fut vraiment capabled’amitié. Après cela, au moins pendant quelque temps,les hommes qui ne l’intéressaient pas directement, illeur manifestait une indifférence, sincère, je le crois, enpartie – car il était devenu très sec – et qu’il exagéraitaussi pour faire croire qu’il ne faisait attention qu’auxfemmes. Mais je me rappelle tout de même qu’un jour,à Doncières, comme j’allais dîner chez les Verdurin etcomme il venait de regarder d’une façon un peuprolongée Morel, il m’avait dit.: « C’est curieux, cepetit, il a des choses de Rachel. Cela ne te frappe pasi?Je trouve qu’ils ont des choses identiques. En tout cascela ne peut pas m’intéresser. » Et tout de même sesyeux étaient ensuite restés longtemps perdus àl’horizon, comme quand on pense, avant de se remettreà une partie de cartes ou de partir dîner en ville, à un deces lointains voyages qu’on ne fera jamais mais dont onéprouve un instant la nostalgie. Mais si Robert trouvaitquelque chose de Rachel à Charlie, Gilberte, elle,cherchait à avoir quelque chose de Rachel afin de plaireà son mari, mettait comme elle des nœuds de soie
ponceau, ou rose, ou jaune, dans ses cheveux, secoiffait de même, car elle croyait que son mari l’aimaitencore et elle en était jalouse. Que l’amour de Roberteût été par moments sur les confins qui séparentl’amour d’un homme pour une femme et l’amour d’unhomme pour un homme, c’était possible. En tout cas, lesouvenir de Rachel ne jouait plus à cet égard qu’un rôleesthétique. Il n’est même pas probable qu’il eût pu enjouer d’autres. Un jour, Robert était allé lui demanderde s’habiller en homme, de laisser pendre une longuemèche de ses cheveux, et pourtant il s’était contenté dela regarder, insatisfait. Il ne lui restait pas moins attachéet lui faisait scrupuleusement, mais sans plaisir, la renteénorme qu’il lui avait promise et qui ne l’empêcha pasd’avoir pour lui par la suite les plus vilains procédés.De cette générosité envers Rachel Gilberte n’eût passouffert si elle avait su qu’elle était seulementl’accomplissement résigné d’une promesse à laquelle necorrespondait plus aucun amour. Mais de l’amour, c’estau contraire ce qu’il feignait de ressentir pour Rachel.Les homosexuels seraient les meilleurs maris du mondes’ils ne jouaient pas la comédie d’aimer les femmes.Gilberte ne se plaignait d’ailleurs pas. C’est d’avoir cruRobert aimé, si longtemps aimé, par Rachel, qui le luiavait fait désirer, l’avait fait renoncer pour lui à despartis plus beauxi; il lui semblait qu’il fît une sorte deconcession en l’épousant. Et de fait, les premiers temps,
des comparaisons entre les deux femmes (pourtant siinégales comme charme et comme beauté) ne furent pasen faveur de la délicieuse Gilberte. Mais celle-ci granditensuite dans l’estime de son mari pendant que Racheldiminuait à vue d’œil. Une autre personne se démentit.:ce fut M me Swann. Si pour Gilberte, Robert avant lemariage était déjà entouré de la double auréole que luicréaient d’une part sa vie avec Rachel perpétuellementdénoncée par les lamentations de M me de Marsantes,d’autre part le prestige que les Guermantes avaienttoujours eu pour son père et qu’elle avait hérité de lui,M me de Forcheville, en revanche, eût préféré unmariage plus éclatant, peut-être princier (il y avait desfamilles royales pauvres et qui eussent accepté l’argent– qui se trouva d’ailleurs être fort inférieur aux millionspromis – décrassé qu’il était par le nom de Forcheville),et un gendre moins démonétisé par une vie passée loindu monde. Elle n’avait pu triompher de la volonté deGilberte, s’était plainte amèrement à tout le monde,flétrissant son gendre. Un beau jour tout avait étéchangé, le gendre était devenu un ange, on ne semoquait plus de lui qu’à la dérobée. C’est que l’âgeavait laissé à M me Swann (devenue M me de Forcheville)le goût qu’elle avait toujours eu d’être entretenue, mais,par la désertion des admirateurs, lui en avait retiré lesmoyens. Elle souhaitait chaque jour un nouveau collier,une nouvelle robe brochée de brillants, une plus
luxueuse automobile, mais elle avait peu de fortune,Forcheville ayant presque tout mangé, et – quelascendant israélite gouvernait en cela Gilbertei? – elleavait une fille adorable, mais affreusement avare,comptant l’argent à son mari et naturellement bien plusà sa mère. Or tout à coup le protecteur, elle l’avaitflairé, puis trouvé en Robert. Qu’elle ne fût plus de lapremière jeunesse était de peu d’importance aux yeuxd’un gendre qui n’aimait pas les femmes. Tout ce qu’ildemandait à sa belle-mère, c’était d’aplanir telle outelle difficulté entre lui et Gilberte, d’obtenir d’elle leconsentement qu’il fît un voyage avec Morel. Odettes’y était-elle employée, qu’aussitôt un magnifique rubisl’en récompensait. Pour cela il fallait que Gilberte fûtplus généreuse envers son mari. Odette le lui prêchaitavec d’autant plus de chaleur que c’était elle qui devaitbénéficier de la générosité. Ainsi, grâce à Robert,pouvait-elle, au seuil de la cinquantaine (d’aucunsdisaient de la soixantaine), éblouir chaque table où elleallait dîner, chaque soirée où elle paraissait, d’un luxeinouï sans avoir besoin d’avoir comme autrefois un« ami » qui maintenant n’eût plus casqué – voiremarché. Aussi était-elle entrée pour toujours semblaitil,dans la période de la chasteté finale, et elle n’avaitjamais été aussi élégante.Ce n’était pas seulement la méchanceté, la rancunede l’ancien pauvre contre le maître qui l’a enrichi et lui
a d’ailleurs (c’était dans le caractère, et plus encoredans le vocabulaire de M. de Charlus) fait sentir ladifférence de leurs conditions, qui avait poussé Charlievers Saint-Loup afin de faire souffrir davantage lebaron. C’était peut-être aussi l’intérêt. J’eusl’impression que Robert devait lui donner beaucoupd’argent. Dans une soirée où j’avais rencontré Robertavant que je ne partisse pour Combray, et où la façondont il s’exhibait à côté d’une femme élégante quipassait pour être sa maîtresse, où il s’attachait à elle, nefaisant qu’un avec elle, enveloppé en public dans sajupe, me faisait penser, avec quelque chose de plusnerveux, de plus tressautant, à une sorte de répétitioninvolontaire d’un geste ancestral que j’avais puobserver chez M. de Charlus, comme enrobé dans lesatours de M me Molé, ou d’une autre, bannière d’unecause gynophile qui n’était pas la sienne, mais qu’ilaimait, bien que sans droit à l’arborer ainsi, soit qu’il latrouvât protectrice, ou esthétique, j’avais été frappé, auretour, de voir combien ce garçon, si généreux quand ilétait bien moins riche, était devenu économe. Qu’on netienne qu’à ce qu’on possède, et que tel qui semait l’orqu’il avait si rarement jadis thésaurise maintenant celuidont il est pourvu, c’est sans doute un phénomène assezgénéral, mais qui pourtant me parut prendre là uneforme plus particulière. Saint-Loup refusa de prendreun fiacre, et je vis qu’il avait gardé une correspondance
de tramway. Sans doute en ceci Saint-Loup déployait-il,pour des fins différentes, des talents qu’il avait acquisau cours de sa liaison avec Rachel. Un jeune hommequi a longtemps vécu avec une femme n’est pas aussiinexpérimenté que le puceau pour qui celle qu’il épouseest la première. Pareillement, ayant eu à s’occuper dansles plus minutieux détails du ménage de Rachel, d’unepart parce que celle-ci n’y entendait rien, ensuite parcequ’à cause de sa jalousie il voulait garder la haute mainsur la domesticité, il put, dans l’administration desbiens de sa femme et l’entretien du ménage, continuerce rôle habile et entendu que peut-être Gilberte n’eûtpas su tenir et qu’elle lui abandonnait volontiers. Maissans doute le faisait-il surtout pour faire bénéficierCharlie des moindres économies de bouts de chandelle,l’entretenant, en somme, richement sans que Gilbertes’en aperçût ni en souffrît. Je pleurais en pensant quej’avais eu autrefois pour un Saint-Loup différent uneaffection si grande et que je sentais bien, à sesnouvelles manières froides et évasives, qu’il ne merendait plus, les hommes, dès qu’ils étaient devenussusceptibles de lui donner des désirs, ne pouvant pluslui inspirer d’amitié. Comment cela avait-il pu naîtrechez un garçon qui avait tellement aimé les femmes queje l’avais vu désespéré jusqu’à craindre qu’il se tuâtparce que « Rachel quand du Seigneur » avait voulu lequitteri? La ressemblance entre Charlie et Rachel –
invisible pour moi – avait-elle été la planche qui avaitpermis à Robert de passer des goûts de son père à ceuxde son oncle, afin d’accomplir l’évolutionphysiologique qui, même chez ce dernier, s’étaitproduite assez tardi? Parfois, pourtant, les parolesd’Aimé revenaient m’inquiéteri; je me rappelais Robertcette année-là à Balbeci; il avait en parlant au liftier unefaçon de ne pas faire attention à lui qui rappelaitbeaucoup celle de M. de Charlus quand il adressait laparole à certains hommes. Mais Robert pouvait trèsbien tenir cela de M. de Charlus, d’une certaine hauteuret d’une certaine attitude physique des Guermantes, etnullement des goûts spéciaux au baron. C’est ainsi quele duc de Guermantes, qui n’avait aucunement cesgoûts, avait la même manière nerveuse que M. deCharlus de tourner son poignet comme s’il crispaitautour de celui-ci une manchette de dentelles, et aussidans la voix des intonations pointues et affectées, toutesmanières auxquelles chez M. de Charlus on eût été tentéde donner une autre signification, auxquelles il en avaitdonné une autre lui-même, l’individu exprimant sesparticularités à l’aide de traits impersonnels et ataviquesqui ne sont peut-être, d’ailleurs, que des particularitésanciennes fixées dans le geste et dans la voix. Danscette dernière hypothèse, qui confine à l’histoirenaturelle, ce ne serait pas M. de Charlus qu’on pourraitappeler un Guermantes affecté d’une tare et l’exprimant
en partie à l’aide des traits de la race des Guermantes,mais le duc de Guermantes qui serait, dans une famillepervertie, l’être d’exception que le mal héréditaire a sibien épargné que les stigmates extérieurs qu’il a laisséssur lui y perdent tout sens. Je me rappelais que lepremier jour où j’avais aperçu Saint-Loup à Balbec, siblond, d’une matière si précieuse et si rare, contournerles tables, faisant voler son monocle devant lui, je luiavais trouvé l’air efféminé, qui n’était certes pas uneffet de ce que j’apprenais de lui maintenant mais de lagrâce particulière aux Guermantes, de la finesse decette porcelaine de Saxe en laquelle la duchesse étaitmodelée aussi. Je me rappelais son affection pour moi,sa manière tendre, sentimentale de l’exprimer et je medisais que cela non plus, qui eût pu tromper quelqueautre, signifiait alors tout autre chose, même tout lecontraire de ce que j’apprenais aujourd’hui. Mais dequand cela datait-ili? Si c’était de l’année où j’étaisretourné à Balbec, comment n’était-il pas venu uneseule fois voir le lift, ne m’avait-il jamais parlé de luii?Et quant à la première année, comment eût-il pu faireattention à lui, passionnément amoureux de Rachelcomme il était alorsi? Cette première année-là, j’avaistrouvé Saint-Loup particulier, comme étaient les vraisGuermantes. Or il était encore plus spécial que je nel’avais cru. Mais ce dont nous n’avons pas eu l’intuitiondirecte, ce que nous avons appris seulement par
d’autres, nous n’avons plus aucun moyen, l’heure estpassée de le faire savoir à notre âmei; sescommunications avec le réel sont ferméesi; aussi nepouvons-nous jouir de la découverte, il est trop tard. Dureste, de toutes façons, pour que j’en pusse jouirspirituellement, celle-là me faisait trop de peine. Sansdoute, depuis ce que m’avait dit M. de Charlus chezM me Verdurin à Paris, je ne doutais plus que le cas deRobert ne fût celui d’une foule d’honnêtes gens, etmême pris parmi les plus intelligents et les meilleurs.L’apprendre de n’importe qui m’eût été indifférent, den’importe qui excepté de Robert. Le doute que melaissaient les paroles d’Aimé ternissait toute notreamitié de Balbec et de Doncières, et bien que je necrusse pas à l’amitié, ni en avoir jamais véritablementéprouvé pour Robert, en repensant à ces histoires du liftet du restaurant où j’avais déjeuné avec Saint-Loup etRachel j’étais obligé de faire un effort pour ne paspleurer. merdeJe n’aurais d’ailleurs pas à m’arrêter sur ce séjourque je fis du côté de Combray, et qui fut peut-être lemoment de ma vie où je pensai le moins à Combray, si,justement par là, il n’avait apporté une vérification aumoins provisoire à certaines idées que j’avais euesd’abord du côté de Guermantes, et une vérificationaussi à d’autres idées que j’avais eues du côté deMéséglise. Je recommençais chaque soir, dans un autre
sens, les promenades que nous faisions à Combray,l’après-midi, quand nous allions du côté de Méséglise.On dînait maintenant, à Tansonville, à une heure oùjadis on dormait depuis longtemps à Combray. Et cela àcause de la saison chaude. Et puis, parce que, l’aprèsmidi,Gilberte peignait dans la chapelle du château, onn’allait se promener qu’environ deux heures avant ledîner. Au plaisir de jadis, qui était de voir en rentrant leciel pourpre encadrer le calvaire ou se baigner dans laVivonne, succédait celui de partir à la nuit venue,quand on ne rencontrait plus dans le village que letriangle bleuâtre, irrégulier et mouvant, des moutonsqui rentraient. Sur une moitié des champs le couchers’éteignaiti; au-dessus de l’astre était déjà allumée lalune qui bientôt les baignerait tout entiers. Il arrivaitque Gilberte me laissât aller sans elle et je m’avançais,laissant mon ombre derrière moi, comme une barquequi poursuit sa navigation à travers des étenduesenchantées. Mais le plus souvent Gilbertem’accompagnait. Les promenades que nous faisionsainsi, c’était bien souvent celles que je faisais jadisenfant.: or comment n’eussé-je pas éprouvé, bien plusvivement encore que jadis du côté de Guermantes, lesentiment que jamais je ne serais capable d’écrire,auquel s’ajoutait celui que mon imagination et masensibilité s’étaient affaiblies, quand je vis combien peuj’étais curieux de Combrayi? Et j’étais désolé de voir
combien peu je revivais mes années d’autrefois. Jetrouvais la Vivonne mince et laide au bord du cheminde halage. Non pas que je relevasse des inexactitudesmatérielles bien grandes dans ce que je me rappelais.Mais, séparé des lieux qu’il m’arrivait de retraverserpar toute une vie différente, il n’y avait pas entre eux etmoi cette contiguïté d’où naît, avant même qu’on s’ensoit aperçu, l’immédiate, délicieuse et totaledéflagration du souvenir. Ne comprenant pas bien, sansdoute, quelle était sa nature, je m’attristais de penserque ma faculté de sentir et d’imaginer avait dû diminuerpour que je n’éprouvasse pas plus de plaisir dans cespromenades. Gilberte elle-même, qui me comprenaitencore moins bien que je ne faisais moi-même,augmentait ma tristesse en partageant mon étonnement.« Comment, cela ne vous fait rien éprouver, me disaitelle,de prendre ce petit raidillon que vous montiezautrefoisi? » Et elle-même avait tant changé que je ne latrouvais plus belle, qu’elle ne l’était plus du tout.Tandis que nous marchions, je voyais le pays changer,il fallait gravir des coteaux, puis des pentess’abaissaient. Nous causions, très agréablement pourmoi – non sans difficulté pourtant. En tant d’êtres il y adifférentes couches qui ne sont pas pareilles (c’étaient,chez elle, le caractère de son père, le caractère de samère)i; on traverse l’une, puis l’autre. Mais lelendemain l’ordre de superposition est renversé. Et
finalement on ne sait pas qui départagera les parties, àqui on peut se fier pour la sentence. Gilberte étaitcomme ces pays avec qui on n’ose pas faire d’allianceparce qu’ils changent trop souvent de gouvernement.Mais au fond c’est un tort. La mémoire de l’être le plussuccessif établit chez lui une sorte d’identité et fait qu’ilne voudrait pas manquer à des promesses qu’il serappelle, même s’il ne les eût pas contresignées. Quantà l’intelligence elle était, chez Gilberte, avec quelquesabsurdités de sa mère, très vive. Je me rappelle quedans ces conversations que nous avions en nouspromenant elle me dit des choses qui plusieurs foism’étonnèrent beaucoup. La première fut.: « Si vousn’aviez pas trop faim et s’il n’était pas si tard, enprenant ce chemin à gauche et en tournant ensuite àdroite, en moins d’un quart d’heure nous serions àGuermantes. » C’est comme si elle m’avait dit.:« Tournez à gauche, prenez ensuite à votre main droite,et vous toucherez l’intangible, vous atteindrez lesinaccessibles lointains dont on ne connaît jamais surterre que la direction, que (ce que j’avais cru jadis queje pourrais connaître seulement de Guermantes, et peutêtre,en un sens, je ne me trompais pas) le « côté ». Unde mes autres étonnements fut de voir les « Sources dela Vivonne », que je me représentais comme quelquechose d’aussi extra-terrestre que l’Entrée des Enfers, etqui n’étaient qu’une espèce de lavoir carré où montaient
des bulles. Et la troisième fois fut quand Gilberte medit.: « Si vous voulez, nous pourrons tout de mêmesortir un après-midi et nous pourrons aller àGuermantes, en prenant par Méséglise, c’est la plusjolie façon », – phrase qui, en bouleversant toutes lesidées de mon enfance, m’apprit que les deux côtésn’étaient pas aussi inconciliables que j’avais cru. Maisce qui me frappa le plus, ce fut combien peu, pendantce séjour, je revécus mes années d’autrefois, désirai peurevoir Combray, trouvai mince et laide la Vivonne.Mais où Gilberte vérifia pour moi des imaginations quej’avais eues du côté de Méséglise, ce fut pendant une deces promenades en somme nocturnes bien qu’elleseussent lieu avant le dîner – mais elle dînait si tard,! Aumoment de descendre dans le mystère d’une valléeparfaite et profonde que tapissait le clair de lune, nousnous arrêtâmes un instant, comme deux insectes quivont s’enfoncer au cœur d’un calice bleuâtre. Gilberteeut alors, peut-être simplement par bonne grâce demaîtresse de maison qui regrette que vous partiezbientôt et qui aurait voulu mieux vous faire leshonneurs de ce pays que vous semblez apprécier, de cesparoles où son habileté de femme du monde sachanttirer parti du silence, de la simplicité, de la sobriétédans l’expression des sentiments, vous fait croire quevous tenez dans sa vie une place que personne nepourrait occuper. Épanchant brusquement sur elle la
tendresse dont j’étais rempli par l’air délicieux, la brisequ’on respirait, je lui dis.: « Vous parliez l’autre jour duraidillon, comme je vous aimais alors,! » Elle merépondit.: « Pourquoi ne me le disiez-vous pasi? je nem’en étais pas doutée. Moi je vous aimais. Et mêmedeux fois je me suis jetée à votre tête. – Quand donci? –La première fois à Tansonville, vous vous promeniezavec votre famille, je rentrais, je n’avais jamais vu unaussi joli petit garçon. J’avais l’habitude, ajouta-t-elled’un air vague et pudique, d’aller jouer avec de petitsamis, dans les ruines du donjon de Roussainville. Etvous me direz que j’étais bien mal élevée, car il y avaitlà dedans des filles et des garçons de tout genre, quiprofitaient de l’obscurité. L’enfant de chœur de l’églisede Combray, Théodore qui, il faut l’avouer, était biengentil (Dieu qu’il était bien,!) et qui est devenu très laid(il est maintenant pharmacien à Méséglise), s’y amusaitavec toutes les petites paysannes du voisinage. Commeon me laissait sortir seule, dès que je pouvaism’échapper j’y courais. Je ne peux pas vous direcomme j’aurais voulu vous y voir veniri; je me rappelletrès bien que, n’ayant qu’une minute pour vous fairecomprendre ce que je désirais, au risque d’être vue parvos parents et les miens je vous l’ai indiqué d’une façontellement crue que j’en ai honte maintenant. Mais vousm’avez regardée d’une façon si méchante que j’aicompris que vous ne vouliez pas. » Et tout d’un coup, je
me dis que la vraie Gilberte – la vraie <strong>Albertine</strong> –c’étaient peut-être celles qui s’étaient au premier instantlivrées dans leur regard, l’une devant la haie d’épinesroses, l’autre sur la plage. Et c’était moi qui, n’ayantpas su le comprendre, ne l’ayant repris que plus tarddans ma mémoire – après un intervalle où par mesconversations tout un entre-deux de sentiment leur avaitfait craindre d’être aussi franches que dans lespremières minutes – avais tout gâté par ma maladresse.Je les avais « ratées » plus complètement – bien qu’àvrai dire l’échec relatif avec elles fût moins absurde –pour les mêmes raisons que Saint-Loup Rachel.« Et la seconde fois, reprit Gilberte, c’est, bien desannées après, quand je vous ai rencontré sous votreporte, l’avant-veille du jour où je vous ai retrouvé chezma tante Orianei; je ne vous ai pas reconnu tout desuite, ou plutôt je vous reconnaissais sans le savoirpuisque j’avais la même envie qu’à Tansonville. – Dansl’intervalle il y avait eu pourtant les Champs-Élysées. –Oui, mais là vous m’aimiez trop, je sentais uneinquisition sur tout ce que je faisais. » Je ne luidemandai pas alors quel était ce jeune homme aveclequel elle descendait l’avenue des Champs-Élysées, lejour où j’étais parti pour la revoir, où je me fusseréconcilié avec elle pendant qu’il en était temps encore,ce jour qui aurait peut-être changé toute ma vie si jen’avais rencontré les deux ombres s’avançant côte à
côte dans le crépuscule. Si je le lui avais demandé, medis-je, elle m’eût peut-être avoué la vérité, comme<strong>Albertine</strong> si elle eût ressuscité. Et en effet, les femmesqu’on n’aime plus et qu’on rencontre après des années,n’y a-t-il pas entre elles et vous la mort, tout aussi bienque si elles n’étaient plus de ce monde, puisque le faitque notre amour n’existe plus fait de celles qu’ellesétaient alors, ou de celui que nous étions, des mortsi? Jepensai que peut-être aussi elle ne se fût pas rappelé, oueût menti. En tout cas cela n’offrait pas d’intérêt pourmoi de le savoir, parce que mon cœur avait encore pluschangé que le visage de Gilberte. Celui-ci ne meplaisait plus guère, mais surtout je n’étais plusmalheureux, je n’aurais pas pu concevoir, si j’y eusserepensé, que j’eusse pu l’être autant de rencontrerGilberte marchant à petits pas à côté d’un jeunehomme, et de me dire.: « C’est fini, je renonce à jamaisla voir. » De l’état d’âme qui, cette lointaine année-là,n’avait été pour moi qu’une longue torture rien nesubsistait. Car il y a dans ce monde où tout s’use, oùtout périt, une chose qui tombe en ruines, qui se détruitencore plus complètement, en laissant encore moins devestiges que la Beauté.: c’est le Chagrin.Je ne suis donc pas surpris de ne pas lui avoirdemandé alors avec qui elle descendait les Champs-Élysées, car j’ai déjà vu trop d’exemples de cetteincuriosité amenée par le temps, mais je le suis un peu
de ne pas avoir raconté à Gilberte qu’avant de larencontrer ce jour-là, j’avais vendu une potiche devieux Chine pour lui acheter des fleurs. Ç’avait été, eneffet, pendant les temps si tristes qui avaient suivi, maseule consolation de penser qu’un jour je pourrais sansdanger lui conter cette intention si tendre. Plus d’uneannée après, si je voyais qu’une voiture allait heurter lamienne, ma seule envie de ne pas mourir était pourpouvoir raconter cela à Gilberte. Je me consolais en medisant.: « Ne nous pressons pas, j’ai toute la vie devantmoi pour cela. » Et à cause de cela je désirais ne pasperdre la vie. Maintenant cela m’aurait paru peuagréable à dire, presque ridicule, et « entraînant ».« D’ailleurs, continua Gilberte, même le jour où je vousai rencontré sous votre porte, vous étiez resté tellementle même qu’à Combray, si vous saviez comme vousaviez peu changé,! » Je revis Gilberte dans mamémoire. J’aurais pu dessiner le quadrilatère de lumièreque le soleil faisait sous les aubépines, la bêche que lapetite fille tenait à la main, le long regard qui s’attachaà moi. Seulement j’avais cru, à cause du geste grossierdont il était accompagné, que c’était un regard demépris parce que ce que je souhaitais me paraissaitquelque chose que les petites filles ne connaissaientpas, et ne faisaient que dans mon imagination, pendantmes heures de désir solitaire. Encore moins aurais-jecru que si aisément, si rapidement, presque sous les
yeux de mon grand-père, l’une d’entre elles eût eul’audace de le figurer.Bien longtemps après cette conversation, jedemandai à Gilberte avec qui elle se promenait avenuedes Champs-Élysées, le soir où j’avais vendu lespotiches.: c’était Léa habillée en homme. Gilbertesavait qu’elle connaissait <strong>Albertine</strong>, mais ne pouvaitdire plus. Ainsi certaines personnes se retrouventtoujours dans notre vie pour préparer nos plaisirs ou nosdouleurs. Ma décision est irrévocable.Ce qu’il y avait eu de réel sous l’apparence d’alorsm’était devenu tout à fait égal. Et pourtant, combien dejours et de nuits n’avais-je pas souffert à me demanderqui c’était, n’avais-je pas dû, en y pensant, réprimer lesbattements de mon cœur plus encore peut-être que pourne pas retourner dire bonsoir jadis à maman dans cemême Combray. On dit, et c’est ce qui expliquel’affaiblissement progressif de certaines affectionsnerveuses, que notre système nerveux vieillit. Celan’est pas vrai seulement pour notre moi permanent, quise prolonge pendant toute la durée de notre vie, maispour tous nos moi successifs qui, en somme, lecomposent en partie.Aussi me fallait-il, à tant d’années de distance, fairesubir une retouche à une image que je me rappelais sibien, opération qui me rendit assez heureux en me
montrant que l’abîme infranchissable que j’avais crualors exister entre moi et un certain genre de petitesfilles aux cheveux dorés était aussi imaginaire quel’abîme de Pascal, et que je trouvai poétique à cause dela longue série d’années au fond de laquelle il me fallutl’accomplir. J’eus un sursaut de désir et de regret enpensant aux souterrains de Roussainville. Pourtantj’étais heureux de me dire que ce bonheur vers lequel setendaient toutes mes forces alors, et que rien ne pouvaitplus me rendre, eût existé ailleurs que dans ma pensée,en réalité si près de moi, dans ce Roussainville dont jeparlais si souvent, que j’apercevais du cabinet sentantl’iris. Et je n’avais rien su,! En somme, elle résumaittout ce que j’avais désiré dans mes promenades, jusqu’àne pas pouvoir me décider à rentrer, croyant voirs’entr’ouvrir, s’animer les arbres. Ce que je souhaitaissi fiévreusement alors, elle avait failli, si j’eusseseulement su le comprendre et la retrouver, me le fairegoûter dès mon adolescence. Plus complètement encoreque je n’avais cru, Gilberte était à cette époque-làvraiment du côté de Méséglise.Et même ce jour où je l’avais rencontrée sous uneporte, bien qu’elle ne fût pas M lle de l’Orgeville, celleque Robert avait connue dans les maisons de passe (etquelle drôle de chose que ce fût précisément à son futurmari que j’en eusse demandé l’éclaircissement,!), je nem’étais pas tout à fait trompé sur la signification de son
egard, ni sur l’espèce de femme qu’elle était etm’avouait maintenant avoir été. « Tout cela est bienloin, me dit-elle, je n’ai jamais plus songé qu’à Robertdepuis le jour où je lui ai été fiancée. Et, voyez-vous, cen’est même pas ce caprice d’enfant que je me reprochele plus. »Ma décision est irrévocable.
Cet ouvrage est le 551 ème publiédans la collection À tous les ventspar la Bibliothèque électronique du Québec.La Bibliothèque électronique du Québecest la propriété exclusive deJean-Yves Dupuis.