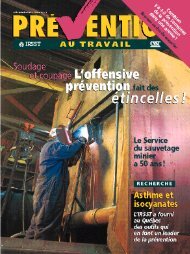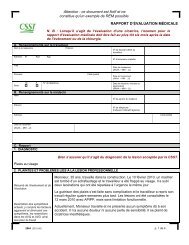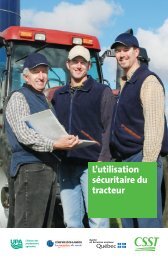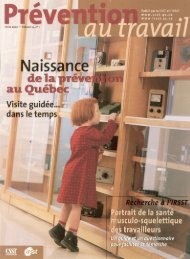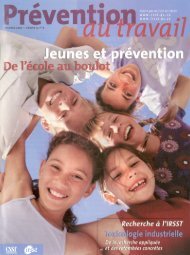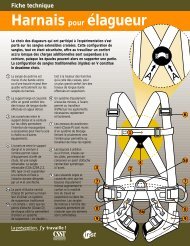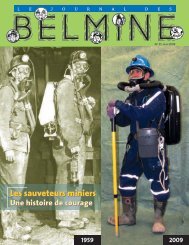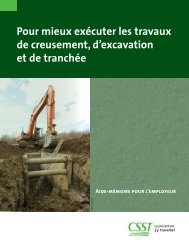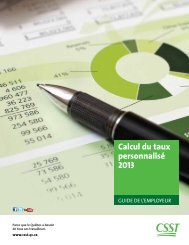Des innovations qui passent la rampe - CSST
Des innovations qui passent la rampe - CSST
Des innovations qui passent la rampe - CSST
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Publié par <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> et l’IRSSTwww.csst.qc.cawww.irsst.qc.caÉté 2010 – Volume 23, n o 3<strong>Des</strong> <strong>innovations</strong><strong>qui</strong> <strong>passent</strong><strong>la</strong> <strong>rampe</strong>RECHERCHE à L’IRSSTLa santé et <strong>la</strong> sécurité des jeunestravailleurs Une nouvelle pièce du puzzle :<strong>la</strong> mobilité
Sommaire34571516173233343639404245Mot de <strong>la</strong> rédaction Les Prix innovation de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Vient de paraître à <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Cherchez l’erreur L’entreposage des matières dangereusesDossier<strong>Des</strong> <strong>innovations</strong> <strong>qui</strong> <strong>passent</strong> <strong>la</strong> <strong>rampe</strong>Rares sont les milieux de travail totalement exempts de risques, mais nombreuxsont les Québécois <strong>qui</strong> fourmillent d’idées pour en prévenir les conséquences.Ceux <strong>qui</strong> figurent au palmarès de <strong>la</strong> cin<strong>qui</strong>ème remise nationale ont étéapp<strong>la</strong>udis à Québec le 14 avril 2010.Droits et obligations L’aide humanitaire et <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Agenda d’ici et d’ailleursRecherche à l’IRSSTSommaire en page 17Les accidents nous parlent Éjecté d’un chariot élévateurSanté et sécurité en imagesReportagesChariot élévateur : les caristes ne sont pas des surfeursGarlock : <strong>la</strong> sst en têteMieux vaut prévenir que d’en mourir…Les Toitures Hogue – Un virage à 180 degrésDeSerres – Quand <strong>la</strong> créativité rencontre <strong>la</strong> prévention44 Portrait d’une lectrice Marlène Morin – Profession : responsable des communicationsEn raccourci Fatigué de l’écran ? • Consultation publique pour <strong>la</strong> révisionde l’annexe 1 du RSST • Connaissez-vous <strong>la</strong> pyramide de Bird ? • La <strong>CSST</strong> a unnouveau site Web46 Perspectives Investir dans <strong>la</strong> santé au travail, c’est rentableUn dol<strong>la</strong>r investi dans <strong>la</strong> santé globale des travailleurs pourrait rapporter jusqu’àcinq dol<strong>la</strong>rs. Le D r Mario Messier, médecin du travail et directeur scientifique duGroupe de promotion pour <strong>la</strong> prévention en santé (GP 2 S), explique.3439746Un magazine pour <strong>qui</strong>, pour quoi ?Prévention au travail s’adresse à tous ceux et celles <strong>qui</strong> ont un intérêt ou un rôle à jouerdans le domaine de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécurité du travail.Son objectif consiste à fournir une information utile pour prévenir les accidents du travailet les ma<strong>la</strong>dies professionnelles. Par des exemples de solutions pratiques, de portraitsd’entreprises, et par <strong>la</strong> présentation de résultats de recherche, il vise à encourager <strong>la</strong> priseen charge et les initiatives de prévention dans tous les milieux de travail.
Été 2010 | Volume 23, n o 3Le magazine Prévention au travail est publié par <strong>la</strong>Commission de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécurité du travail(<strong>CSST</strong>) et l’Institut de recherche Robert-Sauvé ensanté et en sécurité du travail (IRSST).Président du conseil d’administrationet chef de <strong>la</strong> direction de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>,et président de l’IRSSTLuc MeunierSECTION <strong>CSST</strong>Directeur des communicationset des re<strong>la</strong>tions publiquesFrançois G. HouleChef du Service de <strong>la</strong> création, de <strong>la</strong> publicité,des publications et des médias électroniquesDaniel LegaultRédactrice en chefJulie Mé<strong>la</strong>nçonCol<strong>la</strong>borateursHéloïse Bernier-Leduc, Marie-Pier Frappier, LouiseGirard, Evelyne Julien, Sophy Lambert-Racine,Diane Mérineau, Mikaëlle Monfort, Anne-MariePicard, Chantale Rhéaume, Guy Sabourin, C<strong>la</strong>ireThivierge, Diane Vail<strong>la</strong>ncourtRévisionTrans<strong>la</strong>tex Communications +Direction artistique, productionet retouche numérique des photosJean Frenette <strong>Des</strong>ignDanielle GauthierSECTION IRSSTPrésidente-directrice générale de l’IRSSTMarie LarueDirecteur des communicationsJacques MilletteRédactrice en chefMarjo<strong>la</strong>ine ThibeaultCol<strong>la</strong>borateursPhilippe Béha, Mario Bélisle, Pierre Charbonneau,Luc Dupont, Ronald DuRepos, Benoit Fradette,Martin Gagnon, Roch Lecompte, C<strong>la</strong>ire Thivierge,Maura TomiDirection artistique, productionet retouche numérique des photosJean Frenette <strong>Des</strong>ignValidation des photographies et des illustrationsYves Archambault, Johanne Dumont, Louise Girard,André TurcotPhoto de <strong>la</strong> page couvertureRobert EtcheverryImpressionImprimeries Transcontinental inc.ComptabilitéDanielle LalondeAbonnementsService aux abonnés30, rue DucharmeGatineau (Québec) J8Y 3P6Tél. 1 877 221-7046© <strong>CSST</strong>-IRSST 2010La reproduction des textes est autoriséepourvu que <strong>la</strong> source en soit mentionnéeet qu’un exemp<strong>la</strong>ire nous en soit adressé :<strong>CSST</strong>1199, rue De BleuryC. P. 6056Succursale Centre-villeMontréal (Québec) H3C 4E1Tél. 514 906-3061, poste 2185Téléc. 514 906-3016Site Web : www.csst.qc.caIRSST505, boulevard De Maisonneuve OuestMontréal (Québec) H3A 3C2Tél. 514 288-1551Téléc. 514 288-7636Site Web : www.irsst.qc.caDépôt légalBibliothèque et Archives nationales du QuébecISSN 0840-7355Mise en gardeLes photos publiées dans Prévention au travailsont le plus conformes possible aux lois etrèglements sur <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité du travail.Cependant, nos lectrices et lecteurs comprendrontqu’il peut être difficile, pour des raisonstechniques, de représenter <strong>la</strong> situation idéale.Mot de <strong>la</strong> rédactionLes Prix innovation de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Le cin<strong>qui</strong>ème ga<strong>la</strong> national des Prix innovation en santé et sécuritédu travail s’est tenu à Québec le 14 avril 2010. Petit retour enarrière : les ancêtres des Prix innovation, les Prix reconnaissance,ont été décernés pour <strong>la</strong> première fois en 2002 dans le cadre d’unprojet pilote de trois ans. À l’époque, trois régions avaient étévolontaires : Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Centre-du-Québec etOutaouais. Le projet a tout de suite connu un franc succès.Quelques ajustements ont néanmoins été apportés et deuxnouvelles régions se sont ajoutées l’année suivante aux précurseurs: Longueuil et Lanaudière. En 2004, 11 régions participaient.On entrevoyait déjà une grande finale à l’échelle du Québec.Finalement, le concours ayant été imp<strong>la</strong>nté dans toutes lesrégions, <strong>la</strong> première finale nationale des Prix innovation a eulieu à l’automne 2005.Depuis leurs débuts, ces prix récompensent <strong>la</strong> créativité etl’ingéniosité dans <strong>la</strong> prévention des accidents et des ma<strong>la</strong>dies enmilieu de travail. Et on peut constater qu’elles sont présentesdans tous les secteurs d’activité et dans toutes les régions duQuébec. Les neuf entreprises gagnantes de ces prix cette annéeen sont <strong>la</strong> preuve. Qu’elles soient de Saint-Jean-sur-Richelieu, deMontmagny ou de Gatineau, qu’elles appartiennent aux secteursdes forêts, du bâtiment ou des travaux publics, du transport et del’entreposage ou de l’industrie du papier, toutes ont résolu desproblèmes <strong>qui</strong> paraissaient au départ insurmontables… jusqu’àce qu’elles trouvent LA solution. Notre dossier vous invite à lesdécouvrir.La section Reportages met en lumière des entreprises pour <strong>qui</strong><strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité du travail est une priorité. Les entreprisesprésentées appartiennent également à différents secteurs dutravail : construction, commerce de détail et textile.Dans <strong>la</strong> rubrique Perspectives, Mario Messier, médecin dutravail et directeur du Groupe de promotion pour <strong>la</strong> préventionen santé (GP 2 S), explique comment <strong>la</strong> préservation de <strong>la</strong> santé destravailleurs permet d’améliorer <strong>la</strong> productivité des entreprises etprofite à l’ensemble de <strong>la</strong> société.La section Recherche à l’IRSST fait état d’une étude <strong>qui</strong> démontrel’effet de <strong>la</strong> mobilité d’emploi, du travail à temps partiel et dustatut sco<strong>la</strong>ire sur les risques de lésion professionnelle auxquelssont exposés les jeunes de 16 à 24 ans, comparativement auxtravailleurs plus âgés. À lire aussi, les travaux à l’origine d’unguide <strong>qui</strong> propose des solutions concrètes pour nettoyer etdécontaminer des lieux de travail où on fait usage de béryllium.Été 2010Prévention au travail3
Vient de paraître à <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Épargnez-vous biendes formalitésDC 200-1048 • GuideÀ compter de2011, un nouveaumode depaiement de <strong>la</strong>prime d’assurance<strong>CSST</strong>entrera envigueur. Lesemployeurspaieront donc leur prime àRevenu Québec en même tempsque leurs retenues à <strong>la</strong> source etque leurs cotisations en utilisantle même bordereau. Une nouvellecase sera ajoutée sur lebordereau de paiement transmispar Revenu Québec à cet effet.Ce guide vous explique lesmodalités re<strong>la</strong>tives à ce nouveaumode de paiement de <strong>la</strong> primed’assurance par versementspériodiques auprès de RevenuQuébec.RééditionsPour que leur premier emploine soit pas le dernier…DC 100-1490-5 • FeuilletVous êtes unemployeur etvous embauchezdesjeunes au seinde votre entreprise? Cefeuilletcontient del’information <strong>qui</strong> saura vousintéresser. Il vous présente lesservices de l’Escouade jeunessede <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> et vous rappelle que,dans le cadre de son P<strong>la</strong>n d’actionjeunesse, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> offregratuitement les services de sonEscouade jeunesse auxemployeurs <strong>qui</strong>, comme vous,embauchent des jeunes. Forméeelle-même de jeunes, l’Escouadesensibilise les travailleurs de 24ans ou moins à l’importance deprévenir les accidents du travail.Pour ce faire, elle organise desactivités de sensibilisation <strong>qui</strong>visent à renforcer vos efforts enmatière de prévention des accidentsdu travail. Un aidemémoireà conserver !Vous recevez des feuilletsRelevé 5 et T5007 pourl’année d’imposition 2009DC 100-1024-12 • FeuilletVous êtes un travailleur et avezreçu des indemnités de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>en 2009 ? Ces indemnités ne sontpas imposables, mais doiventêtre déc<strong>la</strong>rées. Ces relevés voussont envoyés pour que vous lesretourniez, dûment remplis, àRevenu Québec et à l’Agence durevenu du Canada.Interdiction de transporterdes personnesDC 700-220-1 • Autocol<strong>la</strong>ntCet autocol<strong>la</strong>nt est destiné à êtreapposé sur les véhicules concernés; il a pour but de rappelerqu’il est interdit de transporterdes travailleurs à bord des remorques.Pour mieux comprendre lemode de tarification au tauxpersonnalisé Tarification 2010DC 200-417-12 • DépliantCe dépliant fournitdes explicationsaux employeurs ausujet de <strong>la</strong> tarificationau taux personnalisé,<strong>qui</strong> estl’un des troismodes de tarificationutilisés par <strong>la</strong><strong>CSST</strong>.Ce que vous devez savoirsur nousDC 200-383-8 • DépliantSi vous êtes unemployeur nouvellementinscrit à <strong>la</strong><strong>CSST</strong>, vous devezrecevoir de l’informationde base surles services offertspar l’organisme. Cedépliant vousexplique l’essentielde ce que vousdevez savoir sur votre prime, surles dates importantes pour vouset sur <strong>la</strong> marche à suivre en casd’accident du travail. Le b-a bade <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>.Entente interprovinciale pourl’industrie du camionnageDC 100-281-4 – DépliantCe dépliant expliquetout d’abord cequ’est l’Ententeinterprovincialepour l’indemnisationdes travailleurs,dans le secteur ducamionnage interprovincial.Ilinforme les employeursde cesecteur sur <strong>la</strong>méthode de déc<strong>la</strong>rationdes sa<strong>la</strong>ires <strong>qui</strong> s’appliqueet sur le mode de tarificationparticulier offert aux entreprisesde camionnage interprovincial.Les mutuelles de prévention :Ce que vous devez savoirDC 200-1434-2 • GuideCe guide répondaux questionsque vouspouvez avoir, entant qu’employeur,si vousprévoyez vousregrouper pourfaire de <strong>la</strong>prévention. Ledocument traite entre autres desfacteurs à prendre en comptepour choisir une mutuelle, descritères d’admissibilité et desobligations de chacun.Santé et sécurité à borddes bateaux de pêcheDC 100-1209-1 • PapillonCe papillon rappelle l’un desdangers à bord des bateaux depêche : les treuils. Lorsqu’ilssont en marche, ils peuventcauser des blessures importantesaux travailleurs. On y trouveaussi <strong>la</strong> façon de se procurer leguide Santé et sécurité à borddes bateaux de pêche, c’est-àdireen le commandant partéléphone ou en le téléchargeantsur le site Web de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>.Le béryllium, un métal utilemais dangereuxTravailleurs et employeursde <strong>la</strong> dentisterieDC 500-282 • Feuillet<strong>Des</strong>tiné auxtravailleurs etaux employeursdu secteur de<strong>la</strong> dentisterie,ce feuilletdécrit les typesde travauxsusceptiblesd’émettre despoussières oufumées contenant du béryllium.Il en explique les effets sur <strong>la</strong>santé et propose des moyens pourprotéger les travailleurs exposés.Conformité avec les exigencesquébécoises du SIMDUTDC 200-2200-4 • BrochureInspecteurs de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, ce documents’adresse à vous. Il s’agitd’un outil de diagnostic et deréférence à utiliser lorsque vousvérifiez <strong>la</strong> conformité des établissementsaux exigences duRèglement sur l’informationconcernant les produits contrôlés.Vous y trouverez les principalesexigences de <strong>la</strong> loi et du règlementquébécois applicables auxemployeurs.Vous utilisez de l’ammoniac autravail ? Ceci vous concerne !DC 100-1197 • FeuilletCe feuilletmentionne quele guide a étéréédité entenant compte,entre autres,du Code sur <strong>la</strong>réfrigérationindustrielle. Ilfournit d’ailleurs un court résumédu guide et informe sur lesmoyens d’en faire l’ac<strong>qui</strong>sition.Vous pouvez vous procurer <strong>la</strong>plupart de ces documents aubureau de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> de votrerégion. Vous pouvez égalementsoit les consulter, les téléchargerou les commander à partir du sitewww.csst.qc.ca/publications. PTChantale Rhéaume4Prévention au travail Été 2010
Cherchez l’erreurL’entreposagedes matières dangereusesOn trouve des matières dangereuses dans une foule de milieux de travail.Pour éviter de malheureux incidents, il importe d’entreposer ces matières de façonappropriée et sûre, en conformité avec le Règlement sur <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité du travail.Aux fins de l’exercice, Marilou, technicienne en <strong>la</strong>boratoire, a gentimentaccepté de nous montrer ce qu’il ne faut pas faire.Saurez-vous reconnaître les erreurs qu’elle a commises ?Simu<strong>la</strong>tionPhoto : Denis BernierÉté 2010Prévention au travail5
4317Les erreurs1L’espace choisi pour entreposer lesproduits est à portée de main, mais ilest surchargé. Il y a fort à parier que<strong>la</strong> technicienne ne pourra pas p<strong>la</strong>cersa bouteille sans en faire tomber uneautre et causer un renversement. Elles’expose ainsi à l’inha<strong>la</strong>tion de vapeurs25623possiblement néfastes pour <strong>la</strong> santé età des éc<strong>la</strong>boussures pouvant être nocivespour <strong>la</strong> peau.Étiquettes illisibles ou <strong>qui</strong> se décollent,contenants sans aucune étiquette…Une mauvaise identificationdes matières dangereuses peut être <strong>la</strong>cause d’un mé<strong>la</strong>nge inapproprié deproduits et, par le fait même, d’un accident.Plusieurs bouteilles semblententreposées depuis longtemps, ce <strong>qui</strong><strong>la</strong>isse penser que les produits qu’ellescontiennent sont peut-être périmés.Est-il pratique de ranger des produitssur <strong>la</strong> surface de travail de <strong>la</strong> hotte de<strong>la</strong>boratoire ? Non, c’est surtout dange-4567reux. Les produits peuvent être incompatiblesavec ceux de l’expérienceen cours.La vitre à guillotine de <strong>la</strong> hotte estbeaucoup trop relevée. Pour queMarilou ne respire pas inutilement desvapeurs toxiques, cette vitre devraitêtre baissée pour <strong>la</strong>isser passer les brasde <strong>la</strong> technicienne seulement.Entreposage sûr ne rime sûrement pasavec bouteilles ouvertes, bouchons malscellés et coulis de produits renverséssur les contenants et les étagères.Plusieurs intrus dans cette armoire :rouleaux de papier, boîtes d’essuietouten carton… De plus, on y trouveà proximité de ces objets combustiblesdes comburants renversés (poussièresb<strong>la</strong>nches sur <strong>la</strong> photo)… Voilà un mé<strong>la</strong>nge<strong>qui</strong> pourrait causer un incendie,car les comburants ont <strong>la</strong> propriétéd’activer le feu.La technicienne ne porte pas ses lunettes,son sarrau est ouvert et ses cheveux nesont pas attachés, autant d’éléments<strong>qui</strong> l’exposent à des risques inutiles.Photos : Denis BernierLes correctionsFaire l’inventaire des matières dangereusesest un élément clé d’un entreposagesécuritaire. C’est au cours de cette étapeque l’on va c<strong>la</strong>sser et identifier c<strong>la</strong>irementtous les produits à entreposer, à l’aided’étiquettes conformes au SIMDUT. Lesétiquettes usées sont remp<strong>la</strong>cées par desétiquettes lisibles. Lors de l’inventaire, onidentifie également les produits périméset ceux <strong>qui</strong> ne sont plus utilisés afin deles éliminer correctement.Les matières dangereuses sont entreposéesdans un endroit bien ventilé, réservéà l’entreposage. Seuls les produitsnécessaires à <strong>la</strong> journée de travail sontapportés au poste de travail.Chaque armoire et chaque étagèresont identifiées de manière à préciser <strong>la</strong>catégorie de produits <strong>qui</strong> s’y trouvent. Untel entreposage permet de comprendrerapidement que tous les produits ne vontpas ensemble et qu’il ne faut surtout pasmé<strong>la</strong>nger les types de produits entre eux.Pour en savoir plus sur l’incompatibilitéet <strong>la</strong> réactivité des matières dangereuses,on peut consulter les fiches signalétiquesde chaque produit.La technicienne range sa bouteille deli<strong>qui</strong>de inf<strong>la</strong>mmable au bon endroit dansune armoire conçue à cette fin (dans lerespect de <strong>la</strong> norme NFPA 30 -1996). Lesportes se croisent et sont fermées à l’aidede loquets pour plus de sûreté. Au basde l’armoire, un petit seuil contiendraitles li<strong>qui</strong>des pouvant se renverser.Précisons que les armoires possèdentdes caractéristiques adaptées à chaquecatégorie de produits. Par exemple, pourles matières corrosives (acides ou bases),les étagères sont recouvertes de bacs enp<strong>la</strong>stique <strong>qui</strong> protègent le métal d’uneéventuelle corrosion. Les comburantssont quant à eux entreposés loin des matièresorganiques (bois, carton, etc.), desmatières toxiques et des li<strong>qui</strong>des inf<strong>la</strong>mmableset combustibles.Pour un rangement optimal et sécuritaire,il est préférable de p<strong>la</strong>cer les petitscontenants dans le haut des armoireset les plus gros dans le bas. On minimisepar conséquent les dégâts si le contenanttombe. Par ailleurs, dans l’entrepôt, onne p<strong>la</strong>ce aucun contenant sur les étagèresdu haut. Un marchepied est également à<strong>la</strong> disposition des travailleurs. Voilà deuxbons moyens de réduire les risques derenversements de produits, d’éc<strong>la</strong>boussureset de chutes.Enfin, mentionnons que <strong>la</strong> technicienneporte un sarrau fermé, des lunettesde protection et des gants. Elle a aussiattaché ses cheveux. Ses manches sontcorrectement repliées vers l’intérieur,pour ne pas gêner son travail. PTHéloïse Bernier-LeducNous remercions le cégep de Sorel-Tracy, programmeEnvironnement, hygiène et sécurité dutravail, pour sa col<strong>la</strong>boration de même que notrefigurante Marilou Labonté, étudiante.Nos personnes-ressources : Yves Archambault,inspecteur à <strong>la</strong> Direction régionale de <strong>la</strong> Yamaska,Johanne Dumont, chimiste et conseillère à <strong>la</strong> Directiongénérale de <strong>la</strong> prévention-inspection et dupartenariat, Marie-C<strong>la</strong>ude Brouil<strong>la</strong>rd, coordonnatricedu programme Environnement, hygiène etsécurité du travail au cégep de Sorel-Tracy.Coordination : Louise Girard, conseillère à<strong>la</strong> Direction générale de <strong>la</strong> prévention-inspectionet du partenariat, <strong>CSST</strong>.Pour en savoir pluswww.csst.qc.ca. Répertoire toxicologique,section du SIMDUT. Lois et politiques,Règlement sur l’information concernant lesproduits contrôlés.Norme NFPA 30, Code des li<strong>qui</strong>desinf<strong>la</strong>mmables et combustibles, 1996.www.aspimprimerie.qc.ca. L’entreposage dessolvants.Commission canadienne des codes dubâtiment et de prévention des incendies/Conseil national de recherches du Canada.Code national de prévention des incendies,partie 3.6 Prévention au travail Été 2010
Dossier<strong>Des</strong> <strong>innovations</strong><strong>qui</strong> <strong>passent</strong> <strong>la</strong> <strong>rampe</strong>Par C<strong>la</strong>ire ThiviergeMise au service de <strong>la</strong> prévention, <strong>la</strong> créativité faitmerveille. À preuve, les nombreux prix décernéspar <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> et par des ASP ou organismesactifs en ce domaine à des entreprises<strong>qui</strong> ont résolu d’ingénieuse manièreun problème de santé et de sécuritédu travail (sst). Le dossier<strong>qui</strong> suit n’a qu’un but :titiller votre créativité…et <strong>la</strong> faire s’exprimeraf in qu’ellevous donnele pouvoirde prévenir.Photo : Robert Etcheverry
DossierCatégorieGrand <strong>la</strong>uréatLes Huiles Thuot et BeaucheminIci, on monte <strong>la</strong> gardeDans cette entreprise familiale<strong>qui</strong> emploie 18 personnes, l’esprit desuite n’a d’égal que l’esprit de corps.Depuis trois générations, Les HuilesThuot et Beauchemin livrent mazout,diesel, essence et gaz propane à desrésidences, des commerces et des industriesde <strong>la</strong> région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le volume des livraisonsexige quatre chargements quotidiens ducamion-citerne. Ainsi, qu’il neige, qu’ilpleuve ou que le soleil darde, un chauffeurgrimpe à l’échelle du véhicule pouraccéder au toit, où se trouve le bouchondu réservoir qu’il doit remplir de carburant.Il exécute cette manœuvre à plusde trois mètres du sol. La surface sur<strong>la</strong>quelle il se dép<strong>la</strong>ce en é<strong>qui</strong>libre instableest parfois glissante, parfois brû<strong>la</strong>nte.Un faux pas, et il risque <strong>la</strong> catastrophe,une chute pouvant entraîner de gravesblessures, voire <strong>la</strong> mort. Consciente quecette haute voltige peut menacer <strong>la</strong> viede ses chauffeurs, <strong>la</strong> direction décide derégler le problème une fois pour toutes.« On vou<strong>la</strong>it vraiment assurer <strong>la</strong> sécuritéde nos travailleurs et chaquemembre de l’é<strong>qui</strong>pe a mis ses idées surpapier, raconte le répartiteur MathieuBeauchemin. Après, on a fait un caucus.» Les participants à ce remueméningesexplorent harnais, câbles d’acier,<strong>rampe</strong>s et autres possibilités de protection.« On a opté pour <strong>la</strong> solution des<strong>rampe</strong>s, dit le mécanicien Léo Roy, et ons’est aperçus que c’était bon, sauf pourquelques détails. » C’est ainsi que naît leconcept du garde-corps pneumatique.Dorénavant, le chauffeur ouvre lepanneau situé à l’arrière de son camionciterneet actionne le dispositif de commande<strong>qui</strong> s’y trouve. Et hop !, commeun diable à ressort surgissant de saboîte, les <strong>rampe</strong>s du garde-corps sedressent sur le toit du véhicule. Le travailleurmonte ensuite sur ce perchoirsécurisé, où il remplit son réservoir sanscraindre de tomber dans le vide.S’il se trouve au quai de chargementde l’entreprise, également doté d’une<strong>rampe</strong> <strong>qui</strong> s’appuie sur le véhicule, lechauffeur lève une seule rambarde duPhoto : Robert Etcheverrycamion-citerne et se trouve ainsi abrité detous côtés. Et raffinement final : « S’iloublie de redescendre ses <strong>rampe</strong>s, il nepourra pas repartir avec le camion »,assure Léo Roy. Le mécanisme de freinagea en effet été adapté pour rester bloquétant que le garde-corps n’est pas replié.Aux Huiles Thuot et Beauchemin, lesuspense de l’alimentation des camionsciternesne fait donc plus partie du quotidien,au grand sou<strong>la</strong>gement destravailleurs, <strong>qui</strong> ne jouent plus les acrobates.« Je suis tout à fait heureux quel’entreprise ait pris l’initiative d’installerce système. Maintenant, on peut montersur le camion en toute sécurité. Qu’ily ait un coup de vent ou n’importe quoi,nous sommes protégés à tout moment »,confie le chauffeur Guy Marchesseault.Les garde-corps déployés, dechaque côté du camion, éliminentles risques de chute lorsquele travailleur doit remplir leréservoir.Réalisé dans un esprit de collégialité,ce projet est gratifiant pour tous ceux<strong>qui</strong> y ont participé. « C’est une fiertépour moi et pour <strong>la</strong> partie patronale,affirme Léo Roy, car toute l’é<strong>qui</strong>pe a mis<strong>la</strong> main à <strong>la</strong> pâte pour que tout le mondesoit en sécurité. » Quant à MathieuBeauchemin, il espère que d’autrescompagnies de produits pétroliers s’inspirerontde cette innovation pour éviter,elles aussi, que leurs camionneurs tombentde haut. Qu’on se le dise ! PT8 Prévention au travail Été 2010
PMEMention d’excellenceMavicConstructionOh ! hisse !Ce chantier de Gatineau embaumele bois fraîchement coupé. Mais<strong>la</strong> vingtaine de travailleurs de MavicConstruction y sont sans doute insensibles.Leur préoccupation, c’est de hisseret d’assembler une à une les poutrelles<strong>qui</strong> formeront <strong>la</strong> charpente du bâtimentqu’ils construisent. Malgré <strong>la</strong> chaleur, <strong>la</strong>lourdeur des pièces et <strong>la</strong> fatigue, ils tiennentle rythme. « C’est pas juste unepoutrelle à charrier, précise le charpentierSébastien D’Amours-Lacroix, c’estplusieurs dans <strong>la</strong> même journée, etquand elles sont grandes, ça devientvraiment épuisant. » Efforts excessifs,maux musculo-squelettiques, risques dechutes… pas facile, ce métier !Soucieux de sécuriser ses travailleurstout en les souhaitant productifs et enforme, le président Martin Vienneauimagine un appareil d’assemb<strong>la</strong>ge despoutrelles <strong>qui</strong> lèverait des sections dep<strong>la</strong>nchers préa<strong>la</strong>blement reliées au solsans qu’il soit nécessaire de les manipulerà répétition. Il soumet un cro<strong>qui</strong>s àson personnel, on en discute, on ajoutececi, change ce<strong>la</strong>, précise ce détail, perfectionnele système. Puis, on construitdes supports de levage, fabrique descrochets pour retenir les poutrelles, <strong>qui</strong>s’enclenchent dès lors en un tour demain… Arrive enfin le jour d’expérimenter« l’assembleur ». Merveille ! Le dispositifinédit emporte d’un bloc toute unesection de p<strong>la</strong>ncher, comme s’il s’agissaitd’un fétu de paille.Le dispositif de levage despoutrelles emporte d’un bloctoute une section du p<strong>la</strong>ncher.Chez Mavic Construction, c’est finide suer à grosses gouttes pour accomplirson travail. Fini aussi le frissondans le dos à <strong>la</strong> perspective de sombrerdans le néant.« La participation des travailleurs acréé une certaine fierté envers l’assembleur,assure Martin Vienneau. Travaillerplus en sécurité, on peut penser que çaprend plus de temps, mais depuis <strong>la</strong>création de l’assembleur, on travailleplus rapidement. » Comme quoi sécuritéet rendement peuvent aller de pair. PTPhoto : Martin VienneauMention d’excellenceLes SouduresSt-DenisEsprit constructifà l’œuvreÇa joue dur aux SouduresSt-Denis. Normal, puisque cette PME deSaint-Denis-de-Brompton fabrique etinstalle des structures d’acier. La tâchede certains de ses 45 travailleurs exigeaussi des nerfs d’acier. Grimpés sur l’armaturequ’ils érigent, ils attendent que<strong>la</strong> grue y hisse une poutre ou une poutrelle.Quand <strong>la</strong> pièce leur parvient, ilss’étirent au-dessus du vide pour <strong>la</strong> décrocherde l’élingue <strong>qui</strong> <strong>la</strong> retient.« Étant donné que <strong>la</strong> structure est chambran<strong>la</strong>nteparce qu’elle n’est pas complètementmontée, c’est dangereux pournous », atteste le monteur Pierre Lapointe.Ces conditions de travail risquéesinspirent au chef d’é<strong>qui</strong>pe Benoît Rouleaul’idée d’un évacuateur d’élingue automatisé.« J’ai commencé tout seul, ditl’inventeur, mais ça m’occasionnaitPhotos : Richard Boudreau, <strong>CSST</strong>beaucoup de dépenses et d’essais. » Ilsollicite donc le directeur de l’usine, LucDe Lafontaine, <strong>qui</strong> donne son aval au financementdu projet et à <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borationdu dessinateur Dany Côté. Ainsi,grâce à <strong>la</strong> magie de l’informatique, <strong>la</strong> visionde Benoît Rouleau prend forme ets’anime à l’écran. D’un prototype àl’autre, <strong>la</strong> sécurité du système se renforce,jusqu’à mener au produit fini, <strong>qui</strong>comporte deux boutons : le premierdonne <strong>la</strong> commande et le second actionnele dispositif.Maintenant, les monteurs juchés sur<strong>la</strong> structure guident <strong>la</strong> pièce d’acier à sap<strong>la</strong>ce, puis le grutier au sol active le mécanisme<strong>qui</strong> <strong>la</strong> libère. Les travailleursapprécient l’efficacité de cette innovation,<strong>qui</strong> leur épargne bien des frayeurs.« C’est une très, très bonne idée deBenoît, affirme Luc De Lafontaine. Onl’a encouragé parce que c’était sécuritaireet avantageux pour nous,parce qu’on monte nos structuresplus rapidement. » Modeste, le créateurdu mécanisme considère que<strong>la</strong> sécurité qu’il a procurée à soné<strong>qui</strong>pe peut aussi profiter à d’autrestravailleurs. PTL’évacuateurd’élingue estcontrôlé àl’aide d’unetélécommande.Grâce à ce nouvel appareil, leretrait de l’élingue s’effectuede façon sécuritaire.Été 2010Prévention au travail9
DossierCatégorieGrand <strong>la</strong>uréatLes Produits NeptuneMaintenant, tout baigne !Si le dieu des mers avait des pouvoirssurhumains, les travailleurs desProduits Neptune, eux, ne sont que desimples mortels. Dans cette entreprisede Saint-Hyacinthe, <strong>qui</strong> fabrique et importeune <strong>la</strong>rge gamme de produits desalles de bains, certains des 230 travailleursde l’usine assemblent des baignoiresde formes et de dimensionsparticulières, dites spéciales. Aprèsavoir réuni les différentes pièces <strong>qui</strong> lescomposent, ils font tandem et mobilisentsimultanément toute leur puissancemuscu<strong>la</strong>ire pour retourner à boutde bras ces grandes cuves, <strong>qui</strong> peuventpeser jusqu’à 380 kilos. Ils accomplissentcette prouesse tout en s’assurant dene <strong>la</strong>isser tomber aucun morceau de <strong>la</strong>baignoire pendant le temps que durel’éprouvante gymnastique. Sachantqu’ils répètent cette épreuve de force àplusieurs reprises dans <strong>la</strong> journée, on nes’étonne pas d’apprendre qu’ils finissentleur quart de travail avec les épaules, lesbras et le dos en compote. « Il fal<strong>la</strong>ittrouver une solution », raconte LucBeaupré.Ce technicien en recherche et développementmet son esprit en mode investigationet évalue divers moyens deconstruire le prototype miniature d’unsystème <strong>qui</strong> lui semble commode et efficace.Le simple cadre de bois robustede celui-ci comporte des manettes qu’onactionne pour dérouler les sangles fixéesà <strong>la</strong> travée supérieure. Celles-ci soutiennentune baignoire minuscule qu’onpeut ainsi lever, tourner, retourner et déposerau sol ou sur un p<strong>la</strong>n de travai<strong>la</strong>ussi facilement que s’il s’agissait d’unjouet d’enfant. Essai après essai, le dispositiffonctionne parfaitement. Eurêka !Luc Beaupré a accouché d’une solutionastucieuse à un problème de sécurité<strong>qui</strong> semb<strong>la</strong>it jusqu’alors insoluble. « Jecrois qu’on peut toujours organiser unoutil<strong>la</strong>ge quelconque pour éviter desmanipu<strong>la</strong>tions », dit-il humblement.Grâce au système de retournementé<strong>la</strong>rgi à <strong>la</strong> grandeur voulue, les monteursfont maintenant basculer des baignoiresmonstres comme si elles nepesaient guère plus qu’une bulle desavon. « Cette innovation a permis d’éliminertous les problèmes de dos », seréjouit Jean Rochette, président desProduits Neptune. En prime, l’introductionde ce mécanisme <strong>qui</strong> facilite le quotidiendes travailleurs a procuré unautre avantage imprévu à l’entreprise.« Le but premier était de réduire les accidentset d’améliorer <strong>la</strong> sécurité destravailleurs, poursuit le dirigeant, maisà <strong>la</strong> lumière des résultats, ce<strong>la</strong> a égalementapporté un grand gain de productivité.» Quant à Michel Chabot, ilexprime l’immense satisfaction de tousses collègues monteurs de baignoires :« Je suis très content que quelqu’un aitpensé à nous », se réjouit-il. En effet,avec ce retournement de situation, leschoses vont nettement mieux pour lestravailleurs des Produits Neptune. PTLeprototypeconçu parle Service derecherche etdéveloppement.Photo : C<strong>la</strong>ude Trudelle, <strong>CSST</strong>Mention d’excellenceTeknion QuébecPréventiontop niveauPrêts à <strong>qui</strong>tter l’usine, lesmeubles de bureau haut de gamme s’alignentdans l’entrepôt de Teknion Québec.Mais le raffinement de ce mobilier nerévèle pas les pirouettes que sa productionexige de certains des 150 travailleursde ce fabricant de Montmagny. Ainsi, lesoudeur <strong>qui</strong> assemble les composantesd’un modèle recherché répète <strong>la</strong> mêmeopération jusqu’à 300 fois par jour. Sonposte de travail n’étant pas rég<strong>la</strong>ble, il« doit se contorsionner pour effectuerles différentes soudures dans le bonaxe », re<strong>la</strong>te le superviseur de <strong>la</strong> maintenanceGilbert Caron. Pis encore, i<strong>la</strong>spire les émanations du soudage et,obligé de s’étirer inconfortablement au-10 Prévention au travail Été 2010
Grandes entreprisesPhoto : SFK PâteMention d’excellenceSFK PâteCure de préventionC’est environ 350 000 tonnesde pâte b<strong>la</strong>nchie que les 315 travailleursde SFK Pâte produisent chaque année.Pour ce<strong>la</strong>, l’usine de Saint-Félicien utiliseun refroidisseur d’eau <strong>qui</strong> stabilise <strong>la</strong>température du produit chimique nécessaireau procédé de fabrication. Le hic,c’est que l’appareil doit subir un grandménage annuel, mais il n’existe aucunmoyen mécanique de curer ses 4 000tubes, longs de six mètres. Le travailleurdoit donc insérer une brosse cylindriquedans chacun, <strong>la</strong> pousser au fond, <strong>la</strong> retireret recommencer jusqu’à ce que touteLa brosse rotative est commandée par une pédale pneumatique etmontée sur un système de rails.<strong>la</strong> panoplie ait été astiquée. Quelle corvée! Car ce <strong>la</strong>borieux va-et-vient répétitifuse, des épaules au dos, tous les membressupérieurs du travailleur, <strong>qui</strong> yconsacre plusieurs jours et se fait périodiquementre<strong>la</strong>yer par un collègue pouren venir à bout. « Je pense que le meilleurindividu pour régler le problème, c’estcelui <strong>qui</strong> doit réaliser <strong>la</strong> tâche en question», remarque le superviseur de l’entretienJean-Yves Lepage.Voilà tout un défi pour le préposé à <strong>la</strong>venti<strong>la</strong>tion Gilles Paré, d’autant plus quede prime abord, les obstacles semblentinsurmontables. Puis l’idée lui vient demettre à profit une roue de chariot muepar un arbre usiné. Son concept original,couplé aux connaissances techniques dumachiniste Martin St-Amand, débouchesur un outil ingénieux : une brosse rotative,commandée par une pédale pneumatique,montée sur un système de rails<strong>qui</strong> s’ajustent aux rangées et aux colonnesde tubes. Dorénavant, un seul travailleurfait <strong>la</strong> besogne en un rien detemps et sans ma<strong>la</strong>ises. « Il y a plein d’industries<strong>qui</strong> utilisent ce type de refroidisseurs,commente Jean-Yves Lepage, et ily a donc beaucoup d’entreprises <strong>qui</strong> peuventutiliser une machine simi<strong>la</strong>ire. »Chez SFK Pâte, en tout cas, on a passél’éponge sur un vieux problème. PTdessus de <strong>la</strong> pièce à souder, il masqueainsi son éc<strong>la</strong>irage. Bref, avec tant d’inconvénients,son poste convient bienmal à ses besoins.Une é<strong>qui</strong>pe de travailleurs s’attaqueau problème. Ergonomie en tête, ilsconçoivent un aménagement sur mesurepour éliminer les risques. C’estainsi que le soudeur dispose maintenantd’un gabarit hors pair, adaptable à sataille et à sa tâche. « Les pièces tournentautour d’un axe, explique Gilbert Caron,ce <strong>qui</strong> facilite l’accès de l’opérateur auxdifférentes soudures. Il contrôle <strong>la</strong> rotationau moyen d’une pédale pneumatique<strong>qui</strong> actionne un frein. » Aussirespire-t-il un air plus sain, puisqu’unehotte aspire les fumées de soudage etles rejette à l’extérieur. L’emp<strong>la</strong>cementde l’éc<strong>la</strong>irage, installé dans <strong>la</strong> hotte,évite qu’il fasse de l’ombre sur sa surfacede travail. « J’ai <strong>la</strong> chance de travailleravec ce gabarit, se féliciteGhis<strong>la</strong>in Guichard, et je peux dire quetous les soudeurs apprécieraient enavoir un comme ça dans leur usine. »Photo : Teknion QuébecLaissons le mot de <strong>la</strong> fin à JacquesA<strong>la</strong>in, président-directeur général del’entreprise : « Non seulement on élimineun risque de blessures important,mais on améliore aussi notreproductivité. » Teknion Québec a eneffet réussi à souder prévention, écologieet rendement. « Quand on veuttout ça, on peut l’associer », conclutJacques A<strong>la</strong>in. PTAu poste de soudage ergonomique, les pièces tournent autour d’un axeet une hotte aspire les fumées de soudage.Été 2010 Prévention au travail 11
DossierCatégorieGrand <strong>la</strong>uréatMinistère des Ressources naturelles et de <strong>la</strong> FaunePépinière Sainte-LuceCultiver <strong>la</strong> préventionL’appareil fonctionne à l’aide d’un système hydraulique contrôlépar l’opérateur du tracteur.Avec 17 millions de p<strong>la</strong>ntsd’arbres à divers stades de développement,c’est une mer de verdure <strong>qui</strong>s’étend à perte de vue, alors que le printempsravive le parfum de <strong>la</strong> terre <strong>qui</strong>se réchauffe. Cette saison fébrile ramèneà ce domaine sylvicole jusqu’à200 travailleurs, <strong>qui</strong> s’affairent à repiquer3,5 millions de p<strong>la</strong>nts que <strong>la</strong> PépinièreSainte-Luce livre un peu partout auQuébec chaque année. L’entreprise doitdonc s’assurer que ses p<strong>la</strong>ntations résistentaux rigueurs de l’hiver. « Pour lesprotéger contre le vent, on a 35 kilomètresde coupe-vents naturels », dit <strong>la</strong> directriceFrance Talbot. Mais les jeunesp<strong>la</strong>ntules ayant aussi besoin d’une couverturede neige suffisante, l’établissementinstalle en plus huit kilomètres declôtures chaque automne. Et c’est là quele bât blesse, car au début du printemps,il faut retirer ces protections,alors que les piquets peuvent restercoincés dans le sol encore gelé.Cette tâche ingrate exige qu’un travailleurenroule autour de chaque piquetune chaîne fixée au dispositif delevage du tracteur, <strong>qui</strong> avance en parallèle.Le chauffeur active le bras de levagepour soulever le pieu. Le travailleur àpied contourne ensuite chaque piquetpour le libérer de <strong>la</strong> chaîne, l’arrache etva le déposer dans <strong>la</strong> remorque du tracteur.Les collègues exécutent cette routineharassante à longueur de journée,le temps qu’il faut pour dégager toutesles clôtures. Travailler au grand air, enpleine nature, ne devrait-il pas être synonymede santé ? Manœuvre répétitive,risque de se coincer les doigts dans <strong>la</strong>chaîne, danger d’être heurté par un piquet<strong>qui</strong> casse ou happé par le tracteursont les aléas de ce travail, déplorel’aide sylvicole Ro<strong>la</strong>nde Ruest. Or, <strong>la</strong> pépinièreaspire à devenir un milieu totalementsécuritaire, affirme FranceTalbot : « Un accident, c’est dérangeantpour le travail, pour <strong>la</strong> personne, poursa qualité de vie, sans parler des coûtsfaramineux que ça peut engendrer. » Ladirectrice estime que les gens sur le terrainsont les mieux p<strong>la</strong>cés pour repérerce qu’elle qualifie de « petits dangers ».Et pour y trouver une solution, biensûr.C’est ainsi que Georges Ed. <strong>Des</strong>chênesconçoit une méthode plus sûre et plusrapide pour arracher les piquets. Ils’agit d’un dispositif de pinces muniesd’un cylindre que le chauffeur du tracteuractionne pour le p<strong>la</strong>cer sur le piquet. Ilreferme ensuite <strong>la</strong> pince, actionne <strong>la</strong>mécanique <strong>qui</strong> extirpe le pieu et relâchele cylindre. « Je reste à côté de <strong>la</strong> remorqueet je n’ai qu’à ramasser le piquet età le déposer », confirme Ro<strong>la</strong>nde Ruest.Heureux de révéler les frais minimes dece système, Georges Ed. <strong>Des</strong>chênesajoute qu’il est « applicable à différentesentreprises, dont <strong>la</strong> majorité des entrepriseshorticoles <strong>qui</strong> ont besoin de clôturesà neige ». La directrice de <strong>la</strong>Pépinière Sainte-Luce déc<strong>la</strong>re que c’estune grande joie de finir l’année sansaccident. « On se tape dans les mains,raconte-t-elle. C’est une grande fierté devoir que notre travail de sensibilisationet de prévention donne des résultats. »Comme quoi se livrer au jeu de <strong>la</strong> préventionprocure sécurité et même…bonheur. PTPhoto : Pépinière Sainte-Luce12 Prévention au travail Été 2010
Organismes publicsMention d’excellenceMinistère des TransportsCentre de services de Trois-RivièresSécurité routièreLes journées se <strong>passent</strong> à sillonnerlentement les routes du Québec. C’estque le personnel du Centre de servicesde Trois-Rivières compte parmi les deuxseules é<strong>qui</strong>pes que le ministère desTransports affecte au marquage routiersur le territoire québécois. Mais cette façoninsolite de voir du pays s’avère risquéepour certains travailleurs. Alorsque des bolides filent en vrombissanttout autour, un préposé se tient deboutdans <strong>la</strong> boîte de <strong>la</strong> camionnette, y ramasseun cône de balisage, se retourne,franchit <strong>la</strong> marche <strong>qui</strong> mène à <strong>la</strong> passerellearrière du véhicule, se penche pardessus<strong>la</strong> rambarde et dépose le cônesur <strong>la</strong> chaussée. Il se relève et recommence<strong>la</strong> manœuvre. Mouvements répétitifset dangers de chutes vont de soi.Pis encore, dans le cas où un automobilistedistrait ou téméraire heurterait <strong>la</strong>camionnette, les conséquences pourraientêtre graves, voire fatales.Partant du principe que supprimer <strong>la</strong>passerelle éliminerait une bonne partiede ces risques, le chef des opérationsFrançois <strong>Des</strong>aulniers construit un prototypeen carton d’un pose-cônes automatique.L’idée fait vite son chemin etle Ministère adopte cette solution aussisimple qu’ingénieuse. Maintenant àl’abri du garde-corps arrière du véhicule,le travailleur dépose un cône dansune boîte d’aluminium adaptée à cetusage, puis appuie sur un bouton <strong>qui</strong><strong>la</strong>isse tomber l’objet sur <strong>la</strong> chaussée. « Iln’y a aucun mouvement dangereux pourle corps et le cône tombe directementsur <strong>la</strong> ligne », affirme le chef d’é<strong>qui</strong>peRéal Codère. Les travailleurs estimentdésormais que cette innovation est essentielleà leur sécurité ainsi qu’à leurtran<strong>qui</strong>llité d’esprit, puisqu’elle a aussiLe pose-cônes semi-automatisépermet au travailleur dedemeurer à l’abri du garde-corpsarrière du camion.grandement réduit leur niveau de stress.Car, comme le rappelle Réal Codère,« nous, on est tout le temps sur desautoroutes et sur des routes très acha<strong>la</strong>ndées». PTPhoto : Ministère des Transports - Centre de services de Trois-RivièresMention d’excellenceVille de Sa<strong>la</strong>berryde-ValleyfieldUne solution bétonEn toile de fond, le bruit de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tionautomobile coutumière et <strong>la</strong> rumeurambiante d’une ville bourdonnanted’activité. À l’avant-p<strong>la</strong>n, <strong>la</strong> pétaradecontinue de l’engin et ses jets d’eau <strong>qui</strong>éc<strong>la</strong>boussent, sans compter <strong>la</strong> lourdeur de<strong>la</strong> machine, qu’il faut manœuvrer aussiprécisément que possible dans ses allersretoursbruyants. Voilà ce que vivent lestravailleurs de Sa<strong>la</strong>berry-de-Valleyfieldaffectés à <strong>la</strong> préparation de <strong>la</strong> réfectiondes voies routières municipales. Ils doiventen effet dép<strong>la</strong>cer à tous moments <strong>la</strong>scie à béton pour <strong>la</strong> diriger dans l’axe de<strong>la</strong> ligne de coupe du revêtement de <strong>la</strong>chaussée. C’est avec peine qu’ils soulèventce poids lourd de quelque 90 kilos,et bien sûr, leurs bras et leurs épaules,mais surtout leur dos, écopent.Photo : Ville de Sa<strong>la</strong>berry-de-ValleyfieldL’ajout d’une roue permet dedép<strong>la</strong>cer <strong>la</strong> scie facilement.Las de subir cette contrainte, ils appellentle contremaître Daniel Leclercau secours : « J’ai visualisé <strong>la</strong> solutiond’installer une roue de levage à l’arrièrede <strong>la</strong> machine, activée au moyen d’unepompe hydraulique et d’un cylindre »,dit celui-ci. Il trouve ainsi une réponsesimple à un gros problème. La scie à bétonétant déjà munie d’une pompe hydraulique,il suffit en effet d’y ajouter uninterrupteur et une soupape directionnelle.L’opérateur n’a dorénavant plusqu’à appuyer sur un interrupteur poursélectionner le cylindre avant ou arrière,lequel active <strong>la</strong> pompe et soulève <strong>la</strong> machine.Maintenant, <strong>la</strong> scie roule commesur des roulettes et les travailleursconsidèrent qu’ils ont éliminé bien desrisques de troubles musculo-squelettiques.Quant au coordonnateur administratifde <strong>la</strong> Ville, Georges Lazurka, il estimeque c’est aussi <strong>la</strong> responsabilité destravailleurs de participer à <strong>la</strong> prévention,cette fonction n’étant pas réservée auxreprésentants à <strong>la</strong> prévention ou auxmembres du comité de santé et de sécurité.Il pense également que cette innovation« peut susciter l’émergenced’autres projets simi<strong>la</strong>ires », ce <strong>qui</strong>améliorera davantage le quotidiendes travailleurs municipaux. PTÉté 2010Prévention au travail 13
DossierPrix hommageRemise du Prix hommageUne première pour deux pionniersPar Pierre TurgeonLa <strong>CSST</strong> a décidé d’honorer deuxde ses bâtisseurs lors du dernierga<strong>la</strong> des Prix innovation à Québec,le 14 avril dernier. Sam Hamad,ministre du Travail, de l’Emploiet de <strong>la</strong> Solidarité sociale, et LucMeunier, président du conseild’administration et chef de <strong>la</strong>direction de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, ont remisdes Prix hommage à deuxadministrateurs de <strong>la</strong> premièreheure : le regretté Louis Laberge etGhis<strong>la</strong>in Dufour. Depuis sa créationen 2008, le Prix hommage de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>souligne l’apport particulier d’untravailleur ou d’une entreprise àl’amélioration de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong>sécurité du travail.Dans l’ordre habituel : Sam Hamad, Ghis<strong>la</strong>in Dufour, Jean Labergeet Luc Meunier.Louis Laberge a présidé <strong>la</strong> FTQpendant 27 ans, de 1964 à 1991, et asiégé au conseil d’administration de <strong>la</strong><strong>CSST</strong> de 1980 à 1991. Il a été honoré àtitre posthume. Son fils Jean Laberge,<strong>qui</strong> a travaillé 23 ans à <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, a reçule prix en son nom. Ému, il a racontéque son père aurait été fier de l’honneur<strong>qui</strong> lui était fait et qu’il était de ceux <strong>qui</strong>croyaient que malgré tous les progrès,il faut sans cesse continuer d’améliorer<strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité du travail.Ghis<strong>la</strong>in Dufour a fait l’essentiel desa carrière publique au Conseil du patronatdu Québec, qu’il a notammentprésidé de 1986 à 1997. Il a aussi siégé18 ans au conseil d’administration de <strong>la</strong><strong>CSST</strong>, de 1980 à 1998. Prenant <strong>la</strong> parolelors du ga<strong>la</strong>, il a expliqué que bien peude gens croyaient aux vertus du paritarismequand <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> fut créée en 1980.Réticents, patrons et syndicats ont finalementaccepté de s’asseoir à <strong>la</strong> mêmetable et de prendre ensemble de grandesdécisions concernant l’administration durégime de santé et de sécurité du travail<strong>qui</strong> protège aujourd’hui plus de trois millionsde travailleurs québécois.Rappelons qu’en 1980, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> aremp<strong>la</strong>cé <strong>la</strong> Commission des accidentsdu travail. Le légis<strong>la</strong>teur souhaite alorsque les milieux de travail prennent encharge les questions liées à <strong>la</strong> santé et à<strong>la</strong> sécurité du travail. Il instaure le paritarismecomme mode d’administrationde <strong>la</strong> nouvelle <strong>CSST</strong>. Les entreprises financentle régime, mais les syndicats ontune égale importance au conseil d’administration.La FTQ de Louis Laberge etle CPQ de Ghis<strong>la</strong>in Dufour étaient lesdeux plus grosses organisations syndicaleset patronales, il fal<strong>la</strong>it qu’ils siègent auconseil d’administration de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>.Monsieur Dufour a expliqué queLouis Laberge a fini par lui dire à l’époqueque jamais <strong>la</strong> FTQ ne siégerait auconseil d’administration de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> sile Conseil du patronat n’y était pas.M. Dufour ignore si Louis Laberge bluffaitmais cet ultimatum a fait en sorteque les deux hommes ont accepté departiciper à <strong>la</strong> naissance de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>.Depuis ce temps, <strong>la</strong> FTQ et le CPQ onttoujours été représentés au conseil d’administrationde <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>.En 2000, Louis Laberge avait accordéune entrevue à Prévention au travail.Il confiait alors : « Les premièresannées ont été difficiles, c’était <strong>la</strong> premièrefois que nous avions affaire à unparitarisme décisionnel, ce <strong>qui</strong> nousobligeait à nous entendre. Nous savionsque l’avenir de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> reposait entrenos mains. Nous essayions de construirequelque chose de complètement nouveau.Les ma<strong>la</strong>dies professionnellesn’étaient pas encore reconnues, et ni lesemployés ni les employeurs ne se souciaientde santé et de sécurité. »Pour sa part, traçant un rapide bi<strong>la</strong>ndes 30 dernières années lors du ga<strong>la</strong>,Ghis<strong>la</strong>in Dufour a expliqué que le paritarismea donné naissance à l’Institut derecherche Robert-Sauvé en santé et ensécurité du travail. En effet, lors de <strong>la</strong>mise sur pied de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, le groupe detravail Martin, comprenant des personnalitéséminentes provenant de grandesinstitutions de recherche et du mondedu travail, a proposé que le Québec sedote d’un institut de recherche en santéet en sécurité du travail. Ghis<strong>la</strong>inDufour et Louis Laberge ont signé àl’époque les lettres patentes constituantl’IRSST. Ils ont donc contribué à créerun tel organisme <strong>qui</strong> n’existait encorenulle part au Canada. En fait, grâce enbonne partie à leur engagement et àleur détermination, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> est devenuetelle qu’on <strong>la</strong> connaît aujourd’hui...La <strong>CSST</strong> a 30 ans cette année. C’estl’occasion de regarder le chemin parcouruet également de scruter ce <strong>qui</strong> seprofile à l’horizon. Ghis<strong>la</strong>in Dufour croitqu’il faut maintenant faire évoluer le paritarismepour faire de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> un assureurpublic encore plus performant. Ilsouhaite aussi que l’organisme ne soitplus soumis à <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> fonction publiqueet se demande pourquoi <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>n’est pas assujettie à <strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> gouvernancedes sociétés d’État. PTPhoto : Leatitia Deconinck14 Prévention au travail Été 2010
Droitset obligationsL’aide humanitaireet <strong>la</strong> protection de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Haïti, 12 janvier 2010. Unesecousse terrible fait trembler <strong>la</strong> terreet dévaste <strong>la</strong> « perle des Antilles ». Vul’étendue des dégâts, les autorités compétentesne sauront jamais le nombreexact de morts et de blessés que leséisme a causés. Parmi ces victimes setrouvaient plusieurs travailleurs québécois<strong>qui</strong> accomplissaient un travail pourun employeur du Québec. Ces travailleurs,comme tant d’autres <strong>qui</strong> apportentune aide humanitaire, sont à <strong>la</strong>merci des particu<strong>la</strong>rités souvent périlleuseset hostiles de leur terre d’accueil.Mais est-ce que <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> offre uneprotection à ces personnes <strong>qui</strong> travaillentà l’étranger ?La couverture de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>La Loi sur les accidents du travail et lesma<strong>la</strong>dies professionnelles (LATMP) précisequ’un travailleur victime d’une lésionprofessionnelle survenue hors duQuébec est protégé par <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> s’il remplitcertaines conditions. D’abord, il doitêtre domicilié au Québec ou l’avoir étélors de son affectation. Cette dernière nedoit pas excéder cinq ans. Enfin, sonemployeur doit avoir un établissementau Québec 1 . Donc un travailleur affectépar son employeur à l’aide humanitairesera couvert par <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> s’il remplit cesconditions et s’il subit une lésion professionnelle,soit un accident du travail,soit une ma<strong>la</strong>die professionnelle.Les prestations prévues à <strong>la</strong> loiSi, en raison de <strong>la</strong> lésion professionnellesurvenue hors du Québec, le travailleurn’est plus en mesure de travailler, ilpourra recevoir une indemnité pourcompenser <strong>la</strong> perte de revenu <strong>qui</strong> en découle.La <strong>CSST</strong> versera alors une indemnitéé<strong>qui</strong>va<strong>la</strong>nt à 90 % de sonrevenu net retenu. Cette indemnité estcalculée à partir du revenu brut annueldu travailleur, <strong>qui</strong> ne peut toutefois êtreinférieur au sa<strong>la</strong>ire minimum ni supérieurau maximum annuel assurablefixé à 62 500 $ en 2010. Également, cetravailleur aura droit de recevoir sansfrais tous les soins et traitements médicauxqu’exige son état. S’il subsiste desdommages permanents liés à son état1. LATMP, art. 8Il faut être bien préparé pourfaire face aux dangers multiples<strong>qui</strong> font partie du quotidien destravailleurs humanitaires.physique ou psychologique, il pourraégalement bénéficier du droit à des servicesde réadaptation pour faciliter sonretour sur le marché du travail et saréinsertion sociale. De plus, dans le casd’une atteinte permanente à son intégritéphysique ou psychique, le travailleurpourra avoir droit à uneindemnité pour dommage corporel.Finalement, si l’impensable se produisaitet qu’un travailleur mourait, les personnesà sa charge, conjoint et enfants,pourraient être indemnisées. Un montantpourrait également être accordé pour lepaiement des frais funéraires et des fraisde rapatriement du corps au Québec.Dans le cas où un travailleur disparaîtà <strong>la</strong> suite d’un accident du travail dansdes circonstances <strong>qui</strong> <strong>la</strong>issent présumerson décès, comme ce fut le cas lors dutremblement de terre en Haïti, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>pourra considérer que cette personne estdécédée à <strong>la</strong> date de l’événement. Ainsi,<strong>la</strong> preuve du décès est plus facile et lepaiement des indemnités plus rapide.La LATMP prévoit aussi qu’un bénévolepeut être considéré comme un travailleur.Ce<strong>la</strong> implique qu’il bénéficieraalors de <strong>la</strong> protection accordée par <strong>la</strong>LATMP s’il subit une lésion professionnelle,sauf pour ce <strong>qui</strong> est du droitau retour au travail. Ainsi, le bénévolepourrait bénéficier d’une indemnité deremp<strong>la</strong>cement du revenu s’il devientincapable de travailler, <strong>la</strong>quelle seraitcalculée en fonction du sa<strong>la</strong>ire minimumen vigueur l’année où le travailleur a accompliles heures de bénévo<strong>la</strong>t. Pour quecette protection s’applique, le travailbénévole doit être fait avec l’accord del’employeur <strong>qui</strong> utilise ses services etce dernier doit transmettre à <strong>la</strong> Commissionune déc<strong>la</strong>ration contenant des informationssur <strong>la</strong> nature des activitésexercées dans son établissement, <strong>la</strong> naturedu travail accompli bénévolement, lenombre de bénévoles, <strong>la</strong> durée du travailet <strong>la</strong> période de protection demandée.Il est réconfortant de penser que lestravailleurs humanitaires puissent êtreprotégés par <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>. Ce<strong>la</strong> encouragerapeut-être un plus grand nombre àaller aider les plus démunis. On ne doittoutefois pas partir du jour au lendemainsous le coup d’une impulsion. Ilfaut être bien préparé pour faire faceaux dangers multiples <strong>qui</strong> font partiedu quotidien des travailleurs humanitaires.PTEvelyne JulienÉté 2010Prévention au travailPhotos : iStockphoto15
Agendad’ici et d’ailleurs3 septembre 2010Angers (France)5 octobre 2010Montréal (Québec)4 au 8 octobre 2010Québec (Québec)6 au 7 octobre 2010Oran (Algérie)Premus 2010, 7 e Conférenceinternationale – Préventiondes troubles musculosquelettiquesliés au travailRenseignementshttp://ead.univ-angers.fr/~leest/spip.php?rubrique18Du 20 au 22 septembre 2010Los Angeles, États-UnisForum international sur <strong>la</strong>gestion de l’incapacité etde l’invaliditéRenseignementswww.ifdm2010.comCentre patronal de santé etde sécurité du travail duQuébec21 septembre 2010Montréal (Québec)Accident : enquête et analyse22 septembre 2010Montréal (Québec)Procédures de réc<strong>la</strong>mationsà <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>23 septembre 2010Montréal (Québec)Suivi des cas de lésionsprofessionnelles28 septembre 2010Montréal (Québec)L’imputation des coûtspar <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>29 septembre 2010Montréal (Québec)Opposition à l’admissibilité(Atelier de rédaction)30 septembre 2010Montréal (Québec)Formation à <strong>la</strong> supervisionRéunions efficaces du comitéde santé-sécurité1 er octobre 2010Montréal (Québec)Le calcul de l’indemnité pourles « 14 premiers jours »Sous-traitance :responsabilités en SSTdu donneur d’ouvrageJeunes et nouveaux : bienles accueillir et les formerDevenez un communicateurleaderen SSTIdentifier et contrôler lesrisques en milieu de travailContestation des décisionsde <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>6 octobre 2010Montréal (Québec)Savoir animer des rencontresde sécurité : un « must » pourles superviseurs7 octobre 2010Montréal (Québec)Sécurité des machinesProblèmes de santé mentaleau travail ? Votre gestionfait partie de <strong>la</strong> solution !Renseignementshttp://www.centrepatronalsst.qc.ca/Du 28 au 30 septembre 2010Paris (France)Journal de l’environnementNouveaux enjeux réglementairesen sécurité et <strong>la</strong>prévention comme levierde performanceRenseignementshttp://www.journaldelenvironnement.net/Du 29 septembre au1 er octobre 2010Kosice, Slova<strong>qui</strong>eSymposium international :La prévention au travail dansl’Union européenne (E 27)Renseignementshttp://www.issa.int4 et 5 octobre 2010Lucerne, SuisseDéveloppement desnanotechnologies : les enjeuxpour <strong>la</strong> sécurité et <strong>la</strong> santéau travailRenseignementshttp://www.issa.int/aiss/News-Events/Events/ISSAsymposium-NanotechnologySymposium de l’Associationdes commissions desaccidents du travail duCanada (ACATC)19 et 20 octobre 2010Montréal (Québec)Grand Rendez-vous en santéet sécurité du travail 2010 de<strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Renseignementswww.csst.qc.caColloques régionaux de <strong>la</strong>Commission de <strong>la</strong> santé et de<strong>la</strong> sécurité du travail (<strong>CSST</strong>)6 octobreCarleton (Québec)7 octobreSainte-Anne-des-Monts14 e colloque sur <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong>sécurité du travailde <strong>la</strong> Direction régionale de<strong>la</strong> Gaspésie et des Îles-de<strong>la</strong>-Madeleine15 octobre 2010Jon<strong>qui</strong>ère (Québec)26 e colloque sur <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong>sécurité du travailde <strong>la</strong> Direction régionale duSaguenay–Lac-Saint-Jean26 et 27 octobre 2010Rouyn-Noranda (Québec)22 e colloque sur <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong>sécurité du travailde <strong>la</strong> Direction régionale del’Abitibi-Témiscamingue2 novembre 2010Drummondville (Québec)13 e carrefour en santéet sécurité du travailde <strong>la</strong> Direction régionalede <strong>la</strong> Mauricie et du Centredu-Québec10 novembre 2010Rimouski (Québec)2 e colloque sur <strong>la</strong> santé et<strong>la</strong> sécurité du travail de <strong>la</strong>Direction régionale duBas-Saint-LaurentRenseignementswww.csst.qc.caOrganisé par le centre derecherche en anthropologieet sociologie culturelle(Crasc)Colloque – Harcèlement enmilieu de travail.Renseignementshttp://www.cwsforum.com/en/26 octobre 2010Québec (Québec)2 novembre 2010Montréal (Québec)Colloque Milieu de vie –Qualité de vie en hébergementet santé et sécurité du travail :des inséparables !Renseignementswww.asstsas.qc.caDu 28 au 31 octobre 2010Casab<strong>la</strong>nca, MarocConférence internationalesur <strong>la</strong> santé au travail pourtravailleurs du milieu de <strong>la</strong>santéRenseignementshttp://www.8hcwc2010.ma3 novembre 2010Montréal (Québec)Colloque, Santé psychologique– <strong>Des</strong> solutions pourmieux intervenir dans lesmilieux de travailRenseignementswww.irsst.qc.caDu 4 au 7 novembre 2010Paris (France)Salon ExpoprotectionRenseignementswww.expoprotection.com22 et 23 novembre 2010Québec (Québec)Groupe Ergo bureauRenseignementswww.asstsas.qc.ca16Prévention au travail Été 2010
Rechercheà l’IRSSTDans ce numéro17La santé et <strong>la</strong> sécuritédes jeunes travailleursUne nouvelle pièce du puzzle :<strong>la</strong> mobilité20BruitUn outil pour encoffrerles machines23Nettoyage et décontaminationdans les milieux de travailAvec le béryllium,il y a <strong>la</strong> manière26Chariots élévateursMieux voir pour améliorer<strong>la</strong> sécurité282930Boursière : Hélène FavreauUniversité du Québecà MontréalDéceler le trouble paniquechez les travailleurs ayantdes symptômes respiratoiresNouvelles publicationsRecherches en coursLa santé et <strong>la</strong> sécuritédes jeunes travailleursUne nouvelle pièce du puzzle :<strong>la</strong> mobilitéLes statistiques sont formelles : les15 à 24 ans se blessent nettement plussouvent que leurs aînés. Dans un marchédu travail en rapide transformation,il devient urgent de s’attaquer à <strong>la</strong>question sous tous ses angles, autanten ce <strong>qui</strong> a trait à <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécuritédu travail (SST) comme telle qu’à <strong>la</strong>santé publique, au renouvellement etau maintien de <strong>la</strong> main-d’œuvre ainsiqu’à l’expertise et à <strong>la</strong> situation socialeet économique dans son ensemble.Ce sont ces données, entre autres,<strong>qui</strong> ont déclenché le signal d’a<strong>la</strong>rme <strong>qui</strong>al<strong>la</strong>it mener à <strong>la</strong> création du P<strong>la</strong>n d’actionjeunesse de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, en 2001, et del’Opération JeuneSST de l’IRSST, en2004. Depuis, l’Institut s’affaire à mieuxcirconscrire les enjeux de SST propresaux jeunes afin d’appuyer les actions de<strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, du réseau de <strong>la</strong> prévention etÉté 2010Prévention au travailIllustration : Philippe Béha17
Rechercheà l’IRSSTdes milieux de travail dans cette sphèred’intervention.En 2005, Jean-François Godin et descol<strong>la</strong>borateurs publient Portrait statistiquedes travailleurs en réadaptation en2001-2002, <strong>qui</strong> établit le profil des personnes<strong>qui</strong> devaient passer par un processusde réadaptation. « Nous avonsremarqué que le taux d’atteinte permanenteà l’intégrité physique ou psychiqueétait <strong>la</strong>rgement plus élevé chezles 15 à 19 ans. Du simple au double,Point de départL’Enquête sur <strong>la</strong> dynamique du travail etdu revenu (EDTR) de Statistique Canadaa pour objet de suivre l’évolution de <strong>la</strong>situation de l’emploi et du revenu desménages canadiens. Cette dimensionlongitudinale est de plus en plus présentedans les sciences sociales, maisrarement dans le domaine de <strong>la</strong> santé etde <strong>la</strong> sécurité du travail. C’est pourquoiune é<strong>qui</strong>pe de chercheurs s’est demandési une telle source de données, <strong>qui</strong> documenteles parcours d’emploi plutôtqu’une situation ponctuelle, pourraitjeter un nouvel éc<strong>la</strong>irage sur les facteursexpliquant <strong>la</strong> plus grande fréquence delésions professionnelles chez les jeunes.ResponsablesJean-François Godin 1 et ÉliseLedoux 2 , de l’IRSST ; BenoîtLap<strong>la</strong>nte, Mircea Vultur etZacharie Tsa<strong>la</strong> Dimbuene, del’INRS-Urbanisation, cultureet société.RésultatsLa plus grande contribution del’étude est sa démonstration del’effet de <strong>la</strong> mobilité d’emploi,du travail à temps partiel et2de <strong>la</strong> situation sco<strong>la</strong>ire sur lesrisques de lésions professionnelles auxquelssont exposés les jeunes de 16 à24 ans, comparativement aux travailleursplus âgés.UtilisateursLes responsables de programmes publicset privés en matière d’emploi, de formationprofessionnelle, de ressourceshumaines, de santé et de sécurité dutravail, d’éducation, entre autres. Leschercheurs, les intervenants et les milieuxde travail intéressés à <strong>la</strong> situationparticulière des jeunes travailleurs enmatière de SST.1comparativement à <strong>la</strong> moyenne. Plusieursfacteurs peuvent expliquer cettesituation. Reste que, pour mieux comprendreles réalités de l’emploi chez lesjeunes, on devait utiliser une approchetemporelle, situant les événements dansle temps. »Peu de temps après, Marie Labergeet Élise Ledoux publient Bi<strong>la</strong>n et perspectivede recherche sur <strong>la</strong> SST des jeunestravailleurs, <strong>qui</strong> attire l’attention surles enjeux de <strong>la</strong> précarité d’emploi etles accidents de travail chez les jeunes.L’économiste et sociologue Jean-FrançoisGodin et l’ergonome Élise Ledoux décidentalors de tenter d’exploiter certainesdonnées d’enquêtes longitudinales existantesafin d’estimer l’influence de <strong>la</strong>précarité ou de <strong>la</strong> mobilité d’emploi sur<strong>la</strong> survenue précoce des lésions professionnelleschez les jeunes.L’é<strong>qui</strong>pe de chercheurs s’est intéresséeà l’Enquête sur <strong>la</strong> dynamique du travailet du revenu (EDTR), que StatistiqueCanada produit depuis 1993. L’EDTRrecueille chaque année des données surles parcours d’emploi et sur l’activité dedeux groupes échantillons. Chacund’entre eux contient 15 000 ménages canadiens.« Cette source de données nousest apparue tout de suite comme pouvantapporter un éc<strong>la</strong>irage nouveausur <strong>la</strong> question des jeunes etde leur santé au travail, puisquec’est une enquête longitudinale, <strong>qui</strong>interroge les mêmes personnesd’année en année, pendant six annéesconsécutives, poursuit Jean-François Godin. Donc, si l’on a desdonnées sur un jeune de 15 ans, onpeut suivre son parcours d’emploijusqu’à 20 ou 21 ans. C’esttrès intéressant puisque même sil’on ne connaît pas <strong>la</strong> nature de<strong>la</strong> lésion ou de <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, l’EDTRfournit l’information sur les arrêtsde travail causés par une lésion professionnelleet sur les caractéristiques del’emploi. »Pratiquement toutes les études sur lesujet réalisées auparavant sont de typetransversal, c’est-à-dire qu’elles ne tiennentpas compte du moment ni de l’étapedu processus d’insertion en emploi, nonplus que de l’expérience sur le marchédu travail. Jean-François Godin est enthousiaste: « J’ai rarement vu des résultatsde cette nature dans le domaine de<strong>la</strong> SST. Notre étude représente vraimentune contribution originale au domaineparce qu’elle repose sur des donnéesPhotos : iStockphotolongitudinales plutôt que sur des donnéestransversales. Une étude longitudinaleexamine une situation <strong>qui</strong> évoluedans le temps, tandis que l’étude transversalenous donne l’état de <strong>la</strong> situationà un moment donné. On pourrait lescomparer à un film versus une photo, lepremier étant riche en informations, lesecond offrant un seul point de vue. »Questions de départAu moment d’entreprendre l’étude,et déjà même avant, comme le souligneJean-François Godin, « il y avaitbeaucoup de débats dans le domaine, àsavoir si c’est le fait d’être jeune, toutsimplement, <strong>qui</strong> caractérise <strong>la</strong> forteincidence de lésions – parce qu’ona tendance à associer à <strong>la</strong> jeunessel’inexpérience, une maturité moindre,de l’insouciance... –, ou si c’est le faitd’être un nouveau travailleur ». Avantde pouvoir interroger <strong>la</strong> masse d’informationfournie par l’EDTR, les chercheursont d’abord procédé à une revue18 Prévention au travail Été 2010
des recherches récentes sur <strong>la</strong> problématiquede <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécurité desjeunes au travail. Plusieurs questionsdemeuraient sans réponse : Y a-t-il unlien entre le niveau de sco<strong>la</strong>risation desjeunes et le risque auquel ils s’exposent ?Est-ce simplement le fait d’être jeune ouplutôt celui d’être un nouveau travailleur<strong>qui</strong> accroît les risques de lésionsprofessionnelles ? Qu’en est-il de <strong>la</strong> mobilitéd’emploi des jeunes ? Les jeunesréintègrent-ils plus rapidement le marchédu travail après une lésion ?Plus jeune, plus de risquesComme les études transversales précédentes,celle-ci montre d’abord que lesjeunes sont exposés à de plus grandsrisques de lésions professionnelles. « Onmontre souvent du doigt l’inexpérienceou le jeune âge, poursuit Jean-FrançoisGodin, mais – et c’est une contributionmajeure de l’étude – il est c<strong>la</strong>ir que c’estle risque cumulé <strong>qui</strong> fait en sorte que lesjeunes sont plus à risque. Ainsi, <strong>la</strong> mobilitéen emploi est fortement associée aurisque d’apparition de lésions professionnelles.Cette situation est cependant plusrépandue chez les jeunes <strong>qui</strong> changentplus fréquemment d’emploi au débutde leur entrée sur le marché du travailcomparativement aux travailleurs plusâgés. La différence est que les jeunes,à cause de leur grande mobilité d’emploi,se retrouvent plus fréquemmentdans cette situation : exposés à de nouveauxrisques, dans un environnementde travail qu’ils ne connaissent pas, souventaffectés à des tâches dont les travailleursplus expérimentés ne veulentpas... Paradoxalement, leur statutprécaire fait en sorte que les investissementsen matière de formation, d’encadrement,d’amélioration des conditionsd’exercice du travail sont parfois limitésEn raison de leurgrande mobilitéd’emploi, les jeunesse retrouvent plusfréquemmentexposés à de nouveauxrisques,dans un environnementde travailqu’ils neconnaissentpas.Les investissementsen matière de formation,d’encadrement, d’améliorationdes conditions d’exercicedu travail des jeunessont parfois limités comptetenu du fait que cettemain-d’œuvre est considéréecomme étant « de passage »dans l’entreprise.compte tenu du fait que cette maind’œuvreest considérée comme étant“de passage” dans l’entreprise. »Facteurs en jeuIl faut donc insister sur le fait que l’âgeen soi n’apparaît pas comme un facteurexpliquant les différences de risques delésions professionnelles, mais <strong>la</strong> mobilitéen emploi, oui. Occuper plusieursemplois différents au cours d’une périodedonnée, ce qu’on nomme <strong>la</strong> mobilitéd’emploi, « est fortement associé àune première lésion. Souvent, les jeunestravaillent en alternance avec des périodesd’études ou cumulent plusieursemplois. En plus, ils se retrouvent dansdes secteurs reconnus comme étant àrisque élevé », note le chercheur.Autre résultat déterminant de l’étude,les analyses faites sur les popu<strong>la</strong>tionsâgées de moins de 25 ans ont révélé uneproportion de lésions professionnellesnettement plus élevée chez les décrocheurs(travailleurs n’ayant pas terminéleurs études secondaires) que chez tousles autres jeunes, peu importe leur parcourssco<strong>la</strong>ire.Les chercheurs ont aussi pu établirque les jeunes retournent plus vite autravail après une absence pour lésionprofessionnelle que les travailleurs plusâgés. Dans ce cas, l’étude ne permettoutefois pas de déterminer les facteursen cause.<strong>Des</strong> indices pour mieux intervenirTelle que conçue, à des fins d’analyse durevenu et de l’emploi, l’EDTR de StatistiqueCanada fournit peu de données surles conditions d’exercice du travail desjeunes. Toutefois, diverses recherchestransversales avaient déjà fait <strong>la</strong> preuveque le type d’emploi occupé ainsi que lescontraintes auxquelles les jeunes sontÉté 2010Prévention au travail19
Un outil pour encoffrer les machinesIl s’agit d’un logiciel prévisionnelscientifique grâce auquel les chercheurspeuvent concevoir et prédire l’efficacitéréelle d’un encoffrement avant mêmede le fabriquer.Entréedes piècesOuvertureSortie d’airvers dépoussiéreurOuverturePanneauxinsonorisantsL’encoffrement ? Une boîte…L’encoffrement lui-même est une boîte,généralement de grande dimension, <strong>qui</strong>entoure <strong>la</strong> source sonore. Il est habituellementconstitué d’un assemb<strong>la</strong>ge dep<strong>la</strong>ques multicouches, composées d’unetôle métallique éventuellement raidie,d’un matériau absorbant (de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ineminérale, par exemple) et d’une p<strong>la</strong>queperforée ou d’un film de protection.Même si ce<strong>la</strong> peut paraître simple,pour assurer l’efficacité d’une telle barrièreantibruit, il faut tenir compte desfortes interactions physiques entre leséléments <strong>qui</strong> le constituent (loi de massepour les parois simples, fréquence derespiration pour les parois doubles,dissipation des matériaux absorbants,présence de fuites dues à un mauvaisassemb<strong>la</strong>ge ou à des ouvertures, etc.).On distingue trois typesd’encoffrements :intégré : il est tellement près de <strong>la</strong>source qu’il fait quasiment partie de<strong>la</strong> machine ;complet : recouvrant entièrementl’é<strong>qui</strong>pement, il se présente commeun ensemble de panneaux préfabriqués,munis de portes, de fenêtres et d’autresouvertures ;partiel : plus de 10 % de <strong>la</strong> surfacede l’encoffrement est ouverte ou nontraitée.« Le grand avantage de notre outil,précise Franck Sgard, chercheur àl’IRSST et responsable de l’étude, c’estqu’il permet d’analyser, d’étudier etd’évaluer sur ordinateur une multitudede paramètres, en limitant le plus possible<strong>la</strong> réalisation d’essais matériels etle développement de prototypes avec, à<strong>la</strong> clé, <strong>la</strong> possibilité d’intervenir plusParementextérieurEntrée d’airpour ventilerl’enceintePortesd’accèsFuitesGarnissage(matériau absorbant)tôt, plus vite, en réduisant les coûts touten optimisant <strong>la</strong> performance. »Inspiré de l’architectureet de l’aéronautiquePour arriver à concevoir cet outil, lesscientifiques ont amorcé leurs travauxpar une importante révision de l’étatdes connaissances en <strong>la</strong> matière, passanten revue les caractéristiques desoutils semb<strong>la</strong>bles existants. Ainsi, bienqu’il existe des outils informatiquesFenêtred’observationFilmprotecteuréventuelParementinterne(tôle perforée)CôtésourceSilencieuxRideaux de <strong>la</strong>ttes<strong>qui</strong> se chevauchentOn trouve de tels encoffrementsdans nombre d’industries :fabrication de produitsmétalliques et de p<strong>la</strong>stique,pâtes et papiers,etc. Ils sont constituésd’un assemb<strong>la</strong>ge dep<strong>la</strong>ques multicouchescomposées d’un parementextérieur, éventuellementraidi, servant de barrièreau bruit. Ils comportent aussiun garnissage constitué d’unmatériau absorbant (<strong>la</strong>ine deverre, <strong>la</strong>ine de roche, mousseacoustique), de même qu’unep<strong>la</strong>que perforée en guise deparement intérieur pour le protéger; éventuellement, un film deprotection peut être glissé entre legarnissage et <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que perforée.Ce type d’assemb<strong>la</strong>ge comportegénéralement une ou plusieursportes, des fenêtres et d’autresouvertures fonctionnelles (entréeou sortie d’air parfois é<strong>qui</strong>péesde silencieux, ouverture pour <strong>la</strong>convection de matières, etc.).Été 2010Sortiedes piècesOuverturePrévention au travail21
Nettoyage et décontamination« C’était inattendu, explique <strong>la</strong>chimiste Chantal Dion. Il y a eu d’uncoup, en 1999, un nombre exceptionnellementélevé de cas qu’on pensait êtrede <strong>la</strong> sarcoïdose, mais <strong>qui</strong> se sont avérésêtre de <strong>la</strong> bérylliose. » La bérylliosechronique (CBD) – <strong>qui</strong> peut facilementêtre confondue avec <strong>la</strong> sarcoïdose – estdans les milieuxde travailPoint de départEn 1999, le Québec est aux prises avecune recrudescence de cas de béryllioseet de sensibilisation au béryllium (Be)alors que l’on croyait avoir maîtrisé l’expositionà ce composé. De concert avecses partenaires, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> entreprend defaire une recension méthodique dessecteurs et des entreprises <strong>qui</strong> utilisentce métal, soit quelque 3 000 au Québec.En 2004, l’IRSST et <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> diffusent unesynthèse des bonnes pratiques à cetégard et l’Institut présente deux nouveauxdocuments en <strong>la</strong> matière. Le premierest un rapport de recherche et lesecond, un guide de bonnes pratiques,axé cette fois sur les techniques d’entretienménager et de décontamination deslieux de travail, visant principalementl’élimination du béryllium résiduel <strong>qui</strong> sedépose et s’accumule sur les surfaces.ResponsablesStéphanie Viau et Chantal Dion 1 ,de l’IRSST ; André Dufresne,de l’Université McGill et GuyPerrault, consultant.RésultatsPlusieurs déterminants entrent 1en jeu dans l’efficacité des techniquesutilisées pour récupérer le bérylliumrésiduel : <strong>la</strong> surface sur <strong>la</strong>quelleles poussières sont déposées, le composéen cause, <strong>la</strong> solution nettoyante,<strong>la</strong> technique de prélèvement et l’opérateur.Le guide synthétise concrètementles principales lignes directrices en matièred’entretien ménager et de décontaminationdes lieux de travail.UtilisateursPrincipalement, les entreprises où il y adu béryllium, les travailleurs des compagnieschargées de nettoyer ces lieuxde travail ainsi que les inspecteurs de<strong>la</strong> <strong>CSST</strong> et les hygiénistes du réseau de<strong>la</strong> SST.Avec le béryllium, il y a <strong>la</strong> manièreune atteinte pulmonaire caractériséepar <strong>la</strong> présence de granulomes dansles poumons. Elle peut être contractéeaprès une exposition prolongée à defaibles concentrations de béryllium etest précédée d’une phase de sensibilisation(BeS), <strong>qui</strong> est asymptomatique.Ce ne sont pas toutes les personnessensibilisées au béryllium <strong>qui</strong> contracteront<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. <strong>Des</strong> affections de <strong>la</strong>peau, du type des dermatites de contact,ont aussi été observées chez des travailleursayant eu une exposition cutanéeau Be.« Il y avait eu des cas dema<strong>la</strong>dies reliées à l’expositionau béryllium un peu partoutdans le monde, certes, maisc’était chose du passé pourtous, poursuit <strong>la</strong> chimiste.Nous savionsque des entreprisesmanipu<strong>la</strong>ient encore dubéryllium, mais à desconcentrations jugéestrop faibles pour menacer<strong>la</strong> santé. »À l’IRSST, c’est ChantalDion <strong>qui</strong> porte le dossierdu Be. Elle est à l’originedu premier guide – en fait,une synthèse des bonnes pratiques–, publié en 2004.C’est également elle <strong>qui</strong> aété <strong>la</strong> bougie d’allumagedu Colloque internationalsur le béryllium, tenu àMontréal en 2005. « Uncolloque, dit-elle, où lesAméricains, <strong>qui</strong> ont étéles premiers à documenter ce dossierdans les années 1940, ont été impressionnéspar <strong>la</strong> stratégie de préventionmassive mise alors sur pied par leQuébec. »Rapidement en effet, après <strong>la</strong> confirmationdes cas de bérylliose auQuébec, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> a é<strong>la</strong>boré un p<strong>la</strong>n d’actionavec ses partenaires (réseau de <strong>la</strong>santé, IRSST et associations sectoriellesparitaires) afin d’évaluer <strong>la</strong> situationdans les industries en priorisant certainssecteurs d’activité, dont les fonderies,les entreprises de nettoyage, lesavionneries et les ateliers d’usinage.Pour compléter son travail,l’é<strong>qui</strong>pe composée de chercheursde l’IRSST et de l’UniversitéMcGill a remis l’ouvrage sur lemétier ces dernières semainesen publiant un nouveaurapport de recherche et unguide de nettoyage. L’objectifde ces publications,Les personnes <strong>qui</strong>effectuent les travauxde nettoyage, celles <strong>qui</strong>font des prélèvementsdans <strong>la</strong> zone de décontamination,le personneldes <strong>la</strong>boratoires et lestechniciens responsablesde l’entretien des pompeset du matériel d’échantillonnagedoivent porterdes é<strong>qui</strong>pements de protectionindividuelle adéquats.Été 2010Prévention au travailIllustrations : Ronald DuRepos23
Rechercheà l’IRSSTLa surveil<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> contamination des surfacesest utile pour maîtriser les émissions de poussièresde béryllium. L’échantillonnage constitueun moyen efficace pour effectuer cette surveil<strong>la</strong>nce.Il existe trois principales techniques deprélèvements d’échantillons de surfaces, cependantle frottis réalisé avec une lingette humide,enveloppée individuellement est recommandé.Illustration : Ronald DuReposdestinées aux compagnies <strong>qui</strong> manipulentdu béryllium (y compris celles<strong>qui</strong> effectuent le nettoyage et l’entretiendes locaux) est, globalement, d’affinerles moyens de protéger les travailleurs,en entretenant et en décontaminantadéquatement les lieux de travail. « Ona étoffé nos procédures, dit ChantalDion. Les techniques de prélèvementde surface pour vérifier s’il y a contaminationou non sont mieux adaptées.Secteurs industriels oùdu béryllium peut être présentLe béryllium est utilisé dans plusieurssecteurs d’activité, les principaux étantles neuf ci-dessous dont les cinqpremiers sont c<strong>la</strong>ssés prioritaires :1. Fonderie2. Recyc<strong>la</strong>ge des métaux3. Industries de l’aérospatiale et del’aéronautique4. Industrie de l’environnement(traitement et recyc<strong>la</strong>ge des déchets)5. Entreprises d’usinage et de soudagedes alliages contenant du béryllium6. Industrie du p<strong>la</strong>stique utilisant desmoules en alliage de béryllium7. Fabrication de moules et de matrices8. Fabrication de prothèses dentaires9. Fabrication de certains composantsélectriques et électroniquesOn trouve dans le guide des exemplespratiques de techniques de nettoyagedûment évaluées. »Le nettoyage est d’autant plus pertinentque l’absorption de Be par voiecutanée (s’ajoutant à <strong>la</strong> voie respiratoire)a été suggérée pour expliquerl’apparition de certains cas de sensibilisation.« On s’est rendu compte quemême si l’échantillonnage de l’air révé<strong>la</strong>itdes seuils acceptables, il y avaitmalgré tout des travailleurs <strong>qui</strong> développaientune sensibilisation au béryllium», dit Chantal Dion. Dans cecontexte, <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce des niveauxde contamination des innombrablessurfaces d’un milieu de travail (l’abatjourd’un luminaire, le cadre d’un venti<strong>la</strong>teur,etc.) est apparue comme unestratégie importante de <strong>la</strong> maîtrise desémissions. La présence de particulesde béryllium sur les é<strong>qui</strong>pements detravail augmente le potentiel de contactcutané des travailleurs avec cette substance.Aussi, ce <strong>qui</strong> s’est déposé ici etlà peut être remis en circu<strong>la</strong>tion et pénétrerdans l’organisme, cette fois parles voies pulmonaires.Mêmes précautionsqu’avec l’amianteQuatrième élément du tableau périodique,situé entre le bore et le lithium,le Be est un métal léger, non magnétiqueet résistant à <strong>la</strong> corrosion. Pouvantabsorber de grandes quantités dechaleur, il est utilisé entre autres dansl’aérospatiale et l’aéronautique. Il sertaussi dans les alliages (sous forme decuivre-béryllium [Be-Cu] ou de nickelbéryllium[Be-Ni]) et donc, dans unegrande variété de matériaux et de secteurs,dont <strong>la</strong> denturologie.Comme c’est le cas avec d’autres produitscontaminants, on peut être exposéau Be dès qu’il se trouve à l’état libre,en suspension dans l’air, sous <strong>la</strong> formede poussières ou de fumée : « D’ailleurs,les mesures préventives prises avecl’amiante – on sait que l’amiante doitêtre manipulé avec précaution et ensuivant des règles – sont le modèle <strong>qui</strong>a guidé <strong>la</strong> structure préventive misesur pied à l’IRSST depuis maintenant10 ans », explique Chantal Dion.L’étude dont il est question a évaluédifférentes solutions nettoyantes surdes surfaces de matériaux en cuivrebéryllium(CuBe) et de matériaux sansBe. Elle s’est aussi penchéesur l’efficacité de trois techniquesde prélèvement desurface (frottis avec lingetteshumides, aspiration de type« microvacuum » et colorimétrieavec les ChemTest®).Enfin, elle a évalué des techniquesde nettoyage et de décontaminationutilisées surle terrain. Ainsi, le cycle denettoyage combinant deuxméthodes, soit l’aspirationsuivie d’un nettoyage humideavec du détergent, est efficacesur les surfaces re<strong>la</strong>tivementlisses et homogènes. Le prélèvementpar frottis avec leslingettes humides demeure <strong>la</strong>technique <strong>la</strong> plus adéquatepour estimer <strong>la</strong> contaminationde surface.Le bérylliumen milieu de travailOutre leurs activités en <strong>la</strong>boratoire,les chercheurs onttravaillé en situation réelledans les entreprises. Cetteincursion sur le terrain leur apermis d’observer différentes situations.Ainsi, dans un atelier d’usinage demoules en alliage contenant du béryllium(destinés à l’industrie des p<strong>la</strong>stiques),24 Prévention au travail Été 2010
« des prélèvements de surface ont étéeffectués sur deux moules, avant etaprès leur nettoyage, afin de vérifier <strong>la</strong>variation de <strong>la</strong> contamination des surfaces,re<strong>la</strong>te Chantal Dion. Les résultatsont démontré que <strong>la</strong> valeur seuil étaitdépassée sur les surfaces de CuBe, et ce,même après le nettoyage humide avecun solvant. »Que s’est-il passé ? « La présence debéryllium sur <strong>la</strong> surface en aluminium,en concentrations plus élevées après lenettoyage qu’avant, <strong>la</strong>isse supposer unemigration des particules de béryllium »,explique le rapport de recherche. Ilfaut éviter d’utiliser une solution acidepour nettoyer des surfaces en cuivrebérylliumafin de limiter l’oxydation et <strong>la</strong>génération accrue de Be à <strong>la</strong> surface.En recommandant ces précautions,les chercheurs incluent non seulementles matériaux manipulés, mais égalementles outils des travailleurs. « Lesoutils et les é<strong>qui</strong>pements en alliage deBe devront être traités comme étantdes sources potentielles d’expositioncutanée et leur utilisation devrait êtreIllustrations : Ronald DuReposencadrée par des mesures de préventionadéquates. Une pièce contenantdu béryllium, dont <strong>la</strong> surface a été décontaminée,conserverait toujours sonpotentiel de libération de Be », prévientChantal Dion. Dans une entreprise, parexemple, un p<strong>la</strong>ncher de ciment friableet abîmé posait problème. L’applicationd’un scel<strong>la</strong>nt a été <strong>la</strong> solution retenuepour confiner <strong>la</strong> contamination. Il faudracependant suivre <strong>la</strong> dégradationdu scel<strong>la</strong>nt pour s’assurer de l’efficacitécontinue de cette barrière.É<strong>la</strong>rgir les champsde <strong>la</strong> préventionLes travailleurs affectés à l’entretien età <strong>la</strong> décontamination sont potentiellementà risque d’être contaminés etdoivent donc porter des é<strong>qui</strong>pementsde protection individuels, tant cutanéeque respiratoire.« Si l’on veut prévenir toutes les formesd’exposition, il faut aussi éviter<strong>la</strong> propagation des poussières versl’extérieur ou <strong>la</strong> contamination dezones connexes, dit Chantal Dion. LaUn procédé comportant trois seaux estsuggéré pour nettoyer des surfaces où ily a du béryllium. L’opérateur en utilised’abord un avec de l’eau mé<strong>la</strong>ngée à unesolution nettoyante pour <strong>la</strong>ver <strong>la</strong> surface.Un seau vide lui permet d’essorer l’éponge,<strong>la</strong> vadrouille ou le chiffon souillé avantde retourner l’objet dans le premier seauet de continuer le <strong>la</strong>vage. Un troisième,contenant de l’eau seulement, sert aurinçage de <strong>la</strong> surface après le <strong>la</strong>vage.réglementation québécoise prévoit l’utilisationd’un vestiaire double pour lestravailleurs. Les zones à décontaminerdoivent être cloisonnées et sous pressionnégative, ce <strong>qui</strong> pourrait être dessolutions tout à fait appropriées. » PTLuc DupontPour en savoir plusVIAU, Stéphanie,Chantal Dion.Béryllium – Entretienménager et décontaminationdes lieuxde travail – Guidede nettoyage, Guidetechnique RG-638,36 pages.Téléchargeablegratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RG-638.pdfVIAU, Stéphanie, Chantal DION,Guy PERRAULT, André DUFRESNE,Valérie TURCOTTE, Hooman GOLSHAHI,Bethany CAMPBELL, Teodor MOCANU,Annie OUELLET, Pierre-JeanDÉSORMEAUX. Nettoyage et décontaminationdes lieux de travail où il y aprésence de béryllium – Techniques etsolutions nettoyantes, Rapport R-613,76 pages.Téléchargeable gratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-613.pdfMULLER, Caroline, Bruce MAZER,Fariba SALEHI, Séverine AUDUSSEAU,Ginette TRUCHON, Jean LAMBERT,Gilles L’ESPÉRANCE, Gaston CHEVALIER,Suzanne PHILIPPE, Yves CLOUTIER,Pierre LARIVIÈRE, Joseph ZAYED.Évaluation de <strong>la</strong> toxicité du béryllium enfonction de <strong>la</strong> forme chimique et de <strong>la</strong> tailledes particules, Rapport R-637, 60 pages.Téléchargeable gratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/R-637.pdfIRSST. Conférence internationale de <strong>la</strong>recherche sur le béryllium – Recueil desprésentations. Documents généraux.Téléchargeable gratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/Be2005-fr.pdfToutes les publications de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> sur lebéryllium peuvent être téléchargées deson site Web : www.csst.qc.caPour commentaires et suggestions :magazine-prevention@irsst.qc.caÉté 2010Prévention au travail25
Rechercheà l’IRSSTChariots élévateursMieux voir pour améliorer<strong>la</strong> sécuritéLa sensibilisation aux risquesdes chariots élévateurs et à <strong>la</strong> formationsur leur utilisation sécuritaire figurentparmi les préoccupations de l’IRSST etde certaines associations sectoriellesparitaires depuis plusieurs années.Deux fiches, l’une sur les rétroviseurset l’autre sur les feux et les phares deschariots élévateurs, sont les plus récentsoutils <strong>qui</strong> en résultent.« Ces deux fiches sont des retombéesindirectes d’une étude ergonomique etd’une analyse des stratégies de conduitedes caristes, explique leur concepteur,l’ergonome Denis Giguère, <strong>qui</strong> travail<strong>la</strong>itjusqu’à récemment à l’IRSST.Point de départAu cours d’une recherche antérieuresur <strong>la</strong> sécurité des chariots élévateurs,alors qu’ils examinaient les stratégiesde conduite des caristes, les chercheursont remarqué le manque d’informationsur l’instal<strong>la</strong>tion et l’utilisation des rétroviseurs,des feux et des phares deces véhicules. La matière recueillie pendantcette recherche a permis de réaliserdeux fiches sur le sujet.ResponsableDenis Giguère, IRSST.RésultatsDeux fiches d’information, l’unesur l’instal<strong>la</strong>tion et l’utilisationdes rétroviseurs et l’autre sur les feuxet les phares ont été produites.UtilisateursLes caristes et autres travailleurs delieux où circulent des chariots élévateurs.Les fiches s’adressent aussi auxcontremaîtres, aux cadres responsablesdes chariots dans une entreprise, auxresponsables de l’achat, de <strong>la</strong> location etde l’entretien de ces véhicules de mêmequ’aux mécaniciens et aux membres descomités de santé et de sécurité.C’était une des suggestions du comitéde suivi de <strong>la</strong> recherche devant <strong>la</strong> matièreamassée au cours du projet. » Leschercheurs avaient alors remarqué lemanque d’information sur l’instal<strong>la</strong>tionet l’utilisation des rétroviseurs, desfeux et des phares des chariots élévateurs.Or, plusieurs risques d’accidentspeuvent en découler : heurt ou écrasementd’un travailleur circu<strong>la</strong>nt à piedpendant une manœuvre de recul ou undép<strong>la</strong>cement en marche arrière, collisionavec un autre chariot ou avec unpalettier et dommages matériels àl’é<strong>qui</strong>pement et aux produits. « Même si<strong>la</strong> conception de ces fiches n’était pasreliée à <strong>la</strong> problématique centrale desaccidents causés par les chariots, nouspouvions offrir quelque chose de concretà ce sujet », ajoute Denis Giguère.« Durant l’étude sur les stratégiesde conduite des caristes, je me suisbeaucoup documenté sur les accidentsgraves et mortels et j’ai constaté qu’environun accident sur quatre était reliéde près ou de loin à un manque dansPhoto : iStockphoto26 Prévention au travail Été 2010
<strong>la</strong> prise d’informations visuelles, expliqueDenis Giguère. J’ai aussi inventoriéce qu’on trouve dans les normesde sécurité, car ce sont des données nonnégligeables. J’ai tenu compte de l’expériencede différentes associations sectoriellesparitaires et des manuels deformation produits autant ici qu’ailleursdans le monde. Finalement, bien sûr,les connaissances ac<strong>qui</strong>ses grâce à <strong>la</strong> rechercheont été précieuses, notammentlors des mesures de <strong>la</strong> prise d’informationsvisuelles par les caristes au travailet au moyen d’entrevues approfondiesavec une <strong>qui</strong>nzaine d’entre eux. »Les rétroviseurs, un choix réf léchiLa fiche touchant les rétroviseursaborde, entre autres, le rôle de <strong>la</strong> vision,l’utilisation d’un rétroviseur en marchearrière et l’instal<strong>la</strong>tion de ces miroirssous <strong>la</strong> forme de questions et réponses.Elle fait aussi une mise en garde importantesur les précautions à prendrepour installer ce type d’é<strong>qui</strong>pement.Les feux et les phares,un choix éc<strong>la</strong>iréLa fiche sur les feux et les phares définitles feux témoins de même que lesfeux avertisseurs et les phares, leurutilité respective et leur instal<strong>la</strong>tion,également sous <strong>la</strong> forme de questionset réponses. Elle traite du rôle de <strong>la</strong>vision et de <strong>la</strong> réaction des yeux auxchangements d’éc<strong>la</strong>irage. Comme <strong>la</strong>fiche précédente, elle comporte uneliste de contrôle <strong>qui</strong> permet de vérifiersi tout est conforme aux normes.« Évidemment, les fiches s’adressentaux caristes, car ce sont eux <strong>qui</strong> ont <strong>la</strong>responsabilité de conduire leur véhiculede façon sécuritaire, précise DenisGiguère. Mais nous trouvions aussi importantde sensibiliser les travailleurs<strong>qui</strong> circulent à pied dans l’environnementde chariots élévateurs afin qu’ilscomprennent les exigences visuellesde <strong>la</strong> conduite de ces véhicules. » Parexemple, lorsqu’un piéton rencontre uncariste en action, les deux doivent se regarderet se comprendre pour savoir <strong>qui</strong>passe en premier. Les fiches s’adressentaussi aux comités de santé et de sécuritéainsi qu’aux administrateurs, lesresponsables des achats, par exemple.<strong>Des</strong> utilisateurs satisfaits« Bien faites et d’une bonne facture, cesfiches constituent un exemple d’applicationpratique à <strong>la</strong> suite d’une recherchetrès concrète, explique Pierre Bouliane,conseiller à l’Association SectorielleTransport Entreposage (ASTE). Ellessont faciles à lire et nous amènent àdes situations concrètes. »« Nous avons distribué les fichesdans nos rencontres régionales desresponsables de <strong>la</strong> SST et elles ont ététrès bien accueillies, commente GervaisSaint-Pierre, directeur des re<strong>la</strong>tionsavec le milieu aux associations de <strong>la</strong>santé et de <strong>la</strong> sécurité des pâtes etpapiers et des industries de <strong>la</strong> forêtdu Québec (ASSIFQ et ASSPPQ). C’estune synthèse d’informations praticopratiques<strong>qui</strong> est bien appréciée desgens du terrain. » PTBenoit FradettePour en savoir plusGIGUÈRE, Denis.Rétroviseurs –Utilisation etinstal<strong>la</strong>tion surchariots élévateurs,Fiche techniqueRF-625, 4 pages.Téléchargeablegratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RF-625.pdfGIGUÈRE, Denis. Feux et phares –Utilisation et instal<strong>la</strong>tion sur chariotsélévateurs, Fiche technique RF-626,6 pages.Téléchargeable gratuitement :www.irsst.qc.ca/files/documents/PubIRSST/RF-626.pdfPour commentaires et suggestions :magazine-prevention@irsst.qc.caÉté 2010Prévention au travail27
Rechercheà l’IRSSTBoursièreHélène FavreauUniversité du Québecà MontréalDéceler le trouble paniquechez les travailleursayant des symptômes respiratoiresArchiviste médicale de profession, HélèneFavreau est rapidement séduite par des études en psychologie.Elle entre donc à l’Université du Québec àMontréal (UQÀM) et y obtient un bacca<strong>la</strong>uréat en 2005.Elle y complète ensuite une maîtrise, puis un doctorat.« Après 10 ans comme archiviste médicale, j’ai décidéd’opter pour des études en psychologie, raconte-t-elle.J’avais déjà un pied dans <strong>la</strong> recherche, car je travail<strong>la</strong>isà l’Institut thoracique de Montréal et c’est là que monintérêt s’est développé. » Hélène Favreau termine présentementson doctorat sous <strong>la</strong> direction des D res ManonLabrecque et Kim Lavoie.Asthme ou anxiété ?« Parmi les travailleurs dirigés à une investigationd’asthme professionnel, le tiers recevra un diagnosticle confirmant et obtiendra une compensation de <strong>la</strong>Commission de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécurité du travail(<strong>CSST</strong>), explique <strong>la</strong> doctorante. Un autre tiers recevra undiagnostic d’asthme exacerbé par le milieu de travail,mais sans que celui-ci en soit <strong>la</strong> cause. Le dernier tiers,malgré une symptomatologie manifeste, ne recevra pasde diagnostic d’asthme. Même si les symptômes persistent,ils demeurent inexpliqués médicalement. Pourquoi? Mon hypothèse est que ces travailleurs souffrentd’anxiété. » Cette anxiété a comme conséquence qu’ilssont souvent incapables de travailler et qu’ils demeurentsouffrants. Puisqu’une bonne proportion d’entre euxprésentent plusieurs symptômes somatiques simi<strong>la</strong>iresà ceux de l’asthme, le diagnostic <strong>qui</strong> permet d’en faire<strong>la</strong> différence ou d’identifier les symptômes associés représenteun important défi clinique. « Autrement dit,l’anxiété ou les symptômes somatiques peuvent êtredéclenchés par des troubles psychologiques, possiblementle trouble panique. Ce<strong>la</strong> cause de l’hyperventi<strong>la</strong>tion,<strong>qui</strong> peut se confondre avec de l’asthme. »Les objectifs de <strong>la</strong> thèse d’Hélène Favreau sont d’évaluer<strong>la</strong> prévalence du trouble panique (TP) chez unepopu<strong>la</strong>tion de travailleurs faisant l’objet d’une investigationd’asthme relié au travail et d’en mesurer l’influencesur le p<strong>la</strong>n médical, <strong>la</strong> symptomatologie et les répercussionssur <strong>la</strong> qualité de vie en général ainsi qu’au pointde vue professionnel. « À l’aide dequestionnaires et d’une entrevue psychologiqueavec ces patients, nouspouvons détecter d’importants symptômesd’anxiété ou un trouble panique.Nous pouvons aussi observerl’impact de cette anxiété sur l’emploiet le revenu, <strong>la</strong> maîtrise des symptômes,<strong>la</strong> qualité de vie ainsi que l’utilisationdes services de santé commeles urgences, les hospitalisations, les visites chez le médecin,etc. » Depuis 2007, Hélène Favreau a administré180 questionnaires aux fins de sa recherche. Elle procèdeactuellement au dépouillement des données.<strong>Des</strong> retombées prometteuses« Une étude récente démontre que 82 % des demandesd’invalidité de courte durée et 72 % de celles <strong>qui</strong> sontde longue durée sont reliées à des problèmes de santémentale ou de stress au travail, d’où l’intérêt d’approfondirles connaissances sur ce sujet. Les résultats dema recherche contribueront directement à évaluer <strong>la</strong>prévalence et l’impact de l’anxiété chez les travailleursdirigés à une évaluation d’asthme relié au travail, expliqueHélène Favreau. Mes travaux permettront d’améliorer<strong>la</strong> santé mentale, le traitement et le suivi destravailleurs <strong>qui</strong> présentent des symptômes pouvantfaussement être attribués à de l’asthme. Ce<strong>la</strong> faciliteraleur retour au travail ou encore, leur réorientation dansun nouvel environnement de travail et améliorera leurqualité de vie. »Un avenir dans <strong>la</strong> recherche ?« Pour l’instant, je vais terminer mon doctorat.Par <strong>la</strong> suite, <strong>la</strong> recherche et l’intervention clinique, entant que psychologue, m’attirent autant l’une quel’autre. » PTBenoit FradetteLe programme de bourses de l’IRSSTHélène Favreau est une des étudiantes <strong>qui</strong> bénéficient duprogramme de bourses d’études supérieures de l’IRSST. Celui-cis’adresse à des candidats de 2 e et de 3 e cycle ou de niveaupostdoctoral dont le programme de recherche porte spécifiquementsur <strong>la</strong> prévention des accidents du travail et des ma<strong>la</strong>diesprofessionnelles ou sur <strong>la</strong> réadaptation des travailleurs <strong>qui</strong> ensont victimes.Un programme de bourse thématique existe également pourles champs de recherche É<strong>qui</strong>pements de protection et Sécuritédes outils, des machines et des procédés industriels.Pour obtenir des informations sur le programme de boursesde l’IRSST, on peut téléphoner au 514 288-1551, écrire à :bourses@irsst.qc.ca ou visiter le site www.irsst.qc.ca.28 Prévention au travail Été 2010
NouvellespublicationsToutes ces publications sontdisponibles gratuitement enversion PDF dans notre siteWeb. Elles peuvent aussi êtrecommandées par <strong>la</strong> poste.Les prix indiqués comprennent<strong>la</strong> taxe et les frais d’envoi.Identification de prioritésd’intervention à partir del’interprétation des résultatsdes analyses de substanceschimiques produites à l’IRSSTen 2006OSTIGUY, C<strong>la</strong>ude, CatherineNADEAU, Gilles BENSIMON,Marc BARIL, Rapport B-076,55 pages, 8,40 $.L’IRSST publie régulièrement unbi<strong>la</strong>n des résultats de l’analysedes échantillons de substanceschimiques que les intervenantsdu réseau de <strong>la</strong> prévention recueillentdans les entreprisesquébécoises. Pour les chercheurset les intervenants en SST, cespublications constituent unesource d’information pour déterminerdes besoins de rechercheet des priorités d’intervention enmilieu de travail en ce <strong>qui</strong> concerneles substances chimiques. Ellespermettent de dégager certainesgrandes tendances et de désignerles situations potentiellementles plus à risque parmi les entreprisesdu Québec où des prélèvementsd’air ont été réalisés.Les trois bi<strong>la</strong>ns publiés récemmentindiquent les substancesque les <strong>la</strong>boratoires de l’Institutont analysées le plus fréquemmentselon les années en question,les groupes industriels pourlesquels ces analyses ont étéréalisées le plus souvent, lessubstances trouvées en plus fortesconcentrations dans chacund’eux et, finalement, un tableaude ces groupes industriels.estimer <strong>la</strong> capacité d’endurancedes muscles dorsaux, alors quele deuxième sert à quantifier <strong>la</strong>réponse réflexe à l’étirement. Ilsse sont tous deux avérés sensiblesaux différences entre les sexes.Cependant, seul le test d’endurancel’a été à <strong>la</strong> présence d’unelombalgie chronique.Les auteurs croient qued’autres travaux sont nécessairespour bien valider chacun de cestests. Un plus grand échantillonde sujets permettrait d’évaluerl’existence d’interactions entre lesexe et <strong>la</strong> présence d’une lombalgie,ainsi que de faire des adaptationsselon certaines variablesconfondantes définies dans cetteétude. Ultimement, une fois cestests perfectionnés, ils améliorerontle suivi de l’évolution despatients en réadaptation ainsique <strong>la</strong> validation des modalitésd’intervention spécifiques pourrenverser leurs atteintes particulièreset pour se prononcer plussûrement sur leur retour autravail.l’é<strong>la</strong>boration de stratégies decontrôle efficaces en matièrede réduction des émissions depolluants atmosphériquesnocifs.Les auteurs de ce rapport ontévalué l’utilisation des différentsmodèles de dispersion atmosphériqueapprouvés par l’EnvironmentalProtection Agency(EPA) pour modéliser celle deseffluents de cheminées, afin dedéterminer leur concentrationà divers endroits des toits d’oùils proviennent. Les résultatsont été comparés à ceux quel’on obtient en soufflerie et surle terrain. Les auteurs dressentun bi<strong>la</strong>n des avantages et desinconvénients des modèles dedispersion étudiés selon chaqueconfiguration et suggèrent celui<strong>qui</strong> est le mieux adapté à chaquesituation.AussiLes risques de troublesmusculo-squelettiquesaux membres supérieursdans le secteur des servicesà l’automobile – ÉtudeexploratoireMARCHAND, Denis, DenisGIGUÈRE, Rapport R-645,107 pages, 12,60 $.Identification de prioritésd’intervention à partir del’interprétation des résultatsdes analyses de substanceschimiques produites à l’IRSSTen 2007OSTIGUY, C<strong>la</strong>ude, SimonMORIN, Catherine NADEAU,Gilles BENSIMON, Marc BARIL,Rapport B-077, 50 pages, 8,40 $.Identification de prioritésd’intervention à partir del’interprétation des résultatsdes analyses de substanceschimiques produites à l’IRSSTen 2008OSTIGUY, C<strong>la</strong>ude, RicardoCORDEIRO, Gilles BENSIMON,Marc BARIL, Rapport B-078,51 pages, 8,40 $.Évaluation de <strong>la</strong> validité deconstruit de tests portant surl’endurance et les réponsesréflexes des muscles du doschez des sujets présentantune lombalgie chronique –Programme REPAR-IRSSTLARIVIÈRE, Christian, RobertFORGET, Martin BILODEAU,Roger VADEBONCOEUR,Rapport R-642, 58 pages, 8,40 $.Le diagnostic et le traitementefficaces des travailleurs souffrantd’une lombalgie chroniquere<strong>qui</strong>èrent l’application de mesuresobjectives de leurs déficiencesou de leur fonction. Lesauteurs de ce rapport ont étudié<strong>la</strong> validité prédictive de deuxtests biomécaniques d’évaluationde certaines déficiences lombairesen regard de <strong>la</strong> présence ou nond’une lombalgie chronique. Lepremier test est utilisé pourÉvaluation analytiquede <strong>la</strong> dispersion des émissionsde cheminées de toit surles bâtimentsSTATHOPOULOS, Ted, HajraBODHISATTA, Ali BAHLOUL,Rapport R-643, 94 pages, 12,60 $.L’introduction sporadiqued’émissions polluantes dans lesbâtiments par les prises d’airneuf représente une des principalescauses de <strong>la</strong> mauvaisequalité de l’air de certains lieuxde travail, ce <strong>qui</strong> peut nuire à <strong>la</strong>santé des personnes, particulièrementcelles <strong>qui</strong> travaillentdans des <strong>la</strong>boratoires ou desétablissements hospitaliers. <strong>Des</strong>modèles informatiques sontcouramment utilisés pour déterminersi des instal<strong>la</strong>tions industriellesexistantes ou projetéessont ou seront conformes à <strong>la</strong>norme nationale américaine dequalité de l’air ambiant (NAAQS)ou aux normes d’autres pays.Ces modèles favorisent en outreLes nanoparticules desynthèse – Connaissancesactuelles sur les risqueset les mesures de préventionen SST – 2 e éditionOSTIGUY, C<strong>la</strong>ude, BrigitteROBERGE, Catherine WOODS,Brigitte SOUCY, Rapport R-646,159 pages, 15,75 $.Effets des picsde concentration sur<strong>la</strong> neurotoxicité du styrènedans l’industrie du p<strong>la</strong>stiquerenforcé de fibre de verre –Phase IIVYSKOCIL, Adolf, NaïmaEL MAJIDI, Ross THUOT,Charles BEAUDRY, GinetteCHAREST-TARDIF, Robert TARDIF,France GAGNON, BernadetteSKA, Alice TURCOT, DanielDROLET, Elmira ALIYEVA, C<strong>la</strong>udeVIAU, Rapport R-640, 119 pages,12,60 $.Marjo<strong>la</strong>ine ThibeaultÉté 2010Prévention au travail29
Rechercheà l’IRSSTRecherchesen coursTroubles musculosquelettiquesDéveloppement d’uneméthode ambu<strong>la</strong>toirepour estimer les chargementsau dos : intégrationde <strong>la</strong> cinématique du doset de l’électromyographiede surface(0099-6500)Les maux de dos constituent unthème de recherche privilégié,car les mécanismes exacts <strong>qui</strong>les provoquent sont mal connus.Les chargements aux dos et leurcumul peuvent révéler des informationsimportantes pourmieux comprendre l’apparitionde ces maux et les moyens de lesprévenir.L’objectif de cette étude estde concevoir et de valider uneméthode ambu<strong>la</strong>toire pour estimerles chargements au dos enintégrant le signal électromyographiqued’un minimum demuscles dorsaux à l’informationcinématique obtenue grâce audosimètre de posture que le<strong>la</strong>boratoire de biomécaniquede l’IRSST a créé récemment.É<strong>qui</strong>pe de recherche : A<strong>la</strong>in Delisle,Université de Sherbrooke ; AndréP<strong>la</strong>mondon, IRSST ; Denis Gagnon,Université de Sherbrooke ;Christian Larivière, IRSST ; FrançoisMichaud et Jean Rouat, Universitéde SherbrookeLa manutention chez lesfemmes : un regard du pointde vue biomécaniqueet ergonomique(0099-8020)Les manutentionnaires courentdes risques très élevés de seblesser au dos. Pour trouver dessolutions à ce problème chronique,l’IRSST subventionne uneprogrammation de recherchesur <strong>la</strong> manutention. La premièreétude <strong>qui</strong> en est issue a comparéles méthodes de travail de manutentionnairesexperts et novicesmasculins, pour ainsi dégagerdes principes de manutention<strong>qui</strong> serviront de guide à l’é<strong>la</strong>borationd’un programme de formation.Le présent projet étudierales stratégies de femmes manutentionnairespour comprendrece <strong>qui</strong> différencie leurs modesopératoires de ceux des hommes.Ses résultats serviront à mieuxadapter les programmes deformation en fonction du sexe.É<strong>qui</strong>pe de recherche : AndréP<strong>la</strong>mondon et Denys Denis, IRSST ;A<strong>la</strong>in Delisle, Université deSherbrooke ; Marie St-Vincent,IRSST ; Denis Gagnon, Universitéde Sherbrooke ; Christian Larivièreet Iuliana Nastasia, IRSSTBruit et vibrationsDéveloppement d’outilset de méthodes pour mieuxévaluer et améliorer<strong>la</strong> protection auditiveindividuelle des travailleurs(0099-7630)Environ un demi-million detravailleurs québécois sontexposés quotidiennement à desniveaux de bruit susceptibles deprovoquer des problèmes d’auditionet certains d’entre eux sontaux prises avec les conséquencesd’une surdité professionnelle.Bien que l’élimination du bruit àsa source soit <strong>la</strong> solution <strong>la</strong> plusefficace, il arrive qu’il soit impossiblede le faire. L’utilisation demoyens de protection auditiveindividuelle est alors nécessaire.Cependant, des problèmessont associés au port de protecteursauditifs, notamment desdifficultés de communication<strong>qui</strong> peuvent devenir un cofacteurde risque d’accidents du travail.Parce qu’il est difficile de choisiret de concevoir un protecteurbien adapté, ces appareilspeuvent ne pas protéger adéquatementl’utilisateur et ainsireprésenter un danger pour sasanté auditive. En raison deleur inconfort, <strong>la</strong> durée du portrecommandée pour limiterl’exposition au bruit n’est pastoujours respectée. Enfin, <strong>la</strong>conception des protecteursrelève souvent de l’empirisme,sans que leur performance etleur confort soient optimisés.L’objectif principal de cetteétude est d’é<strong>la</strong>borer des outils etdes méthodes de mesure pourmieux évaluer les performancesacoustiques des protecteursauditifs et pour les améliorer,tout en intégrant certains paramètres<strong>qui</strong> influent sur le confort.L’étude inclut les trois types deprotecteurs les plus courants :les co<strong>qui</strong>lles, les bouchons et <strong>la</strong>double protection, <strong>qui</strong> consisteen l’utilisation simultanée de cesdispositifs.É<strong>qui</strong>pe de recherche : Franck Sgardet Hugues Nélisse, IRSST ; FrédéricLaville et Yvan Petit, ÉTSContexte de travailet SSTLes coûts des lésionsprofessionnelles :une revue de littérature(0099-8560)Au cours des dernières années,<strong>la</strong> <strong>CSST</strong> a reconnu annuellementprès de 110 000 lésions professionnelles.Ces lésions engendrentdes coûts importants pour l’ensemblede <strong>la</strong> société et, parconséquent, il est important d’enévaluer les incidences économiques.Or, l’IRSST ne disposepas d’outils spécifiques pourprocéder à une telle estimation.L’objectif principal de cetteactivité consiste à réaliser unerevue de <strong>la</strong> littérature scientifiquesur les différentes approcheséconomiques utilisées pourestimer les coûts directs etindirects des lésions professionnelles.Les résultats permettrontd’identifier les types de coûts àconsidérer pour é<strong>la</strong>borer desindicateurs économiques utilesà <strong>la</strong> détermination des prioritésde recherche de l’IRSST.É<strong>qui</strong>pe de recherche : MartinLebeau et Patrice Duguay, IRSSTProjet d’enseignementet d’intégration desapprentissages en gestiondes situations de santéet de sécurité au travail :é<strong>la</strong>boration d’études de cas(0099-8450)La gestion de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong>sécurité du travail occupe unep<strong>la</strong>ce importante dans les entreprises.Dans un contexteéconomique de plus en pluscompétitif, celles-ci doivent encontrôler les coûts, c’est-à-direles cotisations qu’elles versent à<strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, leurs investissementsdans des é<strong>qui</strong>pements de protectionet des mesures préventives,ainsi que les dépenses indirectesliées aux absences prolongées etaux incapacités de leurs travailleurs.Les entreprises constatentque l’imp<strong>la</strong>ntation réussie demesures préventives a des effetsmobilisateurs sur l’implicationdu personnel dans <strong>la</strong> production,sur le contrôle de <strong>la</strong> qualité,l’amélioration du climat de travailet <strong>la</strong> cohésion sociale des é<strong>qui</strong>pes.Toutefois, ce<strong>la</strong> pose de nombreuxdéfis aux gestionnaires.Le but de ce projet est decréer une banque d’études de casde <strong>la</strong> gestion de problèmes deSST <strong>qui</strong> pourra servir d’outilpédagogique pour les étudiantsen gestion des ressources humaines.Les chercheurs croientque l’enseignement de <strong>la</strong> SST etde <strong>la</strong> gestion combinées pourraitêtre utile, d’une part, pour aiguiserle sens des responsabilitésdes futurs gestionnaires enversle bien-être des travailleurs et,d’autre part, pour créer uneculture de <strong>la</strong> SST cohérente avecle développement et <strong>la</strong> productivitédes entreprises.É<strong>qui</strong>pe de recherche : SylvieGravel, Monique Lortie etHenriette Bilodeau, UQÀM30 Prévention au travail Été 2010
Substances chimiqueset agents biologiquesExpositions professionnelleset fonctions reproductivesdes hommes : état desconnaissances(0099-8740)Plusieurs études font état d’unelégère baisse de <strong>la</strong> fertilité chezles hommes durant le siècledernier et diverses raisons ontété évoquées pour l’expliquer.Une étude exploratoire menéeen Estrie, mettant en rapportl’exposition professionnelle et lesproblèmes d’infertilité chez lespatients de <strong>la</strong> clinique de fertilitédu CHUS, a permis d’établir unlien entre ces problèmes et letravail des sujets dans le secteurmanufacturier. Il y aurait ainsilieu d’explorer davantage cettepiste de recherche.L’objectif de cette activité estde réaliser une revue systématiqueet critique des étudesscientifiques existantes sur <strong>la</strong>re<strong>la</strong>tion entre l’exposition professionnelleaux contaminantsréglementés au Québec et <strong>la</strong>fertilité masculine. Cette revuede <strong>la</strong> littérature permettra d’évaluer<strong>la</strong> pertinence d’étudier cetteproblématique et de définir desorientations de recherche.É<strong>qui</strong>pe de recherche : LarissaTakser et Guy<strong>la</strong>in Boissonneault,Université de SherbrookeDéveloppement d’uneméthode d’analyse du quartzdans différentes matricespar diffraction des rayons X(0099-8540)Au Québec, le quartz est un descomposés <strong>qui</strong> causent le plusde décès reliés à l’expositionprofessionnelle aux substanceschimiques. Les responsables dece projet veulent é<strong>la</strong>borer uneméthode d’analyse du quartzdans les matériaux et les poussièresdéposées en milieu detravail, tout en évaluant leslimites d’application de l’outil dequantification Rietveild. Celui-cirend possible <strong>la</strong> déterminationen pourcentage de <strong>la</strong> compositionde chaque substance d’unmé<strong>la</strong>nge.La méthode que l’é<strong>qui</strong>pe desServices et expertises de <strong>la</strong>boratoirede l’IRSST produira permettrade mieux soutenir lesintervenants dans <strong>la</strong> productionde leurs p<strong>la</strong>ns d’intervention enleur fournissant non seulementde l’information sur <strong>la</strong> natured’un mé<strong>la</strong>nge de composés inconnus,mais aussi <strong>la</strong> quantification,en pourcentage, de chacun descomposés inorganiques identifiés,dont le quartz.É<strong>qui</strong>pe de recherche : MartinBeaupar<strong>la</strong>nt, IRSST ; Huu Van Traet Joannie Martin, UQÀML’effet des édifices adjacentssur <strong>la</strong> dispersion des émissionsdes bâtiments : une approchenumérique (CFD) etexpérimentale en soufflerie(0099-7590)Les résultats d’un programmede recherche que l’IRSST etl’Université Concordia ont entreprisen 1996 démontrent quel’utilisation de hautes cheminéesne garantit pas <strong>la</strong> dilution adéquatedes émissions des fumées.La présence de bâtiments adjacentsinfluence leur dispersion, etces émissions peuvent contaminerles prises d’air neuf.Ce projet étudiera <strong>la</strong> dispersionde l’air contaminé provenantde cheminées <strong>qui</strong> pourraitêtre réintroduit à l’intérieur àcause des bâtiments avoisinants.Dans un premier temps, les chercheursanalyseront ses effets àl’aide de simu<strong>la</strong>tions numériques(computational fluid dynamicsou CFD) et d’essais expérimentauxen soufflerie. Ils établirontensuite un nouveau modèle pourprédire les dispersions des émissionsdes cheminées, lequel aiderales ingénieurs en mécaniquedu bâtiment à concevoir denouveaux édifices afin d’éviterou de réduire les risques decontamination des prises d’airneuf en milieu urbain.É<strong>qui</strong>pe de recherche : Ali Balhoul,IRSST ; Ted Stathopoulos,Université ConcordiaRéadaptationau travailÉ<strong>la</strong>boration d’un guided’évaluation de <strong>la</strong> margede manœuvre en situationde travail, pour une clientèleprésentant des incapacitésprolongées d’originemusculo-squelettique(0099-7580)Au Canada, un grand nombre detravailleurs subissent des blessuresmusculo-squelettiques <strong>qui</strong> les empêchentde travailler pendant delongues périodes, ce <strong>qui</strong> entraîned’importants coûts humains etfinanciers. De plus, l’absentéismenuit considérablement à <strong>la</strong> productivitédes entreprises canadiennes.Un programme de retourprogressif au travail, dont l’efficacitéa été démontrée, permet defaciliter <strong>la</strong> réintégration de cespersonnes en emploi. Malgré ceprogramme, il est difficile pourles cliniciens de décider de l’écartacceptable entre les capacités del’individu et les exigences de satâche, pour faciliter un retour autravail le plus durable et le plussain possible.Les chercheurs é<strong>la</strong>borerontun outil pour aider les cliniciensà évaluer <strong>la</strong> marge de manœuvredes travailleurs au cours d’unprogramme de retour progressifau travail. Ils le testeront ensuiteauprès d’un petit nombre de clinicienset de travailleurs pour enévaluer les forces et les faiblesses.Cet outil aidera les travailleurs enfacilitant leur retour en emploi ;les entreprises, en leur permettantde bénéficier ainsi d’un employé<strong>qui</strong> revient au travail en meilleuresanté, et les cliniciens en leurfournissant un nouvel instrumentpour améliorer leur pratique.Enfin, cette étude contribuera àaméliorer les services offerts enmatière de réadaptation au travail.É<strong>qui</strong>pe de recherche : Marie-JoséDurand, Université de Sherbrooke ;Nicole Vézina, UQÀM ; PatrickLoisel, Université de SherbrookeSécurité des outils,des machines et desprocédés industrielsRisques en santé eten sécurité au travailet stratégies de préventionpour les travailleurs et lesentreprises du secteur éolien(0099-8690)L’industrie éolienne est en émergenceau Québec. On estimequ’en 2014, plus de 1 000 personnestravailleront à tempsplein dans l’exploitation et l’entretiendes parcs éoliens québécoiset que 2 000 autres yinterviendront occasionnellement.Le travail en hauteur, dansdes espaces clos, l’isolement,l’absence de services de secoursà proximité, les exigences physiquesde l’esca<strong>la</strong>de des tours, letravail par très basses températureset les risques d’électrocutionconstituent autant de défispour <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité dansce secteur d’activité.Ce projet analysera les accidentset les incidents critiquessurvenus dans ce domaine demême que les méthodes et lesp<strong>la</strong>ns d’action existants dans lesparcs éoliens du Québec et ailleursdans le monde. Les chercheurscréeront une base dedonnées sur les risques typiquesauxquels les travailleurs du secteursont exposés. Une attentionparticulière sera portée au cadenassage,à l’isolement et auxspécificités climatiques québécoises.É<strong>qui</strong>pe de recherche : AdrianIlinca et Jean-Louis Chaumel,UQAR ; Laurent Giraud, IRSSTMaura TomiÉté 2010Prévention au travail31
Les accidentsnous parlentÉjecté d’unchariot élévateurUn cariste<strong>qui</strong> ne portepas de ceinturede sécuritéest éjectéde son siège.Que s’est-il passé ?Le 16 février 2009, des travailleurss’activent dans une cour extérieure d’uncentre de transfert spécialisé dans letraitement des matières dangereuses etnon dangereuses, li<strong>qui</strong>des ou solides. Lacour extérieure comprend une zoned’entreposage de barils et autres contenantsvides, une autre différents produitsde traitement de barils et unedernière des conteneurs de déchets etde récupération du métal. Afin de contenirun éventuel renversement de li<strong>qui</strong>de,<strong>la</strong> cour est constituée de plusieurs pentesorientées de manière à dirigerl’écoulement vers un puisard central etdes murets de rétention sont situés àdifférents endroits. Un panneau indiqueque <strong>la</strong> vitesse maximale permise est de5 km/h. Ce soir-là, un des travailleursdoit, entre autres tâches, jeter une partiedes contenants cubiques vides empilésau fond de <strong>la</strong> cour dans l’un des conteneursà déchets. Le travailleur réduit levolume des contenants en les écrasantà l’aide de <strong>la</strong> chargeuse et les transporteensuite jusqu’au conteneur à déchetsavec un chariot élévateur à fourches. Ildépose le contenant dans le conteneuret retourne en prendre un autre. Il faitainsi plusieurs allers-retours entre leconteneur à déchets et le fond de <strong>la</strong>cour, à une vitesse moyenne de 14 km/h.Soudain, le pneu avant gauche du chariotélévateur entre en contact avec unep<strong>la</strong>que de g<strong>la</strong>ce située devant le muretde rétention, derrière le conteneur à déchets.Cette p<strong>la</strong>que sert en quelque sortede <strong>rampe</strong> d’accès au chariot et permetà <strong>la</strong> roue avant gauche du chariot demonter sur le muret. Le chariot se renversesur le côté droit et le travailleur,<strong>qui</strong> ne porte pas de ceinture de sécurité,est éjecté de son siège. Le toit du chariotlui sectionne le cou…Qu’aurait-il fallu faire ?La vitesse de dép<strong>la</strong>cement du chariot,jumelée à <strong>la</strong> présence de g<strong>la</strong>ce devant lemuret, ont permis au chariot de montersur le muret, provoquant son renversement.Le travailleur ne respectait pas <strong>la</strong>limite de vitesse fixée à 5 km/h. Un p<strong>la</strong>ndétaillé de <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion des chariotsélévateurs dans <strong>la</strong> cour extérieure, ycompris une détermination des risques,doit être établi. L’employeur doit égalementé<strong>la</strong>borer et appliquer un p<strong>la</strong>n desupervision lié à <strong>la</strong> conduite sécuritairedes chariots élévateurs.Le danger de renversement lors de <strong>la</strong>conduite d’un chariot est connu. Il estd’ailleurs mentionné au Règlement sur<strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité du travail que lechariot élévateur doit être muni d’undispositif de retenue afin d’éviter que lecariste ne soit écrasé par sa structure encas de renversement. La ceinture desécurité est le moyen le plus souventutilisé sur les chariots élévateurs. Évidemment,pour être efficace, ce dispositifdoit être maintenu en bon état et êtreutilisé.Un programme d’accueil et de formationassure aux nouveaux travailleursqu’ils ont toute l’information nécessairepour comprendre et accomplir leurs tâchesefficacement et en toute sécurité.En ce sens, le Règlement sur <strong>la</strong> santé et<strong>la</strong> sécurité du travail exige <strong>la</strong> formationdes caristes. De plus, <strong>la</strong> supervision doitêtre attentive pour s’assurer que lesbonnes règles de conduite sont mises enpratique. PTJulie Mé<strong>la</strong>nçonNotre personne-ressource : André Turcot, ingénieuret chef d’é<strong>qui</strong>pe à <strong>la</strong> Direction générale de<strong>la</strong> prévention-inspection et du partenariat de <strong>la</strong><strong>CSST</strong>.Illustration : Ronald DuRepos32 Prévention au travail Été 2010
Santéet sécurité en imagesl Les risques psychosociaux au travailCote DV-000354 – Durée 22 minutesUn directeur assaille son employée de demandes incessantes.<strong>Des</strong> travailleurs isolent un collègue. Les opinionsexprimées par une chef d’é<strong>qui</strong>pe sont systématiquement discréditéesen réunion par son supérieur. Ces comportementsconstituent tous des cas de harcèlement moral. C’est ce quenous indique ce film <strong>qui</strong> prend <strong>la</strong> forme d’un reportagetélévisé dans lequel un animateur interroge deux avocatsspécialisés dans les cas de harcèlement psychologique autravail.Plusieurs thèmes sont abordés : définition des risquespsychosociaux et conséquences sur <strong>la</strong> santé du travailleur,définition du harcèlement moral au travail (agissementrépétitif ayant des conséquences sur l’état de santé mentaledu travailleur), harcèlement vertical et horizontal, conséquencespsychologiques et pathologiques pour <strong>la</strong> victime,harcèlement inconscient, différence entre <strong>la</strong> notion de harcèlementet d’ambiance de travail dégradée, causes de l’augmentationde <strong>la</strong> souffrance au travail, moyens de prévention.<strong>Des</strong> reconstitutions de scènes de harcèlement en entrepriseet deux entrevues de victimes illustrent les propos des spécialistes.Une production de A.G.E.s n La chaîneCote DV-000356 – Durée 19 minutesQu’a-t-il bien pu se passer pour que Sophie, responsable destravaux ménagers sur un chantier de construction, soit grièvementblessée après avoir été heurtée par une palette soulevéepar une grue ? Le responsable du chantier tente dereconstituer l’enchaînement de faits anodins ayant mené à l’accidentavec des travailleurs : un livreur <strong>la</strong>isse une chaîne desécurité ouverte, le maître compagnon délègue le déchargementà un jeune ouvrier, une palette est déchargée légèrementen dehors de <strong>la</strong> zone de prélèvement de <strong>la</strong> grue, etc.Tous ces éléments, additionnés à bien d’autres, auront degraves conséquences. C’est ce que révèle l’arbre des causes decet accident du travail. Ce film se veut avant tout un outild’analyse des causes d’un accident du travail par l’emploide l’arbre des causes. Il est accompagné d’un dessin de cetarbre <strong>qui</strong> renvoie à plusieurs séquences du film.Une production de OPPBTBs n Never assume: electrical safety seriesCote DV-000371 – Durée 60 minutesÉnergique et enthousiaste, Jimmy nous accompagne dans lescinq sections de ce DVD sur <strong>la</strong> sécurité électrique. Il nous expliqued’abord les complémentarités des normes OSHA, NEC,IEEE et NEC en sécurité électrique. Notre guide parvient àrendre compréhensible cet enchevêtrement réglementaire etnormatif. Les deuxième et troisième sections donnent unaperçu des principales mesures de sécurité électrique à observersur un chantier de construction ou dans un bâtiment industriel.Notre guide nous indique les principaux risquesassociés au travail sur les instal<strong>la</strong>tions électriques (choc et arcélectrique), et comment les prévenir (mise hors tension desé<strong>qui</strong>pements, qualification du personnel, évaluation et gestiondes risques, é<strong>qui</strong>pement de protection personnelle, consignesgénérales de sécurité).Dans <strong>la</strong> quatrième partie, Jimmy et son collègue Karl expliquentl’importance de mettre hors tension tout matériel électriqueavant le début des travaux. Le choix du voltmètre, lesconséquences des erreurs de prise de mesures et les étapes de<strong>la</strong> vérification de <strong>la</strong> mise hors tension sont les aspects abordés.Finalement, <strong>la</strong> cin<strong>qui</strong>ème section souligne <strong>la</strong> nécessité de bienp<strong>la</strong>nifier les travaux électriques.À noter, ce DVD n’est offert qu’en version ang<strong>la</strong>ise. Uneproduction de Electrical Safey Foundation International. PTAnne-Marie PicardModalités d’emprunt à l’audiovidéothèque de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>Les documents annoncés peuvent être empruntés gratuitementà l’audiovidéothèque de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>. La durée du prêt estd’un mois. L’emprunteur peut passer prendre les documentsou les recevoir par courrier. La <strong>CSST</strong> paie les frais d’expédition,mais les frais de retour sont à <strong>la</strong> charge de l’emprunteur. Levisionnement peut aussi se faire sur p<strong>la</strong>ce.Vous pouvez communiquer avec nous du lundi au vendredi,de 8 h 30 à 16 h 30.1199, rue De Bleury, 4 e étage, Montréal (Québec) H3B 3J1Tél. 514 906-3760 ou 1 888 873-3160 • Téléc. 514 906-3820@ documentation@csst.qc.cawww.centredoc.csst.qc.cal Information grand publics Information spécialiséen Avec document ou guide d’accompagnementÉté 2010 Prévention au travail 33
Photo : Robert Etcheverryque si <strong>la</strong> marge d’erreur permise parle surf est beaucoup plus faible quecelle autorisée par un chariot élévateur,les lois physiques <strong>qui</strong> s’appliquent auxdeux sont rigoureusement les mêmes.En outre, il est probable qu’une chutesur le béton d’un entrepôt soit potentiellementplus dangereuse que dansl’océan…Mais ce <strong>qui</strong> différencie le surfeurdu cariste, c’est que le surfeur peut seforger une image mentale de <strong>la</strong> stabilitéde sa p<strong>la</strong>nche, en expérimentantses limites à l’occasion des chutes qu’ilmultiplie avec p<strong>la</strong>isir. Le cariste, lui,n’a pas <strong>la</strong> possibilité d’expérimenter leslimites de son chariot dans toutes lessituations extrêmes… heureusement !Les pièges de <strong>la</strong> formationLa sensibilisation et <strong>la</strong> formation théoriquevisent à pallier ce manque d’expérimentationen enseignant aux futurscaristes <strong>la</strong> marge d’erreur <strong>qui</strong> leur estpermise. Mais Denis Rancourt met engarde contre les pièges de <strong>la</strong> formation.Les concepts physiques <strong>qui</strong> y sontexpliqués sont assez difficiles à comprendre.En outre, les modes de renversementsont nombreux en statiquecomme en dynamique et sont parfoisinattendus. Les simu<strong>la</strong>tions démontrentqu’un chariot peut ne pas se renverserLe cariste porte saceinture de sécuritéet l’appuie-bras estabaissé, bien en p<strong>la</strong>ce.dans une situation <strong>qui</strong>paraît extrême (vitesseet rotation) ou se renverserdans une situation<strong>qui</strong> paraît anodine (àl’arrêt).Pour Denis Rancourt,l’enseignement des facteursde risques est doncplus approprié que celuide <strong>la</strong> dynamique complexedes chariots élévateurs.Une formationadaptée doit permettreau cariste de déterminerles facteurs de risque etd’être conscient de leurseffets croisés pour unemeilleure prévention.Mais le chercheur insistesur le fait qu’on nepeut prévenir tous les renversements,ce <strong>qui</strong> justifie l’exigence de protection.Encore faut-il que <strong>la</strong> protectionsoit efficace.Denis Rancourt affirme queles prescriptions des manufacturiersen cas de renversement telles que secaler les pieds ou se tenir au vo<strong>la</strong>nt sontquasiment impossibles à mettre enpratique par les caristes en raison dupeu de temps qu’un renversementleur <strong>la</strong>isse. La consigne de ne passauter est également inutile, car ensituation de stress, le cariste peutavoir ce réflexe dangereux.Au-delà des consignes, il fautdonc un dispositif <strong>qui</strong> permette d’éviterl’expulsion du cariste en cas derenversement. C’est à l’employeur querevient <strong>la</strong> responsabilité du choix dudispositif en sachant encore une foisqu’il a une obligation de résultat.La ceinture : seul dispositifde protection eff icace à 100 %Selon Denis Rancourt, <strong>la</strong> recherche aétabli que les dispositifs tels que lesportes gril<strong>la</strong>gées, les cabines ferméesDenis Rancourt, professeur àl’École de génie de l’Universitéde Sherbrooke et Patricia Vega, del’ASP Secteur fabrication d’é<strong>qui</strong>pementde transport et de machines.Photo : Denis BernierLe seul dispositifà offrir uneprotectionefficace à 100%,à peu de frais,de surcroît, est <strong>la</strong>ceinture de sécurité.ou les sièges enrobant offrent tous unecertaine protection contre un type derisque ou un autre, mais pas de protectionglobale. Le seul dispositif à offrirune protection efficace à 100 %, à peude frais, de surcroît, est <strong>la</strong> ceinture desécurité.En outre, Denis Rancourt insiste surle fait qu’il n’a jamais vu d’étude établissantque <strong>la</strong> ceinture de sécurité peutnuire à <strong>la</strong> productivité.En conclusion, Patricia Vega insistesur le fait que les employeurs <strong>qui</strong> optentpour des dispositifs inefficaces sontfautifs dans <strong>la</strong> mesure où ils sont censésêtre informés des études re<strong>la</strong>tivesaux dispositifs de protection. D’autantplus qu’en consultant les manuels d’utilisationde <strong>la</strong> majorité des chariotsélévateurs, on voit que le port de <strong>la</strong> ceinturey est recommandé, même si onutilise un autre dispositif de retenue.Dans ces conditions, <strong>la</strong> ceinture sembleêtre actuellement <strong>la</strong> seule option à retenir.Les caristes ne sont pas des surfeurs,il leur faut une ceinture. PTÉté 2010Prévention au travail35
Photo : François Larivièrevaient peser jusqu’à 32 kg. L’innovationprimée consistait en une nouvelle machinecapable d’enrouler les tresses etd’acheminer les rouleaux vers un chariotsans intervention manuelle.En 2009, l’innovation concernait unautre poste de travail où les risquesde troubles musculo-squelettiques etde coupures étaient élevés.Agir sur <strong>la</strong> pyramide des accidentsCette année, le projet soumis au Prix innovationne visait plus un seul poste detravail, mais tous les comportements ettoutes les situations à risque au sein del’établissement. L’entreprise a en effetmis au point une méthode de collectePhotos : Garlockd’information originale portant sur lesquasi-accidents <strong>qui</strong> n’auraient pas encoreété pris en compte. Elle a distribuéun petit formu<strong>la</strong>ire à tous les travailleursde l’usine en leur expliquantcomment ils pouvaient s’en servir poursignaler les conditions, les comportementsou les événements susceptiblesde provoquer un accident. Ce formu<strong>la</strong>ire,<strong>qui</strong> combine les approches de typecomportemental et le facteur de risqueR3, permet de détecter les situations oules conditions dangereuses jusque-lànon définies et de donner priorité auxcorrectifs à apporter. La participationdes travailleurs a été remarquablepuisqu’à peine un an après <strong>la</strong> mise enservice de ce dispositif, pas moins de236 fiches ont déjà été remplies.L’objectif visé par <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce dece dispositif baptisé RSVP, c’est-à-dire« Renforcement rapide des valeurs sécuritaires», est bien sûr <strong>la</strong> réduction maximaleau bas de <strong>la</strong> pyramide desaccidents. Cette proposition de Garlockau Prix innovation témoigne bien de <strong>la</strong>culture de <strong>la</strong> sst <strong>qui</strong> règne dans l’entreprise,mais une entrevue avec PierreBarnabé, le responsable sst de l’usine,permet de constater rapidement qu’ellene constitue que <strong>la</strong> partie émergée del’iceberg.La sécurité dans <strong>la</strong> tête et le coeur« Lorsque j’ai été embauché en 2002, sesouvient Pierre Barnabé, on m’a chargéd’imp<strong>la</strong>nter une véritable culture de <strong>la</strong>sécurité dans l’usine. Il faut dire quedepuis 2002, l’usine Garlock deSherbrooke était devenue une filiale dugroupe américain EnPro, <strong>qui</strong> accordeune attention particulière à <strong>la</strong> sécuritédans ses instal<strong>la</strong>tions. Une des premièreschoses que j’ai faite en tant que responsablede <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécuritépour Garlock, se rappelle M. Barnabé,a été d’aller visiter les instal<strong>la</strong>tions deBay Minette en A<strong>la</strong>bama, nommées en2006 parmi les 10 compagnies les plussécuritaires des États-Unis par le OccupationalHazards Magazine et leader dugroupe pour <strong>la</strong> sst. Ce que j’ai constatélà-bas, c’est que <strong>la</strong> sécurité était véritablementdans <strong>la</strong> tête et dans le cœur detous les travailleurs. À Sherbrooke, c’estaussi ce que nous visons, nous voulonsque chacun ait toujours <strong>la</strong> sécurité entête, qu’elle soit complètement intégrée», précise encore Pierre Barnabé.Au-delà de <strong>la</strong> participation annuelleau Prix innovation de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, considérécomme un moyen d’associer lestravailleurs et de valoriser leur poste detravail, Garlock déploie donc une panoplied’outils pour sensibiliser tous lestravailleurs à <strong>la</strong> sst au sein de l’usine.« Tous les travailleurs, expliquePierre Barnabé, reçoivent <strong>la</strong> formationDe nombreuses rencontresportant sur <strong>la</strong> sécurité sontorganisées chez Garlock.Safe Start, programme de formationd’une durée de deux heures axé sur lescomportements sécuritaires et l’autoévaluationdes comportements à risque. »De plus, chaque mois Pierre Barnabése dép<strong>la</strong>ce directement dans un servicede l’usine avec un appareil électroniquepour diffuser sept minutes de sst consacréesà des sujets d’intérêt tels que <strong>la</strong>protection auditive, <strong>la</strong> conduite des chariotsélévateurs ou <strong>la</strong> mécanique enzone sécurisée.« En outre, ajoute M. Barnabé, pourbien marquer l’importance que Garlockaccorde à <strong>la</strong> sst et pour y associer pleinementchaque travailleur, nous consacronsdeux heures pleines à <strong>la</strong> sst lepremier jour de chaque année de travail.Cette année, le 5 janvier 2010, unepartie de ce temps a été consacrée àÉté 2010Prévention au travail37
exposer nos objectifs majeurs pour l’annéeen matière d’espaces clos, de cadenassageet de sécurité des machines. Parailleurs, tous les sa<strong>la</strong>riés ont été invitésà signer un Safety pledge, c’est-à-dire unengagement personnel en faveur de <strong>la</strong>santé, de <strong>la</strong> sécurité et de l’environnement».Garlock a également adopté une procédureen cas d’accident <strong>qui</strong> s’intègredans cette stratégie comportementale.Si un événement en sst a lieu et nécessitedes soins légers à l’intérieur del’usine, une enquête interne est systématiquementmenée et des actions préconisées.S’il survient un événement plusgrave, de type « enregistrable » <strong>qui</strong> nécessitedes soins plus poussés, <strong>la</strong> personneblessée est automatiquementaccompagnée au centre de soins par uncadre de l’entreprise. De plus, le présidentde Garlock, <strong>qui</strong> se trouve à Palmyra dansl’État de New York, doit être informé del’accident dans les 24 heures et un p<strong>la</strong>nd’action correctif lui est soumis. Parailleurs, l’activité de l’usine est immédiatementstoppée pour permettre àun major safety stand on destiné àconscientiser les travailleurs. Dans cecas, c’est Pierre Barnabé ou ChristianLauzier, le directeur de l’usine, <strong>qui</strong>s’adressent aux travailleurs.Enfin, si un accident entraîne uneperte de temps, c’est le président dugroupe EnPro <strong>qui</strong> doit en être informé.Le renforcement positifSi <strong>la</strong> haute direction de Garlock est informéedes événements survenus dansl’usine quant à <strong>la</strong> sst, elle ne manquepas non plus de souligner et de récompenserles réalisations. « Chaque année,explique Pierre Barnabé, un PresidentSafety Award est décerné à un groupede l’usine <strong>qui</strong> n’a connu aucune pertede temps en raison d’un accident etaucun événement enregistrable. Les travailleursde l’usine <strong>qui</strong> le remportent reçoivent<strong>la</strong> visite du président du groupeet se voient offrir le BBQ et des blousons.Nous avons déjà remporté ce prixdeux fois, et ça a été bien apprécié ! »,se félicite encore M. Barnabé. « Nousréfléchissons aussi à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ced’autres incitatifs tels que <strong>la</strong> remise degros prix une ou deux fois par annéeaux travailleurs <strong>qui</strong> se seraient le plusdistingués en matière de sst », ajoutet-il.De nouveaux projetsCe nouveau projet viendrait s’ajouter àdeux chantiers majeurs engagés cetteannée par Garlock : les certificationsLa haute direction de Garlock souligne et récompense les réalisationsen santé et sécurité du travail dans l’usine.Photos : GarlockLors d’un BBQ organisé en 2006,alors qu’un groupe de l’usinea remporté le President SafetyAward.OSHAS 18001 et ISO 14001. M. Barnabéentend conduire les projets environnementauxet sst de concert non seulementparce qu’il est responsable à <strong>la</strong> foisde l’environnement et de <strong>la</strong> sst, maissurtout parce qu’il est de plus en plusconvaincu que ces dimensions s’accordentparfaitement ensemble. « Depuisque nous avons installé un mur so<strong>la</strong>iredans l’usine, explique-t-il, de façon quel’air rentrant dans l’usine en hiver soitréchauffé, nous faisons un gain environnemental(réduction du coût de l’énergie),mais également en sst (réductiondes inconvénients liés aux courantsd’air). C’est <strong>la</strong> même chose lorsquenotre projet de luminaires permet deconsommer moins d’électricité tout endiffusant un meilleur éc<strong>la</strong>irage dansl’usine. »« Si nous parvenons à obtenir lesdeux certifications, précise toutefoisPierre Barnabé, nous serons certainement<strong>la</strong> première du groupe EnProIndustries à les détenir. En outre,ajoute-t-il encore, comme je suis égalementresponsable des achats pourl’usine, je suis en mesure d’influencernos fournisseurs sur les questions de <strong>la</strong>sst et de l’environnement et il est certainque j’évalue aussi leurs performances dansces domaines. Pour nous, c’est à <strong>la</strong> fois unmoyen de transmettre notre culture et deremplir notre rôle de bon citoyen. »Chose certaine, si Pierre Barnabé nepeut consacrer tout son temps chezGarlock à <strong>la</strong> sst et à l’environnement –il doit également s’occuper de l’approvisionnement– c’est en permanence qu’i<strong>la</strong> <strong>la</strong> prévention en tête. PT38 Prévention au travail Été 2010
Mieux vaut prévenirque d’en mourir…Au Québec, il fait froid. L’hiver québécois nous saisitpendant plus de quatre mois chaque année. On en sorttout juste. En contrepartie, l’été – le vrai – nous rendvisite… durant deux mois, trois tout au plus. Alors dequoi peut-on se p<strong>la</strong>indre quand il fait chaud ?Par Chantale RhéaumeCertains travailleurs peuventeffectivement se p<strong>la</strong>indre de <strong>la</strong> chaleur.Il faut savoir que le coup de chaleurpeut survenir brusquement quand onexécute un travail physique en ambiancechaude. Il se produit lorsque <strong>la</strong>température de notre corps monte anormalement(pouvant même atteindre40,6 °C) et qu’elle ne redescend pas suffisamment(pour revenir à 37 °C). Finalement,en l’absence de mesures derefroidissement immédiates et énergiques,il peut progresser jusqu’à causerdes dommages irréversibles aux organesvitaux et, dans les cas extrêmes, <strong>la</strong> mort.Avoir chaud, c’est toujours mieux quegeler, non ? Ça dépend… Ça dépend desrépercussions des variations de température,que ce soit à <strong>la</strong> hausse ou à <strong>la</strong> baisse.Pour mieux comprendre, comparons lesaccidents du travail et les ma<strong>la</strong>dies professionnellescausés par des contraintesthermiques opposées : d’une part, les coupsde chaleur et, d’autre part, les gelures etl’hypothermie.Nombre d’accidents, de lésions etde ma<strong>la</strong>dies professionnelles causéspar une exposition à des contraintesthermiques au QuébecContrainte thermiqueAnnée Chaud Froid2006 86 902007 53 812008 35 712009 63 50Les statistiques semblent nous direqu’au travail, « geler est pire qu’avoirchaud ». À preuve, les cas de lésions ou dema<strong>la</strong>dies survenues à <strong>la</strong> suite d’une expositionau froid sont plus nombreuses quecelles recensées à <strong>la</strong> suite d’une expositionà une chaleur intense. C’est évident, non ?Pas tant que ça. Les coups de chaleurpeuvent être mortels. En 2005,deux personnes sont décédées des suitesd’un coup de chaleur. En 2006, une personne.En 2007, même chose. Une personnepar année en moyenne, c’est peu,penserez-vous peut-être ? C’est trop,vous répondra-t-on !En effet, dans le cas des contraintesthermiques par le froid comme dans celuides coups de chaleur, les fortes variationsde température ont desrépercussions très néfastes sur <strong>la</strong> santéet <strong>la</strong> sécurité des travailleurs. Et <strong>la</strong> situationest d’autant plus préoccupantequ’il est possible de les prévenir.Il faut savoir que le coupde chaleur peut survenirbrusquement quand onexécute un travail physiqueen ambiance chaude.<strong>Des</strong> gestes de prévention simplesPour prévenir les coups de chaleur, employeuret travailleur ont leur bout dechemin à faire. L’employeur doit organiserle travail en fonction de <strong>la</strong> chaleur,par exemple en attribuant des tâchesplus légères, en faisant une rotation destâches, en fournissant aux travailleursde l’eau fraîche en quantité suffisante eten accordant des pauses plus longues etplus fréquentes. Il doit aussi prévoir desendroits de repos à l’ombre ou climatisés,en plus d’informer tous les travailleurssur les risques des coups dechaleur et sur les moyens de les éviter.De leur côté, les travailleurs doiventboire au minimum un verre d’eau toutesles 20 minutes. Ils doivent aussi se couvrir<strong>la</strong> tête pour travailler à l’extérieur etporter des vêtements légers, de couleurc<strong>la</strong>ire et de préférence perméables pourfavoriser l’évaporation de <strong>la</strong> sueur.La prévention <strong>qui</strong> sauve des viesQu’on se le dise, dans <strong>la</strong> majorité descas de coups de chaleur mortels, si lescollègues ou l’employeur avaient vu venirles signes et les symptômes de ma<strong>la</strong>isescausés par <strong>la</strong> chaleur, des vies auraientpu être sauvées. Mais encore faut-il lesreconnaître…Alors, quels sont ces signes et symptômes?<strong>Des</strong> étourdissements, des vertiges ouune grande fatigue. <strong>Des</strong> c<strong>rampe</strong>s muscu<strong>la</strong>ires,des frissons, un mal de cœur,de ventre ou de tête. Attention, cessymptômes peuvent être précurseursd’un coup de chaleur.Il y a aussi le comportement inhabituel(perte d’é<strong>qui</strong>libre, incohérence despropos, confusion, agressivité), <strong>la</strong> pertede conscience ou les vomissements.Dans ces situations, non seulement untravailleur est-il probablement victimed’un coup de chaleur, mais il est sansdoute en danger de mort. Il faut donclui donner des premiers secours immédiatementet aviser le 9-1-1 ou les servicesd’urgence (pour les secteurs forestiers <strong>qui</strong>ne sont pas desservis par le 9-1-1).Ces mesures sont faciles à adopter etne feront suer personne. Le travail à <strong>la</strong>chaleur peut être dangereux, voire mortel.La prévention mérite bien qu’on semette en frais ! PTPour en savoir plusGuide de prévention des coups de chaleur,2 e édition – Nouveaux facteurs decorrection pour l’ensoleillement,DC200-16184-2.Photo : iStockphotoÉté 2010 Prévention au travail 39
Les Toitures HogueUn virage à 180 degrésUne entreprise de <strong>la</strong> construction spécialisée dans les toits p<strong>la</strong>ts a décidé de donner prioritéà <strong>la</strong> santé et à <strong>la</strong> sécurité depuis quelques années. Résultat ? Les inspecteurs de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> <strong>qui</strong> s’yrendent n’ont que des félicitations à lui faire… Petite histoire d’une conversion réussie.Par Guy SabourinPhotos : Toitures HogueEn activité depuis 35 ans, lesToitures Hogue se spécialisent dans lestoits p<strong>la</strong>ts. L’entreprise d’environ140 travailleurs fabrique, entretient etrépare des toitures dans les secteurs industriel,institutionnel et commercial,avec incursions également dans le résidentiel.Elle a de gros clients, commeCascades, le Centropolis, l’Université duQuébec en Outaouais et le Cirque dusoleil, pour n’en nommer que quatre.Mais <strong>qui</strong> dit travail sur les toits parlede risques de chutes de hauteur. Auxquelss’ajoutent les risques que font courir75 camions sur <strong>la</strong> route, des grues, desunités d’urgence, des citernes à bitumeet des camions à 12 roues, et enfin ceux<strong>qui</strong> sont associés à <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>tiond’outils et de goudron chauffé à 500 o C.<strong>Des</strong> constats difficilesLes Toitures Hogue ont opéré un viragesécurité il y a cinq ans. « Il y avait desproblèmes de sécurité sur à peu prèschaque chantier et l’entreprise a subi denombreux arrêts de travail, expliquel’ingénieure Josée Ouellet, inspectrice etchef d’é<strong>qui</strong>pe pour <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> dans lesLaurentides, <strong>qui</strong> s’occupe des ToituresHogue depuis deux ans environ. Depuisl’application du P<strong>la</strong>n d’action constructionen 1997, les Toitures Hogue rencontraientbeaucoup d’inspecteurs de <strong>la</strong><strong>CSST</strong> <strong>qui</strong> ont délivré quantité de constatsd’infraction. »Mais un beau matin, en 2005, lesToitures Hogue en ont eu assez. « Tous cesarrêts de travaux étaient contre-productifset nous perdions beaucoup d’argent »,résume Jocelyn Hogue, vice-présidentde l’entreprise. Nous avons décidé d’effectuerun virage à 180 degrés pour <strong>la</strong>sécurité des travailleurs. »Un changement radical« Ils sont venus sonner à notre porte etnous ont demandé de les aider à s’améliorer,ajoute Josée Ouellet. Un inspecteurde <strong>la</strong> Direction des Laurentidestravail<strong>la</strong>it justement à cette époque àLa gestion de <strong>la</strong> sécurité passe par <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification fine des travaux.De g. à dr. : François Veilleux, gérant de projet, Ghis<strong>la</strong>in Beau<strong>la</strong>c, directeurde production, C<strong>la</strong>rence Magny, chargé de projet et Jocelyn Hogue,vice-président directeur général.l’é<strong>la</strong>boration d’un document qu’on utilisebeaucoup aujourd’hui : L’évaluateur degestion. Il n’était pas encore publié, maisde grandes sections pouvaient en êtreutilisées pour venir en aide aux ToituresHogue. Cet inspecteur s’est inspiré dudocument pour faire un portrait trèsfidèle de l’entreprise, semb<strong>la</strong>ble à unaudit de gestion. Ensuite, il a fait uneprésentation devant tous les travailleurset <strong>la</strong> direction. Il leur a montré leurportrait tel qu’il l’avait dressé. On s’endoute, au chapitre sécurité sur les chantiers,il y avait beaucoup de <strong>la</strong>cunes. Lestravailleurs étaient peu ou pas protégés.Il y avait quantité d’accidents à déplorer.L’entreprise a décidé de se servir dece portrait de gestion pour revoir tout sonprocessus de production dans le but d’yintégrer totalement <strong>la</strong> gestion de <strong>la</strong> santéet de <strong>la</strong> sécurité, poursuit Josée Ouellet.Elle a revu absolument toutes ses façonsde faire. Ce fut un remaniement majeurpour que <strong>la</strong> sécurité fasse désormaispartie intégrante de <strong>la</strong> production et desgestes quotidiens des travailleurs. »Quand elle a été saisie du dossier del’entreprise, Josée Ouellet a décidé deretourner voir, il y a deux ans environ,comment les Toitures Hogue se tiraientd’affaires. « Ça m’a impressionnée,résume-t-elle. Le travail qu’ils ont faitest énorme et ça paraît. »L’impact se fait sentir dans le dossiercomplet de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong> sécurité autravail. Par exemple, dans le volet prévention,on constate qu’il n’y a plusaucun arrêt de travail depuis 2006. Auchapitre des constats, un seul à déplorer.Leur dossier de réc<strong>la</strong>mations pour lésionsprofessionnelles a considérablementdiminué malgré l’augmentation de <strong>la</strong>masse sa<strong>la</strong>riale, <strong>qui</strong> a triplé par rapportà 2002.Désormais, avant d’entreprendren’importe quel chantier, le directeur duprojet se rend sur p<strong>la</strong>ce, prend des photos,évalue l’ensemble des protectionsdont auront besoin les travailleurs,40 Prévention au travail Été 2010
Les Toitures Hoguese spécialisentdans les toits p<strong>la</strong>ts,surtout dans lessecteurs industriel,institutionnel etcommercial.Réal Hogue, président et JocelynHogue, vice-président directeurgénéral.dresse <strong>la</strong> liste du matériel nécessaire ets’assure de transmettre cette informationau contremaître responsable duchantier, avec des directives c<strong>la</strong>ires. Parexemple, il faut tel é<strong>qui</strong>pement, tel typed’échafaudage, il faut s’attacher de tellemanière, il faut utiliser les garde-corpsà tel endroit précis et de telle façon,il faut protéger et sécuriser <strong>la</strong> ligneélectrique <strong>qui</strong> se trouve tout près duchantier, etc. Par ailleurs, les travailleurs<strong>qui</strong> manipulent du goudronchaud (à 500 o C) doivent obligatoirementporter des manches longues,même durant l’été, puisqu’une seulegoutte sur <strong>la</strong> peau brûle irrémédiablement.Bien sûr, casque, lunettes et bottesde sécurité sont de mise.« La gestion de <strong>la</strong> sécurité passe par<strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification fine des travaux, insisteJosée Ouellet. Donc aucune surprise,aucune improvisation. Quand les travailleurspartent sur un chantier, leurmatériel de sécurité est déjà prêt, toutrassemblé dans un camion. En arrivant,le contremaître peut leur indiquer comments’installer, comment travailler pourque le tout se déroule en sécurité. Ce <strong>qui</strong>fait que les lieux sont déjà sécurisés quandles travailleurs montent sur le toit. »Les vérifications et le suiviLe processus de gestion comprend égalementun volet vérification. Ce <strong>qui</strong> veutdire que le directeur du projet retournesur le chantier une fois que le projet estmis en p<strong>la</strong>ce pour s’assurer que toutesses directives ont été suivies. « Donc, onboucle <strong>la</strong> boucle, se réjouit Josée Ouellet.C’est d’ailleurs ce à quoi on s’attend de<strong>la</strong> part d’un entrepreneur. »Les Toitures Hogue fonctionnent encorede <strong>la</strong> même manière aujourd’hui.« L’entreprise s’est véritablement appropriée<strong>la</strong> sécurité, se réjouit Josée Ouellet,<strong>qui</strong> y jette un œil de temps en temps.La culture a complètement changé. »« Nous avons fait appel à une entreprisespécialisée, Gestess, ajoute JocelynHogue. Elle nous a fait quantité de recommandationspertinentes pour mieuxgérer <strong>la</strong> sécurité. » À sa suggestion, lesToitures Hogue ont embauché en quelquesorte un inspecteur privé <strong>qui</strong>, tousles jours, fait <strong>la</strong> tournée des chantiersen cours. « Je vous garantis qu’il ne<strong>la</strong>isse rien passer, poursuit JocelynHogue. Il a <strong>la</strong> consigne d’être sévère. Ilvérifie sans relâche si tous les aspectsde <strong>la</strong> sécurité sont respectés et il faittoutes les recommandations nécessaires.Chacun de nos travailleurs sait qu’ildéc<strong>la</strong>re ce qu’il voit au patron, moi enl’occurrence. Je pense que ça dissuadede tourner les coins ronds avec <strong>la</strong> sécurité.» Et si un travailleur se fait troptirer l’oreille pour devenir respectueuxdes consignes de sécurité ? « Il reçoitquelques avertissements et s’il nes’amende pas, il est mis à <strong>la</strong> porte »,tranche Jocelyn Hogue.On pourrait penser que de grosclients des Toitures Hogue <strong>qui</strong> ne veulentpas ternir leur réputation avec desaccidents sur l’un de leurs chantiersinsistent sur <strong>la</strong> sécurité. Peut-être.« Mais il est certain que les ToituresHogue ne relâchent pas <strong>la</strong> sécuritémême sur les chantiers résidentiels, <strong>qui</strong>ne sont pourtant pas sous les projecteurs,précise Josée Ouellet. Même àce niveau, on ne déplore ni constatd’infraction ni fermeture de chantier. Lasécurité s’est vraiment répandue d’unbout à l’autre de l’entreprise. »Au sein de chacune des é<strong>qui</strong>pes detravail, les Toitures Hogue font aussiappel à des travailleurs responsablesde <strong>la</strong> sécurité. Personne ne peut prétendren’avoir pas entendu parler desécurité. « En plus, notre responsablede <strong>la</strong> sécurité <strong>qui</strong> visite les chantierss’occupe de former les nouveaux, caril y a beaucoup de rotation de personneldans notre domaine », précise JocelynHogue.La seule chute que connaissent désormaisles Toitures Hogue, c’est cellede leur facture à <strong>la</strong> mutuelle de préventionGestess. Un « bonus » <strong>qui</strong> réjouitgrandement Jocelyn Hogue. PTÉté 2010 Prévention au travail 41
DeSerresQuand <strong>la</strong> créativitérencontre <strong>la</strong> préventionLe commerce de détail DeSerres, grand spécialiste en matériel d’artisteet de loisir créatif, fait <strong>la</strong> preuve qu’on n’a pas besoin d’être dans un secteur réputédangereux – par exemple mines, construction, pétrole - pour faire de <strong>la</strong> sécuritédes travailleurs un souci de tous les instants.Par Guy SabourinPhoto : iStockphotoLors d’une visite régionale decentres commerciaux l’an dernier, aucours de <strong>la</strong>quelle plusieurs inspecteursse partagent et visitent tous les commerces,l’inspectrice Isabelle Lalonde esttombée sur DeSerres, au marché centralde Montréal. « Je suis arrivée à l’improvisteet le gérant, Stéphane Lelièvre,était justement en train de travaillerà un projet de santé et de sécurité,raconte-t-elle. Ce <strong>qui</strong> est déjà rare. »Elle a ensuite demandé quelquescorrectifs et fait des suggestions desujets pouvant être pris en charge parle comité de santé et de sécurité. Elleal<strong>la</strong>it être surprise une deuxième foispuisqu’on <strong>la</strong> rappe<strong>la</strong>it avant même quene soit échu le dé<strong>la</strong>i qu’elle avait accordépour faire des correctifs. « Il estrare qu’on voie un employeur prendreça de façon si sérieuse », ajoute-t-elle.Enfin, troisièmesurprise, non seulementl’employeuravait-il corrigé ce<strong>qui</strong> devait l’être danssa succursale, maisil avait répandu <strong>la</strong>nouvelle dans tout leréseau DeSerres. Ilcompte 26 succursalesréparties auCanada, dont 16 auQuébec, pour un totald’environ 500 travailleurs,dont 350 à400 au Québec. « Là,je me suis dit quecette entreprise prenaitvraiment au sérieux<strong>la</strong> santé et <strong>la</strong>sécurité de ses travailleurs», ajoutel’inspectrice, <strong>qui</strong> anommé DeSerresd’emblée quand on lui a demandé defournir le nom d’une entreprise proactiveen santé et sécurité.« C’est certain qu’il y a moins de risqueschez nous qu’en usine, mais on essaiede les trouver – et on en trouve »,explique Judith Dubois, conseillère enressources humaines et responsable de<strong>la</strong> santé sécurité chez DeSerres, <strong>qui</strong> s’estdéjà occupée de santé et de <strong>la</strong> sécuritédans d’autres secteurs d’activité.Miser sur les employésTout employé de l’entreprise est mis àcontribution pour <strong>la</strong> découverte et le signalementdes risques et il a accès à unformu<strong>la</strong>ire pour rédiger des suggestionsen matière de sécurité. « Vous connaissezle milieu de travail, alors dites-nousce <strong>qui</strong> vous saute aux yeux », avons-nousexpliqué aux employés ajoute Judith<strong>Des</strong> employés attentifs écoutent les directives del’entreprise en santé et sécurité.Photo : Omer DeSerres42 Prévention au travail Été 2010
Dubois. De notre côté, nous nous assuronsde bien répondre à leurs préoccupationspuisqu’en leur permettant des’exprimer, nous créons du même coupdes attentes.En fait, <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécurité est l’undes volets de <strong>la</strong> gestion « humaine » etorientée vers l’individu que préconiseDeSerres. « C’est plus que sur papier,ajoute Anik <strong>Des</strong>jardins, directrice desressources humaines de l’entreprise.Notre politique de prévention, tout lemonde l’a à cœur, y compris au sein ducomité de direction. Ensuite, ça se répercutedes ressources humaines versles gérants, et de ces derniers vers lesemployés, alors que ces derniers peuventaussi faire valoir leurs préoccupationsen sens inverse. C’est une chaîne<strong>qui</strong> s’alimente de cette façon. »Dès l’embauche, les travailleurs sontsensibilisés à <strong>la</strong> santé et à <strong>la</strong> sécurité.En cours d’année, on vérifie leurs aptitudesà l’aide de différentes activités. Sixfois par année, tous les gérants se rendentà Montréal, au siège social, pourune rencontre d’entreprise. À chacunede ces rencontres, les gérants assistentà un volet santé et sécurité. Les messagesentendus au cours de ces rencontresmigrent ensuite du gérant vers le comitéde santé et de sécurité de <strong>la</strong> succursale,<strong>qui</strong> comprend du personnel de <strong>la</strong> caisse,des ventes et de l’entrepôt, pour être leplus diversifiés possible. « Les gérantsfont office de porte-paroles de leur secteurrespectif », illustre Judith Dubois.Les risques« Chaque année, pour chacune des succursales,nous étudions le registre desaccidents et incidents que le gérantnous fait parvenir, explique Judith Dubois.Nous partons de là pour évalueroù p<strong>la</strong>cer nos priorités. Nous demandonsaussi à nos gérants d’être allumésen matière de définition des risques. »Ces derniers temps, deux types derisques ont été déterminés. De nombreuxemployés se sont coupés avec uncouteau à <strong>la</strong>me rétractable, tandis qued’autres récoltaient des maux de dos enayant trop et mal forcé pour souleverdes charges lourdes. « Dès lors, nousnous posons de nombreuses questions,précise Judith Dubois. Avons-nous lesbons outils ? Les utilisons-nous commeil faut ? Travaillons-nous selon <strong>la</strong> bonneméthode ? Les travailleurs adoptent-ilsle bon comportement ? Bref, nous tentonsd’aller à <strong>la</strong> source du problème etnous nous attaquons ensuite à trouverPhoto : iStockphotoDeSerres utilise des transpalettesmanuels pour les nombreusescharges lourdes.une solution. Nous travaillons essentiellementen mode préventif. »Pour le problème des couteaux à<strong>la</strong>me rétractable, DeSerres a é<strong>la</strong>boréune bonne méthode d’utilisation, à partirde <strong>la</strong>quelle l’employé apprend plusieurschoses, notamment à utiliser lebon outil (ce n’était pas toujours le cas),à diriger <strong>la</strong> coupe vers l’extérieur et jamaisvers soi, à ne pas casser <strong>la</strong> <strong>la</strong>meavec le bout de ses doigts, mais avec lesoutils fournis, à utiliser des gants pourmanipuler du papier.Pour les nombreuses charges lourdes,<strong>la</strong> plupart des succursales sont muniesde transpalettes manuels. Mais en raisonde contraintes d’espace, il restebeaucoup de manipu<strong>la</strong>tion à faire. Lesemployés sont donc pourvus de ceinturesde maintien de <strong>la</strong> posture et de bottes desécurité, qu’ils doivent porter en touttemps. « Nous nous assurons que chacunde nos gérants passe <strong>la</strong> procédurede manutention en revue avec chaqueemployé », ajoute Judith Dubois.Les rappelsLa motivation étant par nature limitéedans le temps, il faut sans cesse ramenerles préoccupations de sécurité surle tapis. DeSerres demande à ses gérantsd’ouvrir l’œil et de faire les rappelsà l’ordre nécessaires. Le détail<strong>la</strong>nt nedéplore pas de délinquants en matière desécurité dans ses rangs. « À l’embauche,nous formulons c<strong>la</strong>irement nos exigencespour <strong>la</strong> sécurité, tandis que <strong>la</strong> culturede <strong>la</strong> sécurité est aussi très répandue dansl’entreprise, explique Anik <strong>Des</strong>jardins.S’il le faut, nous prenons le temps d’expliquerde nouveau notre philosophie enmatière de sécurité à ceux <strong>qui</strong> n’adoptentpas toujours les bons comportements.»Les avantagesPrendre le virage de <strong>la</strong> sécurité est certesavantageux à plus d’un égard. « Àl’embauche, dire à l’employé qu’on offreun environnement de travail sécuritaire,c’est par<strong>la</strong>nt, constate Judith Dubois. Denotre côté, les coûts associés aux dossiers<strong>CSST</strong> et mutuelle de préventionsont moindres. »En épluchant le dossier DeSerres,Isabelle Lalonde n’a découvert que deuxaccidents, un en 2007 et un en 2006,ayant causé des lésions lombaires chezdes commis à l’expédition.« Nous sommes tellement performantsque notre mutuelle nous c<strong>la</strong>ssecomme tels et devient encore plus exigeanteen termes de prévention », ajouteAnik <strong>Des</strong>jardins <strong>qui</strong>, sans avoir leschiffres sous les yeux, a nettementconscience de <strong>la</strong> tendance à <strong>la</strong> baissedes frais associés au dossier santé et sécuritéau travail.Dernièrement, DeSerres a ajouté unvolet supplémentaire à <strong>la</strong> prévention, ené<strong>la</strong>borant un p<strong>la</strong>n complet de mesuresd’urgence et d’évacuation en cas d’incendieou de quelque autre incident. Cep<strong>la</strong>n, <strong>qui</strong> s’applique à l’ensemble dessuccursales, dit quoi faire et ne pasfaire, comporte un coordonnateur, dessurveil<strong>la</strong>nts, des chercheurs et des remp<strong>la</strong>çantsafin que <strong>la</strong> marche à suivre soitpartout <strong>la</strong> plus uniforme possible.Ajoutez une dose de culture de <strong>la</strong>prévention à l’esprit créatif de certainsemployés, et vous obtiendrez, commechez DeSerres, des employés<strong>qui</strong>, spontanément, ontdessiné et fabriqué desillustrations montrantdes « quoifaire et ne pasfaire », qu’ilso n t e n s u i t ep<strong>la</strong>stifiées etp<strong>la</strong>cardées.Une attitudedontse réjouissentAnik<strong>Des</strong>jardinset JudithDubois : <strong>la</strong>préventionportefruit. PTÉté 2010Prévention au travail43Photo : iStockphoto
portraitd’une lectriceMarlène Morin est responsabledes communications pour RIDEAU,un réseau de 150 diffuseurs despectacles dans 250 salles au Québecet hors Québec. Elle travaille dansle milieu des arts de <strong>la</strong> scènedepuis 25 ans, particulièrementdans le domaine de <strong>la</strong> diffusion.Elle est mère de deux enfants.[Prévention au travail] D’oùvient votre intérêt pour <strong>la</strong> santéet <strong>la</strong> sécurité du travail ?Marlène MorinProfession : responsabledes communications[PT] Vous arrive-t-il d’utiliserPrévention au travail à des f ins deformation ?[MM] Oui, je présente le magazineau cours de mes présentations et je recommanderégulièrement des articles.Par exemple, les articles <strong>qui</strong> traitent de<strong>la</strong> Loi sur <strong>la</strong> sst me sont toujours fortutiles dans mes présentations.[PT] Quels sujets aimeriez-vousvoir traiter dans le magazine ?[Marlène Morin] Je suis depuislongtemps préoccupée par <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong>sécurité du travail (sst), particulièrementpar les conséquences du travail sur lecorps. Étonnamment, c’est un de nos sujetsde conversation dans nos rencontresfamiliales. Quand j’ai pris le poste deresponsable des communications àRIDEAU, on m’a proposé de prendreen charge le dossier et de représenterRIDEAU à <strong>la</strong> table de concertation paritaireen sst dans le domaine des arts de<strong>la</strong> scène. J’ai accepté avec p<strong>la</strong>isir vu monintérêt, mais aussi par souci de communiqueraux membres de RIDEAU lesavancées dans le domaine et les moyensde prévention à mettre en p<strong>la</strong>ce.[PT] Depuis quand êtes-vousabonnée à Prévention au travail etcomment avez-vous entenduparler du magazine ?[MM] Depuis deux ans. En tantque membre de <strong>la</strong> table de concertationparitaire en santé et sécurité du travaildans le domaine des arts de <strong>la</strong> scène,j’ai pu en prendre connaissance.[PT] Quelle est votre rubriquepréférée ? Pourquoi ?[MM] Je vais spontanément vers leCherchez l’erreur. J’aime bien ce genrede jeu où l’on doit repérer ce <strong>qui</strong> ne vapas. C’est assez surprenant à quel pointon ne voit pas le danger. Je scrute <strong>la</strong>section Vient de paraître et je vérifie <strong>la</strong>section Recherche de l’IRSST et y puisetout ce <strong>qui</strong> est pertinent pour mes collègueset pour les membres de RIDEAU.Je lis toujours le mot de <strong>la</strong> rédaction.[PT] Quels sont les sujets <strong>qui</strong>vous intéressent particulièrementen santé et sécurité ?[MM] La prévention, bien sûr !Tous les petits détails <strong>qui</strong> nous rendentplus vulnérables vis-à-vis des accidentsou des lésions. Il y a tellement de trucssimples à mettre en p<strong>la</strong>ce pour fairede <strong>la</strong> prévention. Évidemment, commetravailleuse en communication, je portebeaucoup d’intérêt à <strong>la</strong> sensibilisationde mes collègues et des membres deRIDEAU. En ce moment, je valorisebeaucoup dans mes communications<strong>la</strong> création de comités paritaires dansles organismes de diffusion des artsde <strong>la</strong> scène.[PT] Est-ce que <strong>la</strong> variété dessujets abordés dans chaque numéroest suff isante ?[MM] Oh oui ! On passe du trèsconcret à des notions historiques, enpassant par des sujets scientifiques etdes conseils pratiques. C’est vraimenttrès riche comme contenu.[PT] Vous arrive-t-il de fairelire un article à un collègue ou àun proche ?[MM] Je présente régulièrementdes articles dans <strong>la</strong> revue de presse hebdomadaireque j’envoie aux membresde RIDEAU. C’est un magazine que jemets également à <strong>la</strong> disposition de mescollègues.[MM] <strong>Des</strong> articles <strong>qui</strong> visent spécifiquementun public jeune. Trop souvent,les jeunes travailleurs ne se sententpas concernés par <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong> sécuritéen général. J’aimerais bien aussi liredes articles, avec des exemples concrets,sur <strong>la</strong> responsabilité des employeurs,des employés et des bénévoles à l’égardde <strong>la</strong> sst.[PT] Ma plus grande f ierté ouréalisation en santé et sécuritédu travail…[MM] D’avoir contribué à outillerles diffuseurs de spectacles en matièrede prévention, en participant au comitéde rédaction du guide de prévention enart de <strong>la</strong> scène <strong>la</strong>ncé en février 2009.[PT] Finalement, si j’étais rédactriceen chef de Prévention autravail, je…[MM] Je suivrais <strong>la</strong> voie tracée parJulie Mé<strong>la</strong>nçon, l’actuelle rédactrice enchef, <strong>qui</strong> nous propose un magazinecomplet, documenté dont le contenuest fort diversifié. PTPropos recueillis par Julie Mé<strong>la</strong>nçonPour en savoir pluswww.csst.qc.ca/artsde<strong>la</strong>sceneVous aimeriez vous aussi faire l’objetd’un portrait d’un lecteur ou d’unelectrice ? Écrivez-nous en répondantaux questions de <strong>la</strong> rubrique àPréventionautravail@csst.qc.ca.44 Prévention au travail Été 2010
En raccourci45Photo : iStockphotoFatigué de l’écran ?Vous êtes assis devant un écran d’ordinateur toute <strong>la</strong>journée ? Vos yeux n’en peuvent plus ? Ce n’est guère surprenant.À force de fixer des écrans, bien commodes ilfaut le dire, les yeux se crispent en position d’accommodationpermanente, s’assèchent et se fatiguent. Voici unpetit exercice à faire pour sou<strong>la</strong>ger vos yeux. Toutes lesdeux heures, pincez vos sourcils en formant un gros bourreletde peau entre le pouce et l’index. Soulevez l’épidermeen prenant appui sur <strong>la</strong> structure osseuse de l’arcade. Partezde l’extrémité du sourcil et allez jusqu’à sa base en effectuantde gros pincements tout le long de l’arcade. Durantl’exercice, regardez vers le bas, en effet, cetteposition contribue à décontracter les yeux.De plus, bougez régulièrementles yeuxet regardez autre choseque l’écran à différentesdistances. Enfin,clignez des yeux leplus souvent possible.Chaque cillement répartitle li<strong>qui</strong>de <strong>la</strong>crymalsur l’œil, le nettoie,le masse et le détend,tout en lui procurantun instant d’obscuritére<strong>la</strong>xant. JMSource : Psychologies.comConsultation publique pour<strong>la</strong> révision de l’annexe 1 du RSSTFaites part de vos commentaires !Le comité permanent du conseil d’administration de<strong>la</strong> <strong>CSST</strong> pour <strong>la</strong> révision de l’annexe 1 du Règlement ensanté et sécurité du travail (RSST) a amorcé en mai 2010un processus de consultation publique sur les normesre<strong>la</strong>tives à certains contaminants. Les premiers contaminantsciblés par cette consultation sont le manganèseet les farines. Au cours des prochains mois, d’autresproduits feront aussi l’objet d’une consultation.Votre col<strong>la</strong>boration est nécessaire pour assurer lesuccès de ce projet. La <strong>CSST</strong> vous invite donc à remplirle canevas que l’é<strong>qui</strong>pe du Répertoire toxicologiquemet à votre disposition sur son site Web. Les commentairesainsi recueillis aideront le comité à apporter desmodifications au RSST en vue de mieux protéger lestravailleurs.Rappelons que le Répertoire toxicologique de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>fournit des renseignements sur les produits chimiquesou biologiques utilisés en milieu de travail. Il propose àsa clientèle un service de consultation par téléphone etpar courriel et offre un soutien spécialisé dans le butde favoriser <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce de moyens de préventionadéquats.Pour en savoir plus, consultez le site Web du Répertoiretoxicologique au www.csst.qc.ca. HBLConnaissez-vous<strong>la</strong> pyramide de Bird ?Cette pyramide a été é<strong>la</strong>borée par Frank E. Bird Jr à <strong>la</strong> suited’une étude menée par <strong>la</strong> compagnie d’assurance InsuranceCompany of North America en 1969. L’étude a porté sur1 753 498 accidents déc<strong>la</strong>rés par 297 entreprises. Celles-ci,<strong>qui</strong> représentaient 21 groupes industriels différents, employaient1 750 000 personnes <strong>qui</strong> ont travaillé trois millionsd’heures durant <strong>la</strong> période étudiée. Le principe de <strong>la</strong> pyramidede Bird exprime le fait que <strong>la</strong> probabilité qu’un accidentgrave survienne augmente avec le nombre de presqueaccidents et d’incidents. Par conséquent, si une entrepriseréussit à réduire le nombre d’incidents au bas de <strong>la</strong> pyramide,le nombre d’accidentssera forcément réduitAccidentd’autant. JMPlus le nombred’incidents10est élevé, plus<strong>la</strong> probabilité30d’avoir unaccidentest élevée. 6001mortelAccidentsIncidentsà signalerLa <strong>CSST</strong> a un nouveau site WebIncidentsÀ l’occasion de son 30 e anniversaire, <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> <strong>la</strong>nceune nouvelle version de son site Web. Ce nouveau site,plus convivial et dynamique, affiche une allure jeuneainsi qu’un design plus attrayant et moderne.Le nouveau site Web s’inscrit dans <strong>la</strong> volonté de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>d’offrir des services toujours plus performants. Son but ?Permettre aux utilisateurs d’avoir accès rapidement à l’informationqu’ils recherchent. La nouvelle page d’accueil répondà cette demande. La partie de gauche se concentre sur l’informationque le public vient chercher sur le site. La zone utilisateurscomprend dorénavant deux catégories <strong>qui</strong> sonttravailleurs et employeurs. Les pages Web les plus consultées,les formu<strong>la</strong>ires les plus demandés et les services en lignesécurisés complètent cette section.La partie de droite du site facilite <strong>la</strong> navigation des utilisateursen les guidant judicieusement vers l’information<strong>qui</strong> est <strong>la</strong> plus susceptible de les intéresser. Tout ce<strong>la</strong> dansun environnement où<strong>la</strong> navigation est simplifiée.Ajoutons à ce<strong>la</strong>un nouveau moteurde recherche des plusperformants pour unaccès plus facile à l’information.Ce nouveau siteoffre des services, desproduits en ligne etdes outils de qualitérépondant aux besoinsdes utilisateurs.Photo : ShutterstockÉté 2010Prévention au travail
PerspectivesInvestir dans <strong>la</strong>c’est rentableUn dol<strong>la</strong>r investidans <strong>la</strong> santé globaledes travailleurs pourrait rapporter jusqu’à cinq dol<strong>la</strong>rs, puisqu’ilen résulterait une baisse de l’absentéisme, des cotisations à <strong>la</strong> <strong>CSST</strong>, desprimes d’assurance collective et du taux de roulement. Comment peut-onaff irmer que <strong>la</strong> prévention en matière de santé des travailleurs permet aussid’améliorer <strong>la</strong> productivité des entreprises et qu’elle prof ite à l’ensemble de<strong>la</strong> société ? Le D r Mario Messier, médecin du travail et directeur scientif iquedu Groupe de promotion pour <strong>la</strong> prévention en santé (GP 2 S), explique.[Prévention au travail] Surquelles données le GP 2 S s’appuiet-ilpour aff irmer que <strong>la</strong> préventionen matière de santé est une stratégierentable ?[Mario Messier] Il se fait de plusen plus de recherches sur <strong>la</strong> promotionde <strong>la</strong> santé au travail un peu partoutdans le monde, surtout aux États-Unis.Au Canada, des études démontrent quele retour sur l’investissement va d’unpeu plus de deux dol<strong>la</strong>rs jusqu’à quatredol<strong>la</strong>rs. Une recherche menée chez Visa<strong>Des</strong>jardins, à <strong>la</strong>quelle le GP 2 S a contribué,fait état d’un rendement de 1,50 $à 3 $.[PT] Pourquoi, dans sa présentationau Comité consultatif surl’économie et les f inances publiquesdu ministre des Finances, RaymondBachand, en janvier dernier, leGP 2 S a-t-il réc<strong>la</strong>mé une politiquegouvernementale pour intensif ier<strong>la</strong> promotion de <strong>la</strong> santé et de <strong>la</strong>prévention en milieu de travail ?[MM] Les dépenses en santé représentent40 % du budget du Québec etenviron 95 % de ces sommes sont consacréesau curatif. Or, on sait qu’on s’enva vers un mur puisque <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tionvieillit et que les statistiques montrentque 66 % des adultes canadiens présententune surcharge pondérable ousont obèses. Logiquement, ces facteursse traduiront par beaucoup de diabète,d’hypertension, de ma<strong>la</strong>dies cardiaqueset de cancers. Bien que les gouvernementsaient mis en p<strong>la</strong>ce différentescampagnes de promotion de <strong>la</strong> santé,dont le Programme national de santépublique, modifier les habitudes de vie,c’est un gros bateau à bouger. Le GP 2 Sconsidère que le milieu de travail estparticulièrement efficace à cet égardparce que les gens y reviennent jouraprès jour. On peut donc y répéter lesmessages pour les influencer et créerune culture de <strong>la</strong> santé, d’autant plusque les gestionnaires reconnaissent deplus en plus que <strong>la</strong> santé de leurs employésa un effet notable sur <strong>la</strong> productivité,sur l’absentéisme et sur <strong>la</strong>compétitivité de l’entreprise. Et si ce<strong>la</strong>rapporte aux entreprises, ce<strong>la</strong> rapporteraaussi au gouvernement en réduisantles coûts des soins de santé. Onfait donc d’une pierre deux coups enaidant les entreprises par des mesuresincitatives, des lois ou des subventions.Tous y gagnent.[PT] Est-ce pour favoriser unchangement de paradigme, <strong>la</strong>création d’un nouveau modèlesocial, que GP 2 S a institué <strong>la</strong>norme Entreprise en santé 1 ?[MM] Effectivement. On sait qu’ilfaut des décennies pour changer unmodèle social, mais nous en sommeslà parce que nous n’avons pas le choix.La norme Entreprise en santé met en1. Pour en savoir davantage sur le GP 2 S et sur <strong>la</strong>norme Entreprise en santé : www.gp2s.netp<strong>la</strong>ce un programme de promotion de<strong>la</strong> santé <strong>qui</strong> touche quatre sphères : leshabitudes de vie, le milieu de travail, lespratiques de gestion, l’é<strong>qui</strong>libre travailet vie personnelle. Cette norme de typeISO est une première mondiale.En février dernier, le quotidien françaisLe Figaro par<strong>la</strong>it de cette normecomme étant innovatrice. Le GP 2 S ad’ailleurs entrepris des démarches pourl’étendre à l’échelle canadienne. La promotionde <strong>la</strong> santé en est au mêmestade que l’étaient les normes de typeISO il y a 25 ans. À l’époque, des expressionscomme kaizen, améliorationcontinue et qualité totale semb<strong>la</strong>ientbizarres et on pensait que c’était unemode, alors qu’aujourd’hui, c’est passédans les mœurs. On sait qu’une entreprisene peut pas survivre si elle n’appliquepas des normes de qualité. Il y adonc des similitudes avec <strong>la</strong> promotionde <strong>la</strong> santé au travail, car <strong>la</strong> différenceentre une entreprise <strong>qui</strong> réussit et uneautre <strong>qui</strong> va moins bien, c’est pour unebonne part <strong>la</strong> qualité du personnel, <strong>la</strong>quellepasse par <strong>la</strong> santé. Et quand onparle de santé, on sait aujourd’hui quece<strong>la</strong> dépend à 70 % des habitudes devie des gens, de leurs comportementset de l’environnement dans lequel ilsévoluent.[PT] Plusieurs pays, surtout enEurope, commencent à être sensiblesà ces réalités et à <strong>la</strong> nécessitéd’agir pour favoriser <strong>la</strong> santé autravail. Où le Québec se situe-t-ildans ce mouvement naissant ?Photo : Marie-Josée Legault46 Prévention au travail Été 2010
santé au travail,« Les entreprises ne doivent pasoublier que certaines améliorationsdans leurs pratiques de gestionpeuvent avoir de gros impacts sur <strong>la</strong>santé psychologique de leur personnel,» affirme le D r Mario Messier.[MM] L’Ontario a créé un ministèrede <strong>la</strong> Promotion de <strong>la</strong> santé, leNouveau-Brunswick s’est récemmentdonné une loi <strong>qui</strong> promeut <strong>la</strong> santé autravail, le président Barack Obama aannoncé des incitatifs pour que lesentreprises américaines agissent en cesens et <strong>la</strong> France a légiféré pour queles entreprises établissent des protocolespour améliorer <strong>la</strong> santé psychologiquede leurs travailleurs. C’est unmouvement <strong>qui</strong> se manifeste à l’échelleinternationale et le Québec y occupeune p<strong>la</strong>ce avant-gardiste, ne serait-cequ’avec <strong>la</strong> norme Entreprise en santé.[PT] Ce<strong>la</strong> suff it-il pourconvaincre les dirigeants qu’ilsont intérêt à investir dans <strong>la</strong>santé de leur personnel ?[MM] Les gestionnairessont engagés pourassurer <strong>la</strong> prospérité deleur entreprise. Alors,quand on réussit à leurmontrer comment detelles initiatives peuventles aider à atteindreleurs objectifs de rentabilitéet de rendement,ils embarquent. Ils comprennentque pour réussir,leur entreprise a besoind’employés bienformés, motivés et ensanté. On compte actuellementhuit organisationscertifiées Entrepriseen santé et leur expériencerévèle que ça lesaide à attirer et à retenirplus facilement du personnelqualifié. On saitque le recrutement et <strong>la</strong>fidélisation sont devenusdes enjeux majeurs pourles entreprises. Donc, plusnous aurons d’exemplesde ce genre, plus il serafacile de convaincre lesentreprises des avantagesqu’il y a à faire <strong>la</strong> promotionde <strong>la</strong> santé.[PT] Concrètement, que peuventfaire les entreprises dans lequotidien pour que <strong>la</strong> santé deleurs employés s’améliore ?[MM] L’important, c’est de commencer,de faire quelque chose <strong>qui</strong> n’apas nécessairement besoin d’être coûteuxou compliqué. Quand les gens de<strong>la</strong> direction montrent l’exemple, ce<strong>la</strong> aun effet d’entraînement immédiat sur lepersonnel. Par exemple, une entreprisea organisé un défi afin de promouvoirles saines habitudes de vie. Les employés,regroupés en é<strong>qui</strong>pes, gagnaientun point s’ils buvaient cinq verres d’eaupendant <strong>la</strong> journée, un autre point s’ilsmangeaient cinq portions de fruits etde légumes, un autre s’ils al<strong>la</strong>ient marcherà l’heure du midi et ainsi de suite.Ce<strong>la</strong> a créé un esprit de groupe et cetteinitiative toute simple a eu beaucoup desuccès. Ce<strong>la</strong> peut également être aussisimple que de réviser le menu des machinesdistributrices ou de distribuerune pomme à chaque employé l’aprèsmidi.Par ailleurs, les entreprises ne doiventpas oublier que certaines améliorationsdans leurs pratiques de gestionpeuvent avoir de gros impacts sur <strong>la</strong>santé psychologique de leur personnel.En favorisant, par exemple, les gestesde reconnaissance envers les employésou en les impliquant plus dans lesprises de décisions <strong>qui</strong> les concernent.De plus, les initiatives <strong>qui</strong> visent àfaciliter <strong>la</strong> conciliation travail/vie personnellepeuvent contribuer à <strong>la</strong> santépsychologique des employés.[PT] Peut-on faire un rapprochemententre <strong>la</strong> promotion de<strong>la</strong> santé au travail et les Prixinnovation de <strong>la</strong> <strong>CSST</strong> ?[MM] Ces prix stimulent <strong>la</strong> créativitédes gens et font connaître les expériencesnovatrices <strong>qui</strong> ont des effetspositifs sur <strong>la</strong> santé des travailleurs.Gagner un de ces prix, c’est avantageuxpour l’entreprise en question puisquece<strong>la</strong> lui apporte de <strong>la</strong> reconnaissanceet vient récompenser ses efforts. Maisce<strong>la</strong> peut aussi en inspirer d’autres,d’autant que les <strong>innovations</strong> gagnantessont souvent re<strong>la</strong>tivement simples. Lanorme Entreprise en santé va un peuplus loin que <strong>la</strong> prévention des accidentset des ma<strong>la</strong>dies du travail puisqu’ellefait aussi <strong>la</strong> promotion despratiques organisationnelles favorablesà <strong>la</strong> santé. Mais <strong>la</strong> norme reconnaît que<strong>la</strong> prévention est prioritaire. Avant detenter d’améliorer <strong>la</strong> santé de ses travailleurs,une entreprise doit s’assurerde ne pas l’aggraver.Si j’avais un message à communiqueraux entreprises, c’est celui-ci : necraignez pas de commencer à aider vostravailleurs à améliorer leurs habitudesde santé. Ils ont besoin d’aide pour yarriver puisque, chacun le sait, adopterde bonnes habitudes de vie n’est pastoujours facile. Le fait qu’une entreprisearrive à créer un environnement favorableà cet égard aura beaucoup d’impactsur <strong>la</strong> santé de son personnel. De plusen plus, on se rend compte que <strong>la</strong> santéconstitue une responsabilité partagéepar l’entreprise, les travailleurs, <strong>la</strong> collectivitéet les gouvernements. PTC<strong>la</strong>ire ThiviergeÉté 2010Prévention au travail47
PubGRV10_Prevautravail_44pX46pB.pdf 22 06 2010 11:39:38DC 600-202-103Le Grand Rendez-vous fête ses 10 ans!19 et 20 octobre 2010Pa<strong>la</strong>is des congrès de MontréalRéservez dès maintenant ces dates à votre agendaCMYCMMYCYCMYKLe plus grand événement en santéet sécurité du travail au Québec!• Plus de 225 exposants• 24 conférences données pardes spécialistes <strong>qui</strong> répondrontà vos questions• Près de 6 500 participantsl’année dernièrewww.grandrendez-vous.comUn événement produit parInscrivez-vous en ligne dès le mois d’août.Et pour tout savoir, abonnez-vous à nos bulletins électroniques,dans <strong>la</strong> section Abonnement au bulletin du site Web.DCP301-198 (2010-06)Pour recevoir gratuitement le magazine Prévention au travail, il vous suffit d’en faire <strong>la</strong> demande en écrivant à : Prévention au travail,Service aux abonnés, 30, rue Ducharme, Gatineau (Québec) J8Y 3P6. Courriel : preventionautravail@resourceintegration.ca.Ou en téléphonant au numéro suivant : 1 877 221-7046 (sans frais).Port de retour garanti par <strong>la</strong>Commission de <strong>la</strong> santéet de <strong>la</strong> sécurité du travaildu QuébecC.P. 1200, succursale TerminusQuébec (Québec) G1K 7E2Poste-publications commerciale 400 62772