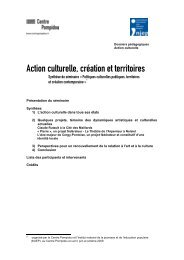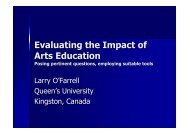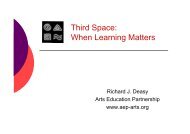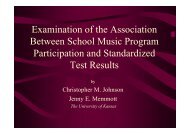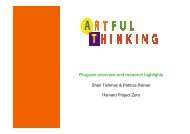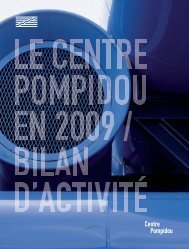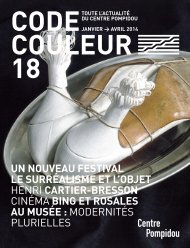Consulter la présentation Powerpoint - Centre Pompidou
Consulter la présentation Powerpoint - Centre Pompidou
Consulter la présentation Powerpoint - Centre Pompidou
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOUVEAUX REGARDS SUR L’EDUCATION ARTISTIQUE,NOUVELLES FORMES DE MÉDIATION MUSÉALE :étude de réceptionauprès des préadolescents et adolescentsen visite sco<strong>la</strong>ire au <strong>Centre</strong> Georges-<strong>Pompidou</strong><strong>Centre</strong> de Recherchesur les Liens Sociaux(PARIS 5 / CNRS)Jacqueline EIDELMANSéverine DESSAJANJean-Pierre CORDIERAurélie PEYRINCERLIS (CNRS - Paris 5) 1
• Une recherche sur les effets de différents stylesde médiation culturelle sur <strong>la</strong> formation du goûtdes adolescents pour l’art moderne etcontemporain• Elle s’inspire des études de réception: horizond’attente, expérience de visite, interprétationspontanée et réfléchie• Elle a été réalisée au centre <strong>Pompidou</strong>, entremars et décembre 2006, au moyen d’uneenquête– auprès de 10 c<strong>la</strong>sses de collège (4 ème - 3 ème ) et 10 c<strong>la</strong>sses delycée (2 nde - 1 ère )– auxquelles sont proposées• <strong>la</strong> découverte d’œuvres de <strong>la</strong> collection permanente (Big Bang ouMouvement des images) ou d’une exposition temporaire (YvesKlein)• <strong>la</strong> découverte de principes scénographiques ou du design d’espaceCERLIS (CNRS - Paris 5) 2
L’HORIZON D’ATTENTEDES ELEVES
« Le contexte des expériencesantérieures» (1/2)• Adolescents dont le capital de familiaritémuséale est non négligeable• Rôle de l’école déterminantA priori ambivalent de <strong>la</strong> sortie sco<strong>la</strong>ireA priori ambivalent de <strong>la</strong> visite encadrée• Adolescents ayant des parcours sco<strong>la</strong>ires etculturels différents• Familiers / novices en art contemporainrejet / adhésion / curiosité / indifférenceCERLIS (CNRS - Paris 5) 4
« Le contexte des expériencesantérieures» (2/2)• Des adolescents qui ne sont pas « tous égauxdevant les œuvres », même si :• Connaissances culturelles et artistiques diffuses danstous les milieux sociaux• Tension propre au temps de l’adolescence : désird’affiliation et de désaffiliationUne visite au CGP, que peu connaissent en tantque musée, saura-t-elle leur faire porter unnouveau regard sur leur rapport à l’art ?CERLIS (CNRS - Paris 5) 5
L’EXPERIENCE DE VISITE
L’échelle d’observationdes attitudes et comportements• Des poses qui peuvent sembler:– Conformes aux exigences sco<strong>la</strong>ires ou à <strong>la</strong> didactiquemuséale– Ostensiblement impassibles– Anomiques• Des poses qui se figent ou se modifient enfonction d’un ajustement apparent aux règles de<strong>la</strong> visite et aux normes de participationCERLIS (CNRS - Paris 5) 7
1 er exempleLes élèves ont un document de « consignes » (elles devrontréaliser un travail p<strong>la</strong>stique en s’inspirant d’un des thèmes deBig Bang), des cahiers, carnets de croquis, appareils photos :elles dessinent, prennent des notes et des photos. Leconférencier les sollicite beaucoup mais elles ne répondentqu’en murmurant, c’est souvent inaudible. Du coup, au boutd’un moment, il leur suggère les réponses de façondétournée (par exemple « Est-ce que c’est courbe ? », alorsque c’est visiblement rectangu<strong>la</strong>ire). Elles échangent leursimpressions à voix basse et rigolent entre elles. Elles suiventbien, mais s’égaillent un peu pendant les dép<strong>la</strong>cements,surtout quand <strong>la</strong> prof attire leur attention sur le thème de <strong>la</strong>salle, ou une œuvre qu’elles ont étudiée en c<strong>la</strong>sse. (1 èreoption Arts P<strong>la</strong>stiques, Lycée, 78, VCF, Big Bang)CERLIS (CNRS - Paris 5) 8
2 ème exempleLa conférencière s’efforce de juguler leur enthousiasmeparce qu’ils parlent tous en même temps qu’elle, surtoutlorsque face à un Warhol elles ont beaucoup de chosesà dire. Elle essaie <strong>la</strong> manière disciplinaire : « Tu peuxme regarder quand je parle ? », et obtient un silencere<strong>la</strong>tif au bout d’un quart d’heure, mais parle souvent surfond de brouhaha et d’interjections désordonnées... Ilsse servent de leur portable et s’agglutinent sur un banc.L’un d’eux s’exc<strong>la</strong>me : « Là-bas ils font l’amour !!’ Untiers regardent aussitôt dans cette direction » (3ème,Collège, 94, VCF Le mouvement des Images)CERLIS (CNRS - Paris 5) 9
3 ème exempleLes interactions se développent dès le début de <strong>la</strong> visite,grâce aux questions du conférencier. Parfois ce sont lesélèves qui initient le dialogue notamment lorsqu’ilss’interrogent sur <strong>la</strong> valeur artistique des œuvres. Leconférencier les questionne beaucoup, sur ce qu’ilsconnaissent, leurs ressentis sur les œuvres, sur lepourquoi d’après eux l’artiste à fait telle ou telle chose. Illes encourage à chaque fois à donner leur avis, réagir,chercher une interprétation. Les interactions se font deplus en plus importantes au fur et à mesure de <strong>la</strong>progression dans les salles. (1 ère professionnelle, Lycéepolyvalent, 92, VCF, Big Bang)CERLIS (CNRS - Paris 5) 10
Le déchiffrement du système complexedes injonctions implicites et explicites (1/4)• 1er p<strong>la</strong>n: <strong>la</strong> philosophie de <strong>la</strong> médiation muséale– Les 2 formules de visite :Visite conférence : l’implicite d’un modèle sco<strong>la</strong>riséDes élèves prennent des notes, <strong>la</strong> conférencière dit : « Ne notez pastout ce que je dis. Je préfère que vous regardiez, que vous fassieztravailler votre œil’ » (2 nde techno., 92, VCF Le mouvement desImages)Parcours: l’explicite d’un modèle émancipé« Vous vous ba<strong>la</strong>dez dans l’exposition avec votre fiche, chaquefiche s’intéresse à deux salles, et vous en choisirez une à présenteraux autres. L’idée est de tenter de répondre aux questions, mais iln’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il s’agit plutôt desoulever le débat. » (Terminale BEP Signalétique, Lycéeprofessionnel, 93, Parcours scéno. Y. Klein)CERLIS (CNRS - Paris 5) 11
Le déchiffrement du système complexe desinjonctions implicites et explicites (2/4)– La distribution des rôles et des tâches entre médiateurs etenseignants : Figures sco<strong>la</strong>iresAvant d’entrer dans l’exposition, l’accompagnateur du groupe fait unesévère mise en garde aux élèves pour qu’ils se conduisent sérieusementet en les avertissant qu’ils seront notés. La conférencière tente de dissiperl’ambiance disciplinaire : « Ne pensez pas qu’à ça. Ça se passe d’abordavec moi, entre nous, ensemble ». (1ère, option informatique, Lycéeprofessionnel, 92, Parcours thématique Klein) Figures non sco<strong>la</strong>iresLorsque nous entrons dans <strong>la</strong> salle consacrée à l’instal<strong>la</strong>tion ValstarBarbie de C<strong>la</strong>ude Levêque, l’enseignante invite <strong>la</strong> conférencière à danserune valse. Les élèves sont perplexes, <strong>la</strong> prof les incite à danser : ilsréagissent assez peu au départ, puis ils finiront par se lâcher et sedéploient dans toute <strong>la</strong> salle. Elle leur dit qu’il faut qu’ils se sentent libres,qu’ils peuvent regarder de près, derrière les rideaux, toucher. Laconférencière n’ose rien dire jusqu’au moment où elle demande à tout lemonde d’arrêter de toucher et tout le monde quitte <strong>la</strong> salle… » (3 ème , 53,VCF Le mouvement des Images)CERLIS (CNRS - Paris 5) 12
Le déchiffrement du système complexe desinjonctions implicites et explicites (3/4)• 2ème p<strong>la</strong>n: le jeu réel ou faussé de l’interaction sociale- vrais ou de fausses questions- temps donné à <strong>la</strong> réponse- distribution <strong>la</strong> parole- temps donné aux œuvres- mode de choix des œuvres- manière de regarder les œuvres ensemble/ individuellement s’en approcher jusqu’à les toucher/se tenir à distance (<strong>la</strong>bonne ?) être debout, être assis ; sur invitation, spontanémentCERLIS (CNRS - Paris 5) 13
Le déchiffrement du système complexe desinjonctions implicites et explicites (4/4)• 3ème p<strong>la</strong>n: le jeu réel ou faussé de <strong>la</strong> transmission descontenusLa conférencière emmène le groupe voir Ten Lizes de Andy Warhol. Elledit : ‘Reculez, on a besoin de distance’. Un élève : ‘C’est Marylin’. Laconférencière : ‘C’est Liz Taylor, une actrice qu’on a vu dans Cléopâtre.C’est une œuvre d’Andy Warhol qui faisait partie du mouvement pop, né enAngleterre, qui se fondait sur <strong>la</strong> culture popu<strong>la</strong>ire… Pour vous <strong>la</strong> culturepopu<strong>la</strong>ire c’est le rap, les p<strong>la</strong>y stations, certaines marques ; mais c’est aussiun thème de travail d’artistes contemporains… Dans les années 60, <strong>la</strong>culture pop c’était le rock, le coca co<strong>la</strong>, le cinéma hollywoodien, Mac Donaldet aussi Kennedy qui avait un look de star. Elle explique ensuite le principede <strong>la</strong> sérigraphie. Plusieurs élèves se mettent à bavarder. Elle termine sonexplication pour les 3/4 des élèves qui continuent à l’écouter. ‘À <strong>la</strong> fin de savie, dans les années 80, il [A. Warhol] a fait d’immenses Mao’. Un élèveinterroge : ‘C’était qui Marylin Monroe ?’ » (2 nde techno. 92, VCF, Lemouvement des Images)CERLIS (CNRS - Paris 5) 14
INTERPRETATIONIMMEDIATE ET REFLECHIE
• Où l’enquêteur pourra se rendre compte que ce qu’i<strong>la</strong>vait perçu à l’observation comme une visite réussie ouratée du point de vue des interactions s’avère être unleurre• Où entre l’interprétation immédiate (sur le vif) etl’interprétation réfléchie (mémoire de <strong>la</strong> visite) que fontles élèves de l’expérience de <strong>la</strong> visite existent– un écart quant au regard que les élèves portent sur le dispositifde médiation (c<strong>la</strong>irement sur le rôle et <strong>la</strong> fonction du médiateur,– des convergences quant aux réactions vis-à-vis des œuvres (enpositif, comme en négatif).CERLIS (CNRS - Paris 5) 16
Les effetssur les catégories d’élèves visiteurs• Pour les lycéens en option AP :– Une pièce de plus dans leurparcours d’acculturationcommencé par les parents,complété par l’École Une double instrumentalisation de<strong>la</strong> visite• Pour les élèves en formationgénérale, professionnelle :– Caractère exceptionnel– Découverte du bâtiment Une expérience d’ouvertureinédite• Pour tous :– La médiation au musée est mise en question– La visite cristallise un questionnement sur l’art, sur l’œuvre d’artCERLIS (CNRS - Paris 5) 17
Critique de <strong>la</strong> médiation (1/3)• Les clés de l’évaluation par les élèves– L’interprétation relève d’un jugement éc<strong>la</strong>iré: l’acceptation d’unprincipe de médiation– L’interprétation est affaire de goût individuel: le re<strong>la</strong>tivisme dupoint de vue du médiateur– L’art contemporain justifie une médiation« G1 : pour l’art moderne, on se rend compte qu’il faut quand même être très ouvertd’esprit pour comprendre l’œuvre et arriver à bien distinguer <strong>la</strong> volonté de l’artiste :qu’est-ce qu’il a voulu nous faire passer à travers l’œuvre, c’est pour ça qu’il faut être,par rapport au musée c<strong>la</strong>ssique où on se contente de regarder pas forcément destableaux, des œuvres d’art, on y arrive quand même, alors que là c’est de l’artmoderne, et il faut essayer de comprendre ; de rentrer dans l’œuvreG2 : c’est pour ça qu’il faut un guideG1 : oui parce que là on aurait été en famille ou avec des amis, on se serait ba<strong>la</strong>dédans le musée, on n’aurait pas pu quand même, là le guide a quand même été uneaide pour comprendre l’œuvre » (3ème, 53, 2ème groupe, VCF le Mouvement desImages)CERLIS (CNRS - Paris 5) 18
Critique de <strong>la</strong> médiation (2/3)• Affirmation de soi et revendication d’une capacité àporter un jugement critique- approche compréhensive de l’œuvre: le médiateur est uneaide- approche sensible de l’œuvre: le médiateur fait écran- concurrence des expertise : le médiateur est un concurrentCERLIS (CNRS - Paris 5) 19
Critique de <strong>la</strong> médiation (3/3)• La visite muséale doit être p<strong>la</strong>cée sous le signe du p<strong>la</strong>isiret non de l’injonction⇒ La revendication d’un espace de liberté« F1 : moi je préfère <strong>la</strong> visite libre parce qu’on peut voir ce qu’on veut eton peut penser ce qu’on veut de <strong>la</strong> chose, je trouve ça mieux, c’est plusintéressant…F2 : c’est pas trop mon truc, à chaque fois qu’on fait une visite guidée, ilparle longtemps sur <strong>la</strong> chose, on peut pas penser ce qu’on veut de <strong>la</strong>chose, ils vont nous dire des trucs que eux ils pensent, c’est vrai, alorsque nous on n’a pas d’imagination » (3ème, 76, VCF Mouvement desimages)⇒ L’énonciation des conditions d’une visite idéale« F. : moi <strong>la</strong> visite idéale, ce serait sans autorité parce que autant êtrelibre, sans personnes pour nous surveiller, nous <strong>la</strong>isser libre toute uneaprès-midi, et avoir le temps de visiter. Et ça peut se faire seul ou entreamis. » (1ère prof., Lycée, 93, Parcours scéno Klein)CERLIS (CNRS - Paris 5) 20
Questionnement sur l’art contemporain:l’ouverture du procès des a priori (1/5)• Le registre des valeurs auxquels puisent les élèves pour délibérer– Valeurs pertinentes à l’univers artistique« G1 : c’est pas spécialement beauG2 : à première vue ça peut paraître <strong>la</strong>id mais si on voit l’idée de l’artiste, ça peut paraître beau.C’est l’idée qui est <strong>la</strong> plus belle. Tu trouves pas ?G1 : ouiG3 : <strong>la</strong> chose que ce<strong>la</strong> représente, moralement, qui n’est pas visible à l’œil.I : en même temps, si c’est pas visible à l’œil, comment on <strong>la</strong> voit alors ?G1 : c’est en réfléchissant ! justementG 3 : en analysant les détails … puisque tu as dit que tu n’avais pas à réfléchir : c’est contradictoire.G1 : non mais, comment dire, en fait à première vue il n’y a pas besoin de réfléchir, mais si onveut s’intégrer plus à l’œuvre, si on veut voir le côté joli, et bah il faut réfléchirG 3 : alors voilà , parce que tu as dit tout à l’heure que…I : pour vous, dans les deux types d’arts, c<strong>la</strong>ssique ou contemporain, il faut avoir des clefs …G1 : ouiG4 : l’art contemporain il est plus fait pour faire passer un message ou quelque chose, une idée, plusque pour … le côté esthétique. » (3ème, 75012, VCF, Mouvement des images)– Valeurs plus hétéronomes« Devant <strong>la</strong> voiture de Bertrand Lavier : « c’est de l’art ? Alors toutes les voitures à Créteil c’est del’art ? » (3ème, Collège, 94 )CERLIS (CNRS - Paris 5) 21
Questionnement sur l’art contemporain:l’ouverture du procès des a priori (2/5)• Une revalorisation de l’attention portée à l’artcontemporain« G : moi par exemple, je n’ai visité jusqu’à présent que des muséesc<strong>la</strong>ssiques donc là de venir au centre <strong>Pompidou</strong>, ça m’a permis dedécouvrir quelque chose de différent. Je pense que pour tout le mondequand on dit musée, pour des gens de notre âge, on pense toujours àtableau ou sculpture, antiquités ou des choses comme ça, alors que là c’estcomplètement différent, c’est pas du tout l’image qu’on a de l’art, c’estcomplètement différent » (3 ème , 53, VCF Le Mouvement des Images)« G : j’arrivais pas à imaginer le bleu Klein, c’est vrai qu’il est très particulier,spécialF1 : je m’étais fait une conception de l’art contemporain, je pensais quec’était quelque chose qui n’avait pas de sens. En fait j’ai bien aimé.F2 : c’est différent de ce que je pensais pour l’art contemporain, parce quec’est pas l’œuvre en soi mais toute une démarche qui est intéressante »(Lycée privé, 1 ère option AP, 75016, VCF Y. Klein)CERLIS (CNRS - Paris 5) 22
Questionnement sur l’art contemporain:l’ouverture du procès des a priori (3/5)• Le contact direct avec les œuvres« F: je me rappelle aussi les éponges roses. J’ai bien aimé aussi <strong>la</strong> couleurrose mais ce que j’ai préféré dans toute l’exposition c’est les toiles en bleu.On aurait dit qu’on était transportée dedans, on était vraiment attirée … lebleu était un super bleu et quand j’ai regardé on aurait dit qu’il n’y avait quece<strong>la</strong> qui existait, comme si j’étais à l’intérieur. c’était super beau. » (4 ème ,75013, VCF, Klein)« F : <strong>la</strong> voiture c’est, je sais pas si c’était vraiment un accident avant… enfinje pense pas !I : vous pensez que <strong>la</strong> voiture n’est pas une vraie voiture accidentée ?F : peut-être pas. Sinon ça serait pas une œuvre d’art ! » (3 ème , 75012, LeMouvement des images)CERLIS (CNRS - Paris 5) 23
Questionnement sur l’art contemporain:l’ouverture du procès des a priori (4/5)• Deux éléments à charge :– La valeur marchande d’œuvres perçue comme d’une exécution facile« F2 : le plus intéressant, c’était sa conception des 7 stades vers le nirvana. J’ai trouvé ça unpeu bizarre, un peu fou. Franchement c’était fou quoi … () … mettre le prix selon qu’il est austade 4 oui au stade 6, il est dans son trip à lui et il essaye de le faire partager à tout lemonde … ça n’a rien à voir avec l’art … () … c’est une démarche commerciale, pas du toutartistique, il profite de ce qu’il a du succès.F1: c’est <strong>la</strong> conception ; il a mis plein de temps à trouver son bleu, une recherche trèsspéciale, et donc qu’il mette un prix assez conséquent, même si le résultat est simpliste,c’est le prix pour <strong>la</strong> conception.F3 : on n’a jamais été fermé à l’art contemporain, donc c’est pas tellement un déclic avec dunouveau. C’est un artiste parmi d’autres intéressant à connaître ; mais il se distingue, parexemple de celui qui a pris des toilettes, parce que là, c’est une création … () … l’urinoir il l’ajuste pris pour en faire une œuvre d’art alors que le bleu, Klein l’a inventé.» (Lycée privé, 1 èreoption AP, VCF Y. Klein)– L’utilisation du corps nu dans <strong>la</strong> réalisation d’œuvres« G1: Et quand les femmes elles se mettaient de <strong>la</strong> peinture pour faire des tableaux jetrouvais pas ça bienI : C’est choquant ?G1 : ouiG2 : Les femmes … il a que ça à faire ! vraiment c’est … on va dire que c’est de l’art ! jecomprends pas » (4ème, 75013, VCF, Klein)CERLIS (CNRS - Paris 5) 24
Questionnement sur l’art contemporain:l’ouverture du procès des a priori (5/5)• Une socialisation a posteriori de l’expérience de <strong>la</strong> visite« F : moi j'en ai parlé pour foutre les boules à ma mère parce qu'elle vou<strong>la</strong>ity aller à ma p<strong>la</strong>ceI : Et elle va y aller ?F : oui bah oui on va y aller ensemble, pas obligé pour l’accompagnerparce que c'est moi qui lui en ai parlé donc j'y vais avec elle. Et puis vuqu’elle sort pas souvent aux musées, c'est bien pour sa culture même si elleen a plus que moiI : Elle connaît Klein ?F : OuiI : Elle l’apprécie ?F : Oui, mes parents apprécient Klein mais après ma mère elle est un peucomme moi, l'art contemporain, elle a du mal. Mais on va sûrement yretourner d'ici février » (1ère prof., Lycée, 93, Parcours scénographie Y.Klein)CERLIS (CNRS - Paris 5) 25
Conclusion• Lignes de tension liées à l’adolescence : Accords et désaccords entre éducation artistique enmilieu sco<strong>la</strong>ire et médiation muséale Déca<strong>la</strong>ge entre culture générationnelle et cultureinstitutionnelle Ambivalences entre l’aspiration à une visite libre etrequête d’un discours d’expert Mise en délibération des idées toutes faites etreconfiguration du système des représentationsCERLIS (CNRS - Paris 5) 26
Conclusion• Si une visite au CGP : Qu’un moment dans une journée hors établissementsco<strong>la</strong>ire, Simple étape dans une carrière de visiteur Elle est l’occasion pour les adolescents De mettre en débat le statut et <strong>la</strong> nature de l’œuvred’art De nourrir, à travers cette interrogation, leurconstruction identitaireCERLIS (CNRS - Paris 5) 27