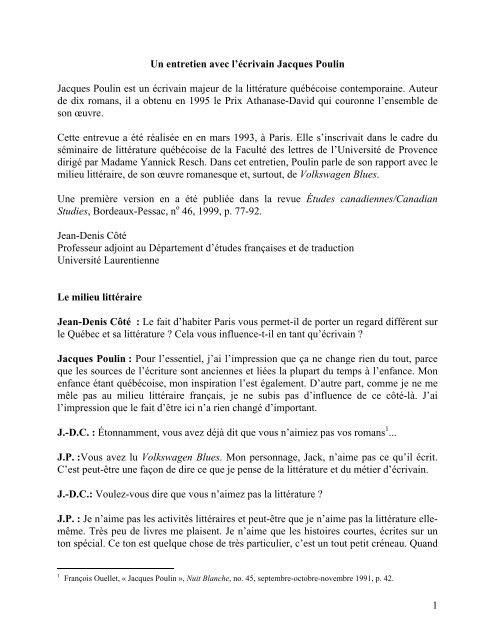1 Un entretien avec l'écrivain Jacques Poulin Jacques Poulin ... - AIEQ
1 Un entretien avec l'écrivain Jacques Poulin Jacques Poulin ... - AIEQ 1 Un entretien avec l'écrivain Jacques Poulin Jacques Poulin ... - AIEQ
Un entretien avec l’écrivain Jacques Poulin Jacques Poulin est un écrivain majeur de la littérature québécoise contemporaine. Auteur de dix romans, il a obtenu en 1995 le Prix Athanase-David qui couronne l’ensemble de son œuvre. Cette entrevue a été réalisée en en mars 1993, à Paris. Elle s’inscrivait dans le cadre du séminaire de littérature québécoise de la Faculté des lettres de l’Université de Provence dirigé par Madame Yannick Resch. Dans cet entretien, Poulin parle de son rapport avec le milieu littéraire, de son œuvre romanesque et, surtout, de Volkswagen Blues. Une première version en a été publiée dans la revue Études canadiennes/Canadian Studies, Bordeaux-Pessac, n o 46, 1999, p. 77-92. Jean-Denis Côté Professeur adjoint au Département d’études françaises et de traduction Université Laurentienne Le milieu littéraire Jean-Denis Côté : Le fait d’habiter Paris vous permet-il de porter un regard différent sur le Québec et sa littérature ? Cela vous influence-t-il en tant qu’écrivain ? Jacques Poulin : Pour l’essentiel, j’ai l’impression que ça ne change rien du tout, parce que les sources de l’écriture sont anciennes et liées la plupart du temps à l’enfance. Mon enfance étant québécoise, mon inspiration l’est également. D’autre part, comme je ne me mêle pas au milieu littéraire français, je ne subis pas d’influence de ce côté-là. J’ai l’impression que le fait d’être ici n’a rien changé d’important. J.-D.C. : Étonnamment, vous avez déjà dit que vous n’aimiez pas vos romans 1 ... J.P. :Vous avez lu Volkswagen Blues. Mon personnage, Jack, n’aime pas ce qu’il écrit. C’est peut-être une façon de dire ce que je pense de la littérature et du métier d’écrivain. J.-D.C.: Voulez-vous dire que vous n’aimez pas la littérature ? J.P. : Je n’aime pas les activités littéraires et peut-être que je n’aime pas la littérature ellemême. Très peu de livres me plaisent. Je n’aime que les histoires courtes, écrites sur un ton spécial. Ce ton est quelque chose de très particulier, c’est un tout petit créneau. Quand 1 François Ouellet, « Jacques Poulin », Nuit Blanche, no. 45, septembre-octobre-novembre 1991, p. 42. 1
- Page 2 and 3: j’écris, c’est ce créneau que
- Page 4 and 5: gens dans le domaine de la créatio
- Page 6 and 7: L’univers romanesque J.-D.C. : Da
- Page 8 and 9: J.-D.C. : Dans le premier chapitre
- Page 10 and 11: Kerouac, c’est plus un poète qu
- Page 12 and 13: J.-D.C. : Un passage de Volkswagen
- Page 14: J.-D.C. : À San Francisco, soit à
<strong>Un</strong> <strong>entretien</strong> <strong>avec</strong> l’écrivain <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong><br />
<strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong> est un écrivain majeur de la littérature québécoise contemporaine. Auteur<br />
de dix romans, il a obtenu en 1995 le Prix Athanase-David qui couronne l’ensemble de<br />
son œuvre.<br />
Cette entrevue a été réalisée en en mars 1993, à Paris. Elle s’inscrivait dans le cadre du<br />
séminaire de littérature québécoise de la Faculté des lettres de l’<strong>Un</strong>iversité de Provence<br />
dirigé par Madame Yannick Resch. Dans cet <strong>entretien</strong>, <strong>Poulin</strong> parle de son rapport <strong>avec</strong> le<br />
milieu littéraire, de son œuvre romanesque et, surtout, de Volkswagen Blues.<br />
<strong>Un</strong>e première version en a été publiée dans la revue Études canadiennes/Canadian<br />
Studies, Bordeaux-Pessac, n o 46, 1999, p. 77-92.<br />
Jean-Denis Côté<br />
Professeur adjoint au Département d’études françaises et de traduction<br />
<strong>Un</strong>iversité Laurentienne<br />
Le milieu littéraire<br />
Jean-Denis Côté : Le fait d’habiter Paris vous permet-il de porter un regard différent sur<br />
le Québec et sa littérature ? Cela vous influence-t-il en tant qu’écrivain ?<br />
<strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong> : Pour l’essentiel, j’ai l’impression que ça ne change rien du tout, parce<br />
que les sources de l’écriture sont anciennes et liées la plupart du temps à l’enfance. Mon<br />
enfance étant québécoise, mon inspiration l’est également. D’autre part, comme je ne me<br />
mêle pas au milieu littéraire français, je ne subis pas d’influence de ce côté-là. J’ai<br />
l’impression que le fait d’être ici n’a rien changé d’important.<br />
J.-D.C. : Étonnamment, vous avez déjà dit que vous n’aimiez pas vos romans 1 ...<br />
J.P. :Vous avez lu Volkswagen Blues. Mon personnage, Jack, n’aime pas ce qu’il écrit.<br />
C’est peut-être une façon de dire ce que je pense de la littérature et du métier d’écrivain.<br />
J.-D.C.: Voulez-vous dire que vous n’aimez pas la littérature ?<br />
J.P. : Je n’aime pas les activités littéraires et peut-être que je n’aime pas la littérature ellemême.<br />
Très peu de livres me plaisent. Je n’aime que les histoires courtes, écrites sur un<br />
ton spécial. Ce ton est quelque chose de très particulier, c’est un tout petit créneau. Quand<br />
1 François Ouellet, « <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong> », Nuit Blanche, no. 45, septembre-octobre-novembre 1991, p. 42.<br />
1
j’écris, c’est ce créneau que je cherche à atteindre. À chaque livre, j’ai le sentiment<br />
d’échouer, alors je recommence.<br />
J.-D.C. : Ça peut paraître surprenant de la part d’un écrivain de ne pas se mêler au milieu<br />
littéraire, de ne pas aimer la littérature.<br />
J.P. : Je sais que la plupart des écrivains aiment bien rencontrer des collègues. Ils vont à<br />
des congrès, s’<strong>entretien</strong>nent <strong>avec</strong> d’autres personnes de ce qu’ils sont en train de faire. Ils<br />
reçoivent du courrier. Ils ont une vie littéraire. Ils font tout ce que je ne fais pas ! (Rires).<br />
Chacun ses goûts. J’aime bien être tout seul dans mon coin et... un petit peu sauvage.<br />
C’est ma façon de vivre.<br />
J.-D.C. : Vous prétendez ne pas aimer la littérature. Comment expliquez-vous alors que<br />
vous vous soyez tourné vers la littérature, que vous soyez devenu écrivain ?<br />
J.P. : Je rêvais déjà d’écrire quand j’avais sept, huit ans et que je lisais les quelques livres<br />
de fiction, en particulier les contes de fée, empruntés à la bibliothèque de mes parents, qui<br />
tenaient un magasin général dans la Beauce.<br />
J.-D.C. : Vous habitez Paris, un peu comme Hemingway l’idole de Jack. Il y a une<br />
coïncidence qui paraît amusante...<br />
J.P. : À Paris, Hemingway avait reconstitué son univers. Il vivait étroitement <strong>avec</strong> ses<br />
amis américains. Il fréquentait une librairie qui s’appelait « Shakespeare and Company ».<br />
Cette librairie, où l’on trouvait des livres en anglais, était tenue par une Américaine,<br />
Sylvia Beach 2 . Je crois que lui-même ne se mêlait pas beaucoup à la vie littéraire<br />
française. C’est le seul parallèle que l’on peut faire entre Hemingway et moi ! (Rires)<br />
J.-D.C. : Lors d’une entrevue 3 , vous avez révélé que le premier manuscrit de Volkswagen<br />
Blues comportait plus de 500 pages et que l’on en avait retranché plus de 200. N’est-ce<br />
pas décevant, pour un écrivain, de mettre de côté autant de travail ?<br />
J.P. : Au contraire. C’est un travail qui me plaît beaucoup, les corrections. On enlève les<br />
choses qui n’ont pas de rapport <strong>avec</strong> l’histoire, qui sont souvent de fausses pistes que l’on<br />
suit en construisant le brouillon. Ça ne me fait pas de peine de les enlever. J’ai<br />
l’impression d’améliorer le texte en retirant ce qu’il y a de trop, tout simplement. Ça me<br />
plaît d’autant plus qu’à cette étape, il n’y a pas cette anxiété très forte que l’on a toujours<br />
au moment où l’on écrit le premier brouillon parce que l’on a peur que les mots ne<br />
viennent pas. On est inquiet en se levant le matin parce qu’on ne sait pas si on va avoir<br />
2 <strong>Poulin</strong> fait allusion à cette librairie dans son roman. Voir <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong>, Volkswagen Blues, Montréal,<br />
Québec/Amérique, 1984, p. 264. Dans les renvois subséquents, le roman sera désigné sous le sigle VB.<br />
3 Hélène De Billy, « <strong>Un</strong>e Amérique panoramique sur la pointe des pieds », Le Devoir, 19 mai 1984, p. 25 et 33.<br />
2
une panne d’écriture définitive. À l’étape des corrections, il n’y a plus ce problème, c’est<br />
merveilleux.<br />
J.-D.C. : Vous parlez des pannes d’écriture. Après plusieurs romans, est-ce qu’il vous est<br />
plus facile d’écrire aujourd’hui ?<br />
J.P. : Non, c’est le contraire. L’écriture devient plus difficile, tout simplement parce que,<br />
d’un livre à l’autre, mes exigences augmentent. Ce que j’acceptais autrefois me paraît<br />
maintenant insuffisant. À chaque livre, il faut que j’aie au moins l’impression de faire un<br />
progrès. Il faut que je m’approche un peu plus, à chaque roman, d’une espèce de « livre<br />
idéal » que j’ai en tête. D’un livre à l’autre, ce « livre idéal » revêt de nouvelles qualités.<br />
Je n’arriverai jamais à l’écrire, mais je vais essayer !<br />
J.-D.C. : Il y a différentes contraintes qui peuvent survenir lors de la rédaction d’un livre.<br />
J’aimerais aborder un aspect dont on parle peu : les contraintes financières. Les revenus<br />
des écrivains, particulièrement des écrivains québécois, sont très peu élevés. Alors,<br />
comment faites-vous pour vivre ? Avez-vous un autre métier que celui d’écrivain<br />
présentement ?<br />
J.P. : Non. Je n’ai pas d’autre métier. Je peux obtenir une bourse quand j’ai un projet<br />
d’écriture, et parfois un prix, si j’ai de la chance, et il y a les droits d’auteur de mes<br />
premiers livres. Tout ça fait la moitié d’un revenu normal, à peu près. Comme je ne<br />
dépense pas beaucoup, que je vis dans une seule pièce, et que je mange pas mal de<br />
spaghetti, j’arrive à vivre <strong>avec</strong> un demi-revenu. Je n’ai pas besoin de faire un autre travail.<br />
Pour écrire correctement, j’ai besoin de tout mon temps.<br />
J.-D.C. : Quand vous parlez de bourse, de quelle bourse s’agit-il ?<br />
J.P. : On peut obtenir une bourse du gouvernement fédéral (le Conseil des Arts) ou une<br />
bourse du ministère de la Culture, à Québec. Elles s’élèvent à environ 20 000 $<br />
(canadiens).<br />
J.-D.C. : Ce type de rémunération vous semble-t-il un bon système ?<br />
J.P. : Je ne pourrais pas écrire s’il n’existait pas. Cependant, je ne trouve pas que ce soit<br />
le système idéal. Selon moi, le meilleur système, c’est un régime général de revenu<br />
minimum garanti. Je dis un régime « général », car il ne s’adresserait pas seulement aux<br />
écrivains, mais à tout le monde. Dans ce cadre-là, les écrivains qui ont vraiment envie<br />
d’écrire à plein temps pourraient se contenter de ce petit montant qui serait, supposons, de<br />
$ 10 000 par année. Ce montant serait établi par le gouvernement. Si on indique dans<br />
notre rapport d’impôt qu’on a gagné $ 5 000, le gouvernement complète notre revenu en<br />
nous envoyant les $ 5000 manquant pour arriver au minimum. J’imagine que beaucoup de<br />
3
gens dans le domaine de la création, la musique, la littérature, les beaux-arts, ou des gens<br />
qui sont très attachés à leur travail, accepteraient de vivre <strong>avec</strong> un revenu très faible, mais<br />
qui ne les obligerait pas à faire un travail supplémentaire. Ce système empêcherait que<br />
l’écrivain soit vu comme un privilégié. Il serait considéré comme un travailleur ordinaire,<br />
qui a le droit de retirer un revenu de son travail, ce qui n’est pas le cas maintenant. Il me<br />
semble que ce système peut être instauré si on élimine les autres subventions<br />
gouvernementales, comme le bien-être social 4 ainsi que les autres formes d’aide. Sur le<br />
plan administratif, ce serait plus simple.<br />
J.-D.C. : Êtes-vous au courant de ce qui se passe au Québec, en particulier le dernier<br />
référendum 5 ?<br />
J.P. : Oui, j’ai suivi ça d’assez près, parce que des amis m’envoient toutes les semaines<br />
les journaux, Le Devoir et La Presse. Donc, je suis très attentif à tout ce qui se passe en<br />
politique, en littérature aussi. Je lis les derniers romans. Je viens d’en acheter plusieurs, au<br />
salon du livre de Paris. En ce qui concerne la politique, je pense que le Québec a tout ce<br />
qu’il faut pour être indépendant. Ça devrait être fait depuis longtemps. C’est le système le<br />
plus clair, le plus simple. Ce n’est pas un mouvement de fermeture sur soi, mais juste<br />
l’expression d’une certaine force que l’on possède. Normalement, on devrait avoir tous<br />
les pouvoirs d’un État, on devrait les prendre, sans aucune forme d’agressivité, sans<br />
exclusion, sans exclure les anglophones du Québec. Les anglophones du Québec sont<br />
aussi Québécois que ceux qui parlent français. Donc, ce n’est pas un mouvement<br />
d’agressivité contre le reste du Canada. C’est une prise de conscience de nos capacités,<br />
tout simplement.<br />
J.-D.C. : Avez-vous lu le dernier roman de Lise Tremblay, L’hiver de pluie 6 ? Quelle est<br />
votre appréciation ?<br />
J.P. : Oui, je l’ai lu. Il me semble que c’est un bon livre, car on y trouve une atmosphère<br />
très spéciale, construite <strong>avec</strong> très peu de mots. On sent l’atmosphère dès les premières<br />
phrases et elle est maintenue tout au long du livre. C’est du bon travail, je pense.<br />
J.-D.C. : Vous disiez, lors d’une entrevue, ne pas accorder d’importance à la place que<br />
vous occupez dans les lettres québécoises 7 . Cependant, l’influence que vous avez eue sur<br />
une écrivaine comme Lise Tremblay ne doit pas vous laisser indifférent 8 .<br />
4<br />
L’équivalent français du bien-être social serait le R.M.I., le Revenu Minimum d’Insertion.<br />
5<br />
On évoque ici, non pas le référendum québécois portant sur l’indépendance du Québec, mais le référendum pancanadien<br />
tenu en 1992, à Charlettetown. Le gouvernement fédéral proposait une réforme de la constitution<br />
canadienne. Le camp du NON l’a emporté.<br />
6<br />
Lise Tremblay, L’hiver de pluie, Montréal, XYZ, 1990, 108 p.<br />
7<br />
François Ouellet, op.cit. p. 42.<br />
8<br />
À ce sujet, lire l’entrevue qu’accordait Lise Tremblay à Jean Morency, « <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong> et Lise Tremblay.<br />
Québec, l’Amérique, la douceur... », Nuit Blanche, no. 45, septembre-octobre-novembre 1991, p. 44-45.<br />
4
J.P. : À mon avis, ce n’est pas vraiment une influence littéraire. C’est plutôt une affinité<br />
que nous avons, elle et moi, dans la façon de voir la ville de Québec. Ça ressemble à une<br />
influence, parce que je suis plus vieux qu’elle et que j’ai écrit avant elle, c’est tout. En<br />
réalité, nous avons tout simplement une sensibilité commune qui nous permet de voir<br />
qu’à Québec, la vie est plus lente et qu’il y a une certaine chaleur dans les rapports<br />
humains que l’on ne retrouve pas ailleurs.<br />
J.-D.C. : Le roman de Lise Tremblay, L’hiver de pluie, est extrêmement triste comme<br />
plusieurs autres romans de la littérature québécoise. Mentionnons, entre autres, les romans<br />
de Réjean Ducharme, ceux de Marie-Claire Blais et vos premiers romans. Comment<br />
expliquez-vous que les œuvres littéraires québécoises soient empreintes d’une telle<br />
tristesse ?<br />
J.P. : C’est une question pour un historien de la littérature. Je ne suis absolument pas<br />
capable de répondre à ça ! Tout ce que je peux dire, c’est que, dans les livres qui ont suivi<br />
ceux de la génération de ces gens-là, il y a beaucoup plus de diversité et d’attitudes<br />
positives par rapport à la vie. Il me semble, en tout cas que, dans [les livres de] Pauline<br />
Harvey, par exemple, ce n’est pas la tristesse qui domine. C’est plutôt la force, le goût de<br />
l’aventure. Dans <strong>Un</strong> homme est une valse, dans les livres de Louis Hamelin, dans ceux de<br />
Mistral, l’atmosphère est moins noire que dans les livres dont vous parliez, mais je ne sais<br />
pas à quoi tient ce changement.<br />
J’ai du mal à savoir dans quel sens vont mes propres livres, alors où s’en va la littérature<br />
québécoise, je ne suis pas en mesure de le dire. Je crois que ce sont les historiens qui sont<br />
les mieux placés pour le savoir.<br />
J.-D.C. : Dans l’édition française 9 de Volkswagen Blues, on a ajouté une dizaine de pages<br />
en annexe. On y trouve la traduction des passages en anglais, un glossaire d’expressions<br />
québécoises et un index des œuvres citées, dont le titre figure en anglais et qui sont<br />
traduites en France. Est-ce un ajout exigé par l’éditeur?<br />
J.P. : L’éditeur craignait que les lecteurs français soient perdus à cause de certaines<br />
expressions québécoises comme les « grandes combines » (rires), la « poudrerie », les<br />
« vadrouilles », des mots comme ça. Il a fait une liste d’expressions françaises<br />
équivalentes. En plus, il a ajouté la traduction des passages qui sont en anglais dans le<br />
texte original 10 , parce que les Français parlent très peu l’anglais. C’est la secrétaire (de<br />
l’éditeur Picollec) qui a fait la traduction et elle a ajouté un « index des personnalités »<br />
pour expliquer aux Français qui étaient Kateri Tekakouitha (Catherine Tekakwitha),<br />
Louis Riel et Maurice Richard.<br />
9 <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong>, Volkswagen Blues, Paris, Jean Picollec, 1988, 290 [11] p.<br />
10 <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong>, Volkswagen Blues, Montréal, Québec/Amérique, 1984, 290 p.<br />
5
L’univers romanesque<br />
J.-D.C. : Dans Volkswagen Blues, vous décrivez la vieille Volkswagen. Vous mentionnez<br />
la présence de graffiti, dont « une mystérieuse inscription en allemand: (...): Die Sprache<br />
ist das Haus des Seins 11 » que l’on pourrait traduire par « le langage est la maison de<br />
l’être ». C’est une inscription qui paraît significative lorsque l’on sait que Jack est un<br />
maniaque des mots et que la Grande Sauterelle affirme : « un mot vaut mille images ». 12<br />
J.P. : C’est une phrase qui m’avait intrigué quand je l’ai lue dans un ouvrage de<br />
Heidegger. Elle se trouvait au tout début du texte. Je pense que je n’ai pas très bien<br />
compris le sens de la phrase, mais elle me plaisait beaucoup. Je l’ai mise dans mon roman<br />
parce que je l’aimais, c’est tout. J’ai l’intuition que c’est une phrase importante.<br />
J.-D.C. : Toujours dans Volkswagen Blues, vous faites dire à la Grande Sauterelle: « Il ne<br />
faut pas juger les livres un par un. Je veux dire: il ne faut pas les voir comme des choses<br />
indépendantes. <strong>Un</strong> livre n’est jamais complet en lui-même; si on veut le comprendre, il<br />
faut le mettre en rapport <strong>avec</strong> d’autres livres, non seulement <strong>avec</strong> les livres du même<br />
auteur, mais aussi <strong>avec</strong> des livres écrits par d’autres personnes. Ce que l’on croit être un<br />
livre n’est la plupart du temps qu’une partie d’un autre livre plus vaste auquel plusieurs<br />
auteurs ont collaboré sans le savoir 13 ». Ce passage n’est-il pas une véritable invitation à<br />
l’intertextualité ?<br />
J.P. : Au moment où j’ai écrit ces lignes, je ne savais pas ce que l’intertextualité signifiait<br />
et je n’en sais pas beaucoup plus long aujourd’hui. Je voulais tout simplement dire qu’il<br />
faut mettre les livres en rapport les uns <strong>avec</strong> les autres pour mieux les comprendre.<br />
Cependant, les théories de l’intertextualité, je ne les connais pas du tout.<br />
J.-D.C. : Le fait de nommer autant de romans et d’écrivains, n’est-ce pas une invitation à<br />
lire les écrivains que vous aimez?<br />
J.P. : Oui. Je suis également en train de le faire dans l’histoire que j’écris en ce moment 14 .<br />
Il y a beaucoup de titres, de passages qui sont cités. Des chansons, aussi. J’ai toujours fait<br />
ça dans mes livres, je pense. Je ne sais pas pourquoi. On peut dire que c’est une manie.<br />
J.-D.C. : <strong>Un</strong> livre que vous mentionnez dans Volkswagen Blues est L’Hôtel New-<br />
Hampshire de John Irving. Vous écrivez que la Grande Sauterelle l’a lu en une seule<br />
journée 15 . Cela paraît surprenant, pour ne pas dire carrément exceptionnel !<br />
11 VB, p. 85.<br />
12 VB, p. 169.<br />
13 VB, p. 169.<br />
14 La tournée d’automne, Montréal, Leméac, 1993, 208 p.<br />
6
J.P. : C’est vrai que L’Hôtel New Hampshire est un assez gros bouquin. Le lire dans une<br />
journée, c’est vraiment un exploit, surtout que la Grande Sauterelle lisait probablement<br />
<strong>avec</strong> un minimum d’attention. Peut-être bien que dans une édition future, ce serait plus<br />
sage de dire qu’elle a mis au moins deux jours pour lire ce livre. (Rires)<br />
J.-D.C. : Le personnage-écrivain occupe une place importante dans votre œuvre. Dans<br />
Volkswagen Blues, on peut lire : « Qu’est-ce que vous faites dans la vie quand vous ne<br />
cherchez pas votre frère ? demanda la Grande Sauterelle. — Je suis écrivain, dit<br />
l’homme 16 ». Ici, on note que le personnage-écrivain ose affirmer son statut, alors que ce<br />
n’était pas le cas <strong>avec</strong> les autres personnages du même type dans les romans précédents.<br />
Par exemple, le personnage d’Amadou dans Faites de beaux rêves ne se prétend pas<br />
écrivain, mais bien « commis aux écritures ». Peut-on y voir la marque d’une plus grande<br />
assurance ?<br />
J.P. : Non, je ne pense pas que ce soit la marque d’une plus grande assurance. À chaque<br />
rire, le même problème se pose: mon personnage principal, je veux toujours qu’il ait un<br />
métier que je connais, tout simplement pour éviter les erreurs. Alors, je lui donne un<br />
métier qui, sur le plan symbolique, est à peu près l’équivalent de celui de l’écrivain 17 .<br />
Comme, par exemple, le traducteur dans Les grandes marées, le « commis aux<br />
écritures » dans Faites de beaux rêves et le « chauffeur de bibliobus » dans le livre que<br />
je suis en train d’écrire. J’ai l’impression que si je mets toujours le même personnage <strong>avec</strong><br />
le même nom et le même métier, ça va finir par être « ennuyeux ». Donc, je cherche des<br />
façons détournées de mettre en scène un écrivain.<br />
J.-D.C. : De tous les personnages que vous avez créés, quel est celui que vous préférez ?<br />
J.P. : Comme j’en suis venu à détester assez franchement mes livres, je n’aime pas trop<br />
les personnages. Mais je n’ai pas encore commencé à détester le personnage du livre que<br />
j’écris en ce moment. C’est un chauffeur de bibliothèque mobile. Je suis en train de<br />
corriger ce texte et d’améliorer mon personnage, de lui donner plus de chaleur. Comme je<br />
suis encore capable de l’améliorer, je ne le déteste pas. C’est celui que j’aime le plus.<br />
J.-D.C. : Quel est le personnage que vous aimez le moins ?<br />
J.P. : Celui que je déteste le plus (ou que j’aime le moins) est celui qui s’appelle<br />
« l’Auteur » dans Les grandes marées. C’est un écrivain qui vient de Montréal, qui a une<br />
barbe noire et qui est exécrable lorsqu’il joue au tennis <strong>avec</strong> mon traducteur.<br />
15 VB, p. 41.<br />
16 VB, p. 31.<br />
17 C’est également le cas dans son dernier roman, Chat sauvage, où le personnage se définit lui-même comme un<br />
écrivain public. Chat sauvage, Montréal/Arles, Leméac/Actes Sud, 1998, 188 p.<br />
7
J.-D.C. : Dans le premier chapitre de Volkswagen Blues, une réplique de la Grande<br />
Sauterelle : « On va faire une petite expérience, mon cher Watson 18 », établit non<br />
seulement une complicité entre les personnages, mais dévoile déjà les rôles que joueront<br />
la Grande Sauterelle et Jack dans la quête de Théo. La Grande Sauterelle apparaît comme<br />
Sherlock Holmes, <strong>avec</strong> son côté pratique et son sens de la déduction, et Jack comme<br />
Watson, <strong>avec</strong> son « espèce de brume permanente » dans sa tête.<br />
J.P. : Oui. Je n’ai pas pensé à ça quand j’écrivais, mais je trouve que c’est une idée pleine<br />
de bon sens.<br />
J.-D.C. : Vous abordez très peu le thème de la politique, à l’exception de votre premier<br />
roman, Mon cheval pour un royaume. Encore moins, de façon explicite, des notions<br />
comme l’indépendance, le nationalisme, le fédéralisme. D’une certaine façon, vous vous<br />
démarquez de plusieurs écrivains québécois. Comment expliquez-vous ce phénomène ?<br />
J.P. : Moi, j’aurais beaucoup de mal à l’expliquer, mais un de mes amis m’a donné son<br />
interprétation. Il dit que mes romans sont de petits univers fermés, comme l’île dans Les<br />
grandes marées, et le Volkswagen de Volkswagen Blues. Dans les deux cas, c’est comme<br />
une petite cellule fermée sur elle-même, un univers à part, un monde <strong>avec</strong> lequel la réalité<br />
a peu de rapports. Cette coupure entre cet univers et la réalité explique, il me semble, que<br />
les histoires de politique ou de nationalisme ne peuvent pas entrer dans mes livres.<br />
J.-D.C. : On a souvent comparé Volkswagen Blues à On the road 19 . Il y a des points<br />
communs évidents. Les personnages partent à l’aventure, sur la route, et traversent le<br />
continent américain. Cependant, il me semble que les personnages du livre de Kerouac<br />
ressemblent beaucoup plus à ceux de Faites de beaux rêves qu’à ceux de Volkswagen<br />
Blues.<br />
J.P. : Personnellement, je ne vois pas beaucoup de rapports entre le livre de Kerouac et le<br />
mien. Ce qui compte le plus pour moi, c’est l’écriture. Or, l’écriture de On the road est<br />
une sorte de grande libération. Enfin... je n’ai pas le mot qui convient mais... c’est<br />
quelqu’un qui laisse aller tous ses sentiments. Mon écriture est tout le contraire. Je me<br />
considère comme un minimaliste au sens où les Américains l’entendent, comme<br />
Raymond Carver et Richard Ford, par exemple. C’est-à-dire des gens qui essaient<br />
d’employer le moins de mots possible pour exprimer la réalité. C’est mon idéal d’écriture.<br />
Kerouac faisait exactement le contraire. Donc, pour l’essentiel, c’est-à-dire l’écriture, il y<br />
a une contradiction.<br />
18 VB, p. 23.<br />
19 La version française, Sur la route, est publiée dans la collection « Folio ».<br />
8
J.-D.C. : Vous faites allusion à Raymond Carver. <strong>Un</strong>e citation de cet écrivain est affichée<br />
dans votre appartement : « Les mots sont notre seul bien. Alors, mieux vaut choisir les<br />
bons et mettre la ponctuation au bon endroit pour qu’ils disent, au mieux, ce qu’ils sont<br />
censés dire ». Cette citation vous touche-t-elle plus particulièrement ?<br />
J.P. : Elle définit assez bien ce que Carver essayait de faire dans ses nouvelles. C’est<br />
celui qui a pratiqué le plus « l’attitude » minimaliste en littérature. C’est-à-dire qu’il allait<br />
jusqu’à enlever, quand il faisait ses corrections, les expressions littéraires, les belles<br />
tournures, les belles phrases. Il enlevait les adverbes, toutes les épithètes trop fantaisistes<br />
qui servaient à autre chose qu’à préciser. Tout ce qui n’est pas concret, il l’enlève aussi. Il<br />
ne garde que l’essentiel. Il évite même de faire des inversions dans ses phrases. Il met un<br />
sujet, un verbe, un complément. Il essaie toujours d’avoir la plus grande simplicité, le<br />
dépouillement le plus grand, la plus grande sobriété. Je pense qu’il a même un peu<br />
exagéré dans ce sens-là et, à la fin de sa vie, il essayait de remettre un peu de fantaisie.<br />
Mais d’une manière générale, cette attitude, qui doit être une exagération du style<br />
d’Hemingway, me plaît beaucoup.<br />
J.-D.C. : Vous dites qu’il y a peu de liens entre On the road et Volkswagen Blues.<br />
Cependant, vous faites allusion à Kerouac à quelques reprises dans le roman. De plus,<br />
vous avez inséré une photo des Beat angels 20 . Kerouac était le chef de file de la<br />
génération « beat » et, sur cette photo, Jack identifie son frère. Alors, on peut émettre<br />
l’hypothèse que Théo s’identifie vraiment à Jack Kerouac, surtout que, sur cette même<br />
photo, on le retrouve <strong>avec</strong> les autres membres du mouvement « beat », dont<br />
M. Ferlinghetti.<br />
J.P. : Le personnage de Théo, dans mon histoire, est celui qui ressemble le plus à<br />
Kerouac et aux gens de cette époque. Il est plus vieux que mon personnage principal et il<br />
se sent des affinités <strong>avec</strong> le groupe formant la « beat generation ». Ce n’est pas pour<br />
autant que Volkswagen Blues est une réplique de On the road. Je ne trouve pas que<br />
Volkswagen Blues soit un « road novel ». C’est un des aspects du livre, mais un aspect<br />
secondaire.<br />
J.-D.C. : D’ailleurs, après la lecture de On the road de Jack Kerouac, on arrive à la<br />
conclusion que Sal Paradise et Dean Moriarty sont plutôt des êtres égoïstes et surtout<br />
attentifs à leurs instincts. Leurs relations <strong>avec</strong> les autres sont superficielles. On arrive<br />
même à se demander comment il se fait que Jack, qui est quelqu’un de tendre et sensible,<br />
aime un écrivain comme Kerouac.<br />
J.P. : Faudrait voir si c’est vrai qu’il aime Kerouac. Je ne me souviens pas de l’avoir écrit<br />
d’une manière très claire. Il doit l’admirer plutôt, admirer sa « capacité » d’écrivain.<br />
20 VB, p. 265.<br />
9
Kerouac, c’est plus un poète qu’un romancier, pour moi. Déjà dans sa façon d’écrire et<br />
dans tout le contenu de ses textes, il me semble que c’est plus une sorte de visionnaire.<br />
J.-D.C. : « <strong>Un</strong> peu plus loin, sur la gauche, il y avait un parc appelé Washington Square.<br />
— Ah oui, dit l’homme, Kerouac venait souvent par ici.<br />
Il parlait comme si Jack Kerouac était une vieille connaissance ; à la vérité, il n’avait lu<br />
que deux de ses livres et quelques articles sur lui dans les revues 21 ». Ce n’est pas une<br />
affirmation qu’il aime Kerouac, mais au moins, il s’intéresse à cet écrivain.<br />
J.P. : Oui. Là, on sent un peu d’admiration. C’est une sorte de grand frère qui a réussi<br />
dans le même domaine que lui.<br />
J.-D.C. : Que répondriez-vous aux lecteurs qui sont déçus de la fin de Volkswagen Blues<br />
parce qu’ils la trouvent trop triste ?<br />
J.P. : Je leur dirais que la première version était encore bien pire: elle s’arrêtait lorsque<br />
Jack revoit Théo en fauteuil roulant et que celui-ci ne le reconnaît même pas. Je trouvais<br />
que c’était une fin normale, logique, mais quelqu’un à qui j’ai fait lire le texte m’a dit que<br />
c’était trop « brutal ». J’ai rédigé un chapitre supplémentaire pour décrire la séparation<br />
entre la Grande Sauterelle et le personnage principal, en ajoutant un peu de chaleur, un<br />
peu de douceur pour terminer le livre.<br />
J.-D.C. : Si le lecteur arrive au constat que c’est une fin malheureuse, c’est peut-être<br />
parce qu’il s’attarde surtout à la quête explicite, c’est-à-dire celle de Théo. En revanche, si<br />
on s’attache à la quête identitaire des deux personnages principaux, la Grande Sauterelle<br />
et Jack, on trouve plutôt une fin heureuse. Les deux personnages ont beaucoup évolué<br />
psychologiquement. De plus, le don du vieux Volks à la Grande Sauterelle et la dernière<br />
image : « les dieux des Indiens et les autres dieux étaient rassemblés et tenaient conseil<br />
dans le but de veiller sur lui et d’éclairer sa route 22 » symbolise la réconciliation entre<br />
l’Homme Blanc et l’Amérindien. Alors, on peut la voir plutôt comme une fin heureuse,<br />
non ?<br />
J.P. : La dernière image en est une d’espoir, mais ça n’empêche pas que la fin elle-même<br />
(le fait que Théo ne reconnaisse même pas Jack) est négative et triste. Mais je trouvais<br />
que l’histoire ne pouvait pas finir autrement, étant donné ce qui s’était passé avant. C’est<br />
très difficile de terminer un livre, et on est porté instinctivement vers une fin triste. Pour<br />
faire une fin heureuse, il faut un effort « spécial », en pensant quelquefois au lecteur.<br />
J.-D.C. : Quand on lit Volkswagen Blues, on se rend compte qu’il y a plusieurs passages<br />
ironiques. Ce n’est pas de l’ironie méchante, mais de la douce ironie. Entre autres, « Pas<br />
21 VB, p. 258-259.<br />
22 VB, p. 290.<br />
10
de doute, c’est un vieux fossile 23 » De même : « — On est sur la bonne route, dit-il. Je me<br />
suis conduit comme un...<br />
Il ne trouvait pas le mot juste.<br />
— ...zouave? suggéra-t-elle.<br />
— À peu près.<br />
— Vous vous êtes couvert de ridicule.<br />
— Oui.<br />
— Vous avez atteint le fond de l’ignominie.<br />
— Oui, c’est ça 24 ».<br />
De plus, lorsqu’on lit les écrivains que vous citez ou mentionnez, on se rend compte que<br />
vous êtes influencé par Brautigan et par Ducharme, où on peut relever le même genre<br />
d’ironie, sauf que Ducharme est peut-être plus noir sur ce plan.<br />
J.P. : Oui, sûrement. L’humour de Ducharme est plus désespéré. Le mien n’est pas aussi<br />
noir. Volkswagen Blues est le premier livre où il y a de l’humour. Il y en avait un peu dans<br />
Les grandes marées. Le fait d’avoir mis de l’humour m’apparaît comme un progrès. C’est<br />
signe que l’on commence à respirer plus librement. L’atmosphère se détend un petit peu.<br />
Lorsqu’on écrit, ce sont les choses tristes qui viennent d’abord. Quand on réussit à mettre<br />
un peu d’humour, c’est que l’on commence à avoir plus de métier.<br />
J.-D.C. : Le fait d’insérer de l’humour dans Volkswagen Blues permet d’établir une<br />
complicité <strong>avec</strong> le lecteur.<br />
J.P. : Oui. L’humour met une distance <strong>avec</strong> soi-même et permet au lecteur d’entrer, de se<br />
rapprocher de l’auteur.<br />
J.-D.C. : Dans vos romans, le personnage de Marie revient souvent. On le retrouve dans<br />
Les grandes marées, dans Jimmy, la petite Mary, dans Le vieux chagrin, Marika, de même<br />
que dans le chapitre IV de Volkswagen Blues, « L’écrivain idéal 25 ». Dans Le vieux<br />
chagrin, vous soulignez aussi que la femme d’Hemingway s’appelait Marie.<br />
J.P. : Ça fait beaucoup de Marie, en effet. C’est le nom que je préfère. Pour moi, c’est LA<br />
femme, ou la première. Si j’étais absolument honnête, ce serait Ève. Mais ce serait un<br />
symbole trop voyant. Alors, j’utilise le nom de Marie. C’est un beau nom, en soi. Petit,<br />
j’ai lu une poésie très naïve, dont je ne me rappelle plus le titre. Elle disait que Dieu<br />
cherchait quel nom donner à sa mère. Il avait pris les lettres du verbe « aimer », les avait<br />
laissé tomber, et les lettres en virevoltant avaient écrit par terre le nom « Marie ».<br />
23 VB, p. 127.<br />
24 VB, p. 181.<br />
25 VB, p. 41-51.<br />
11
J.-D.C. : <strong>Un</strong> passage de Volkswagen Blues me semble particulièrement touchant: « La<br />
lumière paraissait venir de l’intérieur. Elle était vive et chaleureuse comme du miel, et il<br />
ne pouvait pas s’empêcher de penser à l’Or des Incas, à la légende de l’Eldorado. C’était<br />
comme si tous les rêves étaient encore possibles. Et, pour Jack, dans le plus grand secret<br />
de son cœur, c’était comme si tous les héros du passé étaient encore des héros 26 ». Les<br />
personnages principaux, dans vos romans, sont souvent des êtres sensibles, dont<br />
l’imaginaire est particulièrement riche. La sensibilité semble un thème très important pour<br />
vous.<br />
J.P. : C’est ce que j’apprécie chez les gens, hommes ou femmes. Le sens des nuances, la<br />
capacité de réagir à ce qui se passe. Oui, c’est une qualité que j’apprécie beaucoup.<br />
J.-D.C. : Si vous pouviez réécrire Volkswagen Blues, changeriez-vous certaines choses?<br />
J.P. : Ah oui, je changerais tout ! (Rires)<br />
J.-D.C. : À ce point-là ?<br />
J.P. : Ce livre, j’ai failli l’abandonner en plein milieu du premier jet. Il me semblait qu’il<br />
n’y avait pas de rapport entre la Conquête de l’Ouest d’une part, et le fait de chercher son<br />
frère, d’autre part. Je me souviens que j’étais étendu sur mon lit, un soir, découragé à la<br />
pensée qu’il n’y avait pas de rapport entre les deux. J’avais décidé d’abandonner le<br />
roman, car je m’étais engagé sur une mauvaise piste. Je n’étais pas certain que c’était une<br />
bonne idée de traiter les deux thèmes en même temps. Il est donc possible que ce livre-là<br />
soit bâti <strong>avec</strong> des éléments qui ne vont pas ensemble du tout. Enfin, je n’en sais rien... Il<br />
m’est resté cette inquiétude fondamentale.<br />
J.-D.C. : Si Jack a une espèce de brume permanente dans sa tête, ne serait-ce pas parce<br />
qu’il vit trop dans son imaginaire ? On peut penser à l’attente du coup de fil de Sam<br />
Peckinpah et aux exploits inventés de son frère Théo...<br />
J.P. : C’est le cas de tous mes personnages, je crois. Ce sont des rêveurs. Leur contact<br />
<strong>avec</strong> la réalité n’est pas très solide.<br />
J.-D.C. : La Grande Sauterelle, après la lecture du roman de John Irving L’Hôtel New<br />
Hampshire, a particulièrement aimé le personnage de Suzie l’Ourse. Ce n’est pas<br />
vraiment surprenant puisqu’il y a des ressemblances manifestes entre les deux<br />
personnages. Par exemple, les deux ont du mal à s’accepter eux-mêmes...<br />
26 VB, p. 79.<br />
12
J.P. : C’est la raison principale pour laquelle elle aime ce personnage: Suzie L’Ourse, se<br />
déguise parce qu’elle ne s’accepte pas. La Grande Sauterelle a beaucoup de mal à trouver<br />
son identité.<br />
J.-D.C. : Dans le Nevada, Jack s’ennuie des vieilles chansons françaises. Que peut<br />
signifier le fait que cela se passe aux États-<strong>Un</strong>is?<br />
J.P. : Quand on est sur les grandes routes de l’Ouest, aux États-<strong>Un</strong>is, on met la radio et<br />
tout ce qu’on entend, c’est de la musique country. Au bout de plusieurs jours, on en a<br />
plein le chapeau. On a envie d’entendre Édith Piaf. Essayez pour voir !<br />
J.-D.C. : Vers la fin du roman, au chapitre 25, Jack et La Grande Sauterelle font la<br />
rencontre d’un vagabond dont l’auteur préféré est Jack London. Il est en train de lire The<br />
Valley of the Moon 27 . C’est ce vagabond qui leur conseille de partir pour la Californie. Il<br />
y a plusieurs similitudes entre Volkswagen Blues et ce roman. Dans le roman de London,<br />
les personnages, Saxon et Billy, sont, eux aussi, en quête. C’est la quête d’une vallée qui<br />
peut apparaître également comme celle du bonheur. Tout se déroule aussi en Californie.<br />
On fait souvent mention des pionniers de la piste de l’Oregon dans le roman. Le prénom<br />
de l’écrivain est le même que celui du personnage, Jack.<br />
J.P. : Oui, sauf que je n’ai pas lu ce livre.<br />
J.-D.C. : Je vous demande pardon? Vous ne... l’avez pas lu ?<br />
J.P. : Non. J’ai connu Jack London par un vagabond, justement, qui se promenait sur le<br />
pouce et que j’avais fait monter alors que je traversais les États-<strong>Un</strong>is. Il m’avait dit: « Tu<br />
devrais lire Jack London: c’est spécial. » Le roman de London est cité dans Volkswagen<br />
Blues parce que j’aimais beaucoup le titre 28 . C’est tout.<br />
27 La version française, La vallée de la lune, est publiée dans la collection « Bouquins » chez Robert Laffont.<br />
28 Dans son ouvrage, L’écriture de l’Autre chez <strong>Jacques</strong> <strong>Poulin</strong> (Candiac, Les Éditions Balzac, 1993, 243 p.), Anne-<br />
Marie Miraglia traite de l’intertextualité dans l’œuvre de <strong>Poulin</strong>, notamment dans Volkswagen Blues. Elle fait<br />
ressortir, de belle façon, les rapports dialogiques entre ce roman et ses intertextes. Cependant, à la lumière de l’aveu<br />
de l’auteur concernant le roman de London, on sourit lorsqu’on lit, sous la plume de Miraglia à la page 144, qu’il<br />
« est significatif que The Valley of the Moon ne soit pas lu par les protagonistes pouliniens ». En effet... L’auteur luimême<br />
ne l’a pas lu !<br />
Dans le cas présent, peut-on encore parler d’intertextualité, de rapports dialogiques entre The Valley of the Moon et<br />
Volkswagen Blues ? Oui, car le concept d’intertextualité dépasse la « définition » plutôt stricte à laquelle on pourrait<br />
songer de prime abord, soit « l’influence d’un texte sur un autre texte ». Miraglia en précise la portée : « Nous nous<br />
proposons ici d’examiner Volkswagen Blues dans ses rapports <strong>avec</strong> le discours d’autrui, c’est-à-dire, d’abord, en<br />
relation <strong>avec</strong> l’intertexte inscrit dans le roman et, ensuite, en relation <strong>avec</strong> un corpus littéraire extratextuel qui est<br />
suggéré par la thématique même du roman. La lecture dialogique du roman examine le texte littéraire au niveau du<br />
système extra-textuel : le texte représente ou simplement évoque le discours d’autrui, mais leur rapprochement et<br />
leur dissociation se développent dans l’esprit de chaque lecteur. » (p.110, Les italiques sont de nous). En ce sens,<br />
Miraglia est autorisée à proposer une lecture intertextuelle des deux romans. Ajoutons rapidement que les<br />
nombreuses analogies entre les deux romans, relevées par Miraglia et évoquées rapidement dans l’entrevue,<br />
13
J.-D.C. : À San Francisco, soit à la fin du voyage, Jack constate qu’il a oublié d’apporter<br />
une photo de Théo 29 , alors qu’il le cherchait à travers l’Amérique ! Peut-on voir cela<br />
comme un indice que la véritable quête n’est peut-être pas celle de Théo, mais bien celle<br />
de Jack lui-même?<br />
J.P. : Peut-être. Vokswagen Blues traite plusieurs thèmes. <strong>Un</strong>e nuit, je me suis réveillé et<br />
je les ai vus très clairement. Il y en avait cinq ou six, y compris la place du français en<br />
Amérique. Malheureusement, j’ai oublié de les noter. Tant pis.<br />
témoignent de la participation des deux romanciers à un même imaginaire nord-américain et qu’elles manifestent la<br />
présence de l’américanité, puisée dans l’imaginaire collectif.<br />
29 VB, p. 262.<br />
14