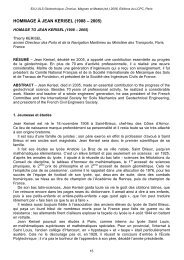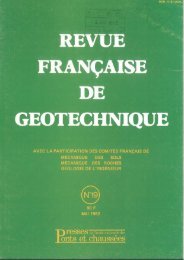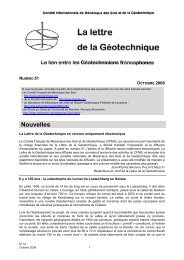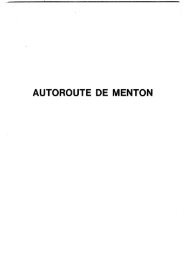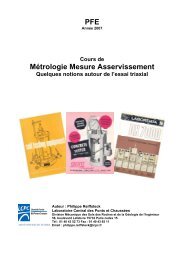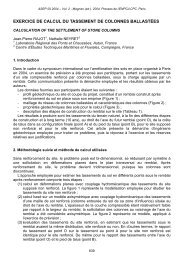La Craie
La Craie
La Craie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il semble, en fait, que les écarts les plus importants<br />
ne concernent pas les mesures à sec et à saturation,<br />
mais plutôt comparativement à celles-ci, les mesures<br />
correspondant à des teneurs en eau intermédiaires<br />
pour lesquelles on aurait une diminution des V t<br />
.<br />
Comportement de la craie, sous contraintes,<br />
en laboratoire<br />
Bien que cet aspect sorte du cadre de la présente étude,<br />
il paraît intéressant de rappeler brièvement des résultats<br />
obtenus par d'autres auteurs et concernant<br />
exclusivement la craie « roche ».<br />
Sous des contraintes statiques, Dessenne a montré<br />
qu'une craie blanche typique subit une densification<br />
pour des pressions de « confinement » élevées [7].<br />
ev<br />
<strong>La</strong> diminution de volume — atteint 15 % pour<br />
a<br />
\ — 3 ff = 900 bars. <strong>La</strong> résistance à la compression<br />
augmente très rapidement avec la densité.<br />
Par cisaillement direct, les caractéristiques suivantes<br />
ont été obtenues :<br />
— C = 20 bars (craie sèche),<br />
— C = 5 à 10 bars (craie saturée),<br />
— q> = 29°.<br />
Par ailleurs, Dessenne a mis en évidence une anisotropie<br />
de la craie, R c<br />
et V, étant maximales, et R,<br />
(résistance à la traction) minimale dans la direction<br />
perpendiculaire à la stratification.<br />
Pour les craies ayant fait l'objet de la présente étude,<br />
une anisotropie de ce type apparaît nettement par<br />
l'essai V l<br />
pour les craies du Rouvray et de Feuillères;<br />
elle est beaucoup moins nette dans les autres cas. Cela<br />
peut s'expliquer par le fait que, contrairement à la<br />
galerie d'Epernay, les zones concernées ici sont peu<br />
profondes et qu'une légère décompression a pu affecter<br />
le massif.<br />
Sous des contraintes dynamiques, la craie évolue très<br />
rapidement par fragmentation, puis pulvérisation, avec<br />
passage à l'état de « sol ». Cette transformation peut<br />
être obtenue expérimentalement :<br />
—- par vibration : dispositif EDF [8] et vibrobroyeur 5<br />
— par attrition : essai Deval adapté 5 ,<br />
— par compactage : essai de compactages répétés 5<br />
montrant, outre l'évolution de la granulométrie, la<br />
densification du matériau.<br />
Ces différents essais tentent de reproduire plus ou<br />
moins imparfaitement les conditions rencontrées sur<br />
5. L'essai de vibrobroyage a été mis au point et réalisé au LCPC<br />
par M. Struillou (Cf. à ce sujet son article : Etude par vibrobroyage<br />
de l'aptitude des craies au compactage) ; l'essai Deval<br />
adapté a été mis au point et réalisé au <strong>La</strong>boratoire de Saint-<br />
Quentin ; l'essai de compactages répétés a été réalisé au <strong>La</strong>boratoire<br />
de Rouen. Les résultats obtenus avec ces trois essais<br />
sont donnés dans l'article de M. Puig.<br />
chantier. Ce sont des tests de comportement. Ils se<br />
différencient donc nettement des essais d'identification<br />
géotechnique, à caractère plus général. Néanmoins,<br />
il est montré par ailleurs que, bien qu'empirique,<br />
l'essai de vibrobroyage en particulier peut tenir lieu<br />
d'essai d'identification.<br />
MISE EN ÉVIDENCE DU ROLE<br />
DE LA TEXTURE<br />
Le comportement très particulier de la craie, intermédiaire<br />
entre celui d'une roche et celui d'un sol, ne<br />
peut s'expliquer indépendamment de la composition<br />
minéralogique que par des caractéristiques spéciales<br />
de sa texture. <strong>La</strong> gamme de variation très étendue de<br />
ce comportement selon le type de craie considéré ne<br />
peut donc s'expliquer que par des variations de cette<br />
texture. Il est donc important de prolonger l'étude<br />
physique et mécanique par une étude plus théorique,<br />
permettant de définir de manière plus rationnelle le<br />
matériau craie.<br />
Deux méthodes d'investigation peuvent être utilisées<br />
dans ce domaine, l'une purement physique et quantitative,<br />
l'autre pétrographique, qualitative.<br />
Mesures physiques<br />
Différentes techniques ont été utilisées pour caractériser<br />
les craies.<br />
Porométrie au mercure<br />
Les diagrammes de la figure 3 montrent que dans leur<br />
quasi-totalité, les micropores des différentes craies<br />
(les macropores, d'ailleurs très peu nombreux, ne<br />
pouvant être décelés par ce procédé) ont des dimensions<br />
comprises entre 1,5 et 0,1 ii (moyenne : 0,9 à<br />
0,25 p).<br />
On remarque que les craies de Normandie se différencient<br />
globalement des autres craies par des diamètres<br />
de pores sensiblement plus grands : moyenne<br />
de 0,8 à 0,75 ii au lieu de 0,5 à 0,25 a. Seule échappe<br />
à cette règle, la craie de Belbeuf, d'âge turonien.<br />
Les courbes cumulatives sont toutes très serrées, indiquant<br />
une distribution unimodale du diamètre des<br />
pores. Cette distribution distingue assez nettement les<br />
craies d'autres roches carbonatées [10]. De même,<br />
les pores des calcaires francs sont généralement plus<br />
fins que ceux de la craie.<br />
Il n'apparaît pas possible de mettre en corrélation<br />
directement les mesures de porométrie avec le comportement<br />
des différents types de craie.<br />
Mesure de la surface spécifique<br />
Les mesures de porométrie sont corroborées par les<br />
mesures de surface spécifique réalisées avec l'appareil<br />
BET simplifié, mis au point par M. Deloye au LCPC<br />
31