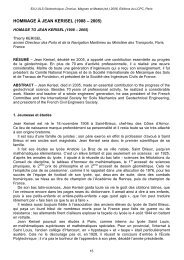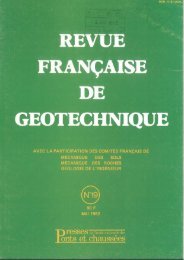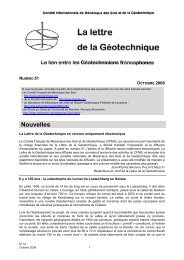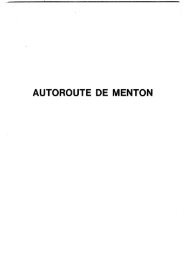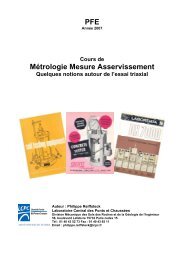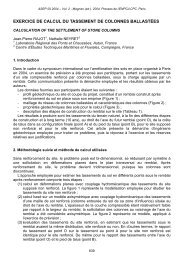La Craie
La Craie
La Craie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
grande partie disparaître les formations détritiques<br />
littorales. Toutefois, la « craie » de Villedieu suggère la<br />
proximité du rivage armoricain. Le Sénonien est<br />
presque exclusivement représenté par des craies<br />
blanches à silex dans lesquelles l'apport continental<br />
s'est limité à des arrivées de phosphates (fig. 8) et de<br />
silice dissous. Les craies blanches sont pratiquement<br />
dépourvues de fraction détritique sableuse ou marneuse<br />
(fig. 2).<br />
On ne sait si la mer s'est retirée à la findu Sénonien<br />
ou au Maestrichtien. Si des sédiments de ces âges se<br />
sont déposés dans le Bassin parisien, ils ont été entièrement<br />
déblayés par l'érosion post-crétacée.<br />
Pendant longtemps, la craie a été considérée comme<br />
l'équivalent fossile des actuelles boues à Globigérines<br />
que l'on rencontre au fond des océans Atlantique et<br />
Pacifique à des profondeurs excédant 1 000 m.<br />
L.Cayeux a vivement critiqué cette assimilation. Il a<br />
établi à partir de l'examen des macrofossiles que la<br />
craie s'est déposée sous une tranche d'eau inférieure<br />
à 250 m. Tous les résultats récents confirment l'hypothèse<br />
de Cayeux.<br />
Les terres émergées fournissaient à la sédimentation<br />
marine du matériel détritique sableux et argileux. Ce<br />
transport a atteint son maximum au Cénomanien,<br />
puis s'est progressivement réduit au cours du Turonien<br />
pour disparaître au Sénonien. Par contre, l'apport<br />
des éléments dissous, générateurs de glauconie, de<br />
silex et de phosphates, semble être resté important<br />
tout au long du Crétacé supérieur. Pour expliquer<br />
ce phénomène, l'hypothèse de masses continentales<br />
à peu près complètement arasées et pénéplanées dès<br />
le Turonien, a été proposée (Bailey 1923). L'érosion,<br />
cessant peu à peu, les apports détritiques diminueront.<br />
<strong>La</strong> théorie de la biorhésistasie (Ehrardt 1934) a conduit<br />
à une explication complètement différente. A l'idée<br />
d'un désert, s'est substituée celle d'un continent<br />
soumis à un climat humide et relativement chaud,<br />
Manche orientale<br />
vosgien<br />
•vosgien<br />
Fig. 14. — Le Bassin parisien au Cénomanien.<br />
Fig. 15. — Le Bassin parisien au Turonien.<br />
Emplacement approximatif des rivages de la mer<br />
Limites actuelles des sédiments de l'étage considéré<br />
Terres émergées<br />
Massif<br />
vosgien<br />
mor vano- vosg len<br />
Fig. 16. — Le Bassin parisien au Sénonien inférieur<br />
(= Conacien + Santonien).<br />
Fig. 17. — Le Bassin parisien au Sénonien supérieur ( = Campanien).<br />
21