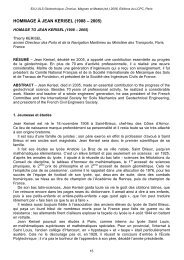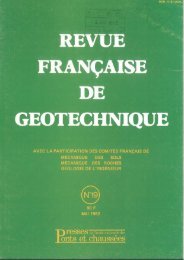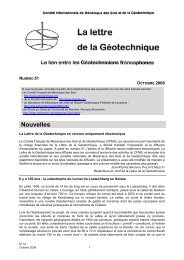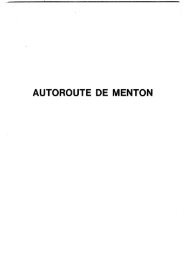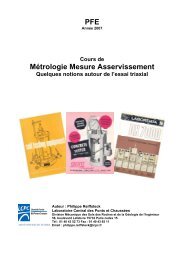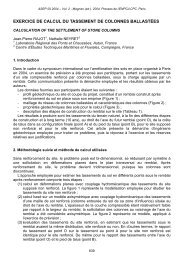La Craie
La Craie
La Craie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PÉTROGRAPHIE DES CRAIES<br />
Buffon s'intéressa le premier à la composition de la<br />
craie et fut suivi en cette voie par bien d'autres.<br />
Lucien Cayeux apporta les résultats fondamentaux.<br />
Sa magistrale Contribution à Vétude micrographique<br />
des roches sédimentaires [7] est consacrée, pour une<br />
part, aux craies du bassin de Paris. Publié en 1897,<br />
cet ouvrage fit autorité durant soixante ans et sa<br />
lecture reste encore aujourd'hui indispensable.<br />
Classiquement, l'étude pétrographique d'une craie<br />
nécessite quatre types d'examens :<br />
— les analyses chimiques et aux rayons X ;<br />
— le lavage et tamisage sous un filet d'eau. Les tamis<br />
les plus couramment employés ont des mailles de<br />
360 et 160 microns ; les résidus séchés sont examinés<br />
à la loupe binoculaire à de faibles grossissements (de<br />
10 à 50 fois) ;<br />
— le frottis qui consiste en l'examen au microscope<br />
optique, à de forts grossissements (de 1 000 à 1 500<br />
fois), de quelques gouttes d'eau dans lesquelles a été<br />
délayée une petite quantité de craie ;<br />
— la lame mince ou plaquette de craie collée sur une<br />
lame de verre et amenée à l'épaisseur de 25 à 50<br />
microns. <strong>La</strong> lame est examinée à la loupe ou au microscope<br />
(fig. 2, 3, 4, 7, 8 et 9).<br />
Les trois premières méthodes sont analytiques car on<br />
considère isolément les différents constituants chimiques,<br />
minéralogiques et paléontologiques. <strong>La</strong> dernière,<br />
par contre, est synthétique et tient compte à la fois<br />
des éléments constitutifs en place et de leur arrangement<br />
réciproque. J. Cuvillier a proposé de désigner<br />
cette image globale, ce « paysage sédimentaire », par<br />
le nom de « microfaciès ».<br />
Chimiquement et minéralogiquement, la craie est une<br />
roche presque entièrement formée de carbonate de<br />
calcium CaC0 3<br />
, à l'état de calcite. Son pourcentage<br />
peut dépasser 90, voire 95 %. Il peut s'y ajouter de<br />
la dolomite Mg Ca(C0 3<br />
) 2<br />
, du phosphate de calcium<br />
Ca 3<br />
(P0 4<br />
) 2<br />
, de la glaucome 6 , des argiles, de la silice,<br />
des sulfures de fer, en proportions variables. Lorsque<br />
la teneur en l'un de ces composants devient élevée,<br />
on distingue des craies dolomitiques, phosphatées,<br />
glauconieuses, marneuses ou des tuffeaux.<br />
<strong>La</strong>vages, frottis et lames minces révèlent la morphologie<br />
des constituants précédents. Depuis les travaux<br />
de Cayeux, on a pris l'habitude de distinguer dans<br />
les craies, comme d'ailleurs dans toute roche sédimentaire<br />
:<br />
—• les fragments détritiques provenant du démantèlement<br />
de roches préexistantes et resédimentés au fond<br />
des mers crétacées. C'est la fraction « héritée » ;<br />
— les restes des organismes ayant vécu autrefois dans<br />
ces mers. Le plus souvent, seules les parties initiale-<br />
6. <strong>La</strong> glauconie est un silicate hydraté de Fe et de K qui se présente<br />
en grains arrondis de couleur verte plus ou moins foncée.<br />
7. Ensemble des transformations subies par les sédiments postérieurement<br />
à leur dépôt.<br />
ment minéralisées ont été fossilisées. Elles sont complètes<br />
ou brisées en morceaux de taille variable ;<br />
— les minéraux de néoformation formés au moment<br />
de la sédimentation ou après au cours de la diagenèse 7 .<br />
Les fragments détritiques de grande taille ne sont pas<br />
courants dans les craies. Dans celles du Nord, de la<br />
Picardie et plus rarement du pays de Caux, des galets<br />
isolés de granité, de quartzite, de schiste et de houille,<br />
ont été rencontrés. Les grains de petite taille (de<br />
l'ordre du millimètre ou au-dessous) sont plus fréquents,<br />
les quartz abondent au Cénomanien. Les<br />
minéraux lourds : rutile, tourmaline, grenat, zircon,<br />
se trouvent quelquefois. Certaines argiles (montmorillonite)<br />
appartiennent à la fraction héritée èt représentent<br />
jusqu'à 40 % du total de la roche au<br />
Turonien inférieur. Les craies blanches, très pures,<br />
du Sénonien supérieur, sont presque totalement dépourvues<br />
d'éléments détritiques.<br />
Les organismes entiers ou en débris forment une<br />
portion importante des craies. A côté des grands<br />
fossiles qui sont, somme toute, accessoires, une foule<br />
de menus fragments d'origine organique s'observe<br />
au microscope : spicules de Spongiaires, débris de<br />
Bryozoaires (fig. 2), de Mollusques, d'Echinides (fig.<br />
3), accompagnés de microfossiles de petite taille (de<br />
0,1 à 1 mm) tels que des Ostracodes et des Foraminifères.<br />
Ces derniers peuvent être fort nombreux ; dans<br />
certaines craies picardes, leur nombre a été évalué à<br />
3 700 individus par 10 g de roche. Enfin, aux très<br />
forts grossissements, le microscope permet d'apercevoir<br />
des fossiles encore plus petits : Pithonelles (fig. 4),<br />
coccolithes (fig. 5) et Nannoconus (fig. 6) dont la taille<br />
avoisine 20 à 50 p. Ce sont les nannofossiles.<br />
Plusieurs minéraux de néoformation sont probablement<br />
d'origine biochimique, résultat de l'activité<br />
biologique de bactéries. On explique ainsi la formation<br />
des grains de glauconie (fig. 7), des boules de marcassite,<br />
du phosphate (fig. 8). <strong>La</strong> mise en place des silex<br />
et la dolomitisation (fig. 9) se comprennent encore mal.<br />
On constate cependant que cette dernière est localisée<br />
dans les régions affectées de plissements ou de failles<br />
(vallée de la Seine, bombement de Beynes, de Compiègne).<br />
Tous ces constituants sont noyés dans une matrice<br />
que les techniques classiques ne permettent pas d'analyser.<br />
Cayeux a appelé cette matrice « ciment » et l'a<br />
considérée comme « la somme des éléments minéraux<br />
et organiques de dimension tellement exiguë qu'il est<br />
impossible d'en préciser la forme et la nature ».<br />
L'utilisation récente depuis 1966 (D. Noël [9]) du<br />
microscope électronique qui permet des grossissements<br />
importants jusqu'à 50 000 fois, a considérablement<br />
accru nos connaissances. Contrairement à ce qui est<br />
de règle avec le microscope optique, où l'observation<br />
porte sur une certaine épaisseur de roche vue par<br />
transparence, en microscopie électronique, la surface<br />
seule du matériau — obtenue par simple cassure —<br />
est prise en considération. L'observation porte sur<br />
une fraction de la roche non modifiée, dans laquelle<br />
les différents constituants sont intacts et « in situ ».<br />
13