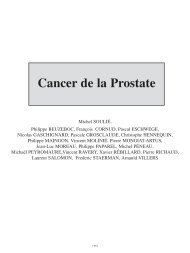Le traitement chirurgical de la maladie de Lapeyronie - Urofrance
Le traitement chirurgical de la maladie de Lapeyronie - Urofrance
Le traitement chirurgical de la maladie de Lapeyronie - Urofrance
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TECHNIQUE CHIRURGICALE Progrès en Urologie (1996), 6, 963-973<br />
<strong>Le</strong> <strong>traitement</strong> <strong>chirurgical</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong><br />
Vincent GRISONI, Dominique ROSSI<br />
Service d’Urologie, Hôpital Salvator, Marseille, France<br />
RESUME<br />
La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong> est à l’origine d’une<br />
courbure <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge pouvant rendre douloureux<br />
voire empêcher les rapports sexuels. Un <strong>traitement</strong><br />
<strong>chirurgical</strong> peut être proposé lorsque <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que est<br />
stable <strong>de</strong>puis au moins 6 mois et après échec du <strong>traitement</strong><br />
médical. Il a pour but <strong>de</strong> restituer une érection<br />
autorisant <strong>la</strong> pénétration. L’examen après un<br />
test intra-caverneux permet d’apprécier <strong>la</strong> déformation<br />
et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’érection. Ces <strong>de</strong>ux données<br />
objectives semblent déterminantes dans le choix <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> technique <strong>la</strong> plus adaptée. Deux groupes <strong>de</strong><br />
métho<strong>de</strong>s existent : d’une part les p<strong>la</strong>sties mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ntes<br />
<strong>de</strong>s corps caverneux (résections et plicatures<br />
<strong>de</strong> l’albuginée, excision-greffe) et d’autre part les<br />
imp<strong>la</strong>ntations <strong>de</strong> prothèses (semi-rigi<strong>de</strong>s, gonf<strong>la</strong>bles<br />
et imp<strong>la</strong>nts souples). Ce travail fait une revue <strong>de</strong>s<br />
différentes techniques <strong>chirurgical</strong>es et propose un<br />
organigramme décisionnel basé sur le résultat du<br />
test intra-caverneux.<br />
Mots clés : Ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong>, <strong>traitement</strong> <strong>chirurgical</strong>.<br />
Progrès en Urologie (1996), 6, 963-973.<br />
La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong> [27] ou induration p<strong>la</strong>stique<br />
<strong>de</strong>s corps caverneux est une fibrose segmentaire <strong>de</strong><br />
l’albuginée <strong>de</strong>s corps caverneux. La lésion <strong>de</strong> base ou<br />
p<strong>la</strong>que fibreuse se manifeste sous <strong>la</strong> forme d’un noyau<br />
ovoï<strong>de</strong> plus ou moins étendu siégeant le plus souvent<br />
sur <strong>la</strong> face dorsale <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge. Elle correspond à une<br />
accumu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> fibres col<strong>la</strong>gènes très <strong>de</strong>nses pouvant<br />
évoluer vers l’apparition <strong>de</strong> carti<strong>la</strong>ge, voire d’ossification.<br />
Elle est responsable d’une modification localisée<br />
<strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>sticité du corps caverneux engendrant à l’érection<br />
une courbure <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge [15]. La courbure est centrée<br />
sur le noyau fibreux donc habituellement en arrière<br />
et en haut. Elle conduit à une difficulté ou une<br />
impossibilité <strong>de</strong> pénétration. Ces critères permettent<br />
d’éliminer les fibroses caverneuses, ma<strong>la</strong>die propre du<br />
tissu érectile et dont le <strong>traitement</strong> est différent <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong>.<br />
Cette ma<strong>la</strong>die atteint l’homme généralement entre 40 et<br />
70 ans, son apparition est rapi<strong>de</strong> et elle évolue selon<br />
<strong>de</strong>ux phases. La première, active ou inf<strong>la</strong>mmatoire,<br />
dure habituellement 6 à 18 mois et se traduit par le<br />
développement d’un nodule, <strong>de</strong>s douleurs et une courbure.<br />
Puis <strong>la</strong> phase chronique s’installe, les douleurs à<br />
l’érection diminuent ou disparaissent, les nodules restent<br />
stables et <strong>la</strong> déformation en érection persiste. Il<br />
existe quelques rares cas où <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que puis l’incurvation<br />
disparaissent après plusieurs années d’évolution<br />
[ 11, 41]. <strong>Le</strong> diagnostic est avant tout clinique.<br />
L’imagerie par échographie ou résonance magnétique<br />
nucléaire peut ai<strong>de</strong>r à préciser le siège exact <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>que quand celle-ci est difficilement palpable [40].<br />
L’étiologie et <strong>la</strong> physiopathologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong><br />
<strong>Lapeyronie</strong> <strong>de</strong>meurent inconnues et ont conduit à expérimenter<br />
d’innombrables <strong>traitement</strong>s médicaux : <strong>la</strong><br />
vitaminothérapie (A et/ou E), le para amino benzoate<br />
<strong>de</strong> potassium, <strong>de</strong>s cytostatiques (procarbazine), <strong>de</strong>s<br />
antihistaminiques (terfenadine), <strong>la</strong> colchicine, le<br />
tamoxifène, <strong>la</strong> testostérone, l’orgotéïne, l’injection<br />
locale d’enzymes, les corticoï<strong>de</strong>s locaux ou généraux,<br />
les ultrasons, l’irradiation par 15 Grays... Hormis un<br />
effet antalgique pour certains, aucun <strong>de</strong> ces <strong>traitement</strong>s<br />
n’a fait <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> son efficacité.<br />
Un <strong>traitement</strong> <strong>chirurgical</strong> peut être proposé <strong>de</strong>vant<br />
une courbure invalidante, sur <strong>de</strong>s lésions stables<br />
<strong>de</strong>puis au moins 6 mois et après échec du <strong>traitement</strong><br />
m é d i c a l . Il a pour objectif <strong>de</strong> restituer une érection<br />
autorisant <strong>la</strong> pénétration. Diverses métho<strong>de</strong>s ont été<br />
proposées que l’on peut séparer en <strong>de</strong>ux groupes : les<br />
techniques visant à restaurer au corps caverneux une<br />
é<strong>la</strong>sticité et une résistance homogène et les imp<strong>la</strong>ntations<br />
<strong>de</strong> prothèse d’érection. <strong>Le</strong> but <strong>de</strong> cet article est<br />
<strong>de</strong> décrire et <strong>de</strong> préciser les indications <strong>de</strong>s principales<br />
techniques du <strong>traitement</strong> <strong>chirurgical</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
<strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong>.<br />
PLASTIES MODELANTES DES CORPS<br />
CAVERNEUX<br />
Considérations générales<br />
Ces interventions visent à redonner aux corps érectiles<br />
une symétrie permettant une érection droite. Pour ce<strong>la</strong>,<br />
il existe <strong>de</strong>ux possibilités : soit raccourcir le corps<br />
caverneux le plus long par une résection ou une plicature,<br />
soit allonger le corps caverneux le plus court en<br />
Manuscrit reçu : mars 1996, accepté : juin 1996.<br />
Adresse pour correspondance : Pr. D. Rossi, Service d’Urologie (Pr. G. Serment),<br />
Hôpital Salvator, 249, Bd. <strong>de</strong> Sainte-Marguerite, 13009 Marseille.<br />
963
excisant <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que et en <strong>la</strong> remp<strong>la</strong>çant par une greffe.<br />
Ces techniques s’appliquent aux courbures liées à <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong> mais aussi aux courbures<br />
congénitales ou post-traumatiques.<br />
<strong>Le</strong>s voies d’abord<br />
• Voie circonférentielle (Figure 1) : une incision <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
muqueuse 5 mm sous <strong>la</strong> couronne du g<strong>la</strong>nd, puis un<br />
décollement <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong>s tissus sous-cutanés permettent<br />
d’exposer les corps caverneux jusqu’à <strong>la</strong> racine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> verge. L’abord du corps caverneux se fait après<br />
ouverture du fascia <strong>de</strong> Bück en regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone à corriger.<br />
Celui-ci sera ensuite refermé par <strong>de</strong>s points séparés<br />
résorbables. Une résection du prépuce chez le<br />
patient non circoncis sera réalisée systématiquement<br />
car cet abord expose à un risque élevé <strong>de</strong> nécrose du<br />
prépuce et <strong>de</strong> phimosis acquis. Aucun drainage n’est<br />
nécessaire. Un pansement compressif évite l’hématome<br />
post-opératoire.<br />
Cette voie simple permet un abord <strong>la</strong>rge <strong>de</strong>s corps<br />
caverneux, donc une correction <strong>de</strong> presque tous les<br />
types d’angu<strong>la</strong>tion.En cas <strong>de</strong> déviation très proximale<br />
on réalisera une contre-incision péno-pubienne ou<br />
péno-scrotale (Figure 2) [29]. En extériorisant <strong>la</strong> verge<br />
par une <strong>de</strong> ces contre-incisions, on obtient un accès à <strong>la</strong><br />
zone <strong>la</strong> plus proximale <strong>de</strong>s corps caverneux mais aussi<br />
au ligament suspenseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge.<br />
• Voie médiane sur le raphé (Figure 3) : Tout aussi<br />
simple, elle permet un abord satisfaisant <strong>de</strong> <strong>la</strong> face ventrale<br />
et ne nécessite pas <strong>de</strong> circoncision [25, 33].<br />
• Voie en regard <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone à réséquer ou à plicaturer :<br />
Elle évite l’oedème et le risque <strong>de</strong> nécrose cutanée.<br />
Mais <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que palpable ne correspond pas toujours au<br />
seul point <strong>de</strong> courbure ce qui conduit souvent à <strong>de</strong>voir<br />
multiplier les incisions. Elles peuvent être axiale,<br />
oblique [14] ou en «z» [7].<br />
La création <strong>de</strong> l’érection se fait par ponction d’un<br />
corps caverneux avec un cathéter souple <strong>de</strong> 16 ou 19<br />
Gauge en injectant du sérum salé isotonique après mise<br />
en p<strong>la</strong>ce d’un garrot (drain souple) à <strong>la</strong> racine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
v e rg e . L’utilisation d’un produit vasodi<strong>la</strong>tateur est<br />
aussi possible et n’expose pas à <strong>de</strong>s problèmes hémorragiques.<br />
La son<strong>de</strong> uréthrale : sa mise en p<strong>la</strong>ce n’est pas indispensable.<br />
<strong>Le</strong> fil : Pour suturer les corps caverneux on utilise un<br />
fil non résorbable soli<strong>de</strong> (polypropylène 3) [24]. <strong>Le</strong>s<br />
fils plus fins résorbables exposent au risque <strong>de</strong> récidive<br />
précoce par lâchage <strong>de</strong> suture.<br />
La présence <strong>de</strong>s fils peut produire un granulome, une<br />
surinfection ou occasionner une gêne pour le patient ou<br />
sa partenaire lors <strong>de</strong>s rapports. On prendra donc soin <strong>de</strong><br />
couper les fils courts, <strong>de</strong> les recouvrir en fermant le fascia<br />
<strong>de</strong> Buck par <strong>de</strong>ssus, d’enfouir les noeuds ou <strong>de</strong> réaliser<br />
<strong>de</strong>s points inversants [4, 25].<br />
Anesthésie : elle peut être générale, loco-régionale<br />
voire locale [3, 24]. <strong>Le</strong> bloc pénien à <strong>la</strong> xylocaïne est<br />
une alternative séduisante.<br />
La p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s <strong>traitement</strong>s évitant les érections post opé -<br />
ratoires (Imipramine, Estrogènes..) : Ces produits font<br />
difficilement disparaître toute érection et leur efficacité<br />
est retardée. Dans notre expérience, ces <strong>traitement</strong>s<br />
ne semblent pas indispensables.<br />
Intervention <strong>de</strong> Nesbit<br />
Initialement décrite en 1965 [31] pour traiter <strong>de</strong>s courbures<br />
congénitales sans hypospadias, elle fut adaptée à<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong> en 1979 [36]. Son principe<br />
est <strong>de</strong> raccourcir l’albuginée au sommet <strong>de</strong> <strong>la</strong> convexité<br />
en excisant <strong>de</strong>s quartiers d’oranges sur <strong>la</strong> face opposée<br />
à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que, celle-ci étant respectée (Figure 4 a) . La<br />
voie d’abord sera circonférentielle. On prendra soins<br />
<strong>de</strong> repérer les éléments à respecter situés sur <strong>la</strong> face à<br />
exciser (convexité), c’est à dire l’urèthre pour les courbures<br />
dorsales et les pédicules vasculo nerveux pour les<br />
courbures ventrales. On crée une érection artificielle.<br />
La mise en p<strong>la</strong>ce d’un point d’essai prenant toute<br />
l’épaisseur <strong>de</strong> l’albuginée permettra d’estimer <strong>la</strong> longueur<br />
d’albuginée à exciser, c’est à dire <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur du<br />
ou <strong>de</strong>s quartiers d’orange. Il faut en moyenne réséquer<br />
1 mm pour corriger 10° [16] <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’albuginée<br />
se fera à points séparés <strong>de</strong> fils non résorbables . La<br />
longueur <strong>de</strong>s ellipses doit être égale au tiers ou à <strong>la</strong><br />
moitié <strong>de</strong> <strong>la</strong> circonférence, ce qui impose pour <strong>la</strong> correction<br />
<strong>de</strong>s courbures dorsales <strong>de</strong> libérer totalement le<br />
corps spongieux du corps caverneux [3].<br />
Résultats : entre 82 et 100 %<strong>de</strong> bons résultats [14, 16,<br />
37].<br />
Inconvénients : <strong>Le</strong> raccourcissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge est<br />
constant. Il est d’autant plus important que <strong>la</strong> courbure<br />
est prononcée (en moyenne <strong>de</strong> 1 à 3 cm). Ce raccourcissement<br />
n’entraîne généralement pas <strong>de</strong> conséquences<br />
sur <strong>la</strong> possibilité d’avoir <strong>de</strong>s rapports sexuels.<br />
En cas d’hyper-correction, il <strong>de</strong>vient nécessaire <strong>de</strong> réaliser<br />
une excision du coté <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que ce qui raccourcit<br />
d’autant plus <strong>la</strong> verge. L’excision <strong>de</strong> fragment d’albuginée<br />
conduit à un traumatisme du tissu érectile sous<br />
jacent qui est généralement déjà <strong>de</strong> mauvaise qualité.<br />
D’autre part, elle est source d’hémorragie peropératoire<br />
et donne souvent (30%) <strong>de</strong>s zones d’hypoesthésie.<br />
Enfin, il existe un risque <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ie uréthrale, sans conséquence<br />
si elle est réparée.<br />
Techniques dérivées <strong>de</strong> l’intervention <strong>de</strong> Nesbit<br />
KELAMI [22] conseille <strong>de</strong> corriger <strong>la</strong> courbure en disposant<br />
<strong>de</strong>s pinces d'Allis sur <strong>la</strong> convexité du corps<br />
964
caverneux puis en réséquant les ellipses ainsi délimitées.<br />
La fermeture <strong>de</strong> l'albuginée se fait par un surjet en<br />
«U» <strong>de</strong> monofi<strong>la</strong>ment 3/0.<br />
Une variante consiste en une incision l'albuginée dans<br />
l'axe <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge au sommet <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbure suivie d'une<br />
fermeture transversale (Figure 4b), une autre consiste<br />
en un <strong>la</strong>mbeau d'avancement.<br />
<strong>Le</strong>s plicatures <strong>de</strong> l’albuginée<br />
Décrites en 1985 par ESSED et SCHROEDER [16] et par<br />
METZ et EBBEHOJ [12], on réalise <strong>de</strong> <strong>la</strong> même façon un<br />
abord <strong>de</strong> l'albuginée et une érection artificielle. <strong>Le</strong>s<br />
points assurant <strong>la</strong> plicature doivent être soli<strong>de</strong>s et charger<br />
<strong>la</strong>rgement l'albuginée. Ils sont p<strong>la</strong>cés à cheval sur le<br />
sommet <strong>de</strong> <strong>la</strong> convexité. <strong>Le</strong>s noeuds sont serrés après<br />
vidange <strong>de</strong>s corps caverneux et une nouvelle érection<br />
permet d'apprécier le résultat. En cas <strong>de</strong> correction<br />
insuffisante, une <strong>de</strong>uxième série <strong>de</strong> plicatures est effectuée.<br />
En cas d'hyper-correction, il est aisé <strong>de</strong> couper les<br />
fils et <strong>de</strong> les repositionner. La longueur <strong>de</strong> chaque plicature<br />
ne doit pas excé<strong>de</strong>r 10 mm pour éviter <strong>la</strong> réduction<br />
<strong>de</strong> circonférence <strong>de</strong>s corps caverneux à l'origine<br />
d'aspect en sablier. Une plicature <strong>de</strong> 10 mm permet <strong>de</strong><br />
corriger une angu<strong>la</strong>tion d'environ 30°.<br />
La correction d'une courbure dorsale peut se faire par<br />
une série <strong>de</strong> points séparés sur toute <strong>la</strong> face ventrale<br />
(Figure 5a) imposant alors une dissection du corps<br />
spongieux ou plus simplement par <strong>de</strong>s points mis <strong>de</strong><br />
part et d'autre <strong>de</strong> l'urèthre (Figure 5b). <strong>Le</strong>s points seront<br />
en «U» ou <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> Klevmark [24] (Figure 5c). La<br />
détermination <strong>de</strong> l'emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s points peut être<br />
facilitée par l'utilisation <strong>de</strong> crochets <strong>de</strong> Gillies [16].<br />
Initialement réalisée après une radiothérapie systématique,<br />
cette <strong>de</strong>rnière semble inutile au vu <strong>de</strong>s résultats.<br />
Avantages par rapport à <strong>la</strong> technique <strong>de</strong> Nesbit : La<br />
rapidité. On évite le traumatisme du tissu érectile source<br />
<strong>de</strong> dysérection post-opératoire. En cas d'hyper-correction,<br />
il est possible <strong>de</strong> recommencer puisqu'aucune<br />
résection n'a été réalisée. Il n'existe pas <strong>de</strong> zone d'hypoesthésie<br />
ni d'impuissance secondaire, les dysérections<br />
secondaires ont une autre étiologie dans 85% <strong>de</strong>s<br />
cas [22, 32].<br />
Inconvénients : Comme le Nesbit, <strong>la</strong> plicature entraîne<br />
un raccourcissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge. Pour <strong>la</strong> correction <strong>de</strong>s<br />
angu<strong>la</strong>tions très marquées (supérieure à 90°), afin d'éviter<br />
les sutures sous tensions, il est parfois indispensable<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>isser 10 à 20° <strong>de</strong> courbure ce qui n'entrave habituellement<br />
pas les rapports.<br />
<strong>Le</strong>s techniques mixtes : résection-greffe d’albuginée<br />
[21]<br />
Décrite par GOLDSTEIN et BLUMBERG, elle consiste à<br />
redresser <strong>la</strong> verge par excision suture d' ellipses d'albuginée<br />
sur <strong>la</strong> face convexe. Puis <strong>la</strong> ou les p<strong>la</strong>ques sont<br />
réséquée (s), cette perte <strong>de</strong> substance sera couverte par<br />
les ellipses prélevées précé<strong>de</strong>mment.<br />
<strong>Le</strong>s résections-greffes <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que<br />
Ces techniques consistent à enlever <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que et à remp<strong>la</strong>cer<br />
<strong>la</strong> perte <strong>de</strong> substance par un greffon (Figure 6).<br />
De très nombreux matériaux ont été testés mais aucun<br />
n'a permis <strong>de</strong> retrouver les caractéristiques biomécaniques<br />
<strong>de</strong> l'albuginée. Ainsi, les premières autogreffes<br />
ont été réalisées en 1950 avec <strong>de</strong>s <strong>la</strong>mbeaux graisseux<br />
libres [29] puis en 1974 avec <strong>de</strong>s <strong>la</strong>mbeaux <strong>de</strong>rmiques<br />
[10, 45], mais aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> vaginale [38], du fascia temporalis<br />
[20], <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau du prépuce, <strong>de</strong>s patch veineux<br />
[5, 6], artériel...Tous ces matériaux sont flexibles mais<br />
ne sont pas é<strong>la</strong>stiques. D'autre part, ils ont tous tendance<br />
à se rétracter sous forme d'une zone fibrosée, ce qui<br />
recrée les conditions <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que. Certains ont proposé<br />
l'utilisation <strong>de</strong> dure-mère lyophilisée <strong>de</strong> cadavre<br />
[23], ce qui est inacceptable vu le risque <strong>de</strong> transmission<br />
<strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies telle <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Creutzfelt Jacob<br />
[17] d'autant que les résultats ne sont pas supérieurs<br />
aux autres greffes [9]. Plus récemment, I'utilisation <strong>de</strong><br />
matériaux inertes tel le PETP (polyester téréphtalique)<br />
ou le PTFE (polytetra fluroethylène) [18] a été proposée<br />
mais ces produits ne sont pas é<strong>la</strong>stiques et génèrent<br />
une réaction inf<strong>la</strong>mmatoire qui peut être importante.<br />
<strong>Le</strong> <strong>de</strong>rme subit une rétraction <strong>de</strong> l'ordre <strong>de</strong> 30% à 3<br />
mois, il est donc nécessaire <strong>de</strong> surtailler le greffon d'environ<br />
30% dans sa <strong>la</strong>rgeur. En revanche, son épaisseur<br />
doit être <strong>la</strong> même que celle <strong>de</strong> l'albuginée. <strong>Le</strong> prélèvement<br />
se fait habituellement au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuisse ou <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> paroi abdominale. La réapparition d'une courbure<br />
par fibrose <strong>de</strong>s sutures conduit certains à adjoindre un<br />
<strong>traitement</strong> corticoï<strong>de</strong> à faibles doses pendant 3 mois<br />
[1].<br />
La dissection <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que conduit à une altération du<br />
tissu aréo<strong>la</strong>ire source <strong>de</strong> dysérection dans les suites.<br />
Certains proposent, pour limiter le risque d'impuissance<br />
secondaire, <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s infiltrations per opératoires<br />
d'héparine diluée sur le site <strong>de</strong> <strong>la</strong> greffe (1).<br />
<strong>Le</strong>s incision-greffes [19] (Figure 7) : Il est possible <strong>de</strong><br />
réaliser <strong>de</strong>s incisions <strong>de</strong> décharges transversales pour<br />
redresser <strong>la</strong> verge puis <strong>de</strong> couvrir le défect par une greffe<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rme . En général 3 incisions sur toute <strong>la</strong> <strong>la</strong>rgeur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> face dorsale suffisent à corriger <strong>la</strong> déviation. La<br />
p<strong>la</strong>que est alors disséquée sous l’albuginée. La résection<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que peut se faire par voie transcaverneuse<br />
évitant <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> substance donc <strong>la</strong> greffe [31].<br />
Lorsqu'il existe un étranglement associé, I'extrémité<br />
<strong>de</strong>s incisions transversales est prolongée en «Y» inversé<br />
permettant un é<strong>la</strong>rgissement. Si ce<strong>la</strong> s'avère insuffisant,<br />
une p<strong>la</strong>stie par <strong>la</strong>mbeau d'avancement (type p<strong>la</strong>stie<br />
en «Z») peut être réalisée. Pour les courbures ven-<br />
965
Figure 1. La voie d’abord circonférentielle avec déshabil<strong>la</strong>ge<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> verge.<br />
Figure 3. La voie d’abord médiane sur le raphé.<br />
Figure 2. La voie d’abord circonférentielle avec extériorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge par une contre incision peno-scrotale.<br />
966
Figure 4A. La résection suture selon Nesbit.<br />
Figure 4B. L’incision suture transversale ou Nesbit dérivé<br />
(avec points inversants).<br />
Figure 5A. <strong>Le</strong>s plicatures <strong>de</strong> l’albuginée par points surfilés.<br />
Figure 5C. <strong>Le</strong>s plicatures <strong>de</strong> l’albuginée par le point <strong>de</strong><br />
Klevmark.<br />
Figure 5B. <strong>Le</strong>s plicatures <strong>de</strong> l’albuginée par points <strong>de</strong> part et<br />
d’autre <strong>de</strong> l’urèthre.<br />
967
Figure 6A. La résection <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que avec greffe <strong>de</strong> peau : l’in -<br />
cision.<br />
Figure 6B. La couverture.<br />
Figure 7A. La résection greffe<br />
Figure 7B. L’incision greffe avec refend.<br />
Figure 8A. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> prothèse par incision penoscrotale.<br />
8B. Cavernotomie transversale sur <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que.<br />
8C. Fermeture du défect par une greffe.<br />
968
Figure 9. La voie péno-pubienne en V inversé.<br />
Figure 10. La désinsertion péno-pubienne.<br />
Figure 11. Organigramme <strong>de</strong>s indications <strong>chirurgical</strong>es pour<br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong> (T.I.C. : Test intra-caverneux).<br />
969
trales on réalise <strong>de</strong>ux séries symétriques d'incisions en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l'urèthre. Pour les courbures <strong>la</strong>térales qui<br />
s'associent fréquemment à une diminution <strong>de</strong> diamètre<br />
du côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> courbure, il est nécessaire <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s<br />
incisions transversales pour augmenter <strong>la</strong> longueur et<br />
<strong>de</strong>s incisions longitudinales pour augmenter le diamètre<br />
conduisant à une greffe en «Scotty Dog». Ce<strong>la</strong><br />
s'avère en général insuffisant pour les courbures <strong>de</strong><br />
plus <strong>de</strong> 40 <strong>de</strong>grés où une plicature contro<strong>la</strong>térale doit<br />
être associée.<br />
Résultats : ils sont bons dans 0% [2] à 70% [10] <strong>de</strong>s<br />
cas.<br />
Inconvénients : <strong>la</strong> nécessité d'une <strong>de</strong>uxième incision,<br />
<strong>la</strong> fréquence élevée <strong>de</strong>s insensibilités du g<strong>la</strong>nd (habituellement<br />
régressive en 2 à 5 mois), le risque d'impuissance<br />
et d'anérection en aval du greffon. En cas<br />
d'impuissance secondaire, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'une prothèse<br />
donne <strong>de</strong> mauvais résultats [2].<br />
La seule bonne indication <strong>de</strong> <strong>la</strong> résection-greffe pourrait<br />
être le sujet jeune ayant une p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> petite taille<br />
(
Avantages : évite l'abord <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que donc simplifie le<br />
geste.Ce procédé selon ces promoteurs n'entraîne pas<br />
plus <strong>de</strong> complication et <strong>de</strong> dégradation du matériel que<br />
<strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce simple <strong>de</strong> prothèse.<br />
Inconvénient : oedème et douleur post opératoire sont<br />
nettement plus marqués qu'après mise en p<strong>la</strong>ce simple<br />
<strong>de</strong> prothèse.<br />
<strong>Le</strong>s imp<strong>la</strong>nts souples<br />
La voie d'abord peut être circonférentielle, péno-scrotale<br />
ou péno-pubienne comme le conseille Subrini.<br />
Incision arciforme en V inversé à <strong>la</strong> jonction <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
abdominale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau pénienne qui a comme avantage<br />
par rapport à l'incision verticale d'éviter <strong>la</strong> formation<br />
d'une bri<strong>de</strong> fibreuse réalisant un néo-ligament suspenseur<br />
( Figure 9).<br />
<strong>Le</strong>s imp<strong>la</strong>nts péniens souples composés <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
cylindres homogènes <strong>de</strong> silicone souples <strong>de</strong> 25 cm <strong>de</strong><br />
longueur sont mis en p<strong>la</strong>ce dans les corps caverneux<br />
après cavernotomie et calibrage du corps caverneux<br />
par <strong>de</strong>s bougies d’Hegar ou avec le di<strong>la</strong>tateur atraumatique.<br />
<strong>Le</strong>s imp<strong>la</strong>nts seront coupés à <strong>la</strong> longueur<br />
adéquate, déterminée à l'ai<strong>de</strong> du gabarit. Un allongement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> verge est habituellement associé, réalisé<br />
par section du ligament suspenseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge et<br />
désinsertion caverno-pubienne. <strong>Le</strong>s fibres unissant<br />
les corps caverneux au pubis sont coupées aux<br />
ciseaux en restant au contact <strong>de</strong> l'os afin d'éviter <strong>de</strong><br />
blesser <strong>la</strong> veine profon<strong>de</strong> (Figure 10). <strong>Le</strong>s corps<br />
caverneux doivent être entièrement libérés jusqu'à<br />
une profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> 7 cm. Une interposition <strong>de</strong> tissu<br />
graisseux suturé dans l'espace ainsi crée prévient une<br />
réinsertion ultérieure. La peau est fermée selon une<br />
p<strong>la</strong>stie YV inversée pour couvrir le corps caverneux<br />
libéré. L'allongement <strong>de</strong> <strong>la</strong> face dorsale du corps<br />
caverneux (qui est raccourci par <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que fibreuse)<br />
permet <strong>de</strong> corriger les courbures dorsales. Il faut parfois<br />
réaliser une g<strong>la</strong>ndulop<strong>la</strong>stie pour repositionner le<br />
g<strong>la</strong>nd en regard <strong>de</strong> l'extrémité <strong>de</strong>s imp<strong>la</strong>nts.<br />
<strong>Le</strong>s imp<strong>la</strong>nts péniens souples modifieraient les conditions<br />
hémodynamiques locales et par le volume qu'ils<br />
occupent diminueraient d'autant le volume vascu<strong>la</strong>ire à<br />
remplir. Ils permettraient, par une faible augmentation<br />
<strong>de</strong> volume, d'atteindre le point critique et donc d'obtenir<br />
une rigidité.<br />
<strong>Le</strong>s avantages, selon le promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> technique:<br />
excellente fiabilité, simplicité, très faible taux <strong>de</strong> complications,<br />
arrêt <strong>de</strong> l'évolution et régression <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
par l'expansion du tissu érectile dans toutes les<br />
directions, conservation <strong>de</strong> l'érection existante et même<br />
amélioration y compris du g<strong>la</strong>nd, pas <strong>de</strong> retard à l'éjacu<strong>la</strong>tion,<br />
allongement <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge [42, 43]. Ces résultats<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt à être confirmés par d'autres étu<strong>de</strong>s.<br />
LES INDICATIONS (Figure 11)<br />
<strong>Le</strong> <strong>traitement</strong> <strong>chirurgical</strong> ne concerne qu'environ<br />
10%<strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>Lapeyronie</strong>. Il<br />
ne doit s'envisager que dans 3 situations : lorsque <strong>la</strong><br />
courbure <strong>de</strong> verge empêche <strong>la</strong> pénétration, <strong>la</strong> rend douloureuse<br />
pour l'un <strong>de</strong>s partenaires, ou en cas <strong>de</strong> dysérection.<br />
<strong>Le</strong>s rapports restent habituellement possibles<br />
pour les courbures dorsale inférieures à 45° et 30° pour<br />
les courbures <strong>la</strong>térales.<br />
L'intervention doit être réalisée à <strong>la</strong> phase chronique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die c'est à dire après au moins 6 à 12 mois <strong>de</strong><br />
stabilité <strong>de</strong>s lésions. Dans cette attente, les <strong>traitement</strong>s<br />
médicaux ayant peu d'effets délétères et n'entravant pas<br />
une éventuelle chirurgie ultérieure trouvent leur p<strong>la</strong>ce.<br />
Une évaluation précise <strong>de</strong> <strong>la</strong> fonction érectile du sujet<br />
est indispensable. Il est en effet illusoire <strong>de</strong> compter<br />
restaurer une érection satisfaisante en mo<strong>de</strong><strong>la</strong>nt les<br />
corps caverneux d'un sujet ayant une dysérection liée<br />
ou associée à une courbure <strong>de</strong> verge. Une analyse <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
courbure est nécessaire et suppose <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> 2<br />
photographies (face et profil) en érection ou mieux un<br />
examen après injection intra-caverneuse qui permet en<br />
outre d'apprécier <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’érection. Pour certains,<br />
une étu<strong>de</strong> par Rigiscan* ou par Doppler <strong>de</strong> <strong>la</strong> verge<br />
aurait une valeur prédictive sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l'érection<br />
post-opératoire et pourrait parfois modifier l'indication<br />
opératoire par rapport à une simple appréciation subjective<br />
<strong>de</strong> l'érection [5, 18].<br />
Lorsque <strong>la</strong> courbure <strong>de</strong> verge est associée à une érection<br />
<strong>de</strong> bonne qualité, un redressement <strong>chirurgical</strong> doit<br />
être réalisé, nous préconisons <strong>la</strong> plicature simple avec<br />
respect <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>que.<br />
En cas d'impuissance ou d'anérection en aval <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>que, le test intra caverneux prend toute sa valeur. S'il<br />
est positif nous réalisons un redressement par plicature,<br />
et instaurons un programme d' injections intra caverneuses.<br />
La mise en p<strong>la</strong>ce d'imp<strong>la</strong>nts souples peut dans<br />
ce cas s' envisager mais nous n'en avons pas l'expérience.<br />
Si le test intra-caverneux est négatif, <strong>la</strong> mise en<br />
p<strong>la</strong>ce d'une prothèse s'impose. <strong>Le</strong> choix entre prothèse<br />
semi-rigi<strong>de</strong> et gonf<strong>la</strong>ble tiendra compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> préférence<br />
du couple et <strong>de</strong> son habileté manuelle.<br />
<strong>Le</strong>s indications <strong>de</strong> prothèse peuvent donc être limitées<br />
compte tenu <strong>de</strong> l'efficacité <strong>de</strong>s injections intra caverneuses<br />
associées à une chirurgie conservatrice [44],<br />
même si <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d'une prothèse lorsqu'elle est<br />
suivie <strong>de</strong> succès a l'avantage d'être une solution définitive<br />
au problème [35].<br />
REFERENCES<br />
1. AUSTONI E., COLOMBO F., MANTOVANI F. Evaluation of corpora<br />
alteration and erectile dysfonction following radical surgery for<br />
Peyronie’s disease and long terme follow-up on 152 operated<br />
patients. J. Androl., 1994, 15, 57S-62S.<br />
971
2. BAILEY M.J., YANDE S., WALMSLEY B., PRYOR J.P. Surgery of<br />
Peyronie's disease. A review of 200 patients. Br. J. Urol., 1985, 75,<br />
746-749.<br />
3. BENSON R.C.,PATTERSON D.E. The Nesbit procedure for<br />
Peyronie's disease. J.Urol., 1983, 130, 692-694.<br />
4. BEURTON D. Mon point <strong>de</strong> vue sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> La Peyronie. Prog.<br />
Urol. 1991, 1, 23-27.<br />
5. BROCK G.,KADIOGLU A.,LUE T.F. Peyronie’s disease: a modified<br />
treatment. Urology, 1993, 42, 300-304.<br />
6. BROCK G.,NUNES L.,BURKHARD von HEYDEN,MARTINEZ-<br />
PINEIRO L.,HSU G.L.,LUE T.F. Can a venous patch graft be a substitute<br />
for the tunica albuginea of the penis? J.Urol., 1993, 150,<br />
1306-1309.<br />
7. BYSTROM J., ALFTHAN 0., GUSTAFSON H., JOHANSSON B.<br />
Early and <strong>la</strong>te result after excision and <strong>de</strong>rmo-fat grafting for<br />
Peyronie's disease.Prog. reprod. Bio. Med., vol.9, 78-84 (Karger,<br />
Basel 1983).<br />
8. COHEN E.S.,SCHMIDT J.D.,LOWELL PARSONS C. Peyronie's<br />
disease: surgical experience and presentation of a proximal approach.<br />
J. Urol. ,1989, 142, 740-742.<br />
9. COLLINS J.P. Experience with Iyophilisazed human dura for treatment<br />
of Peyronie's di<strong>de</strong>ase. Urology, 1988, 31, 379-381.<br />
10. DEVINE C.J. Jr, HORTON C.E. Surgical treatment of Peyronie's<br />
disease with <strong>de</strong>rmal graft. J. Urol., 1974, 111, 44-49.<br />
11. DEVINE C.J.J r,JORDAN G.H.,SCHLOSSBERG S.M. Surgery of<br />
the penis and the urethra. In Walsh, Retik, Stamey, Vaughan:<br />
Campbell's Urology 6th Ed., Saun<strong>de</strong>rs, Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphia, 1992: 3011.<br />
12. EBBEHOJ J.,METZ P. New operation for «Krummerik»(penile curvature).<br />
Urology, 1985, 26, 76-78.<br />
13. EIGNER E.B.,KABALIN J.N.,KESSLER R. Penile imp<strong>la</strong>nts in the<br />
treatment of Peyronie's disease. J. Urol., 1991, 145, 69-72.<br />
14. ERPENBACH K., ROTHE H., DERSCUM W. The penile plicature<br />
procedure: an alternative method for straightening penile <strong>de</strong>viation.<br />
J. Urol., 1991, 146, 1276-1278.<br />
15. ESCOURROU G., SARRAMON JP, RISCHMANN P., BOUISSOU<br />
H. Etu<strong>de</strong> anatomique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> La Peyronie. Ann. Urol.,<br />
1985, 19, 333.<br />
16. ESSED E., SCHRODER F.H. New surgical treatment for Peyronie’s<br />
disease. Urology,1985, 15, 582-587.<br />
17. FALLON B. Cadaveric dura marer graft for correction of penile curvature<br />
in Peyronie disease. Urology, 1990, 35, 127-129.<br />
18. GANABATHI K., DMOCHOWSKI R., ZIMMERN P.E., LEACH<br />
G.E. Peyronie’s disease : surgical treatment based on penile rigidity.<br />
J. Urol., 1995, 153, 662-666.<br />
19. GELBARD M.K. Re<strong>la</strong>xing incisions in the correction of penile<br />
<strong>de</strong>formity due to Peyronie’s disease. J. Urol., 1995, 154, 1457-<br />
1460.<br />
20. GELBARD M.K., HAYDEN B. Expanding contractures of the tunica<br />
albuginea due to Peyronie'disease with temporalis fascia free<br />
grafts. J. Urol.,1991, 145, 772-776.<br />
21. GOLDSTEIN M., BLUMBERG N. Correction of severe penile<br />
curves with tunica albuginea autografts. J. Urol., 1974, 42, 44.<br />
22. KELAMI A. Treatment of morbus Peyronie. How I do it. Twenty<br />
years of experience. Inter. Urol. Nephrol., 1991, 23, 589-593.<br />
23. KELAMI A. et al. Peyronie disease and surgical treatment: a new<br />
concept. Urology, 1980, 15, 559.<br />
24. KLEVMARK B.,ANDERSEN M.,SCHULTZ A.,TALSETH T.<br />
Congenital and acquired curvature of the penis treated by plication<br />
of the tunica albuginea. Br. J. Urol.,1994, 74, 501-506.<br />
25. KNISPEL H.H., GONNERMANN D., HULAND H. Modified surgical<br />
technique to correct congenital and acquired penile curvature.<br />
Eur.Urol., 1991, 20, 107-112.<br />
26. KNOLL L.D., FURLOW W.L., BENSON R.C. Jr. Management of<br />
Peyronie disease by imp<strong>la</strong>ntation of inf<strong>la</strong>table penile prothesis.<br />
Urology, 1990, 36, 406-409.<br />
27. LAPEYRONIE F. Sur quelques obstacles qui s'opposent à l'éjacu<strong>la</strong>tion<br />
naturelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> semence. Mem. Acad. Roy. Chir., p.425, 1743.<br />
28. LOWSEY O.S., BOYCE W.H. Further experience with an operation<br />
for the cure of Peyronie’s disease. J. Urol., 1950, 63, 888.<br />
29. MILLER E.B., SCHLOSSBERG S.M.,DEVINE C.J.,Jr. New incision<br />
for penile surgery. J.Urol., 1993, 150, 79-80.<br />
30. MONTORSI F., GUAZZONI G., BERGAMASCHI F., RIGATTI P.<br />
Patient-partner satisfaction with semirigid penile prosthesis for<br />
Peyronie's disease: a 5year followup study. J. Urol., 1993, 150,<br />
1819-1821.<br />
31. NESBIT R.M. Congenital curvature of the phallus: report of three<br />
cases with <strong>de</strong>scription of corrective operation. J.Urol., 1965, 93,<br />
230-232.<br />
32. NOOTER R.l., BOSCH J.L.H.R., SCHRODER F.H. Peyronie’s<br />
disease and congenital penile curvature: long terme results of operative<br />
treatment with the plication procedure. Br. J. Urol., 1994, 74,<br />
497-500.<br />
33. O’DONNELL P.D. Results of surgical management of Peyronie's<br />
disease. J.Urol., 1992, 148, 1184-1187.<br />
34. PALOMAR J.M., HALIKIOPOULOS H., THOMAS R. Evaluation<br />
of the surgical management of Peyronie's disease. J. Urol., 1980,<br />
123, 680-682.<br />
35. PRYOR J. La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> La Peyronie : étiologie et chirurgie.<br />
Cahiers <strong>de</strong> Sexol. Clin., 1995, 21, 23-28.<br />
36. PRYOR J.P., FITZPATRICK J.M. A new approach to the correction<br />
of the penile <strong>de</strong>formity in Peyronie’s disease. J. Urol., 1979, 122,<br />
622-623.<br />
37. RALPH D.J., AL-AKRAA M., PRYOR J.P. The Nesbit operation for<br />
Peyronie's disease : 16-year experience. J.Urol., 1995, 154, 1362-<br />
1363.<br />
38. RAZ S., DE KERNION J.B., KAUFMAN J.J. Surgical treatment of<br />
Peyronie’s disease : a new approach. J. Urol., 1977, 117, 598.<br />
39. ROSSI D., RATTIER C., COULANGE C., SERMENT G. <strong>Le</strong>s résultats<br />
<strong>de</strong> l'imp<strong>la</strong>ntation <strong>de</strong> prothèses <strong>de</strong> verge gonf<strong>la</strong>bles. Prog. Urol.,<br />
1993, 3, 796-802.<br />
40. SARRAMON J.P., ESCOURROU G. The diagnosis and management<br />
of Peyronie’s disease Int. J. Impotence Res., 1991, 3, 69-83.<br />
41. SELLEM G., ARVIS G. <strong>Le</strong>s courbures <strong>de</strong> verge. In Andrologie III<br />
(ARVIS G). Maloine, Paris,1991 : 1458.<br />
42. SUBRINI L. Surgical treatment of Peyronie’s disease using penile<br />
imp<strong>la</strong>nts : survey of 69 patients. J. Urol., 1984, 132, 47-50.<br />
43. SUBRINI L. <strong>Le</strong>s imp<strong>la</strong>nts péniens souples dans <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fonction érecile. Ann. Urol., 1993, 27, 183-191.<br />
972
44. TREIBER U., GILBERT P. Surgical treatment of Peyronie’s disease.<br />
Urol. Int., 1991, 47, 240-244.<br />
45. WILD R.M., DEVINE C.J. Jr., HORTON C.E. Dermal graft repair of<br />
Peyronies disease: survey of 50 patients. J. Urol., 1979, 121, 47-51.<br />
46. WILSON S.K., DELK J.R.II. A new treatment for Peyronie's disease:<br />
mo<strong>de</strong>ling the penis over an inf<strong>la</strong>table penile prothesis. J. Urol.,<br />
1994, 152, 1121-1123.<br />
____________________<br />
SUMMARY<br />
Surgical treatment of <strong>Lapeyronie</strong> disease.<br />
<strong>Lapeyronie</strong> disease is responsible for curvature of the penis,<br />
making sexual intercourse painful or even impossible. Surgical<br />
treatment can be proposed when the p<strong>la</strong>que has remained stable<br />
for at least 6 months and after failure of medical treatment. It is<br />
<strong>de</strong>signed to restore erection allowing penetration. Examination<br />
after an intracavernous test allows assessment of the <strong>de</strong>formity<br />
and the quality of erection. These two objective parameters<br />
appear to be <strong>de</strong>cisive in the choice of the most appropriate tech -<br />
nique. Two types of methods are avai<strong>la</strong>ble : cavernop<strong>la</strong>sties<br />
(resection-plication of the tunica albuginea, excision-graft) and<br />
p rosthesis imp<strong>la</strong>ntations (semirigid, inf<strong>la</strong>table and flexible<br />
imp<strong>la</strong>nts). This paper reviews the various surgical techniques<br />
and proposes a <strong>de</strong>cisional flow-chart based on the results of the<br />
intracavernous test.<br />
Key words : <strong>Lapeyronie</strong> disease, surgical treatment.<br />
____________________<br />
973