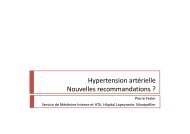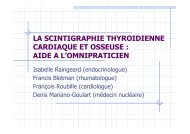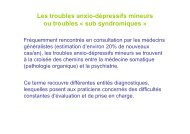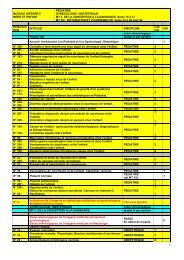Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
+<br />
Introduction à l’électro<strong>en</strong>céphalographie<br />
(<strong>EEG</strong>)<br />
Dr Caroline Briere<br />
Explorations fonctionnelles<br />
CHU de Nîmes<br />
Dr Régis Lopez<br />
Unité des troubles du sommeil<br />
CHU de Montpellier
+ Plan<br />
Méthodologie d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
L’électrogénèse corticale<br />
Les rythmes <strong>EEG</strong> physiologiques<br />
Les manœuvres d’activation<br />
Les stades de sommeil<br />
Exemples d’indication de l’<strong>EEG</strong> et tracés<br />
pathologiques<br />
Interprétation
+<br />
Méthodologie d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t
+ Dispositif d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
Les électrodes<br />
Electrodes tampon<br />
Electrodes aiguilles<br />
Electrodes cupules
+ Dispositif d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t
+ Dispositif d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
Avant la pose des<br />
eĺectrodes tampons ou<br />
cupules, le cuir chevelu doit<br />
être dećapé pour diminuer<br />
l ’impédance du couple<br />
(peau, eĺectrode) àmoins<br />
de 5000 ohms.<br />
Le dećapage est reálisé à<br />
l’aide d’une pâte appeleé<br />
« pâte de Katz »
+ Dispositif d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
Les électrodes sont<br />
reliées par un fil<br />
de connexion à la<br />
boîte têtière
+ Dispositifs d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t<br />
Le plus souv<strong>en</strong>t les électrodes sont disposées sur le scalp<br />
selon le système 10-20 (21 électrodes) :<br />
Lettre :<br />
A : Auriculaire<br />
Fp : Fronto-polaire<br />
F : Frontale<br />
T : Temporale<br />
C : C<strong>en</strong>trale<br />
P : Pariétale<br />
O : Occipitale<br />
Chiffre :<br />
Impair : gauche<br />
Pair : droit<br />
Z : ligne médiane
+ Les montages<br />
standard zéro<br />
Longitudinal<br />
Transverse<br />
Longues distances
+ Réalisation <strong>en</strong> pratique d’un <strong>EEG</strong><br />
Préparation, positionnem<strong>en</strong>t et branchem<strong>en</strong>t des électrodes (15<br />
minutes)<br />
Vérification des impédances<br />
Enregistrem<strong>en</strong>t dans les conditions de veille calme, yeux<br />
fermés, avec des épisodes d’ouverture et de fermeture des yeux<br />
de 10 secondes pour évaluer la réactivité<br />
Epreuves d’activation :<br />
Hyperpnée<br />
Stimulation Lumineuse intermitt<strong>en</strong>te<br />
Fin d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t dans des conditions de veille calme (20<br />
minutes)
+<br />
L’électrog<strong>en</strong>èse corticale
+ Cytoarchitecture<br />
corticale<br />
L’activité électrique <strong>en</strong>registrée provi<strong>en</strong>t<br />
principalem<strong>en</strong>t des neurones pyramidaux des<br />
couches III, V et VI
+ Cytoarchitecture<br />
corticale<br />
L’activité électrique <strong>en</strong>registrée provi<strong>en</strong>t<br />
principalem<strong>en</strong>t des neurones pyramidaux des<br />
couches III, V et VI
+ Origine de l’activité électrique<br />
recueillie<br />
PA<br />
Activité électrique synaptique (1) :<br />
PPSE<br />
PPSI<br />
Canaux Ca ++<br />
voltage dép<strong>en</strong>dants<br />
(2)<br />
NT<br />
(3b)<br />
Rc métabotropique<br />
Rc ionotropique<br />
(5)<br />
PA<br />
(3c)<br />
(3a)<br />
Ions<br />
Activité électrique synaptique<br />
(4)<br />
Canaux Na +<br />
voltage<br />
dép<strong>en</strong>dants
+<br />
Origine de l’activité<br />
électrique recueillie Scalp<br />
La dépolarisation = <strong>en</strong>trée<br />
importante d’ions Na + =<br />
inversion de la polarité<br />
intra/extra-cellulaire<br />
Boite crâni<strong>en</strong>ne<br />
Méninges<br />
Dans l’espace extracellulaire,<br />
création d’une<br />
différ<strong>en</strong>ce de pot<strong>en</strong>tiel<br />
<strong>en</strong>tre la zone d<strong>en</strong>dritique<br />
qui reçoit des<br />
dépolarisations et le corps<br />
cellulaire qui n’<strong>en</strong> reçoit<br />
pas
+ Origine de l’activité électrique<br />
recueillie<br />
Pour que l’activité électrique soit recueillie par les électrodes de<br />
surface, il faut qu’elle soit ample, donc :<br />
Que les dipoles soi<strong>en</strong>t tous ori<strong>en</strong>tés dans le même s<strong>en</strong>s<br />
Electrode <strong>EEG</strong><br />
Courants des<br />
neurones pyramidaux<br />
Courants des<br />
interneurones<br />
Que les différ<strong>en</strong>ces de pot<strong>en</strong>tiel soi<strong>en</strong>t créés au même mom<strong>en</strong>t<br />
(activité rythmique)
+ Synchronisation, désynchronisation<br />
L’amplitude du signal est proportionnelle au degré de<br />
synchronisation des neurones corticaux <strong>en</strong>tre eux dans une<br />
région donnée :<br />
Sommation spatiale des<br />
PPSE / PPSI
+ Origine de l’activité rythmique<br />
Le rythme est donné par un<br />
générateur unique = pacemaker<br />
(exemple du pacemaker thalamique) :<br />
Le rythme est donné par<br />
une excitation / inhibition<br />
mutuelle des neurones <strong>en</strong>tre eux<br />
(boucles cortico-corticales) :
+ Le pacemaker thalamique<br />
Les <strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>ts profonds montr<strong>en</strong>t qu’il existe des<br />
ondes prov<strong>en</strong>ant du thalamus de fréqu<strong>en</strong>ce comparable à<br />
celle des fréqu<strong>en</strong>ces corticales. Elles sont synchronisées.
+ Le pace-maker thalamique<br />
En l’abs<strong>en</strong>ce d’excitation :<br />
Les neurones du noyau réticulé<br />
thalamique ont une activité<br />
rythmique<br />
En prés<strong>en</strong>ce d’une excitation :<br />
Les neurones réticulaires étant<br />
excités <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce perd<strong>en</strong>t<br />
leur caractère rythmique
+<br />
Les rythmes <strong>EEG</strong> physiologiques
+ Les rythmes <strong>EEG</strong><br />
Un rythme est défini par :<br />
La bande de fréqu<strong>en</strong>ce à laquelle il apparti<strong>en</strong>t<br />
Sa localisation<br />
Sa morphologie et son amplitude<br />
Sa réactivité<br />
Il ne peut être interprété que dans un contexte<br />
comportem<strong>en</strong>tal :<br />
Eveil<br />
Somnol<strong>en</strong>ce<br />
Stimulation …
+ Rythmes beta<br />
Rythmes rapides<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce : > 15Hz<br />
Très faible amplitude<br />
Localisation diffuse<br />
Veille att<strong>en</strong>tive, activité motrice<br />
Phénomènes de synchronie et de couplage local
+ Rythme alpha<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce : 8-12 Hz<br />
Amplitude moy<strong>en</strong>ne (variabilité interindividuelle)<br />
Localisation postérieure préfér<strong>en</strong>tielle<br />
Généré au niveau cortical<br />
Rythme associé à la veille dite calme :<br />
Yeux fermés<br />
Pas d’activité motrice<br />
Pas d’activité intellectuelle<br />
Réactivité de l’alpha
+ Réactivité du rythme alpha<br />
à l’ouverture des yeux<br />
Vidéo ouverture des yeux<br />
Yeux fermés<br />
Yeux ouverts<br />
Yeux fermés
+ Rythme theta<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce 4-7 Hz<br />
Amplitude moy<strong>en</strong>ne, souv<strong>en</strong>t un peu inférieure à l’alpha<br />
Localisation c<strong>en</strong>tro-temporale préfér<strong>en</strong>tielle<br />
Générateur limbique : hippocampe<br />
et cortex <strong>en</strong>torrhinal, cingulaire<br />
(implication dans la mémoire)<br />
Rythme retrouvé dans différ<strong>en</strong>ts<br />
états de consci<strong>en</strong>ce :<br />
Veille<br />
Endormissem<strong>en</strong>t<br />
Sommeil paradoxal
+ Rythme delta<br />
= Activité à ondes l<strong>en</strong>tes<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce basse : 0,5-4 Hz<br />
Grande amplitude<br />
(>75 uV dans le sommeil profond)<br />
Localisation préfér<strong>en</strong>tielle frontale<br />
Activité intrinsèque des neurones<br />
corticaux privés de leurs affér<strong>en</strong>ces<br />
Rythme retrouvé <strong>en</strong> sommeil l<strong>en</strong>t profond
+ Les différ<strong>en</strong>tes rythmes physiologiques<br />
Rythme Fréqu<strong>en</strong>ce Amplitude Localisation Corrélats<br />
Delta < 4Hz >30 uV Antérieur,<br />
diffus<br />
Theta 4 – 7 Hz 20 uV C<strong>en</strong>trotemporal<br />
Sommeil l<strong>en</strong>t<br />
profond<br />
Sommeil<br />
léger<br />
Alpha 8 – 12 Hz 30 uV Postérieur Veille calme<br />
Beta 15-30 Hz
+ Rythme 1
+ Rythme 1
+ Rythme 1<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce 10 Hz<br />
= rythme alpha
+ Rythme alpha<br />
Analyse du spectre par<br />
transformation rapide<br />
de Fourrier
+ Rythme 2
+ Rythme delta<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce 1,5 Hz<br />
Rythme delta
+ Rythme 3
+ Rythme 3
+ Rythme theta<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce 6 Hz<br />
Rythme theta
+ Rythme 4
+ Rythme beta<br />
Rythme rapide<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce 22 Hz<br />
Rythme beta
+ Activités physiologiques<br />
inhabituelles<br />
Rythme alpha :<br />
Rythme alpha variante l<strong>en</strong>te (dédoublé <strong>en</strong> sous-harmoniques de<br />
fréqu<strong>en</strong>ce theta, aspect faussem<strong>en</strong>t angulaire). Mêmes<br />
caractéristiques que l’alpha (topographie et réactivité)<br />
Rythme mu : 10% des sujets, rythme c<strong>en</strong>tropariétal 7-11 Hz<br />
bloqué par le serrage des points mais pas par l’ouverture<br />
des yeux.<br />
Ondes l<strong>en</strong>tes postérieures (20% chez l’adulte jeune)<br />
Ondes lambda (70% des sujets jeunes) : pointes occipitales<br />
surv<strong>en</strong>ant à l’ouverture des yeux
+<br />
Rythme mu non bloqué<br />
par l’ouverture des yeux
+<br />
Ondes lambda<br />
postérieures<br />
bloquées par la fixation
+<br />
Manœuvres d’activation
+ Les épreuves d’activation<br />
Hyperpnée<br />
Epreuve d’accélération et d’augm<strong>en</strong>tation de la respiration<br />
p<strong>en</strong>dant au moins 3 minutes (respiration ample)<br />
Mécanisme :<br />
Décl<strong>en</strong>chem<strong>en</strong>t d’une hypocapnie et d’une alcalose respiratoire<br />
Ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t de l’<strong>EEG</strong> avec apparition d’ondes l<strong>en</strong>tes theta ou<br />
delta (hypersynchronie physiologique chez l’<strong>en</strong>fant)<br />
But :<br />
Observer un ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t (apparition d’ondes l<strong>en</strong>tes theta ou<br />
delta)<br />
Observer des anomalies paroxystiques<br />
Inconvéni<strong>en</strong>t :<br />
Ne peut être réalisée chez le jeune <strong>en</strong>fant (consigne)<br />
Contre-indiquée <strong>en</strong> cas de certaines pathologies (cardio, respi)
+ Hyperpnée<br />
Ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t physiologique<br />
Avant l’HPN<br />
P<strong>en</strong>dant l’HPN
+ Hyperpnée<br />
Labilité d’hyperpnée<br />
Avant l’HPN<br />
P<strong>en</strong>dant l’HPN
+ Hyperpnée<br />
Apparition d’anomalies paroxystiques<br />
P<strong>en</strong>dant l’HPN
+ Les épreuves d’activation<br />
La stimulation lumineuse intermitt<strong>en</strong>te<br />
Projection d’éclairs lumineux de fréqu<strong>en</strong>ce variable (1-60<br />
Hz) avec un stroboscope<br />
Mécanisme : synchronisation des activité cérébrales<br />
(visuelles)<br />
But :<br />
Observer le photo<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t (normal ou pathologique)<br />
Observer la réponse photomyogénique (normale ou<br />
pathologique)<br />
Observer une réponse photoparoxystique (pathologique)
+ SLI<br />
Photo-<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t
+ SLI<br />
Photo-<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t
+ SLI<br />
Réponse photomyogénique
+ SLI<br />
Réponse photoparoxystique
+<br />
Apports de l’<strong>EEG</strong> dans l’interprétation<br />
des stades de sommeil
+ <strong>EEG</strong> de sommeil<br />
Montage moins complexe (pas de nécessité de localisation<br />
précise)<br />
Complété par :<br />
Electromyogramme (EMG)<br />
Electro-oculogramme (EOG)<br />
Plus autres mesures (respiratoires, ECG, EMG, vidéo…)<br />
= Polysomnographie
+ Veille<br />
Veille active (yeux ouverts) :<br />
Rythmes <strong>EEG</strong> rapides beta (20-30 Hz)<br />
Activité <strong>EEG</strong> désynchronisée<br />
Activité musculaire<br />
Saturation du tracé<br />
Veille calme (yeux fermés) :<br />
Rythme <strong>EEG</strong> alpha (8-12Hz)<br />
Diminution activité musculaire<br />
Mouvem<strong>en</strong>ts oculaires l<strong>en</strong>ts
+ Veille active
+ Veille calme
+ Stade I<br />
Stade de l’<strong>en</strong>dormissem<strong>en</strong>t<br />
1-5% du temps total de sommeil<br />
Activité <strong>EEG</strong> theta (4-8 Hz)<br />
Diminution du tonus musculaire<br />
Mouvem<strong>en</strong>ts oculaires l<strong>en</strong>ts
+ Stade I
+ Stade II<br />
Activité <strong>EEG</strong> de fond mixte :<br />
Theta (5-8 Hz)<br />
Delta (0,5-2Hz) < 20%<br />
Grapho-élém<strong>en</strong>ts :<br />
Complexes K :<br />
Onde négative suivie immédiatem<strong>en</strong>t par<br />
une composante positive<br />
Fuseaux de sommeil :<br />
Activité de type sigma (12-16 Hz)<br />
Durée > 0,5 s<br />
Tonus musculaire variable
+ Stade II
+ Stade II
+ Stade III et IV<br />
Sommeil l<strong>en</strong>t profond<br />
Sommeil à ondes l<strong>en</strong>tes (>20%) :<br />
Activité <strong>EEG</strong> delta (0,5-2Hz)<br />
Amplitude > 75 μV <strong>en</strong> frontal<br />
Distinction (anci<strong>en</strong>ne) stade III et IV :<br />
20-50% de delta = stade III<br />
>50% de delta = stade IV<br />
Tonus musculaire variable
+ Stade III
+ Stade IV
+ Sommeil paradoxal<br />
Activité <strong>EEG</strong> mixte, de faible amplitude<br />
Rythme alpha souv<strong>en</strong>t plus l<strong>en</strong>t que la veille<br />
Rythme theta (4-7 Hz):<br />
Ondes <strong>en</strong> d<strong>en</strong>ts de scie<br />
Tonus musculaire :<br />
Abs<strong>en</strong>t<br />
Phasique (réapparition du tonus par bouffées<br />
irrégulières)<br />
Mouvem<strong>en</strong>ts oculaires :<br />
Rapides, souv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> salves<br />
Déflexion initiale < 0,25s
+ Sommeil paradoxal
+ Sommeil paradoxal
+ Sommeil paradoxal
+<br />
Exemples d’indications de l’<strong>EEG</strong>
+ Epilepsie<br />
L’<strong>EEG</strong> est l’exam<strong>en</strong> le plus important dans cette indication, il<br />
permet de :<br />
Contribuer au diagnostic<br />
Caractériser le type d’épilepsie<br />
Surveiller la bonne réponse du traitem<strong>en</strong>t proposé<br />
La prés<strong>en</strong>ce d’une épilepsie est caractérisée par la prés<strong>en</strong>ce<br />
d’anomalies paroxystiques (à début et fin brutaux) qui se<br />
détach<strong>en</strong>t nettem<strong>en</strong>t du rythme de fond<br />
Ces anomalies sont différ<strong>en</strong>tes selon que le pati<strong>en</strong>t est<br />
<strong>en</strong>registré :<br />
P<strong>en</strong>dant une crise (anomalies critiques)<br />
En dehors d’une crise (anomalies intercritiques)
+ Epilepsie<br />
Quelques activités paroxystiques<br />
élém<strong>en</strong>taires :<br />
A. Pointe diphasique<br />
B. Polypointes<br />
C et D. Pointe onde<br />
E. Polypointe-onde<br />
F. Pointe l<strong>en</strong>te
+ Epilepsie<br />
Les crises généralisées :<br />
= La décharge paroxystique intéresse tout le cortex<br />
L’abs<strong>en</strong>ce (crise « petit-mal »)<br />
La crise tonico-clonique (crise « grand-mal »)<br />
Les crises partielles :<br />
= La décharge est restreinte à la zone du cerveau lésée<br />
Leurs symptômes sont fonction de la zone atteinte (crises<br />
motrices, crises visuelles, auditives…)
+ Epilepsie<br />
Abs<strong>en</strong>ce
+ Epilepsie<br />
Crise tonico-clonique généralisée
+ Epilepsie<br />
Crise tonico-clonique généralisée
+ Epilepsie<br />
Crise tonico-clonique généralisée
+ Epilepsie<br />
Crise temporale gauche (1)
+ Epilepsie<br />
Crise temporale gauche (2)
+ Epilepsie<br />
Crise temporale G (3)
+ Epilepsie<br />
Crise temporale gauche (4)
+ Epilepsie<br />
Post critique de la crise temporale (5)
+ Epilepsie<br />
Crise partielle frontale secondairem<strong>en</strong>t généralisée
+ Souffrance cérébrale - <strong>en</strong>céphalopathies<br />
Origine multiple :<br />
Métabolique (ex : <strong>en</strong>céphalopathie hépatique)<br />
Par manque de substrat (anoxie, ischémie, hypoglycémie)<br />
Infectieuse (ex : <strong>en</strong>céphalopathie herpétique)<br />
Dégénérative (ex : maladie d’Alzheimer)<br />
Se traduit sur l’<strong>EEG</strong> par :<br />
Un ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t de l’électrog<strong>en</strong>èse<br />
Des anomalies périodiques<br />
Des anomalies paroxystiques
+ Souffrance cérébrale -<br />
<strong>en</strong>céphalopathies<br />
Encéphalopathie hépatique
+ Souffrance cérébrale -<br />
<strong>en</strong>céphalopathies<br />
Encéphalopathie hépatique
+ Souffrance cérébrale -<br />
<strong>en</strong>céphalopathies<br />
Encéphalite herpétique
+ Souffrance cérébrale -<br />
<strong>en</strong>céphalopathies<br />
Maladie de Creutzfeld-Jacob
+ Souffrance cérébrale -<br />
<strong>en</strong>céphalopathies<br />
Maladie de Creutzfeld-Jacob
+ Diagnostic des comas<br />
et de la mort cérébrale<br />
La mort des neurones ou le blocage de leur activité conduit à<br />
une dépression de l’électrogénèse<br />
Coma barbiturique
+ Diagnostic des comas<br />
et de la mort cérébrale<br />
Mort cérébrale
+ Particularités de l’<strong>EEG</strong> de l’<strong>en</strong>fant<br />
L’<strong>EEG</strong> varie <strong>en</strong> fonction de l’âge et de la maturation<br />
cérébrale, les changem<strong>en</strong>ts sont d’autant plus rapides que<br />
l’<strong>en</strong>fant est jeune.<br />
Indications chez l’<strong>en</strong>fant :<br />
Rechercher un retard de maturation cérébrale<br />
Rechercher des conséqu<strong>en</strong>ces des pathologies fœtales,<br />
néonatales ou liées à la prématurité<br />
Epilepsie<br />
Bilan de retard des acquisitions
+ Particularités de l’<strong>EEG</strong> de l’<strong>en</strong>fant<br />
Nouveau-né
+ Particularités de l’<strong>EEG</strong> de l’<strong>en</strong>fant<br />
1 mois et demi
+ Particularités de l’<strong>EEG</strong> de l’<strong>en</strong>fant<br />
2 ans et demi
+<br />
Interprétation d’un <strong>EEG</strong>
Interprétation tracé n°1<br />
Yeux fermés
Interprétation tracé n°1<br />
Ouverture des yeux
Interprétation tracé n°1<br />
Hyperpnée
Interprétation tracé n°1<br />
Fin de l’hyperpnée
Interprétation tracé n°1<br />
Stimulation lumineuse intermitt<strong>en</strong>te
+ Plan pour l’interprétation<br />
Rythme de fond :<br />
Fréqu<strong>en</strong>ce ?<br />
Localisation ?<br />
Prés<strong>en</strong>ce de rythmes inhabituels ?<br />
Réactivité à l’ouverture des yeux?
+ Plan pour l’interprétation<br />
L’hyperpnée :<br />
Provoque un ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t?<br />
Avec ou sans rétrocession après l’arrêt?<br />
Décl<strong>en</strong>che des anomalies paroxystiques?<br />
La stimulation lumineuse intermitt<strong>en</strong>te :<br />
Provoque un photo<strong>en</strong>traînem<strong>en</strong>t ?<br />
Normal<br />
Pathologique<br />
Provoque une réponse photomyogénique ?<br />
Provoque une réponse photo-paroxystique ?