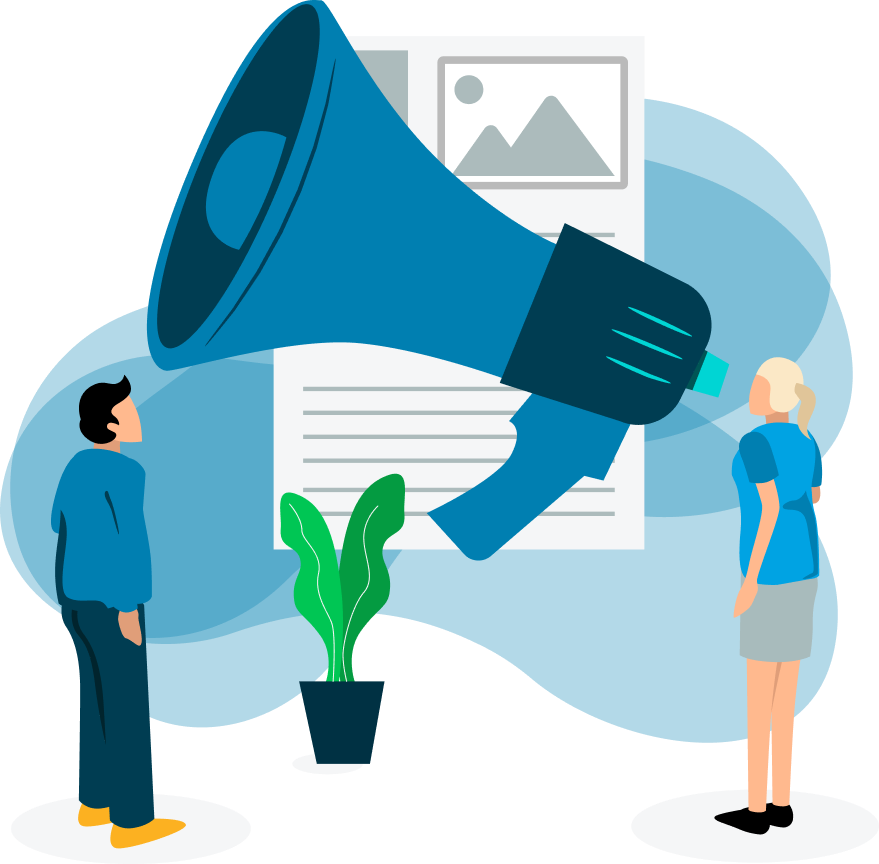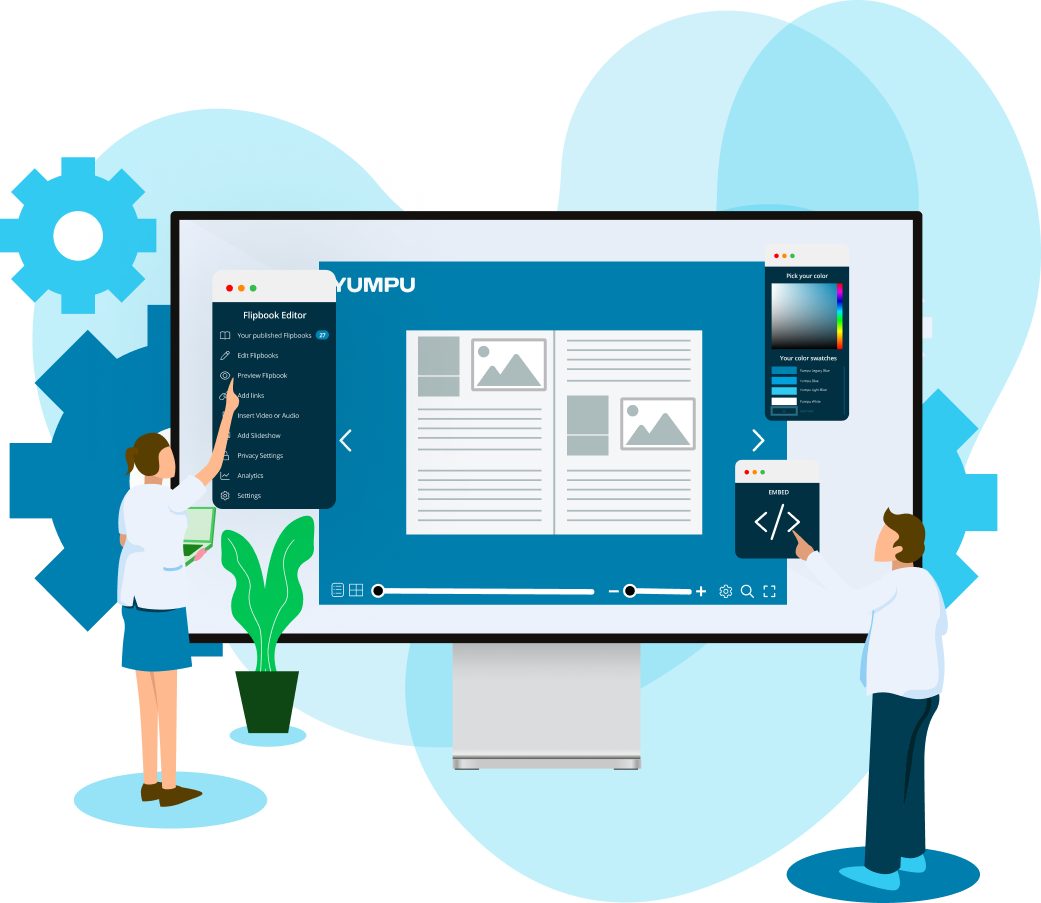Farina, mime pour mémoire - Institut d'histoire du temps présent - IHTP
Farina, mime pour mémoire - Institut d'histoire du temps présent - IHTP
Farina, mime pour mémoire - Institut d'histoire du temps présent - IHTP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MAURICE FARINA, LE MIME POUR MEMOIRE<br />
Le mythe <strong>du</strong> clown se constitue au cours de l’âge romantique, et l’on sait que le romantisme s’est plu<br />
à rassembler des images <strong>du</strong> passé jusqu’à faire de la « réminiscence » esthétique un élément de son<br />
décor propre<br />
Jean Starobinski 1<br />
Jules Maurice Chevalier, dit <strong>Farina</strong> (1883-1943) 2 se situe à la charnière entre deux<br />
époques, celle <strong>du</strong> renouveau temporaire des années 1880-1890 dû à la célébrité de grands<br />
<strong>mime</strong>s comme Séverin et Thalès ainsi qu’à la constitution d’un nouveau répertoire où<br />
s’illustrèrent poètes parnassiens, symbolistes et même quelques auteurs naturalistes, et celle<br />
de la radicale transformation qu’un Etienne Decroux fera subir à la panto<strong>mime</strong> à partir de<br />
1913 aux côtés de Jacques Copeau dans le cadre <strong>du</strong> Vieux-Colombier. Formé à la panto<strong>mime</strong><br />
traditionnelle par Lucien Gothi, lui-même élève de Paul Legrand, <strong>Farina</strong> n’en tissa pas moins<br />
des liens d’amitié avec Georges Wague, l’un des « rénovateurs » des années 1900-1910. Sa<br />
carrière, aussi bien que sa bibliothèque et ses archives déposées auprès de la collection<br />
rassemblée par Auguste Rondel à la Bibliothèque de l’Arsenal en 1947, témoignent toutefois<br />
d’une prédilection <strong>pour</strong> une conservation des pratiques anciennes 3 , conservation bientôt érigée<br />
en fabrique d’une histoire mythifiée de son art.<br />
Mais n’est-ce pas le propre de la panto<strong>mime</strong> de creuser le sillon de sa propre légende<br />
depuis la naissance <strong>du</strong> Pierrot blanc au théâtre des Funambules dans les années 1820 ?<br />
L’entreprise de <strong>Farina</strong> paraîtrait en effet incompréhensible si l’on perd de vue cette<br />
1 Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Skira, 1970, rééd. Flammarion, s. d., p. 13.<br />
2 Ce texte sur Maurice <strong>Farina</strong> et sa collection trouve son origine dans le travail de restauration effectué sur quatre<br />
ouvrages de la collection <strong>Farina</strong> par Christophe Laborde-Balen pendant l’année 2001-2002, et que j’ai eu le<br />
plaisir d’encadrer ; il a donné lieu à un <strong>mémoire</strong> de fin d’études de l’IFROA, le Fonds <strong>Farina</strong> <strong>du</strong> département<br />
des Arts <strong>du</strong> spectacle de la BnF. Etude de conservation préventive, quatre cas de restauration, IFROA, 2002,<br />
122 p. Que Christophe Laborde-Balen soit ici remercié, au nom des nombreuses conversations que nous avons<br />
partagées sur le <strong>mime</strong> <strong>Farina</strong> et son environnement ; auparavant l’un des seuls articles publiés sur la collection<br />
<strong>Farina</strong> est dû à Madeleine Horn-Monval, « La Collection <strong>Farina</strong>, Bibliothèque de l’Arsenal (fonds Auguste<br />
Rondel) », Revue d’histoire <strong>du</strong> théâtre, 1948-1949, p. 82-84. Je remercie également Noëlle Guibert, directrice <strong>du</strong><br />
département des Arts <strong>du</strong> spectacle, qui a attiré mon attention sur cette collection, Charlotte Burel, et Alain Carou<br />
<strong>pour</strong> sa relecture attentive et ses nombreuses et pertinentes remarques.<br />
3 Guina Duret, veuve de l’artiste, fit don de la collection en vue de son adjonction à la collection Rondel, d’où la<br />
cotation qui prévaut aujourd’hui (« RoFa », <strong>pour</strong> « collection Auguste Rondel, section musique, danse et<br />
panto<strong>mime</strong> » associé aux deux premières lettres de <strong>Farina</strong>), le département des Arts <strong>du</strong> spectacle dont le fonds<br />
Rondel est le noyau historique n’ayant été constitué en tant que tel qu’en 1976.<br />
1
mythologie perpétuée jusqu’au mitan <strong>du</strong> XX e siècle. Le combat des comédiens <strong>du</strong> silence <strong>pour</strong><br />
la survie de leur art cherchera long<strong>temps</strong>, tout imprégné qu’ils sont de la tradition ouverte par<br />
Gaspard Deburau dit Baptiste, à restaurer le lustre terni de la panto<strong>mime</strong>. Tenté aussi bien par<br />
un renouveau qui prenne en compte les acquis de la technique moderne (ses tentatives<br />
cinématographiques en sont un exemple) que par un retour aux origines « funambulesques »,<br />
<strong>Farina</strong> n’échappe pas à la crise majeure que traverse la panto<strong>mime</strong> dans les vingt premières<br />
années <strong>du</strong> XX e siècle ; il y apportera plusieurs réponses dont la collection qui porte son nom<br />
est un des éléments. Aujourd’hui déposée au département des Arts <strong>du</strong> spectacle de la<br />
Bibliothèque nationale de France, elle est dominée par un évident désir de <strong>mémoire</strong>, une<br />
forme de « patrimonialisation » de la panto<strong>mime</strong> chez celui qui <strong>pour</strong> raisons de santé fut<br />
empêché de pratiquer son art à partir de 1928.<br />
Naissance d’une mythologie moderne<br />
On sait que Gaspard Deburau (1796-1846) fit les beaux jours <strong>du</strong> théâtre des<br />
Funambules sur le boulevard <strong>du</strong> Temple entre les années 1820 et 1840 4 . La nouveauté <strong>du</strong><br />
spectacle, sa popularité comblèrent les attentes sinon les espoirs de la génération romantique,<br />
lasse des tragédies bavardes de l’Empire, encline à s’ennuyer au Théâtre-Français – sauf<br />
quand ce dernier consentait à jouer ses propres œuvres – et enfin désireuse d’accorder ses<br />
loisirs avec ceux <strong>du</strong> peuple, cette collectivité mythifiée dont Jeunes-France et Bousingots se<br />
firent les thuriféraires 5 . A cet égard, le Deburau, histoire <strong>du</strong> théâtre à quatre sous <strong>pour</strong> faire<br />
suite à l’histoire <strong>du</strong> théâtre français publié en 1832 par Jules Janin 6 re<strong>présent</strong>e une étape<br />
essentielle dans la reconnaissance intellectuelle <strong>du</strong> mythe Deburau. Qu’on en juge par cet<br />
extrait de la seule préface :<br />
Quand [l’auteur de ce livre] s’est emparé si hardiment de ce héros tout neuf [i. e. Deburau],<br />
son but unique a été de résumer l’Histoire de l’Art Dramatique considéré sous son aspect<br />
ignoble 7 , le seul aspect nouveau sous lequel il puisse être encore envisagé. Prenez donc cette<br />
histoire, telle qu’on vous la donne, c’est-à-dire <strong>pour</strong> un supplément indispensable à l’Histoire de<br />
notre Théâtre. Le Théâtre, tel que nous l’entendions au XVIII e siècle, est mort chez nous. Voyez<br />
4 Deburau fils ne fit pas carrière aux Funambules. Après la mort de Gaspard Deburau, c’est en effet Paul Legrand<br />
qui prit sa succession dans les rôles de Pierrot. Le théâtre des Funambules fut détruit en 1862.<br />
5 Sur le peuple et sa re<strong>présent</strong>ation fantasmée par la génération romantique, voir Michel Le Bris, Le Défi<br />
romantique, Paris, Flammarion, 2002, p. 303-305 et surtout p. 351-354.<br />
6 Jules Janin, Deburau, histoire <strong>du</strong> théâtre à quatre sous <strong>pour</strong> faire suite à l’histoire <strong>du</strong> théâtre français, Paris,<br />
Charles Gosselin, 1832, 2 vol., 145 et 163 p. (BnF-département des Arts <strong>du</strong> spectacle, cote RoFa 331), rééd.<br />
Paris, librairie des bibliophiles, 1881, XXIII-219 p. (RoFa 333).<br />
2
où en est venu le Théâtre-Français ! Des héros grecs et romains de quatre pieds, des ingénuités<br />
de soixante ans, des jeunes-premiers décrépits qui le soir, leur rôle joué, répètent <strong>pour</strong> toute<br />
prière la prière de Ninon de Lenclos : Mon Dieu, faites-moi la grâce de porter mes rides au<br />
talon ! Voilà <strong>pour</strong> la comédie, voilà <strong>pour</strong> l’art joué. Quant à l’art écrit, il est tombé dans la<br />
même décrépitude. Tout est mort dans ce pauvre vieux monde comique, autrefois si éclatant, si<br />
jeune, si riche, si plein d’amour et de gloire ! […]<br />
Il n’y a plus de Théâtre-Français, il n’y a plus que les Funambules ; il n’y a plus de Parterre<br />
littéraire, savant, glorieux, le Parterre <strong>du</strong> café Procope ; en revanche il y a le Parterre des<br />
Funambules, Parterre animé, actif, en chemise, qui aime le gros vin et le sucre d’orge.<br />
Janin prend donc le parti d’exalter un théâtre qu’il qualifie justement « d’ignoble », au sens<br />
propre <strong>du</strong> terme, ce théâtre « à quatre sous », que le titre de son livre porte en étendard et qui à<br />
lui seul permet la rencontre d’un public authentiquement populaire (auquel les Romantiques<br />
se mêlent avec délectation) et de sujets qui brisent enfin la gangue de la vieille tragédie à<br />
caractères mythologiques <strong>du</strong> XVIII e siècle. Au-delà de cette mise en exergue <strong>du</strong> « populaire »,<br />
le « théâtre à quatre sous » trouve une légitimité dans son origine même ; c’est de ce peuple<br />
mythifié qui traverse l’imaginaire des intellectuels <strong>du</strong> XIX e siècle, que semble jaillir la<br />
nécessaire rénovation d’un théâtre sclérosé 8 .<br />
Mais Jules Janin ne fut pas le premier et unique jalon de la gloire des Funambules et le<br />
livre est tardif même s’il permet de prendre date <strong>pour</strong> fonder une mythologie nouvelle qui<br />
conspue l’ancienne, celle en toge ou en peplum. Dès la fin des années 1820 en effet, Charles<br />
Nodier, « avant-courrier » des goûts de la nouvelle génération, applaudit Deburau aux<br />
Funambules et y entraîne tout le Cénacle (celui que l’on appela ensuite « Grand Cénacle » par<br />
opposition au « Petit Cénacle » des Romantiques mineurs après 1830), Victor Hugo, Gérard<br />
de Nerval, Jules Janin, Petrus Borel, parfois Balzac et surtout Théophile Gautier à qui il<br />
revient d’avoir été le grammairien de la mythologie <strong>du</strong> Pierrot dans un article fameux intitulé<br />
7 C’est nous qui soulignons ; en revanche toutes les majuscules sont de l’auteur.<br />
8 Près d’un siècle plus tard, les surréalistes repro<strong>du</strong>iront à l’égard <strong>du</strong> cinéma ce processus de mythification d’un<br />
art « ignoble », dédaigné des élites et adoré <strong>du</strong> « peuple », leur amour des serials, feuilletons et autres<br />
cinéromans se nourrissant de l’illégitimité d’un art encore méprisé et de pratiques spectatorielles empruntées au<br />
public des mélodrames à succès <strong>du</strong> XIX e siècle ; voir à ce propos Jenny Lefcourt, « Aller au cinéma, aller au<br />
peuple », dans Pascal Ory (dir.), Pour une histoire cinématographique de la France, Revue d’histoire moderne et<br />
contemporaine, numéro spécial à paraître en 2004 ; Id., article « Publics », dans François Albéra, et Jean A. Gili<br />
(dir.), Dictionnaire <strong>du</strong> cinéma français des années Vingt, 1895, revue de l’AFRHC, n° 33, p. 325-328 ;<br />
Christophe Gauthier, « Les Valeurs renversées, cinéma et modernité à la fin des années 1920 », dans François de<br />
La Bretèque (dir.), Les Intellectuels français et le cinéma, Les Cahiers de la cinémathèque, n° 70, octobre 1999,<br />
p. 65-73.<br />
3
« Shakespeare aux Funambules » 9 . Il y insiste sur le public de la salle parce qu’il y voit la<br />
source d’une renaissance théâtrale qui puise aux mêmes racines que celle <strong>du</strong> théâtre<br />
shakespearien :<br />
Il était de mode parmi les gens de lettres de fréquenter un petit théâtre <strong>du</strong> boulevard <strong>du</strong><br />
Temple où un paillasse célèbre attirait la foule. […]<br />
Si jamais l’on peut re<strong>présent</strong>er en France le Songe d’une nuit d’été, la Tempête, le Conte<br />
d’hiver de Shakespeare, assurément ce ne sera que sur ces pauvres tréteaux vermoulus, devant<br />
ces spectateurs en haillons.<br />
Si nous avions l’honneur d’être un grand génie, nous essayerions de faire une pièce <strong>pour</strong> ce<br />
théâtre dédaigné, mais une telle hardiesse nous irait mal. V. Hugo, A. de Musset <strong>pour</strong>raient tout<br />
au plus s’y risquer dans leurs bons jours. Mais, nous direz-vous, quel est donc l’auteur ou les<br />
auteurs qui travaillent à ces chefs-d’œuvre inouïs ? Personne ne les connaît, on ignore leurs<br />
noms comme les poëtes <strong>du</strong> Romancero, comme ceux des artistes qui ont élevé des cathédrales<br />
<strong>du</strong> moyen-âge. L’auteur de ces merveilleuses parades, c’est tout le monde, ce grand poëte, cet<br />
être collectif qui plus d’esprit que Voltaire, Beaumarchais et Byron ; c’est l’auteur, le souffleur,<br />
le public, surtout, qui fait ces sortes de pièces, à peu-près comme ces chansons pleines de fautes<br />
de mesure et de rime, qui font le désespoir des grands écrivains, et <strong>pour</strong> un couplet desquelles,<br />
ils donneraient avec <strong>du</strong> retour, leurs strophes les plus précieusement ciselées 10 .<br />
On reconnaît ici l’une des plus persistantes utopies des Romantiques (Jean Starobinski parle<br />
d’une « nostalgie primitiviste ») qui tend à « retrouver Shakespeare ailleurs que dans<br />
Shakespeare » 11 et à voir dans les spectacles populaires ce mélange de merveilleux, de<br />
tragique, de comique, sinon de grotesque, qui à leurs yeux caractérisaient l’auteur<br />
élisabéthain. Victor Hugo et Alfred de Musset ne sont point convoqués par hasard, et Gautier<br />
aurait tout aussi bien pu citer Alexandre Dumas. Le drame romantique – on le sait alors<br />
depuis 1827 et la préface de Cromwell – renoue explicitement avec une tradition<br />
shakespearienne occultée par la gloire des Classiques et dont « l’être collectif » est ici<br />
l’incarnation tout à la fois fantasmée et spontanée. Nerval, Gautier, Janin, ces plus illustres<br />
re<strong>présent</strong>ants <strong>du</strong> romantisme français apportent non seulement une légitimité inédite à un art<br />
jusqu’alors considéré comme mineur, mais en outre contribuent à l’édification <strong>du</strong> mythe des<br />
9 Cf Louis Péricaud, Le Théâtre des Funambules, ses <strong>mime</strong>s, ses acteurs et ses panto<strong>mime</strong>s depuis sa fondation<br />
jusqu’à sa démolition, Paris, Léon Sapin, 1897 ; Charles Nodier est en outre l’auteur <strong>du</strong> Songe d’or, panto<strong>mime</strong><br />
dont il ne reconnut jamais la paternité et qui fut re<strong>présent</strong>ée dans ce même théâtre en 1828.<br />
10 Théophile Gautier, « Shakespeare aux Funambules » (1842), cité par Louis Péricaud, op. cit., p. 115-116. Sur<br />
cette mythologie, son invention littéraire et sa fortune picturale, voir aussi J. Starobinski, op. cit. et Francis<br />
Haskell, « Le Clown triste, notes sur un mythe <strong>du</strong> XIX e siècle », De l’art et <strong>du</strong> goût. Jadis et naguère, Paris,<br />
Gallimard, 1989, p. 250-272.<br />
11 J. Starobinski, op. cit., p. 18.<br />
4
Funambules. C’est de cette mythologie que se nourrirent les artistes qui prirent la succession<br />
des Deburau, pierrots parisiens (Paul Legrand) ou provinciaux (Louis Rouffe 12 ). Leur carrière,<br />
quoi qu’alimentée par des textes nouveaux (Catulle Mendès, Jean Richepin, auteurs<br />
prestigieux de la fin <strong>du</strong> XIX e siècle y prirent leur part) n’en fut pas moins placée sous le signe<br />
de l’itération ; tout se passait comme si l’on cherchait désespérément à renouer avec les fastes<br />
crasseux et mythifiés <strong>du</strong> petit théâtre des Funambules détruit en 1862.<br />
La crise de la panto<strong>mime</strong><br />
Lorsque <strong>Farina</strong> débute dans la panto<strong>mime</strong>, celle-ci vient de connaître un brillant<br />
renouveau après une période de relative éclipse dans les années 1850 et 1860,<br />
symboliquement désignée par la destruction <strong>du</strong> théâtre originel à l’occasion des travaux de<br />
percement de la Place de la République en 1862. Toutefois, depuis la fin des années 1880, le<br />
cercle funambulesque, dont le nom lui-même porte témoignage de cette indéfectible<br />
allégeance des artistes <strong>du</strong> silence à leur ancêtre commun, avait remis au goût <strong>du</strong> jour le<br />
personnage de Pierrot, confiné à la province et plus particulièrement à la ville de Marseille<br />
dans les années de son moindre éclat. C’est l’époque où Séverin, héritier <strong>du</strong> <strong>mime</strong> marseillais<br />
Louis Rouffe, triomphe dans ce qui fut en 1890 l’un des plus grands succès de ce renouveau :<br />
la panto<strong>mime</strong> ‘Chand d’habits écrite par Catulle Mendès.<br />
Très vite, cet élan retombe et le déclin, sinon la mort annoncée de la panto<strong>mime</strong> ne<br />
trouvèrent jamais autant de cassandres que dans les années 1900-1910. Sur les ruines d’un art<br />
dont on craint l’obsolescence, de nombreux artistes fondent alors ce qu’ils appellent la<br />
panto<strong>mime</strong> « moderne ». Le personnage de Pierrot tend peu à peu à s’effacer et la pratique <strong>du</strong><br />
<strong>mime</strong> se renouvelle. Avant même Etienne Decroux, Georges Wague en est le théoricien. Dans<br />
une conférence sur la « panto<strong>mime</strong> moderne » 13 , il s’affranchit même de l’ombre tutélaire et<br />
encombrante des Deburau, fustigeant la puérilité des arguments dramatiques, doutant même<br />
de leurs qualités artistiques, car « non seulement les panto<strong>mime</strong>s qu’ils interprétaient, mais la<br />
forme même de leur art nous oblige à affirmer que ce n’était véritablement qu’un art naissant,<br />
un embryon d’art ». Il préconise par conséquent un art renouvelé, lisible et compréhensible<br />
par tous, fondé sur des « scénarios » solides, une collaboration assi<strong>du</strong>e avec le théâtre d’avant-<br />
garde, une grammaire <strong>du</strong> geste à la fois simplifiée et amplifiée (le corps en son entier devra<br />
12<br />
Rouffe fit surtout carrière à Marseille où se développa une école autonome de panto<strong>mime</strong> dans la seconde<br />
moitié <strong>du</strong> XIX e siècle.<br />
13<br />
Georges Wague, Conférence sur la panto<strong>mime</strong> moderne, 19 janvier 1913, s. l. n. d., BnF-ASP, RoFa 370 (2).<br />
5
désormais « dire » le texte, et non plus les gestes seuls) et une évolution <strong>du</strong> vieux Pierrot de<br />
convention en un « type » à-même de re<strong>présent</strong>er les aspirations modernes des spectateurs 14 .<br />
Si la crise provient bien <strong>du</strong> personnage et d’une certaine usure des gestes, elle est de<br />
surcroît aggravée par l’expansion d’un nouveau mode d’expression, lui aussi sans paroles, et<br />
bientôt dominateur : le cinéma. Alors que dans les années 1900, le cinéma fut brièvement<br />
regardé par les « modernistes » comme la providence de cet « autre art <strong>du</strong> silence » (avec<br />
Georges Wague entre autres qui tourne dans l’Enfant prodigue de Benoît-Lévy en 1907,<br />
première tentative de légitimation d’un cinéma théâtral, distinct <strong>du</strong> spectacle de foire 15 ),<br />
l’apparition de Charlot sur les écrans nationaux détrône définitivement Pierrot dans le cœur<br />
des spectateurs après la Première Guerre mondiale. Les <strong>mémoire</strong>s <strong>du</strong> <strong>mime</strong> Séverin, publiés<br />
en 1929, en témoignent avec éclat. L’héritier de Rouffe – et donc par son truchement de la<br />
grande école parisienne puis marseillaise de la panto<strong>mime</strong> française – est partagé entre<br />
l’admiration et l’exécration <strong>pour</strong> le nouveau <strong>mime</strong> universel découvert en Europe pendant la<br />
Grande Guerre, le vagabond incarné par Charlie Chaplin. Confronté à une telle concurrence,<br />
le regard de Séverin est avant tout celui d’un artiste inquiet, dont l’art séculaire est désormais<br />
menacé par des moyens qui le dépassent :<br />
[…] Lorsqu’on compare Charlot à notre Pierrot, cela n’est pas encore juste. Charlot mourra<br />
avec Chaplin […] Pierrot, par la poésie, la littérature, la peinture, le théâtre, sera immortel.<br />
Pierrot a créé un costume qui ne ressemble à aucun autre, qui est à lui et ne peut aller qu’à lui,<br />
qui n’est d’aucune époque et qui sera de tous les <strong>temps</strong>. […] Charlot est caricatural, pas Pierrot.<br />
Qu’un peintre peigne Pierrot, qu’un sculpteur le modèle ; ils en feront une œuvre d’art, tandis<br />
qu’ils ne feront sortir de Charlot qu’un jouet d’enfant, un bibelot de bazar. Ceci soit dit sans<br />
vouloir diminuer le mérite de la création de Charlie Chaplin , qui est bien sienne, et de son génie<br />
d’acteur, qui est réellement admirable. Mais Charlot traversera le ciel de l’art comme un<br />
météore ; Pierrot est l’astre dont la lumière ne s’éteindra jamais 16 .<br />
Chez un artiste qui a connu les derniers feux de la gloire initiale de la panto<strong>mime</strong>, cet<br />
hommage ambigu à Chaplin consacre à son corps défendant le triomphe de Charlot sur<br />
14 Sur ce renouveau de la panto<strong>mime</strong> au début <strong>du</strong> XX e siècle, son opposition à la « panto<strong>mime</strong> d’école » (incarnée<br />
par Rouffe, Séverin et en l’occurrence <strong>Farina</strong>) ainsi que sur les conséquences de ce mouvement sur<br />
l’appréhension <strong>du</strong> cinéma, voir Alain Carou, « L’Autre Art muet. Panto<strong>mime</strong>(s) et cinéma en France », dans<br />
Leonardo Quaresima et Laura Vichi (dir.), La Decima musa. Il cinema e le altre arti -The Tenth Muse. Cinema<br />
and other arts (VI e congrès Domitor, VII e conférence internationale d’études cinématographiques, Udine, mars<br />
2000) Udine, Forum, 2001, p. 525-534.<br />
15 Sur l’Enfant prodigue, Edmond Benoît-Lévy et la place de ce film dans l’histoire <strong>du</strong> cinéma, voir J.-J. Meusy,<br />
« Qui était Edmond Benoît-Lévy ? », dans Les Vingt premières années <strong>du</strong> cinéma français (colloque, Paris,<br />
1993), Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle-AFRHC, 1995, p. 115-142 et Alain Carou, Le Cinéma français et<br />
les écrivains. Histoire d’une rencontre, Paris, Ecole des chartes-AFRHC, 2002, p. 79-83.<br />
16 Séverin, L’Homme blanc, souvenirs d’un Pierrot, Paris, Plon, 1929, p. 246-247, BnF-ASP, RoFa 323 (1).<br />
6
Pierrot. Sinon, <strong>pour</strong>quoi mettre tant de verve à proclamer la pérennité de son propre<br />
personnage contre celui de Charlot ? Cette erreur de jugement, ce triomphe illusoire <strong>du</strong> Pierrot<br />
blanc n’est-il pas l’indice d’une défaite historique de la panto<strong>mime</strong> face au cinéma ? Au<br />
moment où Séverin écrit ces lignes, d’autres artistes ont cherché les voies <strong>du</strong> renouveau ;<br />
Georges Wague et surtout Etienne Decroux – à partir de 1913 aux côtés de Jacques Copeau –<br />
ont déjà jeté la défroque <strong>du</strong> vieux « paillasse » <strong>pour</strong> revêtir des atours plus conformes à<br />
l’esprit <strong>du</strong> <strong>temps</strong> et renouer des liens rompus avec le théâtre d’avant-garde.<br />
Une utopie rétrospective<br />
<strong>Farina</strong> – formé, nous l’avons dit, par Lucien Gothi dans la grande tradition<br />
funambulesque – débute sur la scène en 1898, au moment où meurt Paul Legrand, dernier<br />
élève de Deburau père, et maître de Lucien Gothi. Toute la carrière de <strong>Farina</strong> sera marquée<br />
par cette filiation et le désir de renouer avec ce théâtre originel et à jamais per<strong>du</strong>. S’il connaît<br />
entre 1900 et 1910 des années de « vache enragée » 17 , il n’en est pas moins remarqué très tôt<br />
par la critique comme l’un des successeurs des Deburau père et fils. Ainsi peut-on lire dès<br />
1903 :<br />
Il fallait bien qu’un jour ou l’autre ce genre si aimé des Parisiens retrouvât un théâtre. Depuis<br />
long<strong>temps</strong> les Funambules de Deburau, de Paul Legrand, de Charles Deburau avaient disparu ;<br />
un jeune, un audacieux, un artiste de haute valeur, <strong>Farina</strong> au masque si mobile et si expressif, a<br />
conçu le dessein de les réveiller avec une volonté qui ne redoute aucun obstacle, il est en train<br />
d’y réussir 18 .<br />
A l’ombre de ces grands ancêtres, <strong>Farina</strong> se fraie un chemin et tente, comme tous les artistes<br />
de ce genre, de renouveler son art. Il s’illustre dès 1899 dans le genre des « chansons<br />
mimées » inventé par Xavier Privas, et qui connaît un certain succès dans les dix premières<br />
années <strong>du</strong> siècle. Elles n’en sont pas moins un indice de la crise <strong>du</strong> <strong>mime</strong>. En effet, ce n’est<br />
plus l’artiste qui attire les foules, mais bien le mimétisme entre les paroles (le chanteur se<br />
trouve en coulisses) et le geste (<strong>Farina</strong> est sur scène et <strong>mime</strong> l’action de la chanson) 19 . Il y a là<br />
un premier signe, dans la forme même, d’itération dans la carrière <strong>du</strong> jeune <strong>Farina</strong>. Il est à cet<br />
17<br />
<strong>Farina</strong> se trouve même dans l’obligation d’aller se pro<strong>du</strong>ire devant les troupes cantonnées dans les colonies,<br />
les fameux « Bat’ d’Af », en 1906.<br />
18<br />
Théodore Massiac, « Résurrection des Funambules galerie Vivienne », la Petite République, décembre 1903,<br />
BnF, ASP, collection <strong>Farina</strong>, RoFa 370 (1).<br />
19<br />
Il pouvait arriver que le chanteur se trouvât lui-même en coulisses, mais le plus souvent la panto<strong>mime</strong> était<br />
accompagnée par un phonographe.<br />
7
égard tout à fait symptomatique que ce genre des chansons mimées soit inventé au plus fort<br />
des déclarations récurrentes sur la mort de la panto<strong>mime</strong> 20 .<br />
Celle-ci ne fait aucun doute <strong>pour</strong> les observateurs, parmi lesquels un certain Irénée<br />
Laugier qui en 1910 rend un hommage ambigu à Deburau père et aux Funambules à propos<br />
d’une re<strong>présent</strong>ation de gala de l’Agonie de Pierrot, panto<strong>mime</strong> de Joseph Leroux, où<br />
s’illustre <strong>Farina</strong> lui-même. Sous le titre « La Panto<strong>mime</strong> se meurt », il remercie <strong>Farina</strong>,<br />
Willette et quelques autres de chercher à redonner quelque éclat à « cet art trop délaissé ».<br />
Mais surtout, l’article se veut une petite histoire <strong>du</strong> théâtre par la panto<strong>mime</strong>, tendant à<br />
démontrer que des Anciens à Talma 21 , elle fut l’élément essentiel et permanent de la<br />
rénovation de la pratique théâtrale :<br />
La panto<strong>mime</strong> ne pouvait mourir ; elle est vieille comme le théâtre et immortelle comme lui.<br />
Elle est indispensable au comédien. Molière lui-même reçut des leçons <strong>du</strong> célèbre<br />
Scaramouche, appelé en France par Louis XIV.<br />
Talma, si sobre de gestes, exprimait la pensée des maîtres surtout par des jeux de<br />
physionomie. Diderot, à la re<strong>présent</strong>ation de ses drames, se bouchait les oreilles <strong>pour</strong> mieux se<br />
rendre compte <strong>du</strong> jeu des acteurs. La Malibran, aux répétitions d’une pièce nouvelle, invitait<br />
toujours un professeur de l’école des sourds-muets 22 .<br />
On trouve dans ce bref article les présupposés qui présideront justement à la collection<br />
de <strong>Farina</strong>, après son retrait des planches dans les années 1920. En effet, tout semble concourir<br />
à faire de la panto<strong>mime</strong> le cœur secret de l’évolution <strong>du</strong> théâtre ; tout se passe comme si –<br />
nous verrons à quel point <strong>Farina</strong> y tendra dans sa collection-même – le théâtre, l’art noble,<br />
devait puiser en des ressources considérées comme « ignobles » – <strong>pour</strong> reprendre le mot de<br />
Janin – <strong>pour</strong> connaître ses moments d’apogée. L’histoire rejoint ici l’apologie qui contribue à<br />
ennoblir un art mineur et délaissé <strong>pour</strong> en faire la secrète racine <strong>du</strong> renouveau.<br />
En 1898, Séverin avait ouvert un « Nouveau théâtre des Funambules » qui connut une<br />
existence éphémère et où l’on tentait de créer un véritable répertoire <strong>du</strong> <strong>mime</strong>. Si l’on joue en<br />
effet fort peu de pièces datant de l’époque des Deburau, les pièces de Mendès, de Willette et<br />
20 Faut-il voir dans les nombreuses panto<strong>mime</strong>s dont le thème est la Mort ou l’Agonie de Pierrot un indice<br />
supplémentaire de cette crise ? C’est l’hypothèse de Francis Haskell qui voit dans la mythologie naissante <strong>du</strong><br />
Pierrot une corrélation étroite avec celle <strong>du</strong> clown triste, dont la fortune picturale sera immense entre 1860 et<br />
1940 (Picasso, Rouault, etc.), cf F. Haskell, art. cit.<br />
21 Chronologiquement, la carrière de Talma est immédiatement antérieure à celle de Deburau père ; la<br />
comparaison entre les deux artistes est d’ailleurs fréquente au point que Deburau fut qualifié par Albert Monnier,<br />
chroniqueur dramatique des années 1840-1850, de « Talma de la panto<strong>mime</strong> ». L’expression sera reprise par la<br />
suite.<br />
22 Irénée Laugier, « La Panto<strong>mime</strong> se meurt », la Liberté, 10 avril 1910, BnF-ASP, RoFa 370 (1).<br />
8
d’autres tiennent en effet ce rang de répertoire pendant une trentaine d’années. Le nom de<br />
« Funambules » contribuait de la sorte à sonner comme celui de « Comédie française de la<br />
panto<strong>mime</strong> » dans l’esprit des spectateurs et des feuilletonnistes. C’est d’ailleurs dans cette<br />
perspective que <strong>Farina</strong> lui-même réactiva le cercle funambulesque en 1903, en proposant à<br />
Lucien Gothi d’en être le président. Au mitan des années 1920, <strong>Farina</strong> devait s’emparer à<br />
nouveau de ce nom mythique où rénovation et tradition rivalisent avec ambiguïté.<br />
Après la Grande Guerre où il fut grièvement blessé à l’ypérite, <strong>Farina</strong> remonte sur<br />
scène dans l’une de ces pièces de « répertoire », le ‘Chand d’habits de 1890 légèrement<br />
corrigé ; il y tient le rôle <strong>du</strong> spectre auprès d’un Séverin déjà dépassé par son <strong>temps</strong>. C’est<br />
alors qu’il s’oriente vers deux directions apparemment antagonistes, le cinéma d’une part, et<br />
l’organisation d’une troupe appelée « Funambules modernes » de l’autre. Toute la complexité<br />
<strong>du</strong> rapport de cet artiste au passé est visible dans la double inflexion que <strong>Farina</strong> fait alors subir<br />
à sa carrière. Il tourne donc le Trésor de Kériolet en 1919 sous la direction d’Albert Keim<br />
avec André Nox et Georges Carpentier et la Boscotte toujours dirigé par Albert Keim en<br />
1926. Ce dernier titre n’est en fait que la version filmée d’un spectacle re<strong>présent</strong>é en 1925 à<br />
l’Exposition internationale des Arts décoratifs, spectacle singulier qui à l’inverse <strong>du</strong> courant<br />
général tendait à adapter le cinéma à la scène. Guina Duret, sa veuve, en témoignera des<br />
années plus tard : « Mon mari voulut par sa mise en scène faire <strong>du</strong> cinéma à la scène afin<br />
disait-il d’évoluer, car le public n’était plus au courant des gestes de la panto<strong>mime</strong> classique,<br />
dite vieille panto<strong>mime</strong> à l’époque » 23 . L’adaptation cinématographique d’un tel spectacle était<br />
donc logique.<br />
Plus clairement, seul l’immense succès de Charlie Chaplin explique ce passage au<br />
film. <strong>Farina</strong> cherche de la sorte à vulgariser de nouveau un langage tombé en déshérence,<br />
celui de la panto<strong>mime</strong> traditionnelle, tout en profitant <strong>du</strong> vecteur de masse qu’était le cinéma.<br />
On peut se demander à ce stade si d’ores et déjà – et malgré la « modernité » des moyens<br />
employés – le désir d’un retour mythifié au passé ne l’emporte pas ici. En témoigne au<br />
demeurant un très bref texte de 1930 en hommage à Chaplin où, à l’instar de son prédécesseur<br />
Séverin, il voit dans Charlot un « type populaire » à l’égal de « celui de Robert Macaire et de<br />
Pierrot à la scène, dont cet autre grand <strong>mime</strong>, Jean-Baptiste Gaspard Deburau fut<br />
l’original » 24 .<br />
23<br />
Lettre de Guina Duret à Madeleine Horn-Monval, s. d. [ca 1947-1950], BnF-ASP, dossier relatif à<br />
l’acquisition <strong>du</strong> fonds <strong>Farina</strong>.<br />
24<br />
Maurice <strong>Farina</strong>, « Charlie Chaplin (Charlot) », dans Les Funambules, Maurice <strong>Farina</strong> et la panto<strong>mime</strong>, s. l. n.<br />
d. [1931], p. 1. L’exemplaire sur lequel nous avons travaillé est celui adressé à Auguste Rondel en 1932 (cote Ro<br />
11582).<br />
9
Mais <strong>Farina</strong> ira plus loin encore dans ce retour au passé. Il crée en 1926 une troupe, les<br />
« Funambules modernes », doublée d’une éphémère revue, intitulée Funambules. Il en est le<br />
directeur artistique, assisté par André Girard, rédacteur en chef de la revue et directeur<br />
administratif de la troupe ; les spectacles ont lieu dans les salles qui veulent bien les accueillir<br />
et tout particulièrement dans celle <strong>du</strong> journal Comœdia. Si Funambules ne connaît qu’une<br />
seule et unique livraison, son contenu n’en est pas moins intéressant. Elle est toute entière<br />
placée sous le signe de Deburau, dont un portrait signé Georges Rouault figure en couverture,<br />
tandis que <strong>Farina</strong> lui-même, dessiné par le même Rouault, ferme le volume. Les deux artistes<br />
semblent de la sorte ouvrir et clore une période de l’art <strong>du</strong> silence. Willette, Heuzé, Asselin, et<br />
André Girard en sont les autres illustrateurs, tandis que Rouault contribue également au<br />
contenu par un poème-dédicace intitulé « A feu Deburau ». Plus que jamais, c’est bien une<br />
origine mythifiée qui est ici exaltée et qui place Gaspard Deburau au cœur d’une tendance<br />
authentiquement régressive de la panto<strong>mime</strong>, une forme d’utopie rétrospective en quelque<br />
sorte. A mi chemin entre l’usage lettré et la simple repro<strong>du</strong>ction mythologique, la carrière <strong>du</strong><br />
<strong>mime</strong> illustre bien le « désir régressif » identifié par Jean Starobinski dans Portrait de l’artiste<br />
en saltimbanque qui situe justement la fortune intellectuelle et picturale des Pierrots,<br />
Arlequins et autres clowns de l’art occidental des XIX e et XX e siècle dans une quête impossible<br />
vers un art originel et introuvable :<br />
L’artiste ne peut oublier la réflexion nostalgique qui l’a invité à découvrir un art premier : il ne<br />
peut se plonger dans l’eau de jouvence, se dépouiller de toute sa science <strong>pour</strong> vivre et créer dans<br />
l’élan d’une spontanéité retrouvée. Il fera, <strong>pour</strong> le cirque, <strong>pour</strong> l’art nègre, ce que Virgile a fait<br />
<strong>pour</strong> les bergers d’Arcadie, ce que les Romantiques ont fait de la pensée d’Ossian : il exprimera<br />
son regret de la spontanéité originelle dans une réflexion « sentimentale » et transfigurante. Les<br />
images archaïques, intro<strong>du</strong>ites dans le langage de l’art moderne, apparaîtront comme les reflets<br />
d’un monde per<strong>du</strong> ; elles vivront dans un espace remémoré 25 ; elles porteront la marque de la<br />
passion <strong>du</strong> retour. Ce seront des créatures <strong>du</strong> désir régressif, ou des rôles revêtus de façon à<br />
devenir parodique 26 .<br />
Tout le paradoxe de <strong>Farina</strong> tient dans cette double expérience menée dans la première<br />
décennie qui suit la Grande Guerre : renouveler la panto<strong>mime</strong> en réinvestissant l’antique, si<br />
l’on peut dire, retravailler le personnage de Pierrot (d’où la dette jamais soldée à l’égard de<br />
Deburau), dont tout le monde s’accorde à dire qu’il est presque mort tout en revendiquant une<br />
approche renouvelée de son art. La démarche n’est donc pas uniquement « réactionnaire » au<br />
25 Songeons ici à la revue Funambules illustrée par Rouault, doublée par cet espace symbolique que sont la<br />
troupe des Nouveaux funambules et la collection constituée par <strong>Farina</strong>.<br />
10
sens propre <strong>du</strong> terme ; elle est plutôt « restauratrice » puisqu’elle vise très exactement à<br />
« restaurer » le lustre et la légitimité d’antan en utilisant les gestes de la panto<strong>mime</strong> moderne<br />
<strong>pour</strong> ressusciter un personnage sorti <strong>du</strong> passé.<br />
Un musée imaginaire<br />
Que l’expérience de <strong>Farina</strong> fût consacrée par l’échec ou le succès, on ne le sait guère,<br />
dans la mesure où les circonstances l’obligèrent à l’interrompre. Les séquelles de ses<br />
blessures de guerre l’amenèrent à cesser toute activité en 1928, et <strong>pour</strong> plusieurs années.<br />
Jusqu’à sa mort, et à l’exception de quelques re<strong>présent</strong>ations dans le Sud de la France, <strong>Farina</strong><br />
se consacra à sa seule collection, sublimation d’un art désormais impraticable. Le fonds<br />
<strong>Farina</strong> déposé au département des Arts <strong>du</strong> spectacle se compose de cent quatre-vingt dix-sept<br />
dessins, gravures, et objets, quatre-cent quarante-quatre titres de livres et vingt boîtes<br />
d’archives retraçant la carrière <strong>du</strong> <strong>mime</strong>. Des dessins conservés dans les archives indiquent<br />
que dès les années 1900, la chambre de Maurice <strong>Farina</strong> à Montmartre était organisée comme<br />
un véritable musée où se répondaient gravures, ouvrages et tableaux, le lit de l’artiste étant<br />
surmonté d’un buste de Deburau. Lorsqu’il se retire dans le Sud de la France après 1928, il y<br />
aménage ce qu’il continue d’appeler son studio en véritable musée <strong>du</strong> <strong>mime</strong> dont la visite aux<br />
chandelles, qui n’est pas sans rappeler l’atmosphère d’un film expressionniste, nous est narrée<br />
par Alfred Barol dans le petit livre d’hommage à <strong>Farina</strong> publié en 1930 :<br />
Son studio, pièce étrange et sombre dans l’entassement de meubles et d’objets exagère encore<br />
l’étroitesse (sombre, ma foi parce que d’installation récente, elle n’est pas <strong>pour</strong>vue d’électricité).<br />
A souhait, après tout, puisque ce manque de lumière, obligeant mon hôte à tenir sa lampe à bout<br />
de bras <strong>pour</strong> me faire les honneurs <strong>du</strong> lieu, donne à cette première prise de contact, dans cette<br />
pièce peuplée d’ombres et de clartés, un caractère des plus funambulesques.<br />
Une lourde tenture, un décor de scène curieusement damasquiné, tirée, la grande ombre d’un<br />
très vieux et haut bahut, formant bibliothèque, se dresse et nous surprend au milieu, véritables<br />
reliques d’un art touchant à la religion. […]<br />
Sur les murs, les pierrots multicolores s’animent à la lueur vacillante de la lampe ; là, à mesure<br />
qu’il invoque, Gaspard Debureau [sic] et son fils Charles semblent sortir de leur cadre, et tous<br />
ceux qui prêtèrent à la panto<strong>mime</strong> le concours de leur talent semblent revivre. Et, en une<br />
sarabande folle, de multiples Pierrots, Colombines, Arlequins et Polichinelles, tous les<br />
personnages typiques de la comédie italienne, Docteur ventripotents, Pantalons efflanqués,<br />
26 Jean Starobinski, op. cit., p. 23<br />
11
sordides et vieilles Ruffianas ayant retrouvé des jambes de vingt ans, dont les couleurs bariolées<br />
des costumes de l’époque forment la plus curieuse bigarrure, tournent endiablés, autour de la<br />
chambre, tandis qu’Isabella, ayant per<strong>du</strong> toute dignité, trébuche et perd l’équilibre ; alors toute<br />
la troupe d’éclater de rire sous les masques, et de disparaître… 27<br />
Ainsi donc le musée <strong>du</strong> <strong>mime</strong> de Maurice <strong>Farina</strong> mêle les figures mythiques <strong>du</strong> théâtre<br />
<strong>du</strong> boulevard <strong>du</strong> premier XIX e siècle et la <strong>mémoire</strong> d’un art auquel il convient, <strong>pour</strong> l’éternité,<br />
de conférer une plus grande légitimité. La prééminence <strong>du</strong> <strong>mime</strong> et plus particulièrement de<br />
Deburau dans cet ensemble iconographique est flagrante ; sur cent-six peintures et gravures,<br />
trente-deux se réfèrent soit à Deburau père et fils, soit aux Funambules et au Boulevard <strong>du</strong><br />
Temple. Le fétichisme <strong>du</strong> collectionneur dont témoignent les objets conservés aux Arts <strong>du</strong><br />
spectacle (canne, lunettes et tabatière de Frédérick Lemaître, bâton noué <strong>du</strong> comédien dans<br />
l’Auberge des Adrets) tend à accentuer la dimension proprement mémorielle <strong>du</strong> musée.<br />
Mais ce sont les livres qui illustrent le mieux la part fantasmée et imaginaire <strong>du</strong> musée.<br />
Un grand nombre d’entre eux sont en effet truffés de lettres, d’illustrations, de gravures,<br />
d’affiches ou d’aquarelles (soixante-douze volumes de la collection sont en effet illustrés de<br />
près de huit cents dessins, gravures ou photographies). La composition physique de chaque<br />
ouvrage est elle-même une forme d’écriture historique qui dénote de l’attachement de <strong>Farina</strong> à<br />
quelques constantes de l’histoire <strong>du</strong> théâtre. Le Dictionnaire des comédiens français 28 en<br />
fournit une preuve éclatante. Publié en fascicules, puis en volume, par Henry Lyonnet au<br />
début <strong>du</strong> XX e siècle, <strong>Farina</strong> l’acquiert en 1920 et le truffe, conformément à son habitude, de<br />
repro<strong>du</strong>ctions ou d’illustrations de sa main, parfois elles-mêmes copiées d’après des gravures,<br />
qui mettent en exergue une vision de l’histoire <strong>du</strong> théâtre. Il est à cet égard tout à fait<br />
révélateur que le premier volume soit encadré – en ses seuils – par deux portraits de<br />
Shakespeare, enrichis de deux dessins de <strong>Farina</strong>, le premier re<strong>présent</strong>ant la maison natale de<br />
l’auteur de Roméo et Juliette, le second le théâtre <strong>du</strong> Globe. Point de place ici <strong>pour</strong> la tragédie<br />
classique, Racine ou Corneille. Molière lui-même dans le second tome ne « bénéficie » que de<br />
trois gravures additionnelles, dont l’une re<strong>présent</strong>ant son fameux « fauteuil » aujourd’hui<br />
exposé à la Comédie française. Bien plus encore, au verso de la couverture <strong>du</strong> premier tome<br />
est collée une gravure de Joliez montrant les tréteaux de Tabarin sur la place Dauphine, et<br />
après la page de titre <strong>du</strong> second tome (la couverture n’en a pas été conservée par le relieur),<br />
27<br />
Alfred Barol, dans Les Funambules… op. cit., p. 8-9 ; ce texte fut initialement publié dans la France de Nice<br />
en 1928.<br />
28<br />
Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français, s. l. n. d. [1917], BnF-ASP, RoFa 290 (1 et 2).<br />
12
c’est le Boulevard Saint-Martin qui est à l’honneur 29 . Cela ne signifie pas <strong>pour</strong> autant que le<br />
Théâtre-Français et les « classiques » soient absolument occultés par <strong>Farina</strong> ; un grand<br />
nombre de ses sociétaires y ont droit à des portraits qui s’ajoutent à ceux repro<strong>du</strong>its dans le<br />
texte. Il n’en reste pas moins que domine une impression d’ensemble de mythographie<br />
perpétuée <strong>du</strong> Boulevard <strong>du</strong> Crime et de ses annexes, une glorification d’un théâtre populaire<br />
avant l’heure, où prirent racine puis fructifièrent la panto<strong>mime</strong>, Deburau et Frédérick<br />
Lemaître.<br />
<strong>Farina</strong> est de la sorte aux antipodes <strong>du</strong> bibliophile car le livre n’est <strong>pour</strong> lui qu’un<br />
support matériel de la <strong>mémoire</strong>. Par le truchement d’un complexe processus d’appropriation à<br />
la fois réel (insertion de lettres, de manuscrits ou de dessins dans les ouvrages, envoi des<br />
documents à la reliure) et symbolique (ex-libris, signature apposée au bas de ses dessins ou<br />
sur des plats de reliure peints par lui, annotations marginales), il devient un réceptacle des<br />
témoignages <strong>du</strong> passé, une accumulation de preuves, un réservoir d’archives dont l’unique fin<br />
est de contribuer à la grandeur d’un théâtre populaire dont la légitimité s’institue, comme <strong>pour</strong><br />
les Romantiques, avec Shakespeare. Dans ce <strong>temps</strong> retrouvé qu’est l’apparence physique <strong>du</strong><br />
livre se concentre alors non pas seulement l’histoire, mais la mythologie revisitée d’un art qui<br />
trouve enfin sa noblesse et sa pérennité. Le dépôt de la collection à la Bibliothèque nationale<br />
fut à cet égard envisagé tant par <strong>Farina</strong> lui-même que par son épouse Guina Duret comme un<br />
gage supplémentaire de cette pérennité.<br />
Dès 1930 en effet, <strong>Farina</strong> écrit à Rondel et envisage de déposer à la bibliothèque de<br />
l’Arsenal la collection patiemment constituée au fil des années. Après son décès en 1943, sa<br />
veuve lèguera par testament l’ensemble des ouvrages, dessins, archives et objets de la<br />
collection de son mari, tout en exigeant (clause fréquente dans les donations) qu’elle ne soit<br />
pas dispersée, mais bien annexée en tant que telle au fonds Rondel 30 . Un point est essentiel<br />
aux yeux de Guina Duret, la dimension publique de la collection : elle y insiste à plusieurs<br />
reprises : « Je suis la veuve <strong>du</strong> grand <strong>mime</strong> Maurice <strong>Farina</strong> mort <strong>pour</strong> la France et ami de<br />
Monsieur Rondel […]. Son désir fut que cette collection soit donnée à son Pays. Pendant<br />
l’Occupation, j’ai risqué <strong>pour</strong> la garder et je fais un gros sacrifice <strong>pour</strong> réaliser son désir » 31 .<br />
29 La lithographie de Moudrot qui est repro<strong>du</strong>ite dépeint un marchand ambulant de glaces et de boissons dans la<br />
queue d’un théâtre <strong>du</strong> boulevard ; elle porte la légende suivante : « Par ici cocotier… un verre de Champagne<br />
grand mousseux… faut se préparer l’estomac quand on a dix actes <strong>pour</strong> sa soirée… c’est ça de crânes tartines à<br />
avaler !… ».<br />
30 Dans son testament daté <strong>du</strong> 6 janvier 1950, Guina Duret précise qu’elle « désire que cette donation soit<br />
incorporée à la « Collection Rondel » et suivre le sort de cette collection dans l’avenir, quelle que soit sa<br />
destination et le lieu où elle <strong>pour</strong>ra être conservée matériellement », BnF-ASP, dossier relatif à l’acquisition <strong>du</strong><br />
fonds <strong>Farina</strong>.<br />
31 Lettre <strong>du</strong> 18 juillet 1947 au conservateur de la Bibliothèque de l’Arsenal.<br />
13
Au regard de la singularité de cette collection, <strong>du</strong> statut si particulier qu’elle réservait à la<br />
panto<strong>mime</strong> et de sa réévaluation dans l’histoire <strong>du</strong> théâtre, il ne fait aucun doute que la<br />
donation plusieurs fois confirmée fût perçue tant par <strong>Farina</strong> lui-même que par sa veuve<br />
comme une manière <strong>pour</strong> la panto<strong>mime</strong> de trouver une place enfin digne d’elle, aux côtés de<br />
la plus importante collection théâtrale que l’on pût alors trouver en France – le fonds Rondel –<br />
enrichie trois ans plus tard par l’immense ensemble patrimonial constitué par Edward Gordon<br />
Craig.<br />
Maurice <strong>Farina</strong>, on l’a vu, est entré en scène à un moment de crise particulièrement<br />
sensible de la panto<strong>mime</strong>. A l’encontre de certains de ses collègues, il choisit d’ancrer sa<br />
pratique et son personnage dans la tradition, dans une forme « d’itération » toujours<br />
recommencée <strong>du</strong> moment initial de son art, témoin et acteur de cette « réminiscence<br />
esthétique » dont parle Jean Starobinski. N’est-ce pas là la meilleure preuve de la puissance<br />
d’une mythologie qui laisse dans l’ombre toute tentative de renouvellement et contraint<br />
l’historien <strong>du</strong> spectacle à se faire « mythographe » ou « mythologue » autant qu’analyste de la<br />
pratique ? Les ouvrages conservés dans la collection <strong>Farina</strong> en sont un exemple : le livre lui-<br />
même, son apparence, et encore une fois les usages dont il garde la trace devient à lui-même<br />
autant qu’à l’art dont il est le témoignage « source » ou « archive ». La collection dans son<br />
entier est l’occasion d’écrire une histoire renouvelée qui s’appuie sur sa dimension<br />
symbolique, celle d’un « lieu de <strong>mémoire</strong> », lu, consulté, compulsé comme un grand livre –<br />
<strong>pour</strong>rait-on dire – dont chaque page se trouve démultipliée par les illustrations qui<br />
l’enrichissent.<br />
Je ne résisterai pas au plaisir de revenir une fois encore sur ce mythe <strong>du</strong> XIX e siècle<br />
sans lequel <strong>Farina</strong> et sa collection n’auraient pas existé : celui <strong>du</strong> Baptiste, <strong>du</strong> Pierrot, <strong>du</strong><br />
clown triste, identifié par Starobinski tant dans sa généalogie littéraire que dans son devenir<br />
pictural. C’est en effet à la lumière de cette <strong>mémoire</strong> mythologique que s’éclaire l’une de ses<br />
plus tardives expressions, portée à son point d’incandescence par Jacques Prévert et Marcel<br />
Carné avec Les Enfants <strong>du</strong> paradis. Au-delà <strong>du</strong> seul Chaplin, la légende mythifiée <strong>du</strong><br />
Baptiste, tragique Paillasse voué à la mort ou à l’obsolescence apparaît comme une source<br />
essentielle qui traverse l’histoire <strong>du</strong> cinéma. A l’aune de cette réminiscence esthétique dont la<br />
carrière et la collection de <strong>Farina</strong> sont l’un des jalons, <strong>pour</strong>quoi ne pas voir dans Les Enfants<br />
<strong>du</strong> Paradis la réitération de cette mythologie, conservant <strong>pour</strong> des générations de spectateurs<br />
le récit légendaire d’une <strong>mémoire</strong> de la panto<strong>mime</strong> qui se confond désormais avec son<br />
14
histoire ? Or – comme ne l’ignorent pas cinéphiles et admirateurs de John Ford – la légende,<br />
c’est parfois tout ce qui reste de l’Histoire 32 .<br />
Christophe Gauthier<br />
Conservateur au département des Arts <strong>du</strong> spectacle de la Bibliothèque nationale de France<br />
32 Dans The man who shot Liberty Valance (l’Homme qui tua Liberty Valance, John Ford, 1961), après avoir<br />
enten<strong>du</strong> le récit <strong>du</strong> sénateur Ransom Stoddard (James Stewart) qui reconnaît n’avoir pas tué lui-même Liberty<br />
Valance, fait d’armes auquel il doit sa carrière politique, le directeur <strong>du</strong> journal The Shinbone Star a cette phrase<br />
fameuse : « Quand les faits se sont transformés en légende, publiez la légende ».<br />
15