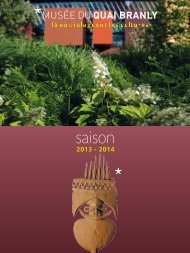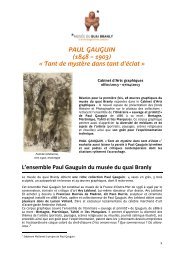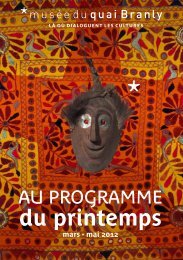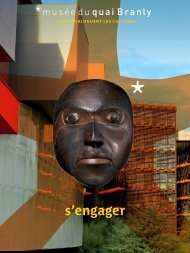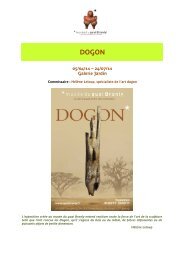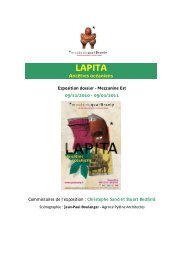télécharger le dossier de presse | (pdf - 2.3 M - musée du quai Branly
télécharger le dossier de presse | (pdf - 2.3 M - musée du quai Branly
télécharger le dossier de presse | (pdf - 2.3 M - musée du quai Branly
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
* MAYA<br />
DE L’AUBE AU CREPUSCULE<br />
Col<strong>le</strong>ctions nationa<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Guatemala<br />
Exposition temporaire – Mezzanine Est<br />
21/06/11 – 02/10/11<br />
Commissaire : Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo<br />
Conseil<strong>le</strong>r scientifique : Richard D. Hansen<br />
L’exposition MAYA, <strong>de</strong> l’aube au crépuscu<strong>le</strong>, Col<strong>le</strong>ctions nationa<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Guatemala est placée sous<br />
<strong>le</strong> haut patronage <strong>de</strong> Monsieur Nicolas Sarkozy, Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République, et <strong>de</strong> Monsieur<br />
Álvaro Colom Cabal<strong>le</strong>ros, Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République <strong>du</strong> Guatemala<br />
L’exposition a été réalisée en étroite collaboration avec <strong>le</strong> Ministère <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong>s sports<br />
au Guatemala et <strong>le</strong> Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Ethnología <strong>de</strong> Ciudad Guatemala.<br />
1
*SOMMAIRE<br />
*Editorial par Stéphane Martin ......................................................... p 3<br />
*Avant-propos par Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo ....................... p 4<br />
*Géographie <strong>du</strong> Guatemala ............................................................... p 5<br />
*Bref historique <strong>de</strong> l’archéologie au Guatemala .............................. p 8<br />
*Le temps chez <strong>le</strong>s Mayas .................................................................. p 9<br />
*Les guerres mayas .......................................................................... p 10<br />
*Le parcours <strong>de</strong> l’exposition ............................................................ p 12<br />
Section 1 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Préclassiques (2000 av. J.-C. – 250 apr. J.-C.) p 12<br />
Section 2 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Classiques (250 apr. J.-C. – 1000 apr. J.-C.) p 17<br />
Section 3 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Postclassiques (1000 apr. J.-C. – 1524 apr. J.-C.) p 21<br />
Section 4 : témoignages <strong>de</strong> la culture maya contemporaine p 22<br />
*Générique <strong>de</strong> l’exposition .............................................................. p 25<br />
*Autour <strong>de</strong> l’exposition .................................................................... p 26<br />
Catalogue <strong>de</strong> l’exposition p 26<br />
Mission Archéo p 26<br />
Visite contée p 26<br />
*Colloque international ................................................................... p 27<br />
La recherche et l’enseignement au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> p 27<br />
*Les col<strong>le</strong>ctions Amériques <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> ................... p 28<br />
La recherche et l’enseignement au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> p 28<br />
*Informations pratiques ................................................................... p 29<br />
*Mécène <strong>de</strong> l’exposition .................................................................. p 29<br />
*Partenaires <strong>de</strong> l’exposition ............................................................ p 30<br />
2
© Musée <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, photo Cyril Zannettacci<br />
* EDITORIAL PAR STEPHANE MARTIN<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong><br />
Après une exposition consacrée à la civilisation <strong>de</strong><br />
Teotihuacan, <strong>le</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, en étroite<br />
association avec <strong>le</strong> Museo Nacional <strong>de</strong><br />
Arqueología y Etnología <strong>du</strong> Guatemala, poursuit<br />
sa mission <strong>de</strong> mise en va<strong>le</strong>ur <strong>du</strong> patrimoine mésoaméricain.<br />
C’est aussi la première fois en France que <strong>de</strong>s<br />
œuvres guatémaltèques aussi prestigieuses sont<br />
rassemblées.<br />
Les Mayas représentent une <strong>de</strong>s cultures <strong>le</strong>s plus<br />
florissantes <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> précolombien. L’architecture<br />
en est l’un <strong>de</strong>s f<strong>le</strong>urons, comme en témoignent <strong>le</strong>s<br />
imposants vestiges <strong>de</strong> palais et <strong>de</strong> temp<strong>le</strong>s.<br />
Les Mayas sont éga<strong>le</strong>ment renommés pour avoir<br />
développé un remarquab<strong>le</strong> système d’écriture, <strong>le</strong><br />
plus comp<strong>le</strong>t <strong>de</strong> toute l’Amérique précolombienne,<br />
qui a fait dire au photographe et explorateur Désiré<br />
Charnay : « Les nombreuses inscriptions que renferment<br />
Pa<strong>le</strong>nque et <strong>le</strong>s temp<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la montagne atten<strong>de</strong>nt <strong>le</strong><br />
Champollion qui doit faire cesser <strong>le</strong> mutisme <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur<br />
tab<strong>le</strong> <strong>de</strong> pierre. »<br />
Grâce à <strong>de</strong>s fouil<strong>le</strong>s récentes, nous sommes en<br />
mesure d’apprécier <strong>le</strong> haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> civilisation <strong>du</strong><br />
peup<strong>le</strong> maya, loin <strong>de</strong>s préjugés <strong>de</strong>s premiers explorateurs européens, qui, confrontés à la beauté<br />
classique <strong>de</strong>s monuments, au raffinement <strong>de</strong> la statuaire et <strong>de</strong>s céramiques peintes,<br />
imaginèrent que <strong>le</strong>s Grecs ou <strong>le</strong>s Romains avaient visité ces nations et influencé <strong>le</strong>s autochtones.<br />
Cette exposition montre combien l’intelligence <strong>de</strong> l’univers a pu surgir dans <strong>de</strong>s temps reculés et<br />
pro<strong>du</strong>ire un art comp<strong>le</strong>xe qui rend compte <strong>de</strong> l’origine <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, d’une parfaite acceptation <strong>de</strong><br />
la mort, où l’idée <strong>de</strong> sacrifice <strong>de</strong>vient une forme d’exaltation <strong>du</strong> pouvoir séculier et divin.<br />
El<strong>le</strong> permet éga<strong>le</strong>ment, en concluant sur la culture maya contemporaine, d’établir un lien cohérent<br />
entre un passé foisonnant et une société riche encore aujourd’hui d’une vingtaine <strong>de</strong> langues,<br />
forte d’un héritage exceptionnel.<br />
La scénographie se veut une mise en mémoire <strong>de</strong>s fastes <strong>de</strong> petits royaumes indépendants,<br />
assimilab<strong>le</strong>s à <strong>de</strong>s cités-États extrêmement élaborées, qui tenaient <strong>le</strong>ur sp<strong>le</strong>n<strong>de</strong>ur d’un savoir<br />
impressionnant dans d’innombrab<strong>le</strong>s domaines : astronomique, cosmologique, mathématiques,<br />
création plastique…<br />
Je salue tout particulièrement <strong>le</strong> travail effectué par l’archéologue Richard D. Hansen qui, <strong>de</strong>puis<br />
2003, dirige <strong>le</strong> projet <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s <strong>du</strong> bassin <strong>de</strong> Mirador. Ce site figure d’ail<strong>le</strong>urs en tête d’un groupe<br />
<strong>de</strong> cinq autres sites sé<strong>le</strong>ctionnés par <strong>le</strong> gouvernement <strong>du</strong> Guatemala en vue d’une inscription sur la<br />
liste <strong>du</strong> patrimoine mondial <strong>de</strong> l’Unesco.<br />
Je tiens aussi à remercier cha<strong>le</strong>ureusement Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo, commissaire <strong>de</strong><br />
l’exposition et directeur <strong>du</strong> Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología <strong>du</strong> Guatemala, pour son<br />
excel<strong>le</strong>nte connaissance <strong>de</strong> la culture maya et sa précieuse collaboration, ainsi que Monsieur <strong>le</strong><br />
ministre <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong>s Sports <strong>du</strong> Guatemala, Héctor Escobedo, pour avoir consenti <strong>de</strong>s<br />
prêts exceptionnels en provenance <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions nationa<strong>le</strong>s.<br />
Stéphane Martin<br />
3
* AVANT-PROPOS PAR JUAN CARLOS MELENDEZ MOLLINEDO<br />
Commissaire <strong>de</strong> l’exposition<br />
« Civilisation antique », « pyrami<strong>de</strong>s », « écriture », « art », « effondrement » et, <strong>de</strong>puis peu « an<br />
2012 », voilà quelques-uns <strong>de</strong>s termes généra<strong>le</strong>ment associés à l’une <strong>de</strong>s cultures <strong>le</strong>s plus<br />
remarquab<strong>le</strong>s <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> antique, <strong>le</strong>s Mayas.<br />
Nombreux sont <strong>le</strong>s érudits à s’être intéressés au mo<strong>du</strong>s vivendi <strong>de</strong> la population préhispanique maya<br />
et chaque année apporte son lot <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s connaissances concernant sa comp<strong>le</strong>xité socia<strong>le</strong>, la<br />
précoce explosion artistique qui la caractérise, ou encore son incroyab<strong>le</strong> capacité à créer et à<br />
utiliser une écriture complètement origina<strong>le</strong>, pour ne par<strong>le</strong>r que <strong>de</strong> quelques aspects qui la<br />
distinguent <strong>de</strong> bien d’autres cultures.<br />
La civilisation maya a occupé <strong>le</strong>s actuels territoires <strong>du</strong> Belize, <strong>du</strong> Hon<strong>du</strong>ras, <strong>du</strong> Salvador, la partie sud<br />
<strong>du</strong> Mexique et ce qu’on appel<strong>le</strong> <strong>le</strong> « cœur <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> maya », <strong>le</strong> Guatemala. El<strong>le</strong> compte aujourd’hui<br />
environ 3 000 sites archéologiques officiels, preuve <strong>de</strong> l’immensité <strong>de</strong> cet héritage.<br />
Les quelques 25 projets <strong>de</strong> recherches archéologiques qui ont lieu chaque année au Guatemala<br />
mettent au jour <strong>de</strong> nouveaux éléments qui viennent enrichir <strong>le</strong> patrimoine culturel guatémaltèque.<br />
Ces fouil<strong>le</strong>s permettent généra<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> découvrir <strong>de</strong> remarquab<strong>le</strong>s vestiges qui, une fois analysés,<br />
aboutissent dans <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctions <strong>du</strong> Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología <strong>du</strong> Guatemala ; ce<br />
<strong>musée</strong> abrite <strong>le</strong> fonds <strong>le</strong> plus riche d’objets provenant <strong>de</strong> la culture maya et, plus important encore, on<br />
connaît, pour la plupart <strong>de</strong> ces trésors, <strong>le</strong>ur contexte archéologique, ce qui distingue ce fond <strong>de</strong><br />
nombreux autres.<br />
Sur la comp<strong>le</strong>xité socia<strong>le</strong>, politique et économique <strong>de</strong>s Mayas, <strong>le</strong>s thèmes <strong>de</strong> discussion possib<strong>le</strong>s sont<br />
multip<strong>le</strong>s. Dans cette exposition, nous nous sommes efforcés <strong>de</strong> traiter plusieurs aspects essentiels <strong>de</strong><br />
la culture maya et d’expliciter certains éléments <strong>de</strong> cette société qui continuent à passer pour<br />
énigmatiques aux yeux <strong>du</strong> grand public. Pour ce faire, nous avons pu compter sur la participation<br />
d’universitaires et <strong>de</strong> chercheurs <strong>de</strong> renom. Le ministère guatémaltèque <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong>s Sports a<br />
en outre <strong>de</strong>mandé au philosophe maya Jesús Salazar Tetzagüic d’intégrer l’équipe <strong>de</strong>s rédacteurs <strong>de</strong><br />
l’ouvrage, en <strong>le</strong> chargeant <strong>de</strong> livrer son point <strong>de</strong> vue sur la communauté maya actuel<strong>le</strong>. Le volume est<br />
ainsi riche d’une gran<strong>de</strong> diversité d’opinions sur cette culture ancestra<strong>le</strong>.<br />
Les pièces archéologiques présentées dans l’exposition appartiennent toutes à la République <strong>du</strong><br />
Guatemala. Sur <strong>le</strong>s 162 objets qui la composent, 3 sont exposés au Museo Carlos F. Novella, 10 font<br />
partie <strong>de</strong> la col<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> la Fundación La Ruta Maya et 149 sont déposés au Museo Nacional <strong>de</strong><br />
Arqueología y Etnología <strong>du</strong> Guatemala.<br />
Les choix qui ont été faits visent à présenter chronologiquement l’héritage préhispanique <strong>du</strong><br />
Guatemala (2000 av. J.-C. - 1524 apr. J.-C.) ; <strong>le</strong>s artefacts proviennent <strong>de</strong>s 3 régions qui composent <strong>le</strong><br />
pays : <strong>le</strong>s Basses Terres, <strong>le</strong>s Hautes Terres et la côte pacifique.<br />
Depuis <strong>le</strong>s années 1960, la France n’avait pas accueilli <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> col<strong>le</strong>ction d’objets<br />
guatémaltèques. Il était donc temps <strong>de</strong> montrer plusieurs <strong>de</strong>s découvertes réalisées au cours <strong>de</strong>s 25<br />
<strong>de</strong>rnières années et d’exposer <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s interprétations qui ont cours désormais sur <strong>le</strong><br />
développement sociopolitique et économique préhispanique <strong>de</strong> notre pays.<br />
Pour <strong>le</strong> ministère <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong>s Sports <strong>du</strong> Guatemala, c’est un honneur et une gran<strong>de</strong> fierté que<br />
<strong>de</strong> présenter un mo<strong>de</strong>ste échantillon <strong>du</strong> riche héritage culturel <strong>de</strong> notre nation. Nous invitons <strong>le</strong>s<br />
citoyens <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> entier à vivre l’expérience extraordinaire d’une vraie visite au « cœur <strong>du</strong> mon<strong>de</strong><br />
maya ».<br />
Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo<br />
Directeur <strong>du</strong> Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología <strong>de</strong> Guatemala<br />
4
* GEOGRAPHIE DU GUATEMALA<br />
Des milliers <strong>de</strong> sites mayas préhispaniques, toutes époques confon<strong>du</strong>es, ont été inventoriés. Sur cette carte figurent <strong>le</strong>s<br />
plus célèbres d’entre eux, ceux qui ont fait l’objet <strong>de</strong> travaux scientifiques et ceux qui sont mentionnés dans<br />
l’exposition. © Thierry Renard<br />
5
Le Guatemala est <strong>le</strong> cœur d’une région plus vaste où <strong>le</strong>s Mayas vivent <strong>de</strong>puis 5 millénaires. En effet,<br />
la civilisation maya s’est développée sur une aire <strong>de</strong> 324 000 km 2<br />
qui, selon <strong>le</strong>s frontières politiques<br />
actuel<strong>le</strong>s, couvre <strong>le</strong> Guatemala, <strong>le</strong> Belize, <strong>le</strong>s états mexicains <strong>du</strong> Yucatan, <strong>du</strong> Quintana Roo, <strong>du</strong><br />
Campeche, <strong>de</strong> Chiapas et <strong>du</strong> Tabasco, ainsi que <strong>le</strong>s parties occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Hon<strong>du</strong>ras et <strong>du</strong><br />
Salvador. Mais <strong>le</strong>s Mayas ne vivaient pas à l’intérieur <strong>de</strong> frontières ethniques ou politiques précises.<br />
Il est éga<strong>le</strong>ment fort probab<strong>le</strong> que d’autres populations non mayas occupèrent différentes zones <strong>de</strong><br />
la région. Ils ont donc cohabité et échangé avec d’autres groupes ethniques tout au long <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur<br />
histoire.<br />
Les anciens habitants <strong>du</strong> Guatemala vivaient dans <strong>de</strong>s environnements très variés : forêt tropica<strong>le</strong>,<br />
vallées ferti<strong>le</strong>s, rives <strong>de</strong> lacs, milieux côtiers, collines karstiques, forêts <strong>de</strong> nuages et vallées<br />
volcaniques couvertes <strong>de</strong> conifères. Accessib<strong>le</strong>s faci<strong>le</strong>ment en peu <strong>de</strong> temps par voie d’eau ou <strong>de</strong><br />
terre, tous ces environnements étaient étroitement liés.<br />
La région maya est généra<strong>le</strong>ment divisée en 3 zones : la côte Pacifique, <strong>le</strong>s Hautes Terres et <strong>le</strong>s<br />
Basses Terres. El<strong>le</strong>s se distinguent par <strong>de</strong>s différences d’altitu<strong>de</strong> notab<strong>le</strong>s, et <strong>de</strong>s variations en<br />
termes <strong>de</strong> géologies, d’approvisionnement en eau, <strong>de</strong> végétation et d’écosystème. El<strong>le</strong>s coïnci<strong>de</strong>nt<br />
éga<strong>le</strong>ment avec <strong>de</strong>s contrastes d’ordre culturel. Il existe cependant <strong>de</strong>s zones tampon, où <strong>le</strong>s<br />
caractéristiques culturel<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s Hautes et <strong>de</strong>s Basses Terres se combinent au sein d’une même<br />
population.<br />
La biodiversité <strong>de</strong> ces régions influa fortement sur l’évolution <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>ments humains, suscitant<br />
<strong>de</strong> multip<strong>le</strong>s formes d’adaptation selon <strong>le</strong>s différentes ressources anima<strong>le</strong>s, végéta<strong>le</strong>s et minéra<strong>le</strong>s.<br />
Ces <strong>de</strong>rnières ont éga<strong>le</strong>ment influé sur <strong>le</strong>ur vision <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>, <strong>le</strong>urs croyances, et <strong>le</strong>s formes<br />
institutionnel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs pratiques religieuses.<br />
Les anciennes cités mayas constituent <strong>de</strong> véritab<strong>le</strong>s paysages qui évoquent <strong>de</strong>s formations<br />
naturel<strong>le</strong>s, et qui s’inspirent <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong>s montagnes karstiques <strong>de</strong>s Hautes Terres <strong>du</strong> nord, qui<br />
regorgent <strong>de</strong> grottes et <strong>de</strong> rivières souterraines pouvant s’étendre sur <strong>de</strong>s kilomètres.<br />
Leur économie et <strong>le</strong>ur politique dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s ressources naturel<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> la configuration <strong>de</strong><br />
chaque région. Le commerce et l’échange <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its lointains étaient essentiels pour <strong>le</strong>s<br />
économies loca<strong>le</strong>s et régiona<strong>le</strong>s, imposant <strong>de</strong>s réseaux d’interaction sophistiqués qui accrurent la<br />
comp<strong>le</strong>xité politique et contribuèrent au développement <strong>de</strong> la civilisation maya.<br />
La côte Pacifique<br />
La côte Pacifique est définie comme une zone <strong>de</strong> basse terre sur <strong>le</strong> plan physique : son attitu<strong>de</strong> ne<br />
dépasse pas 300 mètres, et el<strong>le</strong> s’étend sur 700 km (dont seu<strong>le</strong>ment 250 km au Guatemala). Au<br />
nord, el<strong>le</strong> est bordée par une chaîne <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 40 volcans qui constitue la limite <strong>de</strong>s Hautes<br />
Terres.<br />
Cette côte possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s terrains très ferti<strong>le</strong>s, enrichis par <strong>le</strong>s cendres provenant <strong>de</strong>s éruptions<br />
volcaniques. Les cours d’eau <strong>le</strong>s plus importants ont servi jadis <strong>de</strong> frontières entre <strong>le</strong>s<br />
différentes entités politiques et ethniques. A l’époque <strong>de</strong>s Mayas préhispaniques, la côte<br />
Pacifique <strong>de</strong>vait être recouverte d’une forêt tropica<strong>le</strong> qui diffère peu <strong>de</strong>s jung<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s Basses Terres<br />
<strong>du</strong> nord, et <strong>le</strong>s mangroves ont joué un rô<strong>le</strong> important dans cet écosystème parmi <strong>le</strong>s plus riches <strong>du</strong><br />
pays.<br />
Cette région était propice à la culture <strong>du</strong> cacao, une <strong>de</strong>s ressources <strong>le</strong>s plus recherchées en<br />
Mésoamérique, car il servait <strong>de</strong> boisson aux nob<strong>le</strong>s ainsi que <strong>de</strong> monnaie d’échange. Certaines cités<br />
ont ainsi acquis une position privilégiée en contrôlant la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> cacao, <strong>du</strong> caoutchouc, et<br />
d’autres pro<strong>du</strong>its dépendants <strong>de</strong> l’humidité et la pluviométrie <strong>de</strong> la région.<br />
Les Hautes Terres<br />
Les 2 principa<strong>le</strong>s chaînes <strong>de</strong> montagnes, la Sierra <strong>de</strong> los Cuchumatanes et la Sierra Madre,<br />
culminent à 3800 mètres au-<strong>de</strong>ssus <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> la mer. El<strong>le</strong>s enserrent <strong>de</strong>s vallées ferti<strong>le</strong>s,<br />
idéa<strong>le</strong>s pour l’agriculture, <strong>le</strong>s reliefs faisant office <strong>de</strong> forteresses naturel<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> châteaux d’eau<br />
avec <strong>le</strong>urs lacs, lagunes, rivières et sources.<br />
6
Les Hautes Terres orienta<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s zones <strong>le</strong>s plus sèches <strong>du</strong> pays, avec <strong>de</strong>s forêts basses<br />
constituées d’arbustes épineux et <strong>de</strong> cactus.<br />
Les volcans, lacs et grottes étaient perçus par <strong>le</strong>s Mayas comme <strong>de</strong>s entités divines et <strong>de</strong>s portails<br />
vers <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> surnaturel, ce qui explique que l’architecture <strong>de</strong>s Hautes Terres ne fut jamais aussi<br />
monumenta<strong>le</strong> que cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Basses Terres. Les éléments naturels <strong>de</strong>s Hautes Terres étaient en effet<br />
utilisés comme lieux sacrés pour <strong>le</strong>s rituels.<br />
Une <strong>de</strong>s richesses <strong>de</strong>s Hautes Terres est liée aux gisements minéraux disséminés <strong>le</strong> long <strong>de</strong>s vallées,<br />
ravins, aff<strong>le</strong>urements volcaniques, etc. L’obsidienne, <strong>le</strong> ja<strong>de</strong>, la pyrite et <strong>le</strong> basalte figurent parmi <strong>le</strong>s<br />
principaux matériaux lithiques avec <strong>le</strong>squels toutes sortes d’objets ont pu être fabriqués. Les<br />
territoires abrupts <strong>de</strong>s Hautes Terres permirent l’édification <strong>de</strong> centres défensifs situés au<br />
sommet <strong>de</strong> montagnes encerclées <strong>de</strong> profonds ravins, véritab<strong>le</strong>s forteresses naturel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong>s<br />
conquistadors eux-mêmes ne parvinrent pas à faire cé<strong>de</strong>r.<br />
Les Basses Terres<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>du</strong> Jaguar Paw Temp<strong>le</strong>, El Mirador.<br />
Photo: Char<strong>le</strong>s David Bieber, © FARES 2005<br />
Les Basses Terres dont l’altitu<strong>de</strong> est<br />
inférieure à 300 mètres, couvrent<br />
un vaste territoire au nord <strong>de</strong>s<br />
Hautes Terres. El<strong>le</strong>s forment un<br />
vaste plateau calcaire remo<strong>de</strong>lé par<br />
l’eau et l’érosion. El<strong>le</strong>s sont<br />
subdivisées en 2 régions qui<br />
correspon<strong>de</strong>nt à <strong>de</strong>s variations<br />
naturel<strong>le</strong>s et culturel<strong>le</strong>s importantes,<br />
et sont recouvertes d’une forêt<br />
tropica<strong>le</strong> pouvant atteindre 40<br />
mètres <strong>de</strong> haut. La gran<strong>de</strong><br />
biodiversité végéta<strong>le</strong> et anima<strong>le</strong><br />
contraste avec la pauvreté <strong>de</strong>s sols<br />
pour l’agriculture.<br />
Cette région a connu la plus forte<br />
croissance démographique et la plus<br />
gran<strong>de</strong> diversité sociopolitique. Les<br />
cités comme El Mirador, Tikal ou<br />
encore Calakmul (au Mexique) parviennent à subvenir aux besoins <strong>de</strong> plusieurs dizaines <strong>de</strong> milliers<br />
<strong>de</strong> personnes, en alliant une exploitation efficace <strong>de</strong>s ressources disponib<strong>le</strong>s à <strong>de</strong>s systèmes<br />
d’agriculture intensive.<br />
La population est répartie entre centres et communautés satell<br />
ites <strong>de</strong> petite tail<strong>le</strong>, pour utiliser <strong>le</strong>s ressources naturel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> façon <strong>du</strong>rab<strong>le</strong>. Cependant, pour <strong>de</strong>s<br />
raisons encore non élucidées, cet équilibre se rompt à la fin <strong>du</strong> VII e<br />
sièc<strong>le</strong> et <strong>le</strong> système entier<br />
s’effondre. La région est alors abandonnée définitivement.<br />
Beaucoup <strong>de</strong> sites majeurs <strong>de</strong>s Basses Terres ne se situent pas à proximité d’une source d’eau.<br />
Des systèmes <strong>de</strong> captage et <strong>de</strong> stockage <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> pluies sont alors instaurés et <strong>de</strong> grands puits<br />
naturels donnent accès aux nappes phréatiques et rivières souterraines. Des centres sont éga<strong>le</strong>ment<br />
placés près <strong>de</strong>s rivières, <strong>de</strong> manière à contrô<strong>le</strong>r ce moyen <strong>de</strong> communication essentiel.<br />
L’économie est soutenue grâce au commerce maritime et l’exploitation <strong>du</strong> sel qui procurent à <strong>de</strong>s<br />
cités comme Chichen Itza une richesse et une puissance suffisantes pour dominer tout <strong>le</strong> nord <strong>de</strong> la<br />
péninsu<strong>le</strong> <strong>du</strong> Yucatán (Mexique) pendant la pério<strong>de</strong> postclassique.<br />
7
* BREF HISTORIQUE DE L’ARCHEOLOGIE AU GUATEMALA<br />
La civilisation maya compte aujourd’hui 3000 sites archéologiques officiels. Au Guatemala, l’archéologie a<br />
débuté par une tradition <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s sites et <strong>de</strong> spéculation sur l’origine <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs habitants. Jusque<br />
récemment, <strong>le</strong>s populations indigènes ont été peu impliquées dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs origines.<br />
1834 : Explorations <strong>de</strong>s ruines <strong>de</strong> Copan, Iximche et Utatlan, considérées comme <strong>de</strong>s capita<strong>le</strong>s majeures<br />
<strong>de</strong>s royaumes préhispaniques.<br />
Fin <strong>du</strong> XIX e<br />
sièc<strong>le</strong> : Alfred P. Maudslay photographie et décrit <strong>le</strong>s sculptures et édifices d’importants sites<br />
mayas, ce qui offre une base soli<strong>de</strong> à l’interprétation <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs inscriptions et <strong>le</strong>ur iconographie.<br />
Le ca<strong>le</strong>ndrier maya est déchiffré. Les chercheurs considèrent alors <strong>le</strong>s Mayas comme la plus aboutie <strong>de</strong>s<br />
cultures <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> Préhispanique.<br />
1893 : Les premières lois visant à protéger <strong>le</strong>s vestiges face à l’achat d’œuvres à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> l’Europe<br />
sont promulguées.<br />
Fin <strong>du</strong> XIX e , début XX e : Le Peabody Museum of Archaelogy and Ethnology, rattaché à l’université Harvard,<br />
est <strong>le</strong> premier à organiser <strong>de</strong>s explorations systématiques sur <strong>le</strong>s sites mayas.<br />
1910 : La United Fruit Company délimite un parc archéologique <strong>de</strong> 75 hectares autour <strong>du</strong> site <strong>de</strong> Quirigua,<br />
premier site à faire l’objet d’une véritab<strong>le</strong> recherche archéologique. Sylvanus G. Mor<strong>le</strong>y joue un rô<strong>le</strong><br />
essentiel dans <strong>le</strong>s premières fouil<strong>le</strong>s <strong>de</strong> ce site et est à la tête <strong>de</strong> la Carnegie Institution, principal acteur en<br />
archéologie maya jusque dans <strong>le</strong>s années 1950.<br />
Vers 1930 : Un projet <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s à Uaxactun marque une rupture avec <strong>le</strong>s métho<strong>de</strong>s antérieures, qui se<br />
concentraient sur <strong>le</strong> dégagement <strong>de</strong>s édifices principaux, la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s monuments sculptés et la<br />
col<strong>le</strong>cte d’objets remarquab<strong>le</strong>s. Des fouil<strong>le</strong>s stratigraphiques et l’analyse détaillée <strong>de</strong> céramiques<br />
permettent d’établir une chronologie soli<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’évolution culturel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Basses Terres mayas.<br />
1930 : La législation permet <strong>de</strong> mettre un terme à l’exportation léga<strong>le</strong> <strong>de</strong> pièces archéologiques vers <strong>le</strong>s<br />
<strong>musée</strong>s étrangers. Les pièces découvertes dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> projets nord-américains sont déposées au<br />
Musée National d’archéologie <strong>de</strong> la vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Guatemala.<br />
1946 : L’Instituto <strong>de</strong> Antropologia e Historia voit <strong>le</strong> jour, en résonance avec la politique nationaliste <strong>du</strong><br />
gouvernement démocratique suite au renversement <strong>de</strong> la dictature <strong>de</strong> Jorge Ubico. Pour la première fois,<br />
<strong>le</strong>s sites sont confiés à une institution guatémaltèque, qui procè<strong>de</strong> à <strong>de</strong>s publications importantes en<br />
collaboration avec <strong>le</strong>s archéologues nord-américains.<br />
1956 : Le <strong>musée</strong> d’Archéologie et d’Ethonologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Pennsylvanie finance un programme à<br />
Tikal qui per<strong>du</strong>re jusqu’en 1970. Des évolutions théoriques et méthodologiques en décou<strong>le</strong>nt. On se<br />
détache alors <strong>de</strong> la simp<strong>le</strong> histoire culturel<strong>le</strong> et <strong>de</strong> l’architecture monumenta<strong>le</strong> au profit <strong>de</strong><br />
questionnements sur <strong>le</strong>s structures <strong>de</strong> l’habitat, la subsistance et <strong>le</strong>s unités rési<strong>de</strong>ntiel<strong>le</strong>s ordinaires. Le<br />
gouvernement guatémaltèque investit éga<strong>le</strong>ment dans ce projet qui s’attache à restaurer quelques-uns <strong>de</strong>s<br />
plus grands monuments <strong>de</strong> la région maya. Tikal <strong>de</strong>vient alors une importante <strong>de</strong>stination touristique,<br />
faisant <strong>de</strong> l’archéologie un pan essentiel <strong>de</strong> l’économie nationa<strong>le</strong>.<br />
1970 : La formation d’archéologues commence au Guatemala. Depuis, la discipline a progressé<br />
régulièrement, mais <strong>le</strong>s projets <strong>de</strong> recherches sont toujours largement organisés et dirigés par <strong>de</strong>s<br />
archéologues nord-américains, ou par <strong>de</strong>s scientifiques d’autres pays (français en particulier). Ces <strong>de</strong>rniers<br />
sont particulièrement actifs <strong>de</strong>puis 1960, et ont obtenu <strong>de</strong>s résultats importants dans plusieurs régions <strong>du</strong><br />
pays.<br />
1996 : Des accords <strong>de</strong> paix sont signés pour mettre fin à une lutte sanglante longue <strong>de</strong> plusieurs décennies.<br />
La coopération internationa<strong>le</strong> et la recherche ref<strong>le</strong>urissent, et la reconnaissance <strong>de</strong>s liens historiques entre<br />
Mayas actuels et sites archéologiques est officialisée. Cette relation est teintée <strong>de</strong> connotation religieuse,<br />
car l’Etat doit assurer aux Mayas un accès à ces édifices pour la célébration <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs rituels. Des<br />
professionnels se reconnaissant d’origine maya commencent à participer aux recherches et à la gestion <strong>de</strong>s<br />
sites archéologiques.<br />
8
* LE TEMPS CHEZ LES MAYAS<br />
Le déchiffrement <strong>de</strong>s hiéroglyphes mayas commence à la fin <strong>du</strong> XIX e<br />
sièc<strong>le</strong>, avec l’élucidation <strong>du</strong><br />
système comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong>s ca<strong>le</strong>ndriers mayas. Dans <strong>le</strong>s années 50, la découverte <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s rois<br />
et <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s glyphes, fait évoluer la compréhension <strong>du</strong> temps maya et ses composantes.<br />
Leur conception <strong>du</strong> temps offre un cadre à <strong>le</strong>urs préoccupations mythiques et historiques, ces<br />
<strong>de</strong>rnières pouvant se révé<strong>le</strong>r très terre-à-terre. Les dimensions <strong>du</strong> temps maya constituent un<br />
ref<strong>le</strong>t saisissant <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur culture.<br />
Panneau avec glyphes<br />
La Corona, Petén<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
Les Mayas utilisent un cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> 52 ans, formé par la combinaison <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cyc<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>du</strong>rée inéga<strong>le</strong>,<br />
l’un <strong>de</strong> 260 jours, l’autre <strong>de</strong> 365, et que l’on appel<strong>le</strong> « Compte Court ».<br />
Le cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> 260 jours (tzolk’in) est un ca<strong>le</strong>ndrier divinatoire, utilisé par <strong>le</strong>s prêtres pour prédire<br />
l’avenir et planifier avec précision <strong>le</strong>s prières rituel<strong>le</strong>s. Il est constitué d’une série <strong>de</strong> 20 noms <strong>de</strong><br />
jours qui se succè<strong>de</strong>nt toujours dans <strong>le</strong> même ordre, auxquels on juxtapose <strong>le</strong>s nombres 1 à 13, si<br />
bien qu’une même combinaison <strong>de</strong> nom et <strong>de</strong> nombre se répète tous <strong>le</strong>s 260 jours (13 × 20 = 260).<br />
Ce cyc<strong>le</strong> est associé à un ca<strong>le</strong>ndrier solaire (haab’) représentant une année <strong>de</strong> 365 jours, qui<br />
comporte 18 « mois » <strong>de</strong> 20 jours et se termine par une pério<strong>de</strong> limina<strong>le</strong> <strong>de</strong> 5 jours ([18 × 20] + 5 =<br />
365).<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s Mayas associent à ces cyc<strong>le</strong>s courts une structure <strong>de</strong> décompte <strong>du</strong> temps bien<br />
plus élaborée, appelée « Compte Long ». Cel<strong>le</strong>-ci comporte 5 unités <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>. La plus petite est<br />
<strong>le</strong> jour (k’in) et la suivante, correspondant à 20 jours, s’appelait <strong>le</strong> winal. 18 winal font un tun, soit<br />
360 jours. 20 tun font un k’atun, et 20 k’atun donnent une longue pério<strong>de</strong> appelée bak’tun. La date<br />
<strong>de</strong> départ <strong>du</strong> Compte Long, dite « <strong>de</strong> la Création », correspond au 13 août 3113 av. J.-C.<br />
Par ces ca<strong>le</strong>ndriers, <strong>le</strong>s Mayas arrivent à prévoir certains phénomènes naturels, tels que <strong>le</strong>s<br />
éclipses <strong>de</strong> so<strong>le</strong>il et <strong>de</strong> lune ou <strong>le</strong>s saisons <strong>de</strong>s pluies, et à déterminer <strong>le</strong>s temps propices pour<br />
semer, chasser ou faire la guerre. Ils inscrivent éga<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s monuments <strong>le</strong>s événements<br />
importants et <strong>le</strong>ur date.<br />
9
* LES GUERRES MAYAS<br />
La guerre chez <strong>le</strong>s Mayas constitue un facteur commun <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur histoire et un élément c<strong>le</strong>f <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur<br />
développement et <strong>de</strong> la disparition <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur société.<br />
Les conflits mayas sont principa<strong>le</strong>ment <strong>du</strong>s aux contraintes <strong>de</strong> milieu, à la lutte pour l’autonomie<br />
<strong>de</strong>s différents centres et à la concurrence autour <strong>de</strong>s routes commercia<strong>le</strong>s. La guerre serait un<br />
facteur <strong>de</strong> dégradation <strong>de</strong> l’environnement, d’augmentation <strong>de</strong>s pressions socia<strong>le</strong>s, et en<br />
définitive, une cause <strong>de</strong> l’effondrement <strong>de</strong> la civilisation. Les guerres mayas prennent la forme<br />
d’une succession <strong>de</strong> conflits internes entre <strong>le</strong>s sites, ou entre <strong>de</strong>s entités d’un même groupe culturel<br />
ou ethnique, principa<strong>le</strong>ment menés par <strong>le</strong>s élites afin <strong>de</strong> maintenir un statu quo. Le plus souvent,<br />
ces conflits consistent en <strong>de</strong>s attaques furtives pour capturer ou éliminer <strong>le</strong>s chefs ennemis.<br />
Vers <strong>le</strong> Classique récent, l’importance <strong>de</strong>s affrontements implique la participation <strong>de</strong> sites alliés.<br />
Leur portée et <strong>le</strong> recours à <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> défense <strong>de</strong>s sites ont évolué au fil <strong>du</strong> temps, mais <strong>le</strong>s<br />
guerres mayas ont toujours été limitées par la logistique et la technologie. Les armes utilisées<br />
<strong>du</strong>rant <strong>le</strong>s combats étaient principa<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s lances, <strong>de</strong>s couteaux, haches, masses, lames<br />
d’obsidienne fixées sur <strong>de</strong>s bâtons en bois, <strong>de</strong>s propulseurs, <strong>de</strong>s flèches, <strong>de</strong>s boucliers, et <strong>de</strong>s<br />
armures en coton. Les Mayas ont éga<strong>le</strong>ment utilisé <strong>de</strong>s barrica<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s murs palissadés, <strong>de</strong>s<br />
murail<strong>le</strong>s, <strong>de</strong>s fossés et <strong>de</strong>s terre-p<strong>le</strong>ins, souvent combinés avec <strong>le</strong>s défenses naturel<strong>le</strong>s, comme <strong>le</strong>s<br />
plantes épineuses, <strong>le</strong>s ravins, <strong>le</strong>s î<strong>le</strong>s ou encore <strong>le</strong>s zones marécageuses.<br />
Le Préclassique<br />
Vers 600 av. J.-C., <strong>le</strong>s populations s’affirment <strong>de</strong> plus en plus comme bâtisseuses, et édifient <strong>le</strong>s<br />
premiers sites <strong>de</strong> Nakbé et El Mirador. Apparaissent en même temps <strong>le</strong>s premiers signes <strong>de</strong> vio<strong>le</strong>nce<br />
et <strong>de</strong> conflits, ainsi que <strong>le</strong>s rites d’achèvement <strong>de</strong>s édifices.<br />
Se développe à la pério<strong>de</strong> suivante une architecture <strong>de</strong> plus en plus comp<strong>le</strong>xe. Les bâtiments<br />
seraient en effet <strong>le</strong>s premières expressions <strong>du</strong> pouvoir politique et <strong>de</strong> la célébration publique <strong>de</strong><br />
rituels. Des murail<strong>le</strong>s entourent <strong>le</strong>s grands sites, et <strong>de</strong> vastes fossés sont construits autour <strong>de</strong>s centres<br />
cérémoniels en signe <strong>de</strong> défense. Ces fortifications illustrent aussi <strong>le</strong> rayon d’action et <strong>le</strong> pouvoir <strong>de</strong>s<br />
groupes en conflits, et sont vues comme <strong>de</strong>s éléments à la fois défensifs et offensifs. Les dimensions<br />
et la comp<strong>le</strong>xité <strong>de</strong>s ouvrages montrent autant la puissance <strong>de</strong> frappe et <strong>le</strong>s tactiques <strong>de</strong><br />
conquête que <strong>le</strong>s savoir-faire <strong>de</strong>s bâtisseurs.<br />
Vers 150 apr. J.-C., l’ordre maya est fortement mis à mal par <strong>le</strong> fort déboisement à <strong>de</strong>s fins<br />
constructives, la préparation d’énormes quantités <strong>de</strong> stuc pour parer <strong>le</strong>s édifices d’ornements<br />
monumentaux <strong>de</strong> messages idéologiques, la croissance démographique et la sédimentation <strong>de</strong>s zones<br />
marécageuses. Plusieurs sites sont alors abandonnés et <strong>le</strong> nombre <strong>de</strong> conflits augmente.<br />
Excentrique en si<strong>le</strong>x<br />
© Guatemala, Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología; Photo Ricky Lopez,<br />
http://rickylopezbruni.com<br />
10
Le Classique<br />
Plusieurs sites sont alors transférés dans <strong>de</strong>s zones plus é<strong>le</strong>vées et mieux protégées. Des acropo<strong>le</strong>s<br />
triadiques sont édifiées. Les premières dynasties, dont l’histoire est consignée sur <strong>le</strong>s stè<strong>le</strong>s ou sur <strong>le</strong>s<br />
murs <strong>de</strong>s monuments, se constituent. Les plus importantes cités ont un glyphe-emblème dont<br />
l’occurrence dans d’autres vil<strong>le</strong>s indique l’éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> son pouvoir. Les conflits commencent à être<br />
enregistrés sur <strong>le</strong>s monuments sculptés, avec <strong>de</strong>s symbo<strong>le</strong>s <strong>de</strong> guerre et <strong>de</strong> conquête. Les prisonniers<br />
et <strong>le</strong>s gouvernants victorieux intègrent <strong>le</strong>s sujets idéologiques.<br />
Vers 400 apr. J.-C., après la venue <strong>du</strong> Teotihuacan Siyaj K’ak, la cité <strong>de</strong> Tikal étend son pouvoir sur<br />
plusieurs sites. Cette tentative <strong>de</strong> prise <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong>s vastes régions agrico<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s bassins<br />
fluviaux, soumises au tribut, permet <strong>de</strong> contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s routes commercia<strong>le</strong>s. Tikal va alors<br />
jusqu’à participer à l’installation <strong>de</strong> la nouvel<strong>le</strong> dynastie <strong>de</strong> Copan au Hon<strong>du</strong>ras. Cela lui permet<br />
d’accé<strong>de</strong>r aux terres ferti<strong>le</strong>s pro<strong>du</strong>ctrices <strong>de</strong> cacao, ainsi qu’à une voie commercia<strong>le</strong> où transitent<br />
l’obsidienne et <strong>le</strong> ja<strong>de</strong>. Les liens ainsi tissés et <strong>le</strong>s conflits permettent à Tikal d’obtenir <strong>de</strong>s<br />
prisonniers et <strong>de</strong>s esclaves. La vil<strong>le</strong> construit alors un grand système <strong>de</strong> fossés, <strong>de</strong> terre-p<strong>le</strong>ins qui<br />
délimitent une surface d’environ 167 km 2 .<br />
Vers 600 apr. J.-C, <strong>le</strong>s conflits connaissent une recru<strong>de</strong>scence. Les alliances changent et <strong>le</strong>s mariages<br />
politiques <strong>de</strong>viennent une pratique courante.<br />
Des systèmes <strong>de</strong> barrica<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s murs doub<strong>le</strong>s avec <strong>de</strong>s impasses <strong>de</strong> la mort, sont mises en place.<br />
Dans <strong>le</strong>s scènes <strong>de</strong> victoires et <strong>de</strong> captures, <strong>le</strong> gouvernant est exalté dans son rô<strong>le</strong> <strong>de</strong> guerrier. Les<br />
dirigeants se préparent au combat, para<strong>de</strong>nt en vainqueurs, nouveaux maîtres d’images religieuses<br />
dérobées dans <strong>le</strong>s sites conquis.<br />
Les monuments <strong>de</strong>s vaincus sont détruits, <strong>le</strong>s visages <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs dirigeants martelés, certaines fresques<br />
sont emportées vers <strong>le</strong>s sites <strong>de</strong>s vainqueurs et <strong>le</strong>urs registres <strong>de</strong> victoires passées effacés.<br />
Vers 750 apr. J.-C., <strong>le</strong> sud <strong>du</strong> Péten est plongé dans <strong>de</strong> constants conflits, si bien que <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
migrations s’amorcent. Pendant <strong>le</strong> sièc<strong>le</strong> suivant, <strong>le</strong>s sites <strong>du</strong> Péten sont fina<strong>le</strong>ment abandonnés.<br />
Le Classique terminal et <strong>le</strong> Postclassique<br />
Cette pério<strong>de</strong> est <strong>le</strong> théâtre d’un nouveau<br />
changement dans <strong>le</strong>s pratiques militaires. Des<br />
défenses plus soli<strong>de</strong>s, qui combinent fossés et<br />
murail<strong>le</strong>s, sont mises en place. Une nouvel<strong>le</strong><br />
forme <strong>de</strong> guerre apparait avec la <strong>de</strong>struction<br />
tota<strong>le</strong> <strong>de</strong>s agglomérations. Des communautés<br />
entières sont alors rasées.<br />
Vers 1200 apr. J.-C., la guerre maya connait son<br />
ultime évolution. De nouveaux remparts d’une<br />
épaisseur remarquab<strong>le</strong> et pourvus <strong>de</strong> parapets<br />
sont érigés. Les zones contrôlées par chaque cité<br />
sont alors assez vastes. Cependant, <strong>de</strong> nouvel<strong>le</strong>s<br />
frictions apparaissent entre <strong>le</strong>s membres<br />
dirigeants entraînant l’effondrement final <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>ur société.<br />
Mosaïque <strong>de</strong> coquillages<br />
Classique récent © Guatemala, Museo Nacional <strong>de</strong><br />
Arqueología y Etnología, Photo Ricky Lopez,<br />
http://rickylopezbruni.com<br />
11
* LE PARCOURS DE L’EXPOSITION<br />
Considérée comme l’une <strong>de</strong>s plus éminentes cultures précolombiennes, la civilisation maya s’est<br />
développée en Amérique centra<strong>le</strong>. Les édifices monumentaux, l’essence artistique, l’évolution<br />
socia<strong>le</strong>, l’écriture en hiéroglyphe, <strong>le</strong>s systèmes <strong>de</strong> ca<strong>le</strong>ndriers et <strong>de</strong> numération sont autant <strong>de</strong><br />
découvertes uniques que cette civilisation a su apporter à l’histoire <strong>de</strong> l’humanité.<br />
Près d’un sièc<strong>le</strong> <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s archéologiques sur <strong>le</strong> sol guatémaltèque ont révélé <strong>le</strong>s richesses <strong>de</strong> cette<br />
civilisation, apportant ainsi sa pierre à l’édifice comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong> l’histoire préhispanique.<br />
L’exposition propose un parcours chronologique en 4 séquences. Les 3 premières correspon<strong>de</strong>nt aux<br />
3 principa<strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s définies par <strong>le</strong>s scientifiques qui ont marqué la civilisation maya <strong>du</strong><br />
Guatemala : <strong>le</strong> Préclassique, <strong>le</strong> Classique et <strong>le</strong> Postclassique. El<strong>le</strong> propose un parcours à travers <strong>de</strong><br />
magnifiques céramiques, monuments et bijoux élaborés <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s temps reculés jusqu’en 1524,<br />
année où débarquèrent <strong>le</strong>s premiers Conquistadores sur l’ancien règne K’iche, puissant bastion<br />
préhispanique <strong>de</strong> l’Altiplano <strong>de</strong> la république guatémaltèque actuel<strong>le</strong>.<br />
Au cours <strong>de</strong> son évolution, la culture maya guatémaltèque aurait suivi en partie un déplacement<br />
géographique au fur et à mesure <strong>de</strong> ces 3 pério<strong>de</strong>s : <strong>du</strong> littoral pacifique et <strong>de</strong>s Hautes Terres (ère<br />
Préclassique) vers <strong>le</strong>s Basses Terres <strong>du</strong> sud (ère Classique) puis vers <strong>le</strong>s Basses Terres <strong>du</strong> nord (ère<br />
Postclassique). Les récentes découvertes montrent toutefois que la région <strong>de</strong>s Basses Terres était<br />
éga<strong>le</strong>ment dynamique à l’époque Préclassique, puisque qu’on y trouve la plus importante<br />
concentration d’architecture maya, en particulier dans <strong>le</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador et dans <strong>de</strong>s sites tels<br />
que Cival et San Bartolo.<br />
Enfin, la <strong>de</strong>rnière section dresse un portrait <strong>de</strong> la culture maya contemporaine par une série <strong>de</strong><br />
photographies mettant en lumière <strong>le</strong> quotidien <strong>de</strong> l’ethnie maya actuel<strong>le</strong> <strong>du</strong> Guatemala, <strong>le</strong>s cou<strong>le</strong>urs<br />
vives <strong>de</strong>s vêtements, la magnificence <strong>de</strong>s coutumes et pratiques cérémonia<strong>le</strong>s, preuves d’un héritage<br />
culturel toujours vivant.<br />
Les pièces archéologiques présentées dans l’exposition appartiennent toutes à la République <strong>du</strong><br />
Guatemala. Les choix faits visent à présenter chronologiquement l’héritage préhispanique <strong>du</strong><br />
Guatemala, (2000 av. J.-C. – 1524 apr. J.-C.). Cette exposition permet éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> présenter <strong>le</strong>s<br />
découvertes réalisées ces 25 <strong>de</strong>rnières années, et d’exposer <strong>le</strong>s nouvel<strong>le</strong>s interprétations qui ont<br />
cours dans <strong>le</strong> développement sociopolitique et économique préhispanique <strong>du</strong> pays.<br />
Section 1 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Préclassiques (2000 av. J.-C. – 250 apr. J.-C.)<br />
Préclassique ancien (2000 av. J.-C. – 800 av. J.-C.) ; moyen (800 – 400 av. J.-C.) ; récent (400 av. J.-C. – 100<br />
apr. J.-C.) ; terminal (100 – 250 apr. J.-C.).<br />
Les premiers âges <strong>de</strong> la civilisation maya étaient précéramiques. Des pointes <strong>de</strong> flèches<br />
cannelées datant <strong>du</strong> Pléistocène (âge <strong>de</strong> glace) ont été retrouvées au Mexique, dans <strong>le</strong>s Hautes<br />
Terres <strong>du</strong> Guatemala et au Belize, <strong>de</strong> même que <strong>de</strong>s restes découpés <strong>de</strong> mammouths. Ceux-ci ont<br />
permis d’apporter la preuve d’une activité humaine dans <strong>le</strong>s Hautes Terres guatémaltèques et<br />
mexicaines. Des pol<strong>le</strong>ns <strong>de</strong> maïs et <strong>de</strong> manioc datant d’environ 3500 avant notre ère ont éga<strong>le</strong>ment<br />
été retrouvés dans l’actuel Belize, ainsi que <strong>de</strong>s pol<strong>le</strong>ns <strong>de</strong> maïs, à partir <strong>de</strong> 2600 av. J.-C., dans <strong>le</strong><br />
Bassin <strong>du</strong> Mirador au Guatemala.<br />
Pendant la pério<strong>de</strong> Préclassique, certains groupes sé<strong>de</strong>ntaires s’instal<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> long <strong>de</strong> la côte<br />
Pacifique <strong>du</strong> Chiapas et <strong>du</strong> Guatemala. Cette région offre à l’homme <strong>le</strong>s ressources naturel<strong>le</strong>s<br />
nécessaires à sa subsistance : poissons, tortues et mollusques col<strong>le</strong>ctés dans <strong>le</strong>s estuaires et mangroves<br />
typiques <strong>de</strong> la zone. La découverte <strong>de</strong> récipients et <strong>de</strong> meu<strong>le</strong>s témoigne <strong>de</strong> l’accroissement <strong>de</strong> la<br />
population et <strong>du</strong> développement <strong>de</strong> l’agriculture.<br />
C’est dans ces régions que <strong>le</strong>s premiers vestiges d’objets en céramique ont été<br />
retrouvés : tecomates (vases), bols, cruches, et plats. L’utilisation <strong>de</strong> céramiques monochromes<br />
<strong>de</strong> cou<strong>le</strong>urs noire, crème et rouge, ainsi que la variété <strong>de</strong>s formes et <strong>de</strong>s techniques décoratives<br />
(incision, chanfreinage,…) sont révélatrices d’une unité culturel<strong>le</strong> émergente et d’une activité<br />
politique, économique et socia<strong>le</strong> intense.<br />
12
Entre 1000 et 800 av. J.-C., <strong>le</strong>s premiers grands centres cérémoniels – principa<strong>le</strong>ment ceux <strong>de</strong><br />
la zone <strong>du</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador – sont construits <strong>de</strong> manière relativement indépendante. Vers<br />
500 av. J.-C, quelques centres <strong>de</strong> commémoration astronomique sont bâtis, constitués d'édifices <strong>de</strong>stinés<br />
à l'observatoire <strong>de</strong>s étoi<strong>le</strong>s, en particulier <strong>de</strong>s solstices, <strong>de</strong>s équinoxes et <strong>de</strong>s cyc<strong>le</strong>s <strong>du</strong> So<strong>le</strong>il et <strong>de</strong> Vénus.<br />
De récentes recherches prouvent qu’entre 400 av. J.-C. et 150 apr. J.-C., la civilisation maya connait<br />
un développement exceptionnel dans <strong>le</strong> domaine <strong>de</strong>s arts, <strong>de</strong> l’architecture, mais aussi dans<br />
son organisation socia<strong>le</strong> et politique. Les grands sites se multiplient, <strong>le</strong>s constructions<br />
architectura<strong>le</strong>s s’intensifient, témoignant d’un fort accroissement <strong>de</strong> la population et d’un<br />
pouvoir politique et économique considérab<strong>le</strong>.<br />
Les premiers signes d’écriture hiéroglyphique apparaissent éga<strong>le</strong>ment au cours <strong>de</strong> la première<br />
partie <strong>de</strong> la troisième pério<strong>de</strong> Préclassique (300 – 150 av. J.-C.). Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>de</strong>s battoirs à écorce,<br />
preuve <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> la fabrication d’une forme primitive <strong>de</strong> papier, ont été retrouvés dans <strong>de</strong>s<br />
sites datant déjà <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième pério<strong>de</strong> Préclassique.<br />
Urne avec effigie anthropomorphe, La Laguna, Quiché<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Préclassique récent (400 av. J.-C.-100 apr. J.-C.)<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
Vers 150 apr. J.-C., <strong>de</strong>s tensions apparaissent et poussent mystérieusement <strong>le</strong>s populations<br />
guatémaltèques à abandonner <strong>le</strong>s lieux. Malgré <strong>le</strong>s importantes avancées socia<strong>le</strong>s, politiques et<br />
économiques, <strong>le</strong> système social s’effondre à la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> Préclassique, comme <strong>le</strong> prouve<br />
l’abandon <strong>de</strong> plusieurs sites comme <strong>le</strong> site El Mirador. Cette crise reste passagère puisque, dès <strong>le</strong> début<br />
<strong>du</strong> Classique, se font sentir <strong>le</strong>s prémisses <strong>de</strong> l’apogée <strong>de</strong> cette civilisation.<br />
Les débuts <strong>de</strong> la comp<strong>le</strong>xité socia<strong>le</strong> sur la côte Pacifique et l’Altiplano<br />
C’est sur la côte Pacifique que l’on a i<strong>de</strong>ntifié <strong>le</strong>s plus anciens vestiges d’habitat sé<strong>de</strong>ntaire, qui<br />
remontent à 1700 av. J.-C. Les premiers sites occupés sont constitués par <strong>de</strong> simp<strong>le</strong>s plates-formes <strong>de</strong><br />
terre qui soutiennent <strong>de</strong>s constructions faites <strong>de</strong> matériaux périssab<strong>le</strong>s régulièrement rebâties. La<br />
population est hiérarchisée socia<strong>le</strong>ment, parfois pour <strong>de</strong> brèves pério<strong>de</strong>s, <strong>le</strong> temps <strong>de</strong> recueillir et<br />
d’utiliser <strong>de</strong>s ressources saisonnières loca<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong> se déplace alors vers un autre lieu une fois cel<strong>le</strong>s-ci<br />
exploitées, pour ensuite y revenir.<br />
13
L’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> la côte Pacifique ne connait pas une organisation socia<strong>le</strong> i<strong>de</strong>ntique. Des traces <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces, pouvant être cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> caciques, ou chefs, qui à cette époque contrô<strong>le</strong>nt un ou<br />
plusieurs établissements, ont été retrouvées. Certaines habitations, <strong>de</strong> forme ova<strong>le</strong>, semb<strong>le</strong>nt avoir<br />
servi à loger <strong>de</strong>s personnages importants. Par <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>de</strong> certains pro<strong>du</strong>its comme l’obsidienne,<br />
l’organisation <strong>de</strong> manifestations, gran<strong>de</strong>s célébrations ou fêtes où ils peuvent exhiber <strong>le</strong>ur pouvoir,<br />
ces indivi<strong>du</strong>s s’imposent à la population ordinaire, qui pourvoient alors à <strong>le</strong>urs besoins.<br />
Vers 900 av J.-C., on observe l’apparition d’établissements planifiés, la présence d’une<br />
architecture monumenta<strong>le</strong> et parfois <strong>de</strong> sculptures. D’importants remblais sont construits,<br />
supposant <strong>le</strong> déplacement d’importantes quantités <strong>de</strong> terre, et donc une organisation socia<strong>le</strong><br />
comp<strong>le</strong>xe, peut-être <strong>de</strong> type chefferie, seu<strong>le</strong> susceptib<strong>le</strong> d’avoir supervisé ces travaux. De petites<br />
entités politiques régiona<strong>le</strong>s, à rangs, constituent alors <strong>le</strong>s systèmes sociaux.<br />
L’Altiplano guatémaltèque et <strong>le</strong> Naranjo font l’objet <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s lorsque l’on découvre qu’il s’agit d’un<br />
centre régional majeur pour <strong>le</strong>s célébrations religieuses notamment, vers 800 - 400 av J.-C. Dans<br />
cette région, plus <strong>de</strong> 35 monuments sculptés, dont certains formaient quatre alignements ont été<br />
découverts. Ces sculptures ont dû être érigées et disposées à cet endroit pour commémorer <strong>de</strong>s<br />
évènements particuliers, peut-être <strong>de</strong>s débuts ou fins <strong>de</strong> cyc<strong>le</strong>s d’ordre solaire. L’absence <strong>de</strong><br />
sépultures, <strong>le</strong>s traces d’une occupation domestique éphémère et la présence <strong>de</strong> figurines en terre<br />
cuite représentant <strong>de</strong>s personnages aux traits physiques contrastés laissent à penser que cette<br />
région aurait pu être un lieu <strong>de</strong> rassemb<strong>le</strong>ment. Les populations auraient pu avoir parcouru <strong>de</strong><br />
longues distances, pour commémorer <strong>de</strong>s cyc<strong>le</strong>s temporels, <strong>de</strong> manière ponctuel<strong>le</strong>. Bien que<br />
l’occupation <strong>de</strong>s collines <strong>de</strong> Naranjo ait été brève, <strong>le</strong> site a dû dépendre d’un pouvoir fort,<br />
capab<strong>le</strong> <strong>de</strong> diriger une main d’œuvre suffisamment importante pour effectuer <strong>le</strong>s travaux<br />
nécessaires à l’érection <strong>de</strong> 4 rangées <strong>de</strong> monuments.<br />
Le Préclassique moyen<br />
Le développement <strong>de</strong> l’agriculture, permis par <strong>le</strong>s boues organiques ferti<strong>le</strong>s, est à l’origine <strong>de</strong> la<br />
nucléation <strong>de</strong>s sites et d’une croissance <strong>de</strong> la population <strong>de</strong>puis au moins 1000 av J.-C. Les Mayas<br />
cultivent <strong>du</strong> maïs, <strong>de</strong>s courges, <strong>de</strong>s ca<strong>le</strong>basses, <strong>de</strong>s palmiers, <strong>du</strong> coton et sans doute éga<strong>le</strong>ment <strong>du</strong><br />
cacao. Les ren<strong>de</strong>ments é<strong>le</strong>vés qui en décou<strong>le</strong>nt favorisent l’essor économique nécessaire à la<br />
constitution d’un habitat groupé, aux créations architectura<strong>le</strong>s et artistiques, à l’importation <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>nrées exotiques et à l’instauration d’une hiérarchie et d’une stratification socia<strong>le</strong>.<br />
L’aménagement urbain et la configuration rituel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’architecture sont d’une importance capita<strong>le</strong>.<br />
Les bâtiments aux murs <strong>de</strong> torchis et <strong>de</strong>s plates-formes constituent <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> propre à la pério<strong>de</strong><br />
préclassique. Vers 600 av J.-C., <strong>le</strong>s spécialistes <strong>de</strong> la tail<strong>le</strong> sculptent <strong>de</strong>s blocs pouvant peser <strong>de</strong> 300 à<br />
500 kilogrammes recouverts <strong>de</strong> fines couches d’en<strong>du</strong>its à la chaux. Plusieurs facteurs, comme<br />
l’importation et l’utilisation <strong>de</strong> colorants exotiques, la tail<strong>le</strong> <strong>de</strong>s édifices, suggèrent un contrô<strong>le</strong><br />
centralisé <strong>de</strong> ressources économiques importantes et <strong>de</strong> main d’œuvre.<br />
Des formes architectura<strong>le</strong>s particulières, comme <strong>de</strong>s escaliers aux marches larges, <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s<br />
peintes en rouge, <strong>de</strong>s crêtes faîtières, <strong>de</strong>s masques architecturaux, <strong>de</strong>s escaliers trip<strong>le</strong>s <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>s,<br />
<strong>de</strong>s structures en terrasses et <strong>de</strong>s soubassements pyramidaux atteignant jusqu’à 27 mètres <strong>de</strong> haut<br />
font <strong>le</strong>ur apparition lors <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>. Un art architectural formel est appliqué dans la<br />
décoration <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s en polychromie avec <strong>du</strong> rouge, <strong>du</strong> crème et <strong>du</strong> noir, témoignant d’une<br />
idéologie religieuse, qui se perpétue dans <strong>le</strong>s réalisations <strong>de</strong>s sièc<strong>le</strong>s postérieurs.<br />
Un édifice enfoui, qui présente une crête faîtière intacte et <strong>de</strong>s masques olmecoï<strong>de</strong>s à ses ang<strong>le</strong>s,<br />
révè<strong>le</strong> que l’idéologie est un facteur <strong>de</strong> cohésion socia<strong>le</strong>. Une solidarité organique s’organise ainsi<br />
autour d’une hiérarchie religieuse structurée et impliquée dans <strong>le</strong>s affaires à la fois rituel<strong>le</strong>s et<br />
séculières sous l’égi<strong>de</strong> d’une politique centralisée. D’épaisses couches <strong>de</strong> stuc recouvrent <strong>le</strong>s<br />
centres urbains et <strong>le</strong>s chaussées gèrent <strong>le</strong>s écou<strong>le</strong>ments <strong>de</strong>s eaux, tout en renvoyant peut-être à<br />
d’importantes associations d’ordre cosmologique.<br />
14
La Céramique<br />
L’apparition <strong>de</strong> la céramique se serait pro<strong>du</strong>ite dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> démonstrations <strong>de</strong> pouvoir. Lors <strong>de</strong><br />
cel<strong>le</strong>s-ci, <strong>de</strong>s boissons fermentées auraient été consommées dans <strong>de</strong>s récipients spéciaux imitant <strong>de</strong>s<br />
formes naturel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> ca<strong>le</strong>basses ou décorées. Réservées pour l’occasion, el<strong>le</strong>s auraient été élaborées<br />
avec grand soin, et auraient donc répon<strong>du</strong> dans un premier temps aux besoins d’un petit groupe<br />
élitaire.<br />
Les céramiques permettent <strong>de</strong> dater et d’établir <strong>de</strong>s liens entre <strong>le</strong>s groupes et <strong>le</strong>s différentes<br />
régions. Ainsi, la céramique <strong>de</strong> la phase Las Charcas, plus tardive, est largement représentée sur<br />
l’Altiplano, et suit <strong>le</strong>s mêmes canons et <strong>le</strong>s mêmes formes typiques que la première céramique <strong>de</strong> la<br />
côte Pacifique.<br />
Parmi <strong>le</strong>s objets <strong>le</strong>s plus semblab<strong>le</strong>s figurent <strong>de</strong>s vases globulaires dont <strong>le</strong> bord est orné d’une ban<strong>de</strong><br />
peinte en rouge sur la côte sud. L’Altiplano ajoute à la forme purement globulaire <strong>de</strong> la côte<br />
Pacifique <strong>de</strong>s petits cols pourvus <strong>de</strong> 2 anses qui auraient pu servir pour passer une cor<strong>de</strong> afin <strong>de</strong><br />
faciliter <strong>le</strong>ur transport. La décoration <strong>de</strong>s vases privilégie <strong>le</strong>s motifs poinçonnés, assez semblab<strong>le</strong>s à<br />
certaines décorations <strong>de</strong> la côte.<br />
A la fin <strong>du</strong> Préclassique moyen, vers 400 av J.-C., on trouve d’autres types d’objets, dont <strong>de</strong>s plats<br />
engobés en noir, avec <strong>de</strong>s décorations très semblab<strong>le</strong>s à cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la côte.<br />
Les liens tissés entre ces 2 régions sont visib<strong>le</strong>s par la céramique, mais aussi par l’érection <strong>de</strong><br />
monuments lisses, disposés selon <strong>de</strong>s schémas similaires.<br />
Il est certain que <strong>du</strong>rant <strong>le</strong> Préclassique, d’importantes relations socia<strong>le</strong>s ont été nouées entre<br />
l’Altiplano et la côte sud. Le besoin <strong>de</strong> se fournir en pro<strong>du</strong>its spécifique à certaines régions a dû<br />
favoriser ces interactions.<br />
Urne Anthropomorphe<br />
La Lagunita, Hautes Terres, Guatemala, céramique<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Préclassique récent (400 av. J.-C.-100 apr. J.-C.)<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
15
Le Bassin <strong>du</strong> Mirador<br />
Le Bassin <strong>du</strong> Mirador abrite une quantité é<strong>le</strong>vée <strong>de</strong> Bajos inondés <strong>de</strong> façon saisonnière et<br />
<strong>de</strong>s zones marécageuses temporaires envahies à présent d’espèces épineuses <strong>de</strong> hauteur<br />
ré<strong>du</strong>ite. La faune et la flore y sont abondantes, <strong>de</strong>s espèces inconnues d’insectes y ont même<br />
été découvertes. Cet endroit a éga<strong>le</strong>ment dû être une <strong>de</strong>stination importante pour <strong>le</strong>s<br />
oiseaux migrateurs. Les flancs occi<strong>de</strong>ntal et méridional <strong>du</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador sont marqués<br />
par un escarpement naturel défensif <strong>de</strong> 20 à 30 mètres <strong>de</strong> haut.<br />
Des transformations majeures ont eu lieu en pays maya au cours <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s Préclassiques<br />
moyenne et tardive, en particulier dans la région dite <strong>du</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador, une zone <strong>de</strong><br />
7400 km 2 <strong>de</strong> forêt tropica<strong>le</strong>. Le nombre et la tail<strong>le</strong> <strong>de</strong>s sites archéologiques qui s’y trouvent<br />
lui confèrent un caractère unique et témoignent <strong>du</strong> développement d’une société étatique<br />
précoce, sans éga<strong>le</strong> dans l’histoire maya. Cet Etat, appelé aussi « Royaume <strong>de</strong> Kan », pose<br />
<strong>le</strong>s bases <strong>de</strong> la comp<strong>le</strong>xité socia<strong>le</strong>, politique et économique qui prévalut dans <strong>le</strong>s Basses<br />
Terres mayas.<br />
Vers 300 av J.-C., El Mirador surpasse en tail<strong>le</strong> et en importance <strong>le</strong>s centres voisins et<br />
présente une architecture monumenta<strong>le</strong> sans précé<strong>de</strong>nt. Certaines structures peuvent<br />
atteindre jusqu’à 72 mètres <strong>de</strong> haut. Le sty<strong>le</strong> triadique apparaît, avec <strong>de</strong> grosses platesformes<br />
surmontées <strong>de</strong> 3 superstructures. La sculpture architectura<strong>le</strong> <strong>de</strong>vient l’expression<br />
dominante <strong>de</strong> l’autorité et <strong>du</strong> pouvoir, en combinant portraits <strong>de</strong> divinités et panneaux en<br />
stuc représentant <strong>de</strong>s personnages <strong>de</strong> profils. La pyrami<strong>de</strong> El Tigre qui domine <strong>le</strong> site d’El<br />
Mirador, culmine à 55 mètres.<br />
Cependant, <strong>le</strong> développement rapi<strong>de</strong> et précoce <strong>de</strong> cette cité aurait eu une issue fata<strong>le</strong>,<br />
comme en atteste l’abandon presque total <strong>de</strong>s sites qui se pro<strong>du</strong>it vers 150 av J.-C. Les<br />
structures rési<strong>de</strong>ntiel<strong>le</strong>s sont délaissées, <strong>le</strong>s objets lithiques et <strong>le</strong>s vases sont<br />
abandonnés sur <strong>le</strong>s sols et dans <strong>le</strong>s pièces.<br />
Le site reste abandonné pendant quelques 600 ans, puis a lieu une mo<strong>de</strong>ste réoccupation.<br />
Les habitants fabriquent alors <strong>de</strong>s céramiques <strong>de</strong> sty<strong>le</strong> co<strong>de</strong>x, qui <strong>le</strong>ur est spécifique.<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> la pyrami<strong>de</strong> Danta<br />
El Mirador © Frédéric Pillier - DR<br />
16
Section 2 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Classique (250 apr. J.-C. – 1000 apr. J.-C.)<br />
Classique ancien (250 – 550 apr. J.-C.) ; récent (550 – 800 apr. J.-C.) ; terminal (800 – 1000 apr. J.-C.)<br />
Durant cette pério<strong>de</strong>, <strong>le</strong>s Mayas connaissent <strong>le</strong>ur plus brillant développement artistique, social et<br />
politique. Leur système d’écriture hiéroglyphique, qui revêt une signification particulière au sein<br />
<strong>de</strong> <strong>le</strong>ur culture, atteint un sta<strong>de</strong> avancé d’exécution et <strong>de</strong> représentation.<br />
Des contacts se nouent avec la puissante civilisation <strong>de</strong> Teotihuacan, localisée dans l’actuel<br />
Mexique central. Les échanges aux niveaux artistique, commercial et politique entre <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
sociétés sont nombreux avant la chute <strong>de</strong> Teotihuacan (environ 600 ans apr. J.-C.) qui entraîne, <strong>de</strong><br />
fait, la dissipation <strong>de</strong>s relations entre <strong>le</strong>s Mayas <strong>du</strong> Guatemala et ceux <strong>de</strong>s Hautes Terres <strong>du</strong><br />
Mexique.<br />
Deux centres situés dans <strong>le</strong>s Basses Terres mayas sont particulièrement influents pendant cette<br />
pério<strong>de</strong> : Tikal et Calakmul. Ces <strong>de</strong>ux cités riva<strong>le</strong>s acquièrent une gran<strong>de</strong> importance<br />
sociopolitique dans la région. La culture maya se développe alors autour <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux puissances,<br />
qui entrent en guerre à plusieurs reprises pour étendre <strong>le</strong>ur pouvoir.<br />
Dans <strong>le</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador, outre Calakmul et Naachtun, quelques mo<strong>de</strong>stes foyers <strong>de</strong> population<br />
réapparaissent, après un abandon <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 600 ans. Une pro<strong>du</strong>ction artisana<strong>le</strong> sans éga<strong>le</strong> est<br />
développée par <strong>le</strong>s habitants vivant alors parmi <strong>le</strong>s ruines <strong>de</strong>s grands centres Préclassiques. Scribes,<br />
savants et artisans créent un sty<strong>le</strong> céramique <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> qualité connu sous <strong>le</strong> nom <strong>de</strong> sty<strong>le</strong><br />
« co<strong>de</strong>x », peintures constituées <strong>de</strong> lignes noires et rouges sur fond <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>ur crème qui<br />
montre avec une gran<strong>de</strong> finesse <strong>de</strong>s images à caractère mythologique et cosmologique. Dans<br />
d’autres cités – par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> site La Corona, <strong>de</strong> tail<strong>le</strong> plus mo<strong>de</strong>ste, qui entretenait <strong>de</strong>s liens<br />
privilégiés avec celui <strong>de</strong> Calakmul – <strong>le</strong>s archéologues ont mis à jour <strong>de</strong> magnifiques panneaux<br />
gravés décrivant d’importants événements historiques et <strong>de</strong>s exemp<strong>le</strong>s d’écriture hiéroglyphique<br />
maya <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> Classique parmi <strong>le</strong>s plus remarquab<strong>le</strong>s.<br />
Après ce brillant développement qui marque l’apogée <strong>de</strong> la civilisation maya, <strong>le</strong>s grands centres<br />
sont progressivement abandonnés vers 900 apr. J.-C. et <strong>le</strong>s constructions <strong>de</strong> monuments arrêtées.<br />
Plusieurs hypothèses sont avancées - guerres, désastres écologiques, inondations ou encore<br />
famines - qui cependant ne font pas encore l’unanimité parmi <strong>le</strong>s spécialistes.<br />
Des vases présentant <strong>de</strong>s éléments iconographiques et <strong>de</strong>s exemp<strong>le</strong>s d’écriture hiéroglyphique,<br />
<strong>de</strong>s objets <strong>de</strong> pierre, <strong>de</strong> coquillage ou d’os, ainsi que <strong>du</strong> mobilier funéraire sont exposés,<br />
mettant en lumière <strong>le</strong>s différents aspects <strong>de</strong> la culture maya <strong>de</strong> l’ère Classique.<br />
Les vases Mayas<br />
Vase subcylindrique polychrome <strong>de</strong> type Co<strong>de</strong>x<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
Les céramiques <strong>de</strong> « sty<strong>le</strong> Co<strong>de</strong>x », avec <strong>le</strong>urs <strong>de</strong>ssins aux<br />
traits fins et noirs, appliqués sur fond crème et<br />
encadrés par <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s horizonta<strong>le</strong>s rouges sur <strong>le</strong><br />
bord supérieur et la base <strong>de</strong>s vases, ne sont pas sans<br />
évoquer <strong>le</strong>s manuscrits mayas plus récents ou co<strong>de</strong>x pliés<br />
en accordéons.<br />
Les vases mayas <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> Classique récente sont<br />
souvent <strong>de</strong>s cylindres droits. Les scènes représentées sur<br />
<strong>le</strong>s vases fournissent parfois <strong>de</strong>s informations que l’on<br />
trouve généra<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s monuments sculptés,<br />
notamment <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s détaillés <strong>de</strong>s mythes <strong>de</strong> la<br />
création. Les sculptures <strong>de</strong> cette époque, stè<strong>le</strong>s, panneaux<br />
et autels, représentent <strong>le</strong>s seuls rois mayas <strong>de</strong> manière<br />
statique ou impassib<strong>le</strong>s lors d’épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> conquêtes<br />
héroïques, d’actes douloureux d’autosacrifice, ou comme<br />
incarnation d’un dieu. Ainsi, <strong>le</strong>s thèmes locaux<br />
spécifiques sont privilégiés, qu’il s’agisse <strong>de</strong> dieux<br />
tutélaires, ou d’évènements et traditions comme<br />
l’évocation <strong>de</strong> liens historiques avec Teotihuacan. Plus<br />
17
souvent, <strong>le</strong>s scènes <strong>de</strong>s vases traitent <strong>de</strong> sujets liés à la religion ou à la mythologie qui <strong>le</strong>ur sont<br />
particuliers.<br />
Des peintures mura<strong>le</strong>s, datées <strong>du</strong> I er sièc<strong>le</strong> avant notre ère, comportent éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s scènes<br />
mythologiques (naissance sanglante <strong>de</strong> 5 enfants dans une gour<strong>de</strong>, résurrection <strong>du</strong> dieu maïs,<br />
offran<strong>de</strong>s sacrificiel<strong>le</strong>s, etc.).<br />
On note sur <strong>le</strong>s vases <strong>du</strong> Classique l’omniprésence <strong>du</strong> symbolisme <strong>de</strong> la mort, avec <strong>le</strong>s<br />
représentations <strong>du</strong> dieu <strong>de</strong> la mort, <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong> sque<strong>le</strong>tte et d ’ « yeux morts ». Ces vases, qui<br />
servent aussi lors <strong>de</strong>s fêtes à boire <strong>le</strong> cacao, ont été trouvés dans <strong>de</strong>s tombes et <strong>de</strong>vaient être <strong>de</strong>s<br />
objets mortuaires.<br />
Parmi <strong>le</strong>s thèmes courants, <strong>le</strong> voyage dans l’inframon<strong>de</strong> <strong>du</strong> dieu maïs, accompagnés <strong>de</strong> héros<br />
jumeaux, est souvent abordé. De plus, beaucoup <strong>de</strong>s défunts et <strong>de</strong>s êtres démoniaques qui<br />
figurent sur <strong>le</strong>s vases sont <strong>de</strong>s esprits way, versant sauvage et incontrôlab<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’âme humaine<br />
souvent i<strong>de</strong>ntifié à la forêt et la nuit.<br />
Ces vases, en plus d’être <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s aux morts,.<br />
Les divinités<br />
L’une <strong>de</strong>s principa<strong>le</strong>s divinités <strong>de</strong> la mort est un être sque<strong>le</strong>ttique, malsain, qui<br />
renvoie aux préoccupations <strong>de</strong>s Mésoaméricains concernant l’excès <strong>de</strong> boisson et<br />
ses conséquences. Il est appelé Kimi ou encore Akan. Il apparait aussi bien dans <strong>le</strong>s<br />
co<strong>de</strong>x <strong>du</strong> Postclassique récent que dans l’art Classique. Il porte un signe « <strong>de</strong> division »,<br />
sur la joue, et un long os horizontal dans sa coiffure, terminé par un œil mort.<br />
Les Mayas ont longtemps été associés à la mort, par <strong>le</strong>s médias comme par <strong>le</strong>s<br />
chercheurs. Mais ils sont éga<strong>le</strong>ment fascinés par <strong>le</strong>s forces vita<strong>le</strong>s et la beauté. Ainsi,<br />
<strong>le</strong> dieu <strong>du</strong> vent est représenté comme un être jeune et beau. Le dieu maïs éga<strong>le</strong>ment,<br />
avec son profil et sa tête allongée qui évoquent <strong>le</strong>s canons <strong>de</strong> la beauté roya<strong>le</strong> à<br />
l’époque Classique. Cultivé et raffiné, il apparait couramment dans <strong>le</strong>s scènes<br />
classiques sous <strong>le</strong>s traits d’un scribe ou d’un danseur richement vêtu et serait d’ail<strong>le</strong>urs<br />
<strong>le</strong> principal dieu <strong>de</strong> la danse. Dans certaines scènes, il se transforme en oiseau. Lorsque<br />
<strong>le</strong> dieu danse, il est souvent représenté <strong>le</strong>s jambes rejetées au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la tête, ce qui<br />
n’est pas sans rappe<strong>le</strong>r l’Arbre cosmique, crocodi<strong>le</strong> dont <strong>le</strong> tronc et <strong>le</strong>s pattes inférieures<br />
se transforment en arbre. Dans un exemp<strong>le</strong> <strong>du</strong> Classique ancien, <strong>le</strong> dieu maïs prend la<br />
forme d’un cacaoyer, ses doigts tor<strong>du</strong>s s’enfonçant dans la terre tels <strong>de</strong>s racines.<br />
Derrière l’arbre <strong>du</strong> dieu maïs figure la Montagne f<strong>le</strong>urie, qui évoque <strong>le</strong> royaume cé<strong>le</strong>ste<br />
<strong>de</strong>s ancêtres, <strong>de</strong> même qu’un royaume radieux peuplé d’oiseaux rares. Les ancêtres<br />
royaux préféraient nettement ce paradis à l’enfer maya <strong>de</strong> Xibalba.<br />
L’être suprême <strong>de</strong> ce royaume est <strong>le</strong> dieu so<strong>le</strong>il, un guerrier qui brandit généra<strong>le</strong>ment<br />
un bouclier et une lance. Il est parfois figuré avec un aig<strong>le</strong> ou un jaguar comme attribut.<br />
A bien <strong>de</strong>s égards, il ressemb<strong>le</strong> à son homologue aztèque Tonatiuh, dieu solaire et <strong>de</strong> la<br />
guerre assoiffé <strong>de</strong> sang qui dans un mon<strong>de</strong> naturel peut s’incarner en aig<strong>le</strong> royal. De<br />
plus, l’art maya classique comporte <strong>de</strong> nombreuses scènes <strong>de</strong> coupes sacrificiel<strong>le</strong>s<br />
avec <strong>de</strong>s signes en référence au sang nourrissant <strong>le</strong> so<strong>le</strong>il. Cette convention <strong>de</strong><br />
l’animal buveur <strong>de</strong> sang est répan<strong>du</strong>e dans l’iconographie Classique, avec une<br />
représentation nocturne <strong>de</strong> la divinité <strong>du</strong> so<strong>le</strong>il, souvent nommé dieu Pax.<br />
Selon toute probabilité, <strong>le</strong>s édifices ornés <strong>de</strong> ce motif dévoreur <strong>de</strong> sang sont <strong>de</strong>s lieux<br />
<strong>de</strong> sacrifices.<br />
18
Etrangers, effondrement et conquête<br />
Vers la fin <strong>du</strong> VIII e sièc<strong>le</strong> et au IX e sièc<strong>le</strong>, l’art <strong>de</strong> cour atteint son apogée, puis cesse brusquement<br />
dans certains royaumes, ou se transforme radica<strong>le</strong>ment dans ses motifs et ses compositions. Les<br />
nouvel<strong>le</strong>s recherches et découvertes viennent contrebalancer <strong>le</strong>s hypothèses qui veu<strong>le</strong>nt que <strong>de</strong>s<br />
étrangers venant <strong>du</strong> nord-ouest aient envahi <strong>le</strong> Petén, ou bien aient précipité <strong>le</strong> chaos et<br />
l’effondrement <strong>de</strong> la région. El<strong>le</strong>s donnent en effet à penser que <strong>le</strong>s Mayas <strong>de</strong>s confins nord-ouest<br />
ont entretenu <strong>de</strong>s relations commercia<strong>le</strong>s privilégiées avec <strong>de</strong>s royaumes <strong>du</strong> sud-ouest au cours<br />
<strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> VII e<br />
sièc<strong>le</strong>. Il semb<strong>le</strong> toutefois plus vraisemblab<strong>le</strong> que <strong>de</strong>s ambassa<strong>de</strong>urs, conseil<strong>le</strong>rs<br />
militaires, marchands et artistes étrangers, dont <strong>le</strong>s intérêts sont d’ordre économique plus que<br />
politique, rési<strong>de</strong>nt dans <strong>le</strong>s cours roya<strong>le</strong>s au moment où <strong>le</strong> chaos menace, et que <strong>le</strong>ur influence<br />
s’accroit à mesure que <strong>le</strong>s structures politiques loca<strong>le</strong>s déclinent.<br />
Leur objectif premier est d’assurer <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s routes commercia<strong>le</strong>s afin <strong>de</strong> continuer<br />
l’approvisionnement <strong>de</strong>s marchés extérieurs en jadéite, cacao, plumes et cotons…<br />
Les conséquences <strong>de</strong>s bou<strong>le</strong>versements qui surviennent au Petén sont un déclin démographique,<br />
l’abandon <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s cités roya<strong>le</strong>s et la disparition <strong>de</strong> la royauté divine en tant<br />
que principa<strong>le</strong> institution politique.<br />
Durant l’époque Postclassique, la société <strong>du</strong> Petén se redresse progressivement, si bien que <strong>le</strong><br />
<strong>de</strong>rnier royaume maya à être conquis est celui <strong>de</strong>s Itza en 1697. Les traditions esthétiques mê<strong>le</strong>nt<br />
alors cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s précolombiens et cel<strong>le</strong>s religieuse et culturel<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs conquérants.<br />
L’effondrement <strong>de</strong> la civilisation maya classique<br />
reste un mystère pour <strong>le</strong>s archéologues. Toutes<br />
sortes d’explications ont été avancées : épidémies,<br />
tremb<strong>le</strong>ments <strong>de</strong> terre, sécheresses,<br />
surpopulation, invasions, guerres, déclin moral, et<br />
même une intervention extraterrestre !<br />
Une crise majeure et <strong>de</strong>s changements<br />
politiques radicaux entre 750 et 1050 apr. J.-C.<br />
touchent <strong>le</strong>s Basses Terres. De nombreuses cités<br />
mayas sont abandonnées l’une après l’autre. Les<br />
Etats sont peu éten<strong>du</strong>s, en compétition, et la<br />
plupart <strong>de</strong>s pouvoirs religieux, militaires et<br />
politiques sont détenus par <strong>de</strong>s seigneurs divins,<br />
k’uhul ajaws. Ils s’appuient sur une idéologie qui<br />
se manifeste par <strong>de</strong> spectaculaires cérémonies<br />
organisées dans <strong>le</strong> cadre d’une architecture<br />
imposante, avec <strong>de</strong>s cultes funéraires grandioses,<br />
<strong>de</strong>s monuments sculptés rehaussés d’inscriptions,<br />
et <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> clientè<strong>le</strong> entre chefs et nob<strong>le</strong>s<br />
vassaux, qui passent par <strong>de</strong>s biens exotiques à<br />
caractère sacré. Les pouvoirs religieux et politique<br />
sont indissociab<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>s cérémonies<br />
ritualisées sont essentiel<strong>le</strong>s pour maintenir la<br />
cohésion <strong>de</strong>s Etats.<br />
L’effondrement n’est pas soudain, comme<br />
beaucoup l’ont pensé ; <strong>le</strong>s changements s’éta<strong>le</strong>nt<br />
Vase stuqué et peint, Classique récent<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
sur près <strong>de</strong> 3 sièc<strong>le</strong>s. De plus, la cause fina<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’effondrement maya diffère d’une région à l’autre,<br />
même si <strong>de</strong>s facteurs communs se retrouvent. Vers 1050 – 1100 apr. J.-C., la plupart <strong>de</strong>s cités <strong>de</strong>s<br />
Basses Terres sont abandonnées, et d’autres évoluent vers la culture maya postclassique, très<br />
différente.<br />
Les épidémies, <strong>le</strong>s séismes, <strong>le</strong>s cyclones, <strong>le</strong>s révoltes paysannes, <strong>de</strong> même que <strong>le</strong>s invasions<br />
étrangères sont exclues aujourd’hui. La vallée <strong>du</strong> Pasion s’effondre à cause <strong>de</strong> la guerre, <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s voies commercia<strong>le</strong>s, et <strong>de</strong> l’émigration <strong>de</strong> la population, scénario qui se repro<strong>du</strong>it<br />
dans d’autres parties <strong>du</strong> Guatemala. A cela s’ajoute la rivalité croissante entre un nombre<br />
toujours plus é<strong>le</strong>vé <strong>de</strong> rois et <strong>de</strong> nob<strong>le</strong>s, dû à la polygamie pratiquée par l’élite. La classe<br />
dirigeante a <strong>de</strong>s besoins coûteux qui accroissent la pression sur <strong>le</strong>s routes commercia<strong>le</strong>s, par<br />
19
<strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s transitent <strong>le</strong> ja<strong>de</strong>, <strong>le</strong>s coquillages, la pyrite, <strong>le</strong>s plumes et <strong>le</strong>s autres biens sacrés<br />
nécessaires aux élites et aux rituels royaux. Dans cette situation <strong>de</strong> concurrence accrue et <strong>de</strong><br />
guerre, seuls quelques sites survivent. L’essentiel <strong>de</strong> la population rura<strong>le</strong>, pour sa part, s’enfuit<br />
vers d’autres régions.<br />
Ces mouvements <strong>de</strong> population ont <strong>de</strong>s répercussions sur d’autres zones. Ainsi, el<strong>le</strong>s peuvent<br />
constituer une main d’œuvre supplémentaire dans d’autres Etats pour favoriser <strong>le</strong>ur essor, mais <strong>le</strong>s<br />
effets positifs sont <strong>de</strong> courte <strong>du</strong>rée. La surpopulation et la détérioration qui suivent sont éga<strong>le</strong>ment<br />
<strong>de</strong>s causes <strong>de</strong> déclin.<br />
L’avènement <strong>du</strong> commerce maritime et la disparition <strong>de</strong>s routes concurrentes ai<strong>de</strong>nt au<br />
développement d’autres cités, qui connaissent <strong>le</strong>ur apogée vers 750 à 1050.<br />
On assiste toutefois à une surenchère <strong>du</strong> prestige royal, une rivalité <strong>de</strong> statut, visib<strong>le</strong> à travers la<br />
construction <strong>de</strong> temp<strong>le</strong>s, palais, monuments, places publiques, et autres scènes. Cela met à ru<strong>de</strong><br />
épreuve l’environnement et <strong>le</strong>s ressources loca<strong>le</strong>s, tout en accroissant <strong>le</strong> besoin <strong>de</strong> main d’œuvre,<br />
qui à son tour, augmente la croissance <strong>de</strong> la population.<br />
Ainsi, la pério<strong>de</strong> la plus faste <strong>de</strong>s Mayas <strong>de</strong>s Basses Terres, est éga<strong>le</strong>ment l’expression <strong>de</strong> son<br />
effondrement imminent. Dans chaque région, tandis que la situation commence à se dégra<strong>de</strong>r, <strong>le</strong>s<br />
dirigeants intensifient encore <strong>le</strong>s rituels dispendieux, <strong>le</strong>s actes <strong>de</strong> guerre et <strong>le</strong>s débauches<br />
architectura<strong>le</strong>s, afin <strong>de</strong> rivaliser avec <strong>le</strong>urs ennemis et regagner <strong>le</strong>s faveurs <strong>de</strong>s divinités et <strong>de</strong>s<br />
ancêtres défaillants.<br />
Les différentes zones mayas ont chacune une histoire différente, mais l’ordre sociopolitique <strong>de</strong><br />
cette époque - régi par <strong>de</strong>s seigneurs divins - prend fin, <strong>de</strong> même que son art spectaculaire, son<br />
architecture et <strong>le</strong>s autres manifestations matériel<strong>le</strong>s.<br />
Les dynasties<br />
Les premières dynasties mayas apparaissent pendant <strong>le</strong> Préclassique récent (400 av. J.-C. – 100<br />
apr. J.-C.) et témoignent d’une comp<strong>le</strong>xité socia<strong>le</strong> précoce. Les règ<strong>le</strong>s <strong>de</strong> succession sont<br />
fondées sur l’ascendance paternel<strong>le</strong>, bien que <strong>le</strong> pouvoir et l’autorité aient parfois été transmis<br />
par l’intermédiaire <strong>de</strong> l’épouse ou <strong>de</strong> la mère.<br />
De nombreuses scènes <strong>de</strong> cour représentées sur <strong>le</strong>s monuments, <strong>le</strong>s parois <strong>de</strong>s édifices ou sur<br />
<strong>le</strong>s céramiques sont essentiel<strong>le</strong>ment masculines mais <strong>le</strong> pouvoir exercé par <strong>le</strong>s femmes au sein<br />
<strong>de</strong> la classe dominante est indéniab<strong>le</strong>. Certaines d’entre el<strong>le</strong>s ont porté <strong>le</strong> titre <strong>de</strong> Kalomte, que<br />
l’on pourrait tra<strong>du</strong>ire par impératrice.<br />
Des éléments <strong>de</strong> parures, symbo<strong>le</strong>s <strong>du</strong> pouvoir <strong>de</strong>s souverains et portés lors <strong>de</strong> cérémonies<br />
publiques, sont parvenus jusqu’à nous : coiffes, pen<strong>de</strong>ntifs, ornements d’oreil<strong>le</strong>s en ja<strong>de</strong>, etc.<br />
Collier <strong>de</strong> ja<strong>de</strong><br />
Pério<strong>de</strong> Classique ancien (250-550 apr. J.-C.)<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
20
Section 3 : <strong>le</strong>s pério<strong>de</strong>s Postclassique (1000 apr. J.-C. – 1524 apr. J.-C.)<br />
Postclassique ancien (1000 – 1250 apr. J.-C.) et récent (1250 – 1524 apr. J.-C.).<br />
Grand encensoir subcylindrique à couverc<strong>le</strong><br />
représentant un jaguar<br />
San Andrés, Sajcabajá, Quiché, pério<strong>de</strong> Postclassique<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
Malgré l’effondrement <strong>de</strong>s cités <strong>de</strong>s Basses Terres<br />
lors <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> classique, la gran<strong>de</strong> tradition<br />
maya ne s’éteint pas : el<strong>le</strong> commence un nouveau<br />
cyc<strong>le</strong> au Postclassique. Une nouvel<strong>le</strong> situation<br />
socia<strong>le</strong>, économique, artistique et constructive<br />
apparaît dans <strong>le</strong>s Hautes Terres <strong>du</strong> Guatemala.<br />
Le Bassin <strong>du</strong> Mirador est pratiquement abandonné<br />
alors que <strong>le</strong>s cités Topoxte ou Tayasal, situées dans<br />
<strong>le</strong>s Basses Terres, et cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Q’um’arcaj et<br />
Iximché, dans <strong>le</strong>s Hautes Terres, émergent et<br />
prospèrent.<br />
La politique et l’économie évoluent vers <strong>de</strong>s formes<br />
moins spectaculaires, mais plus résilientes. L’accent<br />
est mis sur <strong>le</strong>s échanges <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its, sur <strong>de</strong> longues<br />
distances par voie maritime, ainsi que sur une<br />
division accrue <strong>du</strong> pouvoir et la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s<br />
investissements dans <strong>le</strong>s domaines somptuaires.<br />
De nouvel<strong>le</strong>s techniques <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction<br />
apparaissent, comme la métallurgie et la<br />
céramique dite plombée en raison <strong>de</strong> son aspect<br />
extérieur. Les représentations artistiques et<br />
architectura<strong>le</strong>s changent, ainsi que l’organisation<br />
politique et socia<strong>le</strong>. En effet, cette pério<strong>de</strong> se<br />
caractérise par une activité guerrière intense, qui<br />
se tra<strong>du</strong>it par la construction <strong>de</strong> cités fortifiées sur<br />
<strong>le</strong>s î<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s plateaux.<br />
Au niveau architectural, <strong>le</strong>s édifices dont la tail<strong>le</strong><br />
diminue nettement sont regroupés au sein <strong>de</strong> cités<br />
fortifiées dominant <strong>le</strong>s vallées. Cette évolution<br />
témoigne <strong>de</strong> relations hosti<strong>le</strong>s et belliqueuses<br />
existant entre <strong>le</strong>s différents royaumes.<br />
La pério<strong>de</strong> Postclassique s’achève avec l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols au début <strong>du</strong> XVI e<br />
sièc<strong>le</strong> ; commence<br />
alors une nouvel<strong>le</strong> phase <strong>de</strong> l’histoire <strong>du</strong> Guatemala. Toutefois, certains sites ne tomberont sous <strong>le</strong><br />
joug espagnol que vers la fin <strong>du</strong> XVII e<br />
sièc<strong>le</strong>. C’est <strong>le</strong> cas <strong>de</strong> Tayasal, capita<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Itzá et icône <strong>de</strong> la<br />
résistance maya, qui ne passera sous la domination européenne qu’en 1697, un sièc<strong>le</strong> et <strong>de</strong>mi après<br />
la chute <strong>de</strong> l’Empire aztèque.<br />
Cette section <strong>de</strong> l’exposition présente <strong>de</strong>s vases en céramique et en albâtre ainsi que <strong>de</strong>s<br />
éléments décoratifs en métal - artefacts en or, en cuivre et en tumbaga (un alliage d’argent, d’or et<br />
<strong>de</strong> cuivre) - significatifs <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> Postclassique.<br />
Disque <strong>de</strong> tumbaga à motif animal<br />
Postclassique (900-1500 apr. J.-C.)<br />
© Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y Etnología<br />
Photo Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
21
Section 4 : témoignages <strong>de</strong> la culture maya contemporaine<br />
Il existe encore au Guatemala une forte population maya. Le parcours <strong>de</strong> l’exposition s’achève ainsi<br />
par une partie contemporaine qui dresse un portrait actuel <strong>de</strong> la civilisation maya, au travers<br />
d’un multimédia et <strong>de</strong> photographies <strong>de</strong> l’artiste Ricky Lopez. Ils permettent <strong>de</strong> transmettre une<br />
vision plus large <strong>de</strong> la culture maya ancienne et contemporaine, créant un lien entre <strong>le</strong> passé et<br />
<strong>le</strong> présent.<br />
1 2<br />
3<br />
1 - Une indigène coud une ceinture en toi<strong>le</strong> - La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Guatemala<br />
2 - Course <strong>de</strong> chevaux célébrée <strong>le</strong> 1 er novembre - Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala<br />
3 - Portique <strong>de</strong> l’église Saint Thomas, construite par <strong>le</strong>s Espagnols sur <strong>le</strong>s ruines d’un temp<strong>le</strong> maya et<br />
dont <strong>le</strong>s marches ont été conservées - Chichicastenango, Quiché, Guatemala<br />
© Ricky Lopez, http://rickylopezbruni.com<br />
22
Les communautés mayas représentent aujourd’hui 55% <strong>de</strong> la population guatémaltèque. El<strong>le</strong>s sont<br />
constituées <strong>de</strong> 22 groupes linguistiques (sur <strong>le</strong>s 25 langues parlées que compte <strong>le</strong> Guatemala, dont<br />
l’espagnol), dont <strong>le</strong>s plus représentés sont <strong>le</strong> k’iche, <strong>le</strong> mam, <strong>le</strong> kaqchikel et <strong>le</strong> q’eqchi’.<br />
Les Mayas contemporains ont conservé certaines <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs traditions, vestimentaires<br />
particulièrement, comme un <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs symbo<strong>le</strong>s i<strong>de</strong>ntitaires. A l’époque <strong>de</strong> la colonisation<br />
espagno<strong>le</strong>, l’habil<strong>le</strong>ment fut l’un <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> la résistance <strong>de</strong>s Mayas qui <strong>le</strong>ur ont permis<br />
<strong>de</strong> conserver intacte <strong>le</strong>ur i<strong>de</strong>ntité culturel<strong>le</strong>. Les femmes tissent au métier à ceinture, un art<br />
transmis à <strong>le</strong>urs fil<strong>le</strong>s et petites-fil<strong>le</strong>s, et parfois même aux garçons <strong>de</strong> certaines communautés. Le<br />
costume typique est toujours porté à l’heure actuel<strong>le</strong>, que ce soit <strong>le</strong>ur habit <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s jours ou<br />
celui porté lors <strong>de</strong>s cérémonies socia<strong>le</strong>s et religieuses. Ceux qui exercent une fonction particulière<br />
au sein <strong>de</strong> la communauté ont éga<strong>le</strong>ment une tenue spécia<strong>le</strong>. Les hommes ont eux aussi un costume<br />
traditionnel, bien que son port tombe en désuétu<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières décennies, surtout dans <strong>le</strong>s<br />
environnements citadins ou proches <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s vil<strong>le</strong>s. Les gui<strong>de</strong>s spirituels mayas portent aussi<br />
un vêtement spécial lors <strong>de</strong>s cérémonies.<br />
Le tissage maya est l’un <strong>de</strong>s arts <strong>le</strong>s plus pratiqués dans <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s indigènes. Chaque village<br />
possè<strong>de</strong> son habit, caractéristique par ses formes et ses cou<strong>le</strong>urs. Ils ont en commun, outre <strong>le</strong>s<br />
techniques, <strong>de</strong>s symbo<strong>le</strong>s comme <strong>le</strong> serpent à plumes (kumatzin ou kan), <strong>le</strong>s étoi<strong>le</strong>s <strong>du</strong> ciel (ri<br />
ch’umil), ou encore <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins abstraits, zoomorphes ou anthropomorphes, etc. On trouve aussi <strong>de</strong>s<br />
visages humains stylisés, <strong>de</strong>s scènes d’enfant, <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> famil<strong>le</strong>s, qui ne sont pas sans<br />
rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s civilisations andines. Chaque création est unique, que ce soit au niveau <strong>de</strong>s vêtements,<br />
<strong>de</strong>s mouchoirs ornementaux, ou <strong>de</strong>s serviettes protocolaires servant à envelopper <strong>de</strong>s présents ou<br />
couvrir <strong>le</strong> pain offert lors d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en mariage.<br />
Le maïs<br />
Le maïs est un aliment vital et un symbo<strong>le</strong> sacré chez <strong>le</strong>s Mayas. Il est encore pour eux un<br />
symbo<strong>le</strong> <strong>de</strong> liberté et <strong>de</strong> spiritualité. En effet, <strong>le</strong> Popol Wuj raconte que Ixmukane a pétri la<br />
pâte <strong>de</strong> maïs qui a servi à la création <strong>de</strong>s premiers ancêtres masculins.<br />
Les différentes variétés <strong>de</strong> maïs - jaune, blanc, rouge, et noir - sont encore cultivées dans tous<br />
<strong>le</strong>s villages mayas, assurant aux famil<strong>le</strong>s <strong>le</strong>ur sécurité alimentaire. Le maïs, cuit dans <strong>de</strong> l’eau<br />
avec <strong>de</strong> la chaux appelé nixtamal, est <strong>le</strong>ur principa<strong>le</strong> source <strong>de</strong> calcium. Un fois moulu, <strong>le</strong><br />
nixtamal est transformé en pâte qui sera utilisée pour faire <strong>le</strong>s tortillas et <strong>le</strong>s tamalitos. Leur<br />
maïs sacré est quant à lui réputé pour ses propriétés curatives et spirituel<strong>le</strong>s.<br />
Les femmes jouent un rô<strong>le</strong> prééminent dans la conservation et la transmission <strong>de</strong>s principes, <strong>de</strong>s<br />
va<strong>le</strong>urs et <strong>de</strong> la connaissance <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la tradition, par <strong>le</strong> biais <strong>de</strong> la langue maternel<strong>le</strong><br />
et <strong>de</strong>s coutumes. El<strong>le</strong>s é<strong>du</strong>quent <strong>le</strong>urs enfants, et ce sont aussi battues contre la discrimination,<br />
l’exclusion et l’exploitation <strong>de</strong>s communautés mayas <strong>du</strong>rant toute l’histoire <strong>du</strong> Guatemala.<br />
Les principes, <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs et <strong>le</strong>s normes socia<strong>le</strong>s mayas se manifestent dans la pratique <strong>de</strong>s coutumes<br />
et <strong>de</strong>s traditions, ainsi que dans <strong>le</strong>s œuvres littéraires ou récits <strong>de</strong> tradition ora<strong>le</strong>, comme <strong>le</strong> Popol<br />
Wuj (récit <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong> la civilisation maya), ou <strong>le</strong> Rabinal Achi’ (drame dansé préhispanique inscrit<br />
au patrimoine culturel immatériel <strong>de</strong> l’UNESCO), mais éga<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s discours cérémoniels<br />
prononcés lors d’évènements importants ou <strong>le</strong>s enseignements prodigués aux enfants.<br />
Les dynamiques <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, <strong>le</strong>s arts, <strong>le</strong> développement intel<strong>le</strong>ctuel et spirituel <strong>de</strong>s communautés<br />
mayas actuel<strong>le</strong>s présentent un lien étroit avec l’interprétation <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l’univers héritée <strong>de</strong><br />
<strong>le</strong>urs ancêtres.<br />
La vie spirituel<strong>le</strong> est très liée au nahualisme (selon <strong>le</strong>quel nous avons tous un doub<strong>le</strong> protecteur qui<br />
nous oriente dans la vie) et à l’animisme (tout a une âme et une force vita<strong>le</strong> que nous <strong>de</strong>vons<br />
connaître et respecter). Les Mayas sont attachés au respect <strong>du</strong> prochain, considérant que chaque<br />
être humain participe à l’harmonie <strong>de</strong> l’univers et que toute action in<strong>du</strong>it une réponse divine<br />
compensatoire.<br />
23
Ces principes sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
- La conscience <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> chacun au sein <strong>du</strong> cosmos et <strong>de</strong> son harmonie. El<strong>le</strong> va <strong>de</strong> pair<br />
avec <strong>le</strong> nahualisme (selon <strong>le</strong>quel nous avons tous un doub<strong>le</strong> protecteur qui nous oriente dans la vie)<br />
et l’animisme (tout a une âme et une force vita<strong>le</strong> que nous <strong>de</strong>vons connaître et respecter).<br />
- Le souci <strong>de</strong> l’équilibre <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l’harmonie <strong>de</strong> l’univers. La nature est la Mère qui<br />
procure abri, nourriture, santé physique et menta<strong>le</strong>, sécurité et inspiration. Pour respecter son<br />
ordre, ils utilisent <strong>le</strong>s ca<strong>le</strong>ndriers lunaire (ou rituel) et solaire (ou agrico<strong>le</strong>).<br />
- L’art, la science et la religion fonctionnent comme un tout interdépendant : l’art en fonction <strong>de</strong><br />
la science et <strong>de</strong> la religion ; la science en fonction <strong>de</strong> la religion et <strong>de</strong> l’art ; la religion en fonction <strong>de</strong><br />
la science et <strong>de</strong> l’art.<br />
- Le maïs est l’aliment vital et <strong>le</strong> signe sacré <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s. Le Popol Wuj <strong>le</strong>ur apprend que <strong>le</strong>ur<br />
premiers pères et mères ont été façonnés dans <strong>de</strong> la pâte <strong>de</strong> maïs.<br />
- Toute personne est mon autre moi (Wach winäq ; La’in la’ech). Chaque être humain est un<br />
élément important dans l’harmonie <strong>de</strong> l’univers ; il a son étoi<strong>le</strong>, sa mission et sa vocation (Ri qa<br />
Ch’umilal). Il est son prochain, je lui dois respect, solidarité et réciprocité.<br />
- Les connaissances ont <strong>le</strong>ur raison d’être <strong>du</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s sont offertes à la communauté. El<strong>le</strong>s<br />
émanent <strong>de</strong> tous et sont <strong>de</strong>stinées à tous.<br />
- Tout phénomène social et naturel comporte une force <strong>de</strong> compensation (Tojb’alil,<br />
Tz’aqatil). Leurs va<strong>le</strong>urs s’expriment sous forme <strong>de</strong> Ruk’u’x na’oj, ce qui signifie cœur, énergie <strong>de</strong> la<br />
pensée et sagesse.<br />
Texte « MAYA WINAKI’ : Les Mayas aujourd’hui » <strong>de</strong> Jesus Salazar Tetzaguic,<br />
extrait <strong>du</strong> catalogue <strong>de</strong> l’exposition<br />
« [Evoquons] l’événement qui constituera, nous l’espérons, une nouvel<strong>le</strong> chance <strong>de</strong> vie juste<br />
et équitab<strong>le</strong>. Il nous reste moins d’un an et <strong>de</strong>mi jusqu'au 21 décembre 2012 : un temps<br />
précieux pour trouver la paix et la concor<strong>de</strong> entre <strong>le</strong>s indivi<strong>du</strong>s et <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s, atteindre la<br />
paix et l’harmonie avec Mère Nature, qui nous fait <strong>de</strong> grands signes. Pour cesser d’exploiter<br />
sans vergogne <strong>le</strong>s ressources naturel<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> seul but <strong>de</strong> s’enrichir davantage et non <strong>de</strong><br />
satisfaire <strong>de</strong>s besoins fondamentaux. Pour généraliser l’observance <strong>du</strong> poqonaj : il faut<br />
protéger <strong>le</strong>s rivières, <strong>le</strong>s lacs, <strong>le</strong>s forêts, <strong>le</strong>s terres cultivées, <strong>le</strong>s montagnes, <strong>le</strong>s animaux ;<br />
traiter notre prochain avec respect et estime, collaborer avec - et servir - la communauté avec<br />
dévouement et sans égoïsme ; respecter <strong>le</strong>s croyances religieuses car nous sommes tous en<br />
quête <strong>du</strong> même Dieu créateur et formateur <strong>de</strong> l’univers ; respecter <strong>le</strong>s langues vernaculaires<br />
et <strong>le</strong>s empêcher <strong>de</strong> disparaître, car el<strong>le</strong>s sont la mémoire <strong>de</strong>s peup<strong>le</strong>s. »<br />
Jesús Salazar Tetzagüic<br />
“Konojel ri tinamital tik’oje ki kuqul k’u’x, jeb’el kichojmilal ; utz taq kib’ey, säq taq kib’eyal”<br />
Que tous <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s soient en paix, en profon<strong>de</strong> harmonie ; bons chemins et chemins blancs<br />
POPOL WUJ<br />
24
* GENERIQUE DE L’EXPOSITION<br />
Commissaire : Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo, Directeur <strong>du</strong> Museo Nacional <strong>de</strong> Arqueología y<br />
Etnología <strong>de</strong> Ciudad Guatemala<br />
Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z étudie l’archéologie à l’Université <strong>de</strong> San Carlos <strong>de</strong> Guatemala, puis travail<strong>le</strong><br />
sur un grand nombre <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s archéologiques sur différents sites, parmi <strong>le</strong>squels : El<br />
Perú-Waka’ (2003-2008), El Zotz (2006-2008), Sierra <strong>de</strong>l Lacandón (2005-2006), Piedras Negras (2002<br />
et 2004)... En 2008, Juan Carlos Melén<strong>de</strong>z Mollinedo est co-directeur <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong>s<br />
archéologiques <strong>du</strong> site El Perú-Waka’. Depuis 2009, il est directeur <strong>du</strong> Museo Nacional <strong>de</strong><br />
Arqueología y Etnología <strong>de</strong> Ciudad Guatemala.<br />
Conseil<strong>le</strong>r scientifique : Dr. Richard D. Hansen, archéologue<br />
Richard Hansen obtient un doctorat (Ph.D.) en archéologie à l’Université <strong>de</strong> Californie à Los Ange<strong>le</strong>s<br />
(UCLA) en 1992 ; il est alors Affiliate Research Professor au sein <strong>du</strong> Département d’Anthropologie à<br />
l’Université d’Idaho. Il fon<strong>de</strong> en 1996 la Foundation for Anthropological Research and Environmental<br />
Studies (FARES), dont il est prési<strong>de</strong>nt. Richard Hansen est spécialiste <strong>de</strong> la civilisation maya et<br />
directeur <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> fouil<strong>le</strong> <strong>du</strong> Bassin <strong>du</strong> Mirador. Il a déjà cartographié et fouillé 51 sites <strong>du</strong> Nord<br />
<strong>du</strong> Guatemala. Il est décoré en décembre 2005 <strong>de</strong> l’Ordre national <strong>du</strong> Patrimoine culturel <strong>du</strong><br />
Guatemala. En 2008, il est nommé Environmentalist of the Year for Latin America par la Latin Tra<strong>de</strong><br />
Association, et en 2009, il reçoit <strong>le</strong> Idaho State University Achievement Award.<br />
Scénographe <strong>de</strong> l’exposition : Jean-Paul Boulanger, agence Pylône<br />
* AUTOUR DE L’EXPOSITION<br />
Catalogue <strong>de</strong> l’exposition<br />
MAYA, <strong>de</strong> l’aube au crépuscu<strong>le</strong>, Col<strong>le</strong>ctions nationa<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Guatemala<br />
Coédition <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> / Somogy<br />
200 pages – 29 € – 170 illustrations<br />
Mission archéo<br />
PROFESSION : ARCHEOLOGUE<br />
14h30<br />
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juil<strong>le</strong>t, 3, 10, 17, 24, 31 août<br />
Les vendredis 8, 15, 22, 29 juil<strong>le</strong>t, 5, 12, 19, 26 août, 2 septembre<br />
Durée : 2h - <strong>de</strong> 9 à 12 ans, accès libre dans la limite <strong>de</strong>s places disponib<strong>le</strong>s<br />
Accessib<strong>le</strong> aux groupes d'enfants en situation <strong>de</strong> handicap mental<br />
Les enfants sont invités à fouil<strong>le</strong>r et analyser pour se lancer sur <strong>le</strong>s traces d'une civilisation<br />
précolombienne. Lors d'une recherche archéologique, ils peuvent retrouver <strong>le</strong>s vestiges <strong>de</strong>s Mayas<br />
et étudier <strong>le</strong>ur influence sur <strong>le</strong>s cultures <strong>de</strong> la région.<br />
Visite contée<br />
11h30<br />
Les dimanches 10, 17, 27, 31 juil<strong>le</strong>t, 14, 21, 28 août, 11, 18, 25 septembre<br />
Durée : 1h<br />
Accessib<strong>le</strong> aux personnes en situation <strong>de</strong> handicap moteur, visuel, mental<br />
Une aventure au cœur <strong>de</strong> la forêt vierge, à la découverte <strong>de</strong>s mystérieuses cités mayas.<br />
25
*COLLOQUE INTERNATIONAL - Sociétés mayas millénaires : Crises<br />
<strong>du</strong> passé et résilience<br />
Les 01/07 et 02/07/11<br />
De 9h30 à 19h<br />
Théâtre Clau<strong>de</strong> Lévi-Strauss<br />
Entrée libre dans la limite <strong>de</strong>s places disponib<strong>le</strong>s<br />
Initié par <strong>le</strong> Département <strong>de</strong> la Recherche et <strong>de</strong><br />
l’Enseignement <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> et organisé<br />
par l’UMR 8096 Archéologie <strong>de</strong>s Amériques (CNRS –<br />
Université <strong>de</strong> Paris 1 Panthéon-Sorbonne)<br />
L’archéologie mayaniste et plus généra<strong>le</strong>ment<br />
l’archéologie <strong>du</strong> Guatemala, qui ont souvent partie<br />
liée avec <strong>le</strong> tourisme, traitent chaque site comme une<br />
entité sociopolitique en soi, dont l’histoire se termine<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> la pyrami<strong>de</strong> Danta,<br />
El Mirador.<br />
Photo : R.D. Hansen © FARES 2010<br />
<strong>le</strong> plus souvent par l’abandon <strong>de</strong> ses monuments que la forêt finit par recouvrir. Cette image<br />
romantique est uti<strong>le</strong> à la mise en scène <strong>de</strong>s ruines. Pourtant <strong>le</strong>s sociétés mayas et <strong>le</strong>s autres<br />
sociétés anciennes ne se ré<strong>du</strong>isent pas à <strong>le</strong>ur site archéologique. Les Mayas et <strong>le</strong>ur culture ont<br />
résisté aux nombreux bou<strong>le</strong>versements et sont, en ce sens, toujours implantées au Guatemala<br />
et dans <strong>le</strong>s pays limitrophes.<br />
La question <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur résilience est fondamenta<strong>le</strong> dans tous <strong>le</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche récents ou<br />
en cours actuel<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s Basses Terres mayas, dans <strong>le</strong>s Hautes Terres mayas, sur la côte<br />
pacifique, pour comprendre <strong>le</strong>s crises <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> Préclassique ou cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la fin <strong>du</strong> Classique.<br />
Cette question comp<strong>le</strong>xe mobilise <strong>le</strong>s résultats <strong>de</strong> recherche archéologique, épigraphique et<br />
iconographique <strong>le</strong>s plus récents et forme l’arrière-fond <strong>de</strong> nombreuses hypothèses. D’autres<br />
graves crises ultérieures furent cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la conquête espagno<strong>le</strong> et <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s <strong>de</strong> guerres<br />
postérieures. Tenter <strong>de</strong> <strong>le</strong>s comprendre à distance dans l’éclairage d’un passé millénaire doit<br />
contribuer à donner <strong>du</strong> sens au présent.<br />
Ce colloque archéologique vise avant tout, dans la problématique <strong>de</strong>s crises et <strong>de</strong> la résilience, à<br />
rassemb<strong>le</strong>r et à présenter <strong>le</strong>s synthèses <strong>de</strong> recherche <strong>le</strong>s plus récentes concernant l’évolution <strong>de</strong><br />
l’ancienne civilisation maya et <strong>de</strong>s sociétés voisines.<br />
La recherche et l’enseignement au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong><br />
Depuis sa création, <strong>le</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> est engagé dans la recherche <strong>de</strong> pointe et dans sa<br />
diffusion, dans <strong>le</strong>s domaines <strong>de</strong> l’histoire et <strong>de</strong> l’anthropologie <strong>de</strong> l’art. La recherche et<br />
l’enseignement supérieur sont intégrés dans la vie <strong>de</strong> l’institution dans <strong>le</strong> cadre d’une politique<br />
novatrice tant par ses visées scientifiques que par ses modalités d’organisation.<br />
Le domaine <strong>de</strong> réf<strong>le</strong>xion : au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions<br />
La recherche et l’enseignement ne se limitent pas aux seu<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctions <strong>du</strong> <strong>musée</strong> et sont ouvertes<br />
sur <strong>le</strong>s domaines <strong>de</strong>s arts occi<strong>de</strong>ntaux et extra-occi<strong>de</strong>ntaux, <strong>de</strong>s patrimoines matériels et<br />
immatériels, <strong>de</strong>s institutions muséa<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs col<strong>le</strong>ctions, <strong>de</strong> la technologie et culture<br />
matériel<strong>le</strong>. Les disciplines concernées sont l’anthropologie, l’histoire <strong>de</strong> l’art, l’histoire,<br />
l’archéologie, l’ethnomusicologie, <strong>le</strong>s arts <strong>du</strong> spectac<strong>le</strong> et la sociologie.<br />
La recherche, un travail en réseau<br />
Le <strong>musée</strong> ne dispose pas d’une unité permanente <strong>de</strong> chercheurs. Sa structure <strong>de</strong> recherche repose<br />
sur la mise en place d’un réseau <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s institutions, dans <strong>le</strong> cadre d’une structure<br />
interdisciplinaire dont <strong>le</strong> <strong>musée</strong> a eu l’initiative : <strong>le</strong> GDRI (Groupement <strong>de</strong> recherche International)<br />
en partenariat avec <strong>le</strong> CNRS. Le GDRI, financé par toutes <strong>le</strong>s parties et dont <strong>le</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong><br />
26
<strong>Branly</strong> est <strong>le</strong> pivot, a pour mission <strong>de</strong> susciter la formation d’équipes porteuses <strong>de</strong> projets, <strong>de</strong><br />
soutenir <strong>le</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche, <strong>de</strong> favoriser la mobilité <strong>du</strong> personnel <strong>de</strong>s institutions<br />
partenaires, d’organiser <strong>de</strong>s séminaires, ateliers, colloques, <strong>de</strong> diffuser <strong>le</strong>s résultats scientifiques.<br />
Le champ <strong>de</strong> la recherche <strong>du</strong> GDRI englobe trois gran<strong>de</strong>s thématiques : <strong>le</strong> statut <strong>de</strong> l’image, la<br />
circulation <strong>de</strong>s pratiques et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>ctions artistiques, <strong>le</strong>s pratiques <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction<br />
contemporaine.<br />
Le département est ainsi ouvert à <strong>de</strong>s projets re<strong>le</strong>vant <strong>de</strong> nombreuses disciplines : anthropologie,<br />
histoire, histoire <strong>de</strong> l’art, sociologie <strong>de</strong>s institutions culturel<strong>le</strong>s, ethnolinguistique,<br />
ethnomusicologie, technologie culturel<strong>le</strong>, sciences <strong>de</strong> la cognition.<br />
Si la nature <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions gérées par <strong>le</strong> <strong>musée</strong> oriente la recherche scientifique vers <strong>le</strong>s arts et <strong>le</strong>s<br />
techniques <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> l’Afrique, <strong>de</strong> l’Océanie, <strong>de</strong>s Amériques et <strong>de</strong> l’Asie, l’Europe et <strong>le</strong> mon<strong>de</strong><br />
occi<strong>de</strong>ntal ne sont pas exclus <strong>du</strong> champ d’étu<strong>de</strong>.<br />
La recherche n’est pas à l’écart <strong>de</strong> la vie <strong>du</strong> <strong>musée</strong><br />
El<strong>le</strong> y participe, par la collaboration et l’échange <strong>de</strong> pratiques professionnel<strong>le</strong>s, entre chercheurs,<br />
conservateurs et enseignants ; par <strong>le</strong>ur participation aux tâches <strong>de</strong> diffusion <strong>du</strong> savoir :<br />
renseignement d’objets, élaboration et mise à jour <strong>de</strong>s programmes multimédias <strong>du</strong> <strong>musée</strong>,<br />
constitution <strong>de</strong> bibliothèques virtuel<strong>le</strong>s pour la médiathèque.<br />
Le <strong>musée</strong> invite régulièrement, avec prise en charge <strong>du</strong> voyage ou <strong>du</strong> séjour, <strong>de</strong>s chercheurs<br />
étrangers spécialistes dans certains domaines afin <strong>de</strong> partager <strong>le</strong>urs expertises, <strong>le</strong>urs savoirs, lors <strong>de</strong><br />
conférences en relation avec <strong>le</strong>s thèmes <strong>de</strong>s expositions temporaires, lors <strong>de</strong> cours ou <strong>de</strong> séminaires<br />
d’enseignement.<br />
L’ai<strong>de</strong> directe à la recherche : bourses et prix <strong>de</strong> thèse<br />
Pour ai<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s doctorants et <strong>de</strong> jeunes docteurs à mener à bien <strong>de</strong>s projets innovants, <strong>le</strong> <strong>musée</strong><br />
attribue chaque année huit bourses (trois doctora<strong>le</strong>s, cinq post doctora<strong>le</strong>s). L’attribution s’effectue à<br />
l’issue d’un appel d’offre international qui génère plus <strong>de</strong> 100 candidatures par an, sur <strong>de</strong>s thèmes<br />
ayant trait à l’histoire <strong>de</strong> l’art à la sociologie, l’archéologie, l’anthropologie.<br />
Les boursiers, sé<strong>le</strong>ctionnés par un comité d’évaluation scientifique pour la pertinence <strong>du</strong> thème <strong>de</strong><br />
recherche, bénéficient d’un poste <strong>de</strong> travail au sein <strong>du</strong> <strong>musée</strong> dont ils font partie pendant une<br />
année, avec la possibilité <strong>de</strong> travail<strong>le</strong>r avec <strong>le</strong>s conservateurs, d’intervenir auprès <strong>du</strong> public dans <strong>le</strong><br />
cadre <strong>du</strong> salon <strong>de</strong> <strong>le</strong>cture Jacques Kerchache.<br />
Le <strong>musée</strong> ne publie pas <strong>le</strong>urs travaux, mais <strong>de</strong>puis 2007, un prix <strong>de</strong> thèse <strong>de</strong> doctorat, d’un montant<br />
<strong>de</strong> 7 000 euros, couronne un travail réalisé dans une université européenne (en français ou en<br />
anglais) et ai<strong>de</strong> à la publication <strong>de</strong> l’ouvrage.<br />
La place <strong>de</strong> l’enseignement<br />
Le <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, en partenariat avec 9 établissements* d’enseignement supérieur, a créé<br />
en son sein une vie <strong>de</strong> campus. Il n’est pas habilité à délivrer <strong>de</strong>s diplômes nationaux et ne se<br />
substitue pas aux universités ou aux éco<strong>le</strong>s spécialisées mais accueil<strong>le</strong>, dans trois sal<strong>le</strong>s <strong>de</strong> cours,<br />
<strong>de</strong>s enseignements en lien avec ses col<strong>le</strong>ctions ou correspondant aux thèmes scientifiques définis<br />
par <strong>le</strong> département <strong>de</strong> la recherche et <strong>de</strong> l’enseignement.<br />
Destinés aux étudiants <strong>de</strong> master et <strong>de</strong> doctorat, et <strong>de</strong> façon plus exceptionnel<strong>le</strong> à ceux <strong>de</strong><br />
troisième année <strong>de</strong> licence, <strong>le</strong>s enseignements dispensés prennent la forme <strong>de</strong> séminaires<br />
spécialisés, <strong>de</strong> journées d’étu<strong>de</strong>s ou <strong>de</strong> conférences dans <strong>le</strong>s domaines <strong>de</strong> l’anthropologie, <strong>de</strong><br />
l’ethnomusicologie, <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’art, <strong>de</strong> l’histoire, <strong>de</strong> l’archéologie, <strong>de</strong> la sociologie, <strong>de</strong> la<br />
littérature ora<strong>le</strong> et <strong>du</strong> droit <strong>du</strong> patrimoine.<br />
Le <strong>musée</strong> propose éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s enseignements concernant ses col<strong>le</strong>ctions, dispensés par <strong>le</strong>s<br />
conservateurs. Les enseignements sont généra<strong>le</strong>ment ouverts aux auditeurs libres, sous réserve <strong>de</strong><br />
l’accord <strong>de</strong> l’enseignant.<br />
* EHESS – Eco<strong>le</strong> <strong>du</strong> Louvre – Eco<strong>le</strong> pratique <strong>de</strong>s hautes étu<strong>de</strong>s – Université Paris I – Paris VIII – Paris X – Paris-Sud XI – INALCO<br />
27
* LES COLLECTIONS AMERIQUES DU MUSEE DU QUAI BRANLY<br />
La col<strong>le</strong>ction américaine constitue <strong>le</strong> fonds <strong>le</strong> plus important en nombre <strong>du</strong> <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong><br />
<strong>Branly</strong> : riche <strong>de</strong> 100 000 objets, el<strong>le</strong> est présentée au travers d’une sé<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 900<br />
pièces, suivant un parcours organisé en <strong>de</strong>ux parties, l’Amérique récente et actuel<strong>le</strong> répondant<br />
à l’Amérique précolombienne.<br />
Au sortir <strong>de</strong> la section consacrée aux col<strong>le</strong>ctions africaines, <strong>le</strong>s Amériques noires sont présentées<br />
par <strong>de</strong>s objets provenant <strong>de</strong>s Marrons <strong>de</strong> Guyane, <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>ctions candomblé <strong>du</strong> Brésil et un<br />
ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong> pièces rituel<strong>le</strong>s vodou d’Haïti<br />
Du détroit <strong>de</strong> Béring à la Terre <strong>de</strong> Feu<br />
La muséographie <strong>de</strong>s Amériques privilégie ensuite une présentation <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions amérindiennes par<br />
gran<strong>de</strong>s aires culturel<strong>le</strong>s. Plusieurs séquences rythment ce parcours, <strong>du</strong> nord au sud, <strong>du</strong> détroit <strong>de</strong> Béring à<br />
la Terre <strong>de</strong> Feu. L’Arctique et la Côte Nord-Ouest sont principa<strong>le</strong>ment illustrés par <strong>de</strong>s masques <strong>de</strong> l’Alaska,<br />
<strong>de</strong>s masques et <strong>de</strong>s figurines <strong>du</strong> Groenland, et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>ctions inuit en ivoire. Au pied <strong>du</strong> mât <strong>de</strong> l’Ours,<br />
masques et récipients <strong>de</strong> la Colombie britannique voisinent avec vanneries, ceintures et coiffes <strong>de</strong>s Indiens<br />
<strong>de</strong> Californie. Hérités <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions <strong>de</strong>s Rois <strong>de</strong> France, <strong>de</strong>s peaux peintes, <strong>de</strong>s wampums, <strong>de</strong>s calumets,<br />
<strong>de</strong>s armes, <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>ctions en per<strong>le</strong>s provenant <strong>de</strong> la région <strong>de</strong>s Grands Lacs et <strong>de</strong> la Vallée <strong>du</strong> Mississipi<br />
sont <strong>le</strong>s témoins <strong>de</strong>s contacts entre Amérindiens et Français aux XVIIe et XVIIIe sièc<strong>le</strong>s.<br />
Parallè<strong>le</strong>ment, une sé<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> costumes et <strong>de</strong> masques festifs <strong>de</strong> Bolivie illustre <strong>le</strong> syncrétisme religieux<br />
dans <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> andin. En vis-à-vis, <strong>le</strong>s objets mexicains évoquent la place <strong>de</strong> l’homme dans l’univers, et <strong>le</strong>s<br />
chatoyantes parures <strong>de</strong> l’Amazonie sont l’illustration d’un art <strong>de</strong> la plume fascinant associé aux peintures<br />
corporel<strong>le</strong>s. Quelques armes et massues, à l’image <strong>du</strong> casse-tête tupinamba ramené en France au milieu<br />
<strong>du</strong> XVIe sièc<strong>le</strong>, révè<strong>le</strong>nt l’ancienneté <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions guyanaises et brésiliennes. Le sud <strong>de</strong> l’Amérique<br />
méridiona<strong>le</strong> est évoqué par <strong>de</strong>s pièces d’argenterie hispano-créo<strong>le</strong>s et indigènes, par ses texti<strong>le</strong>s et la<br />
peinture sur cuir associés à d’imposantes sculptures rituel<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s Mapuche <strong>du</strong> Chili.<br />
L’Amérique avant l’arrivée <strong>de</strong>s Européens<br />
La secon<strong>de</strong> séquence américaine fait remonter <strong>le</strong> temps au visiteur et présente <strong>le</strong>s populations<br />
amérindiennes avant l’arrivée <strong>de</strong>s Européens. La richesse <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions archéologiques dont <strong>le</strong> <strong>musée</strong><br />
dispose permet <strong>de</strong> donner une vue d’ensemb<strong>le</strong> <strong>de</strong>s nombreuses cultures qui se sont succédées, pendant<br />
plusieurs millénaires, à l’intérieur <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s aires culturel<strong>le</strong>s : la Caraïbe, l’Amérique centra<strong>le</strong>, la<br />
Mésoamérique et <strong>le</strong>s An<strong>de</strong>s. La présentation <strong>de</strong> cette séquence est chronologique et culturel<strong>le</strong>, allant –<br />
dans <strong>le</strong> sens <strong>de</strong> la visite – <strong>de</strong>s cultures <strong>le</strong>s plus récentes aux plus anciennes. Les premières sont<br />
représentées par <strong>le</strong>s Tainos <strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s Antil<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s Aztèques <strong>du</strong> Mexique et <strong>le</strong>s Incas <strong>du</strong> Pérou, cel<strong>le</strong>s qui<br />
subirent <strong>de</strong> p<strong>le</strong>in fouet la confrontation avec <strong>le</strong>s colons européens. Dans <strong>de</strong>ux parcours parallè<strong>le</strong>s, <strong>le</strong><br />
visiteur découvre la profon<strong>de</strong>ur historique et la richesse <strong>de</strong>s civilisations précolombiennes <strong>de</strong> la<br />
Mésoamérique et <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s : <strong>de</strong>s Olmèques aux Mayas en passant par Teotihuacan d’un côté ; <strong>de</strong> Paracas,<br />
Mochica et Nazca aux cultures inca et muisca <strong>de</strong> l’autre. Pour illustrer ces temps précolombiens, un vaste<br />
choix d’objets archéologiques a été effectué : statues, céramiques, œuvres en pierre représentant<br />
généra<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s divinités, ainsi que <strong>de</strong>s objets en bois, en métal, en orfèvrerie, en texti<strong>le</strong>s et en plumes.<br />
Les expositions Amériques au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong><br />
E<strong>le</strong>na Izcue : 01/04/2008 - 14/07/2008<br />
Commissaire : Natalia Majluf<br />
Paracas, Trésors inédits <strong>du</strong> Pérou ancien :<br />
01/04/2008 - 14/07/2008<br />
Commissaire : Daniè<strong>le</strong> Lavallée<br />
Teotihuacan, Cité <strong>de</strong>s Dieux : 06/10/2009 -<br />
24/01/2010<br />
Commissaire : Felipe Solis<br />
Sexe, mort et sacrifices dans la religion<br />
Mochica : 09/03/2010 - 23/05/2010<br />
Commissaire : Steve Bourget<br />
A venir : Patagonie, images <strong>du</strong> bout <strong>du</strong><br />
mon<strong>de</strong> : 06/03/2012 - 20/05/2012<br />
Commissaire : Christine Barthe<br />
Sexe, mort et sacrifices dans la religion<br />
Mochica © <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong>, photo Antoine<br />
Schneck<br />
28
* INFORMATIONS PRATIQUES : www.<strong>quai</strong>branly.fr<br />
Visuels disponib<strong>le</strong>s pour la <strong>presse</strong> : http://ymago.<strong>quai</strong>branly.fr Accès fourni sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
Contacts<br />
Contact <strong>presse</strong> : Contacts <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> :<br />
Pierre LAPORTE Communication<br />
tél : 33 (0)1 45 23 14 14<br />
info@pierre-laporte.com<br />
* MECENE DE L’EXPOSITION<br />
Nathalie MERCIER<br />
Directrice <strong>de</strong> la communication<br />
tél : 33 (0)1 56 61 70 20<br />
nathalie.mercier@<strong>quai</strong>branly.fr<br />
L’exposition MAYA, <strong>de</strong> l’aube au crépuscu<strong>le</strong> a été réalisée avec <strong>le</strong> soutien <strong>de</strong><br />
Magalie VERNET<br />
Chargée <strong>de</strong>s relations médias<br />
tél : 33 (0)1 56 61 52 87<br />
magalie.vernet@<strong>quai</strong>branly.fr<br />
Perenco est une société pétrolière indépendante d’exploration et <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction. Nous opérons dans<br />
une quinzaine <strong>de</strong> pays où notre savoir-faire est synonyme, pour <strong>le</strong>s états, <strong>de</strong> revenus importants<br />
tirés <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs ressources naturel<strong>le</strong>s. Nous veillons à ce que <strong>le</strong>s populations vivant à proximité <strong>de</strong>s<br />
sites ou nous travaillons bénéficient <strong>de</strong> notre présence. Nos projets sociaux et environnementaux<br />
sont mis en œuvre en impliquant directement <strong>le</strong>s communautés loca<strong>le</strong>s tout en préservant <strong>le</strong>ur<br />
culture et <strong>le</strong>urs va<strong>le</strong>urs.<br />
Au Guatemala, Perenco est la principa<strong>le</strong> société pétrolière, fournissant la quasi-totalité <strong>de</strong> la<br />
pro<strong>du</strong>ction nationa<strong>le</strong>. En complément <strong>de</strong> plusieurs actions menées dans <strong>le</strong>s domaines <strong>de</strong><br />
l’é<strong>du</strong>cation, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> l’emploi, Perenco a tissé <strong>de</strong>s liens étroits avec <strong>de</strong>s équipes<br />
d’archéologues travaillant sur <strong>le</strong>s sites mayas. Aujourd’hui, en collaboration avec <strong>le</strong> CNRS,<br />
l’Ambassa<strong>de</strong> <strong>de</strong> France au Guatemala et la fondation Pacunam, el<strong>le</strong> apporte un soutien financier et<br />
logistique aux fouil<strong>le</strong>s menées sur <strong>le</strong> site <strong>de</strong> l’ancienne cité maya <strong>de</strong> Naachtun.<br />
L’exposition MAYA, <strong>de</strong> l’aube au crépuscu<strong>le</strong>, Col<strong>le</strong>ctions nationa<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Guatemala organisée en 2011<br />
au <strong>musée</strong> <strong>du</strong> <strong>quai</strong> <strong>Branly</strong> est l’occasion pour Perenco <strong>de</strong> démontrer son attachement <strong>de</strong> longue date<br />
à la mise en va<strong>le</strong>ur <strong>du</strong> riche patrimoine guatémaltèque et sa fierté <strong>de</strong> travail<strong>le</strong>r au développement<br />
économique <strong>de</strong> ce pays et <strong>de</strong> ses habitants.<br />
29
* PARTENAIRES DE L’EXPOSITION<br />
30