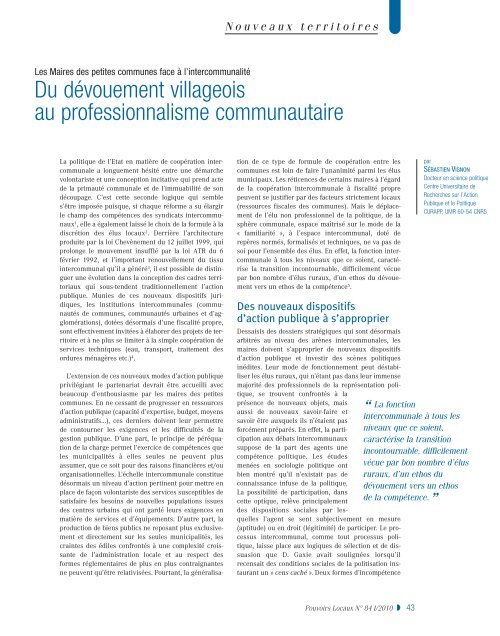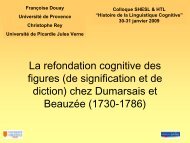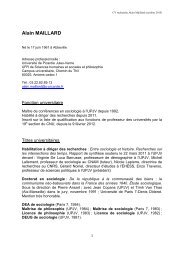Du dévouement villageois au professionnalisme communautaire
Du dévouement villageois au professionnalisme communautaire
Du dévouement villageois au professionnalisme communautaire
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La politique de l’Etat en matière de coopération intercommunale<br />
a longuement hésité entre une démarche<br />
volontariste et une conception incitative qui prend acte<br />
de la prim<strong>au</strong>té communale et de l’immuabilité de son<br />
découpage. C’est cette seconde logique qui semble<br />
s’être imposée puisque, si chaque réforme a su élargir<br />
le champ des compétences des syndicats intercommun<strong>au</strong>x<br />
1 , elle a également laissé le choix de la formule à la<br />
discrétion des élus loc<strong>au</strong>x 2 . Derrière l’architecture<br />
produite par la loi Chevènement du 12 juillet 1999, qui<br />
prolonge le mouvement insufflé par la loi ATR du 6<br />
février 1992, et l’important renouvellement du tissu<br />
intercommunal qu’il a généré 3 , il est possible de distinguer<br />
une évolution dans la conception des cadres territori<strong>au</strong>x<br />
qui sous-tendent traditionnellement l’action<br />
publique. Munies de ces nouve<strong>au</strong>x dispositifs juridiques,<br />
les institutions intercommunales (commun<strong>au</strong>tés<br />
de communes, commun<strong>au</strong>tés urbaines et d’agglomérations),<br />
dotées désormais d’une fiscalité propre,<br />
sont effectivement invitées à élaborer des projets de territoire<br />
et à ne plus se limiter à la simple coopération de<br />
services techniques (e<strong>au</strong>, transport, traitement des<br />
ordures ménagères etc.) 4 .<br />
L’extension de ces nouve<strong>au</strong>x modes d’action publique<br />
privilégiant le partenariat devrait être accueilli avec<br />
be<strong>au</strong>coup d’enthousiasme par les maires des petites<br />
communes. En ne cessant de progresser en ressources<br />
d’action publique (capacité d’expertise, budget, moyens<br />
administratifs…), ces derniers doivent leur permettre<br />
de contourner les exigences et les difficultés de la<br />
gestion publique. D’une part, le principe de péréquation<br />
de la charge permet l’exercice de compétences que<br />
les municipalités à elles seules ne peuvent plus<br />
assumer, que ce soit pour des raisons financières et/ou<br />
organisationnelles. L’échelle intercommunale constitue<br />
désormais un nive<strong>au</strong> d’action pertinent pour mettre en<br />
place de façon volontariste des services susceptibles de<br />
satisfaire les besoins de nouvelles populations issues<br />
des centres urbains qui ont gardé leurs exigences en<br />
matière de services et d’équipements. D’<strong>au</strong>tre part, la<br />
production de biens publics ne reposant plus exclusivement<br />
et directement sur les seules municipalités, les<br />
craintes des édiles confrontés à une complexité croissante<br />
de l’administration locale et <strong>au</strong> respect des<br />
formes réglementaires de plus en plus contraignantes<br />
ne peuvent qu’être relativisées. Pourtant, la généralisa-<br />
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
Les Maires des petites communes face à l’intercommunalité<br />
<strong>Du</strong> <strong>dévouement</strong> <strong>villageois</strong><br />
<strong>au</strong> <strong>professionnalisme</strong> commun<strong>au</strong>taire<br />
tion de ce type de formule de coopération entre les<br />
communes est loin de faire l’unanimité parmi les élus<br />
municip<strong>au</strong>x. Les réticences de certains maires à l’égard<br />
de la coopération intercommunale à fiscalité propre<br />
peuvent se justifier par des facteurs strictement loc<strong>au</strong>x<br />
(ressources fiscales des communes). Mais le déplacement<br />
de l’élu non professionnel de la politique, de la<br />
sphère communale, espace maîtrisé sur le mode de la<br />
« familiarité », à l’espace intercommunal, doté de<br />
repères normés, formalisés et techniques, ne va pas de<br />
soi pour l’ensemble des élus. En effet, la fonction intercommunale<br />
à tous les nive<strong>au</strong>x que ce soient, caractérise<br />
la transition incontournable, difficilement vécue<br />
par bon nombre d’élus rur<strong>au</strong>x, d’un ethos du <strong>dévouement</strong><br />
vers un ethos de la compétence 5 .<br />
Des nouve<strong>au</strong>x dispositifs<br />
d’action publique à s’approprier<br />
Dessaisis des dossiers stratégiques qui sont désormais<br />
arbitrés <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> des arènes intercommunales, les<br />
maires doivent s’approprier de nouve<strong>au</strong>x dispositifs<br />
d’action publique et investir des scènes politiques<br />
inédites. Leur mode de fonctionnement peut déstabiliser<br />
les élus rur<strong>au</strong>x, qui n’étant pas dans leur immense<br />
majorité des professionnels de la représentation politique,<br />
se trouvent confrontés à la<br />
présence de nouve<strong>au</strong>x objets, mais<br />
<strong>au</strong>ssi de nouve<strong>au</strong>x savoir-faire et “<br />
savoir être <strong>au</strong>xquels ils n’étaient pas<br />
forcément préparés. En effet, la participation<br />
<strong>au</strong>x débats intercommun<strong>au</strong>x<br />
suppose de la part des agents une<br />
compétence politique. Les études<br />
menées en sociologie politique ont<br />
bien montré qu’il n’existait pas de<br />
connaissance infuse de la politique.<br />
La possibilité de participation, dans<br />
cette optique, relève principalement<br />
des dispositions sociales par lesquelles<br />
l’agent se sent subjectivement en mesure<br />
(aptitude) ou en droit (légitimité) de participer. Le processus<br />
intercommunal, comme tout processus politique,<br />
laisse place <strong>au</strong>x logiques de sélection et de dissuasion<br />
que D. Gaxie avait soulignées lorsqu’il<br />
recensait des conditions sociales de la politisation inst<strong>au</strong>rant<br />
un « cens caché ». Deux formes d’incompétence<br />
La fonction<br />
intercommunale à tous les<br />
nive<strong>au</strong>x que ce soient,<br />
caractérise la transition<br />
incontournable, difficilement<br />
vécue par bon nombre d’élus<br />
rur<strong>au</strong>x, d’un ethos du<br />
<strong>dévouement</strong> vers un ethos<br />
de la compétence. ”<br />
Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010 ◗ 43<br />
par<br />
SÉBASTIEN VIGNON<br />
Docteur en science politique<br />
Centre Universitaire de<br />
Recherches sur l’Action<br />
Publique et le Politique<br />
CURAPP, UMR 60-54 CNRS
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
Répartition des « non-réponses » <strong>au</strong>x questions relatives à la coopération intercommunale<br />
en fonction du diplôme des maires.<br />
Question posée : Parmi les princip<strong>au</strong>x obstacles à la coopération intercommunale généralement<br />
mis en avant, quel est d’après vous l’importance de ceux-ci ? 8<br />
semblables à celles dégagées par P. Bourdieu concernant<br />
l’incompétence politique, à savoir l’incompétence<br />
sociale et l’incompétence technique 6 , sont à distinguer.<br />
De l’incompétence sociale…<br />
D’une part, une incapacité à se mouvoir politiquement<br />
dans le jeu intercommunal 7 , c’est-à-dire à opérer<br />
une construction politique de l’espace intercommunal.<br />
Celle-ci se traduit par la maîtrise inégale des règles de<br />
fonctionnement et de transformation des structures<br />
intercommunales mais également des enjeux commun<strong>au</strong>taires.<br />
Les entretiens avec des élus rur<strong>au</strong>x, mais<br />
également les analyses statistiques opérées à partir<br />
d’une enquête par questionnaire réalisée <strong>au</strong>près des<br />
maires des petites communes (moins de 2 000 habitants)<br />
du département de la Somme, mettent en<br />
évidence le poids déterminant du nive<strong>au</strong> de diplôme<br />
dans la capacité des élus à se prononcer sur les enjeux<br />
politiques intercommun<strong>au</strong>x. Cette variable est d’ailleurs<br />
be<strong>au</strong>coup plus discriminante que l’ancienneté<br />
dans l’espace municipal dans la propension des maires<br />
à opiner.<br />
En effet, on sait que pour répondre « politiquement »<br />
à une question politique, il f<strong>au</strong>t d’abord se sentir<br />
capable socialement d’y répondre 9 , puis être en mesure<br />
de la percevoir et donc de la comprendre comme une<br />
question politique, et non la réinterpréter en fonction<br />
de principes mor<strong>au</strong>x relevant de l’ethos de classe.<br />
Enfin, une fois qu’elle est pensée en fonction de prin-<br />
44 ◗ Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010<br />
le souci de l'<strong>au</strong>tonomie de<br />
décision<br />
crainte d'un alourdissement des<br />
impôts loc<strong>au</strong>x<br />
le fait que les responsables<br />
intercommun<strong>au</strong>x ne soient pas<br />
élus <strong>au</strong> sud<br />
l'insuffisance des aides<br />
financières de l'Etat<br />
la crainte d'une politisation des<br />
structures intercommunales<br />
Diplôme inférieur <strong>au</strong> bac 19,9 16,6 27,1 25,4 18,8 100,0 (181)<br />
Bac + 3 et plus 7,5 7,5 13,2 13,0 9,4 100,0 (53)<br />
Source: enquête par questionnaire <strong>au</strong>près des maires des communes de moins de 2 000 habitants de la Somme (avril 2001).<br />
Total<br />
cipes politiques, il f<strong>au</strong>t disposer d’une compétence politique<br />
(ou technique) ou d’une « culture politique »,<br />
c’est-à-dire appliquer à cette question des catégories de<br />
perception proprement politiques, plus ou moins adéquates,<br />
plus ou moins raffinées, révélant une maîtrise<br />
plus ou moins fine des principes politiques structurant<br />
l’espace politique. Plus le nive<strong>au</strong> d’instruction<br />
<strong>au</strong>gmente, plus il y a maîtrise pratique des techniques<br />
générales de verbalisation et de conceptualisation et<br />
donc plus il y a de chances pour qu’un jugement<br />
s’énonce selon les formes linguistiques dominantes, et<br />
moins il y a « <strong>au</strong>tocensure » des agents soci<strong>au</strong>x.<br />
« - Et pensez-vous que les aides de l’Etat en<br />
matière d’intercommunalité sont suffisamment<br />
incitatives ou pas actuellement?<br />
Pfff, je ne sais pas vraiment en fait. Il f<strong>au</strong>drait<br />
que vous voyiez ça avec le président ou les gens<br />
du bure<strong>au</strong> peut-être. Mais moi euh.<br />
- Et que pensez-vous de la loi Chevènement ?<br />
[C’est difficile de savoir ce que cela va donner.<br />
Euh, c’est pas quelque chose que j’ai potassé. Je<br />
vois pas trop ce que tout ça va changer pour nous<br />
[…]. Les textes, les lois, et tout ça, c’est bien be<strong>au</strong><br />
mais bon c’est plus pour les politiques [sourire].<br />
Moi ce qui me plait c’est de bien gérer mon<br />
village et aider les gens […]. Après la commun<strong>au</strong>té<br />
de communes bon, c’est à un <strong>au</strong>tre nive<strong>au</strong><br />
de toute manière. C’est pas pareil. Moi je suis un<br />
maire de petite commune. Tout ça c’est com-
pliqué maintenant. C’est difficile à suivre. Ca<br />
prend pas mal de temps en plus. Moi je préfère<br />
m’occuper de mon village. Les gens peuvent<br />
compter sur moi. Je ne compte pas les efforts ni le<br />
temps pour mes administrés. Le village est<br />
propre, tout le monde le dit, on organise encore<br />
une fête de village l’été qui fait bouger les gens.<br />
- Et vous avez des contacts avec les personnels<br />
administratifs, vous vous y rendez souvent à la<br />
commun<strong>au</strong>té de communes pour les réunions?<br />
Ben disons que je connais pas tout le monde, moi<br />
je ne suis dans <strong>au</strong>cune commission. Je vais <strong>au</strong>x<br />
réunions de l’assemblée générale [conseil commun<strong>au</strong>taire],<br />
mais c’est tout, ça s’arrête là ».<br />
Maire d’une commune rurale (214 habitants),<br />
67 ans agriculteur retraité, CAP agricole.<br />
- D’<strong>au</strong>tre part, une incapacité à disposer des connaissances<br />
techniques (administratives, financières, juridiques,<br />
économiques) que requiert la participation <strong>au</strong>x<br />
débats commun<strong>au</strong>taires. L’échelle d’intervention étant<br />
élargie à de nombreuses communes et la coopération<br />
constituant désormais le principe de base des décisions<br />
et politiques commun<strong>au</strong>taires, s’imposent inéluctablement<br />
de nouve<strong>au</strong>x modes d’appréhension de l’action<br />
politique locale avec lesquels les édiles ne sont pas tous<br />
familiarisés. A l’instar de la « cité par projets » dépeinte<br />
par E. Chapiello et L. Boltanski 10 , le « principe supérieur<br />
commun » de la vie intercommunale privilégie effectivement<br />
l’aptitude à élaborer ou à s’intégrer dans une<br />
succession de projets. Dans cette « grammaire du territoire<br />
» 11 , les rapports légitimes entre les élus s’inscrivent<br />
dans une logique réticulaire de partenariat. Plus<br />
exactement, il s’agit d’établir des relations de confiance<br />
(« ouverture <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres », « ne pas rester limité à sa<br />
commune », « s’engager dans des grands projets collectifs<br />
» etc), de coordonner des compétences, de<br />
construire un consensus pour agir ensemble et assurer<br />
ainsi une plus grande cohérence dans les actions<br />
menées à l’échelle intercommunale, par exemple dans<br />
les domaines de l’habitat, des services à la population.<br />
L’émergence de nouvelles pratiques, qui consistent<br />
notamment à se prononcer sur des choix d’aménagement<br />
dans des communes <strong>au</strong>tres que la leur ou sur l’ensemble<br />
du territoire commun<strong>au</strong>taire tend à inst<strong>au</strong>rer<br />
une partition entre les maires qui représentent un<br />
contingent massif de délégués commun<strong>au</strong>taires mais<br />
qui ne possèdent pas tous une connaissance aigüe des<br />
rouages intercommun<strong>au</strong>x. Si les commissions (qui correspondent<br />
à un champ d’intervention publique de<br />
l’établissement intercommunal) permettent <strong>au</strong>x élus<br />
qui ont choisi d’y participer (ce qui n’est pas le cas de<br />
l’ensemble des représentants des municipalités) d’étudier<br />
les projets commun<strong>au</strong>taires, leur densité rend<br />
improbable un contrôle absolu des élus sur leur<br />
contenu. Cela d’<strong>au</strong>tant plus que les délégués les reçoivent<br />
dans la plupart des cas très peu de temps avant la<br />
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
réunion du conseil commun<strong>au</strong>taire où ces projets<br />
devront être soumis <strong>au</strong> vote. Les élus ne peuvent donc<br />
pas être toujours à l’affût des politiques intercommunales,<br />
et ce d’<strong>au</strong>tant plus qu’ils disposent de ressources<br />
politiques et sociales assez inégales pour s’informer sur<br />
celles-ci et participer activement <strong>au</strong>x prises de<br />
décision. Déconcertés face à la diversité des compétences<br />
exercées par la structure (« On s’y perd ! », « Ça<br />
nous dépasse » confient même certains), ces élus font<br />
état de leur difficulté à apprécier et à porter un avis<br />
éclairé sur les décisions et orientations commun<strong>au</strong>taires<br />
qui sont de plus en plus complexes et de surcroît<br />
à raisonner sur des budgets qui sont sans <strong>au</strong>cune<br />
mesure avec ceux qu’ils gèrent dans leurs communes.<br />
Pourtant très impliqués <strong>au</strong> sein de leur village et<br />
dévoués à leur collectivité (disponibilité, écoute,<br />
contacts, médiation), des édiles sont souvent réduits à<br />
se comporter en simples « spectateurs » lorsqu’ils<br />
évoluent dans les arènes intercommunales. Pour ces<br />
maires, l’intégration à une structure de coopération territoriale<br />
traduit effectivement le passage d’un modèle<br />
municipal caractérisé par une extrême personnalisation<br />
du pouvoir local à un système<br />
intercommunal strictement hiérarchisé<br />
dans lequel ils occupent les<br />
positions les plus dominées. Ne dis- “<br />
posant des éléments de connaissance<br />
nécessaires, ces élus se trouvent très<br />
souvent dépassés lorsqu’ils doivent<br />
se prononcer sur des dossiers et<br />
enjeux dépassant le cadre communal.<br />
Certains élus sont d’ailleurs découragés<br />
par le coût que nécessite l’engagement<br />
dans une institution sur<br />
laquelle ils n’ont que peu prise et qui<br />
leur semble alors d’<strong>au</strong>tant plus<br />
complexe à « domestiquer ». Ils vivent<br />
alors, en quelque sorte, en marge de<br />
la structure intercommunale et appréhendent par<br />
conséquent l’intercommunalité à fiscalité propre<br />
comme une démarche opaque et potentiellement pernicieuse.<br />
Puisque quand bien même ces maires décident<br />
de privilégier uniquement les questions liées <strong>au</strong>x<br />
intérêts de leur municipalité, savoir parler <strong>au</strong> nom de<br />
« leur » commune requiert une maîtrise du discours et<br />
des positions internes à l’espace intercommunal.<br />
Rompant avec la logique d’interconnaissance et les pratiques<br />
d’« arrangements » qui prévalent <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de<br />
leur village, elles supposent plus particulièrement une<br />
capacité à identifier rapidement les interlocuteurs, à<br />
décoder les sous-entendus du langage intercommunal,<br />
à saisir l’ambiance, à improviser et à trouver le ton juste<br />
pour répondre à une question ou une remarque inattendue.<br />
La négociation <strong>au</strong>tour de l’élaboration d’un<br />
projet à l’échelle du territoire commun<strong>au</strong>taire ou <strong>au</strong>tour<br />
de la défense des particularismes municip<strong>au</strong>x exige un<br />
ensemble de savoir-faire (techniques d’action) et savoir<br />
être (codes de conduite) caractéristiques de l’action<br />
politique intercommunale qui s’articule <strong>au</strong>tour du com-<br />
Pourtant très impliqués<br />
Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010 ◗ 45<br />
<strong>au</strong> sein de leur village et<br />
dévoués à leur collectivité<br />
(disponibilité, écoute,<br />
contacts, médiation), des<br />
édiles sont souvent réduits<br />
à se comporter en simples<br />
« spectateurs » lorsqu’ils<br />
évoluent dans les arènes<br />
intercommunales. ”
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
promis. Les délégués doivent faire preuve de retenue<br />
dans les gestes et dans les paroles afin de ne pas transgresser<br />
les modes particuliers de régulation des transactions<br />
politiques qui les caractérisent et qui sont<br />
guidées par la recherche permanente du<br />
« consensus » 12 . En cela, la maîtrise de soi est une<br />
qualité essentielle du « bon » élu intercommunal; les<br />
postures <strong>au</strong>toritaires étant risquées en séance publique<br />
dans le sens où elles prennent directement à contrepied<br />
les équilibres caractéristiques de l’espace13 . La<br />
participation active des différents élus <strong>au</strong> processus<br />
intercommunal, et plus encore <strong>au</strong>x pratiques de négociation,<br />
constitue un gage de prise en compte de leurs<br />
intérêts respectifs. Or, tous les élus des petites<br />
communes ne disposent pas de moyens ég<strong>au</strong>x pour le<br />
faire. Tous ne sont pas des familiers des arcanes et des<br />
enjeux de la négociation. Certains maires y sont bien<br />
préparés alors que d’<strong>au</strong>tres <strong>au</strong> contraire sont mal à<br />
l’aise sur cette nouvelle scène politique et ne savent pas<br />
s’y imposer ou s’en saisir. En fait, l’espace intercommunal<br />
tend à inst<strong>au</strong>rer un nouve<strong>au</strong> clivage entre ceux<br />
qui sont pourvus de cette compétence de la négociation<br />
et les <strong>au</strong>tres qui ne peuvent utiliser<br />
cette dernière pour faire progresser les<br />
“ intérêts commun<strong>au</strong>x <strong>au</strong> sein de l’institution<br />
intercommunale. Cette compétence<br />
implique une maîtrise de l’information<br />
commun<strong>au</strong>taire, et plus encore<br />
un travail politique d’objectivation et<br />
de mise en forme des intérêts qu’il<br />
convient d’inscrire dans les discussions<br />
intercommunales. Cela passe par<br />
tout un travail préalable de prise de<br />
conscience, de mise en forme et d’expression<br />
de ces intérêts. La capacité à<br />
évoluer avec aisance dans le jeu intercommunal,<br />
à appréhender ses enjeux, à maîtriser les<br />
interactions complexes produites par des chaînes d’interdépendances<br />
toujours plus longues (notamment en<br />
raison de la multiplicité des « acteurs » qui y interviennent),<br />
l’art du placement qu’elles requièrent pour y<br />
faire prévaloir ses vues et ses intérêts d’élus, ne se distribuent<br />
pas socialement <strong>au</strong> hasard. Ceux qui sont<br />
pourvus de ces compétences, grâce à leur participation<br />
très active dans les commissions, ou leur présence <strong>au</strong><br />
bure<strong>au</strong> lorsque ce dernier est ouvert <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres élus<br />
que les seuls président et vice-présidents, peuvent<br />
acquérir progressivement une position privilégiée dans<br />
le processus de redistribution des ressources politiques<br />
commun<strong>au</strong>taires. Voilà pourquoi ces maires tendent<br />
alors à délaisser plus aisément le discours traditionnel<br />
de la défense des communes, pour se faire les chantres<br />
d’une approche plus syncrétique en tentant de réconcilier<br />
l’affirmation des prérogatives de l’institution intercommunale<br />
et le respect des prérogatives communales.<br />
Les dispositions et les valeurs promues par la réorganisation<br />
de la coopération intercommunale sont moins<br />
celles du « <strong>dévouement</strong> », qui prév<strong>au</strong>t encore sur le<br />
terrain communal, que la compétence et l’efficacité.<br />
L’avènement de nouvelles<br />
formes d’intercommunalité<br />
contribuent très nettement<br />
<strong>au</strong> renouvellement des formes<br />
traditionnelles d’action<br />
politique <strong>au</strong> sein des<br />
territoires rur<strong>au</strong>x et à la<br />
transformation du personnel<br />
politique local. ”<br />
46 ◗ Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010<br />
Cette tendance est d’ailleurs confirmée par les mécanismes<br />
de recrutement socio-politique très sélectifs qui<br />
caractérisent l’accès <strong>au</strong> sommet de la pyramide élective<br />
commun<strong>au</strong>taire (présidents / vice-présidents des EPCI à<br />
fiscalité propre).<br />
Intercommunalité et redéfinition<br />
des normes d’éligibilité locale<br />
L’extension des prérogatives des groupements à fiscalité<br />
propre et leur volonté de mener des actions politiques<br />
locales d’envergure sur des territoires sans cesse<br />
élargis a accru les responsabilités des élus loc<strong>au</strong>x et a<br />
par conséquent complexifié la gestion des affaires<br />
intercommunales. Cette emprise croissante de l’intercommunalité<br />
de projet a eu pour effet de bouleverser la<br />
hiérarchie des qualités et des compétences légitimes<br />
nécessaires à l’exercice d’une fonction de « bonne gouvernance<br />
locale ». La « notabilité » locale (« l’ancienneté<br />
» et la « reconnaissance » dans l’espace politique<br />
local ou /et l’ancrage territorial) est une qualité qui ne<br />
(se) suffit plus pour exister politiquement 14 , y compris<br />
dans les structures les plus excentrées des grandes<br />
agglomérations. Peu importe finalement que les élus<br />
soient « du coin » 15 ou non, pourvu qu’ils détiennent les<br />
compétences requises pour assurer le fonctionnement<br />
et le rayonnement des EPCI. La logique qui structure<br />
désormais le processus de désignation des exécutifs<br />
intercommun<strong>au</strong>x repose effectivement davantage sur la<br />
détention des ressources rares nécessaires à la maîtrise<br />
du jeu intercommunal. En cela, l’avènement de nouvelles<br />
formes d’intercommunalité (commun<strong>au</strong>tés de<br />
communes, commun<strong>au</strong>tés d’agglomération) contribuent<br />
très nettement <strong>au</strong> renouvellement des formes traditionnelles<br />
d’action politique <strong>au</strong> sein des territoires<br />
rur<strong>au</strong>x et à la transformation du personnel politique<br />
local 16 .<br />
La « professionnalisation »<br />
des savoir-faire politiques<br />
intercommun<strong>au</strong>x<br />
Sur la base d’une technicisation du travail intercommunal,<br />
la légitimité élective cède progressivement le<br />
pas à une légitimité technique; la compétence devenant<br />
une qualité incontournable. Les élus placés sur le<br />
devant de la scène intercommunale doivent désormais<br />
être en mesure de projeter et de réguler l’action<br />
publique locale sur le moyen et long terme, tout en<br />
contrôlant l’avancée effective des dossiers qu’ils élaborent<br />
à court terme en commission, et que met en œuvre<br />
le personnel administratif. Les compétences attendues<br />
des élus placés à la tête des EPCI à fiscalité propre (présidence<br />
et vice-présidences) sont généralement récurrentes<br />
et peuvent se décliner ainsi: connaissances techniques<br />
des dossiers, expérience « managériale » et<br />
maîtrise des jeux de la « diplomatie » intercommunale.<br />
D’abord, relevant de plus en plus des problématiques<br />
de développement local, l’action intercommunale
impose inévitablement une connaissance du langage et<br />
du jargon de ses spécialistes et experts, ainsi qu’une<br />
familiarité avec les enjeux sectoriels des politiques<br />
publiques (développement économique, culture,<br />
logement, environnement etc.). Ensuite, l’organisation<br />
par projets étant la caractéristique principale de<br />
l’action commun<strong>au</strong>taire, le rapprochement avec les<br />
valeurs du management (« motivation », « implication »,<br />
« rése<strong>au</strong>x » etc.) et du monde l’entreprise (« efficacité »,<br />
« rentabilité ») contribue à la redéfinition des compétences<br />
et des pratiques légitimes dans l’espace politique<br />
local. Enfin, reposant sur la définition d’arbitrages<br />
entre les communes, qui sous-tend des<br />
transactions permanentes entre les protagonistes et des<br />
stratégies de négociation subtiles, l’espace intercommunal<br />
privilégie les élus qui sont capables d’allier la<br />
sophistication des argumentaires déployés (qui<br />
suppose bien sûr une connaissance approfondie des<br />
dossiers intercommun<strong>au</strong>x dont on a la charge) et le<br />
sens aigu de l’euphémisme qu’impose la recherche de<br />
points d’équilibre. Le savoir-faire des dirigeants intercommun<strong>au</strong>x<br />
se fonde ainsi sur leur capacité d’enrôlement<br />
et d’animation qui permet de construire une solidarité<br />
politique <strong>au</strong>tour des formes du bien public à<br />
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
Le déplacement de l’élu non professionnel de la politique, de la sphère communale, espace maîtrisé sur le mode de la « familiarité », à l’espace intercommunal,<br />
doté de repères normés, formalisés et techniques, ne va pas de soi pour l’ensemble des élus. En effet, la fonction intercommunale à tous les nive<strong>au</strong>x que ce soient,<br />
caractérise la transition incontournable, difficilement vécue par bon nombre d’élus rur<strong>au</strong>x, d’un ethos du <strong>dévouement</strong> vers un ethos de la compétence 5 .<br />
venir. C’est en cela <strong>au</strong>ssi que la posture de l’expert,<br />
souvent nécessaire parce qu’elle confère <strong>au</strong>torité et<br />
crédit, ne peut se suffire à elle-même lorsqu’il s’agit<br />
d’exercer et de tenir des positions de leadership ou<br />
d’animation et qu’elle ne produit de plein effet que<br />
lorsqu’elle se double de celle du diplomate. Pour<br />
garantir la progression des projets et la légitimité<br />
démocratique des orientations définies pour le territoire,<br />
les leaders intercommun<strong>au</strong>x doivent nécessairement<br />
sensibiliser, coordonner et motiver leurs pairs<br />
pour obtenir leur coopération et leur soutien en<br />
trouvant des arguments dotés d’un<br />
degré d’universalité suffisant pour<br />
fédérer les participants. En faisant la “ démonstration de leur aptitude à<br />
impulser et à mettre en œuvre des<br />
projets (raisonnables et mesurés) et à<br />
tenir compte des points de vue des<br />
municipalités représentées, ils apparaissent<br />
comme les mieux disposés à<br />
garantir la cohésion de l’édifice commun<strong>au</strong>taire <strong>au</strong>x<br />
yeux de leurs « pairs », mais également <strong>au</strong>près des personnels<br />
administratifs de l’institution.<br />
Bien évidemment, il est possible d’affirmer que cette<br />
L’espace intercommunal<br />
Crédit photo : wikimedia commons<br />
Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010 ◗ 47<br />
privilégie les élus qui sont<br />
capables d’allier la<br />
sophistication des<br />
argumentaires déployés. ”
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
légitimation « managériale » des élus par l’expertise<br />
n’est pas spécifique <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> intercommunal et que<br />
les maires peuvent très bien concevoir leur action<br />
municipale et leur rôle de premier magistrat à partir du<br />
même registre17 . Toutefois, les budgets et les compétences<br />
de plus en plus limités des communes – <strong>au</strong><br />
profit des instances intercommunales – la rendent<br />
moins évidente. L’espace intercommunal permet de<br />
disposer de moyens d’action financiers<br />
et humains, d’une équipe administrative<br />
professionnalisée (chargés de<br />
mission, secrétaires génér<strong>au</strong>x, directeurs<br />
des services…) et d’élus spécialisés<br />
travaillant en commissions qui<br />
sont <strong>au</strong> cœur du « savoir-faire intercommunal<br />
» qui ne peut être le fait<br />
d’un seul (comme très souvent le maire<br />
dans sa commune rurale) mais une<br />
« petite entreprise en nom collectif »,<br />
seule à même traiter des dossiers complexes.<br />
Les élus municip<strong>au</strong>x qui<br />
détiennent un domaine d’expertise « se<br />
font (rapidement) un nom » et par conséquent sont les<br />
plus à même d’acquérir un crédit politique <strong>au</strong> sein de<br />
cette nouvelle sphère d’action publique locale. Pour<br />
faire face <strong>au</strong>x attributions qui leur sont déléguées, les<br />
vice-présidents doivent mobiliser des connaissances<br />
techniques be<strong>au</strong>coup plus importantes que celles que<br />
nécessite l’administration municipale, et se consacrer<br />
plus assidûment <strong>au</strong>x projets d’envergure pour le territoire<br />
qu’ils portent, pour les faire aboutir à temps. En<br />
privilégiant certaines propriétés individuelles spécifiques,<br />
la sélection des membres des exécutifs commun<strong>au</strong>taires<br />
participe donc d’une homogénéisation sociologique<br />
du personnel politique qui, en retour, s’accorde<br />
plus facilement sur l’importance de la compétence technique.<br />
Sa prim<strong>au</strong>té est d’<strong>au</strong>tant plus prégnante et<br />
mieux acceptée dans ces arènes qu’il s’agit d’élus du<br />
second degré, désignés par leurs pairs18 “<br />
.<br />
La réorganisation de la<br />
coopération intercommunale<br />
dans les espaces rur<strong>au</strong>x<br />
inst<strong>au</strong>re une redéfinition de<br />
la hiérarchie symbolique des<br />
ressources politiques<br />
nécessaires à l’exercice du<br />
« métier » d’élu local. ”<br />
L’inst<strong>au</strong>ration d’un double<br />
« cens caché » intercommunal<br />
La prise en charge d’actions publiques locales d’envergure<br />
se caractérise, même pour les « petits » élus<br />
rur<strong>au</strong>x, par la revendication d’une légitimité fondée sur<br />
le « savoir-faire professionnel » <strong>au</strong> point que les postes<br />
les plus prestigieux des institutions intercommunales<br />
(présidents / vice-présidents) sont tendanciellement<br />
monopolisés par des élus qui sont de moins en moins<br />
représentatifs socialement de ceux qu’ils sont censés<br />
représenter. Si les élus retenus à l’issue de l’élection<br />
des maires présentent déjà une image déformée de la<br />
réalité sociologique, la distorsion s’accentue <strong>au</strong><br />
nouve<strong>au</strong> de la désignation des exécutifs. La différenciation<br />
des critères de sélection sociale qui prévalent<br />
d’une sphère politique (municipale) à l’<strong>au</strong>tre (intercommunale)<br />
traduit le fossé qui se creuse progressivement<br />
entre les porteurs de projet et ceux à qui ils<br />
48 ◗ Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010<br />
doivent bénéficier. Ainsi, l’appartenance <strong>au</strong>x catégories<br />
socialement dominantes constitue une ressource déterminante<br />
pour conquérir les échelons hiérarchiques<br />
supérieurs de l’édifice intercommunal. Les EPCI à fiscalité<br />
propre, par la technicité relative de leurs domaines<br />
d’intervention, tendent à valoriser plus fortement que<br />
les <strong>au</strong>tres institutions intercommunales (sivom, sivu)<br />
les dispositions intellectuelles et / ou l’expérience professionnelle<br />
de certains maires qui leur permettent de<br />
maîtriser mieux que d’<strong>au</strong>tres la complexité d’un<br />
secteur d’intervention. Dans certains cas, les savoirfaire<br />
professionnels d’élus, déjà très valorisés <strong>au</strong> sein<br />
de leur village, sont d’ailleurs si adaptés <strong>au</strong>x aptitudes<br />
exigées par ce nouvel espace politique que certains<br />
apparaissent, et se sentent légitimes en vertu de cellesci,<br />
comme les seuls à pouvoir contrôler le processus<br />
intercommunal.<br />
Loin de s’estomper, les logiques « censitaires » du<br />
pouvoir intercommunal tendent à se raffermir à mesure<br />
que les structures gagnent en visibilité et en surface<br />
décisionnelle. La surreprésentation des cadres et professions<br />
intellectuelles supérieures s’accélère assez<br />
nettement. A la veille du renouvellement de 2008,<br />
31,6 % des maires rur<strong>au</strong>x et périurbains présidents et<br />
vice-présidents des commun<strong>au</strong>tés de la Somme sont<br />
des cadres ou des professions intellectuelles supérieures.<br />
Leur part à la direction des EPCI enregistre une<br />
progression supérieure à 10 points: 42 % des responsables<br />
de ces structures sont issus de cette catégorie<br />
contre 24 % des maires (ré)élus dans les communes<br />
rurales à l’issue du scrutin municipal. Les ouvriers et<br />
les employés d’une part – alors qu’ils sont pourtant un<br />
peu plus nombreux à figurer à la tête des conseils<br />
municip<strong>au</strong>x à l’issue des élections municipales de<br />
2008 19 – et les agriculteurs – dont le poids numérique<br />
parmi les maires ne cesse de s’affaiblir – d’<strong>au</strong>tre part,<br />
sont les grands « perdants » des dernières élections<br />
intercommunales. Précisons que les agriculteurs<br />
portant les dossiers stratégiques des EPCI possèdent<br />
des propriétés sociopolitiques spécifiques. Ce sont ceux<br />
qui sont placés à la tête des plus grosses exploitations<br />
et les plus diplômés ou ceux qui, malgré leur origine<br />
populaire et /ou leur faible capital scolaire, ont pu faire<br />
grâce à leur activisme <strong>au</strong> sein des organisations professionnelles<br />
agricoles (syndicats, chambres d’agriculture),<br />
l’apprentissage des discours (valorisation du<br />
projet, de l’ « ouverture » sur l’extérieur etc.) et des pratiques<br />
liées à l’aménagement du territoire et <strong>au</strong> développement<br />
local (animation de commissions de<br />
réflexion / groupes de travail, négociation avec de<br />
nombreux acteurs professionnels loc<strong>au</strong>x, mise en<br />
forme de projets, savoir-faire managéri<strong>au</strong>x etc.) qui<br />
tiennent les rênes des groupements à fiscalité propre.<br />
Comme on peut le constater, la réorganisation de la<br />
coopération intercommunale dans les espaces rur<strong>au</strong>x<br />
inst<strong>au</strong>re une redéfinition de la hiérarchie symbolique<br />
des ressources politiques nécessaires à l’exercice du
« métier » d’élu local. Même si le processus n’est pas<br />
achevé, la recomposition du paysage politico-institutionnel<br />
<strong>au</strong> sein des espaces rur<strong>au</strong>x provoque des changements<br />
dans les modes d’administration et de gouvernement<br />
qui se traduisent par la spécialisation des<br />
activités de l’élu local, une professionnalisation progressive<br />
des connaissances et des savoir-faire nécessaires<br />
pour l’administration des instances intercommunales.<br />
Les critères de la « bonne » gestion ont ainsi<br />
considérablement évolué par rapport <strong>au</strong>x petites<br />
___________________<br />
Nouve<strong>au</strong>x territoires<br />
communes. Les politiques d’aménagement et de développement<br />
local tendent à inst<strong>au</strong>rer une « démocratie<br />
d’expertise » 20 sur la base de compétences techniques<br />
qui privilégient une catégorie d’élus: ceux qui peuvent<br />
se prévaloir d’assurer le management d’enjeux socioéconomiques<br />
dépassant le cadre d’action strictement<br />
communal et peuvent contribuer à la professionnalisation<br />
de l’action publique.<br />
1 Ribot (C.), « L’<strong>au</strong>tonomie institutionnelle des établissements publics de coopération intercommunale » in Le Saout (R.) (dir.), L’intercommunalité. Logiques nationales<br />
et enjeux loc<strong>au</strong>x, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1997.<br />
2 Gaxie (D.), « Stratégies et institutions de l’intercommunalité » in Rangeon (F.) (dir.), L’intercommunalité. Bilans et perspectives, Paris, Presses Universitaires de<br />
France, 1997.<br />
3 Le Saout (R.), Madoré (F.) (dir.), Les effets de l’intercommunalité, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004.<br />
4 La loi du 13 août 2004 relative <strong>au</strong>x libertés et responsabilités locales conforte le rôle de ces EPCI <strong>au</strong> plan local en leur donnant notamment la possibilité d’exercer<br />
certains pouvoirs de police traditionnellement réservés <strong>au</strong>x maires et certaines compétences des départements et des régions, voire de l’Etat.<br />
5 Retière (J.-N.), « Etre sapeur-pompier volontaire. <strong>Du</strong> <strong>dévouement</strong> à la compétence » Genèses, 16, juin 1994.<br />
6 Bourdieu (P.)., La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.<br />
7 Gaxie (D.), Le cens caché, Paris, Seuil, 1978, pp. 71-82.<br />
8 Les modalités de réponses proposées <strong>au</strong>x maires étaient les suivantes : « très important », « important », « peu important ».<br />
9 Ceux qui se sentent le plus incapables subjectivement de répondre à une question politique sont ceux qui alimentent les non-réponses dans les sondages d’opi-<br />
nion ; les abstentionnistes dans le cas du vote.<br />
10 Boltanski (L.), Chapiello (E.), Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.<br />
11 Ségas (S.), La grammaire du territoire : action publique de développement et lutte politique dans les Pays, thèse de science politique, Université Montesquieu,<br />
Borde<strong>au</strong>x IV, 2004.<br />
12 Desage (F.), Le « consensus » commun<strong>au</strong>taire contre l’intégration intercommunale, thèse de doctorat en science politique, Université Lille 2, 2005.<br />
13 Elias (N.), La civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy, Presses Pocket, 1991, [1re éd. 1969] ; Elias (N.), La dynamique de l’occident, Paris, Calmann-Lévy,<br />
Presses Pocket, 1990 [1re éd. 1969].<br />
14 En 2001, dans le département de la Somme, près de la moitié (48 %) des maires présidents/vice-présidents (n= 63) ont été élus à ce poste la première fois en<br />
ayant moins de 12 ans d’expérience municipale (mandat de conseiller municipal inclus), ce qui est relativement faible dans des espaces où le « cursus-honorum »<br />
municipal reste une modalité fréquente.<br />
15 Rénahy (N.), Les gars du coin. Enquête sur une jeunesse rurale, Paris, La Découverte, 2005.<br />
16 Pour une mise en perspective quantitative et diachronique de ce phénomène de sursélection sociale, on se permet de renvoyer à Vignon (S.), Des maires en<br />
campagne. Les logiques de (re)construction d’un rôle politique spécifique, thèse de doctorat en science politique, Université de Picardie Jules Verne, 2009.<br />
17 F<strong>au</strong>re (A.), Le village et la politique. Essai sur les maires rur<strong>au</strong>x en action, Paris, L’Harmattan, 1992.<br />
18 Le Saout (R.), « De l’<strong>au</strong>tonomie fonctionnelle à l’<strong>au</strong>tonomie politique. La question de l’élection des délégués des établissements intercommun<strong>au</strong>x », Actes de la<br />
recherche en sciences sociales, n° 140, 2001 ; Guéranger (D.), « L’intercommunalité, créature de l’Etat. Analyse sociohistorique de la coopération intercommunale.<br />
Le cas du bassin chambérien, Revue Française de Science Politique, vol. 58, 2008 / 4.<br />
19 A peine 1 % des présidents et vice-présidents des groupements à fiscalité propre « rur<strong>au</strong>x » et « périurbains » de la Somme appartiennent <strong>au</strong>(x) monde(s) ouvriers<br />
en 2008.<br />
20 Vignon (S.), « Les élus rur<strong>au</strong>x face à la démocratie d’expertise intercommunale. Les “semi-professionnels” de la politique locale » in Barone (S.), Troupel (A.) (dir.),<br />
Les élections locales en milieu rural, Paris, L’Harmattan, 2010 (à paraître).<br />
S.V.<br />
Pouvoirs Loc<strong>au</strong>x N° 84 I/2010 ◗ 49