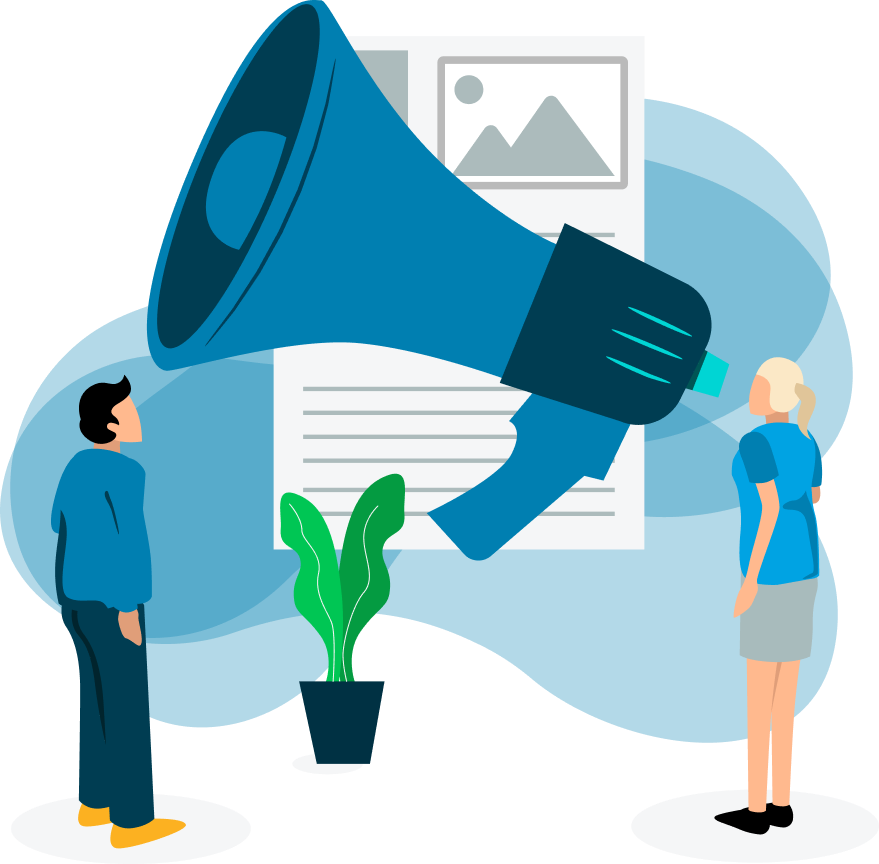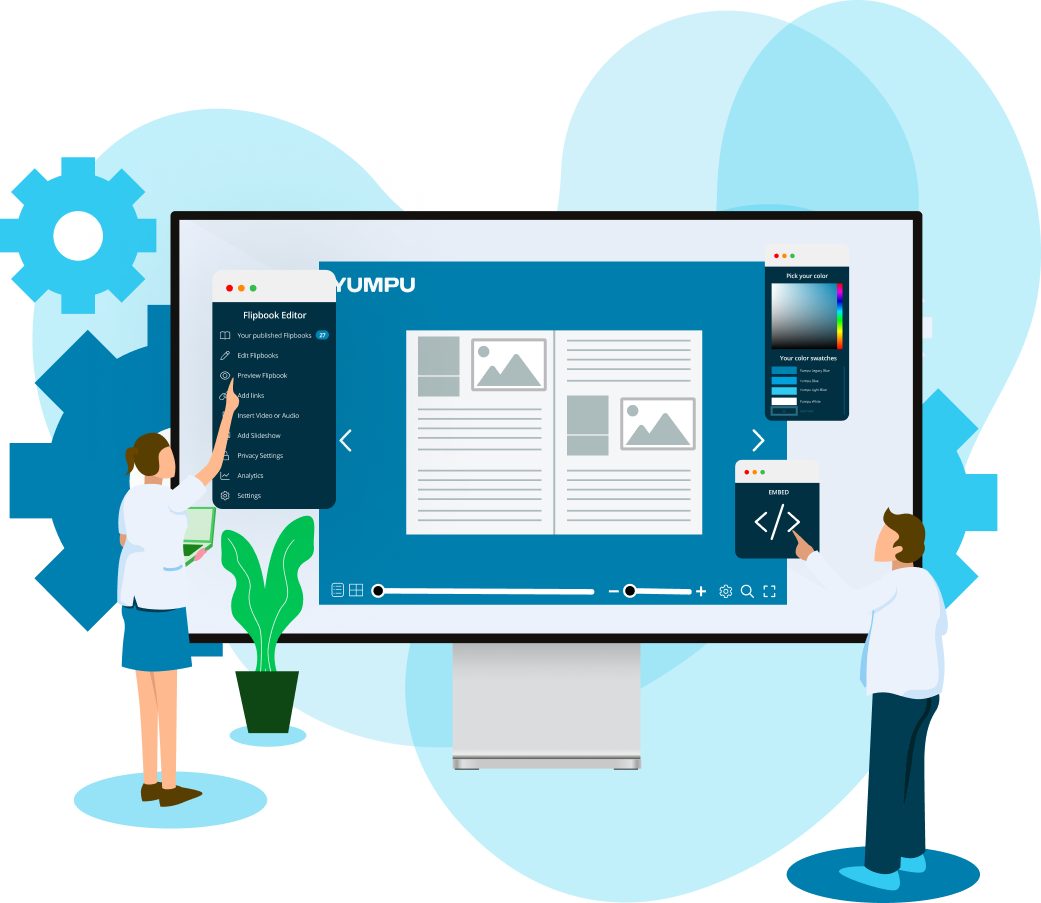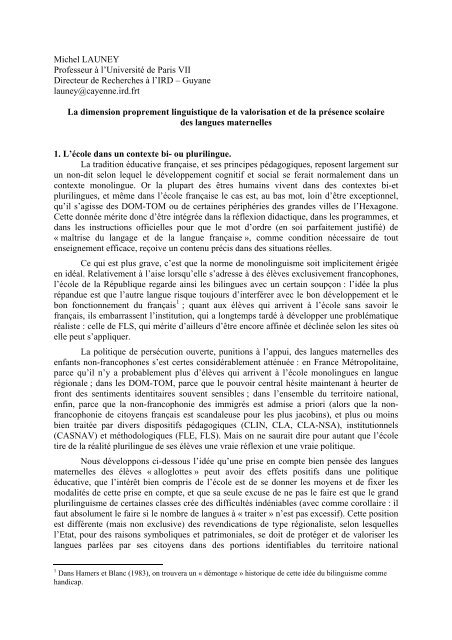Michel LAUNEY
Michel LAUNEY
Michel LAUNEY
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Michel</strong> <strong>LAUNEY</strong><br />
Professeur à l’Université de Paris VII<br />
Directeur de Recherches à l’IRD – Guyane<br />
launey@cayenne.ird.frt<br />
La dimension proprement linguistique de la valorisation et de la présence scolaire<br />
des langues maternelles<br />
1. L’école dans un contexte bi- ou plurilingue.<br />
La tradition éducative française, et ses principes pédagogiques, reposent largement sur<br />
un non-dit selon lequel le développement cognitif et social se ferait normalement dans un<br />
contexte monolingue. Or la plupart des êtres humains vivent dans des contextes bi-et<br />
plurilingues, et même dans l’école française le cas est, au bas mot, loin d’être exceptionnel,<br />
qu’il s’agisse des DOM-TOM ou de certaines périphéries des grandes villes de l’Hexagone.<br />
Cette donnée mérite donc d’être intégrée dans la réflexion didactique, dans les programmes, et<br />
dans les instructions officielles pour que le mot d’ordre (en soi parfaitement justifié) de<br />
« maîtrise du langage et de la langue française », comme condition nécessaire de tout<br />
enseignement efficace, reçoive un contenu précis dans des situations réelles.<br />
Ce qui est plus grave, c’est que la norme de monolinguisme soit implicitement érigée<br />
en idéal. Relativement à l’aise lorsqu’elle s’adresse à des élèves exclusivement francophones,<br />
l’école de la République regarde ainsi les bilingues avec un certain soupçon : l’idée la plus<br />
répandue est que l’autre langue risque toujours d’interférer avec le bon développement et le<br />
bon fonctionnement du français 1 ; quant aux élèves qui arrivent à l’école sans savoir le<br />
français, ils embarrassent l’institution, qui a longtemps tardé à développer une problématique<br />
réaliste : celle de FLS, qui mérite d’ailleurs d’être encore affinée et déclinée selon les sites où<br />
elle peut s’appliquer.<br />
La politique de persécution ouverte, punitions à l’appui, des langues maternelles des<br />
enfants non-francophones s’est certes considérablement atténuée : en France Métropolitaine,<br />
parce qu’il n’y a probablement plus d’élèves qui arrivent à l’école monolingues en langue<br />
régionale ; dans les DOM-TOM, parce que le pouvoir central hésite maintenant à heurter de<br />
front des sentiments identitaires souvent sensibles ; dans l’ensemble du territoire national,<br />
enfin, parce que la non-francophonie des immigrés est admise a priori (alors que la nonfrancophonie<br />
de citoyens français est scandaleuse pour les plus jacobins), et plus ou moins<br />
bien traitée par divers dispositifs pédagogiques (CLIN, CLA, CLA-NSA), institutionnels<br />
(CASNAV) et méthodologiques (FLE, FLS). Mais on ne saurait dire pour autant que l’école<br />
tire de la réalité plurilingue de ses élèves une vraie réflexion et une vraie politique.<br />
Nous développons ci-dessous l’idée qu’une prise en compte bien pensée des langues<br />
maternelles des élèves « alloglottes » peut avoir des effets positifs dans une politique<br />
éducative, que l’intérêt bien compris de l’école est de se donner les moyens et de fixer les<br />
modalités de cette prise en compte, et que sa seule excuse de ne pas le faire est que le grand<br />
plurilinguisme de certaines classes crée des difficultés indéniables (avec comme corollaire : il<br />
faut absolument le faire si le nombre de langues à « traiter » n’est pas excessif). Cette position<br />
est différente (mais non exclusive) des revendications de type régionaliste, selon lesquelles<br />
l’Etat, pour des raisons symboliques et patrimoniales, se doit de protéger et de valoriser les<br />
langues parlées par ses citoyens dans des portions identifiables du territoire national<br />
1<br />
Dans Hamers et Blanc (1983), on trouvera un « démontage » historique de cette idée du bilinguisme comme<br />
handicap.
(problématique des langues régionales, dont les cadres de référence sont la loi Deixonne de<br />
1951, la Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires, et le rapport de<br />
Cerquiglini de 1999 sur les « langues de France »).<br />
Sous des formes diverses selon les régions et selon leur militantisme, de nombreux<br />
mouvements revendicatifs demandent en effet une présence ou une meilleure présence des<br />
langues régionales dans la société et dans l’école, tandis que l’institution met en avant la<br />
« maîtrise du langage et de la langue française » comme objectif fondamental conditionnant<br />
l’ensemble de l’accès aux connaissances. On a ainsi deux objectifs à première vue<br />
antagonistes, avec des soupçons réciproques : les uns se complairaient dans des<br />
particularismes identitaires, les autres imposeraient de manière arrogante une langue, mais<br />
aussi des principes et des modèles venus d’ailleurs. Nous suggérons ici que cet antagonisme<br />
peut être dépassé, voire qu’on peut ne pas arriver à une position antagonique, à condition de<br />
prendre toute la mesure de ce que, dans un contexte bi- ou plurilingue, peut signifier<br />
« maîtrise du langage et de la langue française », à savoir : d’une part, en adoptant un point de<br />
vue ouvert et réaliste sur le bi- et plurilinguisme, et d’autre part, en prenant les langues pour<br />
ce qu’elles sont.<br />
2. Trois dimensions de la langue.<br />
Si, dans une enquête de type micro-trottoir, on demande à brûle-pourpoint à quelqu’un<br />
ce qu’est une langue, il y a de fortes chances pour que la réponse très majoritaire soit :<br />
Une langue est un instrument de communication<br />
Si la personne questionnée milite dans une association culturelle, ou si elle a fait des<br />
études d’anthropologie, une autre réponse pourra être :<br />
Une langue est le véhicule d’une culture.<br />
Ces réponses ne constituent pas des définitions de ce qu’est une langue. Tout au plus<br />
en mettent-elles en évidence une dimension. Voyons rapidement leur sens et leurs limites,<br />
avant d’insister sur une autre dimension moins reconnue.<br />
Instrument de communication. Sous des dehors d’évidence, cette caractérisation<br />
constitue en fait une conception très pauvre de la réalité de la langue. D’abord parce qu’un<br />
instrument n’est pas intéressant en tant que tel : il ne vaut que par ce qu’il permet de réaliser.<br />
Une voiture est un instrument de déplacement, et, sauf si je suis mécanicien de profession ou<br />
collectionneur acharné, je lui demande avant tout de me permettre des déplacements rapides,<br />
sûrs et confortables, et je peux me passer de savoir ce qui se passe exactement sous le capot.<br />
Ensuite, parce que si c’est donc la communication qui est le point intéressant de la langue, elle<br />
peut prendre tellement de formes que si tout usage de la langue entre deux ou plusieurs êtres<br />
humains est communication, on tend vers une définition tautologique de type la langue est ce<br />
qui permet de faire usage de la langue…. Et on se prive de toute compréhension, d’une part<br />
du fonctionnement de la langue elle-même (sa grammaire, sa phonologie…), d’autre part de<br />
ce qui, à volonté de communiquer égale, constitue la difficulté pour un être humain de<br />
reconstruire dans l’apprentissage d’une langue seconde les compétences langagières acquises<br />
lors de l’acquisition de sa langue première.<br />
Véhicule d’une culture. Cette formule a elle aussi des allures d’évidence intouchable,<br />
et la notion de culture peut ici être comprise dans le sens littéraire et esthétique (un ensemble<br />
d’œuvres prestigieuses dont la connaissance permet de dire d’une personne qu’elle est<br />
cultivée), ou dans le sens anthropologique (un ensemble de références partagées incluant des<br />
savoirs, des savoir-faire, des lieux, des valeurs, des croyances, une organisation sociale, une<br />
mémoire collective…) : dans le premier sens, cela revient à dire que la littérature ou la
philosophie ont plus de valeur que la grammaire, et dans le second sens, que l’anthropologie<br />
est supérieure à la linguistique. Cette conception de la langue est souvent utilisée dans une<br />
volonté affichée d’« élévation du débat », dans laquelle une nouvelle fois la langue a moins<br />
d’intérêt que ce dont elle est le véhicule. Mais elle comporte un double risque : celui de<br />
surinvestir la langue de valeurs identitaires, morales ou politiques, en lui associant des<br />
prédicats qui ne s’appliquent pas à une langue en tant que telle 2 , et celui de la réduire à un<br />
ensemble de concepts souvent intraduisibles constitutifs d’une authenticité culturelle 3 , en ne<br />
retenant de la langue que son lexique. Or le lexique est indiscutablement le produit d’une<br />
activité collective de conceptualisation, mais il ne représente qu’une partie du fonctionnement<br />
de la langue, et c’est en associant ces concepts, à travers les mots dont ils sont les signifiés,<br />
autrement dit, en construisant des énoncés, que la langue donne du sens au monde. Ceci veut<br />
dire que l’activité significative apparaît aussi et surtout à travers les catégories grammaticales<br />
(genre, nombre, détermination, personne, temps, aspect, mode…) d’une part, à travers la<br />
syntaxe d’autre part. On peut en tirer, dans une perspective proprement linguistique, des<br />
propositions telles que :<br />
- Une langue est l’une des manifestations du langage humain, qui est une activité<br />
significative<br />
- Une langue est une construction mentale, un univers intellectuel…<br />
- Une langue est un produit de l’esprit humain….<br />
Ces propositions représentent une approche plus riche que les précédentes : elles<br />
suggèrent d’abord que c’est par elles-mêmes, et non en tant qu’instruments, que les langues<br />
ont de l’intérêt. Et si on s’y tient, elles ouvrent sur des perspectives très intéressantes en<br />
termes de légitimité de certaines revendications, d’efficacité pédagogique, de stimulation<br />
intellectuelle, et d’incitation au respect mutuel.<br />
3. La langue comme construction intellectuelle : conséquences.<br />
3.1. La diversité linguistique comme patrimoine de l’humanité.<br />
Si toute langue est un produit de l’esprit humain, les revendications identitaires<br />
peuvent s’orienter vers une perspective patrimoniale décrispée et non exclusive. Une langue<br />
vaut bien une cathédrale, un château, une épopée, une symphonie, une théorie<br />
philosophique… Ceci veut dire en particulier que toute langue a droit à être valorisée (on ne<br />
joue pas Chartres contre Bourges, Versailles contre Chambord, l’Odyssée contre Gilgamesh,<br />
ou Mahler contre Beethoven…), mais aussi et surtout que vouloir éradiquer une langue est<br />
une forme de vandalisme, et que l’absence de toute politique de préservation ou de<br />
valorisation ressemble à ce qui se passe quand on laisse un monument tomber en ruine. Il<br />
incombe donc aux Etats nationaux de se donner les moyens de préserver ce patrimoine en<br />
donnant à l’ensemble des langues parlées par leurs citoyens (y compris bien sûr la langue<br />
nationale officielle, mais pas seulement celle-là) les moyens de continuer à vivre en tant que<br />
2 La formule célèbre de Barthes « La langue est fasciste » est de ce type. Elle a donné lieu à un essai par ailleurs<br />
remarquablement documenté d’Hélène Merlin-Kajman (La langue est-elle fasciste ?, Ed. du Seuil 2003) dans<br />
lequel l’auteur, s’inscrivant en faux contre l’assertion de Barthes, s’appuie en fait non sur la langue française (ou<br />
une autre), mais sur les écrits dans cette langue. Dans une émission de l’Union Rationaliste, diffusée sur France-<br />
Culture le 14 novembre 1999, et consacrée à une attaque en règle contre les langues régionales, l’un des<br />
intervenants professait que « le français a été la langue raisonnable qui a fait sauter la tenaille constituée d'un<br />
côté par le latin et l'arabe cléricaux, de l'autre par les dialectes désunis »…<br />
3 Par exemple, et pour ne prendre que des langues ou cultures familières et peu exotiques : la Gemütlichkeit<br />
allemande, la virtus romaine, l’hybris grecque, la saudade luso-brésilienne… Si l’on étend la quête vers les<br />
langues de populations démographiquement faibles, très ancrées sur un milieu géographique, et culturellement<br />
éloignées des modèles européens, ce genre de spécificités se multiplient, et peuvent constituent la matière de<br />
chapitres entiers d’ouvrages d’anthropologie.
langue : c’est-à-dire, à permettre aux locuteurs d’assurer la transmission intergénérationnelle<br />
sans avoir l’impression de rendre un mauvais service à leurs enfants, et à adopter des<br />
politiques d’aménagement linguistique qui permettent entre autres à ces langues de prendre le<br />
tournant de la modernité. On est ici dans la perspective de la Charte Européenne, et aussi dans<br />
la logique qui à fait ajouter … et aux Langues de France à l’organisme dépendant du<br />
Ministère de la Culture qui était jusque là la Délégation Générale à la Langue Française.<br />
Mais les locuteurs des langues dites régionales ou minoritaires devraient aussi reconsidérer les<br />
termes de leur revendication. En effet, si c’est la diversité linguistique en tant que telle qui est<br />
un patrimoine mondial de l’humanité (idée qui fait son chemin à l’UNESCO), alors les<br />
locuteurs de ces langues n’en sont pas les propriétaires, mais bien plutôt les gardiens, et ce<br />
dans l’intérêt supérieur de l’humanité. Bien loin de rabaisser leur droit à parler leur langue,<br />
cette idée le légitime et donne encore plus de force à leurs revendications.<br />
3.2. La langue maternelle comme socle de l’acquisition des connaissances.<br />
Si la langue maternelle est la première expérience qu’un être humain fait du langage<br />
en général, alors le bon sens pédagogique veut que cette expérience soit menée jusqu’au bout,<br />
et même soit soutenue par l’institution scolaire. Une persécution ouverte ou larvée des<br />
langues maternelles dans le cadre scolaire est notoirement contre-productive (si le but est bien<br />
la « maîtrise du langage et de la langue française »), car elle crée un mal-être cognitif et<br />
identitaire (puisqu’on dit en gros à l’enfant : tout le travail intellectuel que tu as accompli dans<br />
l’acquisition de ta langue n’a servi à rien, ce n’est pas une vraie langue, tu dois tout<br />
recommencer à zéro…), et surtout elle crée un mal-être vis-à-vis du langage en général, si<br />
l’enfant est amené à concevoir la diversité linguistique comme un domaine conflictuel, dans<br />
lequel sa naissance l’a mis du côté des perdants. De ce point de vue, la persécution de la<br />
langue maternelle est beaucoup plus grave que la persécution des gauchers, car elle a<br />
probablement des conséquences cognitives plus critiques ; et l’institution scolaire devrait<br />
accepter l’idée qu’en développant une langue maternelle autre que le français, les futurs<br />
citoyens ne menacent pas plus la République que ceux qui écrivent de la main gauche… En<br />
tout état de cause, il faut assurer une présence scolaire des langues maternelles chaque fois<br />
que c’est possible, et ce surtout dans les petites classes (cycles I et II), c’est-à-dire à l’âge où<br />
le langage n’est pas complètement stabilisé, avec comme perspective de former, non des néofrancophones<br />
mal à l’aise dans leur bilinguisme, mais des bilingues équilibrés sachant<br />
développer harmonieusement une double compétence. Avec une situation linguistique assez<br />
simple (deux langues régionales, assez clairement réparties géographiquement, et connues par<br />
la majorité du corps enseignant), Mayotte est dans une situation très favorable pour mettre en<br />
place une telle politique.<br />
3.3. La grammaire comme lieu de plaisir et d’ouverture intellectuelle<br />
Cette présence des langues sera d’autant plus féconde si elle permet de concevoir la<br />
diversité linguistique comme une source d’intérêt et de plaisir intellectuels. Une présence de<br />
la langue maternelle dans les cycles I et II constitue un soutien au développement du langage<br />
en général, ce qui donne tout son sens à la notion d’activités de langage, et justifie dans le<br />
contexte guyanais le programme des Médiateurs Culturels Bilingues (voir Alby et Launey<br />
dans le précédent volume), ainsi que dans le contexte mahorais l’expérience en cours dans les<br />
écoles de Mtsangamoudji et de Tsingoni. Dans le cycle III, où se développent les programmes<br />
d’Observation Réfléchie de la Langue, il est absurde de ne pas donner à l’enfant qui construit<br />
son bilinguisme le contrepoint que constitue l’observation de sa langue maternelle en même<br />
temps que celle du français. Un tel contrepoint est en effet le meilleur moyen de favoriser le<br />
développement de compétences métalinguistiques, la prise de conscience que les potentialités<br />
du langage sont très riches, que les deux (ou plusieurs) langues avec lesquelles il se trouve en<br />
contact constituent des échantillons également plausibles et valables de ces potentialités, et
que les resemblances et les différences qu’il peut observer entre ces langues sont des options<br />
ouvertes dans une problématique générale de construction du sens.<br />
De ce point de vue, les langues des DOM-TOM renouvellent la problématique des<br />
langues régionales jusqu’ici majoritairement fondée sur les langues métropolitaines, et ce à<br />
deux titres. Il y a en effet, d’une part, les créoles des DOM, et d’autre part, les langues qu’on<br />
pourrait appeler « très différentes ». Dans le cas des créoles, on sait qu’un premier aperçu<br />
trompeur, fondé une fois de plus sur leur lexique issu très majoritairement du français (ou de<br />
l’anglais pour les langues bushinenge de Guyane) donne l’impression d’une grande proximité<br />
avec les langues européennes, mais aussi qu’un examen de leur grammaire met en évidence<br />
une création originale 4 , qui montre les capacités de l’être humain à conserver ses facultés de<br />
langage dans les conditions matérielles et morales pourtant désastreuses. Dans le cas des deux<br />
langues de Mayotte, mais aussi des langues amérindiennes de Guyane, des langues<br />
mélanésiennes (kanak) de Nouvelle Calédonie, et des langues de Polynésie 5 , on trouve<br />
souvent des catégorisations grammaticales et des structures morphosyntaxiques éloignées et<br />
souvent inattendues par rapport à celles des langues indo-européennes sur lesquelles s’est<br />
construite la tradition grammaticale occidentale. Elles forcent donc à repenser à la fois<br />
l’ampleur et les limites de la variation possible de langue à langue, et en tout état de cause<br />
constituent de véritables trésors pédagogiques pour la réflexion sur le langage.<br />
On voudra bien pardonner à l’auteur de ces lignes son incompétence dans le domaine<br />
des langues de Mayotte. Une connaissance livresque partielle du swahili, langue bantoue<br />
proche du shimaoré, et du malgache, langue malayo-polynésienne dont le kibushi semble être<br />
une variante proche, et un contact récent avec le shimaoré à travers Internet et le manuel de<br />
l’association SHIME (2006), lui autorisent peut-être les remarques suivantes.<br />
Le riche système de classes qui existe dans les langues bantoues, et donc en shimaoré,<br />
constitue un phénomène très connu dans la littérature linguistique, et qui a donné lieu à de très<br />
nombreuses études. Il est souhaitable que cette connaissance et ces réflexions sortent du<br />
cercle de spécialistes, et soient pensées dans le cadre d’une pédagogie en direction du cycle<br />
III de l’école primaire et de l’enseignement secondaire. Le même souhait vaut pour tous les<br />
phénomènes de diathèse verbale qu’on trouve notoirement dans les langues malayopolynésiennes<br />
(avec de nombreuses études sur le malais, l’indonésien, le tagalog et le<br />
malgache), mais aussi dans les langues bantoues.<br />
On entend par diathèse une systématisation de ce qui est plus connu comme la<br />
catégorie de la voix, autrement dit, la marque grammaticale d’une orientation du prédicat<br />
verbal, référant à un événement, par rapport aux participants à cet événement : les<br />
phénomènes de diathèse incluent donc, non seulement l’opposition connue entre voix active,<br />
passive ou réfléchie 6 , mais aussi la voix moyenne (telle qu’elle existe par exemple en grec),<br />
les constructions factitives (dites aussi causatives), etc. On pourra y inclure en particulier des<br />
phénomènes qu’on trouve dans les langues de Mayotte. Par exemple en malgache (et donc<br />
probablement en kibushi, mais nous n’avons pas de documentation directe sur cette langue),<br />
on trouve la voix dite active (orientation par rapport à l’agent), ex. man-didy couper, la voix<br />
dite passive (orientation par rapport au patient), ex. didi-ana être coupé, la voix dite<br />
instrumentale (en « promouvant » le complément circonstanciel instrumental à un statut de<br />
4<br />
Nous ne prendrons pas parti ici dans le débat qui divise les créolistes entre « substratistes » (la grammaire des<br />
langues créoles est issue de celle des langues africaines) et « universalistes » (on retrouve dans les grammaires<br />
créoles les propriétés universelles du langage).<br />
5<br />
Il est vrai qu’on pourrait dire la même chose du basque, et même d’une langue indo-européenne un peu<br />
atypique comme le breton.<br />
6<br />
Et/ou réciproque, puisque selon les langues l’expression de la réciprocité peut se faire de la même manière que<br />
l’expression du réfléchi (p. ex. en français) ou d’une manière différente (p. ex. en shimaoré).
complément direct), ex. a-didy être coupé avec, ou la voix dite circonstancielle (en<br />
promouvant le circonstant à une position sujet), ex. an-didi-ana être ce qui sert à couper<br />
qqch. En shimaoré, outre la banale opposition entre voix active, passive, réfléchie et<br />
réciproque, et la voix causative (ula manger / ul-isha faire manger) on trouve aussi la voix<br />
dite stative (perte de l’expression de l’agent), ex. ula manger / ul-iha être mangeable, se<br />
manger, la voix applicative 7 (dite aussi prépositionnelle, ajout d’un complément<br />
d’attribution), ex. ulisha laisser / ulish-ia laisser pour, uvinga apporter / uvingia apporter à,<br />
usoma lire / usom-ea lire pour, uangiha écrire / uangi-shia écrire à. Ce marquage<br />
morphologique du nombre de participants et de l’orientation se double en shimaoré d’un<br />
accord verbal avec l’ensemble de ces participants 8 , p. ex. Angiha barua Ecris une lettre /<br />
Mw-angi-shie barua Ecris-lui une lettre / Mw-angi-shie mahayo barua Ecris (litt. « Ecrislui<br />
») une lettre à ta mère ; Bua mulango Ouvre la porte / Wa-bu-lie mulango Ouvre-leur la<br />
porte / Wa-bu-lie wadjeni mulango Ouvre (litt. « ouvre-leur ») la porte aux invités, etc 9 .<br />
Dans de tels exemples, on voit que les fonctions syntaxiques (sujet et complément(s))<br />
sont marquées, et qu’elles le sont par des indices personnels sur le verbe, ce qui est la stratégie<br />
opposée à ce qu’on appelle la catégorie du cas, telle qu’elle existe par exemple en latin, en<br />
grec, en allemand, ou dans les langues slaves, stratégie qui consiste à marquer la fonction<br />
syntaxique sur le groupe nominal qui occupe cette fonction 10 . Ces deux stratégies, indiciante<br />
et casuelle, ont ceci d’intéressant qu’en marquant morphologiquement les fonctions<br />
syntaxiques, elles mettent en quelque sorte la syntaxe dans la morphologie, en rendant donc<br />
indispensable le dégagement des fonctions syntaxiques. On a donc ce qu’on peut appeler<br />
l’effet latin, autrement dit la vertu traditionnellement reconnue aux langues classiques 11 qui<br />
avec leur système de cas obligeaient les élèves à repérer, y compris en français, la structure<br />
syntaxique de la phrase, autrement dit, la construction du sens. Cette vertu existe bien aussi<br />
dans les langues indiciantes comme le shimaoré, et il serait déplorable de ne pas exploiter en<br />
contexte scolaire 12 cette incitation à la réflexion abstraite, aussi bien pour les locuteurs de<br />
shimaoré – en leur donnant en quelque sorte à « contempler » la structure de leur langue –<br />
qu’aux non-locuteurs, par exemple métropolitains.<br />
Dernière vertu d’une exploitation pédagogique de tels phénomènes grammaticaux.<br />
Elle peut procurer à l’élève locuteur de cette langue un sentiment de valorisation : ma langue<br />
est belle, complexe, digne d’intérêt. Et en même temps cette satisfaction identitaire est<br />
dépourvue d’agressivité : les langues partagent cette caractéristique avec la cuisine et la<br />
musique, qui peuvent susciter le plaisir bien au-delà de leur milieu culturel d’origine. Si<br />
chaque langue (y compris le français bien sûr) a quelque titre à susciter l’intérêt intellectuel, et<br />
le plaisir de la découverte, alors l’affirmation identitaire et l’ouverture à l’autre ne sont pas<br />
7 De tels phénomènes existent aussi dans beaucoup de langues d’Amérique Centrale, dont le nahuatl, et ont été<br />
repérés dès la fin du XVIème siècle par les grammairiens missionnaires.<br />
8 Là encore, le parallèle avec les langues méso-américaines est frappant.<br />
9 Les exemples qui suivent sont empruntés au cours de shimaoré.<br />
10 Les linguistes anglophones parlent, respectivement, de head-marking – marquage sur la tête syntaxique – et de<br />
NP-marking – marquage sur le groupe nominal – .<br />
11 Cette incitation à prendre en compte l’abstraction des structures syntaxiques est distincte de l’autre vertu que<br />
peuvent avoir les études classiques – accès à des œuvres et à l’histoire anciennes de l’Europe et plus ou moins<br />
fondatrices de la culture européenne – , et elle se retrouve dans toute langue moderne casuelle (russe, allemand,<br />
turc, hongrois….), mais aussi dans toute langue indiciante (shimaoré, nahuatl…).<br />
12 En modulant, bien sûr, ce qui est recevable au niveau de chaque classe, du CE2 au lycée… On aurait<br />
cependant tort de construire des programmes trop timorés : le plaisir des jeux de langage apparaît très tôt, et<br />
même si seuls certains élèves sont intellectuellement sensibles à des phénomènes grammaticaux tels que la<br />
diathèse, l’indiciation ou le cas, on n’a pas plus le droit de leur refuser ce plaisir et cette voie de réussite scolaire<br />
qu’on n’a le droit d’arrêter les cours de mathématiques, de physique ou d’histoire sous prétexte que chacune de<br />
ces matières ennuie une partie des élèves…
des démarches contradictoires, la diversité linguistique devient un domaine de plaisir et non<br />
de conflit, et la connaissance réciproque entraîne le respect mutuel. Nous rejoignons ici les<br />
principes des méthodes dites d’éveil aux langues (v. Alby et Launey dans cet ouvrage).<br />
Nous plaidons ici pour une présence modulée des langues maternelles chaque fois que<br />
c’est possible, et la situation linguistique de Mayotte est comme nous l’avons dit très<br />
favorable à un tel programme. Dans les cycles I et II, elle prendrait la forme d’activités de<br />
langage en langue maternelle, dont le volume horaire reste à définir 13 . En cycle III et dans le<br />
secondaire, elle pourrait intervenir dans les activités d’observation réfléchie, et peut-être<br />
occuper des tranches horaires prévues pour les programmes de Langues et Cultures<br />
Régionales prévus par la loi Deixonne, à condition de généraliser de tels programmes 14 , et<br />
d’échapper à la dérive habituelle connue par ces enseignements dès les débutsd e l’application<br />
de la loi Deixonne 15 (glissement vers le folklore : danse, fêtes, cuisine…). Tout ceci implique<br />
une formation spécifique des maîtres, aussi bien ceux qui sont locuteurs de la langue de leurs<br />
élèves (afin de structurer de manière explicite la connaissance implicite qu’ils en ont en la<br />
parlant), que des non-locuteurs (afin qu’ils puissent en avoir le minimum de connaissance qui<br />
leur permette d’aborder de manière confiante, éventuellement en faisant produire par le<br />
dialogue avec leurs élèves les connaissances pertinentes). En amont de ce dispositif, nous<br />
plaidons pour une collaboration des linguistes et des pédagogues dans la perspective d’une<br />
production de connaissances accessibles et utilisables par les non-linguistes.<br />
13<br />
Nous n’osons pas trop suggérer, par crainte d’être taxé d’extrémisme, le modèle des écoles indigènes de<br />
certains pays d’Amérique Latine : accueil en langue maternelle la première année, apprentissage de l’écrit en<br />
langue maternelle, et introduction croissante de la langue nationale à partir de la deuxième année (jusqu’à un<br />
enseignement exclusivement en langue nationale à la fin du primaire ou au début du secondaire). Mais il est clair<br />
que les quelques minutes quotidiennes qu’on peut observer dans les expériences mahoraises (et dans celle des<br />
médiateurs bilingues de Guyane) sont insuffisantes.<br />
14<br />
Eventuellement, d’assurer au moins une partie de ces enseignements en français, afin de permettre aux nonlocuteurs,<br />
non d’apprendre la langue, mais d’acquérir des connaissances au moins partielles sur la langue.<br />
15<br />
v. GARDIN, B. (1975) « Loi Deixonne et langues régionales: représentation de la nature et de la fonction de<br />
leur enseignement » Langue française n° 25 p. 29-36.