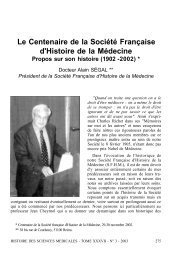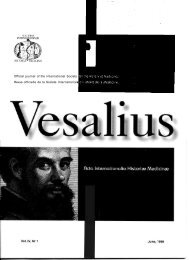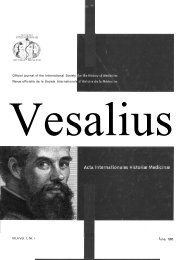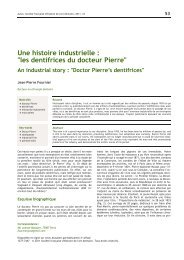Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
chercheur nous informa personnellement qu’« en ce qui concerne <strong>la</strong> transmission naturelle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire il existe une confusion notable. Par exemple, on<br />
indique fréquemment les espèces <strong>de</strong> Lutzomyia comme en étant les vecteurs, uniquement<br />
parce qu’elles manifestent <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> promastigotes (leptomonas), sans i<strong>de</strong>ntifier<br />
dûment le f<strong>la</strong>gellé en question ». En accord avec cette opinion, Laison et Show 39<br />
signalèrent qu’une gran<strong>de</strong> quantité d’infections naturelles dues au f<strong>la</strong>gellé furent observées<br />
parmi <strong>de</strong>s phlébotomes capturés dans <strong>la</strong> nature; cependant les parasites i<strong>de</strong>ntifiés<br />
positivement comme Leishmanies ne furent rencontrés que dans un petit nombre <strong>de</strong> ces<br />
f<strong>la</strong>gellés. Une analyse critique rigoureuse et très minutieuse du problème <strong>de</strong> ces auteurs<br />
indiqua également que les Lutzomyias infectées ne sont pas anthropophiles, et donc ne<br />
se transmettent pas à l’homme ; <strong>la</strong> chaîne épidémiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose humaine<br />
nécessite l’intervention d’espèces <strong>de</strong> Phlebotomus anthropophiles.<br />
Herrer fut l’un <strong>de</strong>s premiers à préparer et à publier, au Pérou et à l’étranger, l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> présence et <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition du Lutzomyia en général et notamment <strong>de</strong> ceux qui<br />
jouent un rôle <strong>de</strong> vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire; il fut suivi par les biologistes<br />
Drs Bertha L<strong>la</strong>nos et Abraham Cáceres, <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et <strong>de</strong> l’institut<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión <strong>de</strong> l’UNMSM. Abe<strong>la</strong>rdo Tejada, son directeur actuel,<br />
fit aussi <strong>de</strong> nombreuses recherches sur le sujet.<br />
Pour l’heure, il était impossible <strong>de</strong> détecter précisément les réservoirs du parasite<br />
pouvant expliquer <strong>de</strong> manière satisfaisante l’endémie qui se maintenait <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s<br />
époques lointaines.<br />
Lors <strong>de</strong> son étu<strong>de</strong> sur l’uta (alors appelée lupus) au Pérou en 1886 40 , Ugaz mit en évi<strong>de</strong>nce<br />
une <strong>de</strong>s idées les plus répandues chez les habitants <strong>de</strong>s zones infectées par l’uta<br />
les vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> Cajamarca, Huamachuco, Ancash, Cerro <strong>de</strong> Pasco, Valle <strong>de</strong>l Rimac et Ayacucho<br />
: les moustiques qui les piquaient le soir jouaient pour eux un rôle important dans<br />
<strong>la</strong> formation du mal ulcéreux ; ces insectes s’étaient nourris <strong>de</strong> « jus d’animaux en putréfaction,<br />
notamment <strong>de</strong>s serpents », et l’inocu<strong>la</strong>ient ensuite à leurs victimes ; ils pensaient<br />
aussi aux petites mouches à ailes b<strong>la</strong>nches vivant à l’ombre du huarango (Acacia<br />
punctata) à Cajamarca, dont elles inocu<strong>la</strong>ient le jus résineux.<br />
À Cuzco, une croyance assurait que le « lèchement d’une araignée » provoquait <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die. À Cajamarca, on attribuait un rôle important à « l’antimoine qui se soulève du<br />
sol sec et chaud <strong>de</strong>s torrents par les premières pluies <strong>de</strong> Carême ». On attribua également<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die aux eaux <strong>de</strong> mauvaise qualité (La Libertad). En 1913 20 Urcia reprit les<br />
conclusions du Dr Barranca dans lesquelles il rapportait <strong>la</strong> croyance que « l’Indien<br />
contracte <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die lorsqu’il boit et qu’il mouille le bout <strong>de</strong> son nez ». Urcia par<strong>la</strong> aussi<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> croyance en l’existence d’animaux ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes qui <strong>de</strong> manière directe ou indirecte,<br />
par les piqûres ou <strong>la</strong> contagion, inocu<strong>la</strong>ient le germe <strong>de</strong> l’uta; il se penchait sur<br />
l’idée que l’eau stagnante pouvait contenir soit les germes producteurs, soit les œufs ou<br />
les <strong>la</strong>rves <strong>de</strong>s insectes. Il décrivit en détail un insecte qu’il estima être le vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die en faisant référence bien évi<strong>de</strong>mment au Phlebotomus, « qu’on prétend nommer<br />
titira lorsque son nom est uta ».<br />
En 1914, Antúnez 41 signa<strong>la</strong> <strong>la</strong> présence constante d’un arbuste appelé mith à l’endroit<br />
où les infections d’uta étaient connues et dangereuses : « L’uta provoque une épidémie<br />
uniquement pendant les mois <strong>de</strong> février, mars et avril, justement pendant l’époque <strong>de</strong><br />
fructification du mith, et elle disparaît lorsque les fruits sont gâtés. L’uta s’acharne sur<br />
l’individu qui aime manger le fruit au pied <strong>de</strong>s arbustes ou sur celui qui habite les environs.<br />
Il suffit, non pas <strong>de</strong> s’approcher pour manger le fruit, mais seulement <strong>de</strong> rester à<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> dangereuse dans un rayon d’environ <strong>de</strong>ux kilomètres <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone où se trouvent<br />
les miths » ; il attribua <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die à un « moustique à <strong>la</strong> tête b<strong>la</strong>nche qui aime le<br />
fruit du mith ».<br />
351