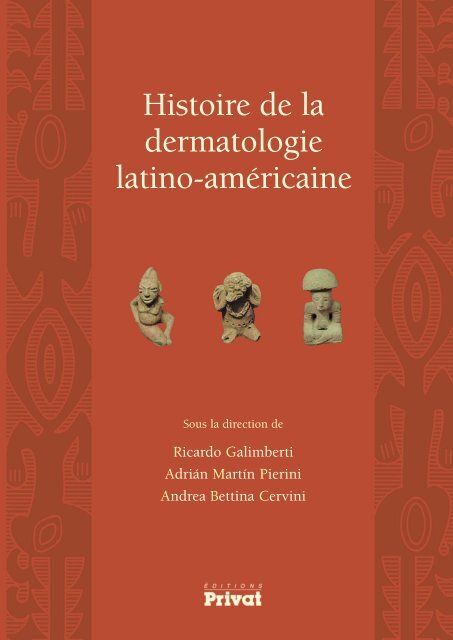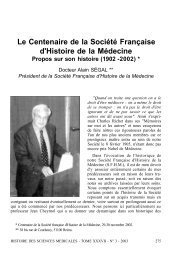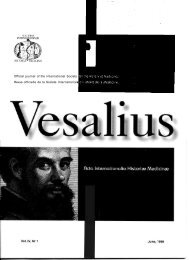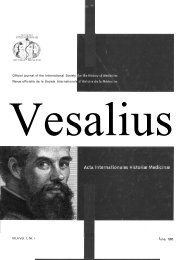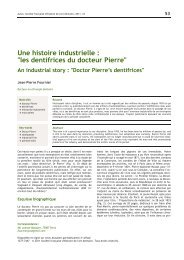Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
Histoire de la dermatologie latino-américaine - Bibliothèque ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
Ricardo Galimberti<br />
Adrián Martín Pierini<br />
Andrea Bettina Cervini
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
LATINO-AMÉRICAINE
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Ricardo Galimberti,<br />
Adrián Martín Pierini et Andrea Bettina Cervini.<br />
Ce livre a été réalisé à l’initiative du comité d’organisation du XXI e Congrès mondial<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Rédigé par 73 auteurs représentant <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong>rmatologique <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>,<br />
il constitue le ca<strong>de</strong>au officiel du XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, organisé<br />
à Buenos Aires du 1 er au 5 octobre 2007.<br />
L’<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> est publiée grâce à un fonds éducatif<br />
sans restriction <strong>de</strong>s Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.<br />
Coordination éditoriale : Andrea Bettina Cervini<br />
Révision <strong>de</strong>s contenus : Andrea Bettina Cervini, Amelia Marta Laterza, Adrián Martín Pierini<br />
Édition technique : Margarita Pierini<br />
Conception <strong>de</strong>s intérieurs : Petits Papiers, Toulouse (France)<br />
Composition typographique, mise en pages et correction : Rafael Centeno<br />
Couverture : Mariana Nemitz<br />
Traduction française : Thierry Boulenger<br />
© 2007, Éditions Privat<br />
10, rue <strong>de</strong>s Arts<br />
BP 38028<br />
31080 Toulouse Ce<strong>de</strong>x 6<br />
ISBN : 978-2-7089-5866-1<br />
Dépôt légal : avril 2007<br />
Couverture : statuettes préhispaniques présentant <strong>de</strong>s lésions cutanées.
Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />
ANDREA BETTINA CERVINI<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
LATINO-AMÉRICAINE<br />
LABORATOIRES PIERRE FABRE
AUTEURS DU LIVRE HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE LATINO-AMÉRICAINE AYANT ASSISTÉ À LA SOIRÉE DU 17 NOVEMBRE 2005<br />
À CARTHAGÈNE, COLOMBIE, DANS LE CADRE DU XIV E CONGRÈS IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE (CILAD)<br />
Alfredo Abreu Daniel (Cuba) ; Gilberto Adame Miranda (Mexique) ; Danielle Alencar-Ponte (Colombie) ; C<strong>la</strong>udio Arias Argudo (Équateur) ;<br />
M. Isabel Arias Gómez (Mexique) ; Eduardo Baños (El Salvador) ; Antonio Barrera Arenales (Colombie) ; Zuño Burstein Alva (Pérou) ;<br />
Andrea Bettina Cervini (Argentine) ; Mauricio Coello Uriguen (Équateur) ; Paulo R. Cunha (Brésil) ; Luis Flores-Cevallos (Pérou) ; Elbio<br />
Flores-Cevallos (Pérou) ; Ricardo Galimberti (Argentine) ; Pedro García Zubil<strong>la</strong>ga (Argentine) ; Jaime Gil Jaramillo (Colombie) ; F<strong>la</strong>vio<br />
Gómez Vargas (Colombie) ; Rubén Guarda Tatín (Chili) ; Enrique Hernán<strong>de</strong>z Pérez (El Salvador) ; Alfredo Lan<strong>de</strong>r Marcano (Venezue<strong>la</strong>) ;<br />
Franklin Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre (Équateur) ; Fernando Magill (Pérou) ; Gracie<strong>la</strong> Manzur (Argentine) ; Aldo Edgar Martínez Campos (Nicaragua) ;<br />
José A. Mássimo (Argentine) ; Jairo Mesa Cock (Colombie) ; Martha Miniño (République dominicaine) ; Isaac Neira Cuadra (Nicaragua) ;<br />
León Neumann Scheffer (Mexique) ; Yo<strong>la</strong>nda Ortiz (Mexique) ; Adrián Martín Pierini (Argentine) ; Jaime Piquero Martín (Venezue<strong>la</strong>) ;<br />
Leana Quintanil<strong>la</strong> (El Salvador) ; Roberto Rampoldi (Uruguay) ; Antonio Rondón Lugo (Venezue<strong>la</strong>) ; Amado Saúl (Mexique) ; Eduardo<br />
Silva-Lizama (Guatema<strong>la</strong>) ; César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z (Colombie) ; Mirta Vázquez (Argentine) ; Alberto Woscoff (Argentine).
LISTE DES AUTEURS<br />
ABREU DANIEL, ALFREDO (Cuba). Professeur consultant. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie. Chef du groupe national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />
publique <strong>de</strong> Cuba.<br />
ADAME MIRANDA, GILBERTO (Mexique). Dermatologue, consultation au cabinet médical.<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie mexicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (2006-2007).<br />
ALENCAR-PONTE, DANIELLE (Colombie). Spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et clinique médicale.<br />
Diplômée en programmation neurolinguistique. Dermatologue. Service médical <strong>de</strong><br />
l’université <strong>de</strong>l Valle.<br />
ALMODÓVAR, PABLO I. (Porto Rico). Professeur associé du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, université <strong>de</strong> Porto Rico.<br />
AMOR GARCÍA, FRANCISCO (Uruguay). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />
publique. Montevi<strong>de</strong>o.<br />
ARENAS, ROBERTO (Mexique). Prési<strong>de</strong>nt du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(2003-2007).<br />
ARIAS ARGUDO, CLAUDIO (Équateur). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie équatorienne <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Ancien professeur <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Cuenca et <strong>de</strong> l’université catholique.<br />
ARIAS GÓMEZ, M. ISABEL (Mexique). Dermatologue, consultation au cabinet médical.<br />
BAÑOS, JULIO EDUARDO (El Salvador). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>rmatologique du Salvador.<br />
BARRERA ARENALES, ANTONIO (Colombie). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />
colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />
colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie.<br />
BORES, AMALIA M. (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Enseignante en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et<br />
formation <strong>de</strong>s enseignants. Orientation <strong>de</strong>rmatologie et histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
BORES, INÉS A. (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Enseignante en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et<br />
formation <strong>de</strong>s enseignants. Orientation <strong>de</strong>rmatologie et histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
BURSTEIN ALVA, ZUÑO (Pérou). Professeur émérite, Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San<br />
Marcos, Lima (<strong>de</strong>rmatologie et mé<strong>de</strong>cine tropicale). Membre <strong>de</strong> l’Académie nationale<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, Pérou. Chercheur permanent <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel<br />
A. Carrión, UNMSM, Lima (<strong>de</strong>rmatologie sanitaire).<br />
CÁCERES, HÉCTOR (Pérou). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue pédiatre. Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’enfant,<br />
Lima. Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Université péruvienne Cayetano Heredia.<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
CAMPOS MACÍAS, PABLO (Mexique). Département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, hôpital Aranda <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra,<br />
León, Gto. Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, université <strong>de</strong> Guanajuato.<br />
CÁRDENAS UZQUIANO, FERNANDO (Bolivie) (✝). Professeur émérite, Universidad Mayor <strong>de</strong> San<br />
Andrés.<br />
7
LISTE DES AUTEURS<br />
8<br />
CERVINI, ANDREA BETTINA (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Mé<strong>de</strong>cin assistante du service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie Pr. Dr. Juan P. Garrahan, Buenos Aires, Argentine.<br />
Enseignante rattachée, orientation <strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
COELLO URIGUEN, MAURICIO (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Société équatorienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, Noyau <strong>de</strong> l’Azuay.<br />
CORREA, JULIO (Paraguay). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Membre actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société paraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
CUNHA, PAULO R. (Brésil). Professeur autonome <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
Sao Paulo. Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí.<br />
Post-Doctorat à <strong>la</strong> New York University.<br />
DE LEÓN G., SUZZETTE (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité d’enseignement <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />
DÍAZ ALMEIDA, JOSÉ G. (Cuba). Professeur émérite. Docteur ès sciences médicales. Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales General Calixto García.<br />
DIEZ DE MEDINA, JUAN CARLOS (Bolivie). Chef <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Fondation « Peau », Bolivie.<br />
FAIZAL GEAGEA, MICHEL (Colombie). Coordinateur. Professeur associé, unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
université nationale <strong>de</strong> Colombie. Directeur du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne<br />
<strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie.<br />
FALABELLA, RAFAEL (Colombie). Professeur émérite. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
université <strong>de</strong>l Valle, Cali, Colombie.<br />
FLORES-CEVALLOS, ELBIO (Pérou). Professeur <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête et du cou <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, Lima.<br />
Fondateur et ancien chef du service d’enseignement et d’assistance <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
tête et du cou <strong>de</strong> l’hôpital général national Dos <strong>de</strong> Mayo, Lima.<br />
FLORES-CEVALLOS, LUIS (Pérou). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, Lima. Fondateur du service<br />
d’enseignement et d’assistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, hôpital Edgardo Rebagliati Martins,<br />
et ancien directeur.<br />
GALIMBERTI, RICARDO (Argentine). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Italiano <strong>de</strong><br />
Buenos Aires. Professeur régulier adjoint <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Professeur adjoint <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’hôpital Italiano <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
GARCÍA ZUBILLAGA, PEDRO (Argentine). Pédiatre. Dermatologue universitaire. Enseignant<br />
rattaché <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Dermatologue pédiatre à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.<br />
GIL JARAMILLO, JAIME (Colombie). Professeur du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, université libre <strong>de</strong><br />
Cali. Dermatologue. Institut <strong>de</strong>s sécurités sociales <strong>de</strong> Cali.<br />
GÓMEZ VARGAS, FLAVIO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien professeur titu<strong>la</strong>ire, service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong> Antioquia.<br />
GONZÁLEZ ROJAS, CARLOS HORACIO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />
colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Ancien prési<strong>de</strong>nt du Collège ibéroaméricain<br />
<strong>de</strong> cryochirurgie.<br />
GREENBERG CORDERO, PETER A. (Guatema<strong>la</strong>). Directeur médical <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Membre <strong>de</strong> l’académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
GUARDA TATÍN, RUBÉN (Chili). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong><br />
vénéréologie (1986-1990). Ancien professeur associé <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du Chili.<br />
GUTIÉRREZ ALDANA, GUILLERMO (Colombie). Ancien chef, professeur titu<strong>la</strong>ire et professeur émérite<br />
du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
HALPERT, EVELYNE (Colombie). Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fondation<br />
Santa Fe <strong>de</strong> Bogotá. Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia et<br />
<strong>de</strong>rmatologue infantile <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie DIF du Mexique.<br />
HERNÁNDEZ PÉREZ, ENRIQUE (El Salvador). Directeur du Centre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />
cosmétique <strong>de</strong> San Salvador. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mesoamerican Aca<strong>de</strong>my of Cosmetic<br />
Surgery et membre du Groupe d’actualités thérapeutiques <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
ISA ISA, RAFAEL (République dominicaine). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, épidémiologiste et<br />
mycologue. Directeur général du IDCP–DHBD. Vice-prési<strong>de</strong>nt du CILAD.<br />
LANDER MARCANO, ALFREDO (Venezue<strong>la</strong>). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
MADERO IZAGUIRRE, FRANKLIN (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à l’université <strong>de</strong> Guayaquil. Chef du service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant Dr Francisco <strong>de</strong> Ycaza Bustamante.<br />
Dermatologue pédiatre <strong>de</strong> l’hôpital pour enfants Dr Roberto Gilbert E.<br />
MADERO IZAGUIRRE, MAURO (Équateur). Professeur principal d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
d’immunologie basique et d’immunologie clinique, université catholique <strong>de</strong> Santiago<br />
<strong>de</strong> Guayaquil. Professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong><br />
Guayaquil. Chef du service d’allergie <strong>de</strong> l’hôpital Dr Teodoro Maldonado Carbo.<br />
IESS Guayaquil.<br />
MAGILL, FERNANDO (Pérou). Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA 2004.<br />
MANZUR, GRACIELA (Argentine). Pédiatre-néonatologue. Dermatologue universitaire.<br />
Dermatologue pédiatre à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutiérrez.<br />
MARTÍNEZ CAMPOS, ALDO EDGAR (Nicaragua). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>.<br />
MÁSSIMO, JOSÉ ANTONIO (Argentine). Docteur en mé<strong>de</strong>cine. Pédiatre. Dermatologue<br />
universitaire. Directeur du cursus <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’hôpital pour enfants Ricardo Gutierrez.<br />
MESA COCK, JAIRO (Colombie). Ancien chef du service et professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Caldas. Directeur du site Internet <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
MINIÑO, MARTHA (République dominicaine). Mé<strong>de</strong>cin pathologiste, <strong>de</strong>rmatologue et <strong>de</strong>rmatopathologiste.<br />
Éditrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Dominicana <strong>de</strong> Dermatología et au IDCP / DHBD.<br />
MONTENEGRO LÓPEZ, GALO (Équateur). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
hôpital Carlos Andra<strong>de</strong> Marín, Quito.<br />
NEIRA CUADRA, JORGE ISAAC (Nicaragua). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue. Professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>.<br />
Professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, université nationale autonome du Nicaragua, Managua.<br />
NEUMANN SCHEFFER, LEÓN (Mexique). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société mexicaine <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique et oncologique.<br />
ORTIZ, YOLANDA (Mexique). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie I.P.N. Chef du service <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Juárez du Mexique.<br />
PIERINI, ADRIÁN MARTÍN (Argentine). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie<br />
Pr. Dr Juan P. Garrahan. Professeur adjoint <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
PIERINI, LUIS DAVID (Argentine). Ancien chef du service <strong>de</strong> neurologie <strong>de</strong>s hôpitaux Torcuato<br />
<strong>de</strong> Alvear et Ignacio Pirovano, Buenos Aires, Argentine. Ancien enseignant <strong>de</strong><br />
neurologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires (UBA). Ancien membre titu<strong>la</strong>ire du tribunal<br />
d’honneur du Collège argentin <strong>de</strong> neurologues cliniques.<br />
PIQUERO MARTÍN, JAIME (Venezue<strong>la</strong>). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vargas <strong>de</strong><br />
Caracas. Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine.<br />
9
LISTE DES AUTEURS<br />
QUINTANILLA SÁNCHEZ, LEANA (El Salvador). Secrétaire <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>rmatologique du<br />
Salvador.<br />
QUIÑONES, CÉSAR (Porto Rico). Professeur associé ad honorem au département <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Porto Rico.<br />
RAMPOLDI BESTARD, ROBERTO (Uruguay). Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue.<br />
REYES FLORES, OSCAR (Venezue<strong>la</strong>). Membre honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
RONDÓN LUGO, ANTONIO (Venezue<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
José M. Vargas, UCV.<br />
RUIZ MALDONADO, RAMÓN (Mexique). Professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique, université nationale autonome du Mexique. Chercheur national niveau<br />
III du système national <strong>de</strong> chercheurs, chercheur en sciences médicales « F » <strong>de</strong>s<br />
Instituts nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
SAÚL, AMADO (Mexique). Professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie UNAM et IPN. Consultant technique du<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico.<br />
SILVA-LIZAMA, EDUARDO (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, centre médical militaire,<br />
Guatema<strong>la</strong>. Coordinateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’université Mariano Gálvez. Regional editor For Central American Activities,<br />
International Journal of Dermatology. Membre du conseil éditorial <strong>de</strong> Medicina<br />
Cutánea Ibero Latinoamericana. Membre <strong>de</strong> l’Association guatémaltèque <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, du CILAD, <strong>de</strong><br />
l’International Society of Dermatology et <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology.<br />
TRUJILLO REINA, BENJAMÍN (Venezue<strong>la</strong>). Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
URQUIZU DÁVILA, PABLO HUMBERTO (Guatema<strong>la</strong>). Chef <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Département<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, hôpital Roosevelt. Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association<br />
guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> l’American<br />
Aca<strong>de</strong>my of Dermatology.<br />
VALDIVIA BLONDET, LUIS (Pérou). Professeur principal <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Universidad Nacional<br />
Mayor <strong>de</strong> San Marcos.<br />
VALLE, LIDIA E. (Argentine). Dermatologue universitaire. Enseignante rattachée <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie (UBA). Professeur universitaire en mé<strong>de</strong>cine (UCS).<br />
VARELA HERNÁNDEZ, CÉSAR IVÁN (Colombie). Professeur ad honorem au service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, université <strong>de</strong>l Valle. Prési<strong>de</strong>nt<br />
fondateur <strong>de</strong> l’Association d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie colombienne. Ancien<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique, région Valle <strong>de</strong>l Cauca.<br />
VARGAS MONTIEL, HERNÁN (Venezue<strong>la</strong>). Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong><br />
Maracaibo.<br />
VÁZQUEZ, MIRTA (Argentine). Mé<strong>de</strong>cin pédiatre du service <strong>de</strong> pédiatrie <strong>de</strong> l’hôpital Pirovano.<br />
VELÁSQUEZ BERRUECOS, JUAN PEDRO (Colombie). Ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Ancien chef du service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia. Ancien professeur titu<strong>la</strong>ire du service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Antioquia.<br />
VIGLIOGLIA, PABLO A. (Argentine). Professeur émérite, université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
VIGNALE, RAÚL (Uruguay). Professeur émérite <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. Chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique,<br />
Montevi<strong>de</strong>o.<br />
WOSCOFF, ALBERTO (Argentine). Professeur consultant titu<strong>la</strong>ire, université <strong>de</strong> Buenos Aires.
SOMMAIRE<br />
PROLOGUE : LE DÉBUT D’UN CHEMIN (RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />
ANDREA BETTINA CERVINI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE DANS LES CULTURES INDIGÈNES ARGENTINES<br />
(LUIS DAVID PIERINI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Les groupes indigènes : botanique médicale, géographie médicale, pathologies . . . .20<br />
Les groupes Brasilio-Guaranis et Chaco Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Les groupes du Nord-Ouest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
Le groupe andin et <strong>de</strong>s Sierras centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />
Pampas, Querandis et Puelches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28<br />
Patagons ou Tehuelches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29<br />
Extrême Sud magel<strong>la</strong>nique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />
Épilogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE ARGENTINE (PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO<br />
WOSCOFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
L’époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
L’époque <strong>de</strong> Baliña et <strong>de</strong> Greco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />
L’époque <strong>de</strong> Pierini et <strong>de</strong> Quiroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />
L’ère actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37<br />
La fédéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40<br />
L’activité internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44<br />
Les différentes sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />
Revues <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
Livres <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48<br />
Maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine (SAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />
DERMATOLOGIE : ART ET CULTURE (AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE) 51<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51<br />
La mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire. Les guérisseurs et <strong>la</strong> magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52<br />
Les mou<strong>la</strong>ges en cire. La photographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56<br />
11
ÍNDICE<br />
12<br />
HISTOIRE DE L’ASSOCIATION ARGENTINE DE DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE<br />
(JOSÉ ANTONIO MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA, GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ) . . . .59<br />
COMPTE RENDU HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ BOLIVIENNE DE DERMATOLOGIE<br />
(FERNANDO CÁRDENAS UZQUIANO, JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Avant sa fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Depuis sa fondation jusqu’à fin 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />
Depuis 1986 jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />
LA DERMATOLOGIE ET LES DERMATOLOGUES AU BRÉSIL (PAULO R. CUNHA) . . . . .73<br />
Le Brésil et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />
Première étape : les bénédictions <strong>de</strong>s payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />
L’étape préscientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />
L´étape scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Personnalités historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans les États . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88<br />
La Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SBD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112<br />
Quelques ma<strong>la</strong>dies et leur traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112<br />
Les défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour le nouveau millénaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN COLOMBIE (CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ)<br />
(COLLABORATEURS : DANIELLE ALENCAR-PONTE, ANTONIO BARRERA ARENALES, MICHEL FAIZAL<br />
GEAGEA, JAIME GIL JARAMILLO, FLAVIO GÓMEZ VARGAS, CARLOS HORACIO GONZÁLEZ ROJAS,<br />
GUILLERMO GUTIÉRREZ ALDANA, JAIRO MESA COCK, JUAN PEDRO VELÁSQUEZ BERRUECOS) . . . .117<br />
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique jusqu’à l’époque coloniale.<br />
L’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et les nouvelles ma<strong>la</strong>dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis l’époque coloniale jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, l’infectiologie et les sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . .130<br />
Institutions <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137<br />
Publications scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142<br />
Activités scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité : les écoles-services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . .144<br />
Dermatologie, art et culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154<br />
COMPTE RENDU HISTORIQUE DE LA DERMATOLOGIE À CUBA (JOSÉ G. DÍAZ<br />
ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157<br />
Pério<strong>de</strong> coloniale (1509-1902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157<br />
Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> république libérale bourgeoise (1902-1958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158<br />
Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution socialiste (<strong>de</strong> 1959 à nos jours) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167<br />
ESQUISSE HISTORIQUE DE LA DERMATOLOGIE CHILIENNE (RUBÉN GUARDA TATÍN) . . .169<br />
La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174<br />
Compte rendu <strong>de</strong> quelques disciplines <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie . . . . . . . . . . . . . . . .185<br />
Publications <strong>de</strong>rmatologiques au Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190<br />
Réunions scientifiques nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
La <strong>de</strong>rmatologie chilienne sur le p<strong>la</strong>n international . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE ÉQUATORIENNE (MAURO MADERO IZAGUIRRE,<br />
FRANKLIN MADERO IZAGUIRRE, GALO MONTENEGRO LÓPEZ, MAURICIO COELLO URIGUEN, CLAUDIO<br />
ARIAS ARGUDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195<br />
I. La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région côtière ou littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Aspects historiques : Époque préhispanique. La Conquête. Époque coloniale.<br />
L’indépendance (1820-1830). Époque républicaine (1830-1900). Première partie<br />
du XXe siècle (1900-1950). La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité (1950-2005).<br />
Fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. La <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
actuelle. Grands <strong>de</strong>rmatologues équatoriens. Références bibliographiques<br />
II. La <strong>de</strong>rmatologie à Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207<br />
III. La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Azuay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque préhispanique. La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque hispanique<br />
et prérépublicaine. La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque républicaine. Fondation<br />
officielle <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca. Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie-Noyau <strong>de</strong> l’Azuay. Références bibliographiques<br />
LA DERMATOLOGIE AU SALVADOR (JULIO EDUARDO BAÑOS, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ,<br />
LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU GUATEMALA (EDUARDO SILVA-LIZAMA, PABLO<br />
HUMBERTO URQUIZU DÁVILA, PETER GREENBERG CORDERO, SUZETTE DE LEÓN G.) . . . . . . . . .231<br />
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pendant <strong>la</strong> Conquête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis l’époque coloniale jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240<br />
Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247<br />
Enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249<br />
Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (INDERMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature. La <strong>de</strong>rmatologie popu<strong>la</strong>ire, les guérisseurs,<br />
<strong>la</strong> magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU MEXIQUE (GILBERTO ADAME MIRANDA,<br />
MARIA ISABEL ARIAS GÓMEZ, ROBERTO ARENAS, PABLO CAMPOS MACÍAS, LEÓN NEUMANN<br />
SCHEFFER, YOLANDA ORTIZ, RAMÓN RUIZ MALDONADO, AMADO SAÚL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .265<br />
Époque préhispanique ou précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265<br />
Époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268<br />
Époque <strong>de</strong> l’indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271<br />
Époque contemporaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272<br />
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE AU MEXIQUE (RAMÓN RUIZ<br />
MALDONADO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE NICARAGUAYENNE (ALDO EDGAR MARTÍNEZ<br />
CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281<br />
Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281<br />
Personnalités remarquables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283<br />
13
ÍNDICE<br />
14<br />
L’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287<br />
Le centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo . . . . . . . . . . . .287<br />
L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique au Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290<br />
NOTES SUR L’HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU PARAGUAY (JULIO CORREA) . .291<br />
À titre <strong>de</strong> prologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291<br />
La popu<strong>la</strong>tion d’Amérique. L’homme américain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292<br />
Territoire du Paraguay. Découverte. Colonie. Indépendance. Guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple<br />
Alliance (1865-1870) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294<br />
Les Guaranis : <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine empirique et son application aux ma<strong>la</strong>dies générales<br />
et cutanées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297<br />
Aspects historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine au Paraguay. Re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . .303<br />
Compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU PÉROU (ELBIO FLORES-CEVALLOS,<br />
LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309<br />
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309<br />
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté . . . . . . . . . . . . .315<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pendant les cent premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . .318<br />
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s publications scientifiques <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou . . . . . . . . . . . .322<br />
Quelques précurseurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323<br />
L’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Aizic Cotlear à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo . . . . . . . . . .337<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />
III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> formalisation légale <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . .339<br />
Premier programme universitaire <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>rmatologique au Pérou . . .341<br />
Aspects historiques <strong>de</strong>s instituts <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche<br />
scientifique <strong>de</strong>rmatologique au Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345<br />
<strong>Histoire</strong> succincte <strong>de</strong> quelques ma<strong>la</strong>dies au Pérou : leishmaniose tégumentaire ;<br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrión (verrue péruvienne) ; lèpre et son contrôle . . . . . . . . . . . . . .348<br />
Légis<strong>la</strong>tion péruvienne pour le contrôle <strong>de</strong>s MST. <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s dispositions<br />
légales en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364<br />
NOTES SUR L’HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE PÉRUVIENNE<br />
(LUIS VALDIVIA BLONDET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367<br />
Époque précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367<br />
La Conquête, <strong>la</strong> vice-royauté et les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . . .368<br />
L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique sous <strong>la</strong> République <strong>de</strong>puis 1856 jusqu’à nos jours . . .369<br />
Les sociétés scientifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374<br />
Épilogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE À PORTO RICO (CÉSAR QUIÑONES, PABLO I.<br />
ALMODÓVAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381<br />
La mé<strong>de</strong>cine précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie Latino-Américaine<br />
De l’arrivée <strong>de</strong> Colomb au changement <strong>de</strong> souveraineté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .382<br />
La <strong>de</strong>rmatologie académique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383<br />
La recherche scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385<br />
La lèpre à Porto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385<br />
Associations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386<br />
Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (MARTHA MINIÑO,<br />
RAFAEL ISA ISA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387<br />
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’époque coloniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388<br />
La <strong>de</strong>rmatologie au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389<br />
La <strong>de</strong>rmatologie au XX e siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390<br />
Développement <strong>de</strong>s sous-spécialités <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393<br />
Publications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .394<br />
Vers <strong>la</strong> fin du XX e siècle et le début du XXI e siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />
Dermatologie et art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />
Dermatologie et magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397<br />
LES INDIGÈNES DE L’URUGUAY ET LEUR RAPPORT À LA DERMATOLOGIE<br />
(ROBERTO RAMPOLDI BESTARD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399<br />
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399<br />
Les voyages dans le Paranaguazú (Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402<br />
L’Uruguay indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403<br />
Pratiques curatives générales et <strong>de</strong>rmatologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE EN URUGUAY (RAÚL VIGNALE)<br />
(COLLABORATEUR : FRANCISCO AMOR GARCÍA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413<br />
Prologue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413<br />
Le premier soin hospitalier à Montevi<strong>de</strong>o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414<br />
Portrait <strong>de</strong>s figures les plus importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay,<br />
XIX e et XX e siècles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415<br />
Hôpitaux possédant <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419<br />
Hôpitaux dépendant du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419<br />
Hôpitaux indépendants du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>s XIX e et XX e siècles . . . . . . . . . . . . . . . .422<br />
Congrès, symposiums et journées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424<br />
La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425<br />
<strong>Histoire</strong> et évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
en Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE AU VENEZUELA (ALFREDO LANDER MARCANO, JAIME<br />
PIQUERO-MARTÍN, ANTONIO RONDÓN LUGO, OSCAR REYES FLORES, BENJAMÍN TRUJILLO<br />
REINA,HERNÁN VARGAS MONTIEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429<br />
Conception : <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong>s indigènes jusqu’à 1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429<br />
Naissance : <strong>de</strong> 1905 à 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432<br />
Développement : <strong>de</strong> 1946 jusqu’à nos jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435<br />
15
ÍNDICE<br />
Sous-spécialités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les provinces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440<br />
Références bibliographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442<br />
LE COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE (CILAD)<br />
(ROBERTO ARENAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443<br />
RÉUNION ANNUELLE DES DERMATOLOGUES LATINO-AMÉRICAINS (RADLA)<br />
(FERNANDO MAGILL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447<br />
DÉVELOPPEMENT DE LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE EN AMÉRIQUE LATINE<br />
(EVELYNE HALPERT, RAMÓN RUIZ MALDONADO, HÉCTOR CÁCERES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451<br />
L’AVENIR DE LA DERMATOLOGIE EN AMÉRIQUE LATINE (RAFAEL FALABELLA) . . . .453<br />
ÉPILOGUE (LES ÉDITEURS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459<br />
INDEX DES NOMS PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461
PROLOGUE<br />
LE DÉBUT D’UN CHEMIN<br />
RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI,<br />
ANDREA BETTINA CERVINI<br />
Nous sommes rentrés <strong>de</strong> Paris en juillet 2002 et, dans nos valises, dans nos esprits<br />
et dans nos cœurs, nous portions non seulement le souvenir <strong>de</strong> tout ce que nous avions<br />
appris durant le congrès mais aussi <strong>la</strong> joie immense et <strong>la</strong> responsabilité d’être chargés<br />
d’organiser le XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Buenos Aires.<br />
Pour <strong>la</strong> première fois un pays d’Amérique du Sud accueillerait l’événement le plus<br />
important <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mondiale. Le rêve <strong>de</strong> nos maîtres <strong>de</strong>venait réalité.<br />
Cette réussite disposait du soutien <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>s,<br />
appui toujours présent et qui s’accroît chaque jour.<br />
Nous avons été saisis par <strong>la</strong> magnifique <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie française et nous<br />
avons aperçu là le début d’un chemin.<br />
Dès le début, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a soutenu <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce livre que<br />
nous présentons aujourd’hui : <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />
Cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans l’aval <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>la</strong>tino<strong>américaine</strong>s,<br />
et c’est notre <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> remarquer, par sa valeur sans égale, l’enthousiasme<br />
et <strong>la</strong> rapidité avec lesquelles les coauteurs ont répondu à notre appel. Sans aucun doute<br />
ils ont facilité notre travail mais ils ont aussi accru notre responsabilité <strong>de</strong>vant une telle<br />
participation.<br />
Si nous parlons <strong>de</strong> « début d’un chemin », c’est parce que nous croyons que cette<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> est, tant elle fait preuve d’un esprit <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
sans mesquinerie ni préjugés, l’acte inaugural <strong>de</strong> notre plus précieux objectif<br />
en tant que <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> ce continent : l’union <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>,<br />
tout en respectant nos différences qui, au lieu <strong>de</strong> nous éloigner, nous surprennent<br />
et nous unissent, afin d’apprendre les uns <strong>de</strong>s autres.<br />
Pour parvenir à cette union, nous comptons sur :<br />
1. notre passion pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, pour l’étu<strong>de</strong> et le soin <strong>de</strong> l’organe d’expression par<br />
excellence, non seulement <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> notre organisme mais surtout <strong>de</strong> notre qualité <strong>de</strong> vie;<br />
2. nos origines communes, puisque nous partageons tous <strong>de</strong>s racines <strong>la</strong>tines, ce qui<br />
ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong> nos problèmes, à nos recherches, à nos objectifs.<br />
L’Amérique <strong>la</strong>tine possè<strong>de</strong> une histoire très riche <strong>de</strong>puis l’époque précolombienne,<br />
dans les cultures indigènes dont les traces persistent encore dans les coutumes <strong>de</strong> nos<br />
peuples. La colonisation a apporté <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité, pas toujours appropriée au bien-être <strong>de</strong><br />
l’homme, mais en définitive enrichissante pour <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> nos popu<strong>la</strong>tions.<br />
17
RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI, ANDREA BETTINA CERVINI<br />
Presque toutes les Sociétés <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie s’expriment dans<br />
cette <strong>Histoire</strong>, à travers le souvenir <strong>de</strong> leurs racines, leurs chercheurs et leurs maîtres,<br />
moyennant un effort que les générations à venir apprécieront.<br />
Nous vivons ce livre comme le début du chemin <strong>de</strong> l’unité <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />
Ne perdons pas le nord.<br />
Unissons nos efforts pour approfondir <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> nos pathologies régionales.<br />
Unissons nos efforts pour effectuer <strong>de</strong>s recherches conjointes.<br />
Unissons nos volontés pour organiser <strong>de</strong>s activités scientifiques partagées stimu<strong>la</strong>nt<br />
<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> tous et rendant plus profitable leur coût <strong>de</strong> réalisation.<br />
Unissons nos capacités en quête d’objectifs permettant d’améliorer <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> notre<br />
popu<strong>la</strong>tion et d’optimiser intégralement sa qualité <strong>de</strong> vie.<br />
Nous voulons remercier tous les col<strong>la</strong>borateurs directs et indirects, ainsi que les<br />
Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, notamment M. Jacques Fabre, M me Colette<br />
Arrighi et M. Philippe Constant, pour leur sensibilité et générosité en soutenant ce projet<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>. ■
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE DANS<br />
LES CULTURES<br />
INDIGÈNES<br />
ARGENTINES<br />
LUIS DAVID PIERINI<br />
À <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> mon père, Luis E. Pierini, qui fut heureux <strong>de</strong><br />
savoir que ma spécialité était en rapport avec l’ecto<strong>de</strong>rme.<br />
■ Introduction<br />
« Les empires <strong>de</strong> l’avenir se construiront sur <strong>la</strong> connaissance. » Albert Einstein<br />
« Le livre est le plus surprenant <strong>de</strong>s multiples instruments <strong>de</strong> l’homme. Les<br />
autres sont <strong>de</strong>s extensions <strong>de</strong> son corps. Le microscope, le télescope, sont <strong>de</strong>s<br />
extensions <strong>de</strong> sa vue, le téléphone une extension <strong>de</strong> sa voix, mais le livre est<br />
une autre chose ; le livre est une extension <strong>de</strong> <strong>la</strong> mémoire et <strong>de</strong> l’imagination.<br />
C’est l’une <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong>s hommes d’être heureux. » Jorge Luis Borges<br />
La <strong>de</strong>rmatologie argentine débuta avec l’arrivée <strong>de</strong>s conquistadors hispaniques. Ils<br />
transmirent leurs maux, amenèrent <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et développèrent à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies cutanées endémiques.<br />
La mé<strong>de</strong>cine aborigène, avec ses hauts et ses bas, a su répondre aux besoins <strong>de</strong> nombreux<br />
groupes <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion, qui créèrent <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> soins à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> magie, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> religion et <strong>de</strong> l’empirisme, guérissant <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et <strong>de</strong>s épidémies chroniques.<br />
Les Espagnols exprimèrent leur admiration pour certaines techniques et modalités<br />
<strong>de</strong>s indigènes, profitant souvent <strong>de</strong>s précieuses propriétés thérapeutiques <strong>de</strong>s espèces<br />
végétales qu’ils envoyèrent plus tard en Espagne. Il faut reconnaître le travail <strong>de</strong> Nicolás<br />
Monar<strong>de</strong>s pour sa c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes à utilisation pharmacologique, employées<br />
avec un grand succès en Europe après l’entreprise <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonisation.<br />
Nicolás V. Greco et Marcial Ignacio Quiroga sont considérés comme les premiers<br />
historiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine. Tous <strong>de</strong>ux stimulèrent <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
19
LUIS DAVID PIERINI<br />
spécialité et <strong>de</strong> ses caractéristiques didactiques et encouragèrent ses a<strong>de</strong>ptes, tout<br />
comme l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans notre pays.<br />
Dans son analyse critique universelle <strong>de</strong> 1944, Nicolás V. Greco rapporte les avatars<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui débuta lorsque Baldomero Sommer présenta sa thèse <strong>de</strong> doctorat<br />
en 1884. Sommer fut le premier professeur à se consacrer à l’enseignement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées en Argentine (1892).<br />
Marcial Ignacio Quiroga, une personnalité éclectique, académicien <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et<br />
d’histoire, décrivit avec maturité l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Argentine.<br />
■ Les groupes indigènes : botanique médicale,<br />
géographie médicale, pathologies<br />
Les groupes indigènes: botanique médicale, géographie médicale, pathologies<br />
Le mot aborigène dérive du <strong>la</strong>tin aborigines, formé <strong>de</strong> ab : « <strong>de</strong>puis » et origo: «origines<br />
», et celui-ci <strong>de</strong> oriri : « naître ». Par conséquent, « <strong>de</strong>puis les origines » on appelle<br />
aborigènes les natifs du territoire que l’on habite.<br />
Le flot migratoire entraîna d’horribles épidémies au sein <strong>de</strong> ces groupes primitifs.<br />
La variole fut l’une <strong>de</strong>s premières ma<strong>la</strong>dies diffusées <strong>de</strong> façon épidémique. Les indigènes<br />
l’appelèrent mal ou ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong>s Espagnols, car selon leur tradition, peut-être bien fondée,<br />
ils ne connurent <strong>la</strong> variole qu’à partir <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols en Amérique. « L’horreur<br />
<strong>de</strong> ces Indiens est indicible, et sans tort, car entrant dans leurs tentes, ils meurent aussi<br />
nombreux que leurs popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>viennent désertées », écrivait un chroniqueur.<br />
Selon les traditions orales, <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> tuberculose étaient <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
inconnues avant <strong>la</strong> conquête.<br />
Suivant Fiz Fernán<strong>de</strong>z, mais avec <strong>de</strong> légères modifications <strong>de</strong> notre part, les paragraphes<br />
suivants détaillent <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> nos aborigènes:<br />
I. Brasilio-Guaranis et groupe Chaco littoral, membres <strong>de</strong> l’ensemble guarani. Il comprend,<br />
outre les propres Guaranis, les Guaycurus (Tobas, Mocobis ou Mocovis, Abipons,<br />
Pi<strong>la</strong>gas), Matacos, Wichis et Charruas, ces <strong>de</strong>rniers liés aux Pampas.<br />
II. Groupes du Nord-Ouest: ils comprennent les Omahuacas, les Apatamas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Puna<br />
et les Diaguitas calchaqui, avec une gran<strong>de</strong> influence inca.<br />
III. Groupe andin et <strong>de</strong>s Sierras centrales: il comprend les Pehuenches, les Huarpes,<br />
les Comechingones <strong>de</strong> Córdoba, les Sanavirones du Río Dulce ou du Río Negro, les Tonocotés<br />
<strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong>l Estero, les Lules et Vile<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Tucumán et les péricordillérans,<br />
ayant tous une enculturation inca.<br />
IV. Pampas: le groupe comprend les Querandis, les Pampas et les Puelches.<br />
V. Patagons ou Tehuelches.<br />
VI. Extrême sud magel<strong>la</strong>nique: Onas, Yaganes et A<strong>la</strong>calufes.<br />
Grands naturalistes et excellents empiristes, guidés par <strong>de</strong>s herboristes reconnus,<br />
ces aborigènes appliquèrent aux besoins <strong>de</strong> leur époque <strong>la</strong> botanique locale. Nous exposerons<br />
ensuite <strong>de</strong> manière extrêmement succincte les caractéristiques <strong>de</strong> ces<br />
groupes.<br />
■ Les groupes Brasilio-Guaranis et Chaco Littoral et Chaco littoral<br />
20<br />
Ils formaient le groupe aborigène le plus nombreux du pays. L’historien Pedro <strong>de</strong><br />
Angelis croit que guaraní provient <strong>de</strong> gua: « peinture », ra: « taché » et ni: signe du<br />
pluriel. C’est-à-dire qu’ils étaient les tachés <strong>de</strong> peinture, ceux qui se peignent. Il écrit:<br />
« Ils couvrent leur corps avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> peinture noire, rouge et jaune, pour se protéger <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> rigueur du soleil, en guise <strong>de</strong> filtres et <strong>de</strong> protecteurs so<strong>la</strong>ires actuels. »
Au moment <strong>de</strong> perdre ses colonies, l’Espagne ne connaissait même pas l’existence <strong>de</strong><br />
quelques-unes <strong>de</strong> ces tribus éparpillées dans l’immensité <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt vierge en raison <strong>de</strong><br />
leur habitat sauvage. De ce fait, l’extermination presque totale d’un bon nombre <strong>de</strong> ces<br />
tribus n’est pas tellement due à l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête mais plutôt aux conséquences désastreuses<br />
<strong>de</strong>s épidémies qu’elles durent subir <strong>de</strong>puis l’arrivée <strong>de</strong>s Européens.<br />
Rappelons que l’étymologie du mot Chaco indique le grand nombre <strong>de</strong> nations qui<br />
peuplent cette région.<br />
1. Guaranis<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
Ils pratiquaient le tatouage*, non seulement comme ornement mais à <strong>de</strong>s fins curatives<br />
pour <strong>de</strong>s patients souffrant d’affections données, au moyen d’incisions faites sur <strong>la</strong><br />
peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> région dorsale et fessière. Ces tatouages étaient appelés « hygiéniques » lorsqu’ils<br />
servaient à sou<strong>la</strong>ger <strong>la</strong> fatigue après <strong>de</strong>s marches accab<strong>la</strong>ntes.<br />
Plusieurs tribus pratiquèrent ce rituel ancestral. Les expressions <strong>de</strong> l’anthropologue<br />
Rubén Pa<strong>la</strong>vecino sont opportunes; il dit à propos <strong>de</strong>s natifs du Chaco: « Le tatouage du<br />
visage est une habitu<strong>de</strong> extrêmement diffusée, commençant chez les pubères et progressant<br />
avec l’âge. L’opération est presque toujours pratiquée par les vieilles <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu,<br />
moyennant le tracé d’un <strong>de</strong>ssin qui sert <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>. La ponction <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau se fait avec <strong>de</strong>s<br />
épines <strong>de</strong> cactus ou <strong>de</strong> poisson, ou bien avec <strong>de</strong>s aiguilles d’os, suivie par l’introduction<br />
d’une matière colorante puis d’un frictionnement énergique. »<br />
Cependant, l’ornement masculin par excellence était le tembetá, <strong>de</strong> formes et substances<br />
diverses, par exemple: du plomb avec <strong>de</strong>s incrustations <strong>de</strong> turquoise ou <strong>de</strong> bois<br />
<strong>de</strong> palo borracho (Chorisia speciosa). Ce<strong>la</strong> représentait le courage, l’agressivité, et c’était<br />
un signe distinctif <strong>de</strong>s jeunes guerriers et <strong>de</strong>s chasseurs.<br />
BOTANIQUE MÉDICALE<br />
Le riche réservoir phytogéographique tropical et subtropical fut employé pour guérir<br />
les affections; son application dépendait <strong>de</strong>s vertus magiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> flore ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> conception<br />
théurgique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Copahu (Copaifera officinalis) (bâton à huile): cette p<strong>la</strong>nte produit une huile résineuse<br />
employée pour guérir les p<strong>la</strong>ies, les ulcérations et les ma<strong>la</strong>dies vénériennes. C’est<br />
l’un <strong>de</strong>s médicaments les plus anciens du Nouveau Continent.<br />
Salsepareille (Zarzaparril<strong>la</strong> smi<strong>la</strong>xsifilítica): en cuisson ou en solution — macération<br />
en vin —, elle jouit d’un prestige thérapeutique pour les affections <strong>de</strong>rmatologiques telles<br />
que <strong>la</strong> gale et les ma<strong>la</strong>dies vénériennes, diffusées par les Espagnols. Elle possédait aussi<br />
une action sudorifique.<br />
Sauge: appliquée sur <strong>la</strong> superficie cutanée, elle servait à faire fuir les insectes.<br />
Mangle (Conocarpus erecta ou Bucia erecta): sa racine rôtie était employée chez les<br />
personnes qui avaient été piquées par les raies.<br />
Carqueja (Yaguareté Caá) (Baccaris chispa): indiquée même aujourd’hui en infusion<br />
(thé) pour sou<strong>la</strong>ger les dyskinésies biliaires, elle était appliquée en ulcérations vénériennes<br />
et chez les lépreux.<br />
Anguay, copal ou benjuí (Styrax leprosus): c’est un arbre d’un bois incorruptible et<br />
imputrescible, utilisé pour construire les églises primitives. On en extrayait un baume<br />
auquel on attribuait <strong>de</strong>s vertus curatives et que l’on appliquait sur <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies, <strong>de</strong>s ulcérations<br />
et <strong>de</strong>s lésions osseuses.<br />
Les sorciers payés adoptèrent sa résine aromatique pour enfumer, comme avec <strong>de</strong><br />
* Le mot tatouage est originaire <strong>de</strong>s îles d’Océanie, <strong>de</strong>s Canacos polynésiens. Tatahu dérive <strong>de</strong> ta : « <strong>de</strong>ssin » et<br />
désigne d’une manière générale les marques et les signes faits sur le corps.<br />
21
LUIS DAVID PIERINI<br />
22<br />
l’encens, l’endroit où ils réalisaient leurs rituels; <strong>de</strong> là le nom iberá payé, mots guaranis<br />
dont le sens littéral est « arbre <strong>de</strong>s sorciers ».<br />
Contrahierba (Dorstenia contra hierba): elle était utilisée dans <strong>de</strong>s bains tiè<strong>de</strong>s et<br />
sous forme d’encens afin <strong>de</strong> traiter certaines formes <strong>de</strong> paralysie. On l’employait aussi<br />
contre <strong>la</strong> rougeole et <strong>la</strong> variole. Ses feuilles et ses racines pilées étaient appliquées pour<br />
soigner <strong>de</strong>s ulcères torpi<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s piqûres <strong>de</strong> serpents.<br />
Arbre corail, « chop » (Erythinia cristagalli): très abondant sur les côtes du Paraná<br />
et ses affluents, les indigènes se servirent <strong>de</strong> son écorce et <strong>de</strong> ses bourgeons pour préparer<br />
<strong>de</strong>s cuissons et <strong>de</strong>s baumes qu’ils appliquaient sur les p<strong>la</strong>ies provoquées par <strong>de</strong>s<br />
griffures ou <strong>de</strong>s morsures <strong>de</strong> jaguar.<br />
Rocou (Bixia orel<strong>la</strong>na): arbre <strong>de</strong> 2 à 5 mètres <strong>de</strong> haut, qui pousse du Mexique jusqu’à<br />
<strong>la</strong> province <strong>de</strong> Chaco, toujours à l’est <strong>de</strong> <strong>la</strong> cordillère. C’est une espèce aux fleurs<br />
voyantes, dont les graines contiennent <strong>de</strong>ux substances colorantes: l’une est jaune (orellina)<br />
et l’autre rouge (cinabre). Cette <strong>de</strong>rnière était employée pour protéger <strong>la</strong> peau car<br />
l’onguent tempérait les rayons ultraviolets. La rocourisation consistait à s’enduire tous<br />
les jours le corps <strong>de</strong> <strong>la</strong> première substance pour éviter les piqûres protéiformes<br />
d’insectes. Indissoluble, elle résistait aux bains et à <strong>la</strong> sueur.<br />
Moisés Bertoni note dans ses Mémoires que tout le corps et le visage <strong>de</strong>s indigènes<br />
présentaient une teinte d’un rouge spécial, pâle bril<strong>la</strong>nt, qui leur donnait un aspect<br />
bizarre mais point désagréable à <strong>la</strong> vue et au toucher car toute trace ou cicatrice s’effaçait,<br />
<strong>la</strong> peau étant satinée. La couleur rouge qu’ils exhibaient fit naître le concept erroné<br />
qu’il existait une race rouge parmi les aborigènes sud-américains.<br />
Les Indiens Yaguas et les guerriers Xikriu, habitants du grand bassin <strong>de</strong> l’Amazone et<br />
<strong>de</strong> l’Orénoque, utilisent toujours le rocou, tout comme leurs ancêtres, pour faire fuir les<br />
insectes et teindre leurs vêtements.<br />
Tabac (Nicotiana tabacum): c’est <strong>la</strong> première espèce botanique mentionnée dans les<br />
références littéraires européennes immédiatement ultérieures à <strong>la</strong> Découverte, constituées<br />
à partir <strong>de</strong>s cahiers <strong>de</strong> bord <strong>de</strong> Christophe Colomb.<br />
À l’aube du Nouveau Mon<strong>de</strong>, on utilisait le tabac pour le fumer et l’aspirer comme du<br />
tabac à priser. Il était habituel d’en sucer le jus et <strong>de</strong> boire l’eau <strong>de</strong> ses feuilles macérées.<br />
Il existait un lien net entre le culte et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, car avant certaines cérémonies — comme<br />
l’initiation <strong>de</strong>s adolescents —, on buvait du jus <strong>de</strong> tabac et on l’aspirait par voie nasale.<br />
On mentionne également son utilisation en aspersion ou en solution colorante pour décorer<br />
<strong>la</strong> peau.<br />
Avant l’époque précolombienne, on l’employait aussi comme principe actif pour les<br />
douleurs et les piqûres, <strong>la</strong> gale et l’érysipèle. Les documents disponibles ne nous permettent<br />
pas d’affirmer que le tabac fût cultivé à cette époque sur le territoire argentin actuel.<br />
Le tabac est <strong>la</strong> seule p<strong>la</strong>nte nocive que nous héritâmes <strong>de</strong> nos aborigènes.<br />
GÉOGRAPHIE MÉDICALE<br />
Juan Carlos Boudin dirait que l’homme ne naît, ne vit, ne souffre ni ne meurt <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
même manière selon les différents endroits du mon<strong>de</strong>. La conception, <strong>la</strong> naissance, <strong>la</strong><br />
vie, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et <strong>la</strong> mort varient selon le climat et le sol, selon les saisons et les mois,<br />
selon <strong>la</strong> race et <strong>la</strong> nationalité.<br />
Les chroniques enregistrent une inci<strong>de</strong>nce manifeste <strong>de</strong>s pathologies tropicales et<br />
subtropicales parmi les Guaranis. Entérite, entérocolite, ankylostomiase, dysenterie,<br />
paludisme, necatorose et autres parasitoses font partie <strong>de</strong> ces infestations par vers, némathelminthes<br />
et p<strong>la</strong>thelminthes. Des arthropo<strong>de</strong>s venimeux tels que les myriapo<strong>de</strong>s,<br />
les scorpions et les araignées provoquaient beaucoup d’acci<strong>de</strong>nts à cause <strong>de</strong> leur poison.<br />
Les insectes transmetteurs et vecteurs <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies tels que les mouches, les moustiques,<br />
les puces et les poux contribuèrent également à maintenir un taux <strong>de</strong> morbidité<br />
significatif.
Nous <strong>de</strong>vons aussi rappeler les ma<strong>la</strong>dies importées: <strong>la</strong> tuberculose, <strong>la</strong> variole et, selon<br />
certaines théories, <strong>la</strong> syphilis, entre autres, qui provoquaient d’innombrables décès.<br />
2. Guaycurus<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
D’après Salvador Canals Frau, <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> famille <strong>de</strong>s Guaycurus avait une origine patagonique<br />
et était composée <strong>de</strong>s Tobas, <strong>de</strong>s Mocovis, <strong>de</strong>s Abipons, <strong>de</strong>s Pi<strong>la</strong>gas, <strong>de</strong>s Payaguas<br />
et <strong>de</strong>s Mbayes. Les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers groupes disparurent il y a longtemps.<br />
Comme trait général, il faut remarquer que les hommes peignaient leur corps au lieu<br />
<strong>de</strong> mettre <strong>de</strong>s vêtements.<br />
A) TOBAS<br />
La mé<strong>de</strong>cine native traditionnelle <strong>de</strong>s Tobas possè<strong>de</strong> une pharmacopée éclectique appliquée<br />
aux p<strong>la</strong>ies, aux fractures, aux entorses, aux ulcérations, aux morsures et aux parasitoses.<br />
Des substances diverses appartenant aux <strong>de</strong>ux autres royaumes <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature<br />
enrichissent <strong>la</strong> vaste étagère pharmacologique <strong>de</strong> ces popu<strong>la</strong>tions primitives, où le rituel,<br />
les cantiques, le son monotone <strong>de</strong>s tambours, <strong>la</strong> fumée du tabac, les conjurations et les<br />
invocations d’agents surnaturels, dramatisés par le mé<strong>de</strong>cin-sorcier, créent le contexte<br />
thérapeutique adéquat aux structures sociales <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté.<br />
B) MOCOBIS OU MOCOVIS<br />
Selon un chroniqueur, « ils soignaient les blessures en les attachant à peine, tout<br />
comme les fractures <strong>de</strong>s os, et ils ont une chair si saine qu’en peu <strong>de</strong> temps elle se sou<strong>de</strong><br />
et gonfle peu. Et ils ont même vu un Indien, égratigné par un tigre aux griffes vénéneuses,<br />
guérir sans aucune enflure ».<br />
Tatouages, ornements<br />
Tout comme leurs voisins, les Abipons s’exercèrent à l’art du tatouage. Pour les filles,<br />
on réalisait <strong>de</strong>s gravures sur leur buste. Selon <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription du Père Manuel Cane<strong>la</strong>s,<br />
cette opération se faisait en utilisant certaines épines enduites <strong>de</strong> couleurs diverses,<br />
notamment le noir et le bleu. « La douleur et l’enflure qu’elles subissaient, restant<br />
enfermées un mois environ, souffrant jusqu’à paraître monstrueuses, [étaient] pour<br />
<strong>de</strong>venir belles, [mais] seulement à leur avis. » Les zones <strong>la</strong>crymales, les angles externes<br />
<strong>de</strong> l’œil et <strong>la</strong> zone située entre les sourcils représentaient les autres endroits privilégiés.<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
Bien que les enfants fussent habitués à <strong>la</strong> nature hostile car ils déambu<strong>la</strong>ient nus, ils<br />
ne purent pas éviter les piqûres d’insectes, spécialement <strong>de</strong>s moustiques, malgré l’effort<br />
<strong>de</strong> leurs parents pour les atténuer. Ils utilisaient pour ce<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse <strong>de</strong> nandou ou <strong>de</strong><br />
poisson qu’ils mé<strong>la</strong>ngeaient à <strong>de</strong>s résines et qu’ils frictionnaient ensuite sur toute <strong>la</strong> superficie<br />
corporelle.<br />
Ils étaient également torturés par <strong>la</strong> chique, nom vulgaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> nigua (Sarcopsyl<strong>la</strong><br />
penetrans) en Argentine et au Paraguay. Cet agent est une puce <strong>de</strong> l’Amérique tropicale<br />
et subtropicale qui attaque l’homme en pénétrant sous l’épi<strong>de</strong>rme <strong>de</strong>s pieds, notamment<br />
les ongles. Ses petits œufs ont une couleur jaune, ils n’émergent pas vers l’extérieur et<br />
se développent au niveau <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns sous-tégumentaires. Ils forment <strong>de</strong> petits abcès exigeant<br />
parfois un drainage chirurgical. Cette affection douloureuse, accompagnée <strong>de</strong> prurit<br />
et d’autres <strong>de</strong>rmatoses, était traitée avec <strong>de</strong>s préparations à base <strong>de</strong> graisse et <strong>de</strong><br />
poudre <strong>de</strong> canthari<strong>de</strong>.<br />
Les mycoses cutanées, <strong>la</strong> syphilis, les réactions <strong>de</strong>rmatologiques probablement d’origine<br />
allergique et <strong>la</strong> leishmaniose étaient traitées avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse phosphorée, comme<br />
le musc <strong>de</strong> yacaré.<br />
23
LUIS DAVID PIERINI<br />
24<br />
Les premières <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong>s témoignages historiques correspondant à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s<br />
différentes du nomadisme et du sé<strong>de</strong>ntarisme <strong>de</strong>s Mocovis coïnci<strong>de</strong>nt avec leur affirmation<br />
que, grâce à <strong>la</strong> sélection naturelle propre, les ma<strong>la</strong>dies étaient rares, sauf les ma<strong>la</strong>dies<br />
épidémiques. Lorsque ces pathologies se diffusaient, tous les indigènes fuyaient. On<br />
ne connaissait pas <strong>de</strong> pire ca<strong>la</strong>mité. En conséquence, <strong>la</strong> mère ou le père s’éloignaient et<br />
<strong>la</strong>issaient les enfants affectés dans le plus grand abandon; ils p<strong>la</strong>çaient une cruche d’eau<br />
juste au chevet du lit, <strong>de</strong> <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> rôtie et <strong>de</strong>s fruits sauvages.<br />
En 1745, une épidémie dévastatrice attaqua 30 peup<strong>la</strong><strong>de</strong>s du Paraguay et ses voisines,<br />
fauchant <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> 72 000 natifs <strong>de</strong> toutes âges. En 1760, San Javier, <strong>la</strong> zone où habitaient<br />
les indiens mocovis convertis au christianisme, dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Santa Fe,<br />
connut une nouvelle recru<strong>de</strong>scence <strong>de</strong> l’épidémie, qui tua 800 aborigènes.<br />
Quant aux médicaments — <strong>la</strong> vaccination antivariolique d’Edward Jenner ne se diffusera<br />
comme prophy<strong>la</strong>xie qu’à partir <strong>de</strong> 1796 —, l’eau d’orge et <strong>de</strong> lin, l’eau sucrée avec<br />
<strong>de</strong>s pépins <strong>de</strong> pastèque ou <strong>de</strong> melon comme boisson rafraîchissante, et <strong>de</strong>s calebasses<br />
pilées étaient les ressources pharmacologiques <strong>de</strong> cette époque.<br />
Herboristerie<br />
Nous mentionnerons quelques spécimens:<br />
Mistol (Ziziphus mistol): connu également <strong>de</strong>s autres ethnies, cet arbre à belle allure est<br />
très répandu dans les bois <strong>de</strong> Santa Fe et <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong>l Estero. Il produit un fruit doux,<br />
rouge, avec lequel on fait l’aloja; ses feuilles sont utilisées pour soigner les blessures.<br />
Cebil : p<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille <strong>de</strong>s mimosées; ses feuilles et son écorce macérées furent<br />
appliquées comme emplâtre sur les lésions muti<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre.<br />
Guayacán : outre son pouvoir <strong>de</strong> sou<strong>la</strong>ger les ma<strong>la</strong>dies rhumatisantes et les algies <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> goutte, sa résine fut employée pour neutraliser les complications <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis. Nos indigènes buvaient ses feuilles et son écorce en infusion<br />
comme fortifiant général.<br />
Palmier pindo ou palmier grand (Coco Romango flianum): cette espèce très appréciée<br />
pour <strong>la</strong> construction <strong>de</strong>s toits <strong>de</strong>s habitations était également utilisée pour <strong>la</strong> fabrication<br />
<strong>de</strong> plusieurs ustensiles, et ses bourgeons servaient <strong>de</strong> nourriture.<br />
Cette variété héberge un vers b<strong>la</strong>nc <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille d’un doigt que les natifs appellent<br />
tombú. Le docteur Esteban Laureano Maradona raconte qu’en mettant ce ver — « ver<br />
à donner <strong>la</strong> chair <strong>de</strong> poule » — au feu, il sécrète une huile que les indigènes utilisent<br />
pour soigner les blessures. Ils mangent sa chair cuite comme s’il s’agissait <strong>de</strong> vian<strong>de</strong><br />
grillée.<br />
Ortie dioca (Ortie majeure): dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire et aborigène, elle est indiquée<br />
pour quasiment tous les systèmes et les appareils. On en faisait l’éloge pour sa fonction<br />
ga<strong>la</strong>ctogène et diurétique, et pour son action sur le follicule pileux.<br />
Solimán ou canine <strong>de</strong> serpent : il fut employé par les aborigènes comme antiophidien.<br />
Les zones fréquentées par les autochtones, où pullulent le serpent <strong>de</strong> corail (E<strong>la</strong>ps<br />
corallino), le serpent à sonnette (Crotalus terrificus) et le serpent <strong>de</strong> <strong>la</strong> croix ou yarará<br />
(Lachesis alternatus), dont les piqûres peuvent être mortelles, font partie d’un vaste territoire<br />
propice à l’ophidisme.<br />
Capucine: elle fut employée en cuisson pour neutraliser <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong>rmatologiques,<br />
le scorbut et diverses formes <strong>de</strong> tuberculose pulmonaire.<br />
C) ABIPONS<br />
Herboristerie<br />
La variété botanique polychrome permit aux natifs du Grand Chaco <strong>de</strong> créer une sorte<br />
<strong>de</strong> pharmacopée où se rassemb<strong>la</strong>ient <strong>de</strong>s connaissances empiriques et <strong>de</strong> sorcellerie<br />
chamanique. Nous mentionnerons quelques variétés:
Abariguay : on préparait un baume employé pour guérir les blessures. Les indigènes<br />
croyaient que son application buccale arrêtait les hémorragies et les accès <strong>de</strong> toux.<br />
Ambay (Cecropia a<strong>de</strong>nopus): il fut mentionné comme traitement antivénérien et<br />
comme élément <strong>de</strong> friction pour obtenir du feu.<br />
Quinoa: p<strong>la</strong>nte légumineuse qui servait comme aliment et qui en plus était appliquée<br />
comme catap<strong>la</strong>sme sur <strong>la</strong> partie blessée ou traumatisée.<br />
Salsepareille: contre les morsures et les piqûres d’animaux venimeux.<br />
Pathologies<br />
Malgré <strong>la</strong> constitution privilégié <strong>de</strong>s Abipons, les ma<strong>la</strong>dies surgies <strong>de</strong> l’écologie régionale,<br />
les insectes et les parasites, les guerres internes et externes, ajoutés aux affections<br />
transmises par l’homme b<strong>la</strong>nc, entraînèrent quasiment l’extinction <strong>de</strong> cette race. Les<br />
épidémies firent également sentir leurs effets; en 1734, <strong>la</strong> variole tua 30 000 habitants,<br />
adultes et enfants.<br />
Un autre fléau mentionné est le « pique », « bestiole <strong>de</strong> pied » ou agrani, mot abipon<br />
qui signifie « bâillon ».<br />
Ces groupes reconnurent l’action hématophage du triatome (vinchuca ou Triatoma infestans),<br />
qu’ils appe<strong>la</strong>ient « sangsue ailée », ainsi que les complications produites par les<br />
piqûres <strong>de</strong> guêpes, d’arachni<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> scorpions.<br />
Symboles <strong>de</strong> beauté<br />
La perforation <strong>de</strong>s oreilles se faisait avec <strong>de</strong> petits morceaux d’os, <strong>de</strong>s éc<strong>la</strong>ts <strong>de</strong> bois<br />
ou <strong>de</strong> petites cornes <strong>de</strong> cerf; on introduisait ensuite une feuille <strong>de</strong> palmier enroulée qui<br />
servait à agrandir l’orifice par distension, afin que le lobe puisse tomber jusqu’à l’épaule.<br />
Le tatouage, diffusé entre les cultures <strong>américaine</strong>s, découvrait son expression raffinée<br />
parmi les Abipons, qui scarifiaient <strong>la</strong> peau du visage, <strong>de</strong> <strong>la</strong> poitrine et <strong>de</strong>s bras. Le<br />
ciseau primitif était une épine rigi<strong>de</strong> qui fixait dans le <strong>de</strong>rme <strong>de</strong>s teintures végétales, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> suie et <strong>de</strong>s cendres. Les filigranes <strong>de</strong> ce sceau indélébile constituèrent un b<strong>la</strong>son <strong>de</strong><br />
différenciation tribale.<br />
Quasiment tous les peuples <strong>de</strong> Paracuaria * étaient tatoués. Les Abipons reconnurent<br />
cet art sous le nom <strong>de</strong> likinrana<strong>la</strong>. Consultés sur <strong>la</strong> signification ou <strong>la</strong> cause <strong>de</strong> cette coutume<br />
barbare, les aborigènes répondaient qu’ils l’avaient héritée <strong>de</strong> leurs ancêtres. Ce<br />
supplice durait cinq jours, pendant lesquels l’adolescente restait enfermée dans sa hutte,<br />
couverte d’une peau, se privant <strong>de</strong> certains aliments comme <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> et le poisson. Les<br />
séances répétées et rapprochées illuminaient le visage, provoquant œdème et tuméfaction.<br />
Depuis leur plus jeune âge, les filles s’épi<strong>la</strong>ient les sourcils et les cils, et se rasaient<br />
partiellement <strong>la</strong> chevelure comme élément d’i<strong>de</strong>ntification tribale.<br />
D) PILAGAS<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
Ornement<br />
Pour peigner leurs cheveux, très abondants, ils se servaient <strong>de</strong> peignes fabriqués avec<br />
<strong>de</strong>s petits bâtons; ils portaient aussi <strong>de</strong>s boucles d’oreilles fabriquées avec ces mêmes<br />
éléments. Nous allons nous attar<strong>de</strong>r sur <strong>la</strong> perforation <strong>de</strong>s oreilles: ces muti<strong>la</strong>tions<br />
étaient pratiquées chez les <strong>de</strong>ux sexes, en introduisant <strong>de</strong>s boutons <strong>de</strong> bois ou <strong>de</strong>s<br />
feuilles <strong>de</strong> palmier enroulées. Le trou se di<strong>la</strong>tait jusqu’à permettre le passage d’un disque<br />
<strong>de</strong> 4 à 5 centimètres.<br />
Ils pratiquaient l’épi<strong>la</strong>tion et décoraient leur peau avec <strong>de</strong>s peintures diverses. Ils<br />
marchaient habituellement pieds nus.<br />
* Paracuaria : vaste zone d’Amérique du Sud où se sont installées les missions jésuites; sa capitale était Córdoba<br />
<strong>de</strong>l Tucumán.<br />
25
LUIS DAVID PIERINI<br />
26<br />
Tatouages<br />
Le tatouage se diffusa beaucoup parmi les Pi<strong>la</strong>gas du fleuve Pilcomayo. Cet art magique et<br />
difficile était pratiqué avec <strong>de</strong>s aiguilles <strong>de</strong> cardon, en frottant sur <strong>la</strong> peau pointillée diverses substances,<br />
dont <strong>la</strong> suie. Les tatouages <strong>de</strong>s enfants représentaient <strong>de</strong>s figures géométriques: <strong>de</strong>s<br />
ovales, <strong>de</strong>s cercles et <strong>de</strong>s losanges, divisés par <strong>de</strong>s diamètres, <strong>de</strong>s diagonales et <strong>de</strong>s rectangles.<br />
Les réponses données quant aux motivations <strong>de</strong> ces tatouages étaient : « c’est <strong>la</strong><br />
marque pi<strong>la</strong>ga », « c’est pour qu’ils n’aient pas <strong>la</strong> peste » ou « pour être immunisé ».<br />
3. Matacos<br />
Botanique médicale<br />
Les naturalistes qui s’enfoncèrent dans l’intimité <strong>de</strong> l’épaisseur amazonienne ou qui<br />
atteignirent les bords <strong>de</strong> ses rivières rassemblèrent <strong>de</strong>s observations phytologiques<br />
exceptionnelles. Nous mentionnerons quelques espèces:<br />
Palo santo (ou palo bendito ou guayacán): toutes les tribus du Nord-Est l’employaient<br />
pour <strong>de</strong>s affections diverses. Le frère jésuite Pedro <strong>de</strong> Montenegro, chirurgien et herboriste<br />
réputé du Paraguay, résuma dans sa Materia médica [Matière médicale], écrite au début du<br />
XVIII e siècle, toutes les applications <strong>de</strong> cette variété arborescente. Connu en Europe comme<br />
une panacée, il fut utilisé pour traiter <strong>la</strong> syphilis, les arthropathies et les troubles <strong>de</strong> <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion.<br />
La résine <strong>de</strong> l’écorce servait dans ces préparations et on lui attribuait <strong>de</strong>s propriétés<br />
diurétiques, diaphorétiques et cathartiques. La résine, mé<strong>la</strong>ngée à <strong>la</strong> graisse d’autruche<br />
ou <strong>de</strong> poisson et appliquée sur <strong>la</strong> peau, faisait fuir les moustiques. Actuellement le palo santo<br />
entre dans <strong>la</strong> composition <strong>de</strong>s produits antimoustiques.<br />
Ceibo ou seibo: l’écorce pilée fut utilisée comme catap<strong>la</strong>sme sur les morsures d’animaux.<br />
Les prescriptions popu<strong>la</strong>ires pour le traitement d’ulcères, <strong>de</strong> rectites, d’hémorroï<strong>de</strong>s<br />
et <strong>de</strong> vaginites l’utilisent toujours sous forme <strong>de</strong> cuisson.<br />
Yetibay ou ja<strong>la</strong>pa: le jus <strong>de</strong> ses fleurs tout juste pressées fut employé pour les otites<br />
infantiles et les éruptions herpétiques.<br />
Ayuy ou <strong>la</strong>urier: arbre d’un bois résistant, ses fruits furent employés pour traiter les<br />
troubles digestifs infantiles et <strong>la</strong> scrofulose; trituré avec du miel, il était appliqué sur <strong>de</strong>s<br />
ulcérations chroniques. Sous forme <strong>de</strong> liniment il était prescrit pour <strong>la</strong> phlogose rhumatisante,<br />
les névralgies et le prurit <strong>de</strong> <strong>la</strong> gale.<br />
Oruzuz (Phy<strong>la</strong> scaberrima): en infusion, il était employée pour les rhumes et les aphonies;<br />
on l’utilisait en plus pour traiter les érysipèles comme sinapisme ou en forme <strong>de</strong> pâte.<br />
Cancha<strong>la</strong>gua (Erythrea chilensis): elle était administrée en infusion, et servait également<br />
pour sou<strong>la</strong>ger les douleurs <strong>de</strong>s personnes souffrant <strong>de</strong> rhumatismes ou <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
vénériennes.<br />
Totora (Schoenoplectus californicus): ses fleurs étaient appliquées sur les brûlures<br />
tandis que ses racines cuites étaient employées pour <strong>la</strong>ver les ulcères et les tumeurs.<br />
Tusca (Acacia caven): son fruit était grillé et bouilli et on buvait ensuite <strong>la</strong> préparation.<br />
Elle était indiquée à jeun et on <strong>la</strong> conseil<strong>la</strong>it pour les infections gonococciques.<br />
Tabac : le docteur Esteban Maradona, un mé<strong>de</strong>cin réputé <strong>de</strong> Formosa et chercheur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> flore du Chaco central, raconte dans son livre A través <strong>de</strong> <strong>la</strong> selva [À travers <strong>la</strong><br />
forêt] qu’en cas <strong>de</strong> piqûres <strong>de</strong> serpent, les indigènes suçaient <strong>la</strong> partie affectée comme<br />
une ventouse, après avoir mâché <strong>de</strong>s feuilles <strong>de</strong> tabac. D’autres parties <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte sont<br />
également employées, telles les racines et les graines, avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse ou sans, avec<br />
<strong>de</strong>s résines ou pas et avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> poudre <strong>de</strong> valve.<br />
4. Wichis ou Wichís et Charruas<br />
Le mot wichi signifie « hommes véritables » ou « hommes à vie pleine », c’est-à-dire<br />
qui participent <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes, <strong>de</strong>s arbres, <strong>de</strong>s poissons et <strong>de</strong>s oiseaux.
Les Espagnols les appelèrent <strong>de</strong> façon erronée Matacos, terme qui vou<strong>la</strong>it dire en<br />
ancien castil<strong>la</strong>n « animal sans envergure » ou « animal sans importance ». Ils nommèrent<br />
Mataguayos les premiers indigènes qu’ils connurent (1623).<br />
Nous pouvons dire qu’il s’agit d’une <strong>de</strong>s communautés les plus anciennes au mon<strong>de</strong>.<br />
Même aujourd’hui, isolée au nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> République argentine, elle lutte pour subsister<br />
dans le mon<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne.<br />
La tuberculose, <strong>la</strong> malnutrition, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Chagas, les ma<strong>la</strong>dies vénériennes, le<br />
choléra et <strong>la</strong> brucellose décimèrent ces communautés, renforcées par un régime non<br />
équilibré, basé essentiellement sur le maïs, le potiron, <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> chèvre, le poisson et<br />
les fruits mais qui manquait <strong>de</strong> légumes.<br />
Groupes du Nord-ouest<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
■ Les groupes du Nord-Ouest<br />
Ce groupe connaissait les eaux thermales. Les miroirs d’eau, les températures propices,<br />
le tapis <strong>de</strong> vegas et mallines et <strong>la</strong> prolifération d’exemp<strong>la</strong>ires arborescents comme<br />
le faux poivrier créèrent un paysage bucolique où <strong>la</strong> vie <strong>de</strong>s familles natives s’écou<strong>la</strong> sans<br />
les angoisses ni les sursauts <strong>de</strong>s autres ethnies.<br />
L’Amérique indigène prit en compte le mythe universel <strong>de</strong> <strong>la</strong> source <strong>de</strong> Jouvence; les<br />
habitants protohistoriques <strong>de</strong> différentes époques incorporèrent <strong>la</strong> connaissance et <strong>la</strong> valorisation<br />
<strong>de</strong>s effets thérapeutiques <strong>de</strong>s eaux que Pachamama (Terre Mère) fournissait<br />
généreusement à ses enfants. Ils fréquentèrent les eaux thermales, avec <strong>de</strong>s fumerolles<br />
bouil<strong>la</strong>ntes, <strong>de</strong>s sources chau<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s effluves soufrés qui formaient <strong>de</strong>s miroirs d’eau<br />
chau<strong>de</strong> et vivifiante.<br />
Depuis <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pré-inca, <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Cuyo connaissait le bain d’Uyurmire et celui<br />
<strong>de</strong> l’Inca, dans le temple <strong>de</strong> Wiracocha (ou Viracocha).<br />
Une autre source liée à <strong>la</strong> dévotion indigène, à cause <strong>de</strong> sa richesse légendaire et <strong>la</strong><br />
vertu <strong>de</strong> ses versants, est celle qui jaillit à l’endroit appelé La Laja. C’est ici que l’amoureux<br />
huarpe Yahue, après avoir tué <strong>la</strong> douce Tahue et l’homme qui l’avait séduite,<br />
mourut sur les terrains rocailleux <strong>de</strong> San Juan en ré<strong>de</strong>mption <strong>de</strong> cette tragédie; après<br />
sa mort, trois sources miraculeuses jaillirent telle une source d’espoir.<br />
D’autres natifs <strong>de</strong> notre territoire se rendirent aussi à un bon nombre <strong>de</strong> bains et <strong>de</strong><br />
sources. Les Araucans visitaient Copahue et Futa<strong>la</strong>uquen et ils connurent également Cullu-co<br />
(eaux aci<strong>de</strong>s) et Laguen-co (eaux chau<strong>de</strong>s). Les Indiens qui traversaient <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires connurent le <strong>la</strong>gon d’Epecuén. Selon Tomás Falkner, les chefs indiens et leurs familles<br />
venaient à ces eaux tonifiantes <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s temps immémoriaux. Les traditions vernacu<strong>la</strong>ires<br />
racontent que le cacique puelche Carhué (« cœur pur »), passionné d’Epecuén, guérit d’une<br />
étrange paralysie en se plongeant dans l’étang formé par les <strong>la</strong>rmes d’amour <strong>de</strong> sa bien-aimée.<br />
Les Diaguitas <strong>de</strong> Ta<strong>la</strong>casto <strong>la</strong>issèrent aussi leur peine indienne à travers les terres<br />
calcinées <strong>de</strong> leurs aïeux, dans une source d’eau potable surgie <strong>de</strong>s pleurs incessants d’un<br />
beau jeune homme qui vit périr sa bien-aimée à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> haine atavique envers les<br />
envahisseurs incas. Les natifs méditerranéens appelèrent Inti-Yacu (« eau du soleil ») <strong>la</strong><br />
zone actuelle <strong>de</strong> Río Hondo (Santiago <strong>de</strong>l Estero), dont les cours d’eau surgissaient <strong>de</strong>s<br />
déversoirs comme <strong>de</strong>s vivifiants. Les habitants associaient les bontés <strong>de</strong> Yacuru-pay (« eau<br />
chau<strong>de</strong> ») aux rayons f<strong>la</strong>mboyants <strong>de</strong> l’astre soleil, qu’ils adoraient.<br />
Alonso Ovalle fait référence dans un livre publié à Rome, en 1646, à <strong>la</strong> chaleur, au goût<br />
saumâtre et à <strong>la</strong> minéralisation <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> Puente <strong>de</strong>l Inca, sans nous en révéler l’explication<br />
scientifique. Son compte rendu est une <strong>de</strong>scription picturale <strong>de</strong> ce monument<br />
enc<strong>la</strong>vé dans <strong>la</strong> précordillère, où l’auteur exalte cette curieuse expression <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature.<br />
Selon Michel Horst von Brand, <strong>la</strong> première analyse <strong>de</strong>s eaux thermales argentines fut<br />
effectuée par le physicien et chimiste Michel Faraday en 1827, à partir d’échantillons<br />
pris à cet endroit.<br />
27
LUIS DAVID PIERINI<br />
Selon le témoignage <strong>de</strong> voyageurs, Vil<strong>la</strong>vicencio fut visitée par le célèbre naturaliste<br />
Charles Darwin en 1839. Déjà <strong>de</strong>puis 1800, les vil<strong>la</strong>geois et les voisins <strong>de</strong> Mendoza s’y<br />
rendaient en quête <strong>de</strong> ses qualités bénéfiques.<br />
■ Le Le groupe andin andin et <strong>de</strong>s Sierras et <strong>de</strong>s Centrales Sierras centrales<br />
Il est formé <strong>de</strong>s Pehuenches, <strong>de</strong>s Huarpes, <strong>de</strong>s Comechingons <strong>de</strong> Córdoba, <strong>de</strong>s Sanavirons<br />
du Río Dulce ou <strong>de</strong> Río Negro, <strong>de</strong>s Tonocotés <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong>l Estero, <strong>de</strong>s Lules et<br />
Vile<strong>la</strong>s <strong>de</strong> Tucumán et <strong>de</strong>s Araucans <strong>de</strong> <strong>la</strong> précordillère, ayant tous une enculturation<br />
inca.<br />
Botanique médicale<br />
Cannelier (Drymis winteri): il appartient à <strong>la</strong> famille <strong>de</strong>s magnoliacées. Il mesure<br />
8 mètres environ et se développe habituellement sur <strong>de</strong>s terres humi<strong>de</strong>s. Il fut introduit<br />
en Europe par John Winter, mé<strong>de</strong>cin du corsaire ang<strong>la</strong>is Francis Drake, d’où sa dénomination<br />
technique. L’écorce <strong>de</strong> cet arbre fut employée aussi bien en infusions qu’en applications<br />
externes. P<strong>la</strong>nte sacrée <strong>de</strong>s Mapuches, on l’utilisait pour les altérations <strong>de</strong><br />
l’appareil digestif, les parasitoses (gale) et le rhumatisme. La « fleur <strong>de</strong>s cendres » <strong>de</strong> cet<br />
arbre, mé<strong>la</strong>ngée à <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse comme excipient, était aussi employée comme dépi<strong>la</strong>toire;<br />
c’est à cause <strong>de</strong> cette coutume qu’on attribua <strong>de</strong> manière erronée aux jeunes<br />
Mapuches l’absence <strong>de</strong> duvet. Son action par influx sympathique était indispensable<br />
dans toutes les cérémonies magico-évocatrices. Dans le bois, <strong>la</strong> machi prenait soin d’un<br />
cannelier favori et, selon <strong>la</strong> croyance araucane rapportée par Ramón Pardal, si quelqu’un<br />
découvrait et coupait cette p<strong>la</strong>nte, <strong>la</strong> machi <strong>la</strong>nguissait et mourait.<br />
Lafo (Rumex romasa): p<strong>la</strong>nte polygonacée. Très utilisée par les Araucans du Chili, elle<br />
était l’une <strong>de</strong>s herbes les plus précieuses. Étant donné ses qualités pharmacologiques<br />
multiples, elle jouissait d’une gran<strong>de</strong> renommée dans <strong>la</strong> guérison <strong>de</strong>s blessures, <strong>de</strong>s ulcérations<br />
torpi<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s otites et <strong>de</strong>s « lèpres <strong>de</strong>s enfants, qui <strong>la</strong>issent <strong>la</strong> tête propre ».<br />
Ñincuil (Heliantus thurífera): selon Martín Gusin<strong>de</strong>, elle était reconnue comme une<br />
merveille <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne et on lui attribuait une action antiluétique.<br />
Jaril<strong>la</strong> (Larrea nítida cavanilles): parmi ses applications thérapeutiques, cet arbuste<br />
fut employé sous forme <strong>de</strong> catap<strong>la</strong>sme pour soigner <strong>de</strong>s abcès et <strong>de</strong>s phlegmons.<br />
Pour terminer cette sélection botanique nous voulons reconnaître les mérites inestimables<br />
du professeur Juan A. Domínguez, qui réalisa d’importantes étu<strong>de</strong>s analytiques<br />
sur <strong>la</strong> composition <strong>de</strong>s médicaments végétaux, réussissant à faire <strong>la</strong> synthèse pharmacodynamique<br />
du vivier araucan.<br />
■ Pampas, Querandis et Puelches et Puelches<br />
28<br />
On appelle Pampas un regroupement humain d’origine mixte, face auxquels se trouva<br />
Sebastián Gaboto à l’embouchure du Carcarañá, leur donnant le nom <strong>de</strong> Querandis<br />
(« hommes avec graisse »).<br />
Face à <strong>la</strong> variole, dans les cas d’anthrax ou d’abcès, ces aborigènes provoquaient leur<br />
maturation en appliquant <strong>de</strong>s catap<strong>la</strong>smes <strong>de</strong> fumier très chaud. « À terme, ils extirpent<br />
le germe à l’ai<strong>de</strong> d’un crin plié et il le mangent ensuite entre <strong>de</strong>ux bouchées <strong>de</strong> vian<strong>de</strong><br />
crue, prétendant ainsi conjurer toute rechute. »<br />
Les Puelches Guenakén, qui habitaient <strong>la</strong> partie nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patagonie, étaient, selon<br />
José Sánchez Labrador, « d’une nature très forte et d’une condition telle qu’ils se
établissaient plusieurs fois <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies et <strong>de</strong> blessures qui seraient mortelles pour les<br />
autres sans mé<strong>de</strong>cine. »<br />
Herboristerie<br />
Du fait d’être <strong>de</strong> grands naturalistes et d’excellents empiristes, guidés par <strong>de</strong>s herboristes<br />
reconnus, ils appliquèrent <strong>la</strong> botanique qui faisait partie du paysage aux besoins <strong>de</strong> leur époque.<br />
On dispose d’informations rares sur les éléments naturels que les aborigènes <strong>de</strong> cette<br />
ethnie utilisaient pour traiter les problèmes <strong>de</strong>rmatologiques; on sait seulement qu’ils employaient<br />
une variété <strong>de</strong> yang, qu’ils appliquaient sur les ulcérations et les aphtes buccaux.<br />
Patagons ou Tehuelches<br />
La région au sud du fleuve Colorado, limite naturelle entre les provinces <strong>de</strong> La Pampa<br />
et Río Negro — <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine <strong>la</strong> plus australe d’Amérique —, est mondialement connue sous<br />
le nom <strong>de</strong> Patagonie, évoquant les mythiques<br />
« géants patagons » décrits par<br />
Antonio Pigafetta en 1520, chroniqueur<br />
du voyage <strong>de</strong> Fernand <strong>de</strong> Magel<strong>la</strong>n.<br />
Naissance et éducation<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
Peu après <strong>la</strong> naissance, les nouveaunés<br />
étaient enduits avec du gypse humi<strong>de</strong>.<br />
Selon Ludwig Karsten (1926), cette procédure<br />
visait à protéger l’enfant <strong>de</strong>s mauvais<br />
esprits. Cet auteur mentionne<br />
d’autres pratiques telles que l’application<br />
<strong>de</strong> peinture rouge, l’onction et les fumigations<br />
<strong>de</strong> tabac.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> quatrième année <strong>de</strong> l’enfant,<br />
on effectuait <strong>la</strong> cérémonie <strong>de</strong> perforation<br />
d’une oreille ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux selon le<br />
sexe, en introduisant <strong>de</strong>s crins <strong>de</strong> cheval<br />
dans les incisions afin d’éviter <strong>la</strong> cicatrisation.<br />
Ils avaient conscience <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
épidémiques, sans pouvoir les nommer<br />
pour autant; pour s’en prémunir, ils dép<strong>la</strong>çaient<br />
régulièrement leurs tentes au<br />
sein du territoire qu’ils occupaient<br />
En général, les Patagons jouissaient<br />
d’une bonne santé, leurs blessures guérissaient<br />
vite ; à travers les cérémonies<br />
décrites, le sorcier indiquait <strong>la</strong> préparation<br />
<strong>de</strong> breuvages aux propriétés médicales<br />
et curatives. Ils connaissaient <strong>la</strong><br />
saignée et savaient ouvrir une veine avec<br />
un morceau <strong>de</strong> coquille ou <strong>de</strong> silex.<br />
■ Patagons ou Tehuelches<br />
29<br />
Distribution <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
indigène en<br />
Argentine à <strong>la</strong><br />
fin du<br />
XX e siècle<br />
Source :<br />
Instituto <strong>de</strong><br />
Cultura<br />
Popu<strong>la</strong>r<br />
(Incupo-En<strong>de</strong>pa).
LUIS DAVID PIERINI<br />
Ectoparasitoses<br />
L’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ine <strong>de</strong> guanaco et <strong>de</strong>s plumes d’autruche aussi bien pour s’habiller<br />
que pour <strong>la</strong> maison étant répandue, les enfants et les adultes étaient exposés aux puces<br />
et aux poux.<br />
■ Extrême Sud Sud Magel<strong>la</strong>nique magel<strong>la</strong>nique<br />
Les ma<strong>la</strong>dies vénériennes scellèrent un horizon sans espoir chez les A<strong>la</strong>calufes, les<br />
Onas et les Yaganes. On suppose qu’ils ne connurent pas les herbes ni les dérivés animaux<br />
et minéraux pour guérir les ma<strong>la</strong>dies.<br />
La transculturation fut un autre mécanisme négatif pour <strong>la</strong> survie <strong>de</strong> ces ethnies, tout<br />
comme l’exhibition impitoyable à <strong>la</strong>quelle ils furent soumis au XIX e siècle dans les différentes<br />
villes européennes.<br />
■ Épilogue<br />
L’auteur rejoint les grands généalogistes Diego Herrera Vegas et Carlos Jáuregui<br />
Rueda sur le fait que le tronc <strong>de</strong> fondation <strong>de</strong> notre pays dérive <strong>de</strong> trois ethnies: l’aborigène,<br />
l’africaine et celle du colonisateur espagnol. Ces ethnies s’unirent tout le long <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux générations et se complétèrent il y a cent cinquante ans avec l’immigration.<br />
■ Conclusions<br />
30<br />
Les trésors <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature jaillirent avec générosité <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre mère, et l’esprit intuitif<br />
<strong>de</strong>s natifs s’en servit pour sou<strong>la</strong>ger leurs souffrances. Sans une synthèse con<strong>de</strong>nsée, nous<br />
avons choisi pour cette contribution quelques éléments parmi leur arsenal botanique. ■<br />
Septembre 2005
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Cantón E. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> medicina<br />
en el Río <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su<br />
<strong>de</strong>scubrimiento hasta<br />
nuestros días, 1512 a 1925.<br />
Madrid: Imp. G. Hernán<strong>de</strong>z y<br />
Galo Sáez; 1928.<br />
Centro educativo para Mapuches.<br />
La Nación. 30 jun 2002; Sec.<br />
Opinión, p.20.<br />
Codazzi Aguirre J. A. La medicina<br />
<strong>de</strong> los aborígenes en <strong>la</strong><br />
República Argentina. Actas<br />
<strong>de</strong>l 1º Congreso Nacional <strong>de</strong><br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina<br />
Argentina. Buenos Aires;<br />
1968.<br />
Díaz Trigo A. « Antece<strong>de</strong>ntes<br />
históricos y características <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> medicina <strong>de</strong> los pob<strong>la</strong>dores<br />
indígenas argentinos. » Rev<br />
Soc Venez Hist Med. 1961;<br />
23: 563-570.<br />
El Libro <strong>de</strong>l Pueblo <strong>de</strong> Dios. La<br />
Biblia. 21ª ed. Madrid:<br />
Ediciones Paulinas; 1999.<br />
Fernán<strong>de</strong>z C. A. Cuentan los<br />
Mapuches. Buenos Aires:<br />
Nuevo Siglo; 1995.<br />
Fernán<strong>de</strong>z A. F. Antropología,<br />
cultura, medicina indígena <strong>de</strong><br />
América y arte rupestre<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les cultures indigènes argentines<br />
argentino. Buenos Aires:<br />
Galerna; 1992.<br />
Furlong G. Los jesuitas y <strong>la</strong><br />
cultura riop<strong>la</strong>tense. Buenos<br />
Aires: Univ. <strong>de</strong>l Salvador;<br />
1984.<br />
García Terán M. « Acercan <strong>la</strong><br />
salud y <strong>la</strong> educación a los<br />
aborígenes <strong>de</strong>l Chaco. » La<br />
Nación. 5 ag. 2001;<br />
Información general, p.21.<br />
Greco N. V. « Historia y <strong>de</strong>sarrollo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología y<br />
Sifilografía en <strong>la</strong> República<br />
Argentina. » Sem Med. Tomo<br />
<strong>de</strong>l Cincuentenario. 1944; (I):<br />
357-453.<br />
Guerrino A. A. La medicina en <strong>la</strong><br />
Conquista <strong>de</strong>l Desierto.<br />
Buenos Aires: Círculo<br />
Militar; 1984.<br />
Ibarra Grasso D. E. Argentina<br />
indígena y prehistoria<br />
americana. Buenos Aires:<br />
TEA; 1971.<br />
Juárez F. N. « Recorridos <strong>de</strong> un<br />
naturalista inquieto. » La<br />
Nación. 9 dic. 2001; Supl.<br />
Enfoques.<br />
Magrassi G. E. Los aborígenes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Argentina. Ensayo sociohistórico<br />
cultural. Buenos<br />
Aires: Galerna-Búsqueda <strong>de</strong><br />
Ayllú; 2000.<br />
Maradona E. L. A través <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
selva. Buenos Aires: Talleres<br />
Gráficos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Penitenciaría<br />
Nacional; 1937.<br />
Moreno F. P. Viaje a <strong>la</strong> Patagonia<br />
Austral 1876-1877. Buenos<br />
Aires: So<strong>la</strong>r; 1969.<br />
Nazar F. « Formosa, un pueblo<br />
cautivo. » Criterio. Mar.<br />
2004; año LXXVIII; (2291):<br />
70.<br />
Pastrana C. F. « Los indígenas<br />
americanos pi<strong>de</strong>n espacio<br />
para sus prácticas<br />
tradicionales. Primer<br />
Congreso <strong>de</strong> Aborígenes <strong>de</strong>l<br />
Mercosur. » La Nación. 3 ag.<br />
2001; Supl. Ciencia y Salud,<br />
p.10.<br />
Pérgo<strong>la</strong> F. Brujos y cuasi médicos.<br />
Buenos Aires: Edimed; 1986.<br />
Pierini L. D. Culturas aborígenes<br />
en <strong>la</strong> medicina argentina.<br />
Buenos Aires: Dunken; 2004.<br />
Rudgley R. Los pasos lejanos. Una<br />
nueva interpretación <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
prehistoria. Grijalbo; 2001.<br />
Seggiaro L. A. Medicina indígena<br />
<strong>de</strong> América. Buenos Aires: El<br />
Ateneo; 1979.<br />
Sopeña G. Monseñor Patagonia.<br />
Buenos Aires: El Elefante<br />
B<strong>la</strong>nco; 2001.
L’époque coloniale<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
ARGENTINE<br />
En 1780, peu après <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, une ordonnance<br />
royale proc<strong>la</strong>ma: « Ayant été informé du désordre et <strong>de</strong>s abus dont souffre l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> phlébotomie, surtout dans les provinces<br />
éloignées <strong>de</strong> cette capitale, je décidai pour l’instant d’établir et <strong>de</strong> créer dans celle-ci un<br />
tribunal <strong>de</strong> Porto, tel qu’il y en a dans les villes <strong>de</strong> Lima et <strong>de</strong> Mexico, avec les mêmes<br />
facultés, les prérogatives et les exceptions, afin <strong>de</strong> corriger et d’éradiquer le désordre<br />
par ce moyen si conforme aux lois. Je choisis et nommai le Dr D. Miguel O´ Gorman, qui<br />
possè<strong>de</strong> les qualités nécessaires pour être Protomedico et Maire majeur <strong>de</strong> tous les professeurs<br />
respectifs… » C’est à ce moment-là qu’apparaît <strong>la</strong> figure du premier mé<strong>de</strong>cin et<br />
doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> future Argentine.<br />
En 1803 fut <strong>la</strong>ncé un « arrêt contre les guérisseurs » et, en décembre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année,<br />
furent distribués les postes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong> chirurgiens habilités pour exercer <strong>la</strong> profession.<br />
Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie argentine<br />
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
■ L’époque coloniale<br />
■ Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
Trois décennies plus tard, le Dr Tiburcio Fonseca publia une thèse intitulée Structure,<br />
fonction et lien dans <strong>la</strong> pathologie et <strong>la</strong> thérapeutique <strong>de</strong> l’organe cutané (1835). Tout au<br />
long <strong>de</strong> ces trente-cinq pages, il aborda <strong>de</strong> manière scientifique les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau;<br />
l’Argentine apparut alors comme <strong>la</strong> pionnière dans ce domaine parmi les pays <strong>la</strong>tinoaméricains.<br />
En 1874, l’Académie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine dirigeant <strong>la</strong> faculté inclut certaines spécialités dans<br />
son curriculum, par exemple <strong>la</strong> « clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis », et<br />
désigna en 1875 les Drs Leopoldo Montes <strong>de</strong> Oca et L. Melén<strong>de</strong>z respectivement comme<br />
professeur titu<strong>la</strong>ire et professeur adjoint; plus tard, ces professeurs furent assignés à<br />
d’autres matières, <strong>la</strong> spécialité restant comprise dans <strong>la</strong> pathologie externe.<br />
L’enseignement était dispensé à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> Buenos Aires, où fonctionnait<br />
un service <strong>de</strong> syphiligraphie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le 18 mars 1892, le doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Faculté <strong>de</strong>s sciences médicales, M. González Catán, fonda <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
et <strong>de</strong> peau, enseignée pendant <strong>la</strong> quatrième année du cursus <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Son<br />
premier professeur fut Baldomero Sommer (figure 1), qui instal<strong>la</strong> sa chaire à l’hôpital<br />
33<br />
Figure 1.<br />
Pr. Baldomero<br />
Sommer
Figure 2.<br />
Pr. Maximiliano<br />
Aberastury<br />
Figure 3.<br />
Pr. Enrique Fidanza<br />
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
San Roque (actuellement hôpital Ramos Mejía) et poursuivit l’enseignement<br />
jusqu’à sa mort, en 1918. Inspiré <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Vienne <strong>de</strong> Von<br />
Hebra (1816-1880) et influencé par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues français <strong>de</strong><br />
l’envergure <strong>de</strong> Gaucher, Fournier, Darier, Gougerot et Civatte, Baldomero<br />
Sommer enseignait en faisant venir à l’hôpital les patients souffrant<br />
d’affections cutanées et en se servant <strong>de</strong>s mou<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> cire, fait<br />
unique en son genre en Amérique Latine à l’époque. Les bril<strong>la</strong>nts<br />
mé<strong>de</strong>cins Aberastury (figure 2), Greco, Baliña, Ragusin, Jonquières,<br />
Uriburu et Fidanza (figure 3) furent ses disciples.<br />
Nous rappelons comme fait anecdotique <strong>la</strong> présence d’une vieille<br />
dame se rendant chaque semaine à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques et qui restait quelques minutes<br />
face au tableau <strong>de</strong> Sommer. En 2000, quelqu’un lui <strong>de</strong>manda son i<strong>de</strong>ntité, et tout l’auditoire<br />
fut ému à sa réponse: « Je suis <strong>la</strong> petite-fille <strong>de</strong> Sommer. Avant, je venais avec ma mère. »<br />
Ce fut une époque dorée pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine, consacrée à <strong>la</strong> syphilis, à<br />
d’autres ma<strong>la</strong>dies vénériennes et à <strong>la</strong> lèpre. La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>rmatologique<br />
argentine (ainsi nommée en 1907), dont le siège était à l’hôpital San Roque, fut très profitable.<br />
Les membres fondateurs furent Baldomero Sommer (premier prési<strong>de</strong>nt), M. Aberastury,<br />
P. Díaz, P. Baliña, Cisneros, Greco, Seminario, J. Uriburu, A. Giménez, Loche, E.<br />
Polito, M. Moyano, J. Farini, F. Mario, J. Arce y Almanza et N. Ragusin.<br />
En 1908 fut <strong>la</strong>ncée <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> l’organe <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, <strong>la</strong> Revista Dermatológica<br />
Argentina, appelée ensuite Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación Argentina <strong>de</strong> Dermatología<br />
y Sifililogía, première publication <strong>de</strong>rmatologique éditée en Amérique Latine.<br />
Baldomero Sommer fut remp<strong>la</strong>cé au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire par Pacífico Díaz et Maximiliano<br />
Aberastury, ce <strong>de</strong>rnier étant l’auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi argentine contre <strong>la</strong> lèpre qui porte son nom<br />
(1926).<br />
En 1927, <strong>la</strong> société changea sa dénomination, <strong>de</strong>venant l’Association argentine <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie; son prési<strong>de</strong>nt était le Pr. Pedro Baliña, remp<strong>la</strong>cé plus<br />
tard par Neocle Ragusin.<br />
En 1934, un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues conduits par Nicolás Greco, disciple <strong>de</strong> Sommer,<br />
décida <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r une nouvelle entité sous le nom <strong>de</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong><br />
Syphiligraphie et <strong>de</strong> vénéréologie, et qui fit partie <strong>de</strong> l’Association médicale argentine<br />
(AMA). L’association n’est pas prolixe sur les causes <strong>de</strong> cette scission — elle se révèle<br />
même contradictoire — mais, eu égard à l’envergure morale et scientifique <strong>de</strong>s dirigeants<br />
et <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong>rmatologiques, les principes et les conceptions<br />
primèrent sans aucun doute sur les intérêts personnels.<br />
Les membres fondateurs <strong>de</strong> cette nouvelle société furent C. Orol Arias, M. A. Mazzini<br />
(secrétaire), A.A. Fernán<strong>de</strong>z, A. Bigatti, S. Rosner, D. Biagini, L. Trepat, A. Muschietti, R.<br />
Wernicke, E. Otahz, C. Banca<strong>la</strong>ri, J. R. Houler, A.Schnei<strong>de</strong>wind, S. Sovin, O. Camaño, J.<br />
Capurro, E. Cortelezzi, F. <strong>de</strong> Biase, E. So<strong>la</strong>ri, S. Ponce <strong>de</strong> León et E. <strong>de</strong>l Vecchio. Elle <strong>de</strong>vint<br />
plus tard <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
En Argentine, <strong>de</strong>ux sociétés <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie existent <strong>de</strong>puis 1934: l’Association<br />
argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont l’organe officiel, <strong>la</strong> Revista Argentina <strong>de</strong> Dermatología,<br />
fut fondé en 1908; et <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (détachée <strong>de</strong> l’AMA en 2001),<br />
dont l’organe officiel est <strong>la</strong> revue Dermatología Argentina (fondée en 1995). Les <strong>de</strong>ux sociétés<br />
comptent <strong>de</strong>s filiales, <strong>de</strong>s sections et <strong>de</strong>s associés dans toutes les provinces du pays.<br />
■ L’époque <strong>de</strong> Baliña et <strong>de</strong> et Greco <strong>de</strong> Greco<br />
34<br />
La scission <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong>rmatologiques provoqua une rivalité scientifique. Toutefois,<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues bril<strong>la</strong>nts surgirent <strong>de</strong> chacune d’elles et <strong>la</strong>issèrent leur empreinte à<br />
<strong>de</strong>s époques remarquables <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine.
L’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, basée au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-syphiligraphie<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires, dont le siège était l’hôpital Ramos Mejía, fut<br />
dirigée par le Pr. Pedro Baliña (titu<strong>la</strong>ire entre 1925 et 1946). Plusieurs <strong>de</strong>rmatologues s’y<br />
formèrent, <strong>de</strong>venant par <strong>la</strong> suite professeurs titu<strong>la</strong>ires: Luis Pierini (figure 4), Marcial<br />
Quiroga (figure 5), Enrique Fidanza, Miguel A. Mazzini (figure 6), José M. Puente, Juan<br />
Pessano, Ceferino Orol Arias, Emilio Fernán<strong>de</strong>z B<strong>la</strong>nco, José L. Carrera, Ludovico Facio,<br />
Guillermo Basombrío, Fernando Noussitou et Aarón Kaminsky (figure 7). Ils furent pour<br />
<strong>la</strong> plupart les chefs <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie les plus reconnus.<br />
L’Association créa une filiale à Rosario en 1934, une autre à Córdoba en 1938, et finalement<br />
<strong>la</strong> filiale <strong>de</strong> Mendoza en 1952.<br />
Pour sa part, <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont le siège se trouvait à l’Association<br />
médicale argentine, était dirigée par Nicolás Greco, professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à l’université <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta et professeur adjoint <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires. En<br />
1943, il fut nommé professeur honoraire <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière.<br />
Cette époque fut caractérisée par <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires et par<br />
une différence numérique importante <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux sociétés.<br />
L’époque <strong>de</strong> Pierini et <strong>de</strong> Quiroga<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
■ L’époque <strong>de</strong> Pierini et <strong>de</strong> Quiroga<br />
À <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Baliña et <strong>de</strong> Greco, <strong>de</strong>ux disciples du premier marquèrent trois<br />
décennies <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine en <strong>la</strong> projetant sur le p<strong>la</strong>n international :<br />
Marcial I. Quiroga et Luis E. Pierini. En 1946, ils avaient publié leur livre Introducción<br />
al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatosifilología [Introduction à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-syphilologie],<br />
dont <strong>la</strong> sémiologie et <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s lésions élémentaires sont toujours en vigueur.<br />
L’ouvrage mit en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> influence <strong>de</strong>s écoles européennes, notamment<br />
<strong>de</strong> l’école française, où se rendaient les <strong>de</strong>rmatologues vou<strong>la</strong>nt se perfectionner à<br />
l’étranger.<br />
Marcial I. Quiroga était doté d’une personnalité aristocratique et charismatique. Originaire<br />
d’une famille aisée <strong>de</strong> <strong>la</strong> société argentine, il s’exprimait <strong>de</strong> façon flui<strong>de</strong> et p<strong>la</strong>isante.<br />
Il par<strong>la</strong>it couramment français et voyageait presque tous les ans en Europe,<br />
notamment en France. Il obtint les principales distinctions. Sur le p<strong>la</strong>n international, il<br />
fut le premier membre argentin du Comité international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie; il fut également<br />
membre honoraire <strong>de</strong> plusieurs sociétés <strong>de</strong>rmatologiques. Sur le p<strong>la</strong>n national, il<br />
fut membre, prési<strong>de</strong>nt et prési<strong>de</strong>nt d’honneur <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Quant à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, il fut professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> première chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
et chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Ramos Mejía, où se trouvait le siège<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>dite chaire. Participer à sa chaire était très intéressant, aussi bien pour les <strong>de</strong>rmatologues<br />
<strong>de</strong>s provinces que pour les visiteurs étrangers. Sa qualité académique est reflétée<br />
dans plusieurs livres et travaux scientifiques.<br />
35<br />
Figure 4.<br />
Pr. Luis E. Pierini<br />
Figure 5.<br />
Pr. Marcial Quiroga<br />
Figure 6.<br />
Pr. Miguel A. Mazzini<br />
Figure 7.<br />
Pr. Aarón Kaminsky
Figure 8.<br />
Pr. Alejandro Cor<strong>de</strong>ro<br />
Figure 9.<br />
Pr. Pedro H. Magnin<br />
Figure 10.<br />
Pr. J.E. Cardama<br />
Figure 11.<br />
Pr. Julio Martín Borda<br />
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
36<br />
Les disciples <strong>de</strong> Quiroga furent les maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> génération ultérieure: Alejandro A.<br />
Cor<strong>de</strong>ro (figure 8) et Pedro H. Magnin (figure 9). D’autres professeurs remarquables furent<br />
Luis Ambrosetti, Enrique Jonquières, Arturo Mom, Rodolfo Corti, E. Molina Leguizamón,<br />
Narciso Vivot, Gisel<strong>la</strong> Dhum, Carlos F. Guillot, H. J. Sánchez Caballero, Manuel<br />
Seoane, Luis Curia, Oscar Bonafina, Nélida Franco, Antonio Raimondo, E. B<strong>la</strong>si, Hans<br />
Botrich, Manuel Olchansky et Natan Gotlib, entre autres. La plupart d’entre eux dirigèrent<br />
<strong>de</strong> prestigieux services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Buenos Aires.<br />
L’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie s’occupait simultanément <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Argentina <strong>de</strong> Dermatología, <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> congrès nationaux annuels<br />
et <strong>de</strong> l’entretien <strong>de</strong> sa bibliothèque <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> plus ancienne du pays. L’association<br />
fut présidée par M.A. Mazzini, G. Basombrio, F. Noussitou, R. Garzón (Córdoba), A.<br />
A. Cor<strong>de</strong>ro, A. Kaminsky, J.L. Carrera, F. Ambrosetti, E. Jonquières, R.N. Corti, P. Viglioglia,<br />
M. Seoane, P. Magnin, J.E. Cardama (figure 10), N. Sánchez Caballero, L.M. Baliña<br />
et C. Parra (Mendoza), M. Marini, L. Valle et J.L. lribas.<br />
Luis E. Pierini fut le maître par excellence. Simple, humble, respectueux, il possédait<br />
une personnalité éblouissante due à ses connaissances <strong>de</strong>rmatologiques et à sa culture<br />
générale. Son origine italienne l’empêcha d’obtenir une p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> première chaire. Sa pensée fut pertinemment exprimée dans son article<br />
« Cinquante ans <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie » (Arch. Argent. Dermatol. 1973; 23: 1-9), où se trouve<br />
<strong>la</strong> réponse au dilemme <strong>de</strong>s nouvelles générations: pourquoi choisit-on <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie?<br />
Pierini exerça ses fonctions au sein <strong>de</strong>s hôpitaux Fernán<strong>de</strong>z, Muñiz (c’est là qu’il é<strong>la</strong>bora<br />
sa thèse <strong>de</strong> doctorat sur le « traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre » et décrivit l’épreuve c<strong>la</strong>ssique<br />
avec histamine qui porte son nom) et Casa Cuna (actuellement Pedro <strong>de</strong> Elizal<strong>de</strong>). Il fut<br />
chef <strong>de</strong> service dans les hôpitaux Fiorito, Italiano et Rawson (à partir <strong>de</strong> 1949), où il<br />
obtint le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième chaire. Signalons que Luis E. Pierini<br />
travail<strong>la</strong> pendant vingt ans avec le Pr. Pedro Baliña, qui le désigna chef <strong>de</strong>s travaux<br />
pratiques à l’hôpital Ramos Mejía. Sa chaire hébergea d’importants spécialistes, tous<br />
fiers d’être <strong>de</strong>s disciples du maître Pierini. Parmi eux, Julio Martín Borda (figure 11), un<br />
homme d’une valeur scientifique, morale et humaine extraordinaire, qui se joignait à<br />
Luis Pierini pour étudier plusieurs <strong>de</strong>rmopathies. Dans son hôpital privé <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau il<br />
organisait <strong>de</strong>s conférences mensuelles auxquelles assistaient <strong>de</strong> jeunes <strong>de</strong>rmatologues,<br />
notamment <strong>de</strong>s provinces. Cette institution forma un bon nombre <strong>de</strong> spécialistes <strong>la</strong>tinoaméricains,<br />
tout comme l’hôpital Rawson. Sur le p<strong>la</strong>n national, nous distinguerons Abraham<br />
Man, José Casas, Raúl Ro<strong>de</strong>iro, Augusto Casalá, Santiago Mosto, Alberto Carvalho,<br />
Raúl Mazzini, lsmael Pomposiello, Gregorio Álvarez, Luis Trepat, Pacífico Díaz, Eduardo<br />
Lacentre, dont certains sont actuellement disparus, et d’autres méritent une mention à<br />
part.<br />
La sagacité <strong>de</strong> Borda lui permit d’établir <strong>de</strong>s hypothèses et <strong>de</strong> mettre en re<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s<br />
tableaux cliniques actuellement acceptés dans le mon<strong>de</strong> entier.
David Grinspan sortit également du lot. Sémiologue exceptionnel et possédant <strong>de</strong> vastes<br />
connaissances en <strong>de</strong>rmatologie, il se pencha vers <strong>la</strong> stomatologie, une spécialité faiblement<br />
étudiée jusque-là. Il fonda et dirigea le Centre <strong>de</strong> tumeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> stomatologie <strong>de</strong><br />
l’hôpital Rawson, pionnier en Amérique Latine. Il nous légua ses enseignements à travers<br />
son Traité <strong>de</strong> stomatologie, un c<strong>la</strong>ssique dans l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> matière en six tomes.<br />
Pour sa part, Jorge Abu<strong>la</strong>fia se consacra à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie. Il participa aux principaux<br />
travaux publiés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et prouva <strong>de</strong>s connaissances approfondies sur <strong>la</strong><br />
clinique <strong>de</strong> l’histopathologie qu’il décrivait. Son <strong>la</strong>boratoire réunit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains<br />
et argentins qui, avec une curiosité et un intérêt révérencieux, s’introduisirent<br />
dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> microscopie. Il est habituel d’entendre, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> clôture<br />
d’une discussion <strong>de</strong>rmatologique: « … et c’est Abu<strong>la</strong>fia qui le dit. »<br />
L’année 1943 fut caractérisée par une succession d’avatars politiques et institutionnels<br />
qui paralysèrent les concours pendant plusieurs décennies; <strong>de</strong>s personnalités<br />
bril<strong>la</strong>ntes, pouvant atteindre dans d’autres circonstances <strong>de</strong>s postes académiques importants,<br />
furent rejetées.<br />
En 1978, l’hôpital Rawson ferma ses portes et <strong>la</strong> pléia<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses remarquables <strong>de</strong>rmatologues<br />
se distribua dans les services <strong>de</strong>s différents hôpitaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
L’ère actuelle<br />
D’autres personnalités qui constituèrent <strong>de</strong>s jalons <strong>de</strong> cette histoire surgirent parallèlement<br />
aux membres <strong>de</strong>s chaires.<br />
Aarón Kaminsky est le père <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmétologie argentine. Étonnant, singulier, d’une<br />
personnalité écrasante, il jouit d’un extraordinaire prestige popu<strong>la</strong>ire. Chef <strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s hôpitaux Israelita et Alvear, il réunit autour <strong>de</strong> lui un grand nombre<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et une légion <strong>de</strong> patients. Il se pencha notamment sur l’aspect thérapeutique,<br />
dominant l’art <strong>de</strong> <strong>la</strong> formule magistrale. Il forma <strong>de</strong>s disciples <strong>de</strong> l’envergure <strong>de</strong><br />
son fils Carlos, ainsi qu’Ana Kaminsky et León Jaimovich. Tous les trois occupèrent <strong>de</strong>s<br />
postes <strong>de</strong> professeurs titu<strong>la</strong>ires, tout comme J. Kriner, P. Bumaschny, S. Braunstein, H.A.<br />
Kap<strong>la</strong>n, B. Sevinsky et A. Aufgang.<br />
De son côté, Alfredo Choue<strong>la</strong> fit un parcours remarquable dans <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Nous citerons aussi A. Segers, qui se consacra à <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, et<br />
M. Asri<strong>la</strong>nt à l’allergie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
Pablo Viglioglia, formé à cette école, fut chef <strong>de</strong> l’hôpital Álvarez et grimpa dans <strong>la</strong><br />
hiérarchie en étant nommé professeur titu<strong>la</strong>ire. Fort du privilège <strong>de</strong> conjuguer une vaste<br />
connaissance clinique avec le pouvoir <strong>de</strong> lire et <strong>de</strong> diagnostiquer <strong>de</strong>s préparations histopathologiques,<br />
son savoir se traduit dans plusieurs livres et articles. Il dispensait ses<br />
cours avec simplicité et autorité scientifique, en leur accordant un caractère cordial et<br />
affectueux et en s’adaptant facilement à son auditoire*.<br />
Enrique Jonquières, très doué en léprologie, travail<strong>la</strong>it à ses côtés.<br />
Miguel A. Mazzini est un autre <strong>de</strong>rmatologue important <strong>de</strong> l’époque. Il fut professeur<br />
titu<strong>la</strong>ire, se distinguant par ses connaissances. Élégant, ga<strong>la</strong>nt, mo<strong>de</strong>ste et affable, il fut chef<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Fernán<strong>de</strong>z avant d’occuper <strong>la</strong> chaire à l’hôpital Ramos Mejía. Son ouvrage Dermatología<br />
Clínica [Dermatologie clinique] (dont <strong>la</strong> première version fut rédigée avec Fernán<strong>de</strong>z<br />
B<strong>la</strong>nco), fut le livre <strong>de</strong> consultation et d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> tous les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> l’époque.<br />
Des circonstances qui al<strong>la</strong>ient signer l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine se produisirent<br />
à cette époque-là.<br />
* Ce paragraphe fut rédigé par le Dr A. Woscoff.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
■ L’ère actuelle<br />
37
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
38<br />
Le Dr Raúl Fleischmajer, disciple <strong>de</strong> Kaminsky, s’instal<strong>la</strong> aux États-Unis et s’engagea dans<br />
un parcours exceptionnel: il fut nommé professeur et chef <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital Mount<br />
Sinai <strong>de</strong> New York. Ses contributions à <strong>la</strong> physiopathologie du col<strong>la</strong>gène et notamment à <strong>la</strong><br />
scléro<strong>de</strong>rmie sont très importantes dans le mon<strong>de</strong> entier. Il voyageait annuellement en<br />
Argentine, où il diffusait ses connaissances. Aux États-Unis, il partagea ses activités avec le<br />
Dr León Jaimovich — disciple <strong>de</strong> Kaminsky et plus tard <strong>de</strong> Pierini —, qui une fois <strong>de</strong> retour<br />
en Argentine débuta un bril<strong>la</strong>nt parcours et fut nommé professeur titu<strong>la</strong>ire.<br />
Arturo Mom voyagea également aux États-Unis où il débuta <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>rmatologique;<br />
le Pr. Alejandro Cor<strong>de</strong>ro suivit lui aussi <strong>de</strong>s formations dans ce pays. Ainsi débuta<br />
l’étape nord-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine qui, sans manquer l’influence<br />
française, prit <strong>de</strong>s directions plus vastes, notamment en physiopathologie et en thérapeutique.<br />
Pedro Horacio Magnin passa un temps aux États-Unis pour col<strong>la</strong>borer avec le pionnier<br />
Stephen Rothman dans ses recherches. De retour en Argentine, il s’engagea dans<br />
une carrière remarquable: il <strong>de</strong>vint le successeur <strong>de</strong> Quiroga et <strong>de</strong> Mazzini en tant que<br />
professeur titu<strong>la</strong>ire, présida l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pendant plusieurs<br />
pério<strong>de</strong>s et dirigea <strong>la</strong> Revista Argentina <strong>de</strong> Dermatología <strong>de</strong>s décennies durant. Il était<br />
passionné par <strong>la</strong> spécialité, et n’arrêta pas <strong>de</strong> l’étudier. Ses journées commençaient très<br />
tôt, consacrées à écrire <strong>de</strong>s livres et <strong>de</strong>s articles et à effectuer <strong>de</strong>s recherches sur <strong>de</strong>s sujets<br />
divers, comme les porphyries et le cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Il organisa <strong>de</strong>s ateliers, <strong>de</strong>s<br />
journées et <strong>de</strong>s congrès, et s’occupa <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation d’un cercle <strong>de</strong> disciples qui le suivirent<br />
dans son travail. Chef <strong>de</strong>s hôpitaux Británico et Ramos Mejía — ce <strong>de</strong>rnier reste le<br />
siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire —, il possédait une personnalité particulière, sévère et exigeante. Sa<br />
mémoire exceptionnelle l’aida à diffuser ses connaissances, en même temps qu’il exigeait<br />
un dévouement presque total <strong>de</strong> ceux qui partageaient son travail. Il succéda à<br />
Marcial Quiroga au sein <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Alejandro A. Cor<strong>de</strong>ro perpétua <strong>la</strong> série <strong>de</strong> maîtres bril<strong>la</strong>nts. Il travail<strong>la</strong> avec Quiroga:<br />
il occupa le poste <strong>de</strong> professeur adjoint <strong>de</strong> sa chaire et fut ensuite nommé chef <strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong>s hôpitaux Tornú, Rawson et <strong>de</strong>s cliniques; il fut professeur titu<strong>la</strong>ire dans ces<br />
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers hôpitaux. Cor<strong>de</strong>ro était une personne exceptionnelle et un scientifique<br />
remarquable. Mo<strong>de</strong>ste, affable, protecteur, il forma plusieurs <strong>de</strong>rmatologues*. Il voyageait<br />
continuellement avec son épouse: le matin, il visitait les centres hospitaliers;<br />
l’après-midi, il se promenait dans les villes et les musées et le soir il partageait <strong>de</strong>s<br />
dîners avec les principaux <strong>de</strong>rmatologues du pays… tout en par<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Au<br />
cours <strong>de</strong>s congrès, tel un élève appliqué, il notait sur un petit cahier tout ce qu’il voyait<br />
et entendait, pour le communiquer ensuite à son retour dans le cadre <strong>de</strong>s cours.<br />
Les principales sociétés <strong>de</strong>rmatologiques mondiales le désignèrent membre honoraire.<br />
Tout comme Quiroga, il fut membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue <strong>de</strong>rmatologique internationale.<br />
Nous tous qui l’avons connu le gardons dans notre mémoire.<br />
Les chaires. Pendant les années qui séparèrent l’époque <strong>de</strong> Pierini <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> Quiroga,<br />
il n’y eut pas <strong>de</strong> concours: les professeurs adjoints déjà désignés occupèrent <strong>de</strong> façon<br />
intérimaire le poste <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire pendant un an. En conséquence, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
notables n’eurent pas l’occasion <strong>de</strong> passer le concours pour <strong>de</strong>venir professeurs titu<strong>la</strong>ires.<br />
La situation re<strong>de</strong>vint normale une décennie plus tard; les Drs Cor<strong>de</strong>ro et Magnin<br />
furent alors nommés professeurs titu<strong>la</strong>ires. Lors <strong>de</strong> leur retraite (<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires pose comme limite d’âge 65 ans), Viglioglia et Jaimovich<br />
leur succédèrent pour une courte pério<strong>de</strong>. Le nombre <strong>de</strong> chaires fut porté à quatre, les<br />
Drs Alberto Woscoff, Ana Kaminsky, Hugo Cabrera et Carlos Kaminsky (mort précocement)<br />
étant nommés pour les diriger.<br />
* Parmi lesquels je me compte (A. W.).
Ana Kaminsky, dont le parcours est mondialement reconnu, fut désignée membre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques (tout comme Quiroga et Cor<strong>de</strong>ro quelques<br />
années auparavant), ce qui permit à l’Argentine d’y avoir son représentant. Elle fut invitée<br />
à donner <strong>de</strong>s conférences dans plusieurs pays, où elle fut désignée membre d’honneur.<br />
Hugo Cabrera, formé avec Gatti et Cardama, exerça <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> chef dans <strong>la</strong> polyclinique<br />
Posadas et plus tard à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques, où il établit sa chaire. Ses vastes<br />
connaissances <strong>de</strong>rmatologiques lui permirent <strong>de</strong> publier <strong>de</strong> nombreux travaux dans lesquels<br />
il décrivit <strong>de</strong>s pathologies inédites dans le pays. Son livre Nevos [Nævi], rédigé<br />
conjointement avec Sandra García et formant un ouvrage <strong>de</strong> consultation obligatoire sur<br />
le sujet, est remarquable.<br />
Alberto Woscoff fut professeur titu<strong>la</strong>ire et chef à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques, ainsi que professeur<br />
consultant <strong>de</strong> l’Armée argentine et chef du service <strong>de</strong> l’hôpital naval Pedro Mallo.<br />
Il fut auparavant chef à l’hôpital Durand. Sa production scientifique est très abondante,<br />
et compte <strong>de</strong>s titres tels que Orientación <strong>de</strong>rmatológica en medicina interna [Orientation<br />
<strong>de</strong>rmatologique en mé<strong>de</strong>cine interne] — un texte <strong>de</strong> consultation et d’étu<strong>de</strong> pour<br />
les étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>la</strong> spécialisation, auquel col<strong>la</strong>borèrent les Drs A. Kaminsky,<br />
M. Marini et M. Allevato — et Principios <strong>de</strong> inmuno<strong>de</strong>rmatología [Principes d’immuno<strong>de</strong>rmatologie]<br />
(écrit avec les Drs P. Troielli et M. Label), <strong>de</strong>s ouvrages complets du genre<br />
en espagnol. Il fonda Dermatología Argentina — organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> SAD —, dont il fut<br />
le directeur pendant une décennie.<br />
Au moment <strong>de</strong> sa retraite, Alberto Woscoff fut désigné professeur consultant titu<strong>la</strong>ire,<br />
tout comme Ana Kaminsky, <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires; les Drs Viglioglia et Cor<strong>de</strong>ro<br />
en furent désignés professeurs émérites.<br />
Actuellement (2005), le docteur Cabrera est le professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire; les<br />
autres chaires, dont le professeur titu<strong>la</strong>ire est désigné par concours, sont actuellement<br />
occupées par Merce<strong>de</strong>s Hassan (hôpital Ramos Mejía), Edgardo Choue<strong>la</strong> (hôpital Argerich)<br />
et Mario Marini (hôpital Británico). Tous trois possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s antécé<strong>de</strong>nts remarquables,<br />
et leur travail et leur intelligence augurent un prestige croissant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie argentine.<br />
Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (AAD)<br />
Elle rassemble <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s services hospitaliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires, avec une activité scientifique et sociétaire soutenue, qui se reflète dans <strong>la</strong> Revista<br />
Argentina <strong>de</strong> Dermatología. L’institution organise <strong>de</strong>s réunions auxquelles assistent <strong>de</strong><br />
nombreux spécialistes argentins et étrangers; elle organise aussi annuellement le<br />
Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui a lieu dans les provinces du pays. Sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> Magnin, l’AAD dép<strong>la</strong>ça son siège traditionnel <strong>de</strong> l’hôpital Ramos Mejía vers un<br />
siège propre, disposant d’une bibliothèque et d’une salle <strong>de</strong> conférences.<br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> l’institution furent M.A. Mazzini (1950), G. Basombrio (1952), F.<br />
Noussittou (1953), R. Garzón (p) (1955), A. Cor<strong>de</strong>ro (1957-1958), A. Kaminsky (1959-<br />
1960), J.L. Carrera (1961-1962), F. Ambrosetti (1963-1964), E. Jonquières (1965-1966),<br />
M.I. Quiroga (1967-1968), R.N. Corti (1968-1971) M.A. Mazzini (1972-1975), P. Viglioglia<br />
(1976-1977), M. Seoane (1978-1979), P. Magnin (1980-1981), J.E. Cardama (1982-1983),<br />
N. Sánchez Caballero (1984-1985), L.M. Baliña (1986-1987) (figure 12), P. Magnin (1988-<br />
1989), C. Parra (1989-1991), M. Marini (1992), P. Magnin (1993-1995), Lidia Valle (1995-<br />
2004) et J.L. Iribas (<strong>de</strong>puis 2004).<br />
Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SAD)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
Jusqu’en 1973, l’institution organisait <strong>de</strong>s séances théoriques mensuelles pour les<br />
diplômés au siège <strong>de</strong> l’Association médicale argentine (AMA). Ses adhérents n’étaient<br />
39<br />
Figure 12.<br />
Pr. L.M. Baliña<br />
Figure 13.<br />
Pr. D. Grinspan<br />
Figure 14.<br />
Pr. J.C. Gatti
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
pas nombreux et quelques professionnels se re<strong>la</strong>yaient à <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce. La SAD regroupait<br />
<strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s disciples <strong>de</strong> Kaminsky et <strong>de</strong> Pierini.<br />
Sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce d’Abu<strong>la</strong>fia (1973-1974) <strong>la</strong> société subit une modification substantielle.<br />
Une nouvelle organisation mo<strong>de</strong>rne, accompagnée d’une succession <strong>de</strong> réunions et <strong>de</strong><br />
congrès, motiva l’incorporation <strong>de</strong> nombreux <strong>de</strong>rmatologues. Désormais, les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> SAD furent A. Casalá (1975-1976), O. Mángano (1977-1978), D. Grinspan (1979-1980) (figure<br />
13), A. Cor<strong>de</strong>ro (1981-1982), J.C. Gatti (1983-1984) (figure 14), S. Stringa (1985-1986),<br />
J.E. Cardama (1987-1988), A. Woscoff (1989-1990), H.N. Cabrera (1991-1992), H.G. Crespi<br />
(1993-1994), A. Kaminsky (1995-1996), A. Cor<strong>de</strong>ro (1997-1998), C.F. Gatti (1999-2000),<br />
M. Larral<strong>de</strong> (2001-2002), H. Cabo (2003-2004 ) et E. Saraceno (<strong>de</strong>puis 2005).<br />
Les congrès ont lieu tous les <strong>de</strong>ux ans dans différentes villes <strong>de</strong>s provinces argentines<br />
et à Buenos Aires. Durant <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce d’Ana Kaminsky, <strong>la</strong> SAD se détacha <strong>de</strong> l’Association<br />
médicale argentine; elle possè<strong>de</strong> actuellement son propre siège.<br />
La publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue Dermatología Argentina, l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> SAD, débuta<br />
en 1995, dirigée dans ses premiers temps par Alberto Woscoff (<strong>de</strong>venu directeur honoraire)<br />
et ensuite par Liliana Olivares (à partir <strong>de</strong> 2004).<br />
Pendant quelques années, l’AAD et <strong>la</strong> SAD travaillèrent ensemble, en organisant <strong>de</strong>s<br />
réunions communes. L’exemple le plus significatif d’intégration fut <strong>la</strong> Commission mixte<br />
d’enseignement <strong>de</strong>rmatologique (COMEDE).<br />
Quatre cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie existaient simultanément à une<br />
époque donnée, mais leurs contenus et leurs exigences étaient divergents; León Jaimovich<br />
(SAD), Pedro Magnin (AAD), Fernando Stengel et Hugo Cabrera étaient chargés <strong>de</strong><br />
ces cours. Ces quatre professionnels cédèrent leurs cours respectifs à <strong>la</strong> COMEDE, qui<br />
mit en p<strong>la</strong>ce un seul cours présidé par Mario Marini (AAD), Alberto Woscoff (SAD) et avec<br />
<strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> Luis Ferreira comme doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Ce cours,<br />
reconnu par l’université <strong>de</strong> Buenos Aires, avait une durée <strong>de</strong> trois ans et délivrait le<br />
diplôme <strong>de</strong> spécialiste universitaire en <strong>de</strong>rmatologie. Il était dirigé par un représentant<br />
<strong>de</strong> l’AAD et un représentant SAD se succédant tous les ans. Au bout <strong>de</strong> dix ans, l’Association<br />
argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie quitta <strong>la</strong> COMEDE et créa un cours propre. Cependant,<br />
l’expérience du travail conjoint <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux groupes éveil<strong>la</strong> le désir <strong>de</strong> création d’un groupe<br />
unique, surtout parmi les <strong>de</strong>rmatologues plus jeunes.<br />
■ La La fédéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> Dermatologie <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine argentine<br />
40<br />
À l’origine, l’activité <strong>de</strong>rmatologique était concentrée à Buenos Aires, où <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues exerçaient leur profession. Avec le temps, une intense et fructueuse<br />
activité scientifique se développa dans les provinces: les centres importants sont généralement<br />
installés dans les chaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à Córdoba<br />
Ses origines remontent au XIX e siècle. La première chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité en Argentine<br />
y fut créée en 1889 (bien avant celle <strong>de</strong> Buenos Aires), ayant son siège à l’hôpital <strong>de</strong>s<br />
cliniques. Le premier professeur fut Hugo Stemphelman, à qui succédèrent Manuel<br />
Freyre, Tomás Garzón, Rafael Garzón (père), Ramón Argüello (intérimaire), Luis<br />
Argüello Pitt, Enrique Tello et Rafael Garzón (fils).<br />
Le travail du Dr Garzón (fils), désigné en 1983, a une immense valeur, tout comme ses<br />
publications et ses contributions scientifiques aux congrès et aux cours, dans lesquels il<br />
donna une gran<strong>de</strong> projection à <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Il édita plusieurs textes pour<br />
les étu<strong>de</strong>s supérieures, écrivit <strong>de</strong>s articles et <strong>de</strong>s livres d’une gran<strong>de</strong> importance pour<br />
l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine.
La <strong>de</strong>uxième chaire fut créée en 1975, le siège se trouvant à l’hôpital Córdoba; Ignacio<br />
Segundo Toledo et Augusto Magnani furent les professeurs chargés <strong>de</strong> l’enseignement.<br />
La troisième chaire, créée au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année à l’hôpital San Roque,<br />
compta sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> professeurs comme Pedro Guillot et Belia <strong>de</strong> Oviedo.<br />
L’université catholique <strong>de</strong> Córdoba, dirigée tout d’abord par Ignacio Toledo et ensuite<br />
par Carlos Consigli, constitue l’un <strong>de</strong>s centres privés les plus prestigieux du pays. Carlos<br />
Consigli et son frère Javier furent également <strong>de</strong> remarquables <strong>de</strong>rmatologues et léprologues,<br />
dont les apports à <strong>la</strong> spécialité furent importants.<br />
Córdoba se distingue notamment dans <strong>de</strong>ux sujets: <strong>la</strong> lèpre et l’hydroarsenicisme<br />
chronique régional endémique (HACRE). Pour ce qui est <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, il faut mentionner<br />
l’existence d’un <strong>la</strong>zaret déjà en 1621 et <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation d’une <strong>de</strong>uxième léproserie en<br />
1884; <strong>la</strong> clinique J.J. Puente et le dispensaire Pr. Guillermo Basombrio, <strong>de</strong>s modèles dans<br />
leur genre, furent inaugurés à San Francisco <strong>de</strong>l Chañar en 1939. Luis Argüello Pitt et<br />
Carlos Consigli se distinguèrent dans ce domaine.<br />
Quant à l’HACRE, il fut méticuleusement décrit par Ramón Argüello et Enrique Tello.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier est l’auteur du livre HACRE, référence obligée sur le sujet. Les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
l’HACRE se poursuivirent dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Salta, sous <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> Roberto<br />
Biagini, qui en précisa l’épidémiologie et le lien avec le carcinome viscéral.<br />
La Réunion <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Córdoba compte plus d’un <strong>de</strong>mi-siècle d’existence et<br />
les plus grands <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>la</strong> présidèrent.<br />
Actuellement se distinguent Miguel A. Orozco, Luis Flores González et Alejandro Ruiz<br />
Lascano.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à Rosario (province <strong>de</strong> Santa Fe)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
L’université nationale du Littoral créa en 1922 <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont le<br />
premier professeur fut Enrique Fidanza, âgé <strong>de</strong> 38 ans à peine mais qui bénéficiait<br />
d’une vaste expérience acquise à Buenos Aires et en Europe. Il débuta l’enseignement<br />
à l’hôpital Italiano et transféra ensuite <strong>la</strong> chaire au sein du traditionnel hôpital du<br />
Centenaire <strong>de</strong> l’université nationale du Littoral. Il forma, entre autres, les Drs José<br />
María Fernán<strong>de</strong>z, Salomón Schujman, Alberto Nu<strong>de</strong>nberg, Francisco Carrillo et<br />
Ama<strong>de</strong>o Campos ; J.M. Fernán<strong>de</strong>z, E. Carboni, V. Pecoraro et B. Nu<strong>de</strong>nberg lui succédèrent<br />
à <strong>la</strong> chaire.<br />
Le mon<strong>de</strong> connut d’importants professionnels en <strong>de</strong>rmatologie originaires <strong>de</strong> Rosario;<br />
José María Fernán<strong>de</strong>z par exemple, auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> réaction en lèpre qui porte son nom. Il<br />
participa également <strong>de</strong> façon décisive à <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification sud-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (La<br />
Havane, 1948) et à l’utilisation du vaccin BCG dans <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Salomón Schujman suivit J.M. Fernán<strong>de</strong>z dans ses recherches sur <strong>la</strong> lèpre. Il établit<br />
<strong>la</strong> forme po<strong>la</strong>ire tuberculoï<strong>de</strong> et <strong>de</strong>vint, selon le Brésilien Rabello, « le premier à avoir<br />
caractérisé <strong>la</strong> physiopathogénie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die ». Sa réputation dépasse les frontières; il<br />
suffirait <strong>de</strong> dire qu’il se rendit en Chine en 1957, où il resta un an, pour dispenser <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong> léprologie; il y forma <strong>de</strong>s disciples qui suivent ses conceptions.<br />
Alberto Nu<strong>de</strong>nberg se perfectionna en France et en Allemagne et se consacra avec<br />
acharnement à <strong>la</strong> vénéréologie. Après sa formation à l’étranger, il organisa et dirigea<br />
cette spécialité, travail qu’il effectua <strong>de</strong> façon inébran<strong>la</strong>ble malgré les intérêts puissants<br />
qui se mouvaient <strong>de</strong>rrière <strong>la</strong> prostitution. La loi nationale <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie antivénérienne<br />
étant promulguée, on établit que « Rosario était <strong>la</strong> ville <strong>la</strong> mieux préparée du pays grâce<br />
à sa connaissance <strong>de</strong> ces p<strong>la</strong>ies sociales ».<br />
Vicente Pecoraro, J.M. Barman et L. Astore se distinguèrent dans l’étu<strong>de</strong> du cheveu,<br />
domaine peu étudié jusque-là. Le premier inventa un microscope original et développa<br />
<strong>la</strong> technique du trichogramme, actuellement employée dans le mon<strong>de</strong> entier. Ses observations<br />
minutieuses restent incontestées.<br />
41
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
42<br />
Bernardo Nu<strong>de</strong>nberg, professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>puis 1983, imprima à <strong>la</strong> chaire une nouvelle<br />
orientation, <strong>de</strong>stinée à intégrer <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que chapitre important <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> clinique médicale. Il publia <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> scléro<strong>de</strong>rmie et <strong>la</strong> mucinose. Il est l’invité<br />
obligé <strong>de</strong> tous les congrès nationaux, et assiste également aux principales réunions<br />
internationales, auxquelles il participe activement. Doté d’une fine sensibilité, il écrit <strong>de</strong>s<br />
récits et <strong>de</strong> <strong>la</strong> poésie dont <strong>la</strong> critique littéraire fait l’éloge.<br />
Ramón Fernán<strong>de</strong>z Bussy, qui suivit son perfectionnement en Europe, est réputé par<br />
ses étu<strong>de</strong>s en immunologie. Il gravite autour <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires et <strong>de</strong> Rosario; il organise <strong>de</strong>s cours et écrit plusieurs ouvrages. Il dirige le cours <strong>de</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à l’université nationale <strong>de</strong> Rosario.<br />
Parmi les figures célèbres, nous pouvons citer Augusto Mercau, Fernando Feijóo, Sebastián<br />
González <strong>de</strong>l Cerro, Carlos Lurati et Ricardo Arpini; dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmo-pathologie, Augusto Serial et Juan Monti.<br />
L’Association <strong>de</strong>rmatologique, filiale <strong>de</strong> l’AAD, fut créée en 1935 et présidée par<br />
Edgard Romano Boix, entre autres. De nos jours, elle constitue une section <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à Mendoza<br />
Les premiers <strong>de</strong>rmatologues qui exercèrent leur profession à Mendoza dans les années<br />
30 furent Everardo Godoy et León Boaknin, à qui s’ajouta le Pr. Gerónimo López<br />
González en 1939. Les soins avaient lieu dans les hôpitaux Central et Luis Lagomaggiore.<br />
La Faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> Mendoza fut fondée en 1950, dépendant <strong>de</strong> l’université<br />
nationale <strong>de</strong> Cuyo; le Portugais Joao Ferreyra Márquez fut embauché comme professeur<br />
titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En 1965, Gerónimo López González lui succéda, et plus tard<br />
Sebastián Pons, Alberto Torres Cortijo (intérimaire) et Cristóbal Parra (1987). L’école <strong>de</strong><br />
Mendoza est réputée pour l’importance <strong>de</strong> ses contributions et ses membres prestigieux.<br />
Gerónimo López González i<strong>de</strong>ntifia le prurigo so<strong>la</strong>ire.<br />
Outre sa fonction <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire, Sebastián Pons fut doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong>s<br />
sciences médicales <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Cuyo; parmi sa production prolifique,<br />
nous citerons son travail « Manifestations cutanées <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Chagas ».<br />
Alberto Torres Cortijo, qui se forma en Espagne avec Gómez Orbaneja et à Buenos<br />
Aires avec Pierini et Borda, se consacra avec acharnement à <strong>la</strong> cryochirurgie. Son travail<br />
« Acropathie ulcéromuti<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> Bureau et Barrière. Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 150 cas. Son association<br />
avec <strong>la</strong> pel<strong>la</strong>gre » est remarquable.<br />
En 1986, le Dr Cristóbal Parra fut désigné professeur titu<strong>la</strong>ire. Son parcours se distingua<br />
par <strong>la</strong> quantité et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> travaux originaux, publiés dans les plus importantes<br />
revues nord-<strong>américaine</strong>s et européennes. Il se rendit en Allemagne pour perfectionner<br />
ses étu<strong>de</strong>s, où il introduisit <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine. Un certain<br />
nombre <strong>de</strong> ses travaux furent publiés en allemand, une <strong>la</strong>ngue qu’il maîtrisait.<br />
Elías Bittar, Olga Bocanegra, José F. Leonforte, Emilce Rivaro<strong>la</strong> et Narciso Driban furent<br />
<strong>de</strong>s membres remarquables <strong>de</strong> cette école, tout comme les <strong>de</strong>rmatologues bril<strong>la</strong>ntes<br />
qui font partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille Parra: Nélida Parra (née Pizzi), célèbre en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
et Viviana Cantú (née Parra).<br />
Aníbal Ortiz Medina, disciple d’Abu<strong>la</strong>fia et coauteur <strong>de</strong> plusieurs publications nationales<br />
et internationales, prit en charge l’histopathologie.<br />
L’enseignement à Mendoza est partagé entre <strong>la</strong> Faculté nationale <strong>de</strong> Cuyo, fondée en<br />
1950, et <strong>de</strong>ux facultés privées: <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Mendoza<br />
(fondée en 1998) et <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> l’Aconcagua (1997).<br />
Les associations <strong>de</strong>rmatologiques locales sont <strong>la</strong> filiale Cuyo <strong>de</strong> l’Association argentine<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (1958), <strong>la</strong> première section <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et le Cercle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Pr. Joao Ferreira-Marques (1966).
La <strong>de</strong>rmatologie à La P<strong>la</strong>ta (province <strong>de</strong> Buenos Aires)<br />
La spécialité débuta dans cette ville en 1918, grâce au Dr Emilio Cortelezzi, le premier<br />
professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie créée en 1930. Nicolás Greco, Ernesto<br />
L. Othaz et Alci<strong>de</strong>s Conti lui succédèrent, signant l’époque <strong>la</strong> plus importante <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta. Les professeurs titu<strong>la</strong>ires ultérieurs furent Jorge Cueto, Juan<br />
Fuertes (intérimaire), Flora Stoichevich et Raúl E. Balsa, qui possédait une connaissance<br />
encyclopédique et <strong>la</strong>issa pour <strong>la</strong> postérité un volumineux Manual <strong>de</strong> Dermatología Clínica<br />
[Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie clinique] (1998). Pour sa part, Roberto Castelleto est un<br />
anatomo-pathologiste d’une activité remarquable.<br />
La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta — <strong>de</strong>venue filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie plus tard — entama ses activités en 1973, présidée par L.T. Miran<strong>de</strong>, Stel<strong>la</strong><br />
Maris Ingrata et Luis H. Pe<strong>de</strong>monte.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à Tucumán<br />
Norberto Olmos Castro et Pascual B. Arcuri, enrichirent <strong>la</strong> léprologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> léprominoréaction<br />
qui porte leur nom. Luis Vallejo y Vallejo fut professeur titu<strong>la</strong>ire à <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, suivi par Eudoro H. <strong>de</strong> los Ríos — <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> Tucumán<br />
font partie <strong>de</strong> son école —, qui apporta <strong>de</strong>s connaissances intéressantes sur les<br />
mycoses profon<strong>de</strong>s.<br />
En ce qui concerne l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pathologies régionales, nous pouvons citer Ana María<br />
Lorenz, N. Cartagena, L. Aguirre (née Iturre) et Ben Ami Alperovich. Le Groupe <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong> Tucumán — filiale <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie — existe <strong>de</strong>puis<br />
1970, ainsi qu’une filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> SAD.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans le Nord-Est<br />
Manuel Giménez (père) se consacra à <strong>la</strong> lèpre dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Chaco <strong>de</strong> manière<br />
ardue et ininterrompue. Sa lutte passionnée contre cette épidémie se traduit par les institutions<br />
et les dispensaires créés à son initiative.<br />
Manuel Iglesias et Félix Scappini furent professeurs titu<strong>la</strong>ires. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
l’université nationale du Nord-Est, Manuel Giménez (fils) <strong>de</strong>vint professeur titu<strong>la</strong>ire à son<br />
tour, et il apporta à sa chaire une activité incessante <strong>de</strong> recherche et d’étu<strong>de</strong> qui le distingua<br />
parmi les professeurs <strong>de</strong>s générations récentes.<br />
D’autres centres <strong>de</strong>rmatologiques importants<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
Andrés Cornejo fut un célèbre <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Salta, suivi par Roberto<br />
Biagini, qui apporta <strong>de</strong>s connaissances épidémiologiques et cliniques très importantes<br />
sur l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> l’HACRE et <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose cutanée.<br />
Dans <strong>la</strong> province d’Entre Ríos, le premier <strong>de</strong>rmatologue fut José María Roque D´Angelo<br />
(1943). En 1985, Abraham Man <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> figure <strong>la</strong> plus remarquable <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
du Littoral et prit en charge <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong>s provinces d’Entre Ríos<br />
— siège <strong>de</strong> l’hôpital où il est chef —, <strong>de</strong> Corrientes et <strong>de</strong> Misiones. C’est l’un <strong>de</strong>s représentants<br />
les plus importants <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Borda. Il exerça d’importantes fonctions au sein<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Buenos Aires pendant plusieurs époques.<br />
L’unité d’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Paraná, qui dépendait <strong>de</strong> l’université nationale<br />
<strong>de</strong> Rosario, fonctionna à partir <strong>de</strong> 1991. Le Dr Man fut désigné enseignant responsable,<br />
tandis que les Drs Rubén Ruberto et Diana Mauro étaient les chefs <strong>de</strong>s travaux pratiques.<br />
L’Association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du centre du Littoral fut fondée en décembre 1978,<br />
présidée par Ricardo Cusanelli et comptant sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong><br />
43
Figure 15.<br />
Ve Congrès ibéro<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie.<br />
Buenos Aires.<br />
Novembre 1963.<br />
Cérémonie<br />
d’ouverture<br />
Figure 16.<br />
Assemblée ordinaire<br />
du CILAD<br />
Figure 17.<br />
Présentation <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s à l’hôpital<br />
Rawson<br />
Figure 18.<br />
Thème officiel<br />
« Cancer cutané ».<br />
Conférenciers:<br />
Pr. Jorge Abu<strong>la</strong>fia<br />
(2e à droite) et<br />
David Grinspan<br />
(3e à droite)<br />
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
Santa Fe, <strong>de</strong> l’est <strong>de</strong> Córdoba et d’Entre Ríos. Cette association rejoignit <strong>la</strong> SAD pendant<br />
<strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Alejandro Campos Carlés.<br />
Parmi les nombreuses rencontres scientifiques qui eurent lieu dans cette région,<br />
notons <strong>la</strong> réunion annuelle « Pr. Dr José M. Fernán<strong>de</strong>z », avec <strong>la</strong> participation d’Entre<br />
Ríos, Rosario et Córdoba. Les IV es Journées internationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
dont le siège se trouve à Paraná, furent dirigées par Susana Block, Diana Mauro, Analía<br />
Svartz et Carlos Cargniel.<br />
À Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta, où <strong>la</strong> spécialité est étroitement liée à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires, les figures remarquables furent Raúl Ro<strong>de</strong>iro, Juan F. Caino, Carlos Cancio, Carlos<br />
<strong>de</strong> Natale. De nos jours, Carlota Jaimovich, Jorge Brusco, Alfredo Amdur et Jorge<br />
C<strong>la</strong>ra sont les référents <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville.<br />
L’hôpital régional <strong>de</strong> Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta possè<strong>de</strong> un haut niveau d’académiciens, et <strong>la</strong> ville<br />
est fréquemment le siège <strong>de</strong> congrès nationaux et internationaux.<br />
■ L’activité internationale<br />
44<br />
Des années durant, les Journées <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta constituèrent<br />
un c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ; elles rassemb<strong>la</strong>ient annuellement les <strong>de</strong>rmatologues<br />
d’Argentine et d’Uruguay, les <strong>de</strong>ux pays en étant alternativement le siège. Bartolomé<br />
Vignale stimu<strong>la</strong> leur réalisation en Uruguay, accompagné <strong>de</strong> Quiroga, Mazzini, Pierini<br />
et Grinspan en Argentine.<br />
Le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) organisa en 1963 le<br />
V e Congrès international, dont le prési<strong>de</strong>nt fut Luis Pierini; David Grinspan en fut le<br />
secrétaire général. L’événement réunit toute <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine et ibéro-<strong>américaine</strong><br />
(figures 15, 16, 17, 18).<br />
Buenos Aires fut le siège du XV e Congrès du CILAD en 2003, présidé par Ana Kaminsky,<br />
tandis que Miguel A. Allevato faisait office <strong>de</strong> secrétaire général. Plus <strong>de</strong>
3 000 <strong>de</strong>rmatologues y assistèrent et jugèrent que ce congrès fut l’événement le plus<br />
bril<strong>la</strong>nt et le plus fructueux parmi ceux organisés jusqu’à présent.<br />
En 1973, Sebastiao Sampaio, Pablo Viglioglia, Juan Carlos Gatti et Osvaldo Mángano<br />
conçurent <strong>la</strong> Réunion annuelle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains du Cône Sud<br />
(RADLA) ; à ses débuts et jusqu’au VIII e Congrès, l’Argentine et le Brésil organisait tour<br />
à tour cette réunion annuelle. Désormais, les autres pays d’Amérique <strong>la</strong>tine l’accueillirent<br />
également, faisant <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA le congrès le plus significatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, aussi bien<br />
pour <strong>la</strong> qualité du travail scientifique que pour <strong>la</strong> quantité d’assistants. La<br />
réunion qui eut lieu à Buenos Aires en 2005 fut présidée par le Dr Edgardo Choue<strong>la</strong>; il<br />
travail<strong>la</strong> <strong>de</strong> manière ardue et décidée pour que le nombre <strong>de</strong> pays intervenants soit<br />
augmenté, <strong>la</strong> Colombie, le Venezue<strong>la</strong>, l’Équateur et le Mexique s’étant alors ajoutés,<br />
suivis prochainement <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté hispanophone <strong>de</strong>s États-Unis.<br />
D’autres activités furent organisées, comme <strong>de</strong>s réunions internationales <strong>de</strong> léprologie,<br />
sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s Drs Gatti et Cardama, ou le Congrès mondial <strong>de</strong> cancer cutané,<br />
présidé par León Jaimovich, avec Fernando Stengel comme secrétaire. Des réunions internationales<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique se réalisent périodiquement.<br />
Ces antécé<strong>de</strong>nts significatifs justifient et anticipent l’éc<strong>la</strong>t du prochain Congrès mondial<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui aura lieu à Buenos Aires en 2007, dont le prési<strong>de</strong>nt sera Ricardo<br />
Galimberti et le secrétaire général Adrián M. Pierini.<br />
L’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont<br />
les institutions qui représentent toute <strong>la</strong> République argentine. Au début, l’activité <strong>de</strong>rmatologique<br />
était centralisée autour <strong>de</strong> Buenos Aires; plus tard, <strong>de</strong>s filiales et <strong>de</strong>s sections<br />
furent établies, reconnaissant <strong>la</strong> capacité et le prestige <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s<br />
provinces argentines. Les sections <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui regroupe<br />
plus <strong>de</strong> 2500 <strong>de</strong>rmatologues, se trouvent à Bahía B<strong>la</strong>nca (province <strong>de</strong> Buenos Aires),<br />
Comahue, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Jujuy, La P<strong>la</strong>ta, Littoral, Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta,<br />
Mendoza, Misiones, Rosario, Salta, San Juan, Santiago <strong>de</strong>l Estero et Tucumán; les délégations<br />
sont situées à Catamarca, San Luis, Santa Cruz et sur <strong>la</strong> Terre <strong>de</strong> Feu. La Société<br />
argentine <strong>de</strong> léprologie fait également partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> SAD.<br />
Les différentes sous-spécialités<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
■ Les différentes sous-spécialités<br />
Dermato-pathologie: à l’origine, Pablo Box et Eugenio Forman étaient les seuls à<br />
l’exercer; suite à l’action du Dr Jorge Abu<strong>la</strong>fia, maître <strong>de</strong>s générations futures, le<br />
nombre <strong>de</strong> professionnels intéressés par <strong>la</strong> spécialité augmenta. José G. Casas, spécialiste<br />
<strong>de</strong> renommée internationale, est professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> pathologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Buenos Aires et prési<strong>de</strong> <strong>la</strong> filiale régionale <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> l’International<br />
Aca<strong>de</strong>my of Pathology. Parmi les pathologistes réputés, nous citerons Roberto G. Schroh,<br />
Oscar Bianchi, Ignacio Calb, María Cristina Kien, Gabriel Magariños, Gracie<strong>la</strong> Sánchez,<br />
Eduardo Lacentre, Alicia Kowalczuk, Javier Anaya, Alberto Carril et Oscar Sanguinetti.<br />
Jorge Monti et Adriana Bergero développent leur activité à Rosario; Roberto Castelleto<br />
et Jorge Cueto (fils), à La P<strong>la</strong>ta. Aníbal Ortiz Medina travaille à Mendoza et Susana Romero<br />
dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Salta.<br />
La Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie (SADEPA) organise régulièrement <strong>de</strong>s<br />
cours et <strong>de</strong>s réunions, invitant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmo-pathologistes étrangers. Elle réalise également<br />
le cours bisannuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie optique basique, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s Drs Oscar<br />
Bianchi et Roberto Schroh.<br />
Dermatologie pédiatrique : parmi les figures remarquables, citons le Pr. Héctor<br />
Crespi, homme sérieux qui jouit d’un grand prestige ; Dagoberto Pierini (figure 19),<br />
maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ; Adrián M. Pierini, prési<strong>de</strong>nt du Vll e Congrès international <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique ; Margarita Luna (née Larral<strong>de</strong>), prési<strong>de</strong>nte du Congrès<br />
45<br />
Figure 19.<br />
Pr. Dagoberto Pierini
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
46<br />
<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique (2006); Rita García Díaz, José A. Mássimo,<br />
Silvia Pueyo, Zulema Piccone, Nélida Parra (née Pizzi) et Jorge Laffargue, entre autres.<br />
La Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique fut fondée en décembre 1989,<br />
<strong>de</strong>venant plus tard l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique (ASADEPE). De<br />
nos jours un cours universitaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pédiatrie est à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> J.A. Mássimo,<br />
M. Larral<strong>de</strong>, A.M. Pierini et L. Valle, octroyant le diplôme correspondant.<br />
Chirurgie <strong>de</strong>rmatologique: elle prit un é<strong>la</strong>n décisif grâce au Pr. Norberto Grinspan<br />
Bozza, fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. La spécialité rassemble <strong>de</strong>s<br />
chirurgiens <strong>de</strong>rmatologues très compétents tels qu’Abel González (expert en chirurgie <strong>de</strong><br />
Mohs), Rafael Garzón, Horacio Costa Córdova, Daniel Ballesteros et Gilberto González<br />
Rescigno. Le cours annuel <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique et d’esthétique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est dirigé par Horacio Costa Córdoba, Eduardo De Carli et<br />
Lidia Inés Vil<strong>la</strong>lba.<br />
Stomatologie: comme nous l’avons déjà signalé, <strong>la</strong> stomatologie doit ses origines à<br />
David Grinspan, dont le monumental traité recouvre toutes les facettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
José Kriner, Samuel B<strong>la</strong>ustein, Julio Díaz, S. Belin, E. Mc Ad<strong>de</strong>n, Gracie<strong>la</strong> Fernán<strong>de</strong>z<br />
B<strong>la</strong>nco et Silvina González poursuivirent le travail du Dr Grinspan.<br />
Cosmétologie: stimulée en Argentine par le Pr. Aarón Kaminsky, <strong>la</strong> spécialité prit une<br />
importance internationale. Des cours, auxquels assistent plusieurs <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tinoaméricains,<br />
ont fréquemment lieu dans le pays. Les figures remarquables en Argentine<br />
sont Alejandro Cor<strong>de</strong>ro (fils), Ana Kaminsky, Gracie<strong>la</strong> Cuomo, Rosa Flom. Chaque service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie comporte une section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-cosmétologie, à <strong>la</strong> charge d’un chef<br />
<strong>de</strong>rmatologue accompagné du personnel technique <strong>de</strong> cosmétologie (auparavant, <strong>de</strong>s<br />
cosmétologues). Il existe également <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité consacrées au soin et à<br />
l’amélioration <strong>de</strong>s aspects éthiques <strong>de</strong> cette pratique. Cosmetología Dermatológica Práctica<br />
[Cosmétologie Dermatologique Pratique], <strong>de</strong> M.I. Quiroga et C.F. Guillot (1973), et<br />
Cosmiatría [Cosmétologie], <strong>de</strong> P. Viglioglia et J. Rubin <strong>de</strong>vinrent les ouvrages c<strong>la</strong>ssiques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Léprologie: son histoire va <strong>de</strong> pair avec celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Suivant certaines<br />
théories, <strong>la</strong> lèpre fut introduite en Amérique par les découvreurs et les premiers conquérants,<br />
qui engagèrent probablement <strong>de</strong>s personnes ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s comme soldats et marins; le<br />
commerce d’esc<strong>la</strong>ves africains du début du XVI e siècle fut un facteur qui contribua également<br />
à étendre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die sur le continent. L’arrivée <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves étant plus limitée en<br />
Argentine, il est probable que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die soit passée dans le pays en provenance <strong>de</strong>s régions<br />
voisines telles que le Paraguay, le Brésil et le Pérou.<br />
Ce fut en 1760 que l’on prit connaissance <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong>s premiers cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
à Buenos Aires, les patients étant éloignés <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville et envoyés à Lima. En 1792, le<br />
protomedico Manuel Rodríguez iso<strong>la</strong> le premier noyau <strong>de</strong> lèpre à Santa Fe (4 patients).<br />
Les guerres d’indépendance disséminèrent ces noyaux vers le Nord-Est, le Nord-Ouest et<br />
<strong>la</strong> région <strong>de</strong> La Pampa. La Maison d’isolement (actuellement hôpital Muñiz) fut fondée en<br />
1883 et reçut <strong>la</strong> même année le premier ma<strong>la</strong><strong>de</strong> atteint <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. Le Pr. Aberastury et<br />
le Dr Farini prirent en charge ces patients. La première conférence nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
eut lieu en 1903, et en 1926 l’assemblée légis<strong>la</strong>tive vota <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie antilépreuse,<br />
rédigée par le Pr. Aberastury et soutenue avec persévérance par le Pr. P. Baliña.<br />
Le premier recensement <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre se réalisa entre 1927 et 1929; il révé<strong>la</strong><br />
un total <strong>de</strong> 2300 ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. En 1930 naquit à l’hôpital Muñiz <strong>la</strong> Fondation du ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
lépreux <strong>de</strong> <strong>la</strong> République argentine. Au cours <strong>de</strong>s années suivantes une série <strong>de</strong> cliniquescolonies<br />
furent inaugurées à Posadas (province <strong>de</strong> Misiones), Is<strong>la</strong> <strong>de</strong>l Cerrito (Corrientes),<br />
San Francisco <strong>de</strong>l Chañar (Córdoba), General Rodríguez (province <strong>de</strong> Buenos Aires, en<br />
1941) et Diamante (Entre Ríos, en 1948). En 1929, le Pr. Fidanza et ses disciples<br />
J. Fernán<strong>de</strong>z et S. Schujman organisèrent le service <strong>de</strong> léprologie à Rosario, qui s’occupa<br />
<strong>de</strong> préparer <strong>la</strong> lépromine standard en 1946, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> II e Conférence pan<strong>américaine</strong> <strong>de</strong>
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
léprologie à Rio <strong>de</strong> Janeiro. Plus tard, Eduardo Carboni et Augusto Mercau se distinguèrent<br />
dans <strong>la</strong> spécialité.<br />
Société argentine <strong>de</strong> léprologie (SAL): elle fut fondée en août 1954 par un groupe <strong>de</strong><br />
41 mé<strong>de</strong>cins intéressés par <strong>la</strong> léprologie et réunis en assemblée au siège <strong>de</strong> l’Association<br />
médicale argentine <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires. La première commission directive, présidée<br />
par J.M. Fernán<strong>de</strong>z, était intégrée par les Drs L. L<strong>la</strong>no, E. Capurro, G. Basombrío,<br />
F. Wilkinson, S. Schujman et L. Argüello Pitt. Parmi les fondateurs <strong>de</strong> cette nouvelle société,<br />
<strong>de</strong>s léprologues illustres tels que P. Arcuri, L.M. Baliña, E. Carboni, J.E. Cardama,<br />
C. Consigli, J.C. Gatti, M. Giménez, E. Jonquières, R. Manzi, A. Mercau, H. Sánchez<br />
Caballero, J. Scappini, A. Serial et E. Tello, entre autres.<br />
R. Val<strong>de</strong>z, G. Pizzariello, L. Olivares, A.M. San Martín et N. Vaquero sont les figures<br />
argentines qui se distinguent actuellement en léprologie.<br />
L’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société fut <strong>la</strong> revue Leprología, fondée en janvier 1956 et éditée<br />
pendant 20 ans. Sa publication fut interrompue pour <strong>de</strong>s raisons d’ordre économique.<br />
Parmi d’autres publications <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, nous citerons les ouvrages <strong>de</strong>s<br />
professeurs J.C. Gatti et J.E. Cardama: Tratado <strong>de</strong> leprología [Traité <strong>de</strong> léprologie] et<br />
Temas <strong>de</strong> Leprología [Sujets <strong>de</strong> léprologie], du Dr L.M. Baliña.<br />
Une assemblée extraordinaire décida en mai 1988 que <strong>la</strong> SAL <strong>de</strong>viendrait une section<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Mycologie: Pablo Negroni étudia cette spécialité, publia <strong>de</strong> nombreux ouvrages sur le<br />
sujet. Ricardo Negroni, référence mondiale dans le domaine, poursuivit bril<strong>la</strong>mment les<br />
recherches. Ricardo Galimberti — dont les apports sont publiés par <strong>de</strong>s revues étrangères<br />
—, Vicente Ma<strong>de</strong>o, Susana Carabelli et Leonardo Amante intègrent <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s mycologues<br />
argentins dotés d’une soli<strong>de</strong> formation.<br />
Cryochirurgie: ses figures <strong>de</strong> renommée furent E. Turjansky et G. Sto<strong>la</strong>r (auteurs<br />
d’un livre <strong>de</strong> consultation obligatoire), <strong>de</strong>s pionniers comme Alberto Torres Cortijo et<br />
Carlos Kaminsky, ainsi que Luis Sevinsky et Eduardo Rodríguez (<strong>de</strong> nos jours). La Société<br />
argentine <strong>de</strong> cryochirurgie organise périodiquement <strong>de</strong>s réunions au siège <strong>de</strong> l’Association<br />
médicale argentine.<br />
Infections <strong>de</strong> transmission sexuelle (ITS): pendant plus <strong>de</strong> 20 ans, les pays <strong>la</strong>tino-américains<br />
firent partie <strong>de</strong> l’Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
(ULACETS en espagnol), créée au Brésil et en Argentine et qui travail<strong>la</strong> intensément au<br />
contrôle <strong>de</strong>s différentes <strong>de</strong>rmatoses entremêlées. Ses prési<strong>de</strong>nts furent, entre autres, les<br />
Argentins Alberto Woscoff, Juan Carlos Flichman et Mario Ambrona. Actuellement, l’Union<br />
argentine contre les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> transmission sexuelle (UACETS) est intégrée par Ricardo<br />
Casco, Alcira Bermejo, Mario Oxilia et Luis Belli. L’UACETS joua un rôle important dans <strong>la</strong><br />
reconnaissance, <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’Organisation sanitaire pan<strong>américaine</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis congénitale<br />
comme une <strong>de</strong>s pathologies prioritaires du continent américain.<br />
Les livres <strong>de</strong> référence sur le sujet sont le Tratado <strong>de</strong> Venereología [Traité <strong>de</strong> Vénéréologie],<br />
écrit par le Dr Viglioglia et coll.; ETS y SIDA [MST et SIDA], <strong>de</strong> P. Viglioglia et<br />
A. Woscoff ainsi que Las ETS en tiempos <strong>de</strong>l SIDA [Les MST à l’époque du SIDA], dont les<br />
auteurs sont M. Marini et M. Oxilia.<br />
Actuellement, les IST représentent toujours un grave problème sanitaire dans les provinces,<br />
qui reçoivent le soutien <strong>de</strong>s professionnels et <strong>de</strong>s services consacrés au sujet.<br />
Photothérapie: plusieurs services hospitaliers possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s appareils PUVA et UVB.<br />
Les pionniers dans <strong>la</strong> technique sont Edgardo Choue<strong>la</strong>, Fernando Stengel, J. Ubogui et<br />
Luis Sevinsky, qui se consacrent également à son enseignement.<br />
Il est impossible <strong>de</strong> mentionner tous les professionnels qui se distinguent dans l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s différentes pathologies sans s’exposer à <strong>de</strong>s oublis impardonnables. Nous en citerons<br />
quelques-uns: Horacio Cabo (diabètes et peau), Esteban Saraceno (mé<strong>de</strong>cine interne et<br />
peau), Sergio et Osvaldo Stringa, Patricia Troielli, María Bibiana Leroux et Cristina Pascutto<br />
(col<strong>la</strong>génopathies).<br />
47
Figure 20. Revista<br />
Argentina <strong>de</strong><br />
Dermatología<br />
Figure 21. Archivos<br />
Argentinos <strong>de</strong><br />
Dermatología<br />
Figure 22.<br />
Dermatología<br />
Argentina<br />
Figure 23.<br />
Actualizaciones<br />
Terapéuticas<br />
Dermatológicas<br />
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
La Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> Fondation du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau — présidée<br />
par Fernando Stengel — organisent ensemble <strong>de</strong>s campagnes annuelles nationales<br />
pour contrôler <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die; les résultats sont analysés et constituent <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>s pour les<br />
pays qui entreprennent le même travail.<br />
■ Revues Revues sur <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
Quatre revues sont publiées périodiquement en Argentine (figures 20-23):<br />
• Revista Argentina <strong>de</strong> Dermatología, organe officiel <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, créée en 1908 et <strong>de</strong>rnièrement dirigée par P. Magnin, J. Abu<strong>la</strong>fia, L. Valle,<br />
N. Gottlib et A. Pa<strong>la</strong>cios.<br />
• Archivos Argentinos <strong>de</strong> Dermatología, dont <strong>la</strong> publication fut <strong>la</strong>ncée en 1951 et dirigée<br />
successivement par Luis Pierini, Dagoberto Pierini, Santiago Mosto, Adrián Pierini,<br />
Fernando Stengel et Andrés Politi.<br />
• Dermatología Argentina, organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
fondée en 1994 et dirigée par Alberto Woscoff (directeur honoraire) et Liliana Olivares.<br />
• Actualizaciones terapéuticas <strong>de</strong>rmatológicas, dirigée et éditée par León Jaimovich<br />
et Miguel Allevato; elle est reconnue en Amérique <strong>la</strong>tine et abor<strong>de</strong> l’aspect thérapeutique<br />
contemporain <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
■ Livres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
48<br />
• Dermatomicosis [Dermatomycoses]. P. Negroni, 1942.<br />
• Micosis cutáneas y viscerales [Mycoses cutanées et viscérales]. P. Negroni, 1944,<br />
1961.<br />
• Dermatología y sifilología [Dermatologie et syphilologie]. M. Fernán<strong>de</strong>z B<strong>la</strong>nco et<br />
M.A. Mazzini, 1945.<br />
• Porfirinas y porfirias [Porphyrines et porphyries]. J.M. Borda, 1946.<br />
• Introducción al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatosifilología [Introduction à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-syphilologie].<br />
L.E. Pierini et M. Quiroga, 1946.<br />
• PH cutáneo [PH cutané]. C.F. Guillot, 1949.<br />
• Eczema [Eczéma]. M. Quiroga et coll. 1949.<br />
• Compendio <strong>de</strong> Dermatosifilografía [Précis <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-syphiligraphie]. F. Noussitou,<br />
A. Cor<strong>de</strong>ro et A.M. Mom, 1949.<br />
• Tuberculosis <strong>de</strong> piel [Tuberculose <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau]. R. Garzón, 1950.<br />
• Sarcomatosis <strong>de</strong> Kaposi [Sarcomatose <strong>de</strong> Kaposi]. D. Grinspan, 1950.<br />
• Rosácea [Rosacée]. P.H. Magnin, 1953.<br />
• Dermatomiositis [Dermatomyosite]. J.M. Borda et S. Stringa, 1955.
• Dermatología Geriátrica [Dermatologie gériatrique]. M. Quiroga, C.F. Guillot et<br />
A. Woscoff, 1963.<br />
• Manual <strong>de</strong> Dermatología [Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. J.C. Gatti et J.E. Cardama (plusieurs<br />
éditions <strong>de</strong> 1963 à 1989).<br />
• Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en <strong>la</strong> Argentina [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Argentine]. M.I. Quiroga,<br />
1964.<br />
• Porfirias [Porphyries]. P.A. Viglioglia et E.F. Saraceno, 1968.<br />
• Sífilis: clínica y <strong>la</strong>boratorio [Syphilis: clinique et <strong>la</strong>boratoire]. P.A. Viglioglia et<br />
E. Gaya Noya, 1968.<br />
• Dermatología infantil [Dermatologie infantile]. A.M. Mom et A. Choue<strong>la</strong>, 1968.<br />
• Úlceras <strong>de</strong> pierna [Ulcères <strong>de</strong>s jambes]. R. Garzón (fils), 1969.<br />
• Las hipo<strong>de</strong>rmitis [Les hypo<strong>de</strong>rmites]. L.E. Pierini, J. Abu<strong>la</strong>fia et S. Wainfeld, 1969.<br />
• Temas <strong>de</strong> Dermatología [Sujets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. Tomes I à V. P.H. Magnin et coll.<br />
• La lepra: pasado y presente [La lèpre: passé et présent]. M. Quiroga, 1974.<br />
• Polidisp<strong>la</strong>sia con hipop<strong>la</strong>sia dérmica focal [Polydysp<strong>la</strong>sie avec hypop<strong>la</strong>sie <strong>de</strong>rmique<br />
focale]. P. Magnin, J.G. Casas, M. Marini et E. Garrido, 1974.<br />
• Dermatología pediátrica en <strong>la</strong> práctica clínica [Dermatologie pédiatrique dans <strong>la</strong><br />
pratique clinique]. H.G. Crespi, 1978.<br />
• Tumores <strong>de</strong> piel [Tumeurs cutanées]. P. Magnin et J.G. Casas, 1978.<br />
• Porfirinas y porfirias [Porphyrines et porphyries]. A. Batlle, P. Magnin et E. Wi<strong>de</strong>r, 1981.<br />
• Urticaria [Urticaire]. A. Cor<strong>de</strong>ro et A. Woscoff, 1981.<br />
• Las disproteinemias en <strong>de</strong>rmatología [Les disprotéinémies en <strong>de</strong>rmatologie]. B. Nu<strong>de</strong>nberg,<br />
1982.<br />
• Manifestaciones <strong>de</strong>rmatológicas <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s internas [Manifestations <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies internes]. P. Viglioglia, 1982.<br />
• Terapéutica <strong>de</strong>rmatológica en <strong>la</strong> infancia [Thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique chez les<br />
enfants]. N.A. Vivot et coll., l983.<br />
• Dermatología elemental [Dermatologie élémentaire]. P. Viglioglia, 1985.<br />
• El eccema infantil [L’eczéma infantile]. A. Cor<strong>de</strong>ro et H.G. Crespi, 1985.<br />
• Conceptos prácticos <strong>de</strong> farmacología <strong>de</strong>rmatológica externa [Concepts pratiques <strong>de</strong><br />
pharmacologie <strong>de</strong>rmatologique externe]. J.C. Gatti, J.E. Cardama, J.G. Machargo et<br />
L. Olivares, 1986.<br />
• Terapéutica <strong>de</strong>rmatológica actualizada [Thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique mise à<br />
jour]. L. Jaimovich, 1986.<br />
• Mucinosis. Nuevas aproximaciones a <strong>la</strong> clínica [Mucinose. Nouvelles approches à <strong>la</strong><br />
clinique]. B. Nu<strong>de</strong>nberg, 1986.<br />
• Dermatología médicoquirúrgica [Dermatologie médicochirurgicale]. R. Garzón (fils), 1987.<br />
• Dermatología pediátrica [Dermatologie pédiatrique]. A. Cor<strong>de</strong>ro et H.G. Crespi, 1987.<br />
• Tumores cutáneos <strong>de</strong> los tejidos b<strong>la</strong>ndos [Tumeurs cutanées <strong>de</strong>s tissus mous]. P. Magnin<br />
et R. Schroh, 1989.<br />
Quelques livres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
• Introducción a <strong>la</strong> inmuno<strong>de</strong>rmatología [Introduction à l’immuno<strong>de</strong>rmatologie].<br />
A. Woscoff et P. Troielli, 1994.<br />
• Dermatología neonatal y pediátrica [Dermatologie néonatale et pédiatrique].<br />
M. Larral<strong>de</strong> <strong>de</strong> Luna, 1995.<br />
• Citogenética en el pregrado [Cytogénétique dans les étu<strong>de</strong>s supérieures]. R. Garzón<br />
(fils), Savia, Bornetto, Garzón, 1996.<br />
• Manifestaciones cutáneas <strong>de</strong> <strong>la</strong> diabetes [Manifestations cutanées du diabète].<br />
H. Cabo, 1996.<br />
• Ictiosis. Estados ictiosiformes [Ichtyose. États ichtyosiformes]. A. Cor<strong>de</strong>ro, 1997.<br />
49
PABLO A. VIGLIOGLIA, ALBERTO WOSCOFF<br />
• Manifestaciones cutáneas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s enfermeda<strong>de</strong>s sistémicas [Manifestations cutanées<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies systémiques]. A. Cor<strong>de</strong>ro, M. Cobreros, M. Allevato et L. Donati, 1997.<br />
• El eccema infantil [L’eczéma infantile]. A. Cor<strong>de</strong>ro et H. Crespi, 1998.<br />
• Nevos [Nævi]. H. Cabrera et S. García, 1998.<br />
• Manual <strong>de</strong> Dermatología Clínica [Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie clinique]. R.E. Balsa,<br />
1998.<br />
• Dermatología infantil en <strong>la</strong> clínica pediátrica [Dermatologie infantile dans <strong>la</strong> clinique<br />
pédiatrique]. S. Pueyo et J.A. Mássimo, 1999.<br />
• Urticaria [Urticaire]. A. Woscoff et P. Troielli, 1999.<br />
• At<strong>la</strong>s Fotográfico <strong>de</strong> Dermatología [At<strong>la</strong>s photographique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. A. Kaminsky<br />
et G. Fernán<strong>de</strong>z B<strong>la</strong>nco.<br />
• Dermatoscopía [Dermatoscopie]. H.A. Cabo.<br />
• Dermatopatología [Dermatopathologie]. J.G. Casas, G. Magariños et G. Casas.<br />
• Temas <strong>de</strong> Dermatología [Sujets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. P. et M. Viglioglia.<br />
• Orientación <strong>de</strong>rmatológica en Medicina Interna [Orientation <strong>de</strong>rmatologique en mé<strong>de</strong>cine<br />
interne]. A. Woscoff et A. Kaminsky, 2002.<br />
• Dermatología <strong>de</strong> Gatti Cardama [Dermatologie <strong>de</strong> Gatti Cardama]. H. Cabrera et<br />
F. Gatti, 2003.<br />
• Dermatología en Medicina Interna [Dermatologie en mé<strong>de</strong>cine interne]. A. Woscoff,<br />
A. Kaminsky, M. Marini et M. Allevato, 2003.<br />
• Principios <strong>de</strong> inmuno<strong>de</strong>rmatología [Principes d’immuno<strong>de</strong>rmatologie]. A. Woscoff,<br />
P. Troielli et M. Label, 2004.<br />
• Dermatología en el pregrado [La <strong>de</strong>rmatologie dans les étu<strong>de</strong>s supérieures]. P. Magnin<br />
et coll. (plusieurs éditions).<br />
• Manual básico <strong>de</strong> Dermatología [Manuel basique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. R. Garzón<br />
(4 tomes).<br />
■ Maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong> Dermatologie <strong>de</strong>rmatologie Argentine argentine (SAD) (SAD)<br />
La Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie octroya le titre <strong>de</strong> « maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
argentine » aux professionnels suivants: Alejandro A. Cor<strong>de</strong>ro, Miguel Ángel Mazzini,<br />
David Grinspan, Pablo A. Viglioglia, Enrique D. Jonquières, Enrique E. Tello, León Jaimovich,<br />
Jorge Abu<strong>la</strong>fia, Vicente Pecoraro, Sergio Stringa, Carlos Consigli, Augusto Casalá,<br />
Gerónimo López González, Osvaldo Mangano, Bernardo Nu<strong>de</strong>mberg, Roberto<br />
Biagini, Alberto Carvalho, Alberto Woscoff. ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Grinspan D. Sinopsis histórica <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dermatología argentina.<br />
Editado con motivo <strong>de</strong>l 10º<br />
Congreso Argentino <strong>de</strong><br />
Dermatología. Buenos Aires;<br />
1990.<br />
Man A. Referencias<br />
<strong>de</strong>rmatológicas en el Litoral<br />
[communication personnelle].<br />
Nu<strong>de</strong>nberg B. Tres héroes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lucha contra <strong>la</strong> lepra y <strong>la</strong>s<br />
enfermeda<strong>de</strong>s venéreas en<br />
Septembre 2005.<br />
Rosario. Edición <strong>de</strong>l autor;<br />
1985.<br />
Olivares L. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra<br />
[communication personnelle].<br />
Parra C, Pizzi <strong>de</strong> Parra N.<br />
Referencias <strong>de</strong>rmatológicas<br />
en Mendoza [communication<br />
personnelle].
DERMATOLOGIE:<br />
ART ET CULTURE<br />
Nous remercions le Pr. Dr Fe<strong>de</strong>rico Pérgo<strong>la</strong>, directeur <strong>de</strong> ce<br />
travail.<br />
Le concept <strong>de</strong> culture est très vaste et permet <strong>de</strong>s interprétations différentes.<br />
Si nous adhérons à <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> Gordon Chil<strong>de</strong> 1 , il s’agit <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
éléments matériels et immatériels dont l’homme se sert pour se débrouiller dans<br />
<strong>la</strong> société 2 . Chaque groupe humain possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s règles propres et uniques qui le<br />
caractérisent 3 .<br />
Dans <strong>la</strong> formation du mé<strong>de</strong>cin, <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> <strong>la</strong> liberté spirituelle est indispensable:<br />
elle privilégie <strong>la</strong> valeur éthique anthropologique et <strong>la</strong> priorité <strong>de</strong> l’être. Les humanités<br />
médicales (l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, <strong>la</strong> linguistique, l’anthropologie, <strong>la</strong> sociologie,<br />
l’éthique, l’épistémologie, <strong>la</strong> communication et l’esthétique médicales) permettent d’encadrer<br />
<strong>la</strong> conception <strong>de</strong> l’homme dans le schéma socioculturel. On réussit à créer à travers<br />
elles l’esprit critique, l’attitu<strong>de</strong> du doute méthodique et rationnel. Cet<br />
antidogmatisme va nous libérer <strong>de</strong>s traits négatifs tels que <strong>la</strong> déshumanisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
et le réductionnisme biologique 4 .<br />
Dans son ouvrage Filosofía y Medicina [Philosophie et mé<strong>de</strong>cine] Lou<strong>de</strong>t affirme: « Il<br />
n’est pas inapproprié <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> philosophie. Les grands mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong><br />
tous les temps et <strong>de</strong> toutes les écoles furent mé<strong>de</strong>cins et philosophes <strong>de</strong> leur science. Ils<br />
ne contemplèrent pas seulement les effets, mais ils en cherchèrent <strong>la</strong> cause; ils ne s’égarèrent<br />
pas dans <strong>la</strong> mer mouvante <strong>de</strong>s symptômes et ils en cherchèrent une explication<br />
intime; ils ne furent pas <strong>de</strong>s prescripteurs impressionnistes, mais <strong>de</strong>s praticiens expérimentés;<br />
ils respectèrent toujours l’action curative <strong>de</strong> <strong>la</strong> propre nature et ils ne <strong>la</strong> perturbèrent<br />
pas avec <strong>de</strong>s impertinences thérapeutiques ; ils furent <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins pru<strong>de</strong>nts<br />
avant d’être <strong>de</strong>s innovateurs audacieux. » 5<br />
La Dermatologie dans <strong>la</strong> littérature<br />
AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature<br />
On peut entendre par « art » l’œuvre humaine exprimant <strong>de</strong> manière symbolique, à<br />
travers <strong>de</strong>s matériaux divers, un aspect <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité comprise esthétiquement.<br />
Plusieurs mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues possè<strong>de</strong>nt une sensibilité qui les pousse à cultiver<br />
les arts (musique, peinture, littérature, sculpture). Ils ne se limitent pas à <strong>la</strong> pratique<br />
quotidienne <strong>de</strong> leur profession mais encore, pour essayer <strong>de</strong> comprendre entièrement <strong>la</strong><br />
condition humaine, ils veulent parvenir à un savoir intégral. Nous distinguerons parmi<br />
eux Carlos Fe<strong>de</strong>rico Guillot et Marcial Quiroga.<br />
51
AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE<br />
Carlos Fe<strong>de</strong>rico Guillot (1917-1984), bril<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>rmatologue, fut membre fondateur<br />
du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ainsi que <strong>de</strong>s Sociétés argentines <strong>de</strong><br />
gérontologie et gériatrie, d’anthropologie et d’histoire.<br />
On trouve chez Marcial Quiroga (1899-1993) un autre exemple <strong>de</strong> personnalité éclectique.<br />
Dermatologue remarquable, il fut professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmato-syphiligraphique<br />
à l’hôpital Ramos Mejía (1947-1965). Il fut désigné membre <strong>de</strong>s Académies nationales<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et d’histoire et on lui octroya les doctorats honoris causa <strong>de</strong>s universités <strong>de</strong><br />
Madrid et Complutense. En 1965, <strong>la</strong> municipalité <strong>de</strong> Buenos Aires le nomma maître extraordinaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et en 1977 il <strong>de</strong>vint professeur émérite à l’université <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
En tant qu’historien médical, nous distinguerons parmi ses ouvrages: Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lepra en Argentina [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Argentine] ; La lepra. Pasado, Presente [La<br />
lèpre. Passé, présent] ; Manuel Moreno, biografía [Manuel Moreno, biographie] et La<br />
Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong> Buenos Aires [L’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Buenos Aires]. Nous citerons également son livre Paremiología Médica y otros refranes<br />
en <strong>la</strong> Argentina [Parémiologie médicale et autres dictons en Argentine] et le vaste mé<strong>la</strong>nge<br />
Un libro y seis lectores [Un livre et six lecteurs] 6, 7, 8 .<br />
Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières décennies, l’utilisation <strong>de</strong> l’informatique s’amplifia dans <strong>la</strong> vie<br />
<strong>de</strong> tous les jours, permettant un échange interactif mondial et sans limites qui favorise <strong>la</strong><br />
maîtrise du temps et <strong>de</strong> l’espace. Marcelo Sosa Ludicissa 9 affirme que dans le mon<strong>de</strong> virtuel<br />
<strong>de</strong> l’Internet, il est possible d’accé<strong>de</strong>r à l’information <strong>de</strong> façon concourante par différents<br />
moyens. Ainsi par exemple, à partir d’un article écrit par un certain auteur, on peut<br />
connaître d’autres données supplémentaires. Cette interaction produit une capacité plus<br />
gran<strong>de</strong> d’association <strong>de</strong>s idées, ce qui permet <strong>de</strong> multiplier <strong>la</strong> capacité d’apprentissage.<br />
Selon Berlim, actuellement, « l’information est sphérique, dynamique, avec <strong>de</strong> multiples<br />
points d’accès et <strong>de</strong> liaison; chacun construit essentiellement son information. Le papier<br />
est remp<strong>la</strong>cé par <strong>de</strong>s images électroniques transmises par télécommunication ».<br />
Le développement d’une société informatisée va permettre <strong>de</strong> construire <strong>de</strong> nouveaux<br />
archétypes culturels.<br />
■ La La mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire. Les guérisseurs Les guérisseurs et <strong>la</strong> magie et <strong>la</strong> magie<br />
52<br />
Pérgo<strong>la</strong> s’exprime comme suit : « On ignore si le mot magie doit son origine au nom d’une<br />
<strong>de</strong>s tribus medas nommée mages ou bien s’il provient d’anciennes voix <strong>la</strong>tines dont <strong>la</strong> signification<br />
est liée à <strong>la</strong> supériorité spirituelle – du point <strong>de</strong> vue étymologique ce<strong>la</strong> semble<br />
bien être vrai. » L’auteur signale trois types <strong>de</strong> magie: <strong>la</strong> théurgie, secrète et religieuse;<br />
<strong>la</strong> magie b<strong>la</strong>nche, appliquée au bien; et <strong>la</strong> magie noire, qui reçoit l’ai<strong>de</strong> du démon 10 .<br />
La magie est interprétée comme <strong>la</strong> croyance que tout phénomène naturel, par<br />
exemple <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, est déterminé par <strong>de</strong>s entités ou <strong>de</strong>s forces invisibles et supérieures,<br />
qui peuvent être dominées d’une certaine manière à travers <strong>de</strong>s cérémonies ou <strong>de</strong>s rituels<br />
exécutés par le sorcier, magicien ou chaman (magie b<strong>la</strong>nche).<br />
Le chaman est un homme qui possè<strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d’entrer en transe extatique (vol<br />
magique ou voyage <strong>de</strong> l’âme). C’est un voyant, un guérisseur et un maître <strong>de</strong> vie.<br />
La formalité du rite comprend <strong>de</strong>s incantations, <strong>de</strong>s conjurations, <strong>de</strong>s enchantements*,<br />
<strong>de</strong>s gestes et <strong>de</strong>s danses. Les rites sont pratiqués à <strong>de</strong>s endroits spéciaux dont l’accès est<br />
difficile, tels que <strong>de</strong>s fontaines, <strong>de</strong>s îles, le sommet <strong>de</strong>s montagnes ou <strong>de</strong>s abîmes.<br />
Pour <strong>la</strong> conception magique, le médicament est efficace grâce au rite par lequel il est<br />
administré, au pouvoir personnel du sorcier et à l’endroit où il est appliqué 11 . Cette idée<br />
* Incantations : moyen superstitieux <strong>de</strong> guérir avec <strong>de</strong>s mots magiques et <strong>de</strong>s médicaments empiriques ; conjurations : imprécations<br />
ou sortilèges <strong>de</strong>s sorciers ; enchantement : action d’enchanter, <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s merveilles <strong>de</strong> façon surnaturelle.
Dermatologie : art et culture<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine est caractéristique <strong>de</strong>s peuples naturels, c’est-à-dire ces unités sociales<br />
ou tribus qui possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s ressources techniques limitées 12 . Suivant l’interprétation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> réalité, il existe cinq mécanismes <strong>de</strong> <strong>la</strong> nosogénèse: l’envoûtement nocif, l’infraction<br />
d’un tabou, <strong>la</strong> pénétration magique d’un objet dans le corps, <strong>la</strong> possession par un esprit<br />
malveil<strong>la</strong>nt et <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> l’âme.<br />
Bon nombre <strong>de</strong> peuples naturels disparurent à cause <strong>de</strong>s épidémies provoquées par<br />
le choc avec d’autres civilisations, les famines, l’émigration et <strong>la</strong> transculturation*.<br />
En Argentine, les Matacos habitèrent le territoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> province du Chaco; quelques<br />
groupes y subsistent encore. Leurs sorciers pratiquaient <strong>la</strong> succion <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et<br />
simu<strong>la</strong>ient l’extraction du mal par <strong>de</strong>s vomissements <strong>de</strong> pierres, d’insectes ou <strong>de</strong> bouts<br />
<strong>de</strong> flèches qu’ils cachaient dans leur bouche. Pour ce<strong>la</strong>, ils accompagnaient leurs pratiques<br />
<strong>de</strong> chants et <strong>de</strong> danses. En herboristerie, ils utilisèrent le yetabay ou ja<strong>la</strong>pa; le jus<br />
obtenu <strong>de</strong> ses fleurs était indiqué dans les affections herpétiques et autres <strong>de</strong>rmatoses.<br />
Les Guaranis appartenant au groupe Tupi Guarani habitèrent les îles du fleuve Paraná;<br />
leur habitat s’étendait jusqu’à l’Amazone. Ils se servirent <strong>de</strong> l’huître, ita, coquille<br />
bivalve pulvérisée ou moulue avec <strong>la</strong>quelle ils saupoudraient les p<strong>la</strong>ies ou les abcès pour<br />
accélérer leur guérison. La peau du corbeau (urubu) s’appliquait également sur les<br />
p<strong>la</strong>ies. Pour les ma<strong>la</strong>dies vénériennes, ils utilisaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> résine <strong>de</strong> copaïba (Copaifera<br />
officinalis ou bâton à huile) ; <strong>la</strong> salsepareille (Smi<strong>la</strong>x aspera), cuite et macérée dans du<br />
vin, ayant <strong>la</strong> propriété <strong>de</strong> stimuler <strong>la</strong> sueur, était également préconisée pour le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gale.<br />
Ils utilisaient dans le même but <strong>la</strong> ronce b<strong>la</strong>nche (Bytneria ou Punttneria cartagenesis),<br />
tandis que <strong>la</strong> sauge (Salvia officinalis) était indiquée pour l’épithélialisation <strong>de</strong>s ulcères.<br />
L’utilisation du rocou (Bixa orel<strong>la</strong>na) fut très importante; les graines <strong>de</strong> cet arbre<br />
contiennent <strong>de</strong>ux colorants: l’un est jaune – orellina ; l‘autre est rouge cinabre, appelé<br />
bixina. Les aborigènes appliquaient sur <strong>la</strong> peau <strong>la</strong> bixina, insoluble dans l’eau, combinée<br />
à <strong>de</strong>s graisses, <strong>de</strong>s résines et <strong>de</strong>s cires afin <strong>de</strong> repousser les insectes et d’atténuer l’action<br />
<strong>de</strong>s rayons ultraviolets. Cette « rocourisation » résistait aux bains et à <strong>la</strong> sueur.<br />
À l’époque précolombienne le tabac (Nicotiana tabacum) était utilisé pour soigner <strong>la</strong><br />
gale, l’érysipèle et les piqûres.<br />
Les Mocovis habitèrent <strong>la</strong> région s’étendant <strong>de</strong>puis le fleuve Bermejo et les frontières<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Tucumán jusqu’à <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Santa Fe. Ils utilisèrent le cébil — <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
famille <strong>de</strong>s mimosacées — sous forme <strong>de</strong> plombage pour les lésions muti<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre.<br />
Les tribus pampas s’établirent dans le sud <strong>de</strong> Mendoza, Santa Fe, San Luis, Córdoba<br />
et le nord-ouest <strong>de</strong> Buenos Aires; elles utilisèrent le yang dans <strong>la</strong> thérapeutique <strong>de</strong>s<br />
aphtes buccaux 13 .<br />
Les formes prétechniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine nous léguèrent certaines pratiques qui<br />
s’ajoutèrent à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire (folk Me<strong>de</strong>cine).<br />
L’empirisme (c’est-à-dire le fait d’avoir recours à un remè<strong>de</strong> ou à une pratique parce<br />
que bénéfiques dans <strong>de</strong>s cas simi<strong>la</strong>ires) et <strong>la</strong> magie fusionnèrent en utilisant quelque<br />
drogue qu’ils firent passer du mon<strong>de</strong> primitif ou naturel au mon<strong>de</strong> « civilisé ». Ce sont<br />
par exemple <strong>la</strong> quinquina, l’opium et <strong>la</strong> bel<strong>la</strong>done, entre autres 11 .<br />
La suggestion est <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> employée par les sorciers pour induire <strong>la</strong> guérison 14 . Le<br />
chaman occupe une position privilégiée dans <strong>la</strong> sphère sociale; son ethnie le respecte<br />
parce qu’elle pense qu’il connaît le mystère <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort, et qu’il possè<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> guérir et <strong>de</strong> produire, à sa guise, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
La mé<strong>de</strong>cine est art (tekne) lorsque celui qui l’exerce connaît <strong>de</strong> façon rationnelle <strong>la</strong><br />
définition <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et le remè<strong>de</strong> qui convient pour chaque cas. Ce double savoir est<br />
* Transculturation : processus <strong>de</strong> diffusion ou d’influence <strong>de</strong>s traits culturels d’une société, lorsqu’elle entre en contact avec une<br />
autre société moins évoluée.<br />
53
AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE<br />
54<br />
en rapport avec <strong>la</strong> connaissance, également rationnelle, <strong>de</strong> <strong>la</strong> « nature » <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
et <strong>de</strong> sa guérison.<br />
Le changement <strong>de</strong> paradigme est dû au génie <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins grecs, exprimé dans un<br />
texte d’Alcméon <strong>de</strong> Crotone vers l’an 500 av. J.-C. 11 .<br />
À partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins européens s’installèrent dans<br />
les régions les plus peuplées, mais ils se révélèrent insuffisants pour répondre aux<br />
besoins <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, qui avait en général recours aux guérisseurs.<br />
Ce<strong>la</strong> amena le protomédico Miguel O´Gorman à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au vice-roi Vértiz <strong>la</strong> création<br />
du Protomedicato du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta (1777). Le Protomedicato était une institution<br />
créée en Espagne et à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins désignés par le roi. L’autorisation, octroyée<br />
en 1780, posa les bases <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> science médicale et pharmacologique<br />
sur ces terres.<br />
Yankilevich écrit à propos <strong>de</strong> ces fonctionnaires: « Ils avaient <strong>la</strong> triple fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
direction, <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong>s problèmes du gouvernement en ce qui concernait <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, <strong>la</strong> chirurgie et <strong>la</strong> pharmacie; ils administraient <strong>la</strong> justice, en constituant un<br />
tribunal spécial pour châtier les fautes et les excès commis par les mé<strong>de</strong>cins; ils poursuivaient<br />
les guérisseurs; enfin, ils fixaient les tarifs pour les examens et <strong>la</strong> visite chez<br />
l’apothicaire. » 15<br />
Plus tard, le 9 avril 1822, <strong>la</strong> loi d’arrangement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine fut promulguée sous le<br />
gouvernement du général Martín Rodríguez (1820-1824). Elle contenait 98 articles et, inspirée<br />
par Rivadavia, elle encadrait les attributions du nouveau tribunal <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, qui<br />
al<strong>la</strong>it remp<strong>la</strong>cer le Protomedicato. Cette loi établissait <strong>la</strong> forme et les conditions <strong>de</strong> l’assistance<br />
médicale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacie, et en créait les écoles respectives; elle stipu<strong>la</strong>it dans <strong>de</strong><br />
brefs articles les procédures judiciaires <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie ainsi que les inspections sanitaires<br />
afin <strong>de</strong> prévenir <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses. Elle établissait les attributions<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> police, du port et <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne. Le titre IX traitait <strong>de</strong> l’administration<br />
du vaccin, tandis que l’Académie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut créée à travers le titre X.<br />
Le danger du guérisseur rési<strong>de</strong> dans le fait que, comme il méconnaît <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, il<br />
a recours à <strong>de</strong>s actes arbitraires afin <strong>de</strong> convaincre son client qu’il peut le guérir, et son<br />
action est souvent liée à son appât du gain et à une forme <strong>de</strong> messianisme. Les mé<strong>de</strong>cins<br />
sont actuellement insuffisants par rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>nsité démographique, rendant l’éradication<br />
<strong>de</strong> ce genre <strong>de</strong> pratiques difficile.<br />
Quant aux char<strong>la</strong>tans, Nerio Rojas les définit comme « tout professionnel diplômé<br />
(mé<strong>de</strong>cin, <strong>de</strong>ntiste ou sage-femme) qui, autorisé à exercer l’art <strong>de</strong> guérir, promet une<br />
guérison dans un dé<strong>la</strong>i fixe ou par <strong>de</strong>s moyens secrets ou infaillibles ».<br />
La diffusion actuelle <strong>de</strong> publicités dans les médias favorise l’action <strong>de</strong> guérisseurs<br />
et char<strong>la</strong>tans 16 . Magrassi et Radovich pensent que dans <strong>la</strong> réussite <strong>de</strong>s guérisseurs le<br />
« rapport personnalisé avec leur patient » est très important. « Cette personnalisation <strong>de</strong><br />
l’interaction est due au fait que le savoir et le <strong>la</strong>ngage du guérisseur coïnci<strong>de</strong>nt avec ceux<br />
du ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. » Les facteurs culturels trouvent leur correspondance dans <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die aussi<br />
bien que dans son traitement 14 . En même temps, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stinité leur accor<strong>de</strong> un facteur<br />
<strong>de</strong> suggestion qui favorise leur attraction auprès <strong>de</strong>s clients, et <strong>la</strong> persécution dont ils<br />
font l’objet engendre un courant <strong>de</strong> sympathie parmi ceux qui les consultent.<br />
Certaines conditions déterminent le caractère idéal du guérisseur, par exemple le jour<br />
et le lieu <strong>de</strong> sa naissance, l’héritage familial ainsi que l’ordre <strong>de</strong> naissance au sein <strong>de</strong> sa<br />
famille. Le fait d’être né le Jeudi saint, le réveillon <strong>de</strong> Noël ou le jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> Saint-Judas,<br />
parmi les jours du martyrologe chrétien, est une marque favorable.<br />
Baudouin fut intrigué par les résultats positifs qu’obtenaient parfois les guérisseurs et<br />
il conclut qu’ils étaient dus à leur réputation et aux « braves pratiques dont <strong>la</strong> bravoure et<br />
le manque <strong>de</strong> logique frappent par émerveillement et mettent le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> dans un tel état<br />
d’émotion qu’il favorise l’autosuggestion spontanée; dans ces conditions, <strong>la</strong> foi guérit ».<br />
L’auteur analysa les effets <strong>de</strong> l’autosuggestion dans <strong>la</strong> guérison <strong>de</strong>s verrues vulgaires 17 .
Dermatologie : art et culture<br />
À partir d’un travail réalisé dans l’état du Nouveau-Mexique avec les indigènes<br />
Apaches, les chercheurs L.M. Boyer et R.M. Boyer conclurent que cette ethnie conciliait<br />
chez les adultes un côté hystérique et un côté compulsif. Le sorcier aurait donc <strong>de</strong>s<br />
résultats positifs sur ce type <strong>de</strong> personnalité, notamment dans le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
psychogènes 18 .<br />
En 1838, un nouveau concept prend force avec <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> l’article <strong>de</strong> Max<br />
Jacobi, « Nouvel examen sur les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine psychosomatique ». L’ouvrage<br />
Psicología Médica [Psychologie médicale], du baron Ernest Von Feuchtersleben<br />
paraît au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, dans lequel il s’exprime comme suit: « La peur<br />
produit énurésie, diarrhée, pollutions, érysipèle et <strong>de</strong>s éruptions sur les lèvres; elle<br />
favorise <strong>la</strong> réception <strong>de</strong> <strong>la</strong> contagion et les miasmes; elle perturbe les crises et aggrave<br />
les troubles. » Voici donc une incursion dans <strong>la</strong> névroimmunologie 14 .<br />
Selon Guerra, <strong>la</strong> suggestion intervient dans l’action du mé<strong>de</strong>cin pour guérir <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
19 ; il s’agit là du processus le plus important, par <strong>la</strong> propre action. Pour sa part, Laín<br />
Entralgo 11 considère que <strong>la</strong> suggestion constitue en soi tout un système thérapeutique;<br />
elle a une valeur en tant que véhicule <strong>de</strong> <strong>la</strong> catharsis. Dans plusieurs cas l’amélioration<br />
du patient fut observée immédiatement après l’interrogatoire ou les techniques sémiologiques.<br />
De son côté, Pérgo<strong>la</strong> affirme que « l’acte médical renferme tout un contenu rituel qui<br />
mit sur le même p<strong>la</strong>n, <strong>de</strong>puis l’Antiquité, le mé<strong>de</strong>cin et les dieux, les saints, les rois légendaires<br />
capables <strong>de</strong> guérir avec une simple imposition <strong>de</strong> mains. » 14<br />
Dans un texte ultérieur, ce même auteur énonce que « <strong>la</strong> présence du mé<strong>de</strong>cin est mé<strong>de</strong>cine.<br />
Elle met en marche <strong>la</strong> pensée magique <strong>de</strong> l’autoguérison, aspect inhérent au<br />
rapport entre le mé<strong>de</strong>cin et le patient. La clef ? Dans son rapport d’entretien – suivant <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> P. Schnei<strong>de</strong>r –, le mé<strong>de</strong>cin généraliste se rapproche <strong>de</strong> son patient, il<br />
risque autant que lui, il se ‘‘fond’’ avec lui dans les manœuvres sémiologiques c<strong>la</strong>ssiques:<br />
observation, palpation, percussion, auscultation. Il établit un contact, et ce contact<br />
engendre <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> solidarité. Lorsqu’un patient distingue une déshumanisation<br />
dans le traitement, il <strong>la</strong> perçoit comme un manque <strong>de</strong> rapprochement sémiologique. » 3<br />
Cet auteur signale également qu’il ne faut pas avoir peur <strong>de</strong> comparer le mé<strong>de</strong>cin au<br />
sorcier et, en citant Sigerist, il ajoute que le guérisseur primitif est bien plus que l’ancêtre<br />
du mé<strong>de</strong>cin mo<strong>de</strong>rne: il est l’ancêtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> nos professions. « Il en sait plus sur<br />
le mon<strong>de</strong> transcendantal que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s gens, au point d’en avoir <strong>la</strong> maîtrise. » 20<br />
Robinson dit que le candidat pour <strong>de</strong>venir sorcier <strong>de</strong>vait possé<strong>de</strong>r une caractéristique<br />
peu commune: avoir une force extraordinaire; être sage ou difforme; souffrir d’attaques<br />
épileptiques; avoir une prédisposition pour entrer en transe; être ma<strong>la</strong>droit avec les<br />
armes; être ventriloque; avoir été l’objet <strong>de</strong>s rêves <strong>de</strong>s aînés ou sentir une attirance manifeste<br />
par <strong>la</strong> méditation et les promena<strong>de</strong>s solitaires dans les bois. Il arrivait parfois<br />
qu’un jeune ayant <strong>de</strong>s aptitu<strong>de</strong>s naturelles préfère <strong>la</strong> science à <strong>la</strong> chasse, et il choisissait<br />
alors <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir élève d’un guérisseur réputé. Les étu<strong>de</strong>s étaient longues, difficiles et<br />
coûteuses; il fal<strong>la</strong>it apprendre beaucoup <strong>de</strong> ruses, connaître plusieurs herbes, infinité <strong>de</strong><br />
rites et une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> base précise. Le guérisseur ne pouvait pas être comme les<br />
autres, il <strong>de</strong>vait être un homme à part. Ses vêtements, ses habitu<strong>de</strong>s et ses pensées <strong>de</strong>vaient<br />
être différents. Il ne pouvait pas partager <strong>la</strong> routine <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> ses semb<strong>la</strong>bles, il<br />
<strong>de</strong>vait toujours être un homme mystérieux. Au fur et à mesure que les cérémonies <strong>de</strong>venaient<br />
plus compliquées et se consacraient à <strong>la</strong> tradition, le sorcier <strong>de</strong>venait le prophète<br />
et le prêtre <strong>de</strong> son peuple 21 .<br />
55
AMALIA M. BORES, INÉS A. BORES, LIDIA E. VALLE<br />
■ Les Les mou<strong>la</strong>ges en cire. en cire. La photographie La photographie<br />
56<br />
La chaire <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vénériennes fut créée le 18 mars 1892. Le Dr Baldomero Sommer,<br />
formée à l’école <strong>de</strong> Vienne où il étudia avec Kaposi, en fut le premier professeur<br />
titu<strong>la</strong>ire ; il reçut plus tard l’influence <strong>de</strong> l’école française (Gaucher, Fournier, Darier) 6 . Il<br />
travail<strong>la</strong> à l’hôpital San Roque (actuellement hôpital Ramos Mejía).<br />
Sommer créa le musée <strong>de</strong>s mou<strong>la</strong>ges en cire, confectionnés par Walter S., représentant<br />
<strong>la</strong> morphologie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées afin <strong>de</strong> faciliter leur apprentissage. Lors <strong>de</strong><br />
l’inventaire <strong>de</strong> 1915, 116 pièces, dont celles représentant <strong>la</strong> sporotrichose, <strong>la</strong> b<strong>la</strong>stomycose,<br />
<strong>la</strong> piqûre d’araignée, <strong>la</strong> scléro<strong>de</strong>rmie, <strong>la</strong> syphilis, <strong>la</strong> pityriasis lichénoï<strong>de</strong> chronique,<br />
<strong>la</strong> lèpre, le lichen, le sarcome <strong>de</strong> Kaposi, le psoriasis et le granulome vénérien, furent<br />
dénombrées.<br />
Sommer utilisait <strong>de</strong>s illustrations d’at<strong>la</strong>s <strong>de</strong>rmatologiques 22, 23 à <strong>de</strong>s fins pédagogiques;<br />
il rassemb<strong>la</strong> également <strong>de</strong>s photographies qui révé<strong>la</strong>ient les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> ses<br />
patients 6 . Plus tard, le Pr. Pedro Baliña vint enrichir le matériel iconographique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
première chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 24 .<br />
La technique photographique permit <strong>la</strong> reconnaissance objective <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatoses.<br />
Dans les premiers temps, les photographies étaient colorées à <strong>la</strong> main. Cependant, <strong>la</strong><br />
photographie en noir et b<strong>la</strong>nc, qui fut tirée en sépia au début, constitua un grand recours<br />
dans le manuel d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologique.<br />
Squire, un chirurgien du Dispensaire libre <strong>de</strong> l’ouest <strong>de</strong> Londres, publia en 1865 un<br />
at<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie entièrement illustré <strong>de</strong> photographies. Parmi<br />
celles-ci, douze étaient colorées à <strong>la</strong> main: elles occupaient toute <strong>la</strong> page et comportaient<br />
un résumé succinct du cas clinique.<br />
Il est essentiel en <strong>de</strong>rmatologie d’i<strong>de</strong>ntifier les ma<strong>la</strong>dies à partir <strong>de</strong> l’aspect extérieur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone affectée, voilà pourquoi les illustrations <strong>de</strong>s manuels d’étu<strong>de</strong> nécessitent une<br />
gran<strong>de</strong> fidélité. Toutes les métho<strong>de</strong>s novatrices à une époque donnée furent utilisées<br />
pour l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong>puis le « <strong>de</strong>ssin à l’aquarelle jusqu’à <strong>la</strong> photographie<br />
en couleur, et <strong>de</strong>puis les premières xylographies jusqu’à <strong>la</strong> technique mo<strong>de</strong>rne<br />
d’impression offset couleur. » 25 ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Chil<strong>de</strong> G. ¿Qué sucedió en <strong>la</strong><br />
Historia? Buenos Aires:<br />
Crítica; 1965.<br />
2. Malinowski B. Magia, ciencia y<br />
religión. Barcelona: P<strong>la</strong>neta<br />
Agostini; 1993.<br />
3. Pérgo<strong>la</strong> E. Cultura,<br />
globalización y medicina.<br />
Buenos Aires: El Guión<br />
Ediciones; 2002.<br />
4. Kohn Loncarica A. Outomuro<br />
D. editores. Bioética hoy.<br />
Implicancias en educación,<br />
clínica, investigación y<br />
políticas <strong>de</strong> salud. Buenos<br />
Aires: Facultad <strong>de</strong> Medicina;<br />
2003.<br />
5. Lou<strong>de</strong>t O. Filosofía y medicina.<br />
Buenos Aires: Emecé; 1977.<br />
6. Grinspan D. Sinopsis histórica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología Argentina.<br />
Editado con motivo <strong>de</strong>l 10º<br />
Congreso Argentino <strong>de</strong><br />
Dermatología. Buenos Aires;<br />
1990.<br />
7. Marcial Ignacio Quiroga.<br />
« Curriculum Vítae<br />
Octobre 2004<br />
resumido ». La Prensa Médica<br />
Argentina. 1980; 67: 33-35.<br />
8. « Murió ayer en ésta el Dr.<br />
Marcial Quiroga ». La Nación.<br />
23 oct 1993; p.15.<br />
9. Oliveri N. Sosa Ludicissa M.<br />
Gamba C. Internet,<br />
telemática y salud. Buenos<br />
Aires: Ed. Panamericana;<br />
1997.<br />
10. Pérgo<strong>la</strong> F. Brujos, magos y<br />
hab<strong>la</strong>dores. Jano. Medicina y<br />
Humanida<strong>de</strong>s. Buenos Aires.<br />
May 1983; (27): 30-40.<br />
11. Laín Entralgo P. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>
Medicina. Barcelona: Salvat;<br />
1978.<br />
12. Pérgo<strong>la</strong> F. Okner O. Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina. Buenos Aires:<br />
Edimed; 1986.<br />
13. Depalma D. La Pediatría en<br />
<strong>la</strong>s culturas aborígenes<br />
argentinas. Buenos Aires:<br />
Fundasap; 2000.<br />
14. Pérgo<strong>la</strong> F. Autosugestión y<br />
char<strong>la</strong>tanismo. Médicos y<br />
Medicina en <strong>la</strong> Historia.<br />
Buenos Aires. 2003; II(7).<br />
15. Yankilevich A. Hospital y<br />
Comunidad. De <strong>la</strong> colonia a <strong>la</strong><br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia y <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
constitución a <strong>la</strong> república<br />
corporativa. Buenos Aires:<br />
edición <strong>de</strong>l autor; 1999.<br />
16. García Puga A. « Venturas y<br />
<strong>de</strong>sventuras <strong>de</strong> los médicos<br />
en <strong>la</strong> Historia ». Historia.<br />
Buenos Aires. 2002; (88):<br />
72-92.<br />
17. Baudouin C. Sugestión y<br />
autosugestión. Madrid:<br />
Francisco Beltrán; 1922.<br />
18. Boyer L.M., Boyer R.M. « Un<br />
aporte mixto antropológico y<br />
psicoanalítico al folklore ».<br />
Cua<strong>de</strong>rnos <strong>de</strong>l Instituto<br />
Nacional <strong>de</strong> Antropología.<br />
Buenos Aires. 1968-1971;<br />
(7): 68-71.<br />
19. Guerra F. Las medicinas<br />
marginales. Madrid: Alianza;<br />
1976.<br />
20. Pérgo<strong>la</strong> F. Brujos y cuasi<br />
médicos en los inicios<br />
argentinos. Buenos Aires:<br />
Edimed; 1986.<br />
21. Robinson V. La Medicina en <strong>la</strong><br />
Dermatologie : art et culture<br />
historia. Buenos Aires:<br />
Editorial Del Tri<strong>de</strong>nte; 1947.<br />
22. Greco N. « Baldomero<br />
Sommer y su obra ». Sem<br />
Med. Buenos Aires. 1942;<br />
(21): 3-55.<br />
23. Mazzini M.A. « Pasado y<br />
presente <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera<br />
cátedra <strong>de</strong> Dermatología. 75<br />
aniversario <strong>de</strong> su fundación<br />
1892–1967 ». Rev Argent<br />
Dermatol. 1967; (3-4);146-<br />
147.<br />
24. Mazzini M.A. « C<strong>la</strong>se<br />
inaugural <strong>de</strong>l Profesor Miguel<br />
Ángel Mazzini ». Rev Argent<br />
Dermatol. 1965; 49: 138.<br />
25. Ehring F. Ilustración científica<br />
en Dermatología, cinco siglos<br />
<strong>de</strong> historia. Barcelona: Edika<br />
Med; 1997.
HISTOIRE DE L’ASSOCIATION<br />
ARGENTINE DE<br />
DERMATOLOGIE<br />
PÉDIATRIQUE<br />
Un poco <strong>de</strong> nuestra historia<br />
JOSÉ ANTONIO MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA,<br />
GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ<br />
■ Quelques mots sur notre histoire<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique est une spécialité qui existe <strong>de</strong>puis longtemps en Argentine,<br />
étant donné que dans les principaux hôpitaux pédiatriques du pays, les services <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie répondirent toujours aux besoins <strong>de</strong>s jeunes patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. C’est dans ce milieu que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues argentins réputés comme Pacífico<br />
Díaz, Luis Trépat et Dagoberto Pierini développèrent leur spécialité; ils diffusèrent<br />
également leurs connaissances en Argentine et à l’étranger.<br />
Malgré leur remarquable activité, autant quantitative que qualitative, les <strong>de</strong>rmatologues<br />
dédiés aux enfants n’avaient aucun endroit commun où partager leurs expériences<br />
et échanger leurs problèmes; ils exprimaient leurs inquiétu<strong>de</strong>s et enseignaient<br />
au sein <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong>rmatologiques consacrés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie générale qui<br />
existaient à l’époque. Dans ce contexte, il n’y avait aucune possibilité d’organiser <strong>de</strong>s<br />
congrès ou d’autres activités académiques <strong>de</strong> portée nationale, encore moins internationale,<br />
avec un programme spécifique traitant <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées <strong>de</strong>s enfants.<br />
D’ailleurs, ce<strong>la</strong> ne différait pas beaucoup <strong>de</strong> ce qui se passait dans le mon<strong>de</strong>.<br />
Cependant, à partir <strong>de</strong>s années 70 un mouvement pour rassembler les <strong>de</strong>rmatologues<br />
pédiatres prit <strong>de</strong> l’ampleur, donnant naissance à <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique qui al<strong>la</strong>it encourager les premiers congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Suivant ce mouvement, l’idée germa <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r un groupe national en Argentine pour<br />
réunir les spécialistes dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> pédiatrie; le 29 décembre 1989 quelquesuns<br />
parmi eux, stimulés par le Dr Adrián Martín Pierini, décidèrent d’entreprendre les<br />
activités qui mèneraient plus tard à <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique (SADEPE).<br />
Dans les premiers temps, <strong>la</strong> nouvelle institution organisa <strong>de</strong>s réunions scientifiques<br />
<strong>de</strong>ux ou trois fois par an dans différents hôpitaux. Ensuite, elle travail<strong>la</strong> pour que l’Argentine<br />
<strong>de</strong>vienne le siège d’un congrès mondial <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Finalement, en 1994, après<br />
<strong>de</strong>s démarches difficiles, <strong>la</strong> SADEPE décrocha sa première responsabilité: organiser le<br />
7 e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, présidé par le Dr Adrián M. Pierini.<br />
59
JOSÉ A. MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA, GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ<br />
60<br />
La SADEPE offrit au congrès un encadrement institutionnel adéquat. Un autre objectif<br />
apparut alors, plus ambitieux: réunir au sein <strong>de</strong> cette société tous les mé<strong>de</strong>cins attirés<br />
par <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
La réussite <strong>de</strong> l’événement, qui accueillit plus <strong>de</strong> 900 assistants du mon<strong>de</strong> entier et eut un<br />
rayonnement national et international, aida à <strong>la</strong> consolidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société ; il était temps <strong>de</strong><br />
penser à son officialisation. Les préparatifs eurent lieu au cours d’une assemblée qui se tint<br />
à l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie Pr. Dr Juan P. Garrahan, où les autorités provisoires furent priées d’entamer<br />
les démarches pour <strong>la</strong> création d’une entité officielle indépendante <strong>de</strong> celles existantes.<br />
Les démarches auprès <strong>de</strong> l’organisme du gouvernement qui contrôle l’existence et le<br />
développement <strong>de</strong>s associations civiles eurent une fin heureuse le 14 août 1995, lorsqu’un<br />
groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues pédiatres se réunit en assemblée à l’hôpital Garrahan, marquant<br />
le début <strong>de</strong>s activités scientifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
Cette assemblée approuva le projet <strong>de</strong> statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle institution et désigna <strong>la</strong><br />
première commission directive, intégrée comme suit: Adrián Martín Pierini (prési<strong>de</strong>nt),<br />
Eva Golberger <strong>de</strong> Mora (vice-prési<strong>de</strong>nte), Silvia Anselmi (secrétaire générale), Rita<br />
García Díaz (secrétaire scientifique), Rebeca Rubinson (trésorière), Alicia Rositto et Zulema<br />
Piccone (membres titu<strong>la</strong>ires), Silvia Pueyo et Alejandro Campos Carlés (membres<br />
suppléants). Le contrôle fiscal fut confié à Amalia Campo et Jorge Savoia (contrôleurs<br />
titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes) et à Lidia Valle (contrôleur suppléante <strong>de</strong>s comptes).<br />
La reconnaissance juridique <strong>de</strong> l’institution fut obtenue par <strong>la</strong> résolution 00191 du 17<br />
novembre 1995.<br />
Les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SADEPE, réunis en assemblée le 27 avril 1996 à l’hôpital<br />
Pr. Dr Juan P. Garrahan, décidèrent <strong>de</strong> rénover <strong>la</strong> commission directive, les nouvelles<br />
autorités étant organisées comme suit: prési<strong>de</strong>nt, Jorge Savoia; vice-prési<strong>de</strong>nt, Silvia<br />
Pueyo; secrétaire général, Alberto Lavieri; secrétaire scientifique, María Rosa Cordisco;<br />
trésorière, Viviana Kis<strong>la</strong>nsky; membres titu<strong>la</strong>ires, José Antonio Mássimo et Adrián<br />
Martín Pierini; membres suppléants, Zulema Piccone et María Ranalletta. Quant à <strong>la</strong> fiscalisation,<br />
María <strong>de</strong>l Carmen Boente et Nélida Pizzi <strong>de</strong> Parra furent désignées contrôleurs<br />
titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes et Gisel<strong>la</strong> Delfino contrôleur suppléante.<br />
La nouvelle commission directive proposa comme tâche majeure l’organisation et <strong>la</strong><br />
réalisation d’un congrès argentin <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Deux ans après, <strong>la</strong> SADEPE organisait le 1 er Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
(du 13 au 16 août 1997) dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires. Ce congrès proposa un important<br />
programme scientifique et accueillit une assistance composée <strong>de</strong> nombreux<br />
pédiatres et <strong>de</strong>rmatologues. Il fut présidé par le Dr Jorge Savoia et compta parmi les invités<br />
spéciaux <strong>de</strong> prestige international John Harper, du Royaume-Uni; Moise Levy, Neil<br />
Prose et Gerald Goldberg, <strong>de</strong>s États-Unis; Ramón Ruiz Maldonado, du Mexique. Cet événement<br />
marqua le début d’un chemin fécond en activités scientifiques <strong>de</strong> très haut niveau.<br />
Le 16 août, à <strong>la</strong> fin du congrès, une assemblée extraordinaire désigna <strong>la</strong> nouvelle commission<br />
directive: Silvia Pueyo (prési<strong>de</strong>nte), Nélida Pizzi <strong>de</strong> Parra (vice-prési<strong>de</strong>nte), José Antonio<br />
Mássimo (secrétaire général), María Rosa Cordisco (secrétaire scientifique), Viviana Kis<strong>la</strong>nsky<br />
(trésorière), Zulema Piccone et Alberto Lavieri (membres titu<strong>la</strong>ires), María Amelia García et<br />
María <strong>de</strong>l Carmen Boente (membres suppléantes), María Teresa González et Carmen Margulis<br />
(contrôleurs titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes) et María Elsa Giovo (contrôleur suppléante <strong>de</strong>s comptes).<br />
Le renouvellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission directive se vit accompagné <strong>de</strong> nouveaux projets tels<br />
que <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une activité scientifique annuelle plus régulière dans les différents<br />
services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, l’é<strong>la</strong>rgissement du registre <strong>de</strong>s associés et l’achat d’un<br />
siège propre. Trois réunions scientifiques eurent alors lieu en 1998 dans les hôpitaux Juan<br />
P. Garrahan, Pedro <strong>de</strong> Elizal<strong>de</strong> (Buenos Aires) et Sor María Ludovica (La P<strong>la</strong>ta).<br />
Par ailleurs, <strong>la</strong> souscription <strong>de</strong> nouveaux associés fut importante et immédiate, entraînant<br />
le changement <strong>de</strong> nom <strong>de</strong> l’institution qui, en pleine croissance, <strong>de</strong>vint l’Association<br />
argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique (ASADEPE), association civile.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
Finalement, l’accord conclu en juin 1998 entre l’ASADEPE et Procter & Gamble (firme<br />
productrice <strong>de</strong> couches) aura permis plus tard à l’institution d’acheter <strong>la</strong> propriété qui<br />
<strong>de</strong>viendra son siège social.<br />
En avril <strong>de</strong> cette même année, le Dr José Antonio Mássimo, toujours en quête du<br />
développement <strong>de</strong> l’institution, créa <strong>la</strong> revue Dermatología Pediátrica Argentina (DPA),<br />
organe officiel <strong>de</strong> l’ASADEPE. Cette publication trimestrielle éditée à 8000 exemp<strong>la</strong>ires<br />
fut <strong>la</strong> première <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité en <strong>la</strong>ngue espagnole.<br />
Par <strong>la</strong> suite, l’institution soutint et donna son aval pour créer le diplôme <strong>de</strong> spécialiste<br />
en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires, à<br />
l’initiative <strong>de</strong>s Drs José Antonio Mássimo et Silvia Teresita Pueyo qui en <strong>de</strong>viendront<br />
respectivement le directeur et <strong>la</strong> sous-directrice. Cette discipline, nouvelle et prépondérante,<br />
se vit donc consolidée dans un domaine très vaste en Argentine, où l’importante<br />
popu<strong>la</strong>tion enfantine nécessite beaucoup <strong>de</strong> soins pour les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />
Trois réunions scientifiques furent organisées en 1999: <strong>la</strong> première, le 27 mars, à<br />
Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta (Hospital Privado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad) ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième, le 7 août, dans le Círculo<br />
Militar <strong>de</strong> Olivos ; <strong>la</strong> troisième, le 20 novembre, à l’hôpital Houssay <strong>de</strong> Vicente<br />
López, dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Entre le 23 et le 25 août <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année se dérou<strong>la</strong> le 2 e Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique, présidé par Silvia Pueyo; les invités étrangers Joseph Morelli et<br />
Amy Nopper (États-Unis) enrichirent <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s prestigieux invités nationaux. L’assistance<br />
dépassa <strong>la</strong>rgement les 600 personnes.<br />
Un autre pas important pour l’institution fut fait le 18 septembre 1999 avec l’achat<br />
d’une maison située au numéro 5770 <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue Honduras, dans le quartier <strong>de</strong> Palermo,<br />
où fut installé le siège social <strong>de</strong> l’ASADEPE (figures 1 et 2). Destinés aux associés, plusieurs<br />
cours sur <strong>la</strong> spécialité furent dispensés <strong>de</strong>puis son inauguration officielle (figures<br />
3 et 4).<br />
Le 25 septembre 1999 eut lieu le renouvellement <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission<br />
directive pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1999-2001, intégrée désormais par Silvia T. Pueyo (prési<strong>de</strong>nte),<br />
José Antonio Mássimo (vice-prési<strong>de</strong>nt), María Amelia García (secrétaire générale), Pedro<br />
García Zubil<strong>la</strong>ga (secrétaire scientifique), Antonio Pignataro (trésorier), Ricardo Kohan<br />
et Pedro Rovere (membres titu<strong>la</strong>ires), Anita Rossi et Araceli Rodríguez (membres suppléantes);<br />
et pour <strong>la</strong> fiscalisation: Guillermo Ilho et Carlos Lorenzano (contrôleurs titu<strong>la</strong>ires<br />
<strong>de</strong>s comptes) et Jorge Díaz Saubi<strong>de</strong>t (contrôleur suppléant <strong>de</strong>s comptes) (figure 5).<br />
Cette nouvelle commission donna une forte impulsion à l’activité académique, mettant<br />
en p<strong>la</strong>ce un programme scientifique annuel régulier: trois réunions scientifiques et<br />
un événement <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong> ampleur, successivement consacré à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie du<br />
nouveau-né, à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique et à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’adolescent.<br />
Les réunions scientifiques annuelles quittèrent l’enceinte <strong>de</strong>s hôpitaux pour être<br />
organisées dans <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong> convention ayant une plus gran<strong>de</strong> capacité, accueil<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins désireux d’échanger leurs expériences. En 2000, <strong>la</strong> première réunion eut lieu<br />
au Pa<strong>la</strong>is rouge (Buenos Aires, 29 avril), <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième, le 24 juin, au même endroit et <strong>la</strong><br />
troisième, le 9 décembre, à La Falda, dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Córdoba.<br />
La sous-commission <strong>de</strong> diffusion dirigée par le Dr Mirta Vázquez col<strong>la</strong>bora à <strong>la</strong> mise<br />
en p<strong>la</strong>ce d’un programme <strong>de</strong>stiné à faire connaître l’institution dans les hôpitaux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> Buenos Aires et <strong>de</strong> ses alentours. Entre avril et novembre 2000, <strong>de</strong>s cours et <strong>de</strong>s<br />
ateliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité furent organisés, rassemb<strong>la</strong>nt plus <strong>de</strong> 1300 mé<strong>de</strong>cins au total.<br />
En août 2000 (25 et 26) eut lieu avec succès le 1 er Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
du nouveau-né, présidé par Silvia T. Pueyo et José A. Mássimo, en présence du Dr<br />
Lawrence Schachner <strong>de</strong>s États-Unis (figure 6), <strong>de</strong> spécialistes réputés <strong>de</strong> notre entourage<br />
et <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 500 pédiatres, <strong>de</strong>rmatologues et néonatologues.<br />
En 2001 fut mis en route un programme permettant à l’ASADEPE <strong>de</strong> se rapprocher<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté, par le biais <strong>de</strong> conventions avec <strong>de</strong>s entreprises commerciales lui<br />
61
Figures 1 et 2.<br />
Siège social <strong>de</strong><br />
l’ASADEPE.<br />
Vue intérieure<br />
(1) et vue<br />
extérieure (2)<br />
Figures 3 et 4.<br />
Inauguration officielle<br />
du siège social<br />
JOSÉ A. MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA, GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ<br />
62<br />
ayant <strong>de</strong>mandé son aval sur <strong>de</strong>s produits pour enfants. Ces conventions permirent d’organiser<br />
<strong>de</strong>s réunions visant à diffuser les connaissances sur le soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, aussi bien<br />
auprès <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins qu’auprès du public en général.<br />
La première réunion scientifique <strong>de</strong> l’année 2001 eut lieu le 31 mars dans le musée<br />
Reconquista (ville <strong>de</strong> Tigre, province <strong>de</strong> Buenos Aires); le 23 juin se tint <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
réunion dans les salles du Pa<strong>la</strong>is rouge <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires.<br />
Entre les mois <strong>de</strong> mars et juillet 2001 – suivant le programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-commission<br />
<strong>de</strong> diffusion – le <strong>de</strong>uxième cycle d’ateliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique eut lieu dans différents<br />
hôpitaux, qui accueillit plusieurs pédiatres et <strong>de</strong>rmatologues.<br />
Le 1 er Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’adolescent eut lieu les 7 et 8 septembre,<br />
présidé par le Dr José A. Mássimo et en présence <strong>de</strong>s Drs Anne Lucky et E<strong>la</strong>ine Siegfried<br />
(États-Unis) comme invitées internationales. Les inscriptions dépassèrent les 600 personnes,<br />
dont plusieurs spécialistes argentins.<br />
Le 25 septembre, une fois le congrès fini, <strong>la</strong> commission directive fut renouvelée pour<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2001-2003 et intégrée comme suit: prési<strong>de</strong>nt, José A. Mássimo ; vice-prési<strong>de</strong>nte,<br />
María Teresa Zaba<strong>la</strong> ; secrétaire général, Pedro García Zubil<strong>la</strong>ga ; secrétaire scientifique,<br />
Pedro Rovere ; trésorier, Carlos Lorenzano ; membres titu<strong>la</strong>ires, Gracie<strong>la</strong> Manzur<br />
et Grete Bloch; membres suppléants, Nancy Leston et Jorge Verges ; Anita Rossi et Ana<br />
María Lorenz comme contrôleurs titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes et María A. García comme<br />
contrôleur suppléante <strong>de</strong>s comptes.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
Cette nouvelle commission décida d’équiper le<br />
siège social d’outils et d’éléments pour que l’activité<br />
scientifique et sociale puisse se dérouler <strong>de</strong> manière<br />
optimale. Une bibliothèque, équipée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ordinateurs<br />
pour rédiger les travaux, fut inaugurée et une<br />
secrétaire permanente fut sélectionnée.<br />
L’activité croissante <strong>de</strong> l’ASADEPE entraîna l’augmentation<br />
<strong>de</strong>s associés, pédiatres et <strong>de</strong>rmatologues,<br />
tous intéressés par ce nouveau mouvement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique. Il fut alors décidé que sur les<br />
trois réunions scientifiques annuelles, <strong>de</strong>ux seraient<br />
organisées à Buenos Aires et <strong>la</strong> troisième dans<br />
d’autres régions <strong>de</strong> l’Argentine, afin <strong>de</strong> diffuser <strong>la</strong> spécialité<br />
dans <strong>de</strong>s endroits plus éloignés.<br />
Au cours du mois d’octobre, l’ASADEPE participa au 9 e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique à Cancun en mobilisant 12 spécialistes.<br />
L’activité scientifique <strong>de</strong> l’année a été close le 1 er décembre dans le grand amphithéâtre<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Privado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Comunidad, à Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta, avec le <strong>la</strong>ncement d’une<br />
campagne <strong>de</strong> photo-éducation sur les p<strong>la</strong>ges.<br />
En 2002 <strong>la</strong> sous-commission <strong>de</strong> diffusion et événements, toujours dirigée par Mirta<br />
Vázquez, organisa un réseau pour faire connaître les activités <strong>de</strong> l’institution et <strong>la</strong> revue<br />
DPA dans les zones les plus éloignées du pays.<br />
L’activité scientifique <strong>de</strong> l’année 2002 débuta au mois d’avril par <strong>la</strong> première <strong>de</strong>s<br />
réunions annuelles (Pa<strong>la</strong>is rouge, Buenos Aires). Un programme visant à développer <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique dans les provinces argentines fut mis en route au mois <strong>de</strong> juin:<br />
les 1 res Journées <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique du Nord-Ouest (15-16 juin), réalisées à<br />
Tucumán, accueillirent les spécialistes argentins les plus réputés ainsi qu’un vaste auditoire.<br />
Les salles du Pa<strong>la</strong>is rouge hébergèrent avec succès le 3 e Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique (du 29 au 31 août 2002), présidé par le Dr J.A. Mássimo<br />
et en présence d’invités étrangers – le Dr Ernesto Bonifazzi (Italie)<br />
et Amy Nopper (États-Unis) – et d’une nombreuse assistance.<br />
À cette époque-là fut construit le <strong>de</strong>uxième étage du siège social: les<br />
invités étrangers du congrès et d’autres autorités académiques locales<br />
furent présents pour son inauguration le 30 août.<br />
La <strong>de</strong>rnière réunion scientifique <strong>de</strong> l’année se réalisa à Luján (province<br />
<strong>de</strong> Buenos Aires), avec un programme scientifique substantiel et <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> nombreux mé<strong>de</strong>cins.<br />
L’activité <strong>de</strong> l’année 2003 débuta le 12 avril, avec <strong>la</strong> première réunion<br />
annuelle (Pa<strong>la</strong>is rouge, Buenos Aires). Le 28 juin, afin <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cer <strong>la</strong><br />
spécialité hors <strong>de</strong> l’enceinte <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
réunion fut organisée à l’hôpital pour enfants <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta, à <strong>la</strong>quelle<br />
<strong>de</strong> nombreux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale, <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta et <strong>de</strong> ses environs,<br />
assistèrent.<br />
Le 2 e Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du nouveau-né fut organisé du 11 au 13 septembre<br />
2003, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr J.A. Mássimo, avec <strong>de</strong>s invités étrangers aussi<br />
réputés que Carlo Gelmetti (Italie), Joseph Morelli (États-Unis) et Marcelo Ruvertoni<br />
(Uruguay) et une assistance dépassant les 800 personnes (figure 7).<br />
L’assemblée <strong>de</strong>s associés décida à <strong>la</strong> fin du congrès <strong>de</strong> ratifier <strong>la</strong> commission directive<br />
pour une nouvelle pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2 ans: J.A. Mássimo (prési<strong>de</strong>nt), María Teresa Zaba<strong>la</strong><br />
(vice-prési<strong>de</strong>nte), Pedro García Zubil<strong>la</strong>ga (secrétaire général), Gracie<strong>la</strong> Manzur (secrétaire<br />
scientifique), Carlos Lorenzano (trésorier), Grete Bloch et Nancy Leston (membres<br />
63<br />
Figure 5.<br />
Commission directive<br />
(pério<strong>de</strong> 1999-2001):<br />
Silvia Teresita Pueyo,<br />
José Antonio<br />
Mássimo, María<br />
Amelia García, Pedro<br />
García Zubil<strong>la</strong>ga,<br />
Antonio Pignataro,<br />
Ricardo Kohan, Pedro<br />
Rovere, Anita Rossi,<br />
Araceli Rodríguez,<br />
Guillermo Ilho, Carlos<br />
Lorenzano et Jorge<br />
Díaz Saubi<strong>de</strong>t<br />
Figure 6.<br />
1 er Congrès argentin<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du<br />
nouveau-né (2000):<br />
José Antonio Mássimo<br />
et Lawrence<br />
Schachner
Figure 7.<br />
2 e Congrès argentin<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du<br />
nouveau-né (2003)<br />
JOSÉ A. MÁSSIMO, PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA, GRACIELA MANZUR, MIRTA VÁZQUEZ<br />
64<br />
titu<strong>la</strong>ires), Susana Grees et Silvina Bruey<br />
(membres suppléantes), et pour <strong>la</strong> fiscalisation<br />
Ricardo Kohan et Guillermo Ilho (contrôleurs<br />
titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes) et Pedro Rovere (contrôleur<br />
suppléant <strong>de</strong>s comptes).<br />
Les 1 res Journées <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatriques<br />
du Centre argentin conclurent l’activité scientifique<br />
<strong>de</strong> 2003 les 6 et 7 décembre dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong><br />
La Falda (province <strong>de</strong> Córdoba). Parmi les conférenciers<br />
invités, les Drs Ricardo Negroni et Héctor<br />
Lanfranchi <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires,<br />
Eudoro <strong>de</strong> los Ríos <strong>de</strong> San Miguel <strong>de</strong> Tucumán, et<br />
Miguel Tregnaghi <strong>de</strong> Córdoba.<br />
La première réunion scientifique <strong>de</strong> l’année<br />
2004 fut organisée une nouvelle fois dans le<br />
musée Reconquista <strong>de</strong> Tigre, avec un programme<br />
attrayant que les nombreux assistants apprécièrent beaucoup.<br />
Dès le début 2004, le comité scientifique <strong>de</strong> l’ASADEPE, dirigé par le Dr Gracie<strong>la</strong> Manzur,<br />
stimu<strong>la</strong> l’enseignement au siège social par <strong>de</strong>s cours (d’esthétique, d’immunologie, <strong>de</strong><br />
thérapeutique, <strong>de</strong> génétique, sur les ma<strong>la</strong>dies exanthématiques), l’instauration d’un cercle<br />
mensuel d’enseignement, qui accueille spécialistes et mé<strong>de</strong>cins en formation <strong>de</strong> l’internat,<br />
et un diplôme <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Au mois <strong>de</strong> mai, l’ASADEPE conclut une convention scientifique avec l’Association<br />
argentine d’allergie et d’immunologie clinique afin <strong>de</strong> travailler ensemble sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies allergiques.<br />
Ce même mois (20, 21 et 22 mai), l’ASADEPE décida d’entrer dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
télémé<strong>de</strong>cine, en soutenant une initiative du Dr J.A. Mássimo et <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> pédiatrie<br />
Ricardo Gutiérrez et en offrant le cadre institutionnel au premier COVIDEP (Congrès virtuel<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique), organisé par les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
<strong>de</strong>s hôpitaux Ricardo Gutiérrez et Juan P. Garrahan, respectivement dirigés par les<br />
Drs J.A. Mássimo et Rita García Díaz. Cette initiative, qui compta également sur <strong>la</strong><br />
remarquable col<strong>la</strong>boration du Dr Moise Levy <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Houston, au Texas, aura<br />
permis aux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> partager leurs connaissances et leurs expériences avec les<br />
patients d’un bout à l’autre du pays.<br />
En juillet 2004 l’ASADEPE envoya une délégation <strong>de</strong> cinq membres au 10 e Congrès<br />
mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique (Rome), qui participa activement au programme<br />
scientifique.<br />
Le 2 e Congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’adolescent, présidé par le Dr J.A. Mássimo,<br />
fut organisé du 26 au 28 août, avec <strong>la</strong> participation d’invités étrangers tels que Antonio<br />
Torrelo (Espagne), Roberto Arenas (Mexique), Jairo Victoria (Colombie), María<br />
Isabel Herane (Chili) et Griselda <strong>de</strong> Anda (Uruguay) (figure 8).<br />
La troisième réunion scientifique <strong>de</strong> l’année coïncida avec les 1 res Journées <strong>de</strong> photoéducation,<br />
réalisées les 11 et 12 décembre à Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta et ayant reçu le soutien du<br />
groupe <strong>de</strong> photo-éducation <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Bahía B<strong>la</strong>nca, dirigé par le Dr María Isabel Caferri.<br />
Grâce au système <strong>de</strong> visioconférence, plusieurs spécialistes <strong>de</strong>s provinces argentines<br />
purent y participer simultanément.<br />
Une assemblée extraordinaire eut lieu afin d’aboutir à une vieille aspiration <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission<br />
directive: é<strong>la</strong>rgir le nombre <strong>de</strong> ses membres en incorporant d’autres représentants.<br />
Sept nouveaux membres furent ainsi choisis pour permettre aux provinces argentines ayant<br />
un nombre important d’habitants et d’associés d’être représentées. Cet é<strong>la</strong>rgissement<br />
contribua à donner à <strong>la</strong> commission directive un caractère national ; on compte parmi ses<br />
nouveaux membres: J.A. Mássimo (prési<strong>de</strong>nt) ; María Teresa Zaba<strong>la</strong>, <strong>de</strong> Córdoba (première
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
vice-prési<strong>de</strong>nte) ; Rita García Díaz (secon<strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nte) ; Pedro García Zubil<strong>la</strong>ga<br />
(secrétaire général) ; Gracie<strong>la</strong> Manzur (secrétaire scientifique) ; Carlos Hugo Escu<strong>de</strong>ro (secrétaire<br />
légal et technique) ; Carlos Lorenzano (trésorier) ; Jorge Laffargue (trésorier adjoint)<br />
; Grete Bloch, Nancy Leston et Alicia Carrillo (Jujuy) ; Antonio Castillo (Salta), Cecilia<br />
Farrero (San Luis) (membres titu<strong>la</strong>ires) ; Susana Grees et María Elsa Giovo (Córdoba), Luis<br />
Pe<strong>de</strong>monte (La P<strong>la</strong>ta) (membres suppléants) ; Ricardo Kohan et Gabriel Magariños (contrôleurs<br />
titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s comptes) ; Pedro Rovere (contrôleur suppléant <strong>de</strong>s comptes).<br />
Ce compte rendu succinct témoigne <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière dont <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique s’imposa<br />
progressivement dans le mon<strong>de</strong> entier, constituant aujourd’hui une spécialité <strong>de</strong> poids.<br />
Les <strong>de</strong>rmatologues pédiatres argentins ressentirent le besoin <strong>de</strong> bénéficier d’une<br />
association qui les rassemblerait et leur permettrait <strong>de</strong> développer une activité scientifique<br />
et sociale en accord avec leurs nécessités. C’est dans ce but que naquit l’ASADEPE.<br />
Ses principaux objectifs visèrent et visent toujours à intensifier le travail scientifique<br />
et pédagogique et à stimuler les rapports entre les <strong>de</strong>rmatologues, les <strong>de</strong>rmatologues<br />
pédiatres, les immunologues, les allergologues et les pédiatres, en vue d’améliorer et<br />
d’augmenter <strong>la</strong> qualité du soin <strong>de</strong> nos patients.<br />
Pour aboutir à ces objectifs et concrétiser plusieurs projets, l’ASADEPE prit toujours <strong>de</strong> nouvelles<br />
responsabilités et accepta <strong>de</strong> nouveaux défis, en offrant à ses associés <strong>de</strong>s formations, <strong>de</strong>s<br />
cours, un support bibliographique et l’accès à un réseau informatique sur <strong>la</strong> spécialité.<br />
Jusqu’ici, une part <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> notre institution est aussi une part <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong><br />
tous ceux qui ont contribué à son développement.<br />
Tout au long <strong>de</strong> ses dix ans <strong>de</strong> vie, l’ASADEPE sut créer, grâce au travail <strong>de</strong> tous ceux<br />
qui ont cru au chemin qu’elle traçait, son propre espace bien mérité. L’ASADEPE continuera<br />
<strong>de</strong> chercher ar<strong>de</strong>mment l’expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique afin <strong>de</strong> pérenniser son<br />
histoire qui, encore aujourd’hui, se confond avec une partie <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> notre pays.<br />
Nos dix ans d’histoire sont le meilleur aval <strong>de</strong> nos efforts, notre éthique professionnelle,<br />
notre passion pour notre travail et notre engagement envers <strong>la</strong> société étant nos<br />
valeurs essentielles. ■<br />
Septembre 2005<br />
Figure 8.<br />
2 e Congrès argentin<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’adolescent (2004)
COMPTE RENDU<br />
HISTORIQUE DE LA<br />
SOCIÉTÉ BOLIVIENNE<br />
DE DERMATOLOGIE<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie comporte trois étapes : avant sa<br />
fondation, <strong>de</strong>puis sa fondation jusqu’à fin 1985, <strong>de</strong>puis 1986 jusqu’à nos jours.<br />
Avant sa fondation<br />
FERNANDO CÁRDENAS UZQUIANO, JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA<br />
■ Avant sa fondation<br />
Pour évoquer les origines <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie bolivienne, il faut chercher<br />
<strong>de</strong>s antécé<strong>de</strong>nts dans l’histoire même <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine en Bolivie. C’est pour cette raison<br />
que nous avons fait appel au conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Ce compte rendu tient compte <strong>de</strong> certains traits inévitablement incomplets et comporte<br />
vraisemb<strong>la</strong>blement <strong>de</strong>s omissions involontaires.<br />
Rien ne se crée spontanément mais il est vrai aussi que les progrès font parfois <strong>de</strong>s<br />
« bonds » : c’est ce qui se passa avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans notre pays.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie fut traditionnellement enseignée au sein <strong>de</strong>s chaires spécialisées <strong>de</strong>s<br />
trois facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du pays : celles <strong>de</strong> Sucre, La Paz et Cochabamba. Il existe <strong>de</strong>puis<br />
longtemps <strong>de</strong>s services d’hospitalisation <strong>de</strong>stinés aux ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau ; dans <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> La Paz, 40 lits réservés à cet usage (30 pour les hommes et 10 pour les femmes)<br />
étaient disponibles. Chacun <strong>de</strong> ces services accueil<strong>la</strong>it <strong>de</strong>s internes (rémunérés), qui y<br />
travail<strong>la</strong>ient lorsqu’ils n’étaient pas admis dans les autres salles.<br />
Dernièrement, ces services furent dirigés par les Drs Jorge Suárez et Enrique Vergara.<br />
Le Dr Suárez eut le mérite <strong>de</strong> rendre possible <strong>la</strong> publication d’une Revista Médica<br />
pendant plus <strong>de</strong> 10 ans, qui contenait <strong>de</strong>s articles liés à <strong>la</strong> mycologie, à <strong>la</strong> léprologie et à<br />
d’autres sujets.<br />
Avant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, plusieurs mé<strong>de</strong>cins exercèrent<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, tels Jorge Suárez, Alexandrowich Ferdin Humboldt, Enrique Vergara,<br />
Apolinar Caro, Luis Nava, L. Piéro<strong>la</strong>, Hartmann, ou encore L. López Ballesteros,<br />
Norah Siles, Jaime Brian, Fernando Cár<strong>de</strong>nas, Omar Vil<strong>la</strong>gomez et peu après le Dr Fabio<br />
Prado.<br />
Les activités scientifiques débutèrent individuellement, à travers <strong>la</strong> participation<br />
aux événements nationaux d’autres sociétés (<strong>de</strong> pédiatrie, <strong>de</strong> chirurgie, les cercles <strong>de</strong><br />
67
FERNANDO CÁRDENAS, JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA<br />
mé<strong>de</strong>cine, entre autres). Le Dr P. Sangüeza joua un rôle capital à l’époque : il innova et<br />
enrichit les conférences <strong>de</strong> ses connaissances en histopathologie cutanée, complétant <strong>la</strong><br />
présentation <strong>de</strong>s cas cliniques grâce à d’excellentes diapositives <strong>de</strong> photomicrographies.<br />
Les écoles <strong>de</strong>rmatologiques argentines, brésiliennes et colombiennes jouèrent un rôle<br />
important dans <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s spécialistes. La première favorisa notamment les liens<br />
affectifs à l’étranger et posa les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> notre société. Trois figures sont à souligner<br />
: les Prs Julio Martín Borda et Jorge Abu<strong>la</strong>fia et le Dr Jaime Rubin, qui contribuèrent<br />
à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> nouveaux spécialistes. Leur soutien est encore manifeste <strong>de</strong> nos<br />
jours ; il faut aussi mentionner l’appui du Pr. Juan Carlos Gatti.<br />
Le besoin pressant <strong>de</strong> créer une organisation scientifique <strong>de</strong>rmatologique visant à<br />
rassembler un nombre croissant <strong>de</strong> spécialistes se fit sentir : c’est ainsi que naquit l’idée<br />
<strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
■ Depuis sa fondation sa fondation jusqu’à fin 1985jusqu’à<br />
fin 1985<br />
68<br />
La Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut fondée le 20 avril 1968 au matin, au cours<br />
d’une réunion qui rassemb<strong>la</strong> les Drs Jorge Suárez, Enrique Vergara, Fernando Cár<strong>de</strong>nas,<br />
Ferdin Humboldt, Pastor Sangüeza, Apolinar Caro et Fabio Prado Barrientos ; celleci<br />
eut lieu au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (section hommes) <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> La<br />
Paz. Les Drs Omar Vil<strong>la</strong>gomez, Luis F. Piéro<strong>la</strong>, Luis Nava, Eduardo Saracho, Jaime Brianson<br />
et Norah Siles furent considérés comme les cofondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite société.<br />
La commission directive fut intégrée comme suit : prési<strong>de</strong>nt : Dr Jorge Suárez ; viceprési<strong>de</strong>nt<br />
: Dr Enrique Vergara ; secrétaire : Dr Fernando Cár<strong>de</strong>nas.<br />
Une semaine plus tard, le 27 avril, une réunion eut lieu afin d’entreprendre <strong>la</strong> rédaction<br />
du règlement <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle société ; celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut adopté en attendant. On suggéra <strong>de</strong> former une commission qui serait chargée<br />
d’é<strong>la</strong>borer un projet <strong>de</strong> statut.<br />
Pendant environ trois ans <strong>la</strong> société ne fonctionna pas <strong>de</strong> manière active. Cependant,<br />
en 1969, une nouvelle réunion qui comptait <strong>la</strong> présence du Dr Norah Siles servit d’encadrement<br />
à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> léprologie, dont <strong>la</strong> première commission<br />
directive fut constituée comme suit : prési<strong>de</strong>nt : Dr Norah Siles ; vice-prési<strong>de</strong>nt :<br />
Dr Fernando Cár<strong>de</strong>nas ; secrétaire: Dr Omar Vil<strong>la</strong>gómez ; conseiller : Dr Jorge Suárez.<br />
Même si cette Société <strong>de</strong> léprologie n’organisa pas <strong>de</strong> réunions officielles, ses<br />
membres jouèrent un rôle éminent dans <strong>la</strong> léprologie bolivienne, initialement pilotée par<br />
le Dr Suárez. La tâche <strong>de</strong>s Drs N. Siles et R. Amonzabel fut notable : ils participèrent activement<br />
à maints congrès, présentèrent <strong>de</strong> nombreux travaux et dirigèrent les léproseries<br />
et les Instituts <strong>de</strong>s Noirs à Jorochito et à Candúa.<br />
Vers 1971, <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut réorganisée et <strong>la</strong> commission<br />
directive rénovée : le Dr Fernando Cár<strong>de</strong>nas <strong>de</strong>vint prési<strong>de</strong>nt et le Dr Ferdin Humboldt<br />
fut élu vice-prési<strong>de</strong>nt. Quelques jours plus tard, ces autorités reçurent une lettre du<br />
Dr J. Brianson communiquant son intention <strong>de</strong> créer une Association bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
; apprenant <strong>la</strong> réorganisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, il leur offrit son soutien. Un projet<br />
surgit alors et <strong>de</strong>viendrait plus tard une réalité : organiser un congrès et <strong>de</strong>s rencontres<br />
<strong>de</strong>rmatologiques.<br />
En 1973, <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie projeta <strong>la</strong> réalisation d’un congrès<br />
international ; étant donné les difficultés économiques liées à sa réalisation, <strong>la</strong> société dut<br />
s’associer à d’autres organisations scientifiques, telles que <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> biochimie<br />
clinique et l’Association d’étu<strong>de</strong> et <strong>de</strong> recherche odontologique ; le Collège ibéro-<strong>la</strong>tinoaméricain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) apporta à cette occasion son soutien financier.<br />
Le congrès eut lieu du 13 au 17 juillet 1974, à <strong>la</strong> Universidad Mayor <strong>de</strong> San Andrés<br />
<strong>de</strong> La Paz, les autorités universitaires et d’autres institutions participèrent à l’organisation
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> cet événement. L’événement, appelé 1 er Symposium international <strong>de</strong> pathologie médicale,<br />
odontologique et <strong>de</strong> biochimie clinique, fut présidé par F. Cár<strong>de</strong>nas et C. Borja, en<br />
étroite col<strong>la</strong>boration avec le Dr Juan Guerra Mercado. Parmi les gran<strong>de</strong>s personnalités invitées<br />
se trouvaient Julio Martín Borda, Jorge Abu<strong>la</strong>fia, Sergio Stringa, Luis Belli, Gilberto<br />
González Resigno, Juan Carlos Flichman, Leopoldo Eguren, Ramón Baros et Jaime Rubin.<br />
Le Pr. David Grinspan (qui nous rendit visite ultérieurement) et le Dr Pablo Viglioglia n’assistèrent<br />
pas au congrès pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> force majeure.<br />
Le moment fut propice à <strong>la</strong> création du symbole ou logotype <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (ce logo, qui existe toujours, fut imprimé pour <strong>la</strong> première fois sur un<br />
programme luxueux). Les Prs Luis F. Piéro<strong>la</strong>, Luis Nava et Jorge Suárez furent nommés<br />
membres d’honneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Les séances eurent lieu dans quatre salles et un<br />
espace fut réservé à l’exposition <strong>de</strong> médicaments et <strong>de</strong> cosmétiques. Il y eut aussi <strong>de</strong>s<br />
conférences sur <strong>la</strong> cosmétologie scientifique.<br />
Une fois le symposium fini, il fut convenu d’organiser <strong>la</strong> 1 re Rencontre nationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à Cochabamba (1975). Presque tous les <strong>de</strong>rmatologues du pays y présentèrent<br />
leurs travaux. Cette réunion, présidée par F. Cár<strong>de</strong>nas et J. Brianson, accueillit le Dr Philippe<br />
Desjeux (in<strong>la</strong>ssable col<strong>la</strong>borateur, encore <strong>de</strong> nos jours) qui fut nommé membre <strong>de</strong><br />
l’institution. Le Dr F. Echeverria conduisit <strong>la</strong> délégation <strong>de</strong> Sucre. Le fait le plus notable<br />
fut <strong>la</strong> décision <strong>de</strong> rédiger les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> société; cette tâche fut unanimement confiée à<br />
<strong>la</strong> délégation <strong>de</strong> Cochabamba, p<strong>la</strong>cée sous <strong>la</strong> direction du Dr J. Brianson et en étroite col<strong>la</strong>boration<br />
avec les Drs Q. Amaya, N. Trigo et H. Maldonado.<br />
La 2 e Rencontre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, organisée l’année suivante (1976) à Trinidad, eut<br />
pour siège l’université Beniana et bénéficia <strong>de</strong> <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong> tous les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville et du soutien du Dr J. Hurtado, à qui nous exprimons toute notre reconnaissance.<br />
La délégation <strong>de</strong> Cochabamba remit le projet <strong>de</strong> statut au cours <strong>de</strong> cette rencontre.<br />
Désormais <strong>de</strong>s réunions anatomo-cliniques furent organisées <strong>de</strong> façon plus ou moins<br />
régulière au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques. Un bureau puis une<br />
petite salle <strong>de</strong> cours furent aménagés à cet égard. Ils seront par <strong>la</strong> suite adaptés à <strong>la</strong> projection<br />
<strong>de</strong> diapositives grâce aux contributions <strong>de</strong>s associés.<br />
La 3 e Rencontre nationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu à Tarija (1978), avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
du Dr Luis Michel et <strong>de</strong> tous les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. Les affiches, les écriteaux et les<br />
c<strong>la</strong>sseurs imprimés pour l’occasion annonçaient <strong>la</strong> « 3 e Rencontre », mais l’ampleur <strong>de</strong><br />
l’événement fut telle qu’il fut renommé 1 er Congrès bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie p<strong>la</strong>cé sous<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s Drs F. Cár<strong>de</strong>nas et L. Michel.<br />
Étant donné le changement <strong>de</strong> caractère <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion et eu égard à l’orientation <strong>de</strong>s<br />
statuts en cours, <strong>la</strong> commission directive fut rénovée, les autorités étant les suivantes :<br />
prési<strong>de</strong>nt : Dr P. Sangüeza ; vice-prési<strong>de</strong>nt : Dr F. Humboldt ; secrétaire: Dr F. Cár<strong>de</strong>nas ;<br />
trésorier : Dr L. Valda.<br />
Les principales conclusions <strong>de</strong> cette nouvelle formation tenaient compte <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong>s réunions anatomo-cliniques à Cochabamba <strong>de</strong>ux fois par an, <strong>de</strong> <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong>s filiales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong>s bulletins mensuels<br />
(seuls <strong>de</strong>ux bulletins et une circu<strong>la</strong>ire avaient été émis jusqu’alors) et d’un projet<br />
très ambitieux, <strong>la</strong> création d’une revue <strong>de</strong>rmatologique.<br />
La ville <strong>de</strong> Sucre fut choisie comme siège du 2 e Congrès, mais <strong>de</strong>s différends impondérables<br />
occasionnèrent ultérieurement le changement <strong>de</strong> siège, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santa Cruz<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sierra étant finalement élue. Le 2 e Congrès bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (1979),<br />
présidé par P. Sangüeza et O. Vil<strong>la</strong>gomez, fut une gran<strong>de</strong> réussite et accueillit <strong>de</strong>s délégations<br />
boliviennes et étrangères.<br />
Le siège du 3 e Congrès bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1980 et du 4 e Congrès en 1981 fut<br />
La Paz. En 1981, <strong>la</strong> réalisation du congrès national coïncida avec celle du 5 e Congrès<br />
bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; ces <strong>de</strong>ux réunions eurent lieu à l’hôtel P<strong>la</strong>za et accueillirent<br />
<strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bolivie, <strong>de</strong> l’Argentine, du Brésil, <strong>de</strong> l’Uruguay et <strong>de</strong>s États-Unis.<br />
69
FERNANDO CÁRDENAS, JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA<br />
À partir <strong>de</strong> ce congrès, <strong>la</strong> société acquit le système <strong>de</strong> thérapeutique PUVA, loua un<br />
bureau pour y installer son siège et se procura quelques meubles (bureau,<br />
étagères, etc.). La bibliothèque régionale du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(CILAD), dont <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est chargée d’assurer l’entretien,<br />
fut installée à cet endroit. Jorge Abu<strong>la</strong>fia et Pastor Sangüeza furent les principaux<br />
garants <strong>de</strong> l’acquisition et du fonctionnement <strong>de</strong> cette bibliothèque. Tous ces événements<br />
furent présidés par le Dr Sangüeza.<br />
À partir <strong>de</strong> 1978, trois réunions anatomo-cliniques eurent lieu à Cochabamba, au<br />
cours <strong>de</strong>squelles <strong>de</strong>s travaux furent présentés et les statuts révisés pour aboutir à leur<br />
rédaction finale. Deux cours d’actualisation <strong>de</strong>rmatologique eurent également lieu. La<br />
<strong>de</strong>rnière réunion anatomo-clinique à Cochabamba se tint en 1983 dans le but <strong>de</strong> présenter<br />
un rapport et <strong>de</strong> fixer le siège du 5 e Congrès, au cours duquel <strong>la</strong> commission<br />
directive serait renouvelée. Rappelons qu’entre 1981 et 1985, le pays subit une inf<strong>la</strong>tion<br />
galopante permettant à peine <strong>la</strong> poursuite d’activités scientifiques et écartant toute possibilité<br />
<strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> congrès. Malgré <strong>la</strong> situation difficile, <strong>la</strong> délégation <strong>de</strong> Santa Cruz<br />
prit <strong>la</strong> responsabilité d’organiser le 5 e Congrès bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie : grâce à l’effort<br />
digne d’éloges <strong>de</strong> nos collègues <strong>de</strong> cette région, <strong>la</strong> réunion scientifique put avoir lieu en<br />
octobre 1984 tel que prévu. La commission directive fut donc rénovée, les nouvelles<br />
autorités étant le Dr Luis Valda (prési<strong>de</strong>nt), le Dr Guido Monasterios (vice-prési<strong>de</strong>nt), le<br />
Dr Alfredo Zeballos (secrétaire) et le Dr Raúl Lara (membre).<br />
Cette jeune commission donna <strong>de</strong> l’énergie à <strong>la</strong> société: conformément aux gestions précé<strong>de</strong>ntes,<br />
elle accomplit en peu <strong>de</strong> temps plusieurs actions et travaux; les liens à l’étranger<br />
sont actuellement plus vastes et plus intenses; beaucoup <strong>de</strong> cours sont organisés; les<br />
membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> société participent activement au Collège médical national et départemental;<br />
il existe un rapport constant et permanent entre <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues dans les<br />
provinces; cette commission suscite également l’essor <strong>de</strong> valeurs juvéniles et <strong>la</strong> diffusion<br />
<strong>de</strong>s informations vers <strong>la</strong> communauté scientifique par le biais <strong>de</strong>s médias. Le siège <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société regroupe <strong>de</strong>s ateliers hebdomadaires réguliers, alternant <strong>de</strong>s présentations <strong>de</strong> cas,<br />
<strong>de</strong>s séances administratives et <strong>la</strong> mise à jour <strong>de</strong> sujets divers. En ce qui concerne l’équipement,<br />
<strong>la</strong> société acquit plusieurs biens (une machine à écrire, un projecteur) et créa une<br />
adresse électronique pour son secrétariat.<br />
Le rassemblement effectif <strong>de</strong> tous les collègues du pays et l’obtention <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité<br />
juridique furent une réussite remarquable. Cette administration, en col<strong>la</strong>boration<br />
avec celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiale Sucre, fut chargée d’organiser le 6 e Congrès bolivien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
■ Depuis 1986 1986 jusqu’ à nos jusqu’à jours nos jours<br />
70<br />
Eu égard aux antécé<strong>de</strong>nts qui viennent d’être exposés, nous pouvons affirmer que <strong>la</strong><br />
société atteignit sa majorité en moins <strong>de</strong> vingt ans d’existence. La création <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation<br />
en est le point culminant.<br />
En 1985, <strong>la</strong> Commission nationale <strong>de</strong> spécialisation approuva, après quasiment <strong>de</strong>ux<br />
ans <strong>de</strong> gestion, les cours <strong>de</strong> spécialisation qui <strong>de</strong>vaient respecter ces conditions requises:<br />
une infrastructure adéquate, une bibliothèque, un groupe permanent d’enseignants et<br />
<strong>de</strong>s programmes favorables au pays. Finalement, le 3 février 1986, nous avons accueilli<br />
les trois premiers rési<strong>de</strong>nts en <strong>de</strong>rmatologie : W. Magariños, S. Cal<strong>de</strong>rón et M. Loredo.<br />
En ce qui concerne l’infrastructure hospitalière, l’agrandissement et <strong>la</strong> rénovation <strong>de</strong><br />
l’aire <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques furent possibles grâce aux démarches du Dr Ana G. Miranda,<br />
une jeune <strong>de</strong>rmatologue bolivienne installée à Caracas.<br />
Le résidanat est actuellement à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Fernando Cár<strong>de</strong>nas et <strong>de</strong> Luis Valda ;<br />
tous les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont escomptés pour rejoindre
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
le groupe d’enseignants l’an prochain. Dans l’ensemble, trois années sont nécessaires à<br />
<strong>la</strong> spécialisation, <strong>la</strong> première année étant consacrée à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine interne.<br />
Signalons qu’une formation en <strong>de</strong>rmatologie tropicale, unique modalité <strong>de</strong> ce cours<br />
<strong>de</strong> spécialisation, est exigée. Pour ce faire, nous comptons encore une fois sur le soutien<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santa Cruz, siège <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux centres d’assistance et <strong>de</strong> recherche qui jouissent<br />
d’un prestige international : Jorochito et CENOTROP, le Centre national <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
tropicales, qui regroupent une équipe d’excellents professionnels et qui disposent d’un<br />
organe <strong>de</strong> publication régulièrement édité.<br />
Pour finir, nous voulons insister sur le fait que ce compte rendu donne un aperçu très<br />
succinct <strong>de</strong> ce que fut et <strong>de</strong> ce qu’est actuellement <strong>la</strong> Société bolivienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Nous avons certainement omis <strong>de</strong> nombreux détails ainsi que les noms <strong>de</strong> personnes qui<br />
travaillent dans l’institution pour le pays.<br />
Plusieurs projections existent pour l’avenir ; elles ne se concrétiseront que si nous<br />
continuons à être un groupe uni encourageant le travail en équipe et ouvrant les portes,<br />
d’une motivation et d’une incitation constantes, à <strong>la</strong> jeunesse. ■<br />
Novembre 2004
LA DERMATOLOGIE<br />
ET LES DERMATOLOGUES<br />
AU BRÉSIL<br />
El Brasil y <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatología<br />
Plusieurs spécialistes considèrent que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne — en ce qui se rapporte<br />
à <strong>la</strong> théorie et à <strong>la</strong> pratique conçues pour <strong>la</strong> spécialisation — apparut au début du<br />
XX e siècle, coïncidant avec une phase plus dynamique voyant aboutir les recherches qui<br />
précédèrent et accompagnèrent <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en<br />
1912.<br />
Nous pourrions dire que les étapes délimitant notre histoire <strong>de</strong>rmatologique sont au<br />
nombre <strong>de</strong> trois : 1. l’étape <strong>de</strong>s bénédictions <strong>de</strong>s payés, précédant <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
l’enseignement secondaire dans le pays ; 2. l’étape préscientifique, qui débuta avec <strong>la</strong><br />
fondation <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Bahia et <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro; 3. l’étape scientifique,<br />
commençant à partir <strong>de</strong>s recherches du XX e siècle et du développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Première étape : les bénédictions <strong>de</strong>s payés<br />
Cette pério<strong>de</strong>, dominée par l’intuition et l’empirisme pur, dura plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cents ans.<br />
Le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies consistait à utiliser <strong>de</strong>s potions préparées avec <strong>de</strong>s feuilles,<br />
<strong>de</strong>s fruits, <strong>de</strong>s graines et <strong>de</strong>s racines, <strong>de</strong>s essences, <strong>de</strong>s baumes et <strong>de</strong>s résines dissolues,<br />
macérées ou cuites, pour que les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s les boivent, les aspirent, s’en frictionnent ou<br />
les appliquent en catap<strong>la</strong>smes.<br />
Certaines substances <strong>de</strong> <strong>la</strong> phytothérapie aborigène furent incorporées plus tard à <strong>la</strong><br />
pharmacopée mondiale : ipéca, jaborandi, épazote, copaïba et ratanhia, ipecacuana,<br />
quinquina, coca, ja<strong>la</strong>p du Mexique, pomme <strong>de</strong> mai <strong>américaine</strong>.<br />
Ce n’est qu’à partir du Gouvernement général que quelques mé<strong>de</strong>cins venus d’Europe<br />
commencèrent à s’installer dans le pays, comme Jorge Va<strong>la</strong>dares et Jorge Fernan<strong>de</strong>s.<br />
L’étape pré-scientifique<br />
PAULO R. CUNHA<br />
■ Le Brésil et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
■ P remière étape : les bénédictions <strong>de</strong>s payés<br />
■ L’étape préscientifique<br />
Cette étape couvre presque tout le XIX e siècle, trois siècles après <strong>la</strong> découverte du<br />
Brésil. Un événement fortuit en fut à <strong>la</strong> base : les avantages col<strong>la</strong>téraux provoqués par<br />
73
Figure 1. Dr Adolfo<br />
Lutz (1855-1940)<br />
PAULO R. CUNHA<br />
74<br />
l’expulsion du sol portugais <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison royale <strong>de</strong> Braganza, causée par l’invasion <strong>de</strong><br />
Napoléon. L’arrivée en 1808 <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille royale au Brésil eut quelques bénéfices, comme<br />
<strong>la</strong> création <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premières écoles <strong>de</strong> chirurgie du pays, à Salvador et à Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, appelées académies médico-chirurgicales (1815).<br />
Même si dans les premiers temps <strong>la</strong> qualité pédagogique fut discutable, les élèves qui<br />
y obtinrent leur diplôme occupèrent progressivement les postes détenus jusque-là par<br />
<strong>de</strong>s professionnels étrangers, donnant à l’enseignement médical <strong>de</strong> base lusitanienne<br />
une certaine empreinte tropicale. À partir <strong>de</strong> 1822, indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation<br />
politique, le modèle français fut le modèle pédagogique adopté.<br />
Le 3 octobre 1832, ces établissements é<strong>la</strong>rgirent leur structure, conservant le cours<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, celui <strong>de</strong> pharmacie et celui sur les accouchements.<br />
Les premières recherches<br />
La plupart <strong>de</strong>s premiers travaux scientifiques entrepris en <strong>de</strong>rmatologie n’ont pas été<br />
réalisés dans ces facultés, mais résultèrent du climat propice à <strong>la</strong> recherche que promouvaient<br />
ces institutions. Le Dr Meirelles <strong>de</strong> Pernambuco, promoteur et fondateur <strong>de</strong><br />
l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine actuelle, écrivit en 1827 sur l’Elephantiasis graecorum,<br />
actuellement connu sous le nom <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen. Le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre à<br />
l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s eaux thermales <strong>de</strong> Goiás préconisé par João Maurício Faivre fut récusé par De<br />
Simoni après <strong>de</strong>s examens minutieux. Les <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins fondèrent l’Académie nationale<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Malgré les remises en question, l’empereur Pierre II désigna Faivre pour traiter les<br />
lépreux à l’hôpital <strong>de</strong>s Lazares, à São Cristóvão, Rio <strong>de</strong> Janeiro. En 1838, Abreu e Lima<br />
constata que <strong>la</strong> lèpre n’était pas héréditaire mais contagieuse, et qu’elle pouvait affecter<br />
toutes les c<strong>la</strong>sses sociales.<br />
Entre 1861 et 1869, le naturaliste et chimiste T. Pecolt introduisit l’huile <strong>de</strong> sapucaína<br />
(Carpotroche brasiliensis) pour le traitement <strong>de</strong> plusieurs <strong>de</strong>rmatoses; un constat ultérieur<br />
prouva que cette huile contient aussi du soufre. On décida alors d’é<strong>la</strong>borer une émulsion<br />
pour le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> gale et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatophytose.<br />
Plusieurs thèses <strong>de</strong> doctorat sur <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, dont <strong>la</strong> plupart n’étaient que<br />
<strong>de</strong> simples dissertations n’apportant aucune contribution scientifique, furent présentées<br />
pendant cette pério<strong>de</strong>. Plus <strong>de</strong> vingt travaux furent également consacrés à <strong>la</strong> lèpre, à <strong>la</strong><br />
syphilis, aux tuméfactions et aux <strong>de</strong>rmatoses ; parmi eux, plusieurs étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> bouba<br />
— considérée comme <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>la</strong> plus redoutable <strong>de</strong> l’époque coloniale et impériale —,<br />
telles Bouba, <strong>de</strong> Bernardo Clemente Pinto (1835), F.B. Fiúza (1856) et Gama Lobo (1858) ;<br />
Mémoire sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die appelée vulgairement bouba, <strong>de</strong> Joaquim Jerônimo Serpa (1842-<br />
44) ; L’origine du nom bouba, variété, traitement, extirpation, <strong>de</strong> João Alves <strong>de</strong> Moura<br />
(1849) ; Considérations brèves sur <strong>la</strong> bouba et son diagnostic différentiel, <strong>de</strong> Gregorio<br />
Pereira <strong>de</strong> Miranda Pinto (1866) ; Les boubas, leurs nature et traitement, <strong>de</strong> Eusébio<br />
<strong>de</strong> Martins Costa (1884).<br />
Quant à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’origine africaine appelée ainhum ou dactylite amputante, il<br />
existe d’autres thèses <strong>de</strong> doctorat telles que Un cas <strong>de</strong> ainhum, <strong>de</strong> Carlos Moncorvo <strong>de</strong><br />
Figueiredo (1875); Ainhum. Étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die connue sous ce nom, <strong>de</strong> Domingos <strong>de</strong><br />
Almeida Martins Costa (1875); Un cas <strong>de</strong> ainhum, <strong>de</strong> José Pereira Guimarães (1877) et<br />
Du ainhum, <strong>de</strong> Antônio Pacheco Men<strong>de</strong>s (1880).<br />
Le Pr Luiz Chaves <strong>de</strong> Faria publia <strong>de</strong>ux travaux méritoires : Précis <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées (1887) et Ma<strong>la</strong>dies vénériennes (1904).<br />
Les notables contributions d’Adolfo Lutz (1855-1940) dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> nosologie<br />
tropicale (figure 1) parurent entre 1888 et 1899. Lors <strong>de</strong> son résidanat au sein<br />
du fameux Dermatologium <strong>de</strong> Hambourg, sous l’égi<strong>de</strong> du Dr Unna, il décrivit avec le<br />
maître allemand les formes cocoï<strong>de</strong>s du bacille <strong>de</strong> Hansen (1886).
Bruno Chaves<br />
En 1887, le Dr Bruno Chaves, diplômé <strong>de</strong> Bahia, prépara une thèse <strong>de</strong> doctorat sur « Le<br />
mercure et ses composés », en le prescrivant pour traiter <strong>la</strong> syphilis. Ce travail fut<br />
publié dans le Medical and Surgical Reporter <strong>de</strong> Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie, et dans les Annales <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphilographie. Ces étu<strong>de</strong>s lui permirent d’être désigné membre<br />
étranger <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société française <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie, qui servit <strong>de</strong><br />
modèle à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il n’est pas étonnant que Bruno Chaves, déjà installé à Pelotas, Rio Gran<strong>de</strong> do Sul,<br />
<strong>de</strong>vînt l’un <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rmatologues brésiliens invités à participer au 1 er Congrès mondial<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie, organisé en 1889 à Paris, à l’hôpital Saint-Louis.<br />
Le premier service<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Peu à peu, le pays perfectionna sa mé<strong>de</strong>cine grâce aux <strong>de</strong>ux facultés et aux travaux<br />
isolés <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins. Ce processus s’accéléra entre 1882 et 1884 en raison <strong>de</strong>s réformes<br />
<strong>de</strong> Leôncio <strong>de</strong> Carvalho et du vicomte <strong>de</strong> Sabóia, qui mo<strong>de</strong>rnisèrent l’enseignement en<br />
l’adaptant aux <strong>de</strong>rnières tendances dictées par l’Europe.<br />
Le nouveau programme introduisit <strong>de</strong> manière surprenante une matière qui reflétait<br />
l’importance croissante acquise par les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau dans le pays et dans le reste<br />
du mon<strong>de</strong>. Le cours « clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées et syphilitiques », développé à<br />
Bahia par Alexandre Evangelista <strong>de</strong> Castro Cerqueira, et à Rio <strong>de</strong> Janeiro par João<br />
Pizarro Gabizo, fut alors créé.<br />
À Rio <strong>de</strong> Janeiro le cours fut créé en 1883, un an après <strong>la</strong> fondation du premier grand<br />
service clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau au Brésil, à <strong>la</strong> polyclinique générale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro. Son directeur et promoteur, Antônio Pereira da Silva Araújo, originaire <strong>de</strong><br />
l’École tropicaliste <strong>de</strong> Bahia et installé à ce moment-là dans <strong>la</strong> capitale du pays, fut le<br />
premier à décrire une ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong>rmatologique et à participer à <strong>la</strong> chirurgie pionnière <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> spécialité au Brésil.<br />
« Silva Araújo fut le premier professeur libre qui enseigna <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Brésil,<br />
offrant au sein <strong>de</strong> son service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie un apprentissage<br />
imprégné d’idées pastoriennes. » 2<br />
Selon Joaquim Mota, « les expositions du Dr José Antônio Pereira da Silva Araújo au<br />
cours <strong>de</strong>s célèbres Conférences <strong>de</strong> Glória qui débutèrent dès 1875 étaient très intéressantes;<br />
il dissertait remarquablement sur <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> parasitologie et <strong>de</strong> microbiologie. Une fois le<br />
service <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique créé, le Dr Silva Araújo y entreprit l’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, en promouvant avec succès <strong>de</strong>s cours très fréquentés. » 2<br />
Silva Araújo était un mé<strong>de</strong>cin bril<strong>la</strong>nt, chercheur et auteur d’importants travaux —<br />
publiés les années suivantes par l’At<strong>la</strong>s <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, avec <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins en<br />
couleur et <strong>de</strong>s textes en <strong>la</strong>ngue française (1883) — ainsi que <strong>de</strong>s conférences sur <strong>la</strong><br />
Réglementation sanitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution (1883) et <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie publique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
syphilis (1891).<br />
L’Académie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine existait déjà <strong>de</strong>puis cinquante-trois ans lorsque fut créée <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1882, constituant ainsi le premier service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du<br />
pays. D’après les informations <strong>de</strong> Rubem David Azu<strong>la</strong>y, Silva Araújo fut nommé <strong>la</strong> même<br />
année 127 e membre titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’entité. « De cette façon <strong>la</strong> nouvelle spécialité apparue<br />
dans le pays intégrait l’académie. Son intense activité l’amena à occuper en 1889 le premier<br />
secrétariat, <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce en 1897 et plus tard le poste <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt perpétuel. Il fut<br />
également chargé <strong>de</strong> créer le musée <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. » 2<br />
Vers <strong>la</strong> moitié du XX e siècle, cette académie compterait <strong>de</strong>ux autres prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité : Rubem David Azu<strong>la</strong>y et Jarbas Porto, qui dirigeaient aussi <strong>la</strong> Société brésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
75
PAULO R. CUNHA<br />
76<br />
L’école tropicaliste <strong>de</strong> Bahia<br />
La spécialité « <strong>de</strong>rmatologie » fut créée à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Bahia à une<br />
époque où cette école disputait <strong>la</strong> première p<strong>la</strong>ce dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
avec celle <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
Alexandre Cerqueira, son titu<strong>la</strong>ire, qui avait été professeur <strong>de</strong> l’école supérieure et<br />
secondaire en 1865 et professeur universitaire un an plus tard, i<strong>de</strong>ntifia <strong>la</strong> Tinea Nigra<br />
en 1891. Ses observations sur le sujet ne furent pas publiées, mais son fils, Antônio Gentil<br />
<strong>de</strong> Castro Cerqueira Pinto, les utilisa en 1916 dans sa thèse appelée Kératomycose<br />
Nigra Palmaris. Il y décrivit <strong>la</strong> manière dont son père avait réussi <strong>la</strong> reproduction expérimentale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die à travers l’inocu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s squames extraites d’une lésion d’un<br />
volontaire.<br />
Les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues, le père et le fils, étaient liés à une fameuse école qui introduisit<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie tropicale dans le pays. Selon F.E. Rabello, « J. A<strong>de</strong>odato en<br />
1888 et Juliano Moreira en 1896 furent justement les premiers à i<strong>de</strong>ntifier cliniquement<br />
le bouton <strong>de</strong> Bahia <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire, appelée sous différents noms au<br />
Moyen-Orient. » 2<br />
Nous rendons justice en disant que l’école bahienne <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut à l’origine <strong>de</strong><br />
l’intérêt croissant pour nos problèmes <strong>de</strong> nosologie tropicale. Ce fut aussi un citoyen <strong>de</strong><br />
Bahia, Silva Lima (1826-1910), qui réalisa pour <strong>la</strong> première fois une <strong>de</strong>scription c<strong>la</strong>ssique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> curieuse affection appelée ainhum. Silva Lima occupait une position privilégiée<br />
pour ce<strong>la</strong> car Bahia fut pendant un certain temps <strong>la</strong> capitale du pays, et par<br />
conséquent le point d’arrivée <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves africains. Il s’agit d’une <strong>de</strong>s rares ma<strong>la</strong>dies<br />
vraiment raciales, propres au noir ou full-blood, généralement associée à un certain<br />
<strong>de</strong>gré d’hyperkératose p<strong>la</strong>ntaire.<br />
L’école tropicaliste <strong>de</strong> Bahia se développa malgré les re<strong>la</strong>tives difficultés <strong>de</strong> l’enseignement<br />
officiel, dispensé à l’époque par l’université <strong>de</strong> Salvador. Quoi qu’il en soit,<br />
Bahia enthousiasmait le milieu spécialisé en raison <strong>de</strong> son intérêt pour <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
cutanée. C’est pourquoi les professionnels venus <strong>de</strong> l’étranger et les mé<strong>de</strong>cins liés à <strong>la</strong><br />
faculté conformèrent <strong>de</strong>s groupes d’étu<strong>de</strong>, <strong>de</strong>venant ainsi les authentiques prédécesseurs,<br />
nationaux et étrangers, <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase scientifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine brésilienne. Nous<br />
citerons le Portugais Silva Lima, l’Ang<strong>la</strong>is John Patterson, l’Allemand Otto Wucherer et<br />
plusieurs Brésiliens tels que Maria Pires Caldas, Ludgero Ferreira, Antônio José Alves et<br />
Antônio Januário <strong>de</strong> Faria.<br />
João Francisco da Silva Lima, diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Salvador — où il<br />
fut un chercheur in<strong>la</strong>ssable pendant toute sa vie —, enrichit le patrimoine scientifique<br />
brésilien avec <strong>de</strong> précieuses contributions sur <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> pathologie tropicale, notamment<br />
ses travaux sur <strong>la</strong> bouba et l’ainhum.<br />
Otto Wucherer s’établit comme généraliste à Bahia en 1843 et commença à étudier<br />
systématiquement les selles <strong>de</strong>s opilés, y trouvant les œufs du Ancylostomum duo<strong>de</strong>nale<br />
et déterminant ainsi l’étiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die causée par ce parasite. Plus tard il i<strong>de</strong>ntifia<br />
les microfi<strong>la</strong>ires responsables <strong>de</strong> l’éléphantiasis, dont l’agent fut baptisé sous le nom<br />
<strong>de</strong> Wuchereria en son honneur.<br />
John Patterson, originaire d’Édimbourg, arrivé à Salvador en 1842, se distingua tout<br />
<strong>de</strong> suite par ses travaux sur <strong>la</strong> fièvre jaune et le Cholera morbus qui se propageaient à<br />
l’époque <strong>de</strong> manière épidémique.<br />
Grâce à son travail Étu<strong>de</strong> du Demo<strong>de</strong>x folliculorum, Silva Araújo — un autre membre<br />
<strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Bahia — eut l’occasion d’intégrer l’Académie impériale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Pour<br />
cette raison il déménagea à Rio <strong>de</strong> Janeiro, où il serait désigné plus tard directeur du<br />
premier service <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique générale récemment créée.<br />
Ultérieurement d’autres maîtres s’y distinguèrent, tels Parreiras Horta et Ramos e Silva.
La Gazeta Médica et son exhortation à <strong>la</strong> science<br />
En 1866 le groupe <strong>de</strong> Salvador créa <strong>la</strong> première publication scientifique brésilienne,<br />
<strong>la</strong> Gazeta Médica <strong>de</strong> Bahía, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Virgílio Clímaco Damazio; elle incluait <strong>la</strong><br />
présentation <strong>de</strong> discussions et <strong>de</strong>s conclusions sur les cas médicaux traités par ces pionniers<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> science brésilienne, « avec <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong>s patients et les données fournies<br />
par le microscope et l’anatomie pathologique. » 2 Pendant sa première année <strong>de</strong> parution,<br />
<strong>la</strong> publication incluait déjà d’importantes étu<strong>de</strong>s dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Dans l’édition du 10 novembre 1866, son directeur signa<strong>la</strong>it l’absence <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins brésiliens<br />
à un congrès médical à Paris, témoignant <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gazeta et <strong>de</strong> ses<br />
membres <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce dans le pays une science médicale du plus haut niveau.<br />
Ce ne fut que vingt-trois ans plus tard (en août 1889) que l’exhortation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gazeta<br />
fut véritablement prise en compte, lors <strong>de</strong>s commémorations du centenaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Révolution<br />
française et à <strong>la</strong> veille <strong>de</strong> <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République dans notre pays. À ce<br />
moment-là, une délégation <strong>de</strong> cinq spécialistes brésiliens, constituée par Silva Araújo,<br />
João Pizarro Gabizo, Adolfo Lutz, Oscar <strong>de</strong> Bulhões et Bruno Chaves, participa activement<br />
à Paris au 1 er Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie.<br />
João Pizarro Gabizo<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut institutionnalisée au Brésil en 1883 au moment où<br />
J.P. Gabizo (1845-1904) fut nommé pour donner <strong>de</strong>s cours à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées et syphilitiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. Pendant presque<br />
cent ans, jusqu’en 1978, cette clinique dispenserait ses cours pratiques dans <strong>la</strong> multiséculière<br />
Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, qui fut aussi le premier siège <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SBD) entre 1912 et 1988. Au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>,<br />
ces locaux, où furent établies les bases pour <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dans le<br />
pays, abritèrent les réunions mensuelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD qui rassemb<strong>la</strong>ient et formaient plusieurs<br />
générations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> toutes les régions.<br />
Francisco Eduardo Rabello raconte que Gabizo suivit sa formation à Vienne, dans <strong>la</strong><br />
fameuse école <strong>de</strong> Ferdinand Hebra et M. Kaposi. Seul candidat dans <strong>la</strong> lutte pour le titre<br />
<strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, Gabizo fut nommé par l’institution<br />
et chargé d’enseigner par le gouvernement impérial après avoir passé <strong>de</strong>s examens<br />
bril<strong>la</strong>nts ; il exerça sa charge avec beaucoup <strong>de</strong> talent, puisqu’il connaissait<br />
profondément <strong>la</strong> spécialité, dont il par<strong>la</strong>it avec une gran<strong>de</strong> éloquence.<br />
Joaquim Mota ajoute : « Gabizo n’écrivit pas beaucoup <strong>de</strong> publications scientifiques,<br />
nous <strong>la</strong>issa à peine un travail sur <strong>la</strong> réglementation <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution, une conférence<br />
sur <strong>la</strong> lèpre et d’autres écrits sur <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes. » 2<br />
À partir <strong>de</strong> cette époque, <strong>de</strong>ux écoles <strong>de</strong>rmatologiques aux philosophies opposées<br />
s’affrontèrent dans <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> <strong>la</strong> République : <strong>la</strong> chaire officielle <strong>de</strong> J.P. Gabizo, qui<br />
soutenait les idées <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Vienne, et <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> Silva Araújo, non reconnue officiellement,<br />
centrée sur l’éclectisme rationnel et pru<strong>de</strong>nt soutenu par l’école française.<br />
Vingt ans plus tard, l’influence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux écoles sur <strong>la</strong> spécialité naissante se traduirait<br />
par <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> leurs disciples dans <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui est, comme nous allons le voir, le produit direct <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
troisième et <strong>de</strong>rnière étape <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne.<br />
L´étape cientifique<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
■ L’étape scientifique<br />
La troisième étape <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne commença officiellement en 1883,<br />
avec <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées et syphilitiques dans les<br />
77
PAULO R. CUNHA<br />
78<br />
facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro et <strong>de</strong> Salvador. En réalité, le Dr Antônio José<br />
Pereira da Silva Araújo, originaire <strong>de</strong> l’école bahianne <strong>de</strong> tropicologie, avait déjà institutionnalisé<br />
en 1882 l’enseignement libre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à travers un cours particulier<br />
donné à <strong>la</strong> première clinique <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (créée <strong>la</strong> même année à <strong>la</strong><br />
polyclinique générale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro), avant que João Pizarro Gabizo (Rio <strong>de</strong> Janeiro)<br />
et Alexandre <strong>de</strong> Castro Cerqueira (Salvador) prennent possession <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire obtenue<br />
par concours public.<br />
Joaquim Mota dit : « On pourrait affirmer que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie était complètement<br />
ignorée au Brésil, sauf par certains écrits, <strong>de</strong> telle sorte que <strong>la</strong> création d’une chaire<br />
officielle marqua en réalité le début <strong>de</strong> ces étu<strong>de</strong>s dans le pays. » 2<br />
Les concours publics pour choisir <strong>de</strong>s professeurs adjoints (postes créés par <strong>la</strong><br />
réforme Sabóia) eurent lieu en 1883. Le Dr Luiz da Costa Chaves Faria fut nommé à Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro, dans <strong>la</strong> 11 e section correspondant à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées ; en 1904,<br />
suite à <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Gabizo, il fut nommé professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et<br />
syphiligraphique, nom donné à <strong>la</strong> discipline à partir <strong>de</strong> 1892.<br />
Produit <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynamique induite par l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle spécialité dans le<br />
pays, <strong>la</strong> décennie 1880 se distingua par l’essor <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche microbiologique à l’Institut<br />
Oswaldo Cruz. La Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie apparut au début du XX e siècle<br />
pour soutenir et é<strong>la</strong>rgir le processus <strong>de</strong> formation, <strong>de</strong> cohésion et <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong> cette<br />
catégorie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins. Elle accorda une priorité à <strong>la</strong> stimu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche scientifique<br />
et favorisa <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce d’une école nationale créative et influente dans le<br />
pays, liée en même temps à l’étranger et respectée dans ce milieu.<br />
Les Drs Fernando Terra et Eduardo Rabello<br />
Le concours pour occuper le poste <strong>de</strong> professeur remp<strong>la</strong>çant à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique<br />
eut lieu en 1906 ; Fernando Terra et Eduardo Rabello, qui avaient obtenu <strong>la</strong> même<br />
quantité <strong>de</strong> points, partagèrent <strong>la</strong> première p<strong>la</strong>ce. Cependant, le gouvernement d’Alfonso<br />
Pena choisit le Dr Terra, car il était le plus âgé et avait été assistant <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>puis<br />
1891. En 1910, <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Chaves Faria le conduisit à occuper le poste <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire, qu’il exerça encore quinze ans.<br />
L’avènement <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD s’explique aussi par le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche scientifique qui<br />
caractérisa — principalement dans les premières années du XX e siècle — le panorama <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie naissante; ce processus fut stimulé par le développement <strong>de</strong>s chaires et<br />
par le rôle <strong>de</strong> l’Institut Oswaldo Cruz. La Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie assuma énergiquement,<br />
l’organisation et <strong>la</strong> divulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle spécialité.<br />
La scène d’inspiration<br />
L’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie avaient atteint, à <strong>la</strong> fin du XIX e siècle, un tel<br />
<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> développement en Europe qu’un débat eut lieu sur les grands problèmes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pathologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique entre les maîtres <strong>de</strong>s différentes écoles. Ferdinand Hebra,<br />
chef <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Vienne, posa les bases définitives <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, en lui fournissant <strong>la</strong><br />
systématisation et le corps doctrinal qui inspireraient les continuateurs <strong>de</strong> son œuvre:<br />
Kaposi, Auspitz et Neuman.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie arriva au Brésil avec une certaine difficulté, car les étu<strong>de</strong>s et les travaux<br />
n’augmentèrent que progressivement à <strong>la</strong> fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle.<br />
Certains auteurs ne reconnaissent même pas <strong>de</strong> contribution avant l’an 1900.<br />
Nous pouvons donc commencer à parler aussi bien d’une mé<strong>de</strong>cine que d’une<br />
<strong>de</strong>rmatologie brésiliennes à partir <strong>de</strong>s débuts du XX e siècle. Le travail <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux écoles<br />
(Salvador et Rio <strong>de</strong> Janeiro) fut <strong>la</strong> graine qui fit germer l’esprit scientifique chez les<br />
premières générations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins diplômés du pays. Beaucoup d’entre eux se
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
rendirent en Europe en quête <strong>de</strong> perfectionnement ; en même temps qu’ils se formaient,<br />
ils essayaient d’appliquer leur apprentissage à <strong>la</strong> réalité du Brésil.<br />
Certains auteurs relèvent le rôle d’Oswaldo Cruz et <strong>de</strong> l’institut Manguinhos sur cette<br />
scène, notamment dans le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle spécialité médicale liée aux ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées. La production académique ne fut plus seulement une simple reproduction<br />
<strong>de</strong> bibliographies — caractéristique fondamentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase préscientifique —,<br />
mais se tourna plutôt vers <strong>la</strong> recherche et l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire, contribuant <strong>de</strong> manière<br />
décisive à i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies auparavant inconnues, et à déterminer leurs diagnostics<br />
et leurs traitements.<br />
L’institut Manguinhos, institut sérothérapique fédéral, fut créé pour préparer<br />
<strong>de</strong>s sérums et <strong>de</strong>s vaccins contre <strong>la</strong> peste. Transformé ensuite par<br />
Oswaldo Cruz (figure 2) et <strong>de</strong>venu l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine expérimentale, il<br />
reçut son nom actuel en 1908. La recherche en <strong>de</strong>rmatologie y fut privilégiée,<br />
en raison <strong>de</strong> l’influence sur O. Cruz <strong>de</strong> Raymond Sabouraud, le véritable<br />
fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie médicale (ils avaient travaillé ensemble à<br />
Paris).<br />
Oswaldo Cruz ainsi qu’un groupe <strong>de</strong> maîtres éminents et <strong>de</strong> jeunes scientifiques<br />
qui étaient passés à Manguinhos intégrèrent <strong>la</strong> première génération<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues brésiliens. Ce fut une pério<strong>de</strong> effervescente d’étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong><br />
recherches scientifiques dans ce domaine. Nous citerons parmi les figures<br />
notables Adolfo Lutz, Adolpho Lin<strong>de</strong>mberg (figure 3), Parreiras Horta, Gaspar<br />
Viana, Rocha Lima, Henrique <strong>de</strong> Beaurepaire Aragão, Arêa Leão, Armínio<br />
Fraga, Eduardo Rabello, Fernando Terra (figure 4) et Olympio da<br />
Fonseca Filho.<br />
Adolfo Lutz (1855-1940), chercheur brésilien génial, découvrit en 1908 à<br />
Sao Paulo une nouvelle ma<strong>la</strong>die, actuellement appelée paracoccidioïdomycose<br />
ou ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Lutz-Splendore-Almeida.<br />
La clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (où<br />
convergèrent l’intérêt <strong>de</strong> Fernando Terra et <strong>la</strong> participation d’Eduardo Rabello, invité<br />
par un geste noble <strong>de</strong> son titu<strong>la</strong>ire à intégrer <strong>la</strong> chaire) fut indubitablement le haut lieu<br />
<strong>de</strong> cette activité parallèle et simultanée. Terra et Rabello créèrent alors un grand centre<br />
<strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>rmatologique, attirant d’autres spécialistes en parasites et <strong>de</strong>s pathologistes<br />
<strong>de</strong> l’Institut Oswaldo Cruz. Tous furent à l’origine <strong>de</strong> l’époque dorée <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
naissante.<br />
Il y eut une production <strong>de</strong> travaux fondamentaux pendant quatre ans. Comme nous<br />
l’avons déjà signalé, Adolfo Lutz découvrit à Sao Paulo en 1908 <strong>la</strong> paracoccidioïdomycose.<br />
Adolpho Lin<strong>de</strong>mberg (1872-1944) exposa en 1909 <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’agent étiologique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose, appelée ultérieurement Leishmania brasiliensis. La même<br />
année, il décrivit un nouveau type <strong>de</strong> mycétome et son agent étiologique sous le nom <strong>de</strong><br />
Dyscomices brasiliensis (actuellement Nocardia brasiliensis).<br />
Eduardo Rabello publia en 1910 une petite monographie historique sur les Dermatomycoses,<br />
dans <strong>la</strong>quelle il reproduisit dans le cas pratique du Brésil et grâce aux techniques<br />
<strong>de</strong> Sabouraud ce que le génial Français avait confirmé en <strong>la</strong> matière. En 1911,<br />
Paulo Parreiras Horta (1884-1961) publia un travail sur <strong>la</strong> « pierre noire » qui <strong>de</strong>viendrait<br />
un c<strong>la</strong>ssique, donnant au parasite <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die le nom <strong>de</strong> l’éminent spécialiste<br />
(Piedraia hortai).<br />
L’an 1912 fut notable pour plusieurs raisons :<br />
– Eduardo Rabello entama <strong>de</strong>s recherches à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> découverte, pour <strong>la</strong> première<br />
fois au Brésil, <strong>de</strong>s « corpuscules <strong>de</strong> Donovan », l’agent provoquant <strong>la</strong> donovanose<br />
(qui était à l’époque un granulome ulcéreux ou vénérien) ; cette étu<strong>de</strong> fut poursuivie en<br />
1917 à travers une thèse c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> Souza Aranha consolidant ce qu’on savait à<br />
l’époque sur le sujet.<br />
79<br />
Figure 2.<br />
Dr Oswaldo Cruz
Figure 3.<br />
Dr Adolpho<br />
Lin<strong>de</strong>mberg (centre)<br />
dans sa clinique <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santa Casa <strong>de</strong> Sao<br />
Paulo<br />
Figure 4.<br />
Dr Fernando Terra<br />
(1865-1947)<br />
PAULO R. CUNHA<br />
80<br />
– Gaspar Viana (1885-1914) découvrit le traitement et <strong>la</strong><br />
guérison <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’antimoine,<br />
sous <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> l’ancien tartare émétique, utilisé en<br />
injections intraveineuses à 1 %. Plus tard, il découvrirait <strong>la</strong><br />
guérison <strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> <strong>la</strong> donovanose en appliquant le même<br />
composé.<br />
Francisco Eduardo Rabello signale à propos <strong>de</strong> ces travaux :<br />
« Il n’est pas surprenant qu’au milieu <strong>de</strong> cette fébrile et si<br />
fertile activité <strong>de</strong> recherche apparaît, à <strong>la</strong> même époque (1912),<br />
<strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. » 2<br />
L’idéal <strong>de</strong> Fernando Terra<br />
Fernando Terra (1865-1947), originaire <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro,<br />
troisième professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> cette ville, fut<br />
l’auteur du projet et le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, exerçant son mandat <strong>de</strong> 1912 à 1925.<br />
En consultant les documents <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite société, on peut affirmer<br />
qu’il fut véritablement l’âme, l’inspiration et <strong>la</strong> force qui<br />
précédèrent <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD. C’est lui qui articu<strong>la</strong> les efforts, invita à <strong>la</strong> participation<br />
et rédigea l’ébauche <strong>de</strong>s statuts. D’aucuns le considèrent comme une force omniprésente<br />
dans <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’entité et les travaux qui y ont été entrepris pendant les<br />
treize premières années. Lors <strong>de</strong> sa retraite, en 1925, il quitta son poste à <strong>la</strong> SBD et à <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du Brésil,<br />
pour l’unique raison qu’il préféra maintenir <strong>la</strong> tradition : son successeur à <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong>vait être aussi le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Terra naquit le 25 décembre 1865 à Niterói<br />
et il mourut à Juiz <strong>de</strong> Fora en 1947. Diplômé en 1887 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
il se consacra tout <strong>de</strong> suite à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et fit son résidanat aux côtés du<br />
Pr. João Pizarro Gabizo dans <strong>la</strong> 19 e infirmerie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa. Les archives révèlent<br />
qu’il travail<strong>la</strong> également à Manguinhos. En 1891, il <strong>de</strong>vint assistant <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et syphiligraphie, et en 1906, il se présenta à un concours public pour aspirer<br />
au poste <strong>de</strong> professeur assistant, qu’il obtint pour les raisons préa<strong>la</strong>blement exposées.<br />
Quand il assuma <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire en 1910, succédant à Chaves <strong>de</strong> Faria, il<br />
appe<strong>la</strong> généreusement le Dr Eduardo Rabello pour travailler ensemble à <strong>la</strong> clinique ; ce<br />
<strong>de</strong>rnier vint accompagné du groupe <strong>de</strong> l’institut Oswaldo Cruz et ils rejoignirent les <strong>de</strong>rmatologues<br />
c<strong>la</strong>ssiques, donnant lieu à une interaction efficace pour les <strong>de</strong>ux secteurs.<br />
Non satisfait <strong>de</strong> son activité <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> l’institut, Fernando Terra posa les principes<br />
d’une entité capable <strong>de</strong> rassembler les <strong>de</strong>rmatologues et les diriger progressivement<br />
vers l’activité scientifique.<br />
Le modèle français<br />
Le modèle français <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie, fonctionnant<br />
<strong>de</strong>puis 1889 à l’hôpital Saint-Louis à Paris avec <strong>la</strong> clinique du même nom, fut choisi pour<br />
régir l’entité brésilienne ; curieusement, Terra et le groupe fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD n’inclurent<br />
pas au départ l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis dans le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle institution. Pendant<br />
treize ans, soit au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> Fernando Terra, l’entité reçut le nom <strong>de</strong> Société<br />
brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Ce ne fut qu’en 1925, lorsque Eduardo Rabello assuma <strong>la</strong><br />
prési<strong>de</strong>nce, que le statut changea pour <strong>de</strong>venir Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
syphilographie, à l’instar <strong>de</strong> l’entité française, avec une légère mais significative différence<br />
: <strong>la</strong> SBDS adopta le terme employé par les Anglo-Saxons syphilographie au lieu du<br />
mot français syphiligraphie. Quelques années après <strong>la</strong> Deuxième Guerre mondiale, avec
l’introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pénicilline, l’entité reprendrait son nom d’origine (1962), après<br />
trente-sept ans d’activité sous le nom <strong>de</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphilographie.<br />
Le changement <strong>de</strong> nom ne sera établi qu’en 1965, quarante ans après <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième raison sociale et le sigle SBDS.<br />
Personnalités historiques<br />
Sebastião <strong>de</strong> Almeida Prado Sampaio<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
■ Personnalités historiques<br />
Lorsqu’on <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à une figure notable <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité tel que le Pauliste Luiz Henrique<br />
Camargo Paschoal <strong>de</strong> dire qui <strong>de</strong>vrait figurer au panthéon <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong><br />
réponse est <strong>la</strong> suivante : « Moi, je mettrais Sebastião Sampaio sur le pié<strong>de</strong>stal. Vous qui<br />
allez écrire sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne <strong>de</strong>vez considérer <strong>de</strong>ux époques :<br />
avant et après Sampaio. Il fut une référence, et il en est toujours une. Prodigieusement<br />
intelligent et très compétent, il importa <strong>de</strong>s États-Unis l’école thérapeutique pour sou<strong>la</strong>ger<br />
et guérir les ma<strong>la</strong>dies, contrastant avec <strong>la</strong> posture <strong>de</strong> l’école française, qui dominait<br />
au Brésil, beaucoup plus encline à décrire les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Sampaio, un homme<br />
qui travail<strong>la</strong>it beaucoup, avait une connaissance médicale spectacu<strong>la</strong>ire et une position<br />
humaniste hors du commun. Sampaio était un homme d’une gran<strong>de</strong> culture. Je fus son<br />
premier disciple, imaginez ma chance. » 2<br />
Sebastião Sampaio (figure 5) naquit dans l’État <strong>de</strong> Sao Paulo et fit ses étu<strong>de</strong>s dans<br />
<strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> cet État. Il se pencha à l’origine vers l’ingénierie, car il était excellent<br />
en mathématiques. Mais sa mère, qui avait toujours voulu avoir un fils mé<strong>de</strong>cin,<br />
exerça son influence pour qu’il commençât <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’USP (1938),<br />
où il obtint son diplôme en 1943.<br />
Même étudiant, Sampaio travail<strong>la</strong> à <strong>la</strong> Ligue <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> syphilis, à une<br />
époque particulièrement difficile eu égard à <strong>la</strong> situation financière précaire <strong>de</strong> sa<br />
famille. Il se présenta au concours du département <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et il y<br />
fut embauché comme auxiliaire académicien. « Quand j’ai fini <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
je travail<strong>la</strong>is <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>ux ans avec les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> lèpre et <strong>de</strong> syphilis, alors<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie est <strong>de</strong>venue le chemin naturel à suivre. »<br />
Ce chemin s’é<strong>la</strong>rgit progressivement au point que Sebastião Sampaio <strong>de</strong>vint <strong>la</strong><br />
troisième gran<strong>de</strong> référence en matière <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Sao Paulo (les <strong>de</strong>ux autres<br />
étaient Adolpho Lin<strong>de</strong>mberg et Aguiar Pupo). « La chaire s’appe<strong>la</strong>it <strong>de</strong>rmatologie et<br />
syphiligraphie. Le Pr. Pupo aimait beaucoup travailler avec <strong>de</strong>s lépreux également.<br />
Lorsque j’ai eu fini mes étu<strong>de</strong>s en mé<strong>de</strong>cine, et comme <strong>la</strong> pratique obligatoire n’existait<br />
pas encore, le professeur a décidé que je <strong>de</strong>vais fréquenter l’unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
: c’est comme ça que j’appris <strong>la</strong> spécialité. »<br />
Grâce à une expérience en <strong>de</strong>rmatologie qui dura cinq ans, Sampaio <strong>de</strong>vint enseignant<br />
et obtint une bourse pour <strong>de</strong>venir assistant à <strong>la</strong> Mayo Clinic, aux États-Unis, le plus<br />
grand centre médical du pays à l’époque ; il y fit son résidanat entre 1951 et 1952, et<br />
poursuivit ensuite <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s en Europe.<br />
À <strong>la</strong> Mayo Clinic, Sampaio vit que les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s recevaient <strong>de</strong>s visites tous les jours et<br />
qu’ils bénéficiaient d’une assistance médicale efficace ; à son retour à Sao Paulo, il<br />
appliqua cette pratique, influençant plusieurs générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues brésiliens.<br />
« J’ai formé <strong>de</strong>s disciples, et mes disciples ont formé d’autres disciples », disait-il.<br />
Il fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association médicale brésilienne, du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et du Conseil régional <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, et membre <strong>de</strong> l’International<br />
Committee of Dermatology.<br />
Depuis sa chaire à l’USP, Sebastião Sampaio forma <strong>de</strong>s disciples répartis dans tout<br />
l’État <strong>de</strong> Sao Paulo, dans plusieurs États brésiliens et à l’étranger. La plupart <strong>de</strong> ses<br />
81<br />
Figure 5.<br />
Dr Sebastião Sampaio
PAULO R. CUNHA<br />
82<br />
disciples conservèrent un lien avec le maître, l’invitant pendant plusieurs décennies<br />
comme conférencier à <strong>de</strong>s rencontres et à <strong>de</strong>s journées ; sa seule présence donna du<br />
prestige aux réunions qu’il avait créées.<br />
Bernardino Antônio Gomes<br />
Auteur du premier livre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en portugais, il visita <strong>de</strong>ux fois le Brésil, en<br />
1797 et en 1817.<br />
José Francisco da Silva Lima<br />
José Francisco da Silva Lima, portugais <strong>de</strong> Vi<strong>la</strong>rinho, arriva à Salvador en 1840 et obtint<br />
son doctorat à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Bahia. Aux côtés <strong>de</strong> Wucherer et Paterson,<br />
ils mirent en p<strong>la</strong>ce à Bahia les premières étu<strong>de</strong>s sur les ma<strong>la</strong>dies tropicales.<br />
Adolpho Lin<strong>de</strong>mberg<br />
Originaire <strong>de</strong> Cabo Frío, il obtint son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro en 1896 et poursuivit sa spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à Paris. Il fut l’un <strong>de</strong>s<br />
pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, créant le premier service <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Sao Paulo à <strong>la</strong><br />
Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia.<br />
Paulo Parreiras Horta<br />
Le Carioca Paulo <strong>de</strong> Figueiredo Parreiras Horta naquit en 1884 ; il fut pharmacien<br />
avant <strong>de</strong> suivre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine au Brésil et <strong>de</strong> microbiologie à Paris. Il fut l’un<br />
<strong>de</strong>s plus grands mycologues brésiliens.<br />
João <strong>de</strong> Aguiar Pupo<br />
Pauliste d’Itatiba, diplômé en 1912 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, il<br />
encouragea <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> Sao Paulo.<br />
João Ramos e Silva<br />
Diplômé en 1918 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Praia Vermelha, à Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, Ramos e Silva fut réputé pour ses étu<strong>de</strong>s sur les ma<strong>la</strong>dies vénériennes et <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen. Il promut <strong>la</strong> première réunion <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues syphiligraphes<br />
au Brésil.<br />
Joaquim Mota<br />
Il fut l’un <strong>de</strong>s plus grands syphiligraphes brésiliens. Il obtint son diplôme à l’université<br />
du Brésil en 1916 et travail<strong>la</strong> à l’institut Oswaldo Cruz, au service médical <strong>de</strong><br />
l’armée, au Département national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et à l’Inspection <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes.<br />
Oswaldo Costa<br />
Dermatologue <strong>de</strong> Minas Gerais, il consacra sa thèse (1962) à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s kératoses<br />
palmop<strong>la</strong>ntaires ; il fit son résidanat à l’hôpital Saint-Louis, à Paris.
Domingos Barbosa da Silva<br />
En 1955, il fut désigné professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et chirurgie <strong>de</strong> Pará. Ses étu<strong>de</strong>s en <strong>de</strong>rmatologie tropicale furent déterminantes<br />
et il forma plusieurs générations <strong>de</strong> spécialistes.<br />
Eduardo Rabello<br />
Né à Barra Mansa (R.J.) en 1876, le <strong>de</strong>uxième prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD eut son doctorat<br />
en 1903 à <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. Disciple <strong>de</strong> l’école française, Rabello<br />
fréquenta le service <strong>de</strong> curiethérapie <strong>de</strong> l’hôpital Necker, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Degrais,<br />
acquérant une expérience en <strong>la</strong> matière. De retour au Brésil, il fonda en 1919 l’Institut<br />
d’électroradiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro avec Fernando Terra, qui intégra plus<br />
tard <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique. Il mourut le 8 août 1940.<br />
Francisco Eduardo Rabello<br />
Il succéda à son père, Eduardo Rabello, au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Ses contributions dans les<br />
domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen et <strong>la</strong> sarcoïdose<br />
furent originales (figure 6).<br />
Hil<strong>de</strong>brando Portugal<br />
Diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, sa gran<strong>de</strong> œuvre fut <strong>la</strong><br />
création du <strong>la</strong>boratoire d’histopathologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique, en 1926.<br />
Jorge <strong>de</strong> Oliveira Lobo<br />
Né à Recife en 1889, il obtint son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. Il<br />
travail<strong>la</strong> avec Olympio da Fonseca Filho et Arêa Leão à Manguinhos, et fut l’assistant<br />
d’Eduardo Rabello. De retour sur sa terre natale, il travail<strong>la</strong> à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong><br />
l’hôpital <strong>de</strong> Santo Amaro, marquant le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Pernambuco.<br />
Jorge <strong>de</strong> Oliveira Lobo utilisa son propre nom pour i<strong>de</strong>ntifier une ma<strong>la</strong>die provoquée par<br />
le champignon appelé Paracoccidioi<strong>de</strong>s loboi. Il décrivit aussi une nouvelle forme <strong>de</strong> b<strong>la</strong>stomycose,<br />
dont les lésions fongoï<strong>de</strong>s particulières ont leur niche écologique en Amazonie.<br />
Glynne Leite Rocha<br />
Originaire d’A<strong>la</strong>goas, à Maceió, il obtint son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Pernambuco<br />
en 1930. Il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> IASERJ pendant<br />
<strong>de</strong>s décennies.<br />
Demétrio Peryassú<br />
Né à Belém do Pará, diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1937, il étudia<br />
plusieurs syndromes <strong>de</strong>rmatologiques. Il possédait aussi <strong>de</strong> vastes connaissances en<br />
radiothérapie et en léprologie.<br />
Anuar Auad<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Le Pauliste Anuar Auad obtint son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong><br />
83<br />
Figure 6.<br />
Dr Francisco Eduardo<br />
Rabello
Figure 7.<br />
Dr Carlos<br />
da Silva Lacaz<br />
PAULO R. CUNHA<br />
84<br />
Janeiro en 1951. Il étudia longuement le pemphigus foliacé. En 1954, il assuma <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Pemphigus à Goiânia.<br />
Antônio Carlos Pereira Júnior<br />
Natif <strong>de</strong> Minas Gerais, <strong>de</strong> Juiz <strong>de</strong> Fora, diplômé en 1963 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université du Brésil, il fit son résidanat à l’hôpital Saint-Louis (Paris). Il est coauteur d’un<br />
livre sur l’herpès ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s MST adoptée dans le pays et à l’étranger.<br />
Norberto Belliboni<br />
Originaire <strong>de</strong> Camposapiero (Italie), il débarqua au Brésil en 1934. Il obtint son<br />
diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1949 à l’université <strong>de</strong> Sao Paulo. Il coordonna pendant dix ans <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie au cours expérimental <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Sao Paulo.<br />
Raymundo Martins Castro<br />
Diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’USP, il y fut également enseignant libre. Il suivit<br />
un cours <strong>de</strong> spécialisation en mé<strong>de</strong>cine tropicale en Allemagne et fonda en 1986 le<br />
centre d’étu<strong>de</strong>s Nico<strong>la</strong>u Maria Rossetti.<br />
Guilherme V. Curban<br />
Professeur libre à <strong>la</strong> FMUSP, il est l’auteur, avec Luiz M. Bechelli, du Compendio <strong>de</strong><br />
Dermatología [Précis <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie], livre <strong>de</strong> consultation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Carlos da Silva Lacaz<br />
Historien <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne, Lacaz fut professeur <strong>de</strong><br />
mycologie et <strong>de</strong> microbiologie à l’USP et fut à <strong>de</strong>ux reprises directeur <strong>de</strong><br />
sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. En 1959 il fonda l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale.<br />
Il est considéré comme l’un <strong>de</strong>s plus grands mycologues au mon<strong>de</strong><br />
(figure 7).<br />
Clóvis Bopp<br />
Antar Padilha-Gonçalves<br />
Il naquit à Santa Maria (RS) le 17 octobre 1913. Il fut chef du service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> jusqu’en 1984.<br />
Diplômé en 1937 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, il approfondit les étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong><br />
leishmaniose et en mycologie. Il travail<strong>la</strong> au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Gaffrée<br />
Guinle et au <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> Raimundo Aragão par <strong>la</strong> suite.<br />
Abrahão Rotberg<br />
Mondialement reconnu grâce à <strong>la</strong> doctrine <strong>de</strong> <strong>la</strong> marge Hansen sous sa forme anergique<br />
et du facteur N dans <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen, Rotberg étudia à Rio <strong>de</strong> Janeiro et<br />
obtint son diplôme en 1933 à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Sao Paulo. Il apporta ses<br />
connaissances sur <strong>la</strong> léprologie.
Alexandre Mello Filho<br />
Diplômé <strong>de</strong> l’école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, il fut admis à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong><br />
l’hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Municipal en 1948. Il enseigna à <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong>s sciences<br />
médicales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia pendant vingt ans.<br />
Antonio Delfina<br />
Diplômé en 1942 <strong>de</strong> l’école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, il se consacra pendant quarantecinq<br />
ans à l’institution ; il est l’auteur <strong>de</strong> plusieurs travaux scientifiques sur <strong>la</strong> spécialité.<br />
Antônio Souza Marques<br />
Né à Rio <strong>de</strong> Janeiro, il obtint son diplôme en 1960 à <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
et fit ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation au Cancer Hospital <strong>de</strong> Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie, aux États-Unis.<br />
Aurélio Ancona López<br />
Diplômé en 1937 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, il créa en<br />
1945 le service <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Municipal. Dans le cadre<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Croisa<strong>de</strong> Pro-Enfance, il fonda un centre d’éducation en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Jarbas Porto<br />
Originaire <strong>de</strong> Pernambuco <strong>de</strong> Caruaru, il obtint son diplôme à <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Assistant <strong>de</strong> Rabello et <strong>de</strong> Rubem David Azu<strong>la</strong>y, Porto fut admis à l’hôpital <strong>de</strong> los Servidores <strong>de</strong>l Estado<br />
et réalisa sa spécialisation au Michigan. Il fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Luiz Henrique Camargo Paschoal<br />
Diplômé à l’USP en 1960, il est actuellement titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’ABC.<br />
Luiz Marino Bechelli<br />
Diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’USP en 1933, il fut désigné mé<strong>de</strong>cin spécialiste<br />
du département <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. Il fut directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique Cocais et<br />
enseignant libre à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’USP. Il fut secrétaire du secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
<strong>de</strong> l’Organisation mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (OMS), en Suisse, pendant dix ans.<br />
Márcio Lobo<br />
Il créa <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à l’université fédérale <strong>de</strong> Pernambuco. La<br />
donovanose fut une <strong>de</strong> ses lignes <strong>de</strong> recherche.<br />
Nelson Guimarães Proença<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
En 1970, le Pr. Nelson Proença fonda l’Anuario Dermatológico Brasileño dans le but d’y<br />
rassembler <strong>de</strong>s travaux publiés dans <strong>de</strong>s revues appartenant à d’autres domaines. Il fut<br />
directeur <strong>de</strong> l’APM et l’AMB (Association pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et Association médicale brésilienne)<br />
et titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Sao Paulo.<br />
85
PAULO R. CUNHA<br />
86<br />
Neuza Dillon<br />
Diplômée <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et chirurgie <strong>de</strong> Belém do Pará, elle se spécialisa<br />
en <strong>de</strong>rmatologie à l’USP. En 1966, elle fut désignée professeur à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences<br />
médicales et biologiques <strong>de</strong> Botucatu, récemment créée. Elle y exerça bril<strong>la</strong>mment <strong>la</strong><br />
charge <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’à sa retraite.<br />
Ney Romitti<br />
Diplômé en 1958 <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, il fit un résidanat en Allemagne,<br />
où il publia 20 travaux scientifiques. Il fut professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> Santos. Il possè<strong>de</strong> une culture générale et <strong>de</strong>rmatologique notable.<br />
René Garrido Neves<br />
Diplômé en 1953 <strong>de</strong> <strong>la</strong> Faculté Fluminense <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, il fut l’assistant volontaire<br />
<strong>de</strong> João Ramos e Silva pendant treize ans. Il travail<strong>la</strong> au service <strong>de</strong> léprologie. Participant<br />
assidu <strong>de</strong>s réunions <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD, il fut responsable <strong>de</strong> l’achat du siège <strong>de</strong> l’entité.<br />
Maurício et Alice Casal Alchorne<br />
Né à Pesqueira (PE), Maurício se rendit à Recife afin <strong>de</strong> poursuivre ses étu<strong>de</strong>s secondaires<br />
et celles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> Pernambuco. Il effectua<br />
sa formation <strong>de</strong>rmatologique et le début <strong>de</strong> son parcours académique au HC/FMUSP.<br />
Depuis 1994, il est professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’UNIFESP/école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. C’est au<br />
HC qu’il fit connaissance d’Alice, originaire <strong>de</strong> Sao Paulo, une élève avec <strong>la</strong>quelle il se<br />
maria ; ils ont <strong>de</strong>ux enfants et quatre petits-enfants.<br />
Alice effectua son résidanat au HC/FMUSP ; elle est actuellement professeur adjoint et<br />
enseignante libre à l’UNIFESP/école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (<strong>de</strong>puis 1997).<br />
Tous <strong>de</strong>ux occupèrent différents postes au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD, comme <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
section régionale <strong>de</strong> Sao Paulo (Alice et Maurício) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD (Maurício).<br />
Rubem David Azu<strong>la</strong>y<br />
Né à Belém do Pará en 1917, il obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à <strong>la</strong> faculté Fluminense<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Pr. Parreiras Horta. Différents concours<br />
publics lui permirent d’occuper les postes <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> plusieurs<br />
universités, telles que celles <strong>de</strong> Pará, UFF, UERJ et UFRJ. Il fut aussi chargé <strong>de</strong> poursuivre<br />
les activités du pavillon historique Sao Miguel, lors du déménagement <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire et<br />
du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UFRJ vers l’hôpital universitaire, à Ilha do Fundão.<br />
Il travail<strong>la</strong> au début <strong>de</strong> son parcours avec Eduardo Rabello. Lié à <strong>la</strong> SBD <strong>de</strong>puis qu’il<br />
était étudiant, il fréquenta le pavillon Sao Miguel (financé au début <strong>de</strong>s années 30 par<br />
l’Organisation mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé pour <strong>de</strong>s cours internationaux sur <strong>la</strong> lèpre, mais<br />
transféré immédiatement vers <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’université du Brésil). Il<br />
était prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD lors du 50 e anniversaire <strong>de</strong> sa création ; il décida alors d’opérer<br />
quelques changements : « Les réunions existaient déjà, mais toutes se réalisaient à Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro. La plupart <strong>de</strong>s associés étaient natifs <strong>de</strong> Rio. Lorsque j’ai assumé <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce,<br />
j’ai fait modifier les statuts et commencé à promouvoir les réunions dans d’autres<br />
États, puisque j’envisageais <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sur le p<strong>la</strong>n national et pas seulement dans<br />
<strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. »<br />
Il fut à <strong>de</strong>ux reprises l’éditeur en chef <strong>de</strong>s Anais Brasileiros <strong>de</strong> Dermatologia, où il<br />
introduisit plusieurs innovations. Il fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association brésilienne <strong>de</strong> léprologie,
du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> l’International Society of Dermatology<br />
et <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. On lui octroya 13 prix pour ses mérites personnels<br />
et <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> ses travaux scientifiques: les médailles d’or Oswaldo Cruz,<br />
Antonio Pedro (trois fois) et Gaspar Viana, le prix Jorge Lobo, plusieurs p<strong>la</strong>quettes — trois<br />
nationales et une <strong>de</strong> <strong>la</strong> North American Clinical Dermatological Society. Azu<strong>la</strong>y est un <strong>de</strong>s<br />
auteurs les plus remarquables <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie Brésilienne.<br />
Rui Miranda<br />
Pilier <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Paraná, il fonda en 1960 le centre d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
Souza Araújo à l’université fédérale <strong>de</strong> Paraná, et <strong>la</strong> fondation Pro-Hansen en 1990.<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, il décrivit 5 nouvelles pathologies ; pour ce qui est<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen, il contribua à en améliorer <strong>la</strong> connaissance.<br />
Lucio Bakos<br />
Né en 1942 à Zadar — actuellement <strong>la</strong> Croatie mais territoire italien à l’époque —, il<br />
obtint son diplôme en 1966 à l’université fédérale <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> do Sul (UFRGS). Il fut<br />
Visiting Scho<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cambridge University en 1972-1973, travail<strong>la</strong>nt au Ad<strong>de</strong>nbrooke’s<br />
Hospital <strong>de</strong> Cambridge, dirigé par le Dr Arthur Rook. Il est professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’UFRGS <strong>de</strong>puis 1991.<br />
Sylvio Fraga<br />
Il reçut son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’ancienne université du Brésil en<br />
1953. Entre 1955 et 1956, il effectua son résidanat à Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie (U.S.A.). Il suivit le<br />
cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et pathologie au Armed Forces Institute of<br />
Pathology, à Washington. Il fut le cofondateur <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa<br />
Casa.<br />
João et Bernardo Gontijo<br />
Originaire <strong>de</strong> Minas Gerais, <strong>la</strong> famille Gontijo (le père, João B. Gontijo Assunção, et le<br />
fils, Bernardo Gontijo) regroupe <strong>de</strong>s personnalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie remarquables.<br />
João obtint son diplôme en 1947 à l’UFMG et réalisa son résidanat à l’hôpital Saint-Louis<br />
<strong>de</strong> Paris en 1948 et 1949. Grâce à un concours public, il fut nommé professeur adjoint<br />
et enseignant libre à l’UFMG. Il publia individuellement ou conjointement 24 travaux, et<br />
présenta près <strong>de</strong> 200 communications lors <strong>de</strong> congrès et <strong>de</strong> réunions au Brésil et à<br />
l’étranger. Bernardo, son fils, obtint son diplôme à l’UFMG et compléta son résidanat en<br />
<strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> l’USP ; il est actuellement professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UFMG. Tous <strong>de</strong>ux furent membres et prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD.<br />
Mário et Márcio Rutowitsch<br />
Márcio Rutowitsch est le fils du <strong>de</strong>rmatologue Mário Rutowitsch, qui fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> SBD en 1960. Márcio obtint son diplôme à l’université fédérale Fluminense et il est<br />
actuellement premier chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’HSE.<br />
Jorge José <strong>de</strong> Souza Filho<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Né à Florianópolis en 1937, il obtint son diplôme à l’université fédérale <strong>de</strong> Paraná en<br />
1964 et fut admis comme rési<strong>de</strong>nt en 1965 grâce à une bourse <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques<br />
87
PAULO R. CUNHA<br />
<strong>de</strong> Sao Paulo. En 1967, il retourna sur sa terre natale et se présenta au concours pour<br />
être maître auxiliaire à l’UFSC, où il <strong>de</strong>vint professeur titu<strong>la</strong>ire en 1990. Il fut l’un <strong>de</strong>s<br />
fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> régionale SC <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD et le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Réunion sudbrésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu à Florianópolis en 1981.<br />
■ La La <strong>de</strong>rmatologie Dermatologie dans les états dans les États<br />
88<br />
Ces générations vigoureuses, avec leur volonté <strong>de</strong> tracer <strong>de</strong>s nouveaux chemins,<br />
furent le résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> stimu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche scientifique que favorisèrent l’éducation<br />
<strong>de</strong>rmatologique renouvelée, l’arrivée <strong>de</strong> nouvelles spécialités dans d’autres régions<br />
du pays et l’action synergique <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD.<br />
En effet, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie s’é<strong>la</strong>rgissait. Dans les années 20 et 30, d’après Rabello<br />
Junior, « <strong>la</strong> chaire d’Antonio Aleixo (1884-1943) située à Belo Horizonte al<strong>la</strong>it marquer<br />
l’arrivée d’un nouveau centre d’étu<strong>de</strong>s dans le pays, avec <strong>de</strong>s travaux et <strong>de</strong>s nouvelles<br />
publications dans les secteurs jumeaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> vénéréologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> léprologie, dans<br />
lesquels se distinguaient Orsini <strong>de</strong> Castro (1892-1970) en <strong>de</strong>rmatologie et O. Diniz (1902-<br />
1966) en léprologie. Des travaux originaux <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure furent réalisés par Cl.<br />
<strong>de</strong> Castro, Oswaldo Costa (chaire <strong>de</strong> l’université fédérale) et Tancredo Furtado (chaire <strong>de</strong><br />
l’UFMG). » 3 Costa fut l’auteur d’une thèse réputée sur les acrokératoses (1960), tandis<br />
que Furtado en écrivit une sur <strong>la</strong> framboesia en 1955.<br />
Un grand centre <strong>de</strong>rmatologique s’instal<strong>la</strong> aussi à Juiz <strong>de</strong> Fora, avec Antônio Carlos<br />
Pereira et Carlos Adolfo Pereira. Entre 1922 et 1940, d’importants travaux brésiliens sur<br />
le pemphigus foliacé furent publiés, dont ceux <strong>de</strong> J.P. Vieira (1927) et Orsini <strong>de</strong> Castro<br />
(1940).<br />
Fondée en 1916, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Sao Paulo compta tout <strong>de</strong> suite une chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont le titu<strong>la</strong>ire fut Adolpho Lin<strong>de</strong>mberg (1872-1944), auteur <strong>de</strong> travaux<br />
pionniers sur <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire et le pemphigus foliacé. Son disciple,<br />
Nico<strong>la</strong>u Rossetti (1894-1956), fut plus tard le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, où il fut remp<strong>la</strong>cé par le léprologue et <strong>de</strong>rmatologue<br />
Abrahão Rotberg, auteur <strong>de</strong> célèbres travaux sur <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong> Mitsuda, <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong><br />
Montenegro et les angiites nécrotisantes. Rabello signale :<br />
Dans les années 30, J. Aguiar Pupo, disciple préféré d’Eduardo Rabello, al<strong>la</strong>it assumer<br />
<strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Sao Paulo, où se forma immédiatement<br />
une gran<strong>de</strong> école. Dans <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> <strong>la</strong> tradition brésilienne, Aguiar Pupo a<br />
dominé, grâce à <strong>de</strong>s travaux pionniers, <strong>la</strong> léprologie avec <strong>la</strong> même supériorité. En<br />
1957, Sebastião Sampaio, un jeune professeur <strong>de</strong> bonne formation histologique qui<br />
al<strong>la</strong>it stimuler les travaux dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure et <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau,<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> génétique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie immune, le remp<strong>la</strong>ça. À Sao Paulo se distingueraient<br />
d’autres éléments <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valeur comme H. Cerruti à Sorocaba, L.M. Bechelli<br />
et W. Pimenta à Ribeirão Preto, tous trois issus <strong>de</strong> l’école d’Aguiar Pupo.<br />
J’accor<strong>de</strong> une mention spéciale aux jeunes, parmi lesquels Ney Romiti, disciple <strong>de</strong><br />
Ramos e Silva, Marchionini et Raimundo Martins <strong>de</strong> Castro, initialement professeur<br />
à Campinas, où il fut l’élève <strong>de</strong> son célèbre père, le maître A. Martins <strong>de</strong> Castro<br />
(1885-1968), spécialiste en mycologie, en histopathologie et en roentgenthérapie 2 .<br />
Nous ne citons ici que quelques-uns <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues nationaux qui étudièrent avec<br />
les grands maîtres <strong>de</strong> l’étranger :<br />
1. Olympio da Fonseca Filho, Nico<strong>la</strong>u Rossetti et Abílio Martins <strong>de</strong> Castro travaillèrent<br />
avec Raymond Sabouraud à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> Paris.<br />
2. J. Luiz Miranda fut rési<strong>de</strong>nt à <strong>la</strong> Duke University, avec N.F. Conant.<br />
3. Eduardo Rabello fréquenta le service <strong>de</strong> curiethérapie <strong>de</strong> l’hôpital Necker, sous <strong>la</strong>
direction <strong>de</strong> Degrais ; <strong>de</strong> retour au Brésil, il fonda avec Fernando Terra l’Institut d’électroradiologie,<br />
qui intégrerait plus tard <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté nationale<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
4. Adolfo Lutz fit son résidanat en Suisse avec Paul Gerson Unna (1850-1929), le fondateur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mo<strong>de</strong>rne.<br />
5. Ney Romitti travail<strong>la</strong> à Munich avec Alfred Marchionini.<br />
6. Sebastião <strong>de</strong> Almeida Sampaio effectua son résidanat à <strong>la</strong> Mayo Clinic, à Rochester<br />
(USA).<br />
7. Newton Guimarães travail<strong>la</strong> à Barcelone avec Xavier Vi<strong>la</strong>nova.<br />
8. Joaquim Pereira da Mota (1894-1952) travail<strong>la</strong> à Paris avec Pautrier.<br />
9. Valdir Ban<strong>de</strong>ira (Recife) et René Garrido Neves (Niterói) firent leur résidanat à<br />
Buenos Aires, dans les services <strong>de</strong>s Prs Julio Borda et Jorge Abu<strong>la</strong>fia.<br />
La Société Brésilienne <strong>de</strong> Dermatologie (SBD)<br />
La séance <strong>de</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie commença le<br />
dimanche 4 février 1912 à 10 heures du matin, dans le pavillon Miguel Couto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa<br />
Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. 18 mé<strong>de</strong>cins, dont seulement 10 <strong>de</strong>rmatologues,<br />
y étaient présents ; 3 d’entre eux faisaient partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission organisatrice : Fernando<br />
Terra, Eduardo Rabello et Werneck Machado. Les Drs Moncorvo Filho, Alfredo<br />
Porto, Eduardo Magalhães, Adolfo Lutz, Víctor <strong>de</strong> Teive, Caetano <strong>de</strong> Menezes, Gaspar<br />
Viana, Leal Júnior, Oscar da Silva Araújo, Juliano Moreira, Paulo Parreiras Horta,<br />
Zopyro Gou<strong>la</strong>rt, Miguel Salles, Eduardo Jorge et Franco <strong>de</strong> Carvalho furent les autres<br />
fondateurs.<br />
La SBD est <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième entité au mon<strong>de</strong> en nombre d’associés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. La<br />
fête du Dermatologue fut instaurée en 2000 (5 février), visant à sa commémoration<br />
annuelle.<br />
Un débat scientifique très sérieux, <strong>la</strong> stimu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche (é<strong>la</strong>rgie par <strong>la</strong> suite<br />
aux nouvelles générations qui étudiaient <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine), <strong>la</strong> connaissance et <strong>la</strong> vulgarisation<br />
<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>rmatologiques dans les autres régions du pays, l’esprit accueil<strong>la</strong>nt et<br />
attentif <strong>de</strong>s dirigeants et le souci <strong>de</strong> poser les bases définitives <strong>de</strong> cette activité caractérisèrent<br />
les treize premières années d’intervention <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD.<br />
La SBD connut <strong>de</strong>ux longues gestions au cours <strong>de</strong> son histoire: celle <strong>de</strong> Fernando<br />
Terra, qui dura treize ans, et celle d’Eduardo Rabello, qui <strong>la</strong> présida pendant quinze ans<br />
sans interruption.<br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDB<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
■ La Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SBD)<br />
Les <strong>de</strong>rmatologues qui exercèrent <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD furent les suivants:<br />
Fernando Terra (1912) ; Eduardo Rabello (1925) ; Oscar Silva Araújo (1941) ; Joaquim<br />
Mota (1942) ; João Ramos e Silva (1944) ; A.F. Da Costa Jr. (1946) ; Hil<strong>de</strong>brando Portugal<br />
(1948) ; Francisco Eduardo Rabello (1950) ; Demétrio Peryassu (1951) ; Edgard Drolhe da<br />
Costa (1953) ; Luis Campos Mello (1955) ; Antar Padilha-Gonçalves (1957) ; Mário Rutowitsch<br />
(1959) ; Rubem David Azu<strong>la</strong>y (1961) ; Glynne Leite Rocha (1963) ; J. Aguiar Pupo<br />
(1964) ; João Ramos e Silva (1965) ; Domingos Barbosa da Silva (1966) ; Antônio Carlos<br />
Pereira (1967) ; Rui Noronha Miranda (1968) ; Jorge Lobo (1969) ; Anuar Auad (1970);<br />
Clóvis Bopp (1971); Rubem David Azu<strong>la</strong>y (1972); Tancredo Furtado (1973); Sebastião <strong>de</strong><br />
Almeida Prado Sampaio (1974) ; Jarbas Anacleto Porto (1975) ; José Pessoa Men<strong>de</strong>s<br />
(1976) ; Walter Moura Cantídio (1977) ; João Batista Gontijo (1978) ; Newton Guimarães<br />
(1980) ; Raymundo Martins Castro (1981) ; Márcio Lobo Jardim (1982) ; José Serrya<br />
(1983) ; Jorge José <strong>de</strong> Souza Filho (1984) ; Luiz Carlos Cucé (1985) ; Divino Rassi (1986);<br />
89
Figure 8.<br />
Commission directive<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD (2000-<br />
2001). De gauche à<br />
droite (assis): María<br />
Lour<strong>de</strong>s Viegas,<br />
secrétaire générale ;<br />
Fernando Augusto <strong>de</strong><br />
Almeida, prési<strong>de</strong>nt ;<br />
Márcio Santos<br />
Rutowitsch, viceprési<strong>de</strong>nt<br />
; (<strong>de</strong>bout) :<br />
Macedo Paschoal,<br />
<strong>de</strong>uxième secrétaire ;<br />
Beatriz Moritz Trope,<br />
trésorière ; Paulo<br />
Rowilson, secrétaire<br />
PAULO R. CUNHA<br />
90<br />
René Garrido Neves (1987); César Bernardi (1988); Luiz Henrique<br />
C. Paschoal (1989) ; Orcanda Andra<strong>de</strong> Patrus (1990) ; Antonio<br />
Carlos Pereira Junior (1991) ; Jesús Rodrígues Santamaría<br />
(1992) ; José Eduardo Costa Martins (1993) ; Arival Cardoso <strong>de</strong><br />
Brito (1994) ; Sarita Martins (1995) ; Iphis Campbell (1996) ; C<strong>la</strong>risse<br />
Zaitz (1997) ; Alberto Eduardo Cox Cardoso (1998) ; Maurício<br />
Mota <strong>de</strong> Ave<strong>la</strong>r Alchorne (1999) ; Bernardo Gontijo (2000) ;<br />
Fernando Augusto <strong>de</strong> Almeida (2001) (figure 8) ; Márcio Rutowitsch<br />
(2003) et Sinésio Talhari (2005).<br />
Dans les années 90, trois femmes présidèrent <strong>la</strong> Société brésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie : Orcanda Andra<strong>de</strong> Patrus (1990-1991),<br />
Sarita Martins (1995-1996) et C<strong>la</strong>risse Zaitz (1997-1998).<br />
Le siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDB. Les Anais Brasileiros <strong>de</strong> Dermatologia.<br />
La bibliothèque. Le premier congrès<br />
La SDB et plusieurs secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et syphiligraphique furent<br />
transférés en 1932 au pavillon Sao Miguel, où fut inaugurée <strong>la</strong> bibliothèque <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique<br />
(20 octobre 1933). Vers <strong>la</strong> moitié du XX e siècle, cette bibliothèque possédait déjà le plus<br />
grand patrimoine <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité en Amérique Latine. En 1987, René Garrido Neves<br />
obtint <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD en poursuivant une mission: doter l’entité d’un siège<br />
propre, acheté avenue Nilo Peçanha, abandonnant l’ancien siège du pavillon Sao Miguel.<br />
Eduardo Rabello fut l’éditeur en chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> première édition <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue bimestrielle<br />
Anais Brasileiros <strong>de</strong> Dermatologia en 1925 (figure 9).<br />
En 1985 réapparaît le bulletin <strong>de</strong> Nouvelles SBD, remp<strong>la</strong>cé en 1996 par le Diario <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dermatología Actual, <strong>de</strong> meilleure allure, et finalement par le Diario <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD.<br />
Du 26 au 28 septembre 1944, <strong>la</strong> première réunion <strong>de</strong>s spécialistes brésiliens en <strong>de</strong>rmatoses<br />
syphiligraphiques eut lieu dans le pavillon Sao Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia<br />
<strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro; à partir <strong>de</strong> 1969, ces réunions <strong>de</strong>vinrent congrès (figure 10).<br />
Le cinquantenaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDB<br />
La SBD commémora ses 50 ans en 1962, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Rubem David Azu<strong>la</strong>y.<br />
Une déc<strong>la</strong>ration publique, dans <strong>la</strong>quelle on reconnaissait l’expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans tout le Brésil, fut alors présentée. Cette expansion ouvrit le chemin aux professionnels<br />
<strong>de</strong>s autres États, leur permettant ainsi d’occuper <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> societé. La désignation<br />
<strong>de</strong> Ramos e Silva comme membre du CID (Comité international <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie) marqua également <strong>la</strong> décennie. Ultérieurement, Antar Padilha-Gonçalves,<br />
Sebastião Sampaio et Márcia Ramos e Silva furent également désignés membres du CID.<br />
En 1971, le rayon d’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD fut é<strong>la</strong>rgi au cours du Congrès brésilien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> Porto Alegre présidé par Clóvis Bopp, en tenant compte <strong>de</strong>s intérêts<br />
éthiques, sociaux et économiques <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues brésiliens. Bopp fut aussi le principal<br />
organisateur <strong>de</strong>s réunions régionales appelées Lignes Sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne,<br />
actuellement Journées sud-brésiliennes, qui rassemblent les spécialistes <strong>de</strong> Rio<br />
Gran<strong>de</strong> do Sul, Santa Catarina et Paraná.<br />
Le 90 e anniversaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDB<br />
La commémoration du 90 e anniversaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD revint au Pr.<br />
Fernando Augusto <strong>de</strong> Almeida, prési<strong>de</strong>nt élu <strong>de</strong> l’époque. Ce remarquable spécialiste,<br />
dont <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> doctorat à <strong>la</strong> USP traitait du prurigo d’Hebra, est un <strong>de</strong>s plus grands<br />
connaisseurs <strong>de</strong>s tumeurs cutanées, notamment le mé<strong>la</strong>nome. Il est également l’un <strong>de</strong>s
fondateurs et le premier prési<strong>de</strong>nt du Groupe brésilien d’étu<strong>de</strong> du mé<strong>la</strong>nome (GBM). Le<br />
projet Pro-Mémoire, coordonné par le Pr. Dr Paulo Cunha (figure 11) et dont le but est<br />
<strong>de</strong> protéger l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Brésil à travers <strong>de</strong>s livres, <strong>de</strong>s documents et<br />
<strong>de</strong>s images, fut encouragé sous sa direction. L’édition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
en Brasil [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Brésil], une compi<strong>la</strong>tion agréable <strong>de</strong> photos et<br />
<strong>de</strong> textes <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité au Brésil <strong>de</strong>puis les origines, fut le premier travail accompli.<br />
Son passage fut également remarqué en raison <strong>de</strong> sa gestion professionnelle <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
SBD et <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>n financier qu’elle reçut.<br />
La SBD 2003-2004<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières années, <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie centralisa<br />
les actions institutionnelles et politiques visant à <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Avec<br />
l’Association médicale brésilienne, elle participa activement au mouvement national <strong>de</strong>stiné<br />
à mettre en p<strong>la</strong>ce une nouvelle liste plus juste d’honoraires médicaux, employée<br />
dans tout le pays. Elle participa également aux rencontres pour repousser <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
nouvelles écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et les réunions sur le projet <strong>de</strong> loi sur <strong>la</strong> pratique médicale ;<br />
elle <strong>de</strong>manda aux spécialistes d’intégrer <strong>la</strong> chambre <strong>de</strong>s produits et <strong>de</strong>s procédures<br />
esthétiques du Conseil fédéral <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Par le biais <strong>de</strong> ses départements spécialisés, elle travail<strong>la</strong> intensément à <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong> manuels <strong>de</strong> conduite orientant les mé<strong>de</strong>cins sur les techniques et les procédures utilisées<br />
dans <strong>la</strong> spécialité. Les commissions spécialisées inspectent toujours les services <strong>de</strong><br />
résidanat accrédités, garantissant ainsi <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans le pays. Un groupe <strong>de</strong> travail, formé par les directions <strong>de</strong> services accrédités et les<br />
commissions d’enseignement, accomplit un travail important : leurs scientifiques et leurs<br />
spécialistes redéfinirent le programme minimal d’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne,<br />
énoncèrent les nouvelles normes pour l’accréditation <strong>de</strong>s services spécialisés<br />
(en leur proposant ledit programme) et formulèrent <strong>de</strong>s propositions visant au perfectionnement<br />
<strong>de</strong>s critères d’évaluation pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste.<br />
Pour connaître le cadre où travaillent les <strong>de</strong>rmatologues brésiliens, et <strong>la</strong> situation<br />
réelle <strong>de</strong>s spécialistes dans les différentes régions du pays, <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
réalisa une enquête qui traça le profil <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues du Brésil. Sur <strong>la</strong> base<br />
<strong>de</strong>s données collectées, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD, le Dr Marcio Rutowitsh, rencontra <strong>de</strong>s<br />
91<br />
Figure 9.<br />
Anais Brasileiros <strong>de</strong><br />
Dermatologia.<br />
Année 1940<br />
Figure 10.<br />
IIe Réunion annuelle<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatosyphiligraphes<br />
brésiliens à Belo<br />
Horizonte (1945)
Figure 11.<br />
Pr. Dr Paulo Cunha<br />
Figure 12. Première<br />
commission<br />
d’accréditation du TSD<br />
(28 octobre 1967) à<br />
Juiz <strong>de</strong> Fora. De<br />
gauche à droite :<br />
Pr. Rubem D. Azu<strong>la</strong>y,<br />
Rui Miranda,<br />
Sebastiao Sampaio,<br />
Tancredo Furtado et<br />
Clóvis Bopp<br />
PAULO R. CUNHA<br />
92<br />
jeunes possédant moins <strong>de</strong> dix ans <strong>de</strong> formation pour discuter <strong>de</strong>s perspectives <strong>de</strong> <strong>la</strong> profession,<br />
favorisant <strong>de</strong> cette manière l’intervention <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD dans <strong>la</strong> défense du marché<br />
du travail.<br />
En même temps, <strong>la</strong> SBD promut une révision <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue Anais Brasileiros <strong>de</strong> Dermatologia<br />
dans le but <strong>de</strong> réorganiser sa base <strong>de</strong> données, Ín<strong>de</strong>x Medicus/Medline.<br />
Le titre <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie<br />
La SBD est considérée comme une entité d’utilité publique <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> loi n o 1.270 <strong>de</strong><br />
1950. Vingt-trois ans passèrent entre <strong>la</strong> 1 re Réunion <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>de</strong>rmatologiesyphiligraphie<br />
brésiliens (1944) et un autre grand événement <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’entité<br />
(1967) : l’examen <strong>de</strong>s premiers professionnels pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie,<br />
à Juiz <strong>de</strong> Fora. Les Prs Tancredo Furtado, Clóvis Bopp, Rubem David Azu<strong>la</strong>y,<br />
Rui Noronha <strong>de</strong> Miranda et Sebastião Sampaio (délégué auprès <strong>de</strong> l’AMB) passèrent ce<br />
premier examen (figure 12).<br />
Le 39 e examen pour <strong>de</strong>venir spécialiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD eut lieu en 2005 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
du Pr. Dr Paulo R. Cunha.<br />
Services accrédités par <strong>la</strong> SDB<br />
Les services accrédités par <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont au nombre <strong>de</strong><br />
soixante dans tout le pays, prouvant le bon niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité au Brésil: outre <strong>de</strong>s soins<br />
étendus prodigués à <strong>de</strong>s millions <strong>de</strong>s patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées, ils offrent<br />
204 postes vacants annuels pour le résidanat, <strong>la</strong> spécialisation, <strong>la</strong> maîtrise et le doctorat.<br />
Unités régionales<br />
NORD-NORD-EST<br />
Bahia<br />
Bahia, berceau <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans le pays, possè<strong>de</strong> actuellement <strong>de</strong>ux services<br />
habilités par <strong>la</strong> SBD : celui <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques (UFBA) et celui <strong>de</strong> l’hôpital Santa<br />
Isabel <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Bahia <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et santé publique.<br />
La chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées et syphilitiques fut fondée en 1884,<br />
Alexandre Evangelista <strong>de</strong> Castro Cerqueira en étant le titu<strong>la</strong>ire; elle <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> clinique
<strong>de</strong>rmatologique en 1893. À partir <strong>de</strong> 1915, Artur da Silva Leitão, F<strong>la</strong>viano da Silva, Otávio<br />
Garcez <strong>de</strong> Aguiar, Newton Alves Guimarães, Nei<strong>de</strong> Ferraz et Ênio Ribeiro Maynard<br />
Barreto <strong>la</strong> dirigèrent successivement.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques comporte trois salles pour le<br />
public et une salle <strong>de</strong> chirurgie ambu<strong>la</strong>toire. L’infirmerie dispose <strong>de</strong> quatre lits et d’une<br />
salle annexe pour les réunions. Malgré l’espace réduit, le cabinet externe <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
est le <strong>de</strong>uxième espace <strong>de</strong> l’hôpital en quantité <strong>de</strong> patients; cette situation changera certainement<br />
avec le déménagement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie vers le pavillon Pr. Magalhães Neto.<br />
Au cours <strong>de</strong>s trois <strong>de</strong>rnières années, les rési<strong>de</strong>nts réussirent leurs étu<strong>de</strong>s à quasiment<br />
100 %. Les ma<strong>la</strong>dies tropicales constituent le domaine <strong>de</strong> recherche principal du service.<br />
Amazonas<br />
Installé dans l’État d’Amazonas, l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale et vénéréologie<br />
Alfredo da Matta, consacré <strong>de</strong>puis 1955 à l’enseignement, <strong>la</strong> recherche, <strong>la</strong> prévention et<br />
le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, est le centre <strong>de</strong> référence en ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles (MST) et en ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen. Son chef est le Pr. Sinésio<br />
Talhari (prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD en 2005-2006).<br />
Initialement <strong>de</strong>stiné à soigner les patients atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, l’institut Alfredo da<br />
Matta é<strong>la</strong>rgit son action vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 70 à d’autres <strong>de</strong>rmatoses. Depuis 1981,<br />
son propre <strong>la</strong>boratoire effectue <strong>la</strong> sérologie pour détecter le virus HIV.<br />
L’hôpital universitaire Getúlio Vargas, <strong>de</strong> l’université d’Amazonas, est un autre hôpital<br />
<strong>de</strong> référence, sous <strong>la</strong> coordination du Dr Jonas Ribas.<br />
Pará<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
L’institut Evandro Chagas et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
L’institut Evandro Chagas (IEC) fut créé le 11 novembre 1936, par le décret 2346 du<br />
gouvernement <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Pará. En 1942, il rejoignit le service spécial <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
publique <strong>de</strong> l’époque, <strong>la</strong> fondation Oswaldo Cruz, <strong>la</strong> Fondation nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, le<br />
secrétariat <strong>de</strong> vigi<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.<br />
Les objectifs basiques du IEC sont : a) <strong>de</strong>s recherches en sciences biologiques, mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale et environnement ; b) <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> vigi<strong>la</strong>nce dans <strong>la</strong> santé.<br />
Les recherches en cours sur <strong>de</strong>s agents étiologiques <strong>de</strong> certaines ma<strong>la</strong>dies présentant<br />
<strong>de</strong>s manifestations cutanées se rapportent à :<br />
- Virologie : rubéole, rougeole, parvovirus B19, herpes simples (1 et 2), herpes virus<br />
6, 7 et 8, virus <strong>de</strong> Epstein Barr, HTLV et les entérovirus proprement dits (coxsackie et<br />
echo).<br />
- Arbovirologie: fièvres hémorragiques, <strong>de</strong>ngue, oropouche, mayaro et le syndrome hémorragique<br />
<strong>de</strong> Altamira; les trois premiers agents associés aux tableaux exanthématiques.<br />
- Bactériologie et mycologie : Mycobacterium leprae et les recherches comprenant<br />
les <strong>de</strong>rmatophytes (à moindre échelle).<br />
- Parasitologie : leishmaniose et agents déterminants <strong>de</strong> « pathologies exotiques »<br />
(voir <strong>de</strong>scription plus loin).<br />
Une nouvelle ma<strong>la</strong>die fut décrite dans les années 70 : le syndrome hémorragique <strong>de</strong><br />
Altamira, essentiellement le purpura thrombocytopénique associé à <strong>la</strong> piqûre du moustique<br />
Simulium amazonicum ou pium. Cette étu<strong>de</strong>, réalisée par l’équipe du Dr Francisco<br />
Pinheiro, fut publiée dans The Lancet, un journal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> notoriété.<br />
Dans les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 2000, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire et épidémiologiques<br />
furent mises en p<strong>la</strong>ce : elles comprenaient les herpes virus humains <strong>de</strong> type<br />
7 et 8, respectivement exanthème critique et sarcome <strong>de</strong> Kaposi. Ces initiatives furent<br />
coordonnées par le Dr Ronaldo Barros <strong>de</strong> Freitas.<br />
93
PAULO R. CUNHA<br />
94<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et syphiligraphique fut créée en 1922 pour <strong>la</strong><br />
4 e année du cours médical <strong>de</strong> l’ancienne faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> Pará,<br />
dont <strong>la</strong> spécialité était dirigée par le Pr. Manuel Ferreira dos Santos Bastos. En 1951, le<br />
Pr. Domingos Barbosa da Silva fut nommé titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, et il reprit cette fonction<br />
en 1955 ; il fut également chargé pendant plusieurs années <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction du département<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, où <strong>de</strong> nombreuses générations <strong>de</strong> spécialistes reçurent leur<br />
formation.<br />
Le département <strong>de</strong> pathologie tropicale, service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />
fédérale <strong>de</strong> Pará — dont le chef est le Dr Arival Cardoso <strong>de</strong> Brito, ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> SBD —, propose <strong>de</strong>ux cours, dans <strong>de</strong>s immeubles situés dans les dépendances <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fondation Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Pará. Les salles ambu<strong>la</strong>toires sont au nombre<br />
<strong>de</strong> huit, et il dispose également d’un auditorium, d’un mini-auditorium pour <strong>la</strong> spécialisation,<br />
d’un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie, d’un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie, <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
salles chirurgicales, d’une salle <strong>de</strong> premiers secours, d’une salle d’infirmerie, d’une<br />
pharmacie, d’une bibliothèque, d’un secrétariat et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s salles d’attente<br />
pour les patients.<br />
Le groupe <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’UFPA est actuellement constitué <strong>de</strong><br />
13 enseignants travail<strong>la</strong>nt dans divers domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche : les nouveaux traitements<br />
chimiothérapiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Jorge Lobo, <strong>la</strong> léprologie et <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
les mycoses superficielles et profon<strong>de</strong>s avec imidazolés et l’utilisation <strong>de</strong> nouveaux composés<br />
en ectoparasitose.<br />
Pernambuco<br />
À Pernambuco, les services habilités par <strong>la</strong> SBD sont l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> l’université<br />
fédérale — dont le chef <strong>de</strong> service est le Pr. Josemir Belo dos Santos —, l’hôpital Santo<br />
Amaro — le chef <strong>de</strong> service étant le Pr. Itamar Belo dos Santos — et l’hôpital universitaire<br />
Oswaldo Cruz (le Pr. Dr Emmanuel Rodrigues <strong>de</strong> França en est le chef <strong>de</strong> service).<br />
Ceará<br />
Fondé en 1975, l’actuel centre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dona Libânia, du secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santé <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Ceará, est le centre <strong>de</strong> référence étatique et macro-régional en léprologie.<br />
Il se consacra pendant vingt ans au contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> léprologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose ;<br />
<strong>de</strong> nos jours, il inclut également le soin, <strong>la</strong> recherche et l’enseignement. Il comprend les<br />
services <strong>de</strong> léprologie, <strong>de</strong> leishmaniose, du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, <strong>de</strong>s MST, d’allergies cutanées,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>de</strong> tuberculose et<br />
d’autres <strong>de</strong>rmatoses. Le Dr Heitor <strong>de</strong> Sá Gonçalves, <strong>de</strong>uxième secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD pour<br />
<strong>la</strong> gestion 2005-2006, en est le directeur général ; le Dr Maria Araci Pontes Aires est le<br />
chef du service.<br />
En 2003, <strong>la</strong> SDB octroya une nouvelle certification à l’hôpital universitaire Walter<br />
Cantídio, dont le chef <strong>de</strong> service est le Dr José Wilson Acioly Filho.<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Norte<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, situé à l’hôpital Onofre Lopes<br />
<strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> do Norte, sous <strong>la</strong> coordination du Dr Pedro<br />
Bezerra da Trinda<strong>de</strong> Neto, dispose d’un espace propre à l’intérieur <strong>de</strong> l’hôpital : six<br />
cabinets pour <strong>de</strong>s soins ambu<strong>la</strong>toires, <strong>de</strong>ux salles équipées pour <strong>la</strong> chirurgie et <strong>la</strong> cryochirurgie,<br />
une salle <strong>de</strong> cosmétologie, un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie, une salle <strong>de</strong> réunions,<br />
une unité <strong>de</strong> photothérapie, une salle <strong>de</strong> premiers secours et une infirmerie comportant<br />
six lits. Habilité en 1999 par <strong>la</strong> SBD, on y donne <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong>s cours<br />
pratiques et théoriques pour les élèves <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> septième année ; on y forme aussi<br />
dans <strong>la</strong> théorie et dans <strong>la</strong> pratique les mé<strong>de</strong>cins qui soignent dans <strong>la</strong> clinique et les élèves<br />
du doctorat en mé<strong>de</strong>cine. Pour les stages autorisés par le ministère <strong>de</strong> l’Éducation
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture (MEC), le service propose <strong>de</strong>ux postes vacants par an. Au cours <strong>de</strong>s cinq<br />
<strong>de</strong>rnières années, 91 % <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts réussirent l’examen pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD.<br />
On réalise dans ce service <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong>s travaux scientifiques dans<br />
le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> géno<strong>de</strong>rmatose bulleuse, spécifiquement le pemphigus chronique familier<br />
bénin, sujet <strong>de</strong> <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> doctorat du Pr. Pedro Bezerra da Trinda<strong>de</strong> Neto. On y réalise<br />
également <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s liées à l’épidémiologie du mé<strong>la</strong>nome à Rio Gran<strong>de</strong> do Norte et<br />
à <strong>la</strong> cytologie appliquée au diagnostic <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées, sujet <strong>de</strong> <strong>la</strong> thèse du Pr. Thomas<br />
<strong>de</strong> Aquino Paulo Filho.<br />
Sergipe<br />
À Sergipe, l’hôpital universitaire est le seul habilité par <strong>la</strong> SBD ; son chef <strong>de</strong> service<br />
est le Pr. Pedro Menezes Portugal.<br />
A<strong>la</strong>goas<br />
La <strong>de</strong>rmatologie fut pratiquée dans <strong>la</strong> clinique privée à partir <strong>de</strong> 1940, <strong>de</strong>puis l’intervention<br />
pionnière <strong>de</strong>s jeunes mé<strong>de</strong>cins Aldo <strong>de</strong> Sá Cardoso (élève <strong>de</strong> Jorge Lobo à<br />
Recife, diplômé en 1938) et A<strong>de</strong>rbal Loureiro Jatobá.<br />
Quelques années plus tard, Jorge Duarte Quinte<strong>la</strong> Cavalcanti commença lui aussi à<br />
exercer à Maceió. L’enseignement médical dans cet État fut établi le 5 mars 1951, et le<br />
Dr Aldo Cardoso fut élu professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie. Une<br />
fois <strong>la</strong> faculté créée, d’autres mé<strong>de</strong>cins y obtinrent leur diplôme, tels que Zirelli Valença<br />
— qui décrivit le signal <strong>de</strong> Zirelli — et Nehemias <strong>de</strong> Alencar.<br />
Suite à <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>s sciences médicales d’A<strong>la</strong>goas (le 15 mars 1970), <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut mise en p<strong>la</strong>ce par le Pr. Aldo Cardoso ; son assistant, le Dr<br />
Alberto Eduardo Cox Cardoso, fut élu titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite chaire ultérieurement.<br />
Brasilia<br />
L’actuel service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Brasilia (HUB) naquit en<br />
1980 <strong>de</strong> <strong>la</strong> fusion entre le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> los Servidores <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Unión (HSU), <strong>de</strong> l’IPASE (passé plus tard dans l’INAMPS) et du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital école <strong>de</strong> l’unité intégrée <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> Sobradinho (UISS), <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
Brasilia.<br />
Au sein <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux institutions, dans les services d’origine, nous distinguons les<br />
Drs Iphis Campbell et G<strong>la</strong>dys Campbell (initiateurs), Roberto Doglia Azambuja, Rosicler<br />
Álvares et Carmélia Matos Reis (HSU) et le Pr. Raimunda Nonata Ribeiro Sampaio (initiatrice),<br />
ainsi que Rosicler Aíza Álvares (UISS). Dans le cas <strong>de</strong> l’HUB, on peut citer les<br />
Drs Antônio <strong>de</strong> Pádua, Ana Maria Costa Pinheiro, Ribeiro <strong>de</strong> Pau<strong>la</strong> et Gerson Pena — ce<br />
<strong>de</strong>rnier associé au noyau <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> l’UNB et prési<strong>de</strong>nt du 60 e Congrès <strong>de</strong> Dermatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD (Brasilia 2005). Il y a actuellement dix <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> l’HUB.<br />
L’unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> recherche en leishmaniose tégumentaire <strong>américaine</strong>, créée<br />
par le Pr. Raimunda (également chef <strong>de</strong> service), encouragée par le Pr. Philip Davis<br />
Mars<strong>de</strong>n (in memoriam) et qui fonctionnait <strong>de</strong>puis 1975 à l’UISS-UNB, fut transférée à<br />
l’HUB, tout en conservant <strong>la</strong> même ligne <strong>de</strong> recherche. Peu après, le Pr. Rosicler et le<br />
Dr Iphis créèrent l’unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> pemphigus, tandis que celles <strong>de</strong> léprologie, <strong>de</strong><br />
cryochirurgie, <strong>de</strong> mycose, <strong>de</strong> psoriasis, <strong>de</strong> vieillissement cutané, <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
et <strong>de</strong> tumeurs cutanées furent établies et/ou coordonnées par les Drs Rosicler<br />
Álvares, Carmélia, G<strong>la</strong>dyz, Izelda et Ana. En février 1999 fut créée l’unité <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles (à l’initiative du Pr. Raimunda Nonata Ribeiro Sampaio), à<br />
caractère multidisciplinaire et avec sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> gynécologie, <strong>de</strong><br />
proctologie et d’urologie. Au total, 14 400 patients atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau sont<br />
soignés par an.<br />
95
PAULO R. CUNHA<br />
96<br />
La <strong>de</strong>rmatologie en tant que spécialité fut officiellement créée en 1971 par l’UNB, mais<br />
ce ne fut qu’à partir <strong>de</strong> 1974 qu’elle fonctionna indépendamment <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique médicale.<br />
Son enseignement comprend un nombre d’heures total qui correspond à quatre crédits. Le<br />
résidanat, créé sur le modèle du HSE <strong>de</strong> Rio, débuta en 1974, le Dr Izelda Costa en étant<br />
le premier rési<strong>de</strong>nt. Jusqu’à présent, trente-quatre rési<strong>de</strong>nts et dix-neuf stagiaires ont obtenu<br />
leur diplôme dans ce service. Le résidanat <strong>de</strong> l’actuel HUB est également orienté vers<br />
<strong>la</strong> recherche, et <strong>la</strong> présentation d’une monographie à <strong>la</strong> fin du cours est une condition requise<br />
pour obtenir le diplôme. Tous les rési<strong>de</strong>nts présentent leurs travaux aux annales <strong>de</strong>s<br />
congrès; 90 % d’entre eux publient un ou plusieurs travaux scientifiques pendant le résidanat.<br />
Dans les années 90, grâce à <strong>la</strong> création du diplôme <strong>de</strong> spécialiste en sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
santé, les étudiants en maîtrise et en doctorat commencèrent à s’intéresser à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
: huit élèves ont obtenu leur maîtrise, huit <strong>la</strong> préparent actuellement et un prépare<br />
son doctorat. Des projets en cours visent à améliorer l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
le résidanat et <strong>la</strong> spécialisation stricto sensu.<br />
Goiás<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut ouverte à l’université fédérale <strong>de</strong> Goiás grâce aux<br />
Prs Anuar Auad, Rodovalho Men<strong>de</strong>s Domenici et Van<strong>de</strong>rli Dutra aujourd’hui défunts.<br />
Divino Miguel Rassi et Paulo Cezar Borges furent admis en 1967 et prirent leur retraite<br />
au cours <strong>de</strong>s années 90. Aiçar Chaul, Lia Cândida Miranda <strong>de</strong> Castro et Hugo Junqueira<br />
les rejoignirent dans les années 1970.<br />
Le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie fut créé en 1978 et immédiatement admis par <strong>la</strong> SBD;<br />
les Drs Anuar Auad, Divino Miguel Rassi et Paulo Cezar Borges et Aiçar Chaul (dès 1997)<br />
dirigèrent l’institution. Jusqu’en 2002, 80 mé<strong>de</strong>cins, dont <strong>la</strong> plupart obtinrent le diplôme<br />
<strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD, suivirent les <strong>de</strong>ux années <strong>de</strong> résidanat.<br />
Trois prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sortirent du<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Goiás :<br />
Anuar Auad (1970), Divino Miguel Rassi (1987) et Lia Cândida Miranda <strong>de</strong> Castro, les<br />
<strong>de</strong>ux premiers étant aussi prési<strong>de</strong>nts nationaux <strong>de</strong> l’entité, selon les normes <strong>de</strong> l’époque<br />
qui ne séparaient pas les attributions <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD et celles du congrès.<br />
Minas Gerais<br />
La Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Belo Horizonte fournit les services dont avait besoin<br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Minas Gerais, fondée en 1914. La clinique<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était alors dirigée par Antônio Aleixo, qui fonda en 1917 l’infirmerie<br />
et <strong>la</strong> clinique pour hommes, tandis qu’Olyntho Orsini était le chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique<br />
pour femmes.<br />
À partir du transfert <strong>de</strong> l’unité ambu<strong>la</strong>toire vers un immeuble propre en 1944, <strong>la</strong> clinique<br />
<strong>de</strong>rmatologique fut dirigée par Josefino Aleixo, assisté par Oswaldo Costa et José<br />
Mariano.<br />
La clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa compte actuellement quinze assistants<br />
— dont neuf obtinrent le diplôme dans le service — et douze col<strong>la</strong>borateurs, possédant<br />
tous le titre <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie. La direction du service est à <strong>la</strong> charge du Dr<br />
Jackson Machado Pinto. Deux membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique font actuellement leur résidanat à<br />
l’University of Colorado, d’autres en Argentine et en Autriche.<br />
L’aire propre à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital dispose <strong>de</strong> douze lits, cinq unités ambu<strong>la</strong>toires,<br />
<strong>de</strong>ux salles pour <strong>la</strong> chirurgie légère, une salle <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse, une salle <strong>de</strong> réunion avec<br />
une bibliothèque et un équipement mo<strong>de</strong>rne. Le service reçoit une moyenne annuelle <strong>de</strong><br />
200 patients hospitalisés et près <strong>de</strong> 16 000 patients externes en <strong>de</strong>rmatologie générale,<br />
sanitaire, pédiatrique et chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. En décembre 2001, il s’est doté d’une<br />
unité <strong>de</strong> photothérapie avec UVA et d’une autre avec UVB 311 NM.
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Plusieurs travaux scientifiques, parmi lesquels se distinguèrent les mémoires <strong>de</strong><br />
maîtrise et les thèses <strong>de</strong> doctorat en leishmaniose tégumentaire <strong>américaine</strong> et ma<strong>la</strong>dies<br />
bulleuses, notamment le pemphigus foliacé endémique, furent réalisés à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong>puis sa fondation.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UFMG<br />
C’est au Pr. Antonio Aleixo (1884-1943), l’un <strong>de</strong>s fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> Belo Horizonte (1911) et premier professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, que revient le mérite<br />
d’être considéré comme le créateur <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Minas Gerais. Son intérêt<br />
scientifique était centré sur <strong>la</strong> léprologie, le pemphigus, les ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles et les mycoses. Il fut le premier chef <strong>de</strong> l’infirmerie <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santa Casa <strong>de</strong> Belo Horizonte, une référence pour les <strong>de</strong>rmatologues jusqu’à nos jours.<br />
À <strong>la</strong> mort d’Aleixio en 1943, Olyntho Orsini — originaire <strong>de</strong> Minas Gerais (Sabará) — assuma<br />
<strong>de</strong> façon intérimaire <strong>la</strong> chaire comme enseignant libre. Ce mé<strong>de</strong>cin, diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1917, avait passé son concours en 1927 avec <strong>la</strong> thèse Contribution à<br />
l’étu<strong>de</strong> du pemphigus foliacé, dans <strong>la</strong>quelle il analysa les lésions en vespertilion, sans connaître<br />
pour autant le travail <strong>de</strong> Senear et Usher présenté antérieurement sur le sujet (1926).<br />
En 1945, un autre enseignant libre, Oswaldo Costa, reçu au concours public en 1944<br />
grâce à sa thèse sur les Dermatofibromes progressifs et récidivants <strong>de</strong> Darier-Ferrand,<br />
occupa <strong>de</strong> façon intérimaire le poste <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1945, le Pr. Olyntho Orsini (1891-1970) <strong>de</strong>vint professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire; le<br />
sujet <strong>de</strong> sa thèse fut Aspects épidémiologiques et cliniques du pemphigus foliacé à Minas<br />
Gerais. Il remplit rigoureusement ses <strong>de</strong>voirs en dirigeant <strong>la</strong> chaire et l’infirmerie pour<br />
femmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> façon compétente, dévouée et responsable ; il s’attira ainsi<br />
<strong>la</strong> sympathie <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong>rmatologique. Il fut un spécialiste notable du pemphigus,<br />
et il encouragea toujours <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration entre son service et le département <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Minas Gerais, dirigé à l’époque par le Dr Orestes Diniz.<br />
Les Prs Oswaldo Costa, José Mariano (léprologue compétent et ancien chef du Service<br />
national <strong>de</strong> lèpre) et Josephino Aleixo comptèrent parmi ses assistants ; ce <strong>de</strong>rnier fut,<br />
outre son statut d’enseignant libre en 1946 (le sujet <strong>de</strong> sa thèse fut Subvention à l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chromomycose), professeur adjoint à l’UFMG et professeur à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
d’Uberaba, M.G.<br />
En 1962, le Pr. Oswaldo Costa (1905-1996), né à São João <strong>de</strong>l-Rei, M. G. occupa <strong>la</strong><br />
chaire suite à un concours mémorable où il présenta sa thèse monumentale sur Acrokératose,<br />
une véritable bible <strong>de</strong> 577 pages montrant <strong>de</strong>s détails complets sur le sujet. Sa<br />
véritable passion pour <strong>la</strong> spécialité et son enseignement firent que ce spécialiste émérite<br />
en diagnostics, très studieux — il avait l’habitu<strong>de</strong> d’étudier jusqu’à l’aube —, séduisit<br />
beaucoup <strong>de</strong> patients dans sa clinique particulière. Il fut un excellent professeur ; il fréquenta<br />
les congrès et publia in<strong>la</strong>ssablement et <strong>de</strong> façon perspicace <strong>de</strong>s centaines <strong>de</strong> travaux<br />
scientifiques. Il eut également le mérite <strong>de</strong> décrire en 1954 une nouvelle entité,<br />
l’acrokératoé<strong>la</strong>stoïdose, reconnue <strong>de</strong> nos jours dans le mon<strong>de</strong> entier. Dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’enseignement, il fonda <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales<br />
<strong>de</strong> Minas Gerais, dont il fut le premier professeur.<br />
Il conserva l’équipe d’assistants du Pr. Orsini, qu’il renforça avec l’admission <strong>de</strong> Tancredo<br />
Furtado, du professeur adjoint Cid Ferreira Lopes — également chef <strong>de</strong> l’infirmerie<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa, organisateur et premier directeur <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong><br />
santé publique <strong>de</strong> Minas Gerais, membre titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Minas<br />
Gerais et membre correspondant <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine —, et du Dr João<br />
Gontijo, chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’hôpital municipal.<br />
Oswaldo Costa prit sa retraite en 1975. Son fils, Paulo Uchôa Costa, suivit l’exemple<br />
<strong>de</strong> son père <strong>de</strong> façon bril<strong>la</strong>nte, <strong>de</strong>venant un <strong>de</strong>rmatologue réputé et professeur adjoint<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UFMG.<br />
97
PAULO R. CUNHA<br />
98<br />
Le Pr. Tancredo Furtado (1923), natif <strong>de</strong> Carmo do Paranaíba, M.G., fut le successeur<br />
d’Oswaldo Costa; son discours <strong>de</strong> 1975, lors <strong>de</strong> l’exposition <strong>de</strong> sa thèse Tumeur granulocellu<strong>la</strong>ire<br />
d’Abrikossoff (Schwannome granulo-cellu<strong>la</strong>ire), fut remarqué. Il avait défendu<br />
l’enseignement libre dans sa thèse Manifestations tardives <strong>de</strong> <strong>la</strong> framboesia. En 1963, il<br />
s’était présenté au concours public pour <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> sciences médicales <strong>de</strong><br />
Minas Gerais, en soutenant <strong>la</strong> thèse sur Kératoacanthome et processus simi<strong>la</strong>ires.<br />
De 1975 à 1993, année <strong>de</strong> sa retraite contrainte, Tancredo Furtado éleva <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’UFMG à un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> prestige avec ses innombrables publications, sa<br />
participation aux congrès, aux commissions d’examens, sa direction <strong>de</strong> thèses, etc. À<br />
partir <strong>de</strong> 1975, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>vint plus dynamique,<br />
étant transféré <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa à l’annexe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques.<br />
Le Pr. Furtado inaugura le stage <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1976 et le mastère en 1977 ; il<br />
fut directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté entre 1982 et 1986.<br />
Pendant sa gestion, le professeur adjoint João Gontijo Assunção <strong>de</strong>vint enseignant libre<br />
(mars 1978) avec <strong>la</strong> thèse Pemphigus foliacé dans l’enfance. Quelques aspects épidémiologiques<br />
et cliniques et occupa le poste <strong>de</strong> chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entre 1982 et 1986.<br />
Tancredo Furtado fut l’un <strong>de</strong>s créateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Réunion triangu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> Minas Gerais <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> section nationale en<br />
1973. Il fut également membre émérite <strong>de</strong> l’Académie mineira <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, membre<br />
honoraire <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et associé correspondant ou honoraire<br />
<strong>de</strong> plusieurs sociétés étrangères <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Ce parcours professionnel et universitaire fulgurant se basa sur une formation<br />
humaniste soli<strong>de</strong>, et un cursus médical appliqué (il fut l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux meilleurs élèves <strong>de</strong><br />
sa promotion <strong>de</strong> l’an 1946), comportant <strong>de</strong>s spécialisations aux États-Unis : <strong>de</strong>s pratiques,<br />
<strong>de</strong>s cours, le résidanat dans les universités <strong>de</strong> Kansas City, Chicago, New York,<br />
Washington et Los Angeles.<br />
Le Pr. Orcanda Andra<strong>de</strong> Patrus (1941), native <strong>de</strong> Juiz <strong>de</strong> Fora, fut professeur assistante<br />
<strong>de</strong>puis l’époque du Pr. Oswaldo Costa ; elle passa son doctorat en soutenant sa thèse<br />
(1980) Antigènes d’histocompatibilité, immunocomplexes et complément dans le pemphigus<br />
foliacé, qui lui permit d’obtenir le poste <strong>de</strong> professeur adjointe. Elle fut nommée<br />
professeur titu<strong>la</strong>ire lors d’un concours public en 1991 ; visionnaire, elle dirigea le service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie avec compétence et générosité, en apportant <strong>de</strong>s améliorations, en mettant<br />
en p<strong>la</strong>ce l’informatisation et en maintenant le haut niveau <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’équipe et<br />
le modèle reconnu d’apprentissage en collectif.<br />
Après sa retraite, le Dr Antonio Carlos Martins Gue<strong>de</strong>s, professeur adjoint, assuma <strong>la</strong><br />
direction du service ; on lui reconnut une très bonne administration : il réforma et modifia<br />
l’annexe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques tout en continuant <strong>de</strong> s’impliquer<br />
<strong>de</strong> manière compétente et dévouée dans <strong>la</strong> section d’histopathologie.<br />
Une fois son mandat achevé, il fut remp<strong>la</strong>cé par le professeur adjoint Bernardo Gontijo,<br />
auparavant directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> section<br />
<strong>de</strong> Minas Gerais. Entre 2000 et 2001 il dirigea <strong>la</strong> SBD (nationale) avec courage, dévouement,<br />
générosité et compétence.<br />
L’université fédérale <strong>de</strong> Juiz <strong>de</strong> Fora (dirigée par le Pr. Aloísio Gamonal) et l’université<br />
fédérale <strong>de</strong> Uberlândia (dont le chef <strong>de</strong> service est le Dr Sônia Antunes <strong>de</strong> Oliveira)<br />
sont d’autres services habilités à Minas.<br />
Espírito Santo<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Cassiano Antônio Moraes (<strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Espírito Santo) aurait pu être<br />
habilité bien avant par <strong>la</strong> SBD, mais il voulut <strong>de</strong> lui-même repousser l’habilitation :<br />
« Il fal<strong>la</strong>it que le service soit convaincu qu’il recevrait <strong>la</strong> note maximale pour son approbation,<br />
tel que l’exige le respect pour l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine. » 2
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
La revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD signale: « Certains aspects frappent dans ce service: <strong>la</strong> simplicité<br />
et l’harmonie qui règnent partout et entre tous, le caractère informel <strong>de</strong>s rapports entre<br />
les personnes et <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong>s tâches; l’esprit <strong>de</strong> sacerdoce qui se traduit dans les<br />
projets et <strong>la</strong> capacité à être audacieux. Les Prs Carlos Cley Coelho et Délio Del Maestre (le<br />
chef du service) intègrent le magistère d’un programme choisi d’un commun accord. » 2<br />
Même si le service n’est pas très grand, les 7 cabinets impressionnent par leur luminosité,<br />
<strong>de</strong> même dans <strong>la</strong> salle <strong>de</strong>s réunions et dans une autre salle consacrée aux chirurgies<br />
légères, ainsi que dans le magasin. Habilité en 1999 — au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion du<br />
conseil délibérant qui eut lieu pendant le 54 e Congrès brésilien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Belo<br />
Horizonte —, le service médical, approuvé avec <strong>la</strong> note maximale, est <strong>la</strong> référence étatique<br />
en léprologie, en tuberculose extra-pulmonaire et en leishmaniose ; il soigne 150<br />
personnes par jour (en moyenne), é<strong>la</strong>rgissant son champ d’action jusqu’aux limites <strong>de</strong><br />
Bahia, Minas Gerais et Rio <strong>de</strong> Janeiro.<br />
Des étu<strong>de</strong>s statistiques et nosologiques <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur<br />
<strong>de</strong>s patients greffés, <strong>de</strong>s psycho<strong>de</strong>rmatoses, <strong>de</strong>s affections cutanées dues aux paracoccidioïdomycoses,<br />
à <strong>la</strong> tuberculose extra-pulmonaire, à <strong>la</strong> lèpre et à <strong>la</strong> leishmaniose, furent<br />
effectuées dans ce service.<br />
La Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Vitória fut également habilitée par <strong>la</strong> SBD ; le<br />
Pr. João Basílio <strong>de</strong> Souza Filho en fut le chef <strong>de</strong> service.<br />
Services <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
Siège du royaume et <strong>de</strong> l’empire du Brésil dans les premiers temps, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
jusqu’en 1960, Rio <strong>de</strong> Janeiro fut toujours l’un <strong>de</strong>s principaux noyaux <strong>de</strong> développement<br />
médical du pays, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> ses entités médicales, parmi<br />
lesquelles se distingue <strong>la</strong> SBD.<br />
« Seule faculté brésilienne à obtenir <strong>la</strong> qualification 4 <strong>de</strong> l’évaluation du ministère <strong>de</strong><br />
l’éducation, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université fédérale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro propose un<br />
cours <strong>de</strong> spécialisation, une maîtrise et un doctorat en <strong>de</strong>rmatologie, qui gar<strong>de</strong> <strong>de</strong>puis<br />
1986 <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification A selon l’évaluation du CAPES. » 2<br />
Créés en 1970 par Sylvio Fraga, <strong>la</strong> maîtrise et le doctorat en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UFRJ<br />
sont les plus anciens du pays. Le Pr. Carlos Cley fut le premier diplômé <strong>de</strong> maîtrise en<br />
1974 ; <strong>la</strong> même année, le MEC reconnut et valida <strong>la</strong> spécialisation.<br />
À Niterói, Sinésio Talhari, actuellement chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’institut<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Alfredo da Mata, fut le premier à obtenir le titre <strong>de</strong> maître à l’université<br />
fédérale Fluminense.<br />
Le docteur coordinateur Absalom Lima Filgueira signale que <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut créée au début <strong>de</strong>s années 70, quasiment en même temps que <strong>la</strong> fermeture<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire: « Nous avions besoin <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s professeurs pour l’enseignement supérieur,<br />
et le chemin <strong>de</strong>vait passer par <strong>la</strong> maîtrise et le doctorat. La spécialisation brésilienne,<br />
et c’est là sa caractéristique principale, doit être effectuée dans chaque spécialité.<br />
Il n’existe pas, ou du moins il n’existait pas à l’époque, un autre cours i<strong>de</strong>ntique au<br />
mon<strong>de</strong> ; dans les autres pays, on enseignait seulement les matières <strong>de</strong> base : <strong>la</strong> physique,<br />
<strong>la</strong> biologie, <strong>la</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire, <strong>la</strong> chimie. »<br />
Deux aspects contribuèrent au succès <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UFRJ :<br />
le transfert à l’hôpital universitaire (1978), abandonnant les instal<strong>la</strong>tions sécu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia, et <strong>la</strong> proximité avec le Centre <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, siège<br />
du fameux Institut <strong>de</strong> biophysique, un organisme <strong>de</strong> recherche fondamentale célèbre à<br />
l’étranger. L’intégration entre les <strong>de</strong>ux milieux fut graduelle et totale. La biophysique et<br />
<strong>la</strong> biochimie <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s matières qui traitent <strong>de</strong>s organes. Celles-ci furent à l’origine<br />
<strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> tissu conjonctif, d’hormones, d’endocrinologie et <strong>de</strong> photobiologie.<br />
João Pizarro Gabizo fut le premier professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, à l’académie médico-chirurgicale qui n’al<strong>la</strong>it recevoir le nom <strong>de</strong> faculté <strong>de</strong><br />
99
Figure 13.<br />
Clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santa Casa, Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro, pavillon Sao<br />
Miguel<br />
PAULO R. CUNHA<br />
100<br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du Brésil qu’en 1932. Luiz da Costa Chaves Faria, Fernando<br />
Terra, Eduardo Rabello et Francisco Eduardo Rabello (exerçant <strong>la</strong> charge jusqu’à son<br />
départ en retraite, en 1975, par application du principe du <strong>de</strong>voir acquis) succédèrent<br />
à Gabizo.<br />
Les Prs Sylvio Fraga et Antônio <strong>de</strong> Souza Marques<br />
(figure 13) occupèrent <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
lorsqu’elle était encore située à <strong>la</strong> Santa Casa. À Ilha do<br />
Governador, après le transfert à l’hôpital universitaire, le<br />
Pr. Absalom Figueira (1978-1980) fut chargé <strong>de</strong> l’organisation<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; les<br />
Prs Rubem David Azu<strong>la</strong>y (1980-1985), Antônio Carlos<br />
Pereira Junior (1986-1997), Celso Tavares Sodré lui succédèrent.<br />
Doté d’une infirmerie propre disposant <strong>de</strong> quatorze<br />
lits, le soin ambu<strong>la</strong>toire du service est intégré aux autres<br />
secteurs <strong>de</strong> l’hôpital universitaire ; <strong>de</strong> cette façon, les<br />
élèves <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ont<br />
une vision d’ensemble <strong>de</strong> tous les aspects médicaux.<br />
Au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation, le cours est dispensé <strong>la</strong>to ou stricto sensu. Du point <strong>de</strong><br />
vue <strong>la</strong>to sensu, il existe <strong>de</strong>ux niveaux : cours <strong>de</strong> perfectionnement I et cours <strong>de</strong> perfectionnement<br />
II, chacun proposant six postes vacants. La quantité d’heures <strong>de</strong> cours est<br />
compatible avec <strong>la</strong> spécialisation et le programme est associé au résidanat. L’intérêt pour<br />
les cours est si vif que plus <strong>de</strong> 100 candidats se présentent chaque année pour obtenir<br />
un <strong>de</strong>s huit postes vacants proposés.<br />
IASERJ (Institut d’assistance aux travailleurs <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro)<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’institut d’assistance aux travailleurs <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro est l’un <strong>de</strong>s organes les plus respectés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dans le pays. Il fut<br />
conçu et organisé par son fondateur, Glynne Leite Rocha, auquel succédèrent Manoel<br />
Sternick et Arlindo Ferraro. Le résidanat fut mis en p<strong>la</strong>ce en 1970 ; habilité par <strong>la</strong> SBD,<br />
il comptait jusqu’à 2001 soixante-dix mé<strong>de</strong>cins spécialistes diplômés <strong>de</strong> tout le pays,<br />
sept élèves ayant passé leur maîtrise et <strong>de</strong>ux élèves leur doctorat en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Deux mé<strong>de</strong>cins obtiennent chaque année leur diplôme au service <strong>de</strong> I’ASERJ, service qui<br />
n’est pas lié au système universitaire. Sa production scientifique est i<strong>de</strong>ntifiée à celle du<br />
Pr. Glynne Rocha, « l’un <strong>de</strong>s piliers <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne les plus forts<br />
et les plus efficaces »; il faut distinguer <strong>la</strong> publication dans les Annales brésiliennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux revues consacrées exclusivement aux travaux du service.<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> première année du résidanat, les élèves s’occupent <strong>de</strong> l’unité ambu<strong>la</strong>toire<br />
et <strong>de</strong> l’infirmerie. Pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième année, les rési<strong>de</strong>nts soignent les patients du<br />
service dans leur propre clinique et suivent <strong>de</strong>s apprentissages dans <strong>de</strong>s unités spécialisées<br />
à l’extérieur <strong>de</strong> l’hôpital : <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique à l’hôpital Jesús par exemple,<br />
<strong>la</strong> léprologie et les ma<strong>la</strong>dies infectieuses à l’hôpital Fiocruz et l’oncologie cutanée à<br />
l’INCA.<br />
Les rési<strong>de</strong>nts préparent en permanence <strong>de</strong>s cas cliniques qu’ils présentent au cours<br />
<strong>de</strong>s réunions mensuelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD-RJ, lors <strong>de</strong> congrès ou dans diverses publications.<br />
Des cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie et <strong>de</strong> mycologie médicale ont lieu tous les ans. Selon le<br />
Pr. Sérgio Quinete, chef du service, les activités comprennent le club <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue le<br />
mardi, <strong>la</strong> séance <strong>de</strong> diapositives le mercredi, <strong>la</strong> réunion clinico-pathologique (présentation<br />
<strong>de</strong> patients avec discussion et projection d’images histopathologiques) le jeudi et<br />
<strong>la</strong> discussion autour <strong>de</strong> sujets <strong>de</strong>rmatologiques et les tests d’évaluation mensuelle le<br />
vendredi.
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Gaffrée-Guinle<br />
Le Pr. Ramos e Silva fut le premier titu<strong>la</strong>ire en <strong>de</strong>rmatologie au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital universitaire Gaffrée-Guinle, <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> chirurgie,<br />
tandis que les Prs Demétrio Peryassu et Antar Padilha-Gonçalves y étaient assistants.<br />
Son siège se trouvait à <strong>la</strong> polyclinique générale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro. D’après Gabrie<strong>la</strong> Lowy,<br />
dans les années 60 « on a remporté une gran<strong>de</strong> victoire lorsque <strong>la</strong> faculté a acquis l’hôpital<br />
Gafrée-Guinle, lieu d’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong>puis lors ».<br />
Peryassu et Gonçalves furent chargés <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
jusque fin 1972, après avoir passé tous <strong>de</strong>ux le concours public qui leur permit <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir<br />
professeurs titu<strong>la</strong>ires. Les Drs Aldy Barbosa Lima, Gabrie<strong>la</strong> Lowy et Danilo Vicente<br />
Filgueiras comptèrent parmi leurs col<strong>la</strong>borateurs. Le Pr. Demétrio Peryassu décéda peu<br />
après, victime d’une ma<strong>la</strong>die.<br />
Deux grands progrès furent réalisés sous <strong>la</strong> direction d’Antar Padilha Gonçalves : <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’infirmerie <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> création du cours <strong>de</strong> spécialisation en<br />
<strong>de</strong>rmatologie, qui avait reçu l’autorisation, le soutien et l’approbation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD. À cette<br />
même époque, le service s’étendit avec <strong>la</strong> création <strong>de</strong> nouvelles salles <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse et un<br />
meilleur confort pour le soin ambu<strong>la</strong>toire.<br />
Son successeur, le Pr. Aldy Barbosa Lima, créa ultérieurement le service <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique. En 1998, le <strong>de</strong>uxième titu<strong>la</strong>ire prit sa retraite, et le Pr. Gabrie<strong>la</strong> Lowy<br />
lui succéda. Le groupe d’enseignants s’agrandit avec l’intégration <strong>de</strong> José Alvimar Ferreira,<br />
Carlos José Martins, Coaracy Mello et Ricardo Barbosa Lima.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire Gaffrée-Guinle sponsorisa plusieurs<br />
événements scientifiques, parmi lesquels nous distinguerons les Réunions triangu<strong>la</strong>ires,<br />
avec <strong>de</strong>s présentations innovantes par vidéo <strong>de</strong> cas cliniques. Ses spécialistes<br />
sont toujours présents lors <strong>de</strong>s réunions, <strong>de</strong>s journées, <strong>de</strong>s congrès nationaux et internationaux,<br />
et leur contribution scientifique est abondante.<br />
Hôpital Antônio Pedro<br />
L’histoire du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire Antônio Pedro (Niterói,<br />
université fédérale Fluminense) fut toujours liée à l’enseignement. Le Pr. Paulo <strong>de</strong><br />
Figueiredo Parreiras Horta, professeur à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et syphiligraphique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté Fluminense <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, créa le service dans les années 1930 ; il était situé<br />
à l’origine dans l’hôpital São João Batista, dans <strong>la</strong> localité <strong>de</strong> Valonguinho. Il fut transféré<br />
en 1953 à l’hôpital Antônio Pedro par le Pr. Rubem David Azu<strong>la</strong>y, le successeur <strong>de</strong><br />
Horta. Malgré les difficultés auxquelles il se heurta, Azu<strong>la</strong>y se consacra à l’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, aboutissant à <strong>la</strong> création du cours <strong>de</strong> spécialisation stricto sensu.<br />
L’exemple du nordiste Rubem David Azu<strong>la</strong>y est intéressant : quand <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Pará fut transférée à Niterói, il suivait encore son cursus universitaire, et<br />
prit <strong>la</strong> question que lui avait posée <strong>la</strong> secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté Fluminense comme un défi:<br />
réussirait-il à maintenir les excellentes notes qu’il apportait <strong>de</strong> sa terre natale ? « Le premier<br />
examen se passait face au Pr. Pedro da Cunha, que l’on jugeait très exigeant ; le 10<br />
obtenu par Azu<strong>la</strong>y fut encore augmenté par <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong> son examen face aux autres<br />
élèves et aux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’hôpital São João Batista. » 2<br />
Le mastère débuta au Brésil en 1971 ; le Dr Sinésio Talhari, professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong><br />
l’université fédérale <strong>de</strong> Amazonas fut son premier élève. Ayant suivi les cours <strong>de</strong> maîtrise<br />
et effectuant <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche scientifique, quatre-vingts élèves obtinrent le diplôme<br />
correspondant, dont cinquante-huit enseignent dans différentes écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
du pays ; cinq se consacrent à <strong>la</strong> recherche scientifique, tandis que dix-neuf<br />
poursuivent <strong>de</strong>s activités liées au doctorat. Après avoir passé <strong>de</strong>s concours publics, trois<br />
anciens élèves <strong>de</strong>vinrent professeurs titu<strong>la</strong>ires : René Garrido Neves, Sinésio Talhari et<br />
Nei<strong>de</strong> Kalil Gaspar.<br />
101
PAULO R. CUNHA<br />
102<br />
Le résidanat fut créé en 1967, le Pr. Antônio Pedro Gaspar étant son premier élève. Il<br />
fut recruté l’année suivante pour enseigner cette discipline. Le résidanat, réglementé par<br />
décret (septembre 1977) et par loi (1981), fut régi par le ministère <strong>de</strong> l’Éducation et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Culture. Quatre-vingts <strong>de</strong>rmatologues firent leurs années <strong>de</strong> résidanat à l’UFF jusqu’en<br />
2002, et beaucoup d’entre eux occupent aujourd’hui <strong>de</strong>s postes dans les universités<br />
brésiliennes publiques et privées.<br />
Après <strong>la</strong> retraite du Pr. Rubem Azu<strong>la</strong>y dans les années 70, <strong>la</strong> direction du service et<br />
<strong>la</strong> coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité furent assurées — jusqu’en 1992 — par son ancien élève,<br />
le Pr. René Garrido Neves, une autorité aussi bien en léprologie qu’en oncologie. Son<br />
parcours remarquable l’amena à faire <strong>de</strong>s recherches, <strong>de</strong>s directions <strong>de</strong> thèses et à<br />
publier <strong>de</strong> nombreux articules dans <strong>de</strong>s revues et <strong>de</strong>s livres, et à occuper <strong>de</strong>s postes importants<br />
au sein <strong>de</strong> l’UFF et <strong>de</strong> l’UFRJ, ainsi que <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (il en acheta le premier siège). Le cours <strong>de</strong> spécialisation <strong>la</strong>to sensu<br />
(décembre 1989), qui octroya le diplôme à 172 élèves jusqu’en 2002, fut créé durant son<br />
mandat.<br />
À partir <strong>de</strong> 1992 <strong>la</strong> direction du service fut occupée par le Pr. Nei<strong>de</strong> Kalil Gaspar, qui<br />
nous fournit l’information suivante :<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième année du cursus, <strong>de</strong>vant réaliser un travail sur <strong>de</strong>s médicaments<br />
cosmétiques, nous avons cherché celui qui serait pour nous à l’avenir un modèle<br />
et un motif <strong>de</strong> fierté professionnelle : le Pr. Rubem David Azu<strong>la</strong>y. Orientés <strong>de</strong><br />
manière enthousiaste, profitable et compétente par cette personne qui répondait à<br />
nos attentes d’ordre scientifique, nous allions travailler davantage pendant vingt ans.<br />
Notre service occupait <strong>la</strong> moitié d’un étage <strong>de</strong> l’ancienne polyclinique <strong>de</strong> Valonguinho<br />
et nous avions été transférés au début à l’hôpital Antônio Pedro dans un espace <strong>de</strong><br />
trois mètres carrés... Nous gardons beaucoup <strong>de</strong> souvenirs <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique ; ce<strong>la</strong> a<br />
été un milieu simple et tranquille où nous avons appris à enseigner et à faire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
recherche. De là nous sommes allés au Fiocruz, où nous avons effectué <strong>de</strong>s recherches<br />
sur <strong>de</strong>s aspects essentiels <strong>de</strong> <strong>la</strong> fibre é<strong>la</strong>stique chez une patiente <strong>de</strong> 6 ans<br />
avec <strong>de</strong>s tissus <strong>de</strong> soixante. Nous appartenions déjà au groupe d’enseignants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
matière; comme il était habituel à l’époque, nous travaillions pour le p<strong>la</strong>isir d’apprendre,<br />
sans aucune rémunération, mais honorés par notre tâche. Je crois que ce<br />
qui manque <strong>de</strong> nos jours dans notre pays, c’est <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong> l’individu par le travail<br />
qu’il exécute. Celui qui reçoit une telle rétribution sait ce qu’il est capable <strong>de</strong><br />
faire pour surmonter les difficultés.<br />
Du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Antônio Pedro a surgi l’initiative d’unifier<br />
<strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture <strong>de</strong>rmatologique, sur <strong>la</strong> base du travail du Pr. Francisco Eduardo Rabello.<br />
Le Pr. Antônio Pedro <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> Gaspar fut chargé, avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration du<br />
Pr. Nei<strong>de</strong> Kalil Gaspar, <strong>de</strong> réunir et d’i<strong>de</strong>ntifier les différents et nombreux synonymes<br />
qui rendaient <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie difficile. Ce<strong>la</strong> représentait près <strong>de</strong><br />
10 000 termes. Ces auteurs ont regroupé 7 000 termes dans <strong>la</strong> Nómina Dermatológica,<br />
tout en mentionnant <strong>la</strong> nomenc<strong>la</strong>ture suggérée par le Pr. Rabello. Ce livre fut<br />
un événement marquant pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne, et il est utilisé dans toutes<br />
les universités et les services du pays. Les Prs Antônio Pedro et Nei<strong>de</strong> ont également<br />
fourni 5 autres livres d’actualisation thérapeutique <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, en rassemb<strong>la</strong>nt<br />
les termes codifiés par l’Organisation mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé au CID <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
afin <strong>de</strong> rendre plus facile son utilisation dans le pays. Ils ont aussi orienté 28 travaux<br />
<strong>de</strong> recherche scientifique employés pour <strong>de</strong>s thèses soutenues et approuvées au<br />
niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> maîtrise et du doctorat 2 .<br />
Actuellement, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie reste le siège <strong>de</strong>s activités didactiques <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> l’université fédérale Fluminense. C’est pour
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
cette raison qu’il est également lié au département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine clinique, composé <strong>de</strong><br />
122 professeurs. Le service accueille 13 professeurs et 2 mé<strong>de</strong>cins responsables <strong>de</strong>s<br />
activités du cursus, y compris les aspects théoriques et pratiques, l’internat, le résidanat,<br />
<strong>la</strong> spécialisation et le soin médical. L’intervention dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche se fait<br />
à travers les projets d’initiation scientifique, coordonnés par les Prs Nei<strong>de</strong> Kalil Gaspar<br />
et Jane Marcy Neffá Pinto. À partir <strong>de</strong> 1995, le Dr Nei<strong>de</strong> Kalil Gaspar occupa le poste <strong>de</strong><br />
professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. La gestion administrative du service, ainsi que <strong>la</strong><br />
coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire sont à nouveau, <strong>de</strong>puis 2001, exercées annuellement par les<br />
différents professeurs ; le Pr. Jane Marcy Neffá Pinto fut élue pour prendre en charge <strong>la</strong><br />
gestion actuelle.<br />
Les autres services habilités à Rio <strong>de</strong> Janeiro sont : <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia (chef<br />
<strong>de</strong> service : Rubem David Azu<strong>la</strong>y), le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie du HSE<br />
(chef <strong>de</strong> service : Márcio Rutowitsch), l’hôpital universitaire Pedro Ernesto (chef <strong>de</strong> service<br />
: Isabel Succi), l’université fédérale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro (chef <strong>de</strong> service : Márcia Ramos<br />
e Silva), l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lagoa-institut <strong>de</strong> spécialisation médicale Carlos Chagas (chef <strong>de</strong><br />
service : Andrea Gurfinkel), <strong>la</strong> polyclinique générale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro (chef <strong>de</strong> service :<br />
Marcius Peryassú), l’hôpital général <strong>de</strong> Bonsucesso (chef <strong>de</strong> service : José Anselmo<br />
Lofêgo Filho) et l’hôpital naval Marcílio Días (chef <strong>de</strong> service : Cláudio Lerer).<br />
LA DERMATOLOGIE PAULISTE<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pauliste débuta le 3 mai 1907, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création d’un service <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau à <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale, dirigé par Adolpho<br />
Lin<strong>de</strong>mberg, l’un <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Le 29 février 1916, Lin<strong>de</strong>mberg dispensa son premier cours comme professeur <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> Sao Paulo. Il prit sa retraite en<br />
1929 et fut remp<strong>la</strong>cé par le Pr. João <strong>de</strong> Aguiar Pupo ; celui-ci occupa le poste jusqu’en<br />
1960, et il fut remp<strong>la</strong>cé lors <strong>de</strong> sa retraite par le Pr. Sebastião Almeida Prado Sampaio,<br />
à son tour retraité en 1989 et auquel succéda le Pr. Evandro Rivitti, titu<strong>la</strong>ire actuel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fonctionnait à <strong>la</strong> Santa Casa.<br />
Étant donné le nombre élevé <strong>de</strong> patients, il entretenait une excellente unité ambu<strong>la</strong>toire<br />
qui occupait tout un étage du pavillon <strong>de</strong> Lara et <strong>de</strong>ux infirmeries, masculine et féminine,<br />
chacune ayant une capacité <strong>de</strong> quarante lits. Lorsque ce service fut installé en 1945 à<br />
l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques, <strong>la</strong> chaire se dép<strong>la</strong>ça aussi à cet endroit. Une série <strong>de</strong> difficultés<br />
détacha pratiquement <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’institution multisécu<strong>la</strong>ire. En 1975, le Pr. Nélson<br />
Proença succéda au Pr. Humberto Cerruti comme titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
faculté <strong>de</strong>s sciences médicales : un important noyau <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité venait <strong>de</strong> se créer à<br />
Sao Paulo.<br />
Santa Casa<br />
Selon un ancien chef <strong>de</strong> service, le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Sao Paulo « repose sur l’assistance au ma<strong>la</strong><strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong> manière efficace et qualifiée, <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> nouveaux professionnels et <strong>la</strong> recherche<br />
scientifique. » 2 L’unité ambu<strong>la</strong>toire reçoit 200 personnes par jour, dont cinquante sont <strong>de</strong><br />
nouveaux patients, soit un total <strong>de</strong> 4 000 patients par mois et 40 000 par an, sans qu’il y<br />
ait <strong>de</strong>s files d’attente. « L’inauguration récente du centre chirurgical lié à <strong>la</strong> clinique,<br />
avec tout l’équipement nécessaire, aussi bien pour dispenser <strong>de</strong>s cours que pour les soins<br />
ambu<strong>la</strong>toires et le développement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s recherches, constitue une innovation<br />
au Brésil. » 2 La production scientifique suit <strong>la</strong> tradition établie par Lin<strong>de</strong>mberg et Pupo.<br />
Les travaux <strong>de</strong> l’équipe actuelle furent reconnus au niveau national, et plusieurs d’entre<br />
eux constituent une référence dans le milieu international.<br />
103
PAULO R. CUNHA<br />
104<br />
Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa<br />
<strong>de</strong> Sao Paulo datent <strong>de</strong>s années 70, lorsque le Pr. Nelson Proença en assuma <strong>la</strong> direction.<br />
Les <strong>de</strong>rmatologues Fausto Alonso et Marcus Maia faisaient partie <strong>de</strong> l’équipe initiale ;<br />
avec le temps, Humberto Frucchi, C<strong>la</strong>risse Zaitz, Ida Duarte, Sylvia Souto Mayor, Rosana<br />
Lazzarini, Thais Proença et Valéria Souza les rejoignirent. Outre les professeurs recrutés,<br />
le service médical compte plusieurs volontaires.<br />
La clinique est divisée en plusieurs secteurs <strong>de</strong> sous-spécialités comme celles d’oncologie,<br />
<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, <strong>de</strong> photothérapie, <strong>de</strong> mycologie,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> pédiatrie. Le Pr. Ida Duarte, ancienne rési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique,<br />
<strong>la</strong> dirige actuellement et son objectif principal est le soin, l’enseignement et <strong>la</strong> recherche<br />
en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Hôpital <strong>de</strong>s cliniques<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> l’USP fut le noyau <strong>de</strong> l’expansion<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité pauliste. Le décret n° 5837 du 12 mars 1975 permit <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques, tandis que le 24 juin 1986 fut créé<br />
le département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Sao Paulo.<br />
Le département dispose d’une équipe <strong>de</strong> soixante-dix professionnels ; vingt-trois fonctionnaires<br />
techniques, biologiques et administratifs, quatorze mé<strong>de</strong>cins assistants, trois<br />
mé<strong>de</strong>cins mandataires, sept enseignants, <strong>de</strong>ux psychologues, <strong>de</strong>ux infirmières et dixneuf<br />
auxiliaires.<br />
Il y a trente salles <strong>de</strong>stinées au soin <strong>de</strong>s patients et aux services auxiliaires dans l’immeuble<br />
<strong>de</strong> l’unité ambu<strong>la</strong>toire inauguré en 1979. Outre les consultations <strong>de</strong>rmatologiques<br />
générales — on reçoit <strong>de</strong>s patients du Brésil et <strong>de</strong> toute l’Amérique Latine —, il y<br />
a aussi <strong>de</strong>s groupes qui se consacrent à <strong>de</strong>s pathologies spécifiques sous <strong>la</strong> responsabilité<br />
<strong>de</strong>s professeurs du groupe d’enseignants.<br />
300 <strong>de</strong>rmatologues ont déjà obtenu leur diplôme dans cette unité, qui compte actuellement<br />
26 rési<strong>de</strong>nts. Quant à <strong>la</strong> spécialisation, trente élèves passèrent <strong>la</strong> maîtrise jusqu’en<br />
1999, quarante-cinq obtinrent le doctorat et dix-sept <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s enseignants<br />
libres. Les cours <strong>de</strong> perfectionnement accueillent <strong>de</strong>s candidats pour être mé<strong>de</strong>cins-observateurs,<br />
mé<strong>de</strong>cins-col<strong>la</strong>borateurs et mé<strong>de</strong>cins-chercheurs. Le département reçoit<br />
aussi <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins en roulement et organise un cours <strong>de</strong> spécialisation pour étrangers.<br />
Entre 1991 et 1998, les professionnels du département présentèrent environ<br />
soixante-seize articles scientifiques, dans <strong>de</strong>s publications nationales et quarante-<strong>de</strong>ux<br />
pour l’international, et éditèrent cinq livres : Terapéutica <strong>de</strong>rmatológica [Thérapeutique<br />
<strong>de</strong>rmatologique], <strong>de</strong> José Eduardo Costa Martins et Luiz Camargo Paschoal ; C<strong>la</strong>sificación<br />
general <strong>de</strong> hongos y sistemática [C<strong>la</strong>ssification générale <strong>de</strong>s champignons et systématique],<br />
<strong>de</strong> Carlos da Silva Lacaz ; Manual <strong>de</strong> Dermatología [Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie],<br />
<strong>de</strong> Luís Carlos Cucé et Cyro Festa Neto ; et Dermatología [Dermatologie], <strong>de</strong> Sebastião<br />
Sampaio et Evandro Rivitti. Six équipes permanentes mènent une recherche systématique<br />
dans les domaines <strong>de</strong> l’immuno-<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> l’oncologie cutanée, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatoses<br />
infectieuses et parasitaires, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique, <strong>de</strong> l’immuno-déficience et l’immuno-modu<strong>la</strong>tion, <strong>de</strong> l’histopathologie,<br />
du psoriasis et <strong>de</strong> <strong>la</strong> photobiologie. Depuis 1989, <strong>la</strong> direction du service médical est exercée<br />
par le professeur titu<strong>la</strong>ire Evandro Rivitti, qui obtint son diplôme en mé<strong>de</strong>cine à<br />
l’USO en 1965 et le titre <strong>de</strong> docteur en <strong>de</strong>rmatologie et d’enseignant libre à <strong>la</strong> FMUSP ; il<br />
s’intéresse notamment à l’immunité en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
École pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
Nico<strong>la</strong>u Rossetti commença <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université<br />
fédérale <strong>de</strong> Sao Paulo en 1936, tout en en étant le premier titu<strong>la</strong>ire, charge qu’il<br />
exerça pendant vingt ans. Lui succédèrent les Prs Newton Alves Guimarães, Abrahão
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Rotberg, Antônio Francisco Defina, Raymundo Martins Castro et Maurício Mota <strong>de</strong> Ave<strong>la</strong>r<br />
Alchorne ; <strong>de</strong> nos jours, <strong>la</strong> direction est confiée au Pr. Jane Tomimori Yamashita.<br />
Pendant <strong>la</strong> gestion du Pr. Raymundo Martins Castro, en 1990, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie se<br />
dédoub<strong>la</strong> en <strong>de</strong>rmatologie générale et <strong>de</strong>rmatologie infectieuse et parasitaire. L’école<br />
pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine compte 9 professeurs pour l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. La<br />
popu<strong>la</strong>tion ayant un pouvoir d’achat minimal, dont <strong>la</strong> plupart souffrent <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
infectieuses, <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatites eczémateuses et éritémato-squameuses, représente l’essentiel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en soins médicaux. Le soin ambu<strong>la</strong>toire est dispensé quotidiennement<br />
dans <strong>de</strong>ux services <strong>de</strong> l’hôpital Sao Paulo. Il existe aussi un <strong>la</strong>boratoire pour effectuer<br />
<strong>de</strong>s examens mycologiques et bactériologiques, un secteur chirurgical <strong>de</strong>rmatologique et<br />
un secteur <strong>de</strong>s allergies.<br />
Les nouveaux groupes <strong>de</strong> recherche se consacrent à <strong>la</strong> léprologie, <strong>la</strong> mycose et <strong>la</strong><br />
leishmaniose, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>génose, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, les ma<strong>la</strong>dies bulleuses, les<br />
tumeurs, <strong>la</strong> cosmétologie, l’allergie <strong>de</strong>rmatologique et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie professionnelle.<br />
La supervision et l’orientation <strong>de</strong> l’enseignement est à <strong>la</strong> charge d’un service <strong>de</strong> MST,<br />
comptant sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Ce service est caractérisé par <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité dans <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s spécialistes.<br />
Outre les cours (diplôme pour les élèves <strong>de</strong> 3 e et 4 e années) et <strong>la</strong> spécialisation<br />
par le résidanat — qui propose six postes vacants par an et dont <strong>la</strong> durée est <strong>de</strong> trois ans<br />
(une année <strong>de</strong> clinique médicale et <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité) —, le département <strong>de</strong> l’école<br />
pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine offre un cours <strong>de</strong> spécialisation stricto sensu et trois spécialisations<br />
: <strong>de</strong>rmatologie pour étrangers, <strong>de</strong>rmatologie avancée et <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s zones<br />
sélectives.<br />
Facultés<br />
Le Pr. Sebastião Almeida Prado Sampaio affirme que <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Ribeirão Preto fut fondée dans les années 50 ; <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Botucatu <strong>de</strong><br />
l’UNESP, dont <strong>la</strong> matière « <strong>de</strong>rmatologie » fut dirigée par le Pr. Neuza Dillon à partir <strong>de</strong><br />
1967, fut fondée en 1963. Elle est actuellement dirigée par le Pr. Silvio Marques.<br />
Plusieurs écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine furent créées dans d’autres villes paulistes entre les années<br />
60 et 80, dont les facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Rio Preto, Unicamp, Santos, ABC, Santo<br />
Amaro, Jundiaí, PUCs <strong>de</strong> Campinas et Sorocaba, Taubaté, Bragança, Marília et Catanduva.<br />
De nos jours, il existe 19 écoles médicales dans l’État <strong>de</strong> Sao Paulo; les titu<strong>la</strong>ires<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont pour <strong>la</strong> plupart originaires <strong>de</strong> l’USP, comme les Prs Luís Carlos<br />
Cucé, Luiz Henrique Camargo Paschoal, Alice Ave<strong>la</strong>r Alchorne, Neuza Dillon, Nelson<br />
Proença, Maurício Alchorne, entre autres ; parmi les professeurs originaires d’autres<br />
États, il faut distinguer João Roberto Antônio (Rio Preto) et Nei Romitti (Santos).<br />
L’hôpital <strong>de</strong>l Servidor Municipal et l’hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Estatal sont les<br />
noyaux les plus importants pour <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues. Le premier, dirigé par<br />
le Dr Aurélio Ancona López et ensuite par le Dr Alexandre <strong>de</strong> Mello, est actuellement à<br />
<strong>la</strong> charge du Dr Ival Peres Rosa ; le <strong>de</strong>uxième, dirigé à l’origine par le Dr J. Pessoa<br />
Men<strong>de</strong>s, est actuellement sous <strong>la</strong> direction du Dr J. Alexandre Sittart.<br />
Le Pr. Sebastião Almeida Prado Sampaio se distingue parmi les <strong>de</strong>rmatologues qui<br />
contribuèrent le plus à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s nouveaux spécialistes. Nous pouvons aussi mentionner<br />
João Bicudo Junior, Argemiro Rodrigues <strong>de</strong> Souza, Vinicio Arruda Zamith,<br />
Estevão Almeida Neto, Norberto Beliboni, Guilherme V. Curban, ainsi que <strong>la</strong> section<br />
régionale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, créée en 1970.<br />
Hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Estatal<br />
Dans l’univers <strong>de</strong>s utilisateurs <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Estatal <strong>de</strong> Sao Paulo,<br />
qui comprend 3 millions <strong>de</strong> personnes, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie reçoit une moyenne<br />
mensuelle <strong>de</strong> 2500 patients. Il propose, grâce à <strong>de</strong>s conventions conclues avec les facultés<br />
105
PAULO R. CUNHA<br />
106<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, un internat et accueille trois mé<strong>de</strong>cins rési<strong>de</strong>nts tous les ans. Le processus<br />
<strong>de</strong> formation nécessite l’é<strong>la</strong>boration obligatoire d’une monographie réalisée sous l’orientation<br />
<strong>de</strong>s précepteurs.<br />
Parmi les réussites du service notons : d’importants travaux publiés dans le pays et à<br />
l’étranger, <strong>la</strong> participation à <strong>de</strong>s rencontres et l’édition d’un livre dont le titre est Dermatología<br />
para el Clínico [Dermatologie pour le généraliste], qui en est déjà à sa 3 e édition.<br />
Le centre d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologiques Dr José Pessoa Men<strong>de</strong>s (qui fut directeur du<br />
service médical jusqu’en 1987 et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD nationale et régionale) contribue<br />
activement à encourager <strong>la</strong> recherche scientifique dans cette unité autorisée par <strong>la</strong><br />
Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le Pr. Alexandre Sittart est chargé <strong>de</strong> diriger ce service<br />
; il fait également partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’AMB.<br />
Hôpital Heliópolis<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Heliópolis (Sao Paulo), créé il y a environ<br />
trente ans, <strong>de</strong>vint un centre <strong>de</strong> référence dans le traitement <strong>de</strong>s mycoses profon<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s<br />
vascu<strong>la</strong>rites, <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies bulleuses et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées graves, dont le diagnostic<br />
et le traitement s’avèrent difficiles.<br />
Le Dr Alice Alchorne fut à l’origine <strong>de</strong> sa création ; elle en assuma <strong>la</strong> direction pendant<br />
vingt-<strong>de</strong>ux années consécutives. Actuellement, le Pr. Jacob Levites est le chef du<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Depuis 1984, le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie y est autorisé par le<br />
MEC et <strong>la</strong> SBD.<br />
Ce service dispose d’une infirmerie spécialisée avec dix lits et il offre un soin continu à <strong>la</strong><br />
communauté locale, et même à <strong>la</strong> région d’Ipiranga et <strong>de</strong> l’ABC Pauliste. Il a formé jusqu’à<br />
présent <strong>de</strong> nombreux spécialistes et participé à tous les événements liés à <strong>la</strong> spécialité.<br />
Hôpital <strong>de</strong>l Servidor Público Municipal<br />
La clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’HSPM fut inaugurée en 1945. Tout au long <strong>de</strong> ses<br />
soixante ans d’existence, <strong>la</strong> direction fut exercée par les Drs Aurélio Ancona López,<br />
Alexandre Mello Filho, Ival Peres Rosa, Yassubonu Utiyama et Bogdana Victoria Kadunc.<br />
En 1972, encore sous <strong>la</strong> direction d’Alexandre Filho, le Dr Ival Peres Rosa introduisit<br />
<strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, qu’il pratiqua, diffusa et enseigna ; c’est ainsi que <strong>la</strong> clinique<br />
<strong>de</strong>vint <strong>la</strong> première au Brésil à effectuer <strong>de</strong>s actes chirurgicaux sans l’intervention<br />
<strong>de</strong>s chirurgiens esthétiques ou généraux. Les assistants <strong>de</strong> l’hôpital municipal se distinguèrent<br />
aussi bien dans le pays qu’à l’étranger, en publiant <strong>de</strong>s livres et <strong>de</strong>s articles sur<br />
le sujet. La clinique dispose <strong>de</strong> cinq salles chirurgicales — dont une <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong> Mohs —, un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie, <strong>de</strong>s centres d’étu<strong>de</strong>s et dix cabinets ; on<br />
y reçoit 200 patients par jour et près <strong>de</strong> 1 000 interventions chirurgicales y sont effectuées<br />
chaque mois.<br />
Le service <strong>de</strong> Jundiaí<br />
Le Pr. Paulo Rowilson Cunha, son chef actuel, raconte: « Les premières années du service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí ont été merveilleuses et difficiles<br />
à <strong>la</strong> fois; elles ont été propices au développement d’actions et d’axes <strong>de</strong> travail (pour les<br />
rési<strong>de</strong>nts, les <strong>la</strong>boratoires, les cliniques, chez les patients et auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté).<br />
Un projet pilote parfait, dont les objectifs étaient c<strong>la</strong>irement l’enseignement, <strong>la</strong><br />
recherche et le soin médical, fut entamé sous <strong>la</strong> direction du Pr. Fernando Augusto <strong>de</strong><br />
Almeida. Celui-ci <strong>de</strong>manda à <strong>de</strong>s personnalités bril<strong>la</strong>ntes telles que Carlos Machado,<br />
Vítor Reis, Célia Riscal<strong>la</strong>, Agenor Silveira, tous <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Sao Paulo, Benedito<br />
Corrêa (mycologie) et Câmara Lopes (pathologiste) <strong>de</strong> travailler avec lui.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> FMJ grandit progressivement selon ces objectifs et<br />
quelques-uns <strong>de</strong>s premiers rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s professeurs compétents : Célia Antonia<br />
Xavier, Iza Maria Bottene, Jacqueline Calvo, Mônica Bulizani, Otávio Moraes, et les
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
nouveaux membres qui rejoignirent l’équipe, comme les Prs Lucía Helena Arruda et<br />
Dense Steiner. Lors <strong>de</strong> son 25 e anniversaire en 2002, le service célébra <strong>la</strong> formation <strong>de</strong><br />
50 rési<strong>de</strong>nts, dont <strong>la</strong> plupart furent approuvés au TED et certains incorporés au magistère<br />
<strong>de</strong> l’unité propre.<br />
Le Pr. Dr Paulo R. Cunha est professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí. En 1997, il obtint le titre d’enseignant libre <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’USP avec <strong>la</strong> thèse « Étu<strong>de</strong> comparative sur <strong>la</strong> sensibilité <strong>de</strong>s tests d’immunofluorescence<br />
indirecte et Immunoblotting ou Western Blotting pour <strong>la</strong> détection<br />
d’anticorps intercellu<strong>la</strong>ires dans les différentes formes et phases évolutives <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
du pemphigus foliacé ou Fogo Selvagem ». En 1988, il obtint le doctorat en <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> FMUSP, en présentant <strong>la</strong> thèse « Étu<strong>de</strong> du sérum épidémiologique dans le<br />
foyer du pemphigus foliacé endémique (Fogo Selvagem) dans l’État <strong>de</strong> Sao Paulo ». Il<br />
effectua un post-doctorat à <strong>la</strong> New York University. Il fut directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1996-2000.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Jundiaí se distingue dans le<br />
domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, principalement sur le Fogo Selvagem. Ses membres sont fiers<br />
d’avoir participé au progrès et au prestige national qu’acquit le service.<br />
L’exemple <strong>de</strong> Rio Preto<br />
Combien <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins pourront dire, comme le Pr. Dr João Roberto Antônio, que tous<br />
les spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie formés entre 1971 et 2004 furent leurs élèves?<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Sao José do Rio Preto (État <strong>de</strong> Sao Paulo) débuta<br />
lorsqu’il fut nommé professeur directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Né à Catanduva<br />
et installé à Rio Preto dès l’âge <strong>de</strong> 2 ans, le Pr. João Roberto Antônio obtint son diplôme<br />
à <strong>la</strong> faculté nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1964 ; il prépara le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie<br />
à <strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, au sein du service du Pr.<br />
Sylvio Fraga, et suivit ultérieurement plusieurs cours <strong>de</strong> perfectionnement au Brésil<br />
et à l’étranger.<br />
Une fois qu’il eut reçu le titre <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie (SBD, 1967), il retourna<br />
à Rio Preto pour se consacrer à l’enseignement <strong>de</strong> cette spécialité à <strong>la</strong> faculté ; en 1971,<br />
il dispensa le premier cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 4 e année du cursus. Les cours pratiques<br />
se faisaient initialement dans l’unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Casa locale, mais ils furent<br />
ensuite transférés à l’hôpital <strong>de</strong> base. Plusieurs élèves suivirent l’enseignement en <strong>de</strong>rmatologie<br />
(intégrant par <strong>la</strong> suite le groupe d’enseignants), qui jouit actuellement d’un<br />
certain prestige.<br />
Nous citerons parmi ses membres les Drs João Roberto Antonio, Euri<strong>de</strong>s Pozetti,<br />
Vânia Rodrigues, Ana Maria Nogueira, Tânia Regina Barbon, Margareth Lima, Rosa<br />
Maria Soubhia et Carlos Alberto Antonio. Ils rédigèrent — individuellement ou en<br />
groupe — plusieurs articles scientifiques pour <strong>de</strong>s revues médicales nationales et internationales<br />
; ils reçurent <strong>de</strong>s prix pour leurs travaux présentés aux congrès ; ils col<strong>la</strong>borèrent<br />
à <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> chapitres pour <strong>de</strong>s livres <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésiliens et étrangers<br />
et ils sont invités en tant que conférenciers à <strong>de</strong>s congrès, <strong>de</strong>s journées et <strong>de</strong>s cours,<br />
aussi bien au Brésil qu’à l’étranger.<br />
Le Pr. Joao Roberto Antonio signale que <strong>de</strong>puis 1974, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’hôpital <strong>de</strong> base et <strong>la</strong> matière <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> FAMERP organisent les cours du<br />
résidanat et d’apprentissage pour <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Complexe hospitalier Padre Bento <strong>de</strong> Guarulhos<br />
À l’institution initiale, inaugurée le 5 juillet 1931 pour soigner les patients lépreux,<br />
s’adjoignit en 1972 l’hôpital Adhemar <strong>de</strong> Barros, donnant ainsi naissance au complexe<br />
hospitalier.<br />
107
PAULO R. CUNHA<br />
108<br />
La Société pauliste <strong>de</strong> léprologie fut fondée le 23 août 1933 ; son siège se trouvait à <strong>la</strong><br />
clinique Padre Bento ; <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> Leprología <strong>de</strong> São Paulo, qui <strong>de</strong>viendrait plus tard <strong>la</strong><br />
Revista Brasileña <strong>de</strong> Leprología, fut créée peu <strong>de</strong> temps après.<br />
L’hôpital Adhemar <strong>de</strong> Barros, qui soignait les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> Fogo Selvagem, fut<br />
transféré en 1972 dans les locaux <strong>de</strong> l’hôpital Padre Bento.<br />
Le Dr Mário Luís Macca fut le premier chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, suivi du<br />
Dr Thais Romero Gatti et du Dr Vitor Manoel Silva dos Reis (1989). En 1991, <strong>la</strong> SBD<br />
donna son autorisation. En 1996, suite à <strong>la</strong> création du poste, le Dr Vitor fut désigné<br />
titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’au mois <strong>de</strong> septembre 2000.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, inauguré en 1998, porte le nom du Pr. Sebastião <strong>de</strong><br />
Almeida Prado Sampaio et possè<strong>de</strong> sept salles pour le soin du public général, 62 lits<br />
exclusifs pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, un centre chirurgical, une salle pour les premiers<br />
secours, une salle pour les prélèvements <strong>de</strong> sang, un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie, une mycothèque,<br />
<strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie, une salle d’archives pour les illustrations<br />
et un auditorium. Son directeur est le Pr. Dr Mario Cezar Pires.<br />
L’unité ambu<strong>la</strong>toire reçoit 2 500 consultations et réalise 150 interventions chirurgicales<br />
par mois ; elle inclut <strong>de</strong>s sous-spécialités telles que les ma<strong>la</strong>dies bulleuses, <strong>la</strong> cosmétologie,<br />
<strong>la</strong> cryothérapie, l’allergie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique et <strong>la</strong><br />
mycologie.<br />
Hôpital Lauro Souza Lima<br />
En 1989, l’institut Lauro Souza Lima (Bauru, SEP) fut officiellement reconnu comme<br />
étant un centre <strong>de</strong> recherche, en reconnaissance <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong>s soins liés<br />
à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui y étaient effectués, ainsi que <strong>de</strong> l’entraînement du personnel spécialisé.<br />
Son service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, créé en 1977, eut comme fondateur et premier chef le<br />
Pr. Milton W<strong>la</strong>dimir Araújo Opromol<strong>la</strong>. Comme ses étu<strong>de</strong>s portaient spécialement sur <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen, l’institut <strong>de</strong>vint pour tous les pays <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue portugaise le centre <strong>de</strong><br />
référence du secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Sao Paulo et <strong>de</strong> l’OMS dans l’analyse <strong>de</strong><br />
cette ma<strong>la</strong>die. 82 <strong>de</strong>rmatologues y ont obtenu leur diplôme <strong>de</strong>puis sa création; actuellement,<br />
12 professionnels par an sont diplômés en tant que spécialistes. Le résidanat a une<br />
durée <strong>de</strong> trois ans. L’hôpital a signé une convention avec <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Botucatu,<br />
et abrite <strong>de</strong>ux titu<strong>la</strong>ires en spécialisation <strong>de</strong> l’USP et <strong>de</strong> l’école pauliste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Travail pionnier à Botucatu<br />
Créée en juillet 1962 sous le nom <strong>de</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales et biologiques <strong>de</strong><br />
Botucatu, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine locale, qui a débuté ses activités en avril 1963 et qui est<br />
actuellement rattachée à l’université Estadual Pauliste (UNESP), dut faire face à <strong>de</strong>s difficultés<br />
originales : elles ont, d’après les propos du chef <strong>de</strong> service le Pr. Sílvio Alencar<br />
Marques, « forgé l’esprit guerrier et persévérant <strong>de</strong> l’école dans cette tradition, s’adaptant<br />
à <strong>la</strong> personnalité <strong>de</strong> celle qui fut <strong>la</strong> pionnière du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, le<br />
Dr Neuza Lima Dillon ».<br />
En 1966, le Dr Dillon intégrait le groupe d’enseignants et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’USP qui arriva<br />
à Botucatu pour dispenser le premier cours pionnier <strong>de</strong> sémiologie <strong>de</strong>rmatologique<br />
dans <strong>la</strong> première c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté. Installée dans <strong>la</strong> ville, elle <strong>de</strong>vint responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie au département <strong>de</strong> clinique médicale. « Tout était insuffisant et difficile,<br />
mais le Dr Neuza a reçu l’ai<strong>de</strong> inestimable <strong>de</strong>s Prs Sebastião Sampaio, Norberto Belliboni,<br />
Raymundo Martins Castro et Dilton Opromol<strong>la</strong> pour consoli<strong>de</strong>r le cours. Elle n’hésitait pas<br />
à mettre <strong>de</strong> l’argent <strong>de</strong> sa poche pour fournir <strong>de</strong> façon permanente le matériel et les articles<br />
nécessaires à <strong>la</strong> discipline. Elle a tout <strong>de</strong> suite perçu que le fait <strong>de</strong> mettre les lits <strong>de</strong><br />
l’infirmerie à <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, d’être présente lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> diplômes<br />
et <strong>de</strong> vouloir créer avec une audace suprême le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie représentait<br />
un bon moyen <strong>de</strong> s’affirmer et <strong>de</strong> grandir. »
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
De nouveaux enseignants furent embauchés entre 1971 et les années 1980 : Marta<br />
Cassoni Habermann, Sílvio Alencar Marques, Joel Carlos Lastória, Hamílton Ometto<br />
Stoff, Sílvia Regina Barraviera, Vidal Haddad Júnior et Maria Regina Silvares (rappelons<br />
qu’à Botucatu, les enseignants sont sous le régime du temps complet et du dévouement<br />
exclusif). La création <strong>de</strong> l’UNESP en 1976 entraîna <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> nouveaux départements,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie se liant à <strong>la</strong> radiologie et aux ma<strong>la</strong>dies infectieuses et parasitaires<br />
; en 1994 surgit le département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> radiothérapie. Ce<strong>la</strong><br />
représentait <strong>la</strong> meilleure solution, bien que les possibilités <strong>de</strong> nouvelles embauches fussent<br />
toujours limitées.<br />
Le résidanat débuta en 1970, comptant quatre lits et une gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> soins<br />
ambu<strong>la</strong>toires ; il traversa un processus <strong>de</strong> consolidation lent et difficile jusqu’en 1978,<br />
début <strong>de</strong> sa croissance. Quatre-vingt-<strong>de</strong>ux rési<strong>de</strong>nts obtinrent leur diplôme entre 1970<br />
et 2001. Depuis 1994 jusqu’à nos jours, six postes vacants sont offerts. Quant au service<br />
proprement dit, il disposait <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux lits en 1968, tandis qu’actuellement il en possè<strong>de</strong><br />
seize. L’unité ambu<strong>la</strong>toire générale et spéciale fonctionne quotidiennement en <strong>de</strong>ux services,<br />
disposant <strong>de</strong> sept salles <strong>de</strong> consultations, <strong>de</strong>ux salles <strong>de</strong> chirurgie et une salle <strong>de</strong><br />
premiers secours. Elle dispose également <strong>de</strong> services <strong>de</strong> mycologie, <strong>de</strong> documents photographiques,<br />
d’immunologie allergique, <strong>de</strong> photobiologie et <strong>de</strong> télémé<strong>de</strong>cine.<br />
Hôpital et maternité Celso Piero (PUC Campinas)<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC Campinas fut mis en p<strong>la</strong>ce en 1979 par le<br />
Pr. Dr Walter Belda, son directeur jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 80. Les premiers assistants embauchés<br />
furent le Dr Antônio Francisco Bastos, Maria Elizabeth Nanni et ultérieurement le<br />
Dr João Roberto Pupo Neto. Le résidanat fut approuvé par le MEC en 1987, instituant <strong>de</strong>ux<br />
postes vacants pour <strong>la</strong> 1 re ou <strong>la</strong> 2 e année en <strong>de</strong>rmatologie; cette situation se maintient jusqu’à<br />
nos jours, et une expérience <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans dans <strong>la</strong> clinique médicale est exigée.<br />
Après quelques difficultés, le Dr Lúcia Arruda assuma <strong>la</strong> direction du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en 2002 et se fixa l’objectif <strong>de</strong> lui fournir une nouvelle structure. Actuellement<br />
les Drs Mariana Zaniboni, Sylvia Ipiranga, Márcia Mayko Kobayashi, Cláudia Valéria<br />
Braz et Valéria Pereira Santos sont embauchées pour travailler à l’hôpital Celso Piero;<br />
les Drs Ril<strong>de</strong> Veríssimo (Service d’anatomie pathologique), Glória Sasseron et Antonio<br />
Bastos Filho (unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie) et le Pr. Magali Soares (enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie) col<strong>la</strong>borent en tant que mé<strong>de</strong>cins volontaires. Les réunions du service<br />
ont lieu le mardi, un professeur invité y participant tous les premiers mardis du mois.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’ABC<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’ABC doit ses débuts au Pr. Luis Henrique Camargo Paschoal,<br />
pionnier en chirurgie <strong>de</strong>rmatologique; aujourd’hui c’est le Dr Carlos Machado Filho<br />
qui en a <strong>la</strong> responsabilité. Le centre <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique est actuellement considéré<br />
comme étant l’un <strong>de</strong>s meilleurs d’Amérique <strong>la</strong>tine. Le Dr Luis Henrique Camargo Paschoal<br />
et ses disciples Carlos Machado, Mário Marques, Eliandre Palermo et Francisco Levocci se<br />
distinguent dans <strong>la</strong> sous-spécialité au Brésil. Le Pr. Francisco Macedo Paschoal fut également<br />
l’un <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatoscopie c<strong>la</strong>ssique et numérique.<br />
Outre les services mentionnés ci-<strong>de</strong>ssus, Sao Paulo possè<strong>de</strong> d’autres services habilités<br />
tels que l’hôpital universitaire W<strong>la</strong>dimir Arruda (chef <strong>de</strong> service : Dr Luiz Cucé), l’hôpital<br />
Guilherme Álvaro, <strong>la</strong> fondation Lusíadas (chef <strong>de</strong> service : Pr. Dr Ney Romitti),<br />
l’université <strong>de</strong> Sao Paulo, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Ribeirão Preto (chef <strong>de</strong> service :<br />
Pr. Norma Foss), Unicamp (chef <strong>de</strong> service : Dr Elemir Macedo <strong>de</strong> Souza), <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marília (chef <strong>de</strong> service : Dr Spencer Sornas) et l’hôpital universitaire <strong>de</strong><br />
Taubaté–UNITAU (chef <strong>de</strong> service : Dr Samuel Man<strong>de</strong>lbaum) 3 .<br />
109
PAULO R. CUNHA<br />
110<br />
DERMATOLOGIE DU PARANÁ<br />
Curitiba<br />
Le majestueux hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> l’université fédérale du Paraná possè<strong>de</strong><br />
49196m 2 <strong>de</strong> constructions, 191 cabinets, 374 unités ambu<strong>la</strong>toires et 635 lits distribués en<br />
quarante-cinq spécialités; il abrite l’un <strong>de</strong>s plus prestigieux services habilités par <strong>la</strong> SBD,<br />
à <strong>la</strong> charge du Pr. Jesús Rodrigues Santamaría, qui fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’entité nationale.<br />
Fondé en 1961, lorsque le Pr. Rui Miranda était encore professeur, le service <strong>de</strong>rmatologique<br />
du HC compte déjà quatre décennies. Il fonctionne dans <strong>de</strong>ux immeubles : l’un<br />
pour les services administratifs et l’autre pour les services ambu<strong>la</strong>toires et le centre chirurgical<br />
ambu<strong>la</strong>toire pour toutes les spécialités. Ce centre fournit également au service<br />
sept salles pour le soin du public général, sept cabinets, une salle pour <strong>de</strong>s soins mineurs<br />
et une salle pour l’équipe. En moyenne, soixante-dix patients y sont soignés par jour, originaires<br />
du Paraná, du Mato Grosso et <strong>de</strong> Santa Catarina. À Curitiba prédominent les<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> type européen propres à l’ethnie <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, telles que le<br />
cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, le lupus, le col<strong>la</strong>génose, le psoriasis, le diabète, l’artériosclérose et<br />
l’insuffisance vascu<strong>la</strong>ire.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s murs du HC, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie finance le centre Souza Araújo<br />
(créé par Rui Noronha <strong>de</strong> Miranda), qui reçoit entre quarante et cinquante personnes par<br />
jour, et se consacre principalement à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire et à l’onco-<strong>de</strong>rmatologie.<br />
Le service, une référence pour tout le système SUS, reçoit, outre les étudiants <strong>de</strong> l’internat,<br />
les rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique médicale qui passent un mois en <strong>de</strong>rmatologie, et les<br />
élèves <strong>de</strong> l’internat qui choisirent <strong>la</strong> spécialité pour y passer les quatre-vingts <strong>de</strong>rniers<br />
jours d’entraînement à l’institution, 100 élèves du cursus <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine par semestre.<br />
Quant à <strong>la</strong> production scientifique, le service du HC <strong>de</strong> Curitiba <strong>la</strong>issa son empreinte<br />
dans les Annales brésiliennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ainsi que dans <strong>de</strong>s publications étrangères,<br />
grâce à <strong>de</strong>s travaux sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen et le pemphigus.<br />
Dermatologie <strong>de</strong> Londrina<br />
La faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du nord du Paraná, située à Londrina, fut fondée en 1967,<br />
mais ce ne fut que trois ans plus tard qu’elle commença l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
grâce aux Prs Drs José Schwein<strong>de</strong>n (titu<strong>la</strong>ire) et Lorivaldo Minelli (assistant), suivis<br />
par leurs collègues Roberto Piraino et Roberto Schnitzler.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1979, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine s’unit à d’autres facultés pour former l’université<br />
étatique <strong>de</strong> Londrina. À cette occasion, le titu<strong>la</strong>ire fut obligé <strong>de</strong> retourner à Curitiba,<br />
et le Dr Minelli prit alors en charge <strong>la</strong> discipline ; il conserve <strong>de</strong> nos jours le poste.<br />
Trois ans auparavant, en 1976, les Drs Minelli et Piraino avaient soutenu leurs thèses <strong>de</strong><br />
doctorat et obtinrent les postes <strong>de</strong> professeur assistant. La thèse du Dr Minelli, Géographie<br />
médicale du pemphigus foliacé sud-américain dans l’État du Paraná, fut dirigée par<br />
le Pr. Raymundo Martins Castro, tandis que celle du Dr Piraino, Porokératose <strong>de</strong> Mibelli,<br />
le fut par le Pr. Dr José Kriner, originaire d’Argentine.<br />
En 1998, le Dr Minelli fut promu au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> professeur associé par concours public<br />
présidé par le Pr. Dr Sebastião <strong>de</strong> Almeida Prado Sampaio.<br />
Dans les années 70 et 80, plusieurs rési<strong>de</strong>nts firent leur spécialité à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’université ; à partir <strong>de</strong>s années 90, le résidanat fut officialisé par <strong>la</strong> Société<br />
brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, offrant <strong>la</strong> possibilité à plusieurs anciens élèves d’obtenir<br />
leurs diplômes <strong>de</strong> spécialiste.<br />
Hôpital universitaire évangélique <strong>de</strong> Curitiba<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie naquit en 1974, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté évangélique<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Son premier professeur titu<strong>la</strong>ire, le Dr Fernando Laynes <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>,<br />
intégra <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en 1989, accompagné <strong>de</strong>s Drs Álvaro Schiavi Jr.
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
et C<strong>la</strong>risse Furtado. Actuellement, <strong>la</strong> direction du service repose sur le Dr Anelise<br />
Roskamp Bu<strong>de</strong>l.<br />
Le réseau d’assistance <strong>de</strong> l’intendance est lié à celui <strong>de</strong> l’État, se répartissant près <strong>de</strong><br />
1000 patients par mois.<br />
La Santa Casa <strong>de</strong> Misericordia, PUC, dont le chef <strong>de</strong> service est le Dr Luiz Carlos<br />
Pereira, est un autre service habilité à Paraná.<br />
Gaúchos et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Le Dr Ernst von Bassewitz, un Allemand diplômé à Berlin en 1890, exerça pour <strong>la</strong><br />
première fois <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Rio Gran<strong>de</strong> do Sul. Après être passé par Sao Paulo, il arriva<br />
à <strong>la</strong> pampa gaúcha <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> do Sul en 1894, travail<strong>la</strong>nt dans <strong>de</strong>s localités lointaines<br />
du littoral et <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne. En 1927 il publia dans les Annales <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul un rapport sur l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre sur <strong>la</strong> colonie germanique.<br />
Le Dr Mo<strong>de</strong>sto José <strong>de</strong> Souza fut le premier professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Porto Alegre, créée en 1898 ; il fut suivi par le Dr<br />
Rodolfo Masson et ensuite, par concours public, par le Dr Ulisses <strong>de</strong> Nonohay ; ce <strong>de</strong>rnier<br />
intégra aussi <strong>la</strong> colonne révolutionnaire qui partit vers Rio <strong>de</strong> Janeiro en suivant Getúlio<br />
Vargas.<br />
Le cours comparé <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et syphiligraphique fut créé en 1942 à<br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Porto Alegre, dirigé par José Gerbase, originaire d’A<strong>la</strong>goas,<br />
disciple <strong>de</strong> Ramos e Silva. En 1946 vint s’y joindre le Pr. Clóvis Bopp, professeur <strong>de</strong>puis<br />
1959 grâce à <strong>la</strong> thèse Chromob<strong>la</strong>stomycose : contribution à son étu<strong>de</strong>. En 1992 et suite à<br />
un concours public, le Pr. Lúcio Bakos fut nommé professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’université fédérale <strong>de</strong> Rio Gran<strong>de</strong> do Sul.<br />
Sciences médicales<br />
La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté fédérale <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> Porto Alegre fut créée<br />
en 1960 sous le nom <strong>de</strong> faculté catholique <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, avec <strong>la</strong> Fraternité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa<br />
Casa <strong>de</strong> Misericordia. Quatre ans plus tard, le Pr. Enio Candiota <strong>de</strong> Campos, scientifique<br />
réputé, fut désigné premier titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, aux côtés <strong>de</strong>s Prs<br />
Achyles Hemb, Gise<strong>la</strong> Del Pino et Aída Schafranski. Après <strong>la</strong> mort du premier,<br />
le Pr. Dr Armin Bernhard prit le re<strong>la</strong>is comme titu<strong>la</strong>ire, remp<strong>la</strong>cé par le Pr. Cláudio<br />
Bartelle.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> FFFCMPA est situé dans le complexe hospitalier <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Santa Casa <strong>de</strong> Porto Alegre, où sont dispensés les cours d’étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong> spécialisation.<br />
Érika Geier, Walmor Bonatto, Renan Bonamigo, Irene Menezes, Aída Schafranski,<br />
Carolina Feijó, Raquel García comptent parmi les professeurs, accompagnés<br />
d’autres col<strong>la</strong>borateurs.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>la</strong> UFRGS<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> Porto Alegre compte trois professeurs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> UFRGS : un titu<strong>la</strong>ire, Lúcio Bakos, et <strong>de</strong>ux adjoints, Tânia Cestari et Luiz<br />
Fernando Bopp Muller. Il compte également cinq mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues — Ane K.<br />
Simões Pires, Isabel C. P. Kuhl, Márcia S. Zampese, Marlene L. Weissbluth et Mirian Pargendler<br />
—, <strong>de</strong>ux rési<strong>de</strong>nts et trois élèves, en plus <strong>de</strong>s élèves <strong>de</strong> maîtrise, et un élève <strong>de</strong><br />
doctorat par an. Outre ces activités d’enseignement, les membres du service se consacrent<br />
à l’assistance et à <strong>la</strong> recherche (celle-ci est très stimulée à tous les niveaux).<br />
Considéré comme le centre <strong>de</strong> référence du sida à Rio Gran<strong>de</strong> do Sul, le service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’HC <strong>de</strong> Porto Alegre dispose d’un secteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatoscopie numérique,<br />
avec vidéo-<strong>de</strong>rmatoscopie et analyse <strong>de</strong>s images ; un secteur <strong>de</strong> photothérapie et <strong>de</strong> photobiologie,<br />
pour soigner les patients photosensibles ; un secteur <strong>de</strong> santé publique, car il<br />
reçoit les mé<strong>de</strong>cins qui se consacrent au sida, aux MTS et à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen<br />
111
PAULO R. CUNHA<br />
envoyés par le secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé. L’activité se fait en <strong>de</strong>ux services, les jours<br />
ouvrables, avec une gar<strong>de</strong> les jours fériés et les fins <strong>de</strong> semaine. Comme c’est un hôpital<br />
<strong>de</strong> référence, le service reçoit <strong>de</strong> nombreux patients pour les soins <strong>de</strong> niveau tertiaire,<br />
présentant <strong>de</strong>s pathologies systémiques et plus difficiles à traiter.<br />
Unité ambu<strong>la</strong>toire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire<br />
Elle fut créée en 1975 par le Dr César Duílio Varejão Bernardi, disciple du Pr. Clóvis<br />
Bopp et professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’université fédérale <strong>de</strong> RS. Sous <strong>la</strong> direction du<br />
secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé <strong>de</strong> l’État, il fonda ce service qui visait à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> nouveaux<br />
<strong>de</strong>rmatologues et avait pour priorité les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques d’intérêt sanitaire,<br />
notamment les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles et <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen. Une disposition<br />
gouvernementale <strong>de</strong> 1987 céda l’aire utilisée pour l’hospitalisation <strong>de</strong>s patients<br />
au secteur MST/sida : elle fut utilisée pour le soin <strong>de</strong>s porteurs du virus HIV ; ceci provoqua<br />
l’interruption provisoire <strong>de</strong>s activités du résidanat. Toutefois, le programme <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nt<br />
fut repris en 1997 et approuvé par <strong>la</strong> SBD un an plus tard. Actuellement, le service<br />
reçoit le soutien <strong>de</strong> l’État comme centre <strong>de</strong> formation en <strong>de</strong>rmatologie, avec une capacité<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux postes vacants par an. Le Dr Cecilia Cassal Corrêa est <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologue qui<br />
coordonne le service.<br />
Rio Gran<strong>de</strong> do Sul possè<strong>de</strong> un autre service habilité, celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique Santa<br />
C<strong>la</strong>ra ; le chef du service en est le Pr. Cláudio José Bartelle.<br />
Santa Catarina<br />
Santa Catarina possè<strong>de</strong> l’habilitation <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’université fédérale (chef <strong>de</strong> service<br />
: Pr. Jorge José <strong>de</strong> Souza Filho).<br />
■ L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA (Réunion annuelle <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains du cône sud)<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA (Réunion Annuelle <strong>de</strong>s Dermatologues Latino-Américains du Cône Sud)<br />
L’idée <strong>de</strong> <strong>la</strong> première réunion <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains du cône sud<br />
(Argentine, 1973) vint d’une discussion entre les Drs J. Gatti, P. Viglioglia, O. Mangano et<br />
S. Sampaio, pendant <strong>la</strong>quelle il fut également résolu que <strong>la</strong> réunion aurait un caractère<br />
annuel, sauf si elle coïncidait avec le Congrès ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(CILAD).<br />
Le Pr. Júlio César Empinotti présida <strong>la</strong> XXI ème RADLA, qui eut lieu à Foz do Iguaçu<br />
(Brésil) en 2001, et qui compta le plus grand nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins réunis dans l’histoire<br />
<strong>de</strong> cet événement. (Note <strong>de</strong> l´éditeur: voir dans ce livre le chapitre « Réunion annuelle<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains-RADL », p. 447).<br />
■ Quelques ma<strong>la</strong>dies ma<strong>la</strong>dies et leur traitement et leur traitement<br />
112<br />
Lèpre et ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
Ancien camara<strong>de</strong> <strong>de</strong> Carlos Chagas à l’institut Oswaldo Cruz, Eduardo Rabello reçut<br />
vers 1920, en qualité d’inspecteur général <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, <strong>la</strong> mission d’é<strong>la</strong>borer <strong>la</strong> première<br />
légis<strong>la</strong>tion brésilienne <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes, affections qui faisaient<br />
souffrir les patients, mis à part les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, les effets négatifs du<br />
manque d’information publique et du retard <strong>de</strong> <strong>la</strong> mentalité prédominante.<br />
On accusa les Noirs immigrés d’avoir introduit <strong>la</strong> lèpre, comme le signale Manoel Santos<br />
en par<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s ca<strong>la</strong>mités <strong>de</strong> Pernambuco entre 1707 et 1715. Selon cet auteur, les Noirs<br />
attrapèrent <strong>la</strong> lèpre au Brésil, probablement apportée par les Portugais qui l’auraient
contractée dans les lieux d’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die au XVI e siècle: l’île <strong>de</strong> Madère, les<br />
Açores, les possessions marocaines et les In<strong>de</strong>s lusitaniennes. Un mé<strong>de</strong>cin portugais, Aleixo<br />
Guerra, écrivit dans son Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Lepra en Portugal [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Portugal]:<br />
« Il ne fait aucun doute que les Portugais ont introduit <strong>la</strong> lèpre au Brésil en l’an 1500, tel<br />
qu’ils l’avaient introduite à Madère, où elle était inconnue avant leur arrivée. »<br />
Au début du XX e siècle, cette ma<strong>la</strong>die représentait toujours un très grave problème <strong>de</strong><br />
santé publique. « Vers 1920 cependant prédominaient encore les préconcepts millénaires<br />
qui faisaient du pauvre <strong>la</strong>dre une victime effrayante d’un mal qui ne pardonne pas, un paria<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société, sans patrie ni famille, méprisé et condamné sans pitié à un exil perpétuel afin<br />
<strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> ses semb<strong>la</strong>bles qui, pour compenser le sacrifice imposé, le traitaient<br />
avec mépris et parfois lui donnaient même une aumône humi<strong>la</strong>nte et rabaissante. »<br />
Eduardo Rabello conclut en 1933 <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> l’isolement <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, prévoyant qu’il<br />
serait facile dans l’avenir <strong>de</strong> contenir <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die dans sa phase macu<strong>la</strong>ire.<br />
À peu près vers <strong>la</strong> même époque, Rio <strong>de</strong> Janeiro et Sao Paulo (avec Emilio Ribas,<br />
Aguiar Pupo et Salles Gomes) se rassemblèrent pour entreprendre <strong>de</strong>s campagnes sur le<br />
problème, cherchant non seulement à humaniser le traitement mais aussi à établir <strong>de</strong>s<br />
éléments <strong>de</strong> prévention pour les enfants <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hanseniens. Nelson Souza Campos<br />
réussit à montrer en 1937 le cas curieux d’infiltrés tuberculoï<strong>de</strong>s précoces qu’il appe<strong>la</strong><br />
lèpre nodu<strong>la</strong>ire infantile et qui fut traduite par lepra-infeckt dans <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> Rabello (Jr.)<br />
(1941). Abrahão Rotberg démontra à son tour en 1934 <strong>la</strong> valeur du pronostic <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
réaction <strong>de</strong> Mitsuda, et en 1937 <strong>la</strong> notion du facteur N comme responsable <strong>de</strong>s formes<br />
<strong>de</strong> résistance <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen.<br />
En 1940, Aguiar Pupo fut le premier à montrer l’importance épidémiologique <strong>de</strong>s<br />
formes non caractéristiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Ces idées obtiendraient leur consécration à<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conférence pan<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> 1946 ; peu après, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong><br />
po<strong>la</strong>rité, postulée par Rabello (Jr.) <strong>de</strong>puis 1938, obtint <strong>la</strong> reconnaissance du milieu<br />
international en 1948 à La Havane.<br />
Le Fogo Selvagem<br />
Le Fogo Selvagem (FS) est une ma<strong>la</strong>die endémique <strong>de</strong> certaines régions du Brésil, qui<br />
touche environ 15 000 personnes et dont <strong>la</strong> prévalence se situe chez <strong>de</strong>s individus jeunes<br />
qui habitent les zones rurales du pays. À Sao Paulo, <strong>la</strong> croissance du nombre <strong>de</strong> cas dans<br />
les années 30 poussa le gouvernement à créer un hôpital exclusif pour ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ; plus<br />
tard, d’autres hôpitaux furent inaugurés à Goiânia et à Campo Gran<strong>de</strong>. En 1970, on<br />
estimait à 10 000 au moins le nombre <strong>de</strong> cas connus <strong>de</strong> FS dans les États endémiques du<br />
Brésil. Le Pr. Sebastião Sampaio (Sao Paulo) et le Pr. Luiz Díaz (USA) encouragèrent en<br />
1983 <strong>la</strong> création du Groupe coopératif Brésil-USA, consacré à <strong>la</strong> recherche sur le Fogo<br />
Selvagem; cette entreprise produisit <strong>de</strong>s dizaines <strong>de</strong> travaux scientifiques et contribua<br />
gran<strong>de</strong>ment à faire progresser <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathogenèse <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et le<br />
développement <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> diagnostic.<br />
Entre les années 50 et 90, l’inci<strong>de</strong>nce du FS diminua à Sao Paulo ; <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> doctorat<br />
du Pr. Paulo R. Cunha à l’USP informait du <strong>de</strong>rnier foyer dans l’État, situé dans les<br />
communes <strong>de</strong> Franco da Rocha et Mairiporã. Les caractéristiques épidémiologiques <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die révèlent fortement que le FS est influencé par <strong>de</strong>s facteurs environnementaux<br />
; les efforts <strong>de</strong>s chercheurs visent à déterminer l’agent étiologique environnemental<br />
qui déclenche cette ma<strong>la</strong>die au Brésil.<br />
Campagne <strong>de</strong> prévention du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
L’épidémie silencieuse, c’est-à-dire l’inci<strong>de</strong>nce croissante du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
dans le mon<strong>de</strong> entier, constitue aussi au Brésil l’un <strong>de</strong>s plus graves problèmes <strong>de</strong> santé<br />
113
Figures 14 et 15.<br />
Campagne <strong>de</strong><br />
prévention du cancer <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> peau (24 novembre<br />
2001)<br />
PAULO R. CUNHA<br />
publique. C’est pour cette raison que <strong>la</strong> campagne menée par <strong>la</strong> SBD fut é<strong>la</strong>rgie en<br />
1999 du domaine régional au domaine national, afin que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion prenne<br />
conscience <strong>de</strong>s conséquences terribles <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, dont 100 000 nouveaux cas sont<br />
répertoriés chaque année. Cette campagne accueille plus <strong>de</strong> 30 000 personnes par an<br />
(figures 14, 15).<br />
Le programme national <strong>de</strong> contrôle du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, coordonné par le Pr.<br />
Marcus Maia, fut créé dans le but d’informer et <strong>de</strong> faire prendre conscience du besoin<br />
<strong>de</strong> changer les attitu<strong>de</strong>s, les croyances et les conduites liées aux risques encourus par <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion.<br />
Ce programme se compose <strong>de</strong> cinq modules: 1. centre <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> traitement;<br />
2. programme d’éducation <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé ; 3. programme d’éducation<br />
pour <strong>la</strong> protection so<strong>la</strong>ire; 4. programme d’éducation à travers les médias ; 5. campagne<br />
annuelle pour l’examen <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
En 2000, <strong>la</strong> SBD et l’université fédérale <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro s’unirent pour inaugurer un<br />
service permanent <strong>de</strong> prévision quotidienne du taux <strong>de</strong> risque par brûlures so<strong>la</strong>ires. Le<br />
taux ultraviolet (TUV) est fourni sur Internet ou par téléphone; il est également fourni aux<br />
capitales <strong>de</strong>s États par le biais <strong>de</strong>s journaux, <strong>de</strong> <strong>la</strong> radio ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> télévision nationale.<br />
■ Les défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour le nouveau millénaire pour le nouveau millé-<br />
114<br />
La régionalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SBD débuta après <strong>la</strong> commémoration <strong>de</strong> ses cinquante ans<br />
d’existence, lorsque <strong>la</strong> participation fut ouverte à tous les États brésiliens. Actuellement<br />
les sections régionales exercent une influence extraordinaire dans les entreprises <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
SBD, renforçant ainsi <strong>la</strong> nationalisation <strong>de</strong> l’entité. Tout en garantissant l’intégration,<br />
elles agissent au sein <strong>de</strong>s unités comme <strong>de</strong> véritables délégations <strong>de</strong> l’entité majeure,<br />
sans perdre pour autant les caractéristiques <strong>de</strong>s organisations locales.<br />
Dans le domaine scientifique, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie n’est plus une spécialité purement clinique<br />
: elle a évolué en tant que spécialité clinico-chirurgicale. Tout comme <strong>la</strong> notion <strong>de</strong><br />
« santé » se vit é<strong>la</strong>rgie — <strong>la</strong> santé n’étant plus l’« absence <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies » mais plutôt un<br />
synonyme <strong>de</strong> bien-être physique, moral, social et mental —, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie inclut <strong>de</strong>s<br />
nouveautés qui attirent actuellement <strong>de</strong> nombreux professionnels et patients, dont<br />
l’attention se tourne spécialement vers <strong>la</strong> cosmétologie.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution vécue avec l’arrivée <strong>de</strong>s antibiotiques, <strong>de</strong>s corticostéroï<strong>de</strong>s et<br />
<strong>de</strong>s rétinoï<strong>de</strong>s, les défis <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie rési<strong>de</strong>nt encore dans les ma<strong>la</strong>dies infectieuses
comme le sida, <strong>la</strong> leishmaniose et les MST. De nouveaux concepts vont surgir grâce à <strong>la</strong><br />
biologie molécu<strong>la</strong>ire, et ces étu<strong>de</strong>s vont sans doute apporter <strong>de</strong>s bénéfices extraordinaires<br />
pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie brésilienne et mondiale. ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Campbell I. Zaitz C., Teixeira<br />
J.E., editores. História da<br />
Dermatología Brasileira. Uma<br />
La <strong>de</strong>rmatologie et les <strong>de</strong>rmatologues au Brésil<br />
Visão Panorâmica. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro : Medsi Editora<br />
Medica e Cientifica ; 1999.<br />
2. Carneiro G. História da<br />
Dermatología no Brasil. Rio <strong>de</strong><br />
Janeiro: Ed. Socieda<strong>de</strong> Brasileira<br />
<strong>de</strong> Dermatología; 2002.<br />
Octobre 2005<br />
3. Forgerini E. Rossini C. editores.<br />
Mestres da Dermatología<br />
Paulista, Sao Paulo : Editora<br />
JSN ; 2002.
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
EN COLOMBIE<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
COLLABORATEURS: DANIELLE ALENCAR-PONTE, ANTONIO BARRERA<br />
ARENALES, MICHEL FAIZAL GEAGEA, JAIME GIL JARAMILLO, FLAVIO GÓMEZ<br />
VARGAS, CARLOS HORACIO GONZÁLEZ ROJAS, GUILLERMO GUTIÉRREZ<br />
ALDANA, JAIRO MESA COCK, JUAN PEDRO VELÁSQUEZ BERRUECOS<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
Jaime Gil Jaramillo-César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z<br />
Certains auteurs estiment que les premiers habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> Colombie arrivèrent au<br />
pays en quête <strong>de</strong> nouvelles terres et <strong>de</strong> meilleures conditions <strong>de</strong> vie au cours d’une étape<br />
paléo-indigène (15 000 à 10 000 av. J.-C.). Profitant <strong>de</strong>s g<strong>la</strong>ciations, ils passèrent par le<br />
détroit <strong>de</strong> Behring en provenance d’Océanie et d’Asie ; d’après Mén<strong>de</strong>z Correa, il est également<br />
possible qu’ils soient arrivés par l’Antarctique et l’océan Pacifique 1 .<br />
La faible <strong>de</strong>nsité démographique, <strong>la</strong> dispersion <strong>de</strong>s colonies et l’absence d’animaux<br />
domestiques favorisèrent <strong>la</strong> dissémination moindre <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies ; <strong>de</strong>s évi<strong>de</strong>nces anthropologiques<br />
prouvent une croissance importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion parmi les Chibchas 2 .<br />
Nonobstant, ils souffrirent d’affections génétiques, auto-immunes, traumatiques, dégénératives<br />
et infectieuses, qui entraînèrent <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> prévention et<br />
<strong>de</strong> traitements ; ils découvrirent aussi certains médicaments.<br />
Les habitants préhispaniques du continent américain considérèrent sagement que<br />
l’être humain était un élément <strong>de</strong> plus dans le cosmos, et qu’ils ne pouvaient pas rompre<br />
l’équilibre <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature sans recevoir un châtiment visant leur santé. Nos indigènes c<strong>la</strong>ssifièrent<br />
les ma<strong>la</strong>dies en plusieurs groupes. Les Nukaks du sud-est du pays les divisaient<br />
en : 1) poussées et boutons associés à <strong>de</strong>s « fléchettes magiques » <strong>la</strong>ncées par <strong>de</strong>s « êtres<br />
ennemis » et/ou faisant partie d’un châtiment, soit que <strong>la</strong> chasse et <strong>la</strong> pêche avaient été<br />
infructueuses, soit qu’elles avaient été excessives ; 2) associées aux esprits <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt<br />
(EbEp) et à <strong>la</strong> piqûre <strong>de</strong>s tonnerres (takuEji), très dangereuses, qui pouvaient entraîner<br />
<strong>la</strong> mort; 3) associées au manque <strong>de</strong> respect <strong>de</strong>s normes ; 4) ma<strong>la</strong>dies mineures qui n’impliquaient<br />
pas <strong>la</strong> mort, telles les piqûres et les petites blessures 3 . Les Huitotos du Putumayo<br />
croyaient que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die était le produit d’attaques « chamanistes » (sorciers)<br />
d’autres tribus. Les Paeces les c<strong>la</strong>ssifiaient en visions du « lutin », du « cacique » et <strong>de</strong><br />
117
Figure 1.<br />
Céramique jamacoaque.<br />
Bartonellose.<br />
Collection privée <strong>de</strong><br />
Hugo A. Sotomayor T.<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
118<br />
l’« arc » ; cette <strong>de</strong>rnière catégorie incluait les enfants portant <strong>de</strong>s traits physiques d’animaux<br />
et qui présentaient <strong>de</strong>s boutons sur <strong>la</strong> peau. D’autres tribus les c<strong>la</strong>ssifièrent en<br />
ma<strong>la</strong>dies « chau<strong>de</strong>s » — comme <strong>la</strong> fièvre — et en ma<strong>la</strong>dies « froi<strong>de</strong>s » — comme le rhumatisme<br />
— ou simplement en acci<strong>de</strong>nts (fractures). Parmi les Emberas, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die était<br />
produite et guérie par les jais, qui étaient « l’essence <strong>de</strong>s choses, considérée comme une<br />
énergie, quelque chose <strong>de</strong> vital. » 4 Les Motilons tinrent compte <strong>de</strong> certaines notions <strong>de</strong><br />
contagion et donnèrent une valeur mineure à <strong>la</strong> sorcellerie. Les Chibchas définirent les<br />
mots liés aux ma<strong>la</strong>dies, par exemple sojusua (acné et furoncle), sinua (pellicules), gacha,<br />
bimi (ulcère), iza (ulcère, gale et variole) 5 .<br />
Ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques autochtones<br />
L’époque préhispanique connut certainement bien <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies ; cependant, <strong>la</strong> perte<br />
<strong>de</strong>s tissus mous <strong>de</strong>s dépouilles humaines conservées en empêche le constat. Néanmoins,<br />
certaines ma<strong>la</strong>dies furent catégoriquement définies. C’est le cas du carate, causé par le<br />
Treponema caratenum, appelé puru-pururú dans <strong>la</strong> région Guainía, qui était fréquent<br />
dans le Chocó 6 ; d’après le père Rivero, « ils souffraient <strong>de</strong> carate, qui affectait les mains<br />
et le visage avec <strong>de</strong>s taches bleues et b<strong>la</strong>nches, dont ils étaient fiers au point que les<br />
jeunes femmes ne souffrant pas <strong>de</strong> carate n’étaient pas <strong>de</strong>mandées en mariage<br />
». Les boubas, frambesía ou pian, causés par le Treponema pertenue, furent<br />
bien documentées par les étu<strong>de</strong>s paléontologiques <strong>de</strong> José Vicente<br />
Rodríguez Cuenca et Carlos Armando Rodríguez, réalisées sur <strong>de</strong>s dépouilles<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée du Cauca 6 . Des trouvailles archéologiques 7 (figure 1) prouvent <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> bartonellose (verrue péruvienne) — dont le vecteur est le Phlebotomus,<br />
Lutzomía colombiana —. Le charbon bactérien, appelé maraña, était<br />
fréquent dans <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guajira; selon Pineda Giraldo, « l’homme est<br />
contaminé lorsqu’une goutte <strong>de</strong> sang tombe sur sa peau quand il ouvre un animal,<br />
ou lorsqu’il se blesse en l’ouvrant, ou lorsqu’il mange <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> mal cuite<br />
<strong>de</strong> l’animal mort <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die ». Le toke<strong>la</strong>o (Tinea imbricata), touchait les<br />
Indiens du Chocó, <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte du Pacifique. Les fièvres pétéchiales et les boubas<br />
causèrent <strong>de</strong>s dégâts parmi les conquistadors lorsqu’ils arrivèrent par <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
Patía <strong>de</strong>puis le Pérou. La gale, les piqûres <strong>de</strong> moustiques, d’abeilles, <strong>de</strong> guêpes, <strong>de</strong><br />
tiques, <strong>de</strong> puces, d’arachni<strong>de</strong>s étaient fréquents; ainsi que les morsures <strong>de</strong> grands<br />
lézards (comme les caïmans), <strong>de</strong> serpents <strong>de</strong>s genres Bothrops, Lechesis mu<strong>la</strong>muta<br />
(putréfactrice) et Crotalus dirussus terrificus (serpent à sonnette), tout comme les morsures<br />
<strong>de</strong> chauve-souris, notamment <strong>de</strong> Desmodus rotundos, qui transmirent arbovirus et<br />
causèrent <strong>de</strong>s anémies 6 . La nigua (Tunga penetrans) et le gusano <strong>de</strong> monte (nuche,<br />
myiase) étaient complètement inconnus <strong>de</strong>s Européens ; d’après Safari, « on estime que<br />
les insectes <strong>de</strong>s régions tempérées provoquèrent davantage <strong>de</strong> victimes parmi les Espagnols<br />
durant <strong>la</strong> conquête que toutes les flèches empoisonnées <strong>de</strong>s Indiens. Ils ne connaissaient<br />
pas <strong>de</strong> remè<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> nigua, et pour se débarrasser <strong>de</strong>s moustiques ils étaient<br />
souvent obligés <strong>de</strong> s’enterrer dans le sable ». La fi<strong>la</strong>riose par Manzonel<strong>la</strong> ozardi, existe<br />
toujours dans nos forêts du Vaupés 2, 6 . La leishmaniose, dont José <strong>de</strong>l Carmen Rodríguez<br />
Bermú<strong>de</strong>z déduit <strong>la</strong> présence à partir d’une sculpture préhispanique trouvée à Cundinamarca,<br />
est également examinée. Les traces <strong>de</strong>s excréments fossiles prouvent <strong>la</strong> présence<br />
<strong>de</strong> plusieurs parasites intestinaux comme Strongiloi<strong>de</strong>s, ascaris et trichocéphales 6 .<br />
Quant à <strong>la</strong> syphilis vénérienne, son origine <strong>américaine</strong> ou européenne fut <strong>la</strong>rgement<br />
discutée, mais d’anciens témoignages écrits <strong>la</strong>issent supposer son existence dans nos<br />
terres à l’époque préhispanique. Des étu<strong>de</strong>s paléontologiques récentes remontant à<br />
3000 ans av. J.-C. — comme celles du Pr. José Vicente Rodríguez Cuenca (université nationale<br />
<strong>de</strong> Colombie) et <strong>de</strong> Gonzalo Correal Urrego, qui en trouva <strong>de</strong>s traces dans le tissu<br />
osseux <strong>de</strong>s dépouilles d’Aguazuque (Cundinamarca) — semblent le confirmer 6, 10 . Dans
son ouvrage Tratado l<strong>la</strong>mado fruto <strong>de</strong> todos los santos contra el mal serpentino venido<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> Españo<strong>la</strong> [Traité appelé fruit <strong>de</strong> tous les saints contre le mal serpentin venu <strong>de</strong><br />
l’île Españo<strong>la</strong>] (1509), le mé<strong>de</strong>cin espagnol Rodrigo Ruiz <strong>de</strong> Is<strong>la</strong> affirme qu’elle « fut apportée<br />
d’Haïti dans les nefs <strong>de</strong> Christophe Colomb, les premiers cas ayant existé à Barcelone<br />
en 1493 ». La même idée est exprimée dans Historia general y natural <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Indias<br />
[<strong>Histoire</strong> générale et naturelle <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s] du chroniqueur Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo<br />
(1535): « Ainsi, le ‘mal français’, ‘mal napolitain’, ‘mal serpentin’, ‘mal <strong>la</strong>zarin’ ou ‘ma<strong>la</strong>die<br />
<strong>de</strong>s courtisanes’ était en réalité une ma<strong>la</strong>die d’origine <strong>américaine</strong> »; et il note aussi<br />
dans une communication sur l’expansion <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis dans les nouvelles terres et sur son<br />
arrivée dans <strong>la</strong> péninsule Ibérique, adressée au roi d’Espagne: « Aux In<strong>de</strong>s... il existe le<br />
palo santo, que les indigènes appellent guayacán... La vertu principale <strong>de</strong> ce bois est <strong>de</strong><br />
guérir le mal <strong>de</strong>s boubas... il recueillent <strong>de</strong> fins éc<strong>la</strong>ts à partir <strong>de</strong> son bois … qu’ils font<br />
cuire dans une certaine quantité d’eau… et lorsque l’eau a disparu avec <strong>la</strong> cuisson… les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>la</strong> boivent certains jours, le matin, à jeun… et plusieurs ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s guérissent sans<br />
aucun doute <strong>de</strong> ce mal. Votre Majesté peut bien croire que cette ma<strong>la</strong>die est venue en<br />
Espagne en provenance <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s. » Il est possible que le Treponema ait subi <strong>de</strong>s mutations<br />
lors <strong>de</strong> son arrivée massive en Europe, sa pathogénicité grandissant dans un milieu<br />
et une popu<strong>la</strong>tion vierges jusqu’en 1493 2 .<br />
La présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose en Amérique préhispanique est aujourd’hui <strong>la</strong>rgement<br />
documentée par les techniques d’ADN ; <strong>de</strong>s dépouilles <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture muisca présentent<br />
<strong>de</strong>s lésions osseuses en un nombre re<strong>la</strong>tivement important <strong>de</strong> cas, ce qui <strong>la</strong>isse supposer<br />
que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die affecta beaucoup les communautés 6 .<br />
La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Chagas, produite par le Tripanosoma cruzi et transmise par <strong>de</strong>s triatomi<strong>de</strong>s,<br />
ne se trouve qu’en Amérique.<br />
Outre ces ma<strong>la</strong>dies, <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion native fut affectée par les blessures <strong>de</strong>s<br />
flèches empoisonnées soit par <strong>de</strong>s herbes (Ogen<strong>de</strong>ia terstroeniflora, Moracea et Strychnos<br />
toxicaria), soit par <strong>de</strong>s venins d’animaux tels que les crapauds (Dendrobates), les<br />
araignées (mygale) et les serpents. D’autres ma<strong>la</strong>dies non infectieuses furent l’hypothyroïdisme<br />
congénital, le goitre, le bec <strong>de</strong> lièvre, l’albinisme, le nanisme et <strong>la</strong> pilimiction<br />
(kyste <strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> vessie) observée à Popayán.<br />
P<strong>la</strong>ntes médicinales et métho<strong>de</strong>s thérapeutiques<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Les indigènes c<strong>la</strong>ssifièrent les p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> diverses façons, résumées comme suit :<br />
p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance (psychotropiques), amères (énergétiques), purgatives, stimu<strong>la</strong>ntes,<br />
préventives et médicinales au sens strict 11 . L’herboristerie indigène contribua<br />
beaucoup au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> thérapeutique ; parmi les p<strong>la</strong>ntes considérées sacrées<br />
et médicinales notons : l’achiote (Bixa orel<strong>la</strong>na), utilisé pour prévenir les brûlures du soleil<br />
; <strong>la</strong> chica (Bignonia chica), pour faire fuir les insectes et prévenir les morsures <strong>de</strong> serpents<br />
et <strong>de</strong> chauves-souris ; l’otoba (Miristicacea), pour <strong>la</strong> gale et le soin <strong>de</strong>s cheveux,<br />
utilisation inaltérée ; chez les Cubeo et les Macuna, le piment (Capsicum) fut employé<br />
pour traiter l’acné « pour maintenir le visage libre <strong>de</strong> points noirs et <strong>de</strong> taches ; le jus du<br />
piment, absorbé par le nez au moyen d’un tuyau <strong>de</strong> feuilles, exsu<strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse naturelle<br />
» ; pour guérir le nuche, ils mettaient un catap<strong>la</strong>sme en diachylon grâce à quoi <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>rve mourait et qu’ils pressaient ensuite ; <strong>la</strong> coca (Erythroxylon coca), qu’ils mâchaient<br />
(mambeo) pour obtenir un « organisme plus résistant » ; le palo santo et le guayacán, utilisés<br />
pour les boubas ; le coralito, dont le fruit « mouillé et frotté détruit les lèpres ou les<br />
taches qui surgissent sur le corps, que certains appellent dartres, d’autres carates et<br />
d’autres par <strong>de</strong>s noms semb<strong>la</strong>bles, immon<strong>de</strong>s et répugnantes, et qui <strong>la</strong>isse <strong>la</strong> chair et <strong>la</strong><br />
peau propres, sans aucun signe <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die 12 »… ; le tabac, utilisé comme cicatrisant, hémostatique<br />
et cautérisant pour les morsures ou les blessures causées par les flèches empoisonnées,<br />
fut peut-être l’herbe qui jouit le plus d’influence pendant <strong>la</strong> Colonisation 3,13 ;<br />
119
Figure 2.<br />
Temple so<strong>la</strong>ire. Saint-<br />
Augustin,<br />
300 après J.-C.<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
120<br />
<strong>la</strong> caraña (résine <strong>de</strong> palmier), pour les p<strong>la</strong>ies purulentes ou les blessures récentes ; les<br />
herbes <strong>de</strong>s boubas, dont on fabriquait une poudre pour l’épithélialisation <strong>de</strong>s blessures ;<br />
l’ace<strong>de</strong>ra pour le tabardillo et <strong>la</strong> quinquina pour les hématomes 9 .<br />
Outre les p<strong>la</strong>ntes, les indigènes employèrent <strong>de</strong>s substances et <strong>de</strong>s éléments animaux<br />
dans leurs traitements, par exemple un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> pâte <strong>de</strong> sébum, <strong>de</strong> vert-<strong>de</strong>-gris et <strong>de</strong><br />
farine <strong>de</strong> maïs grillée ou <strong>de</strong>s poudres d’écorce <strong>de</strong> crabe et <strong>de</strong> corail rouge pour soigner les<br />
p<strong>la</strong>ies; les os <strong>de</strong> <strong>la</strong>mantin furent utilisés comme hémostatiques et le miel d’abeille comme<br />
antiseptique local. Les <strong>de</strong>nts, crocs et griffes d’animaux étaient <strong>de</strong>s amulettes qui prévenaient<br />
les ma<strong>la</strong>dies. Pour les piqûres <strong>de</strong> vers et <strong>de</strong> certains scorpions, Aguado dit qu’ils<br />
« extraient les tripes et ils enduisent <strong>la</strong> piqûre avec <strong>de</strong>s herbes ramassées ». S’ils ne trouvaient<br />
pas l’animal qui les avait piqués et que l’endroit affecté était « le doigt ou une partie<br />
semb<strong>la</strong>ble, ils l’enfoncent dans le sexe <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme pour stopper <strong>la</strong> fureur du poison 9 ».<br />
Quelques-uns <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s actuellement employés étaient déjà utilisés par nos indigènes,<br />
qui avaient atteint un certain <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> développement en mé<strong>de</strong>cine et en thérapeutique.<br />
Des traces, même fragmentaires, <strong>de</strong> l’apport important <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacopée <strong>de</strong>s<br />
nouvelles terres sont contenues dans <strong>de</strong> précieuses <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conquête et <strong>la</strong> Colonisation. Notons les ouvrages <strong>de</strong> Nicolás Monar<strong>de</strong>s, qui publia en 1574<br />
son traité Primera, segunda y tercera parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> historia medicinal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas que se<br />
traen <strong>de</strong> nuestras Indias y que sirven <strong>de</strong> medicina [Première, <strong>de</strong>uxième et troisième parties<br />
<strong>de</strong> l’histoire médicinale <strong>de</strong>s choses apportées <strong>de</strong>puis nos In<strong>de</strong>s et qui servent <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine],<br />
ainsi que le Tratado <strong>de</strong> <strong>la</strong>s drogas y medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Indias [Traité sur les drogues<br />
et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s], <strong>de</strong> Cristóbal <strong>de</strong> Acosta. Les autres types <strong>de</strong> traitement incluaient<br />
l’hydrothérapie, <strong>la</strong> thermothérapie et <strong>la</strong> balnéothérapie dans <strong>de</strong>s puits d’eau thermale,<br />
ainsi que les régimes, les purges et les bains d’encens. Quant à <strong>la</strong> chirurgie, les indigènes<br />
effectuaient le drainage <strong>de</strong>s abcès et l’extraction <strong>de</strong> niguas avec <strong>de</strong>s épines ou <strong>de</strong>s fibules,<br />
tout comme <strong>de</strong>s trépanations crâniennes et <strong>de</strong>s craniotomies obturées avec <strong>de</strong> l’argile.<br />
Fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène<br />
La mé<strong>de</strong>cine indigène avait <strong>de</strong>ux fon<strong>de</strong>ments. Le premier, du genre préventif, aussi<br />
bien individuel que collectif, qui se manifestait <strong>de</strong> diverses façons: les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s graves<br />
étaient abandonnés dans le but <strong>de</strong> protéger <strong>la</strong> survie du groupe; les colonies se dép<strong>la</strong>çaient<br />
en fonction du cumul <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s quantités d’ordures et <strong>de</strong> déchets, comme une prévention<br />
envers les facteurs déclencheurs <strong>de</strong><br />
ma<strong>la</strong>dies; les femmes ayant leur menstruation<br />
étaient isolées ; les maisons<br />
étaient construites dans les arbres, et ils<br />
dormaient dans <strong>de</strong>s hamacs et sous <strong>de</strong><br />
petites tentes. Le <strong>de</strong>uxième, du genre<br />
symptomatique, faisait appel à l’ingestion,<br />
l’inha<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> mastication ou l’onction <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ntes diverses (au cours <strong>de</strong> régimes ou<br />
<strong>de</strong> saignées), <strong>de</strong>stinées à sou<strong>la</strong>ger les<br />
affections orales, épi<strong>de</strong>rmiques ou traumatiques.<br />
Cas extrême: <strong>la</strong> coutume <strong>de</strong> l’infantici<strong>de</strong>,<br />
pratiquée chez les nouveau-nés qui<br />
présentaient <strong>de</strong>s défauts physiques et dans<br />
le cas <strong>de</strong> certaines géno<strong>de</strong>rmatoses telles<br />
que l’albinisme 14 .<br />
Pendant <strong>la</strong> Découverte et <strong>la</strong> Conquête,<br />
nos indigènes subirent une grave détérioration<br />
organique, <strong>la</strong> diminution ou <strong>la</strong>
perte <strong>de</strong> leurs valeurs spirituelles ancestrales, un sentiment d’infériorité et <strong>la</strong> disparition<br />
presque totale <strong>de</strong> leur conception du mon<strong>de</strong> ; ceci fut <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong> l’imposition <strong>de</strong>s<br />
changements culturels — drastiques, rapi<strong>de</strong>s et forcés —, qui les amena à disparaître<br />
presque complètement 15 . Ces lignes, brèves mais sincères, constituent un hommage et un<br />
tribut pérenne d’admiration et <strong>de</strong> respect envers nos indigènes ; hier comme aujourd’hui,<br />
ils nous offrirent <strong>de</strong>s leçons <strong>de</strong> bonhomie, <strong>de</strong> vie commune harmonieuse et amoureuse<br />
avec les êtres animés ou inanimés que mère nature nous fournit (figure 2).<br />
César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z-Jaime Gil Jaramillo<br />
Alonso <strong>de</strong> Ojeda, Amerigo Vespucci et Juan <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cosa débarquèrent sur les terres<br />
colombiennes à Coquibacoa — <strong>de</strong> nos jours Cabo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ve<strong>la</strong>, péninsule <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guajira — en<br />
1499, ouvrant ainsi <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> conquête <strong>de</strong> notre territoire qui s’étendit jusqu’à 1550 1 .<br />
Santa Fe <strong>de</strong> Bogotá (aujourd’hui Bogotá) fut fondée au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, le 6 août<br />
1538, par Don Gonzalo Jiménez <strong>de</strong> Quesada. L’arrivée <strong>de</strong>s colonisateurs espagnols<br />
entraîna un changement radical chez les popu<strong>la</strong>tions indigènes, par rapport à leur façon<br />
<strong>de</strong> vivre, à leur alimentation, à leurs coutumes et à leurs croyances, également menacées<br />
par l’imposition d’une nouvelle religion. La vulnérabilité organique <strong>de</strong> nos aborigènes était<br />
déterminée par <strong>la</strong> malnutrition — leur alimentation était basée sur les hydrates <strong>de</strong> carbone<br />
et <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> protéines était rare —, par les ma<strong>la</strong>dies propres à l’Amérique<br />
et par l’absence d’immunité contre les ma<strong>la</strong>dies importées d’Europe. Ces facteurs, ajoutés<br />
à <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s colonisateurs, provoquèrent un immense désastre démographique<br />
parmi les communautés aborigènes. On estime qu’au XVII e siècle, 90 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
native avait disparu. Toutefois <strong>la</strong> rencontre <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s fut bénéfique en raison du<br />
métissage entre les apports <strong>de</strong> nos indigènes à l’humanité, <strong>de</strong> par leurs vastes connaissances<br />
en herboristerie, et l’apport scientifique provenant <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong> l’océan.<br />
Les premiers protomedicos et mé<strong>de</strong>cins<br />
Álvarez Chanca fut le premier mé<strong>de</strong>cin européen arrivé en Amérique au cours du<br />
<strong>de</strong>uxième voyage <strong>de</strong> Colomb; en 1514, il arriva sur les terres du Darién. Les conquistadors<br />
amenèrent aussi <strong>de</strong>s char<strong>la</strong>tans, <strong>de</strong>s empiristes et quelques protomedicos militaires comme<br />
le capitaine Antonio Díaz Cardozo en 1538 et le soldat Martín Sánchez Ropero 9, 16 . Comptons<br />
parmi ces personnages Pedro Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Valenzue<strong>la</strong>, personnage popu<strong>la</strong>ire et<br />
controversé qui écrivit le Tratado <strong>de</strong> medicina y mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> curar en estas partes <strong>de</strong> Indias<br />
[Traité <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et modèle pour guérir dans ces parties <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s] ; Mendo López<br />
<strong>de</strong>l Campo, Lope Sanjuán <strong>de</strong> los Ríos et Esteban González (chirurgien) ; on mentionne <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> Luis <strong>de</strong> Soria et <strong>de</strong> quatre barbiers (chirurgiens) à Santa Marta en 1528 ;<br />
Martín Rodríguez exerçait <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à Carthagène en 1547.<br />
La mé<strong>de</strong>cine ne fut pas enseignée en Colombie pendant <strong>la</strong> Conquête.<br />
Les premiers hôpitaux<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> découverte <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique <strong>de</strong> jusqu’à l’Amérique <strong>la</strong> Colonie. jusqu’à L’influence l’époque<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conquête coloniale. et les nouvelles L’influence ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et les nouvelles ma<strong>la</strong>dies<br />
La Découverte et <strong>la</strong> colonisation eurent lieu du côté <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique ; par conséquent,<br />
les colonies <strong>de</strong> cette région furent les premières à être peuplées et ce fut donc à cet<br />
endroit que débuta le soin hospitalier. D’après Andrés Soriano Lleras, le roi Ferdinand le<br />
Catholique ordonna en 1513 <strong>la</strong> création d’un hôpital au Darién — l’hôpital <strong>de</strong> Santa<br />
María <strong>la</strong> Antigua <strong>de</strong>l Darién —, transféré en 1524 sur le territoire du Panamá actuel. La<br />
121
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
construction <strong>de</strong> l’hôpital San Sebastián, appelé aussi Santa C<strong>la</strong>ra (ou <strong>de</strong> La Caridad), fut<br />
entreprise à Carthagène en 1535 ; cet hôpital était <strong>de</strong>stiné au soin <strong>de</strong> tout type <strong>de</strong><br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. L’hôpital <strong>de</strong> San Lázaro (le premier <strong>la</strong>zaret) commença à être construit au<br />
cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, suivi <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>l Espíritu Santo pour les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s incurables et <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Santa Marta (en 1528) 2, 16 .<br />
Les nouvelles ma<strong>la</strong>dies importées d’Europe<br />
Les conquistadors espagnols véhiculèrent plusieurs ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, parmi<br />
lesquelles il faut remarquer <strong>la</strong> lèpre et les ma<strong>la</strong>dies exanthématiques, notamment <strong>la</strong><br />
variole et <strong>la</strong> rougeole. Pour leur part, les esc<strong>la</strong>ves africains arrivaient décimés par le<br />
scorbut, <strong>la</strong> gangrène, <strong>la</strong> variole, le typhus et surtout <strong>la</strong> lèpre; le marché et <strong>la</strong> traite <strong>de</strong>s<br />
esc<strong>la</strong>ves furent donc autant <strong>de</strong> facteurs déterminants dans <strong>la</strong> propagation <strong>de</strong> plusieurs<br />
ma<strong>la</strong>dies.<br />
Selon Soriano Lleras, le moustique Ae<strong>de</strong>s aegyptii fut le vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre jaune<br />
dans les centres urbains. L’Ae<strong>de</strong>s voyagea sur les bateaux avec les esc<strong>la</strong>ves africains, débarqua<br />
sur les côtes <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique et s’enfonça dans les terres, suivant <strong>la</strong> rivière Magdalena,<br />
provoquant plusieurs épidémies dès 1509 8 . Le tabardillo (typhus<br />
exanthématique) causa <strong>de</strong> multiples épidémies <strong>de</strong>puis le XVII e siècle ; cette Rikettsiosis<br />
provoquant une mortalité élevée obligea les Espagnols à interdire aux Indiens <strong>de</strong> se <strong>la</strong>ver<br />
tous les jours 6 . D’après Pedro <strong>de</strong> Aguado, <strong>la</strong> première <strong>de</strong>s multiples épidémies <strong>de</strong> variole<br />
se produisit en 1558 ; le virus arriva sur le littoral caribéen par l’île Españo<strong>la</strong> et se propagea<br />
sur <strong>la</strong> terre ferme via <strong>la</strong> rivière Magdalena : « Ainsi, une Noire attaquée <strong>de</strong> ce mal<br />
contagieux qui venait <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte maritime,… selon les dires <strong>de</strong>s gens, fut <strong>la</strong> cause <strong>de</strong> cette<br />
ca<strong>la</strong>mité et <strong>de</strong> ce malheur 16 … ». Les épidémies ultérieures <strong>de</strong> variole, tout comme celles<br />
<strong>de</strong> rougeole, causèrent beaucoup <strong>de</strong> morts parmi les indigènes, les esc<strong>la</strong>ves noirs et<br />
même les Espagnols. Citons d’autres ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques ou analogues : <strong>la</strong> brucellose,<br />
<strong>la</strong> blennorrhagie, les mycobactérioses, le choléra, <strong>la</strong> diphtérie, <strong>la</strong> peste noire ou bubonique<br />
et les tréponématoses, <strong>la</strong> rubéole, <strong>la</strong> grippe et le <strong>de</strong>ngue, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ria, les<br />
schistosomiases, l’éléphantiasis arabe, causée par <strong>la</strong> fi<strong>la</strong>ire Wuchereria bancrofti, et <strong>la</strong><br />
cécité <strong>de</strong>s fleuves par l’Onchocerca volvulos 6 . La pédiculose et <strong>de</strong>s nouveaux vecteurs<br />
comme le moustique (Ae<strong>de</strong>s aegypti), <strong>la</strong> puce (Xenophyl<strong>la</strong> cheopis) et <strong>de</strong>s hôtes <strong>de</strong> zoonoses<br />
tels les équins, les caprins, les bovins, les porcs, le chat domestique et les souris<br />
furent d’autres maux importés 2, 6 .<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>puis l’époque <strong>la</strong> Colonie jusqu’à coloniale nos jours jusqu’à nos jours<br />
122<br />
César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z<br />
La mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> coloniale fut le produit <strong>de</strong>s connaissances européennes et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sagesse et <strong>la</strong> magie <strong>de</strong>s Indigènes, le métissage entre <strong>de</strong>s substances et <strong>de</strong>s pratiques<br />
thérapeutiques et <strong>de</strong>s doctrines et <strong>de</strong>s ingrédients psychoreligieux. La « mé<strong>de</strong>cine<br />
spirituelle » joua un rôle important, caractérisée par <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> cathédrales et<br />
d’ermitages et par l’arrivée <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vierge (comme celle <strong>de</strong> Chiquinquirá en<br />
1598), considérées comme <strong>de</strong>s médiatrices du mé<strong>de</strong>cin suprême. Tout ce<strong>la</strong> vint s’ajouter<br />
à l’assistance spirituelle offerte aux Indiens et aux esc<strong>la</strong>ves <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> prêtres miséricordieux<br />
comme saint Pedro C<strong>la</strong>ver, l’apôtre <strong>de</strong>s Noirs, qui mourut <strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre jaune en<br />
1650 2, 3 .<br />
Les ma<strong>la</strong>dies caractéristiques <strong>de</strong> l’époque coloniale furent <strong>la</strong> variole, le tabardillo (typhus<br />
exanthématique), <strong>la</strong> rougeole, <strong>la</strong> lèpre, les boubas et le scorbut. Des épidémies multiples<br />
eurent lieu sur tout le territoire, dont les plus graves furent celles <strong>de</strong> variole,
affectant plusieurs villes. À Tunja, « les citoyens et les Espagnols décédèrent comme <strong>de</strong>s<br />
rats traqués par <strong>la</strong> flûte <strong>de</strong> Hamelin » en 1587. Il n’y avait point d’apothicaireries ni <strong>de</strong><br />
cimetières civils ; entre 400 et 1 000 habitants seraient morts (sur un total <strong>de</strong> 3 000). L’hôpital<br />
couvent <strong>de</strong> San Juan <strong>de</strong> Dios ne possédait que <strong>de</strong>ux lits pour les riches et <strong>de</strong>ux lits<br />
pour les pauvres ; le mé<strong>de</strong>cin empiriste Pedro Juan Ruiz Delgado y travail<strong>la</strong> à partir <strong>de</strong><br />
1586. Deux décennies plus tard, l’épidémie s’étendit à tout le royaume <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle-<br />
Grena<strong>de</strong>; « les Indiens, effrayés par <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> mortalité, fuirent dans les bois et les montagnes,<br />
abandonnant les peuplements ».<br />
La promiscuité <strong>de</strong>s colonisateurs entraîna <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis dans <strong>la</strong> région ;<br />
c’est ce qui peut être déduit <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Juan Rodríguez Freyle El Carnero [Le Mouflon]<br />
à propos du ministre Don Luis Tello <strong>de</strong> Erazo, habitant <strong>de</strong> Santa Fe et fonctionnaire<br />
du prési<strong>de</strong>nt du Nouveau Royaume, Diego Gómez <strong>de</strong> Mena. Le ministre serait parti à<br />
Séville pour y mourir du « mal français » après avoir « échangé <strong>la</strong> toge par les aventures<br />
avec <strong>de</strong>s donzelles dissolues ».<br />
Une épidémie <strong>de</strong> tabardillo se déclencha à Santa Fe en 1630, s’étant diffusée dans<br />
tout le pays au bout <strong>de</strong> quatre ans. Outre <strong>la</strong> variole, aucune autre épidémie ne fut aussi<br />
dévastatrice ni ne se propagea autant ; selon l’historien Groot, « elle tua les quatre cinquièmes<br />
<strong>de</strong>s Indiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> savane » ; <strong>de</strong>s archevêques moururent également, tout comme<br />
<strong>de</strong>s prêtres, <strong>de</strong>s religieux, <strong>de</strong>s maires, <strong>de</strong>s nobles, <strong>de</strong>s gens du peuple et <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves.<br />
Cette épidémie fut connue sous le nom <strong>de</strong> peste <strong>de</strong> Santos Gil, car ce notaire prépara <strong>la</strong><br />
plupart <strong>de</strong>s testaments <strong>de</strong>s nobles moribonds, qui lui faisaient don <strong>de</strong> leurs biens après<br />
<strong>la</strong> mort <strong>de</strong> tous leurs <strong>de</strong>scendants, tués par <strong>la</strong> même peste 2 .<br />
Mé<strong>de</strong>cins, hôpitaux et chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Dom Álvaro <strong>de</strong> Aunón fut le premier mé<strong>de</strong>cin titré arrivé à Santa Fe (1579), tandis<br />
que Dom Juan López fut le premier mé<strong>de</strong>cin créole diplômé en Espagne (1584).<br />
L’hôpital <strong>de</strong> San Pedro, à Santa Fe, ouvrit ses portes en 1569 grâce au don en 1564<br />
<strong>de</strong> l’évêque frère Juan <strong>de</strong> los Barrios y Toledo, qui offrit l’une <strong>de</strong> ses maisons dans le but<br />
<strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r « un hôpital où vivront, seront recueillis et soignés les pauvres venant dans<br />
cette ville, dans <strong>la</strong>quelle il y aurait <strong>de</strong>s Espagnols aussi bien que <strong>de</strong>s natifs ». En 1635,<br />
l’ordre <strong>de</strong>s Hospitaliers <strong>de</strong> San Juan <strong>de</strong> Dios fut chargé <strong>de</strong> diriger l’hôpital ; on l’appe<strong>la</strong><br />
hôpital <strong>de</strong> Jesús, María y José, mais on le connaît désormais sous le nom d’hôpital San<br />
Juan <strong>de</strong> Dios 16 . Vingt-cinq hôpitaux furent créés durant <strong>la</strong> colonisation, tels<br />
celui <strong>de</strong> San Sebastián à Carthagène, celui <strong>de</strong> Popayán (1577), celui <strong>de</strong> Honda<br />
(1600) et celui <strong>de</strong> San Gil (léproserie), en 1789 ; <strong>la</strong> première apothicairerie <strong>de</strong><br />
Santa Fe fut celle <strong>de</strong> Pedro López <strong>de</strong> Buiza (1630).<br />
Au cours <strong>de</strong>s XVI e et XVII e siècles, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine ne fut pratiquement pas enseignée<br />
; les rares mé<strong>de</strong>cins servaient exclusivement <strong>la</strong> royauté et les autorités<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> colonisation. Les premières chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine — au collège Mayor <strong>de</strong><br />
San Bartolomé en 1641 et au collège Mayor <strong>de</strong>l Rosario, à Santa Fe — furent<br />
closes faute d’élèves, car « le diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin était considéré indigne et<br />
seulement propre aux personnes d’une condition sociale inférieure 9 », outre<br />
l’interdiction pour les Espagnols d’étudier hors <strong>de</strong> leur pays.<br />
L’arrivée <strong>de</strong>s Bourbons à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> l’Espagne au début du XVIII e siècle marqua<br />
<strong>la</strong> renaissance <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en Espagne et, par conséquent,<br />
dans ses colonies ; c’est ainsi que <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut consolidée en 1753<br />
avec José Vicente Román Cancino, à l’université <strong>de</strong> Santo Tomás, où le premier<br />
mé<strong>de</strong>cin, Juan Bautista <strong>de</strong> Vargas Uribe, obtint son diplôme en 1764. José Celestino<br />
Mutis revint d’Espagne en 1760, apportant les idées <strong>de</strong> l’Illustration, en fonction <strong>de</strong>squelles<br />
il diffusa le vaccin contre <strong>la</strong> variole et encouragea <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> cimetières<br />
dans les environs <strong>de</strong>s villes ; telles furent les premières mesures <strong>de</strong> santé publique dans<br />
123<br />
Figure 3.<br />
Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Is<strong>la</strong>
Figure 4.<br />
Antonio Vargas<br />
Reyes<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
124<br />
le pays. Il « découvrit » <strong>la</strong> quinquina, utilisée <strong>de</strong> manière ancestrale par les indigènes, et<br />
en tant qu’éducateur médical, il fit <strong>de</strong> Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Is<strong>la</strong> son disciple, futur fondateur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> première école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à Santa Fe (1802) (figure 3).<br />
Juan Gualberto Gutiérrez, mé<strong>de</strong>cin et avocat, travail<strong>la</strong> en 1810 à l’asile où l’on enfermait<br />
les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> variole <strong>de</strong> Santa Fe et soigna les soldats ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s le 5 août<br />
1819, <strong>de</strong>ux jours avant <strong>la</strong> bataille du pont <strong>de</strong> Boyacá, libératrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> Colombie ; il fut au<br />
chevet du grand homme Antonio Nariño lors <strong>de</strong> son agonie, annotant le moment <strong>de</strong> sa<br />
mort dans un journal conservé à <strong>la</strong> maison musée <strong>de</strong> Nariño à Vil<strong>la</strong> <strong>de</strong> Leyva 12 .<br />
Les difficultés provoquées par les guerres d’indépendance durant les premières décennies<br />
du XIX e siècle firent disparaître presque totalement l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
dans le pays. La malnutrition, le manque <strong>de</strong> services basiques et <strong>de</strong> mesures<br />
d’assainissement, déterminèrent une importante morbi-mortalité durant ce siècle 16 . Plusieurs<br />
épidémies se produisirent : <strong>de</strong> fièvre jaune, <strong>de</strong> variole, <strong>de</strong> syphilis, <strong>de</strong> tuberculose,<br />
<strong>de</strong> rougeole, <strong>de</strong> bartonellose, <strong>de</strong> parasitoses, <strong>de</strong> fièvre typhoï<strong>de</strong> et <strong>de</strong> typhus exanthématique<br />
; on conseil<strong>la</strong>it d’« être en contact avec le peuple et se vacciner lentement avec les<br />
eaux infectées, avec les écorces sales <strong>de</strong>s fruits 17 »… La lèpre et le paludisme furent<br />
parmi les principaux fléaux du siècle.<br />
La mé<strong>de</strong>cine mo<strong>de</strong>rne arriva en Colombie avec <strong>la</strong> République <strong>de</strong> 1810.<br />
L’histoire <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine débuta avec celle <strong>de</strong> l’université nationale<br />
<strong>de</strong> Colombie, en mars 1826 ; à cette date, le général Francisco <strong>de</strong> Pau<strong>la</strong><br />
Santan<strong>de</strong>r promulgua <strong>la</strong> loi organisant l’université centrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> République,<br />
première manifestation gouvernementale <strong>de</strong> l’université publique. En 1864, Antonio<br />
Vargas Reyes fonda à Bogotá une faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à caractère privé,<br />
tandis que José María Samper présenta au Congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> République un projet<br />
sur l’université nationale <strong>de</strong>s États-Unis <strong>de</strong> Colombie — inspirée <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> Santan<strong>de</strong>r<br />
— qui serait créée trois ans après (1867), sous le gouvernement <strong>de</strong> Santos<br />
Acosta. S’y ajoutèrent <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Vargas Reyes et l’hôpital<br />
San Juan <strong>de</strong> Dios 18 . À l’époque, quelques mé<strong>de</strong>cins étudiaient sous <strong>la</strong> tutelle <strong>de</strong><br />
leurs maîtres, tandis que d’autres partaient à l’étranger, surtout à Paris. La loi<br />
<strong>de</strong> 1850 permettant l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine sans licence ouvrit <strong>la</strong> voie à l’empirisme<br />
et au char<strong>la</strong>tanisme. Un <strong>de</strong>s grands hommes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’époque<br />
fut Antonio Vargas Reyes (figure 4), qui décrivit magistralement <strong>la</strong> fièvre jaune<br />
et qui est considéré comme le père <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie en Colombie 16, 19 .<br />
À propos <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’époque, <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> figure <strong>de</strong> Me<strong>de</strong>llin, Manuel<br />
Uribe Ángel, écrivit en 1881 : « Je crois que nous tuons pas mal <strong>de</strong> malheureux avec cette<br />
mé<strong>de</strong>cine précaire et déplorable. Dieu nous pardonne le mal causé par ces essais. »<br />
Désormais, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine hospitalière <strong>de</strong> l’école française commença à se développer.<br />
La chaire <strong>de</strong> bactériologie fut florissante à <strong>la</strong> fin du XIX e siècle grâce à Epifanio Combarías<br />
; elle fut à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, tout comme les chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire,<br />
<strong>de</strong> micrographie et <strong>de</strong> syphiligraphie. L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité débuta<br />
à l’université nationale en 1886 ; Gabriel José Castañeda en fut le premier professeur.<br />
Le développement général <strong>de</strong>s USA au XX e siècle, qui intègre les gran<strong>de</strong>s disciplines<br />
médicales mo<strong>de</strong>rnes (<strong>la</strong> physiopathologie, l’étiopathologie et l’anatomie clinique) à <strong>la</strong> recherche<br />
et à <strong>la</strong> technologie, diminua l’influence française sur <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine colombienne 16 .<br />
La mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire fut renforcée, <strong>de</strong> nouvelles techniques chirurgicales arrivèrent,<br />
tout comme <strong>la</strong> pharmacologie, et c’est ainsi que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie acquit le caractère<br />
d’une véritable spécialité à partir <strong>de</strong> 1910 à l’université nationale <strong>de</strong> Colombie, à travers<br />
José Ignacio Uribe 18 .<br />
Le ministère du Travail, <strong>de</strong> l’Hygiène et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Prévention fut créé en 1930, comptant<br />
un département pour <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre, les ma<strong>la</strong>dies vénériennes et <strong>la</strong> tuberculose.<br />
Le ministère <strong>de</strong> l’Hygiène fut créé en 1946 ; suivraient <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine à Cali, Popayán et Manizales, <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s spécialisations et <strong>de</strong>s
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
résidanats médicaux ainsi que <strong>la</strong> création <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins spécialistes. Pendant<br />
les <strong>de</strong>rnières décennies du XX e siècle, le développement rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> génétique, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire, <strong>de</strong> l’immunologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pharmacologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie systématisée<br />
menèrent à l’ouverture et à l’évolution <strong>de</strong> tous les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche<br />
en <strong>de</strong>rmatologie, avec <strong>de</strong>s progrès extraordinaires.<br />
Précurseurs et pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en 1970<br />
La connaissance <strong>de</strong> l’histoire nous permet d’exercer avec enthousiasme<br />
et dignité l’héritage <strong>de</strong> nos précurseurs et pionniers.<br />
Au cours du XIX e siècle, nous reçûmes l’héritage <strong>de</strong> Ricardo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra, auteur <strong>de</strong> La<br />
Elefantiasis <strong>de</strong> los griegos y su verda<strong>de</strong>ra naturaleza [L’éléphantiasis <strong>de</strong>s Grecs et sa nature<br />
véritable] (1838) ; Juan <strong>de</strong> Dios Tavera, conseil<strong>la</strong>nt dans son Estudio sobre <strong>la</strong> lepra<br />
[Étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> lèpre], un traitement avec <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> chaulmoogra (leprol); José Joaquín<br />
García, qui décrivit les altérations sensitives et motrices <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (1842) ; Marcelino<br />
S. Vargas, convaincu que <strong>la</strong> lèpre, mal dont il souffrait, pouvait être guérie ; Fe<strong>de</strong>rico<br />
Rivas Mejía, dont les services furent précieux lors <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> variole <strong>de</strong> 1840 ;<br />
Librado Riva, auteur d’un travail sur La Pe<strong>la</strong>gra [La pel<strong>la</strong>gre] ; Abraham Aparicio, et son<br />
ouvrage Baños fríos en el tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiebre tifoi<strong>de</strong>a [Bains froids pour le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre typhoï<strong>de</strong>] ; Evaristo García, qui écrivit Acción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Otoba en <strong>la</strong>s enfermeda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> piel [Action <strong>de</strong> l’Otoba sur les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau] et Variedad <strong>de</strong> lepra<br />
l<strong>la</strong>mada Mal <strong>de</strong> San Antón [Variété <strong>de</strong> lèpre appelée mal <strong>de</strong> San Anton] ; Policarpo Pizarro,<br />
vénéréologue ; Juan <strong>de</strong> Dios Carrasquil<strong>la</strong>, chercheur sur <strong>la</strong> lèpre et le pemphigus ;<br />
Andrés Posada Arango, pour son ouvrage La Rana venenosa <strong>de</strong>l Chocó [La grenouille vénéneuse<br />
du Chocó], et Ignacio Pereira, dont on se souvient à cause <strong>de</strong> ses publications<br />
sur <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies parasitaires. Gabriel José Castañeda fut le premier professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à l’université nationale <strong>de</strong> Colombie (1886-1898) à se pencher sur les ma<strong>la</strong>dies<br />
tropicales.<br />
Le début du XX e siècle fut encore marqué par une attention spéciale accordée à <strong>la</strong><br />
lèpre et <strong>la</strong> syphilis. L’ère <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires débuta, qui permit <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> recherches<br />
originales et le développement intellectuel <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins illustres 17 .<br />
Pablo García Medina, le père <strong>de</strong> l’hygiène en Colombie,<br />
né à Tunja en 1857, mé<strong>de</strong>cin diplômé <strong>de</strong> l’université<br />
nationale en 1880, exerça à Bogotá ; il fut à l’origine <strong>de</strong>s<br />
lois pour que les léproseries <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s colonies <strong>de</strong><br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ; il fut le premier prési<strong>de</strong>nt honoraire du Bureau<br />
sanitaire panaméricain et le secrétaire perpétuel<br />
<strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Pour sa part, Eliseo<br />
Montaña Granados (figure 5), le père <strong>de</strong> l’histologie<br />
en Colombie, fut professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire en 1904 et<br />
transforma <strong>la</strong> théorie en pratique au moyen <strong>de</strong> l’introduction<br />
<strong>de</strong> nouveaux microscopes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> microphotographie.<br />
Roberto Franco (figure 6) créa <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies tropicales en 1905 et invita Fe<strong>de</strong>rico Lleras<br />
Acosta à travailler dans son <strong>la</strong>boratoire. Ce professionnel, né à Bogotá — où il étudia <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine vétérinaire et <strong>la</strong> bactériologie — , se distinguerait pour ses recherches sur le<br />
charbon bactérien et son vaccin, et plus tard sur <strong>la</strong> lèpre; il décrivit <strong>la</strong> « réaction <strong>de</strong> Lleras<br />
» et fonda l’Institut <strong>de</strong> recherche sur <strong>la</strong> lèpre.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>vint une spécialité à part entière en 1910, avec <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> José<br />
Ignacio Uribe à l’université nationale. Manuel José Silva (1892-1980), <strong>de</strong>rmatologue diplômé<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Paris, fut le professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université;<br />
125<br />
Figure 5. Eliseo<br />
Montaña<br />
Figure 6. Roberto<br />
Franco
Figure 7.<br />
Guillermo Pardo<br />
Figure 8.<br />
José Posada<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
126<br />
il fut un maître par excellence, et fonda le musée <strong>de</strong> cire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> cette université.<br />
Gonzalo Reyes García étudia à Paris et à Vienne ; il fut un grand professeur <strong>de</strong><br />
l’université nationale — où il avait obtenu son diplôme — entre 1930 et 1962, ainsi que<br />
le fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. Parmi les professionnels remarquables notons Miguel Serrano Camargo, Carlos<br />
Cortés Enciso et Ignacio Cha<strong>la</strong> Hidalgo.<br />
En 1936, Alfonso Gamboa Amador entreprit le cours <strong>de</strong> syphiligraphie ; furent également<br />
remarquables à l’époque Alfredo Laver<strong>de</strong> Laver<strong>de</strong>, Tomás Henao B<strong>la</strong>nco et<br />
Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba (figure 7), qui présida le 1 er Congrès national (1960) à Bogotá<br />
en qualité <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Vers 1957, Fabio Londoño González <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> référence<br />
obligée dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, <strong>de</strong> l’immunologie<br />
cutanée et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies associées au soleil. Ses apports<br />
à <strong>la</strong> connaissance et au traitement du prurigo actinique<br />
sont considérables. Sa culture générale, son amabilité<br />
et ses qualités humaines et didactiques furent inéga<strong>la</strong>bles.<br />
Il eut <strong>de</strong>s disciples bril<strong>la</strong>nts, comme Guillermo<br />
Gutiérrez Aldana, <strong>de</strong>rmatologue et oncologue, professeur<br />
émérite <strong>de</strong> l’université nationale, un homme éminemment<br />
vertueux, doté d’une aptitu<strong>de</strong> incomparable<br />
pour l’enseignement et l’organisation, qui récupéra et<br />
restaura le musée <strong>de</strong> cire <strong>de</strong> l’université — son encouragement<br />
pour celui qui écrit ces lignes fut incomparable;<br />
Víctor Manuel Zambrano et Mariano López<br />
López, une autre lumière <strong>de</strong> notre histoire, le premier <strong>de</strong>rmatologue diplômé à l’institut<br />
Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta. Luis Alfredo Rueda P<strong>la</strong>ta étudia à Barcelone et suivit <strong>la</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmato-pathologie avec Degos et Civatte à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> Paris; il fut<br />
l’un <strong>de</strong>s pionniers dans le domaine à son retour en Colombie en 1963; ses apports dans<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s papovavirus furent importants 15, 20 .<br />
Gustavo Uribe Escobar fut le premier <strong>de</strong>rmatologue à Me<strong>de</strong>llin (Antioquia) ; il étudia<br />
à Paris, à Barcelone et à Bruxelles. En 1920, il instal<strong>la</strong> <strong>la</strong> chaire à l’université d’Antioquia,<br />
dont il fut le recteur ; il fut le fondateur <strong>de</strong> l’Institut prophy<strong>la</strong>ctique pour les ma<strong>la</strong>dies<br />
vénériennes, ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> Croix-Rouge colombienne. José Posada Trujillo<br />
(figure 8) fut formé par lui et lui succéda à <strong>la</strong> chaire en 1936, comptant sur <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
<strong>de</strong> Carlos Enrique Tobón. La même école forma aussi Juvenal Gaviria (il exerça à<br />
l’époque dans le domaine privé) et Fabio Uribe Jaramillo, décédé lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong><br />
ce chapitre. En me communiquant <strong>la</strong> regrettable nouvelle, F<strong>la</strong>vio Gómez écrivit : « Il était<br />
le <strong>de</strong>rmatologue le plus âgé en Colombie, bon comme l’eau, simple comme le pain, doux<br />
et délicat comme les cannes à sucre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vallée, humble, ga<strong>la</strong>nt, sincère, bon ami, studieux,<br />
il ne connut jamais l’orgueil ni l’arrogance. »<br />
Jorge López <strong>de</strong> Mesa et Iván Rendón Pizano se formèrent à l’école argentine, tandis<br />
qu’Aníbal Zapata Gutiérrez étudia en Espagne. Les diplômés <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Michigan<br />
revinrent ultérieurement : Gonzalo Calle Vélez en 1955, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’université d’Antioquia jusqu’à sa mort, promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie dans le pays ;<br />
Alonso Cortés en 1959, bible vivante, maître éminent, polyglotte, historien, doté d’une<br />
mémoire surprenante et d’une très gran<strong>de</strong> bonté ; Mario Robledo Villegas, le premier<br />
<strong>de</strong>rmato-pathologiste du pays, qui approfondit l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mycoses.<br />
La mycologue Ánge<strong>la</strong> Restrepo Moreno mérite une reconnaissance spéciale en tant<br />
que pionnière <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dans les années 60 et figure distinguée <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche mycologique<br />
jusqu’à nos jours.<br />
Les spécialistes suivants proviennent <strong>de</strong> l’école mexicaine : Hugo Espinal Múnera<br />
et Libardo Agu<strong>de</strong>lo Alzate, suivis <strong>de</strong>s diplômés <strong>de</strong> l’université d’Antioquia : Enrique
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Saldarriaga Arango et Víctor Cár<strong>de</strong>nas Jaramillo (1964) ; F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas (1965),<br />
qui étudia aussi <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique à l’université <strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro, un pionnier<br />
<strong>de</strong> cette sous-spécialité ; en 1967, Juan Pedro Velásquez Berruecos. Ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers,<br />
professeurs éminents, ga<strong>la</strong>nts et grands amis, à l’égard <strong>de</strong>squels j’exprime publiquement<br />
ma profon<strong>de</strong> admiration et ma gratitu<strong>de</strong> pour leur col<strong>la</strong>boration désintéressée à <strong>la</strong> rédaction<br />
<strong>de</strong> ce travail ; Jorge Mesa Restrepo 15 ; Myriam Sanclemente (née Mesa) et Stel<strong>la</strong><br />
Castañeda (née Prada) (1969), les pionnières <strong>de</strong> l’immuno-<strong>de</strong>rmato-pathologie.<br />
À Pasto (Nariño), les mé<strong>de</strong>cins Efraín So<strong>la</strong>re A<strong>la</strong>va et Jorge García travaillèrent dans<br />
les années 20 et 30 pour contrôler les foyers <strong>de</strong> lèpre et l’épidémie <strong>de</strong> bartonellose; José<br />
María Delgado Riascos, qui avait étudié à <strong>la</strong> Sorbonne, travail<strong>la</strong> quelques années dans<br />
cette ville vers 1950, s’instal<strong>la</strong>nt ensuite à Cali 15, 21 .<br />
À Carthagène (Bolívar), <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut comme<br />
représentants les personnes suivantes : Rubén Marrugo<br />
Ramírez, le premier directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Caño<br />
<strong>de</strong>l Oro (Tierra Bomba, baie <strong>de</strong> Carthagène); Moisés<br />
Pianeta Muñoz, qui étudia à l’université <strong>de</strong> Carthagène,<br />
dont il fut le doyen en 1946, « le responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnisation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine », un « multi-spécialiste<br />
et un pédagogue dans l’âme 22 »; Carlos Alberto<br />
Garzón Fortich, qui étudia <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> léprologie<br />
au Brésil et aux États-Unis et s’instal<strong>la</strong> définitivement<br />
à Carthagène en 1953. Il fut le premier<br />
<strong>de</strong>rmatologue titré <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, ainsi que professeur <strong>de</strong><br />
l’université, directeur <strong>de</strong>s <strong>la</strong>zarets <strong>de</strong> Caño <strong>de</strong>l Oro et<br />
Agua <strong>de</strong> Dios, chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne nationale antilépreuse du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, détenteur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> croix <strong>de</strong> Damian (Brésil) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> croix Jorge Bejarano (Colombie)<br />
; Nayib Ambrad Domínguez, formé en Argentine (1950) où il suivit <strong>de</strong>s cours<br />
d’endocrinologie avec Carlos Galli Mainini, E.B. Del Castillo et Guillermo Di Pao<strong>la</strong> ; il fut<br />
col<strong>la</strong>borateur et disciple du prix Nobel Bernardo Alberto Houssay dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
recherche endocrinienne ; en <strong>de</strong>rmatologie, il fut le disciple du professeur Cordivio<strong>la</strong> et<br />
auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Coloration contrastée pour les réactions <strong>de</strong> Galli Mainini; Enrique Alonso<br />
Osorio Camacho (figure 9) étudia à l’université nationale autonome du Mexique, il fut<br />
professeur <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Carthagène (1972-1992) et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association colombienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont il est actuellement<br />
prési<strong>de</strong>nt émérite et membre honoraire; il exerce avec<br />
excellence <strong>la</strong> profession à Carthagène. Finalement, citons<br />
Diego Fernando Gómez Pérez, qui obtint son diplôme<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue en Argentine en 1960 ; il est<br />
enseignant et dirigeant politique 15 .<br />
La ville <strong>de</strong> Cali (vallée du Cauca) accueillit Julio<br />
César Barreneche Mesa en 1939, qui avait étudié <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et l’anesthésiologie en Suisse. D’autres<br />
mé<strong>de</strong>cins exerçaient déjà <strong>la</strong> profession <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue<br />
dans cette ville, sans être pour autant spécialistes,<br />
tels Carlos Salcedo Cabal et Jaime Kelber.<br />
Hernán Tobón Pizarro — du Skin & Cancer <strong>de</strong> New<br />
York et ayant fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s à Buenos Aires avec le<br />
professeur Luis Pierini — fut un pilier <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
<strong>de</strong>puis 1954 jusqu’à sa mort en 1985. Jaime Betancourt Osorio (figure 10), gloire vivante<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, arriva dans cette ville en 1956 après avoir étudié à Madrid (1955) et perfectionné<br />
son savoir aux côtés du Pr. Pierini à Buenos Aires. Lui et le Dr Tobón furent les<br />
premiers professeurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong>l Valle. Jaime Betancourt cultiva<br />
127<br />
Figure 9.<br />
Enrique A.<br />
Osorio<br />
Figura 10. Jaime<br />
Betancourt<br />
Figure 11.<br />
Antonio Torres<br />
Figure 12.<br />
Cecilia<br />
Moncaleano
Figure 13.<br />
Pedro M.<br />
Román<br />
Figure 14.<br />
José M. Delgado<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
128<br />
également les arts <strong>de</strong> <strong>la</strong> peinture, <strong>la</strong> sculpture et <strong>la</strong> poésie ; je professe une très gran<strong>de</strong><br />
affection et un très grand respect envers lui. Ernesto Correa Galindo, <strong>de</strong>rmato-pathologiste<br />
pionnier formé en Argentine sous <strong>la</strong> tutelle <strong>de</strong> Pierini, Borda et Abu<strong>la</strong>fia, instal<strong>la</strong> <strong>la</strong><br />
chaire à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios en 1960. Cinq ans plus tard, Antonio José Torres<br />
Muñoz (figure 11), disciple du Dr Correa, perfectionna ses étu<strong>de</strong>s à Buenos Aires avec<br />
Aarón Kamisnky ; il fut un professeur ad honorem exemp<strong>la</strong>ire à l’université <strong>de</strong>l Valle,<br />
ainsi qu’un parfait lecteur, doué d’une mémoire incomparable et d’une culture générale<br />
très vaste. L’année 1966 marqua l’arrivée <strong>de</strong> Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>, diplômé <strong>de</strong><br />
l’université <strong>de</strong> l’Iowa, qui créa le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong>l Valle en<br />
1970 et le dirigea. Il fut assisté par Jaime Betancourt et Nelson Giraldo ; ses recherches<br />
aidèrent au progrès <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> et du traitement du vitiligo.<br />
Cecilia Laspril<strong>la</strong> (née Moncaleano) (figure 12), <strong>la</strong> dame <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée<br />
du Cauca, fut en 1967 <strong>la</strong> première femme à exercer <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie. Elle<br />
avait obtenu son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin à l’université nationale et celui <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue à<br />
l’université <strong>de</strong> Sao Paulo. Elle joua un rôle majeur à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios, au dispensaire<br />
<strong>de</strong> lèpre et aux Ferrocarriles Nacionales (Chemins <strong>de</strong> fer nationaux) jusqu’à sa<br />
retraite en 1991. La même année Nelson Giraldo Restrepo retourna au pays ; il avait fait<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie à Buenos Aires avec le professeur Abu<strong>la</strong>fia et fut un<br />
excellent professeur à l’université <strong>de</strong>l Valle 15, 21 .<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Santan<strong>de</strong>r commença avec Álvaro Sabogal Rey, arrivé<br />
à Bucaramanga en 1958 après avoir été nommé par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé pour diriger<br />
les programmes sur <strong>la</strong> lèpre, assisté par Virgilio Rodríguez. Alejandro Vil<strong>la</strong>lobos<br />
Fernán<strong>de</strong>z arriva dans <strong>la</strong> ville en 1960, après avoir obtenu son diplôme à Buenos Aires ;<br />
il exerça <strong>la</strong> profession pendant quelques années et se rendit ensuite aux États-Unis. Luis<br />
Felipe Moreno arriva en 1961 après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s en Espagne et il se consacra au traitement<br />
<strong>de</strong>s ulcères <strong>de</strong>s membres inférieurs. En 1964, ce fut le tour <strong>de</strong> Jaime Acevedo Ballesteros<br />
; ces <strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins exercent toujours.<br />
Heriberto Gómez Sierra arriva à Manizales (Caldas, <strong>la</strong> route du café) en 1965 après <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s à l’université d’Antioquia; il fut le fondateur et le titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire à l’université<br />
<strong>de</strong> Caldas; nous regrettons très profondément sa mort, survenue pendant <strong>la</strong> préparation<br />
<strong>de</strong> cet ouvrage. Jairo Mesa Cock, son premier disciple en 1968, fut enseignant pendant<br />
plusieurs décennies et chef <strong>de</strong> service (1980-1985); il représente actuellement le pilier <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> communication et <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong>rmatologique dans tout le pays à travers Internet.<br />
Bernardo Giraldo Neira étudia <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie aux États-Unis, se spécialisant dans les<br />
allergies et exerçant <strong>la</strong> profession à Pereira et à Manizales<br />
<strong>de</strong>puis 1967. Adolfo Ormaza Hinestrosa arriva à Pereira<br />
(Risaralda) vers <strong>la</strong> même époque, après ses étu<strong>de</strong>s en Argentine.<br />
Fabio Rivera fut le pionnier <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité à<br />
Armenia (Quindío).<br />
À Cúcuta (nord <strong>de</strong> Santan<strong>de</strong>r) et à Arauca, le maître<br />
Pedro Miguel Román Suárez (figure 13), formé en léprologie<br />
à l’institut Fe<strong>de</strong>rico Lleras en 1966, fut chargé d’initier<br />
<strong>la</strong> spécialité. Il apporta pendant quasiment quatre<br />
décennies le bien-être nécessaire à ses patients. À Barranquil<strong>la</strong><br />
(At<strong>la</strong>ntique), les premiers spécialistes furent<br />
B<strong>la</strong>s Retamoso (ayant étudié <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à Carthagène, il<br />
se consacra à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie), Luis López et Carmelo<br />
Castillo Porto (décédés) et Alí Tajan Calvo (grand homme,<br />
autodidacte et poète, actuellement en exercice). Dans le<br />
département du Cauca, les pionniers furent José María Delgado Pare<strong>de</strong>s (figure 14), <strong>de</strong>rmatologue<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> South Carolina et mé<strong>de</strong>cin sanitaire <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Harvard,<br />
responsable du cours <strong>de</strong> morphologie et professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université
<strong>de</strong>l Cauca; Mario Ernesto González, <strong>de</strong>rmatologue à l’université <strong>de</strong> Buenos Aires, professeur<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’Université <strong>de</strong>l Cauca pendant plus <strong>de</strong> trente ans; et José Félix<br />
Zambrano Payán, formé à l’hôpital Fe<strong>de</strong>rico Lleras, professeur col<strong>la</strong>borateur <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong>l Valle sur <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> leishmaniose 15 . Hugo Corrales Lugo arriva le premier à Córdoba<br />
(Montería) dans les années soixante; il fut formé à l’institut Fe<strong>de</strong>rico Lleras et géra<br />
les programmes sur <strong>la</strong> lèpre, suivi d’Albio Puche. À Sincelejo (Sucre), Hugo Corrales Medrano<br />
(il est en plus un spécialiste en mé<strong>de</strong>cine interne) fut le premier. À Boyacá, Antonio<br />
Morales débuta l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité à partir <strong>de</strong> 1968, lorsqu’il arriva <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>manque (Espagne); il exerce toujours <strong>la</strong> spécialité avec réussite et compétence 15 .<br />
MARÍA MÉLIDA DURÁN MERCHÁN<br />
Je considère comme pionniers les mé<strong>de</strong>cins qui commencèrent à exercer <strong>la</strong> profession<br />
avant 1970. Même si María Mélida Durán Merchán (figure 15) obtint son diplôme en<br />
1976 à l’université Javeriana, je veux lui rendre hommage pour le rayonnement qu’elle<br />
offrit à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie colombienne. Adriana Arrunátegui Ramírez dit :<br />
(C’était) une très belle femme, un modèle et une in<strong>la</strong>ssable voyageuse, le g<strong>la</strong>mour<br />
était son signe distinctif ; elle se dép<strong>la</strong>çait avec élégance et délicatesse dans<br />
tous les domaines. La <strong>de</strong>rmatologie colombienne trouvait en elle son ambassadrice<br />
<strong>la</strong> plus importante, car elle était un membre notable […] <strong>de</strong> l’Organisation<br />
mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
[…], <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique […], <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
ibéro-<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> […] ; elle fut vice-prési<strong>de</strong>nte et secrétaire exécutif <strong>de</strong><br />
l’International Society of Dermatology, ainsi que coéditrice <strong>de</strong> sa revue. […] Elle<br />
organisa <strong>de</strong>s congrès en Colombie, en In<strong>de</strong>, en Australie et en Égypte… Sa vie<br />
fut une recherche constante, l’excellence était son objectif et elle l’atteignit en<br />
étant exigeante envers elle-même. Elle pensa toujours à ses engagements jusqu’à<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière minute <strong>de</strong> son existence ; c’est ainsi que nous <strong>la</strong> vîmes inaugurer<br />
et clore le XVIII e Cours d’actualisation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> l’International<br />
Society à Bogotá sans penser que le len<strong>de</strong>main — le 26 juin 2000 — elle partirait<br />
pour toujours. Elle souriait délicatement et chaleureusement, elle était très calme.<br />
Rien ne <strong>la</strong>issait présager un dénouement aussi rapi<strong>de</strong>.<br />
Descriptions cliniques originales<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
La Colombie a suscité nombre <strong>de</strong> témoignages sur les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>puis<br />
l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête, tout comme <strong>de</strong>s techniques diagnostiques et chirurgicales,<br />
que nous détaillons ci-<strong>de</strong>ssous :<br />
Piqûres : « Certaines araignées ou moustiques… qui soulèvent, suite à leur piqûre, <strong>la</strong><br />
chair avec une gran<strong>de</strong> douleur et une brûlure persistant pendant trois ou quatre heures »<br />
(Père Aguado, Sabandija, près <strong>de</strong> Neiva) 9 .<br />
Nuche (myiase) : « Un catap<strong>la</strong>sme en diachylon appliqué sur l’enflure et <strong>la</strong> chair<br />
molle force <strong>la</strong> chair et enlève le ver : <strong>la</strong> bosse dure se défait, <strong>la</strong> peine et <strong>la</strong> douleur sont<br />
sou<strong>la</strong>gées » (Juan <strong>de</strong> Castel<strong>la</strong>nos) 9 .<br />
Altérations sensitives et motrices <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre: « L’absence <strong>de</strong> sensibilité chez le Lazare<br />
est le véritable symptôme <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et ce qui détermine son existence. » ;<br />
« L’examen <strong>de</strong>s patients doit se faire sans que le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> s’en ren<strong>de</strong> compte, en le blessant<br />
avec un instrument aigu sans qu’il le voie ni ne sente <strong>la</strong> blessure; en lui <strong>de</strong>mandant<br />
<strong>de</strong> prendre une pièce <strong>de</strong> monnaie avec ses doigts dépourvus <strong>de</strong> cors et apparemment<br />
sains, il ne peut pas <strong>la</strong> prendre, car n’ayant plus <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> toucher, il ne perçoit pas<br />
le corps <strong>de</strong> <strong>la</strong> pièce. Si en marchant ils s’arrachent un doigt du pied, ils ne le reconnaissent<br />
pas quand ils ne le voient pas… » (José Joaquín García, 1842) 23 .<br />
129<br />
Figure 15.<br />
María Mélida<br />
Durán Merchán
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
Fièvre jaune : « La ma<strong>la</strong>die frappait brusquement... Les yeux s’injectaient et <strong>la</strong>rmoyaient…<br />
Une profon<strong>de</strong> anxiété, une prostration extrême <strong>de</strong>s forces, <strong>de</strong>s taches sur <strong>la</strong><br />
peau, <strong>de</strong> l’épistaxis, <strong>de</strong>s gencives qui saignent, une sueur froi<strong>de</strong>, une lenteur extrême du<br />
pouls, le hoquet et finalement <strong>la</strong> mort… » (Antonio Vargas Reyes) 19 .<br />
Démonstration du pou comme agent étiologique du typhus et différenciation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fièvre typhoï<strong>de</strong> : Luis Patiño Camargo (1922) 17 .<br />
Réaction <strong>de</strong> Lleras (lèpre) : réaction <strong>de</strong> <strong>la</strong> fixation du complément : Fe<strong>de</strong>rico Lleras<br />
Acosta 24 .<br />
Vaccin pour le charbon bactérien : Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta.<br />
Positivité sérologique du carate : décrite par Gustavo Uribe Escobar, Alfredo Correa<br />
Henao, José J. Escobar et Jesús Peláez Botero à Me<strong>de</strong>llin.<br />
Greffes épi<strong>de</strong>rmiques et leur application sur les zones achromiques et <strong>de</strong> granu<strong>la</strong>tion<br />
: Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> (1971) 25 .<br />
Coloration contrastée pour <strong>la</strong> réaction Galli Mainini et Ambrad Domínguez : Nayib<br />
Ambrad Domínguez.<br />
Phytophoto<strong>de</strong>rmatite <strong>de</strong>s pieds et <strong>de</strong>s jambes par <strong>la</strong> rue après l’accouchement :<br />
Fabio Londoño González.<br />
Contribution à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s caractéristiques cliniques et dénomination du<br />
prurigo actinique : Fabio Londoño González.<br />
Traitement du prurigo actinique avec thalidomi<strong>de</strong> : Fabio Londoño González 26, 27 .<br />
Description <strong>de</strong>s effets cytopatiques du virus papova dans l’épy<strong>de</strong>rmodisp<strong>la</strong>sie verruciforme<br />
: Luis Alfredo Rueda P<strong>la</strong>ta.<br />
Repigmentation du vitiligo segmentaire par <strong>de</strong>s mini-greffres autologues : Rafael<br />
Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> (1983) 28 .<br />
Hipome<strong>la</strong>nose idiopathique en gouttes : Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> (1983) 29 .<br />
Leuko<strong>de</strong>rma punctata (achromie lenticu<strong>la</strong>ire) : Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> (1984) 30 .<br />
Paramètres cliniques d’anesthésie tumescente dans <strong>la</strong> chirurgie reconstructive du<br />
cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau : Álvaro Acosta <strong>de</strong> Hart (1997) 31 .<br />
Éruption éosinophilique, polymorphe et prurigineuse associée à radiothérapie :<br />
Ricardo Augusto Rueda P<strong>la</strong>ta (1999) 32 .<br />
■ <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>Histoire</strong> <strong>la</strong> recherche, <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, l’infectiologie et les sous-spécialités et les sous-spécialités<br />
130<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
On dit que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die débarqua en Colombie au XVI e siècle avec les conquistadors et<br />
les esc<strong>la</strong>ves africains, et qu’elle trouva les conditions propices pour s’installer, se propager<br />
et se maintenir dans les milieux ayant <strong>de</strong>s difficultés sociales et sanitaires. Désormais,<br />
une série <strong>de</strong> pratiques se développa dans différents domaines, comme <strong>la</strong> création<br />
du premier <strong>la</strong>boratoire, les mesures sanitaires gouvernementales, <strong>la</strong> recherche et <strong>la</strong> statistique,<br />
tout comme <strong>la</strong> reconnaissance du droit du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> face au préjugé.<br />
C’est à Carthagène <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s que fut créé en 1610 le premier <strong>la</strong>zaret, l’hôpital <strong>de</strong> San<br />
Lázaro, qui subit plusieurs dép<strong>la</strong>cements à cause <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>intes <strong>de</strong>s voisins et dut être clôturé<br />
par <strong>de</strong>s murs en pierre. Les léproseries Caño <strong>de</strong>l Oro (1808), Contratación et Agua<br />
<strong>de</strong> Dios, dont une partie <strong>de</strong> l’entretien économique dépendait <strong>de</strong>s impôts sur les liqueurs,<br />
les tissus et <strong>la</strong> vian<strong>de</strong>, furent créées ultérieurement. Le premier patient lépreux fut inscrit<br />
à Santa Fe en 1646 : il s’agissait <strong>de</strong> Santibáñez Brochero, le prêtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> cathédrale.<br />
Au XVII e siècle, <strong>la</strong> lèpre abondait sur <strong>la</strong> côte caribéenne et le lépreux était considéré<br />
comme un paria que l’on séparait <strong>de</strong> sa famille saine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> société jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> ses<br />
jours ; il était envoyé avec son mobilier — en prenant toutes les précautions <strong>de</strong> rigueur<br />
— au <strong>la</strong>zaret <strong>de</strong> Carthagène, qui était <strong>de</strong>venu un cimetière <strong>de</strong> vivants.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
José Celestino Mutis eut une idée c<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die au XVII e siècle, faisant <strong>la</strong> différence<br />
entre les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s peu contagieux ou très contagieux. Au XVIII e siècle, <strong>la</strong> lèpre attaqua<br />
les départements d’Antioquia et <strong>de</strong>s Santan<strong>de</strong>res. Le peuplement du Socorro fut si<br />
ravagé en 1775 que les habitants fuirent l’endroit et les maisons <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s furent <strong>la</strong>pidées<br />
9 . Vers <strong>la</strong> fin du siècle, le vice-roi Caballero y Góngora écrivit : « À l’instant où un<br />
patient est déc<strong>la</strong>ré lépreux, il est conduit à l’hôpital <strong>de</strong> Carthagène, on lui indique sa petite<br />
part <strong>de</strong> terrain et on lui remet sa maison ou habitation où il passera le reste <strong>de</strong> sa<br />
vie… comme quoi, ces malheureux sont condamnés à une prison perpétuelle 2 …» Au<br />
XIX e siècle, José Joaquín García décrivit les manifestations sensitives et motrices <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die ; Ricardo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra affirma que <strong>la</strong> lèpre était contagieuse, héréditaire et<br />
curable. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> sa pièce représentant le « mal <strong>de</strong> San Antón » au<br />
musée Dupuytren, Evaristo García <strong>la</strong>nça à Paris <strong>la</strong> polémique sur l’arthropathie et <strong>la</strong><br />
lésion osseuse causées par une anomalie du tube neural. Au cours <strong>de</strong> ce siècle, les<br />
traitements utilisés étaient <strong>la</strong> strychnine, les arsenicaux, l’aspirine, les venins <strong>de</strong> serpents<br />
et l’huile <strong>de</strong> chaulmoogra (leprol).<br />
Grâce à son ouvrage intitulé La Lepra en Colombia. Etiología, nosología, profi<strong>la</strong>xis<br />
y tratamiento [La lèpre en Colombie. Étiologie, nosologie, prophy<strong>la</strong>xie et traitement],<br />
Gabriel José Castañeda favorisa <strong>la</strong> promulgation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong>s Lazarets. Lorsqu’il cherchait<br />
les premières manifestations <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, Juan <strong>de</strong> Dios Carrasquil<strong>la</strong> (figure 16)<br />
décrivit le « chancre lépreux »; il mena <strong>de</strong>s recherches et produisit une antitoxine qui<br />
parcourut le mon<strong>de</strong> en 1890. Il considéra que <strong>la</strong> puce pouvait être un vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die; il conçut sa propre métho<strong>de</strong> pour trouver le bacille chez <strong>la</strong> lymphe 33, 34 ; il soutint<br />
l’origine infectieuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre causée par un microbe, même contre les théories<br />
héréditaires 35 . Pablo García Medina aboutit pour sa part à <strong>la</strong> promulgation <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> fin du XIX e siècle pour convertir les léproseries en colonies <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s 2 .<br />
Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta (figure 17) effectua plusieurs recherches bactériologiques<br />
dans les années 20 et 30, notamment sur <strong>la</strong> lèpre; il décrivit <strong>la</strong> réaction <strong>de</strong> Lleras — un<br />
test <strong>de</strong> fixation du complément à 97 % <strong>de</strong> sensibilité et à 99,7 % <strong>de</strong> spécificité — qui fut<br />
employé sur plus <strong>de</strong> 7 000 patients mais qui fut abandonné, sa spécificité ne pouvant<br />
pas être prouvée 24 . Le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre avec <strong>de</strong>s sulfones fut initié au cours <strong>de</strong>s<br />
années 50, mais à partir <strong>de</strong> 1981 on passa à <strong>la</strong> polychimiothérapie à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> résistance<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
D’importantes institutions et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues prestigieux participèrent, dans<br />
un passé récent et encore <strong>de</strong> nos jours, à l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, parmi lesquels nous<br />
citons : Fabio Londoño, Luis Alfredo Rueda, Mariano López, Gerzaín Rodríguez, Antonio<br />
Torres, Luis Hernando Moreno, Adriana Arrunátegui, Gustavo Corredor, Efraín<br />
So<strong>la</strong>res A<strong>la</strong>va, Jorge García, Rubén Marrugo, Carlos Garzón Fortich, Álvaro Sabogal,<br />
Pedro Miguel Román, José Félix Zambrano et Antonio Morales, entre autres.<br />
En 1998, le pays recensait 2 933 ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s.<br />
Malgré les innombrables recherches, les mesures d’assainissement <strong>de</strong> l’environnement<br />
et le développement technologique, <strong>la</strong> lèpre est toujours un fléau pour l’humanité.<br />
Il reviendra aux nouvelles générations <strong>de</strong> mener les recherches génétiques et <strong>de</strong><br />
biologie molécu<strong>la</strong>ire pour parvenir à l’éradication du mal <strong>de</strong>s siècles.<br />
HISTOIRE DE LA SYPHILIS ET AUTRES TRÉPONÉMATOSES<br />
Les infections par tréponèmes apparurent probablement en Afrique équatoriale sous<br />
<strong>la</strong> forme du pian. Les migrations vers les zones sèches du tropique africain entraînèrent<br />
un changement dans l’emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong>s lésions, qui se situèrent dans les parties plus humi<strong>de</strong>s<br />
du corps (autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> bouche) et <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> syphilis non vénérienne ;<br />
elles voyagèrent peut-être ainsi avec les premiers migrants du Nouveau Mon<strong>de</strong>, pour<br />
réintroduire le pian sur le tropique américain. On trouva davantage en Amérique qu’en<br />
Europe <strong>de</strong>s restes osseux présentant <strong>de</strong>s séquelles <strong>de</strong> tréponématoses, qui furent<br />
131<br />
Figure 16.<br />
Juan <strong>de</strong> Dios<br />
Carrasquil<strong>la</strong><br />
Figure 17.<br />
Fe<strong>de</strong>rico Lleras
Figure 18.<br />
Liborio Zerda<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
132<br />
interprétées comme pian et syphilis vénérienne; on attribua exclusivement à cette <strong>de</strong>rnière<br />
les lésions <strong>de</strong> Caries sicca du crâne, qui sont remarquables. Ceux qui partagent <strong>la</strong><br />
théorie <strong>de</strong> l’origine unitaire <strong>de</strong>s tréponématoses considèrent qu’elles se développèrent simultanément<br />
au sein <strong>de</strong> plusieurs popu<strong>la</strong>tions sur le vieux et le nouveau continent. La<br />
syphilis vénérienne, <strong>la</strong> syphilis endémique non vénérienne, le pian et le carate « seraient<br />
quatre syndromes à l’intérieur d’un gradient biologique causé par le Treponema pallidum<br />
6 . » La syphilis endémique apportée en Europe par les Espagnols suite à leur contact<br />
avec les indigènes fut sans doute favorisée par les différences du style <strong>de</strong> vie (par<br />
exemple, le port d’habits), ce qui entraîna une modification dans <strong>la</strong> transmission du Treponema<br />
pallidum vers une forme sexuelle ; c’est ainsi que le pian <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> syphilis vénérienne,<br />
qui revint plus tard en Amérique avec ces mêmes Espagnols. José Vicente<br />
Rodríguez, Carlos Armando Rodríguez, Gonzalo Correal Urrego et Hugo Armando Sotomayor<br />
Tribín à Bogotá contribuèrent gran<strong>de</strong>mment à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong>s tréponématoses,<br />
à partir <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> restes osseux découverts au département <strong>de</strong><br />
Cundinamarca et dans <strong>la</strong> vallée du Cauca.<br />
La présence <strong>de</strong>s tréponématoses <strong>de</strong>puis les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête apparaît<br />
dans maints récits <strong>de</strong>s chroniqueurs <strong>de</strong> l’époque, et fut désormais étudiée. La syphilis<br />
vénérienne <strong>de</strong>vint un problème sanitaire <strong>de</strong>puis l’irruption <strong>de</strong>s colonisateurs<br />
espagnols ; <strong>la</strong> pauvreté et <strong>la</strong> prostitution jouèrent un rôle important dans sa dissémination.<br />
L’inci<strong>de</strong>nce élevée <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis à <strong>la</strong> fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle obligea<br />
le gouvernement à réformer les programmes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et à établir <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong><br />
syphiligraphie dans les universités 17 . Le carate, qui fut même un élément d’i<strong>de</strong>ntité ethnique<br />
parmi les natifs, <strong>de</strong>vint après un problème <strong>de</strong> santé publique, tout comme le pian<br />
<strong>de</strong>puis le XVI e siècle et jusqu’à <strong>la</strong> moitié du XX e siècle. L’arrivée <strong>de</strong> <strong>la</strong> pénicilline constitua,<br />
pour le bien commun, un événement marquant dans l’histoire <strong>de</strong>s tréponématoses,<br />
et c’est grâce à elle que Gerardo López Narváez traita les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> côte occi<strong>de</strong>ntale<br />
du pays pendant quatorze ans jusqu’à l’éradication du pian.<br />
HISTOIRE DE LA RECHERCHE, LA BACTÉRIOLOGIE ET L’IMMUNOLOGIE CUTANÉE<br />
José Celestino Mutis importa d’Espagne en 1760 les idées <strong>de</strong>s Lumières et <strong>la</strong><br />
science européenne <strong>de</strong> l’époque; en 1842, José Joaquín García mena les premières<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recherche sur <strong>la</strong> lèpre basées sur l’observation; en 1865, <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> pharmacie<br />
fit ses premiers pas dans <strong>la</strong> recherche grâce au mé<strong>de</strong>cin Osorio, à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Bogotá 36 , mais ce ne fut qu’à <strong>la</strong> fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle<br />
que débuta <strong>la</strong> tradition d’une recherche expérimentale et que <strong>la</strong> bactériologie <strong>de</strong>vint<br />
un moyen <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée scientifique.<br />
Entre 1880 et 1904 (pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s gouvernements <strong>de</strong> Rafael Núñez et <strong>de</strong> Rafael Reyes),<br />
les bases pour le développement scientifique colombien furent établies. On créa les<br />
chaires <strong>de</strong> bactériologie, d’histologie, <strong>de</strong> microbiologie, <strong>de</strong> micrographie et <strong>de</strong> syphiligraphie;<br />
Epifanio Combariza et Liborio Zerda (figure 18) jouèrent un rôle important,<br />
marquant l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> bactériologie et <strong>la</strong> micrographie. En 1900, Francisco Tapia créa<br />
un <strong>la</strong>boratoire à l’université nationale (Bogotá), qui fut plus tard transféré à l’hôpital San<br />
Juan <strong>de</strong> Dios 17 . Juan <strong>de</strong> Dios Carrasquil<strong>la</strong> chercha dans <strong>la</strong> sérologie <strong>la</strong> possibilité d’un traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, transfusant à <strong>de</strong>s chevaux le sang <strong>de</strong>s patients; son sérum parcourut le<br />
mon<strong>de</strong> en 1896, entraînant <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> sérothérapie 35 . Roberto Franco fonda<br />
<strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies tropicales et, aidé par le phi<strong>la</strong>nthrope Santiago Samper, il mit en p<strong>la</strong>ce<br />
le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios, où Jorge Martínez Santamaría et Gabriel Toro<br />
Vil<strong>la</strong> menèrent d’importantes étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> fièvre jaune et les ma<strong>la</strong>dies tropicales. L’ère <strong>de</strong><br />
l’histologie débuta en 1904 grâce à Eliseo Montaña Granados; Laurentino Muñoz le définit<br />
comme « un <strong>de</strong>s créateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine scientifique en Colombie 2 .»<br />
Le <strong>la</strong>boratoire bactériologique et celui <strong>de</strong> l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paúl à Me<strong>de</strong>llin<br />
furent créés en 1913. Quelques années plus tard (1917) fut créé à Bogotá le <strong>la</strong>boratoire
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
privé Samper Martínez, dont <strong>la</strong> production <strong>de</strong> sérums immunes et <strong>de</strong> vaccins constitua<br />
un événement marquant qui entraîna son changement <strong>de</strong> statut en 1946, <strong>de</strong>venant l’Institut<br />
national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 17 . Dans les années 20, certaines universités <strong>de</strong>s États-Unis mirent<br />
en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale et <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires privés ; <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins colombiens s’y rendirent pour se former et ils renforcèrent <strong>la</strong> recherche à leur<br />
retour au pays.<br />
La création <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> pharmacie <strong>de</strong> l’université nationale (Andrés Bermú<strong>de</strong>z,<br />
1927) joua également un rôle important. Gustavo Uribe Escobar mena vers <strong>la</strong> même<br />
époque d’importantes étu<strong>de</strong>s à Me<strong>de</strong>llin sur <strong>la</strong> positivité sérologique dans le carate.<br />
En 1922 et suite à une recherche exhaustive, Luis Patiño Camargo prouva à Bogotá<br />
que le typhus et <strong>la</strong> fièvre typhoï<strong>de</strong> étaient <strong>de</strong>ux ma<strong>la</strong>dies différentes, iso<strong>la</strong>nt le pou<br />
en tant que vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> première 17 . Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta fonda à Bogotá son<br />
propre <strong>la</strong>boratoire et commença à participer aux étu<strong>de</strong>s sur le vaccin du charbon<br />
bactérien, et aux tentatives <strong>de</strong> culture du bacille <strong>de</strong> Hansen. Il tenta <strong>de</strong>s traitements<br />
pour <strong>la</strong> lèpre à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> différentes préparations immunologiques et décrivit <strong>la</strong><br />
réaction qui porte son nom en cherchant le diagnostic précoce au moyen d’une métho<strong>de</strong><br />
spécifique 35 . Son <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>vint le centre <strong>de</strong>rmatologique qui porte son<br />
nom 37 ; il compta <strong>de</strong>s représentants bril<strong>la</strong>nts comme Fabio Londoño González, qui fut<br />
pendant plus <strong>de</strong> trois décennies le moteur d’importantes recherches sur plusieurs<br />
ma<strong>la</strong>dies, accompagné <strong>de</strong> Luis Alfredo Rueda P<strong>la</strong>ta 26, 27, 38, 39 .<br />
Une nouvelle ère <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche se développa en Colombie à partir <strong>de</strong>s années 50,<br />
grâce à <strong>de</strong>s figures telles que Alonso Cortés (figure 19) et Gonzalo Calle Vélez à l’université<br />
d’Antioquia, qui entamèrent <strong>de</strong>s recherches basées sur <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s prospectives <strong>de</strong><br />
patients et menèrent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s clinico-épidémiologiques, thérapeutiques, diagnostiques<br />
et histopathologiques. Un peu plus tard, <strong>la</strong> mycologue Ánge<strong>la</strong> Restrepo Moreno (toujours<br />
en exercice) se distingua. Heriberto Gómez Sierra commença l’application <strong>de</strong>s techniques<br />
d’immunofluorescence à Manizales dans les années 60. En 1969, Gonzalo Calle Vélez créa<br />
à l’université d’Antioquia le <strong>la</strong>boratoire d’immuno<strong>de</strong>rmatologie et appe<strong>la</strong> à son ai<strong>de</strong><br />
Myriam Sanclemente (née Mesa) et Stel<strong>la</strong> Castañeda (née Prada) (figure 20), qui menèrent<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s recherches sur les techniques d’immunofluorescence pour le<br />
traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies bulleuses; elles enchaînèrent ensuite sur l’immunothérapie<br />
topique, l’immuno-histochimie, <strong>la</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire et l’immuno-intervention. Les<br />
Drs Mary Ann Robledo Prada, Ana María Abreu, Margarita Velásquez et Juan Carlos<br />
Wolf méritent aussi une reconnaissance pour leur travail dans <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> tissus,<br />
qu’ils mènent au <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>puis 1999.<br />
Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> entreprit à Cali dans les années 70, aidé par Nelson Giraldo et<br />
Carlos Escobar, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur les altérations pigmentaires, notamment le vitiligo, en<br />
concevant <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s chirurgicales <strong>de</strong> repigmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, <strong>de</strong>s cultures et<br />
l’imp<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> mé<strong>la</strong>nocytes. Luis Hernando Moreno, Adriana Arrunátegui, María Isabel<br />
Barona, C<strong>la</strong>udia Covelli et Lucy García intégrèrent l’équipe dans <strong>la</strong> décennie 80 21 .<br />
Le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie Gustavo Uribe Escobar, dirigé par le <strong>de</strong>rmatopathologiste<br />
Walter León Hernán<strong>de</strong>z, fut créé à l’université d’Antioquia (sous <strong>la</strong> direction<br />
d’Alonso Cortés) en 1975. L’année suivante, le Dr María Mélida Durán, cette éminente et<br />
inoubliable gran<strong>de</strong> dame à l’allure élégante, qui emporta avec elle notre amour et nous<br />
<strong>la</strong>issa en héritage plusieurs étu<strong>de</strong>s sur le prurigo actinique chez les communautés indigènes,<br />
fit son incursion dans <strong>la</strong> recherche 15, 40, 41 .<br />
Guillermo Gutiérrez Aldana commença à se consacrer à <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
oncologique 42 dans les années 80, consolidée en 1992 par <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-spécialité<br />
à l’Institut national <strong>de</strong> cancérologie (Bogotá). C’est là qu’Álvaro Acosta <strong>de</strong> Hart<br />
mena ses recherches sur <strong>la</strong> chirurgie du cancer et <strong>la</strong> technique tumescente 31 . Vers <strong>la</strong><br />
même date, Felipe Jaramillo Ayerbe mena à Manizales <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur les tumeurs cutanées,<br />
qu’il réalise toujours. Les recherches en photochimiothérapie, développées à partir<br />
133<br />
Figure 19.<br />
Alonso Cortés<br />
Figure 20.<br />
Stel<strong>la</strong> Prada
Figure 21.<br />
Gonzalo Calle<br />
Vélez<br />
Figure 22.<br />
Nelson Giraldo<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
134<br />
<strong>de</strong> 1980 dans les universités d’Antioquia et <strong>de</strong> Nueva Granada, furent également notables,<br />
tout comme les recherches <strong>de</strong> B<strong>la</strong>nca Lilia E. Lesmes Rodríguez à Bogotá sur l’étiopathogénie<br />
<strong>de</strong> l’acné. Jaime Soto Mancipe réalisa aussi à Bogotá (années 90) d’importantes<br />
étu<strong>de</strong>s sur <strong>de</strong>s médicaments, <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies tropicales et l’évolution du cancer cutané 43, 44 .<br />
En 1993, Michel Faizal et ses rési<strong>de</strong>nts César Burgos et Guillermo Jiménez, en association<br />
avec l’institut d’immunologie dirigé par Manuel Elkin Patarroyo, développèrent une<br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose cutanée basée sur <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire<br />
45 . Ultérieurement, Evelyne Halpert et Elizabeth García développèrent une ligne<br />
<strong>de</strong> recherche sur l’immunopathogénèse du prurigo scrofuleux causé par <strong>la</strong> piqûre <strong>de</strong><br />
puce. Le groupe <strong>de</strong> chercheurs <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> Me<strong>de</strong>llin reçut, à<br />
travers <strong>la</strong> distinction octroyée à Ánge<strong>la</strong> Zuluaga, <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong>s institutions gouvernementales.<br />
Des nouvelles figures bril<strong>la</strong>ntes firent leurs apports à <strong>la</strong> recherche vers <strong>la</strong> fin du<br />
XX e siècle, telles Rodolfo Augusto Trujillo Mén<strong>de</strong>z à Cali et Gloria Sanclemente Mesa à<br />
Me<strong>de</strong>llin, entre autres. De nos jours, les différentes écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du pays développent<br />
plusieurs lignes <strong>de</strong> recherche.<br />
HISTOIRE DE LA MYCOLOGIE<br />
Les premières étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> mycologie furent effectuées par José Posada Trujillo à<br />
l’université d’Antioquia dans les années 30. La même université reçut en 1954 le<br />
Dr Gonzalo Calle Vélez (figure 21), le premier promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie, qui s’était<br />
entraîné à Ann Arbor (Michigan); il apporta au pays <strong>la</strong> première collection mycologique,<br />
qui servit <strong>de</strong> base pour l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> recherche. Le domaine se vit renforcé par<br />
<strong>la</strong> présence d’Ánge<strong>la</strong> Restrepo Moreno, qui débuta comme technologiste médicale et<br />
<strong>de</strong>vint <strong>la</strong> mycologue <strong>la</strong> plus remarquable grâce à ses recherches mémorables sur<br />
l’histop<strong>la</strong>smose et <strong>la</strong> paracoccidioïdomycose, qui entraînèrent <strong>de</strong>s innovations en<br />
techniques diagnostiques, en étu<strong>de</strong>s cliniques épidémiologiques et thérapeutiques.<br />
L’apport précieux du mé<strong>de</strong>cin Julio Sánchez Arbeláez fut remarquable (1956).<br />
Le Dr Calle aboutit à inclure l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mycoses dans le programme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
À partir <strong>de</strong> 1960, <strong>la</strong> recherche se pencha sur l’histop<strong>la</strong>smose et <strong>la</strong> paracoccidioïdomycose,<br />
à l’ai<strong>de</strong> d’étu<strong>de</strong>s prospectives <strong>de</strong> patients ; le pathologiste Mario<br />
Robledo Villegas joua un rôle prépondérant dans cette tâche. Les départements <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> pathologie et <strong>de</strong> mycologie fusionnèrent à l’époque avec l’université ; <strong>la</strong><br />
mycologie est désormais incluse dans l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s différentes écoles <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie du pays.<br />
HISTOIRE DE LA DERMATO-PATHOLOGIE<br />
Alfredo Correa Henao, le premier pathologiste colombien, spécialisé aux États-Unis,<br />
ouvrit <strong>la</strong> chaire à l’université d’Antioquia et travail<strong>la</strong> à l’institut prophy<strong>la</strong>ctique,<br />
fondé en 1924 à Me<strong>de</strong>llin par Gustavo Uribe Escobar. Cette ville reçut vers 1950 le<br />
premier <strong>de</strong>rmato-pathologiste, Mario Robledo Villegas (<strong>de</strong>puis le Michigan), qui<br />
contribua beaucoup à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatomycoses ; c’est un homme plein <strong>de</strong> sagesse<br />
dans sa noble simplicité.<br />
Ernesto Correa Galindo arriva à Cali en 1960 après sa formation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatopathologie<br />
en Argentine; cet homme dont l’héritage et l’humanité furent incomparables,<br />
créa <strong>la</strong> chaire à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios. Antonio José Torres Muñoz se<br />
forma à ses côtés, et se rendit ensuite à Buenos Aires afin <strong>de</strong> perfectionner ses étu<strong>de</strong>s.<br />
Accompagné <strong>de</strong> Nelson Giraldo Restrepo (figure 22) (formé aux côtés du Pr. Abu<strong>la</strong>fia<br />
à Buenos Aires), il fonda <strong>la</strong> chaire à l’université <strong>de</strong>l Valle dans les années 70 21 . Luis<br />
Alfredo Rueda P<strong>la</strong>ta, qui avait étudié <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie en France avec les Prs<br />
Degos et Civatte, entreprit à Bogotá en 1963 sa contribution universelle, notamment<br />
sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s virus papota 15, 20 . En 1975, Alonso Cortés créa à l’université
d’Antioquia le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie Gustavo Uribe Escobar, sous <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong> Walter León Hernán<strong>de</strong>z, un éminent <strong>de</strong>rmato-pathologiste et un excellent<br />
pédagogue. Les apports du pathologiste Aníbal Mesa Cock sont également remarquables.<br />
À Bogotá, Fernando García Jiménez, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />
nationale, imprima à son service une approche <strong>de</strong>rmato-pathologique dans les<br />
années 70 et 80 ; il entama une importante col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>puis l’Institut national <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> santé qui se prolonge encore aujourd’hui en <strong>la</strong> personne du pathologiste Gerzaín Rodríguez<br />
Toro. L’admission <strong>de</strong> Luis Fernando Palma — reconnu pour l’acuité <strong>de</strong> ses observations,<br />
son humanisme et son envie d’enseigner — dans cette école (1989) donna<br />
à <strong>la</strong> sous-spécialité encore plus <strong>de</strong> prestige. À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 80, Felipe Jaramillo<br />
Ayerbe arriva à Manizales après avoir suivi <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s à l’université <strong>de</strong> Nueva York et<br />
<strong>de</strong>vint <strong>la</strong> référence <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-spécialité dans <strong>la</strong> région<br />
du café. Pendant les années 90, d’autres <strong>de</strong>rmato-pathologistes<br />
s’installèrent dans différentes villes pour<br />
développer cette sous-spécialité, dont Mabel Yaneth<br />
Ávi<strong>la</strong> Camacho à Bucaramanga et Ricardo Augusto<br />
Rueda P<strong>la</strong>ta à Cali, qui décrivit l’éruption polymorphe<br />
et éosinophilique associée à radiothérapie 21, 32 . Antonio<br />
Barrera, Patricia De Castro, Felipe Jaramillo, Leonor<br />
Molina, Luis Fernando Palma, Gerzaín Rodríguez, Luis<br />
Alfredo Rueda et Ricardo Rueda fondèrent à Bogotá, le<br />
22 juin 1996, <strong>la</strong> Délégation colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatopathologie,<br />
choisissant Antonio Barrera Arenales<br />
comme premier prési<strong>de</strong>nt (figure 23).<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE ONCOLOGIQUE<br />
Dès 1934, les patients atteints du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau étaient soignés à l’Institut national<br />
<strong>de</strong> radium à Bogotá. Cependant, en 1978 Guillermo Gutiérrez Aldana (figure 24) diffusa<br />
ses connaissances <strong>de</strong>puis l’université nationale (Bogotá) vers l’Institut national <strong>de</strong><br />
cancérologie, en <strong>de</strong>ssinant l’histoire clinique onco-<strong>de</strong>rmatologique et en commençant sa<br />
pratique et son enseignement, qui se consolidèrent sous sa direction grâce à <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie oncologique en 1992, dont <strong>la</strong> conception revient à<br />
Michel Faizal Geagea et ensuite à Álvaro Acosta <strong>de</strong> Hart. Dans les années 90, C<strong>la</strong>udia<br />
Marce<strong>la</strong> Covelli Mora et Carmen Helena <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hoz Ulloa commencèrent à prodiguer <strong>de</strong>s<br />
soins à l’université <strong>de</strong>l Valle à Cali. Plusieurs collègues formés à l’étranger et diplômés à<br />
l’Institut national <strong>de</strong> cancérologie diffusèrent <strong>la</strong> sous-spécialité dans d’autres villes du<br />
pays.<br />
HISTOIRE DE LA DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE<br />
COLLABORATEUR: Antonio Barrera Arenales<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique fit ses premiers pas dans les décennies 70 et 80, suivant<br />
l’intérêt mondial naissant et croissant pour approfondir l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
infantile, grâce à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues associés à l’enseignement. Les mé<strong>de</strong>cins<br />
remarquables dans le domaine furent : à Bogotá, Mariano López et Manuel Forero<br />
(hôpital pédiatrique La Misericordia), Enrique Suárez Peláez et Jaime Soto Mancipe<br />
(clinique infantile Colsubsidio) et Antonio Barrera Arenales (hôpital infantile universitaire<br />
Lorencita Villegas <strong>de</strong> Santos) ; à Me<strong>de</strong>llin, Evelyne Halpert Ziskiend (figure<br />
25), <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> l’université d’Antioquia et <strong>la</strong> première <strong>de</strong>rmatologue<br />
infantile colombienne, diplômée à l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie à Mexico en 1981,<br />
créatrice du service à l’hôpital universitaire San Vicente <strong>de</strong> Paúl, qui serait plus tard<br />
à <strong>la</strong> charge d’Amparo Ochoa, Martha Sierra et Gabriel Ceballos ; à Cali, Guillermo<br />
135<br />
Figure 23.<br />
Antonio Barrera<br />
Figure 24.<br />
Guillermo<br />
Gutiérrez<br />
Figure 25.<br />
Evelyne Halpert
Figure 26.<br />
Fondation du<br />
Collège ibéroaméricain<br />
<strong>de</strong><br />
cryochirurgie<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
136<br />
González Rodríguez, Rafael Isaza Zapata et Jairo Victoria Chaparro, tandis qu’à Manizales<br />
se distingua Josefina Danies à l’hôpital infantile. Les Séminaires internationaux<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique débutèrent à Cali ; le premier (1989) fut coordonné<br />
par Guillermo González et Rafael Isaza.<br />
Après <strong>la</strong> clôture du XIX e Congrès colombien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à San Andrés (1992), présidé<br />
par F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas, un symposium sur L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en<br />
Colombie eut lieu, pendant lequel Antonio Barrera dit : « La dimension insoupçonnée et<br />
<strong>la</strong> complexité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, ainsi que <strong>la</strong> diversité <strong>de</strong>s faits pathologiques nous poussent<br />
à considérer qu’il est urgent d’augmenter, d’é<strong>la</strong>rgir et d’approfondir l’étu<strong>de</strong> et <strong>la</strong> recherche<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dans ses différents sujets, sans favoriser une fragmentation<br />
inutile et sans rien proposer <strong>de</strong> nouveau… La création et l’impulsion <strong>de</strong> programmes et<br />
<strong>de</strong> services sous-spécialisés dans certains domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont <strong>de</strong>s tâches à<br />
accomplir dans un futur proche [ainsi que] les considérations sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique,<br />
entre autres… et <strong>de</strong>s programmes sous-spécialisés pouvant être développés dans<br />
quelques écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du pays. »<br />
Antonio Barrera, Josefina Danies, Manuel Forero, Guillermo González, Evelyne Halpert,<br />
Mariano López, Amparo Ochoa, Enrique Suárez Peláez, Jaime Soto et Jairo Victoria<br />
fondèrent l’Association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique en 1992 à Bogotá, dont le<br />
premier prési<strong>de</strong>nt fut le Dr Suárez tandis que le Dr Barrera était chargé du secrétariat.<br />
La sous-spécialité continue <strong>de</strong> se développer et elle se répand dans les différents services<br />
grâce à l’admission <strong>de</strong> nouveaux spécialistes.<br />
HISTOIRE DE LA CRYOCHIRURGIE<br />
COLLABORATEUR: Carlos Horacio González Rojas<br />
Gilberto Castro Ron, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’American College of Cryosurgery, organisa un cours<br />
<strong>de</strong> cryochirurgie pour <strong>de</strong>rmatologues à l’institut d’oncologie Luis Razetti à Caracas. En<br />
1988, Carlos Horacio González Rojas et Sergio Cáceres Orozco se trouvaient parmi les assistants,<br />
et introduisirent ensuite <strong>la</strong> cryochirurgie mo<strong>de</strong>rne en Colombie. Le Dr González<br />
fonda l’unité <strong>de</strong> cryochirurgie à Armenia, consacrée à l’enseignement et à <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> technique, assistant les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s sans moyens économiques, sans but lucratif. Luis Hernando<br />
Moreno, Ánge<strong>la</strong> Sei<strong>de</strong>l Arango, Rafael Isaza et Danilo Álvarez Villegas (<strong>de</strong>rmatologues),<br />
ainsi que le chirurgien maxillo-facial Carlos Enrique Mora Bajo se formèrent sous<br />
sa direction. Plus tard, ce fut le tour <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues María Bernarda Gáfaro Barrera,<br />
Yamil Alberto Duque Ossman, Joaquín Eliécer Berrio Muñoz, Gema Esther Revelo<br />
Hernán<strong>de</strong>z, et <strong>de</strong>s odontologues Diego Arango et Julio César Torres. L’équipe reçut ultérieurement<br />
l’apport <strong>de</strong> collègues d’autres villes, comme Fabio Londoño, Juan Pedro<br />
Velásquez, Gustavo Acevedo Merino et María Mélida<br />
Durán, et <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> Gerzaín Rodríguez pour <strong>la</strong><br />
lecture <strong>de</strong>s biopsies. À l’initiative <strong>de</strong> six <strong>de</strong>rmatologues, le<br />
Collège ibéro-américain <strong>de</strong> cryochirurgie (figure 26) fut<br />
fondé le 3 décembre 1991 à Guada<strong>la</strong>jara (Mexique) au<br />
cours du congrès du CILAD; le Dr Castro Ron fut élu prési<strong>de</strong>nt,<br />
auquel succéda le Dr González. Ce <strong>de</strong>rnier donna<br />
une plus gran<strong>de</strong> impulsion à <strong>la</strong> technique lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième réunion du Collège à Carthagène (1999), qui<br />
compta 270 <strong>de</strong>rmatologues nationaux et 70 participants<br />
venus <strong>de</strong> l’étranger.<br />
Bien d’autres collègues notables contribuèrent à l’histoire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-spécialité, tels que Virginia Pa<strong>la</strong>cios Bernal<br />
et Luis Fernando Balcázar Romero.
Le 25 janvier 1999 fut une journée noire pour <strong>la</strong> Colombie et pour <strong>la</strong> cryochirurgie :<br />
un tremblement <strong>de</strong> terre dévasta 60 % d’Armenia ainsi que son unité <strong>de</strong> Cryochirurgie,<br />
à l’époque où César Iván Vare<strong>la</strong> s’y rendait tous les vendredis. Un an plus tard, l’unité<br />
fut reconstruite, dirigée par Ánge<strong>la</strong> Sei<strong>de</strong>l Arango, qui reçut <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> tous<br />
les collègues <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville ; ceci entraîna l’é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> son champ d’action tout en<br />
conservant <strong>la</strong> philosophie <strong>de</strong> son fondateur sur l’enseignement et le soin <strong>de</strong>s plus nécessiteux.<br />
Note : nous sommes profondément peinés <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort du Dr Castro Ron quelques jours<br />
après <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> ce chapitre.<br />
HISTOIRE DE LA CHIRURGIE DERMATOLOGIQUE<br />
Les premiers pas associés aux drainages et aux extractions reviennent à nos indigènes,<br />
qui connaissaient déjà <strong>de</strong>s procédures pour soigner les blessures. Les protomedicos<br />
et les barbiers s’exercèrent pendant <strong>la</strong> Conquête, suivis ultérieurement <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
et <strong>de</strong>s chirurgiens. F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas étudia <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique à l’université<br />
<strong>de</strong> Rio <strong>de</strong> Janeiro en 1965; à son retour à Me<strong>de</strong>llin, il introduisit les techniques chirurgicales.<br />
Un peu plus tard (1967), Juan Pedro Velásquez Berruecos <strong>de</strong>vint un expert <strong>de</strong>s nouvelles<br />
techniques et <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s équipements avant-gardistes. Pionnier en<br />
radio-chirurgie, il conçut et enseigna <strong>de</strong> multiples techniques simples et efficaces pour les<br />
procédures <strong>de</strong> cabinet. À Cali, Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> conçut dans les années 70 <strong>de</strong> nouvelles<br />
techniques pour le traitement chirurgical du vitiligo en utilisant <strong>de</strong>s mini-greffes 25, 28 ;<br />
Carlos Escobar fonda plus tard <strong>la</strong> chaire à l’université <strong>de</strong>l Valle. À Montería, <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique débuta en 1983 avec Adolfo Gómez Agámez, formé au Mexique et en Argentine<br />
en <strong>de</strong>rmo-cosmétologie avec le Dr Cor<strong>de</strong>ro; Rómulo Vitar Zapa et Víctor Otero<br />
Marrugo le secondèrent dans son travail. Une nouvelle ère <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
commença à Bogotá en 1992 avec Guillermo Gutiérrez Aldana, à travers <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie oncologique à l’Institut national <strong>de</strong> cancérologie. Les premiers<br />
chirurgiens <strong>de</strong>rmatologues — Michel Faizal Geagea, qui avait étudié au Brésil, et<br />
Álvaro Enrique Acosta Madiedo <strong>de</strong> Hart, en Espagne — furent chargés d’organiser et <strong>de</strong><br />
mettre en route les programmes et l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs 31 , une technique<br />
chirurgicale introduite à Cali par C<strong>la</strong>udia Marce<strong>la</strong> Covelli Mora et Carmen Helena <strong>de</strong> La<br />
Hoz Ulloa. Le Dr Covelli introduisit <strong>la</strong> liposuccion, suivi <strong>de</strong> Pablo Alonso Tróchez Rodríguez.<br />
L’Institut <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé créa à Me<strong>de</strong>llin le premier programme <strong>de</strong> supraspécialité<br />
en chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Actuellement, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues en<br />
exercice effectuent <strong>de</strong>s chirurgies <strong>de</strong>rmatologiques habituelles, et <strong>la</strong> discipline est régulièrement<br />
enseignée dans les différentes écoles.<br />
Institutions <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
■ Institutions <strong>de</strong>rmatologiques<br />
HISTOIRE DE L’ASSOCIATION COLOMBIENNE DE DERMATOLOGIE ET DE CHIRURGIE<br />
DERMATOLOGIQUE; SES DÉLÉGATIONS, SES FILIALES ET SES RÉGIONS<br />
César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z<br />
L’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
Les Drs Manuel José Silva, Gonzalo Reyes García, Carlos Cortés Enciso, Miguel Serrano<br />
Camargo, Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba, Alcibía<strong>de</strong>s Correal, Álvaro Medina, Tomás<br />
Henao B<strong>la</strong>nco, Gustavo Castel<strong>la</strong>no M, Alberto Medina Pinzón, Alberto Caballero, Rafael<br />
López Ruiz, Luis A. Díaz et Alfredo Laver<strong>de</strong> se réunirent au Club médical <strong>de</strong> Bogotá le<br />
27 juin 1948 (à 18 heures), dans le but <strong>de</strong> créer <strong>la</strong> Société colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> syphiligraphie. Ils désignèrent les autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite société : Gonzalo Reyes García<br />
137
Figure 27.<br />
F<strong>la</strong>vio Gómez<br />
Vargas et Gonzalo<br />
Reyes García<br />
Figure 28.<br />
Jaime Betancourt,<br />
Fabio Londoño,<br />
Miguel Serrano<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
138<br />
(figure 27) (prési<strong>de</strong>nt), Carlos Cortés Enciso (vice-prési<strong>de</strong>nt)<br />
et Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba (secrétaire). La société fut<br />
créée dans le but <strong>de</strong> favoriser le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité,<br />
l’enseignement et <strong>la</strong> recherche, <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
syphilis et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies tropicales, et pour veiller aux intérêts<br />
<strong>de</strong>s associés, entre autres. Afin <strong>de</strong> respecter son véritable<br />
caractère national, Gonzalo Calle Vélez, Fabio<br />
Londoño González (figure 28) et Hernán Tobón Pizarro <strong>de</strong>mandèrent<br />
le 27 juin 1959 aux fondateurs <strong>de</strong> supprimer<br />
l’obligation <strong>de</strong> vivre à Bogotá pour pouvoir appartenir à <strong>la</strong><br />
société, ce qui fut approuvé. Un an plus tard, <strong>la</strong> société organisa<br />
à Bogotá son premier congrès national (8-10 décembre<br />
1960), Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba étant prési<strong>de</strong>nt du<br />
conseil et Carlos E. Cortés vice-prési<strong>de</strong>nt ; le statut juridique<br />
fut obtenu en 1961 ; en 1998, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Merce<strong>de</strong>s Flórez, <strong>la</strong> société<br />
changea sa raison sociale, <strong>de</strong>venant l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique. En 2002, Arturo C. Argote Ruiz encouragea l’achat <strong>de</strong> son siège<br />
actuel.<br />
L’association fut présidée par Gonzalo Reyes García, Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>ba, José<br />
Posada Trujillo, Hernán Tobón Pizarro, Álvaro Sabogal Rey, Fabio Londoño González,<br />
Gonzalo Calle Vélez, Heriberto Gómez Sierra, Luis Alfredo Rueda P<strong>la</strong>ta, Fuad Muvdi<br />
Chaín, Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>, Adolfo Ormaza Hinestrosa, Guillermo Gutiérrez Aldana, Alfonso<br />
Rebolledo Muñoz, Enrique Alonso Osorio Camacho,<br />
Juan Guillermo Chale<strong>la</strong> Mantil<strong>la</strong>, María<br />
Mélida Durán Merchán, Mariano López López,<br />
F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas, Juan Pedro Velásquez<br />
Berruecos, Merce<strong>de</strong>s Flórez Díaz Granados,<br />
Carlos Horacio González Rojas, Ánge<strong>la</strong> Zuluaga<br />
<strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>na et Evelyne Halpert Ziskiend.<br />
À <strong>la</strong> date d’aujourd’hui l’association rassemble<br />
448 membres actifs, 20 membres honoraires,<br />
25 membres correspondants, 34<br />
membres internationaux et 54 rési<strong>de</strong>nts en <strong>de</strong>rmatologie,<br />
ce qui fait un total <strong>de</strong> 581 membres<br />
associés. Elle organisa 24 congrès nationaux,<br />
plusieurs symposiums et <strong>de</strong>s cours nationaux et<br />
internationaux. Elle regroupe dix délégations régionales et compte cinq filiales. La Revista<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación Colombiana <strong>de</strong> Dermatología y Cirugía Dermatológica est son organe<br />
<strong>de</strong> diffusion. Carlos Horacio González, Ánge<strong>la</strong> Zuluaga et Evelyne Halpert<br />
consolidèrent les délégations régionales et renforcèrent <strong>la</strong> participation syndicale à travers<br />
<strong>la</strong> coordination nationale <strong>de</strong> César Iván Vare<strong>la</strong> et <strong>de</strong> César Burgos, visant aux changements<br />
<strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé imposés par <strong>la</strong> loi 100 <strong>de</strong> 1993.<br />
Les délégations régionales<br />
a) Délégation du Centre, <strong>de</strong> Bogotá et <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale, Cundinamarca. La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie fut le premier événement que<br />
<strong>la</strong> délégation organisa. Cependant, le développement <strong>de</strong>s écoles et même celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
nationale empêchèrent pendant plusieurs années sa visibilité. La délégation naquit<br />
à nouveau en 1990, et son prési<strong>de</strong>nt fut Antonio Barrera Arenales, suivi <strong>de</strong> Juan<br />
Guillermo Chale<strong>la</strong> Mantil<strong>la</strong>. L’étape actuelle commença en novembre 2002, suite à une<br />
initiative d’Evelyne Halpert intégrant les collègues <strong>de</strong> Cundinamarca et Boyacá et
choisissant Héctor José<br />
Castel<strong>la</strong>nos Lorduy comme<br />
prési<strong>de</strong>nt. Elle regroupe<br />
144 <strong>de</strong>rmatologues.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
b) Délégation <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée<br />
du Cauca. Elle fut créée à<br />
Cali en 1963 par Hernán<br />
Tobón Pizarro, Jaime Betancourt<br />
Osorio — premier<br />
prési<strong>de</strong>nt — et Ernesto<br />
Correa Galindo. Elle regroupe<br />
66 membres actifs,<br />
5 membres honoraires et 8 aspirants. Parmi ses prési<strong>de</strong>nts nous citerons Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>,<br />
Martha Helena Campo, Jairo Victoria, Luis Hernando Moreno, Myriam Jazmín Vargas,<br />
César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z (figure 29) et Rodolfo Augusto Trujillo. Sous sa prési<strong>de</strong>nce<br />
(1996-2004), le Dr Vare<strong>la</strong> mena une importante gestion administrative et obtint d’excellentes<br />
réussites syndicales; son vice-prési<strong>de</strong>nt, Jaime Gil Jaramillo (figure 30), réalisa un<br />
travail pionnier dans <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> thèmes <strong>de</strong>rmatologiques dans les médias. Lors du 40 e<br />
anniversaire <strong>de</strong> sa fondation, en 2003, on rendit hommage aux membres honoraires<br />
Jaime Betancourt, Antonio Torres, Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>, Daniel González Bermú<strong>de</strong>z et Cecilia<br />
Moncaleano; le Dr Vare<strong>la</strong> présenta son livre Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología Vallecaucana<br />
1939-2003 [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée du Cauca 1939-2003]. L’ordre du mérite<br />
Vallecaucano fut octroyé par le gouvernement départemental à <strong>la</strong> délégation et au<br />
Dr Torres, en reconnaissance <strong>de</strong> leur travail 21 .<br />
c) Délégation d’Antioquia.<br />
La Société antioqueña<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut créée à Me<strong>de</strong>llin en<br />
1977, inspirée par son<br />
premier prési<strong>de</strong>nt F<strong>la</strong>vio<br />
Gómez Vargas, accompagné<br />
<strong>de</strong> Fabio<br />
Uribe, Juan Pedro<br />
Velásquez, Diego Jaramillo,<br />
Myriam Mesa,<br />
Beatriz Sierra, Gonzalo<br />
Gómez, Stel<strong>la</strong> Prada,<br />
José Ignacio Gómez et<br />
<strong>de</strong>s collègues déjà décédés Iván Rendón, Jorge López, Jorge Mesa, Aníbal Zapata, Enrique<br />
Saldarriaga et Libardo Agu<strong>de</strong>lo. Elle fut également présidée par Jorge Mesa, Juan<br />
Pedro Velásquez, Diego Jaramillo et actuellement par José Ignacio Gómez (figure 31).<br />
Elle compte 80 membres actifs, 8 membres honoraires, 19 membres adhérents et<br />
3 membres adjoints. Lors du 25 e anniversaire <strong>de</strong> sa fondation (2002), le Pr. Alonso Cortés<br />
reçut une reconnaissance officielle, tandis que <strong>la</strong> mémoire <strong>de</strong> José Posada, Carlos<br />
E. Tobón et Gonzalo Calle fut honorée.<br />
d) Délégation <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique. Elle fut fondée à Barranquil<strong>la</strong> en 1987 par Antonio Jaller, Álvaro<br />
Correa, Bernardo Huyke (figure 32), Jairo Fuentes, Lesbia De León Ternera, Dubys<br />
Charris et Amín Ariza. En 1993, elle affilia <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues appartenant à d’autres départements<br />
du Caraïbe colombien; elle se caractérisa par son organisation excellente et sa<br />
139<br />
Figure 29.<br />
César I. Vare<strong>la</strong><br />
Figure 30.<br />
Jaime Gil<br />
Figure 31.<br />
J. Ignacio Gómez<br />
Figure 32.<br />
Bernardo Huyke<br />
Figure 33.<br />
Alfonso Rebolledo<br />
Figure 34.<br />
Gonzalo Marrugo
Figure 35.<br />
Álvaro Sabogal<br />
Figure 36.<br />
Adolfo Ormaza<br />
Figure 37.<br />
Adolfo Gómez<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
140<br />
lutte permanente pour le<br />
bien-être <strong>de</strong> ses membres<br />
dans les domaines professionnel<br />
et social. À l’initiative<br />
d’Álvaro Correa,<br />
Esperanza Melén<strong>de</strong>z et<br />
Bernardo Huyke, elle organisa<br />
quatre symposiums<br />
du Caraïbe avec succès.<br />
e) Délégation <strong>de</strong> Nariño.<br />
Alfonso Rebolledo Muñoz<br />
(figure 33) créa en 1977<br />
le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital départemental <strong>de</strong> Nariño, à Pasto, s’occupant <strong>de</strong><br />
l’enseignement supérieur <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université. En 1990, il fonda avec César<br />
Gregorio Arroyo Eraso <strong>la</strong> délégation qui rassemble les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> région que<br />
prési<strong>de</strong> toujours son fondateur.<br />
f) Délégation <strong>de</strong> Bolívar. Cette délégation fut fondée le 3 mars 1993 par Erick Álvarez,<br />
Nayib Ambrad, Francisco M. Camacho, Miguel Camacho Sánchez, Germán Enrique Covo,<br />
Carlos Alberto Garzón, Víctor Isaza, Gonzalo Marrugo Guardo (figure 34), Luz Marina<br />
Lara, Guillermo Alejandro Mundi, Julio César Naar et José Pretelt ; Alfonso Navarro Céar<br />
fut désigné prési<strong>de</strong>nt, poste qu’occupe actuellement Luis Miguel Covo Segrera.<br />
g) Délégation <strong>de</strong> Santan<strong>de</strong>r. Álvaro Sabogal Rey (figure 35) fut le pionnier et le doyen <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie régionale, suivi <strong>de</strong> Virgilio Rodríguez, Alejandro Vil<strong>la</strong>lobos, Luis Moreno,<br />
Jaime Acevedo, Andrés Torres, Juan F. Hernán<strong>de</strong>z, Hernando Mosquera, Evencio Saza,<br />
Miguel Zárate, Zulma P<strong>la</strong>ta, Pablo Rey, Donaldo Ortiz, Miguel F. Duarte, Luz Stel<strong>la</strong> Montoya,<br />
Armando Vásquez, Jairo Sabogal, Alfinger Celi et son épouse Lour<strong>de</strong>s Eid, Ricardo<br />
F<strong>la</strong>minio Rojas, Edgar Moreno, Mabel Ávi<strong>la</strong>, Carolina Chávez, Sandra O. Martínez, Martha<br />
S. Ramírez et Luisa H. Díaz.<br />
La délégation fut fondée en juin 1994, bril<strong>la</strong>mment présidée par Luz Stel<strong>la</strong> Bayona<br />
(née Montoya) jusqu’en 2002, remp<strong>la</strong>cée par Armando Vásquez Lobo.<br />
h) Axe Cafetero-Caldas, Quindío et Risaralda. Heriberto Gómez Sierra fut le premier<br />
à exercer <strong>la</strong> spécialité à Manizales (1965), secondé par son disciple Jairo Mesa et par<br />
Bernardo Giraldo ; plus tard ce fut le tour <strong>de</strong> Felipe Jaramillo, Lucía Van <strong>de</strong>n En<strong>de</strong>n<br />
et John Harvey Gaviria. À Pereira, le pionnier fut Adolfo Ormaza, tandis qu’à Armenia<br />
ce furent Fabio Rivera, María Bernarda Gáfaro, Julio César Vélez, Silvia Ferrer,<br />
Rafael Isaza et Carlos Horacio González. La délégation constituée le 4 octobre 2003<br />
est actuellement présidée par Germán Santacoloma Osorio. Elle rassemble 32 <strong>de</strong>rmatologues<br />
et 2 membres honoraires : Adolfo Ormaza Hinestrosa (figure 36) et Jairo<br />
Mesa Cock, principale figure contemporaine dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> télé-éducation<br />
continue.<br />
i) Délégation Centre-Orient. Elle fut fondée en septembre 2003 à Bogotá par Michel Faizal<br />
Gragea ; elle est intégrée par les collègues <strong>de</strong>s départements <strong>de</strong> Boyacá, Meta, Tolima,<br />
Hui<strong>la</strong> et Caquetá et les communes <strong>de</strong> Cundinamarca autres que Bogotá.<br />
j) Délégation Morrosquillo-Córdoba et Sucre. Hugo Corrales Lugo fut le premier à exercer<br />
à Córdoba, suivi d’Albio Puche. En 1983 commença une nouvelle ère pour <strong>la</strong> spécialité<br />
grâce à l’arrivée du premier <strong>de</strong>rmatologue diplômé, Adolfo <strong>de</strong>l Cristo Gómez Agámez
(figure 37), qui avait étudié au Mexique et en Argentine et fut professeur à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> corporation universitaire du Sinú (CUS). Plus tard arrivèrent Rómulo<br />
Bitar, Víctor Otero, José Joaquín Meza, Catalina Zárate et Samira Acosta. À Sucre, Hugo<br />
Corrales Medrano fut le pionnier, tandis qu’actuellement Mufith Sa<strong>la</strong>iman, Jorge Vargas<br />
et Gabriel Rey exercent <strong>la</strong> spécialité. La délégation fut formée en 2004 et elle est présidée<br />
<strong>de</strong> nos jours par Catalina Zárate.<br />
k) Délégation nord-santandérienne. Pedro Miguel Román Suárez en fut le pionnier et impulsa<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région jusqu’à sa mort en 2003. La délégation fut officialisée<br />
à Cúcuta en avril 2004 par Matil<strong>de</strong> L<strong>la</strong>nos Campo, Pablo Colmenares Porras, Emiro<br />
Andra<strong>de</strong> Chaparro et Sergio Cáceres Orozco ; elle est présidée par Álvaro Arévalo Durán.<br />
l) Le département du Cauca. José M. Delgado, Mario E. González et José F. Zambrano en<br />
furent les pionniers. À partir <strong>de</strong> 1983, <strong>la</strong> spécialité fut exercée à Popayán par Edgar Ricardo<br />
Altuzarra Galindo (figure 38), <strong>de</strong>rmatologue et épidémiologiste, professeur et chef<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire du département ; Germán Ve<strong>la</strong>sco Cár<strong>de</strong>nas (figure 39), diplômé<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Barcelone (<strong>de</strong>puis 1992) et José F. Ospina Alzate à partir <strong>de</strong><br />
1999, diplômé <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Caldas et professeur universitaire. Les <strong>de</strong>rmatologues<br />
intégrèrent <strong>la</strong> délégation <strong>de</strong>l Valle en 2002.<br />
m) Département <strong>de</strong> Boyacá. Le pionnier fut Antonio José Morales Segura (figure 40) qui<br />
exerça à son retour d’Espagne en 1968 ses activités avec dévouement et compétence,<br />
jusqu’à nos jours. Doris Stel<strong>la</strong> León Romero (figure 41), <strong>de</strong> l’université nationale, exerce<br />
<strong>de</strong>puis 1986 ; tout comme son époux, le mé<strong>de</strong>cin historien José Miguel Gaona, elle fut une<br />
importante col<strong>la</strong>boratrice. Pour sa part, Aldo Fajardo Palencia, <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong>l Valle,<br />
exerce <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis 1990.<br />
Faute <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce, je ne peux distinguer tous les collègues qui exercèrent et qui exercent<br />
toujours <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les différentes villes du pays, contribuant à <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong><br />
notre spécialité.<br />
Les filiales<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
a) Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Elle fut créée le 12 décembre<br />
1992 à Bogotá par Antonio Barrera, Josefina Danies, Manuel Forero, Guillermo González,<br />
Evelyne Halpert, Mariano López, Amparo Ochoa, Jaime Soto, Enrique Suárez et Jairo<br />
Victoria. Enrique Suárez Peláez (figure 42) fut élu prési<strong>de</strong>nt et Antonio Barrera Arenales<br />
secrétaire. Les objectifs <strong>de</strong> l’association sont l’étu<strong>de</strong>, l’enseignement, <strong>la</strong> recherche et <strong>la</strong><br />
141<br />
Figure 38.<br />
Edgar Altuzarra<br />
Figure 39.<br />
Germán Ve<strong>la</strong>sco<br />
Figure 40.<br />
Antonio J. Morales<br />
Figure 41.<br />
Doris S. León
Figure 42.<br />
Enrique Suárez<br />
Figure 43.<br />
Luis A. Rueda<br />
Figure 44.<br />
Assis (<strong>de</strong> gauche<br />
à droite) : Jairo<br />
Mesa, César<br />
I. Vare<strong>la</strong>, Danielle<br />
Alencar-Ponte.<br />
Debout : D. Jaime<br />
Soto, Juan P.<br />
Velásquez, Jaime<br />
Gil, Antonio Torres<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
promotion <strong>de</strong> nouveaux services. Marie<strong>la</strong> Tavera<br />
est sa prési<strong>de</strong>nte actuelle. Le 1 er Congrès national<br />
eut lieu à Bogotá en 1994, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du<br />
Dr Suárez ; six congrès nationaux furent organisés<br />
jusqu’à présent, dont trois furent présidés par le<br />
Dr Halpert.<br />
b) Délégation colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie.<br />
Elle fut fondée à Bogotá le 22 juin 1996 par Antonio<br />
Barrera — qui fut élu prési<strong>de</strong>nt — , Patricia De<br />
Castro, Felipe Jaramillo, Leonor Molina, Luis Fernando<br />
Palma, Gerzaín Rodríguez, Luis Alfredo<br />
Rueda P<strong>la</strong>ta (figure 43) et Ricardo Rueda. Elle vise,<br />
entre autres, à promouvoir et à stimuler l’étu<strong>de</strong>, l’enseignement, <strong>la</strong> recherche et à encourager<br />
<strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologistes.<br />
c) Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique. Elle fut fondée à Bogotá en<br />
août 2002 par Álvaro Acosta, Guillermo Gutiérrez, Xavier Rueda, Elkin Peñaranda et<br />
Guillermo Jiménez; les trois premiers furent respectivement<br />
élus prési<strong>de</strong>nt, vice-prési<strong>de</strong>nt et secrétaire.<br />
Malgré sa création récente, ses<br />
gestionnaires développèrent un important travail<br />
d’éducation et <strong>de</strong> service envers <strong>la</strong> communauté.<br />
■ Publications scientifiques scientifiques<br />
142<br />
d) Association d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
colombienne. Elle fut fondée le 12 juin 2004, à<br />
l’initiative <strong>de</strong> César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z (prési<strong>de</strong>nt)<br />
et Michel Faizal Geagea (vice-prési<strong>de</strong>nt), accompagnés<br />
d’Antonio Torres, <strong>de</strong> Jaime Gil, <strong>de</strong><br />
Danielle Alencar-Ponte (secrétaire), <strong>de</strong> Jairo Mesa,<br />
<strong>de</strong> Juan <strong>de</strong> Pedro Velásquez, d’Evelyne Halpert, <strong>de</strong><br />
F<strong>la</strong>vio Gómez et <strong>de</strong> Jaime Soto. Les principaux objectifs<br />
<strong>de</strong> l’institution sont <strong>de</strong> veiller à ce que les<br />
événements et les grands noms <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong>meurent<br />
dans <strong>la</strong> mémoire collective et soient diffusés<br />
à travers l’enseignement (figure 44).<br />
De nombreuses publications traitant <strong>de</strong> sujets médicaux existent en Colombie <strong>de</strong>puis<br />
le XVII e siècle. Nous allons ici nous limiter à en énumérer quelques-unes liées à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à partir <strong>de</strong>s années 40.<br />
La Revista Colombiana <strong>de</strong> Dermatología<br />
COLLABORATEUR: F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas<br />
La Revista Colombiana <strong>de</strong> Dermatología (La Revista) est l’organe d’expression <strong>de</strong> l’Association<br />
colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, ses filiales et ses<br />
délégations régionales. Son contenu est essentiellement scientifique, bien que soient éventuellement<br />
publiées <strong>de</strong>s informations à caractère syndical ou informatif. Sa mission principale<br />
est d’assurer <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins. La Revista naquit grâce à
l’initiative <strong>de</strong> F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas (figure 45) lorsqu’il<br />
présidait l’association (1990-1992); il reçut <strong>la</strong><br />
col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> M. William Sánchez, dirigeant du <strong>la</strong>boratoire<br />
Essex Farmacéutica, division <strong>de</strong> Schering<br />
Plough S.A. Le docteur Gómez offrit l’édition <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
revue à Carlos Enrique Escobar Restrepo (figure 46),<br />
à qui succédèrent Diego E. Jaramillo, Jaime Soto et<br />
Juan Jaime Atuesta. Carlos Escobar reprit l’édition<br />
en 1998; il fut remp<strong>la</strong>cé par María Isabel Barona et<br />
Lucy García à sa mort en 1999; <strong>de</strong>puis 2002, Luis<br />
Fernando Balcázar Romero est chargé <strong>de</strong> l’édition.<br />
Le premier numéro parut le 1 er juillet 1999. La revue<br />
paraît <strong>de</strong> façon trimestrielle, avec un tirage à 1000<br />
exemp<strong>la</strong>ires.<br />
Le site Internet <strong>de</strong> l’association <br />
COLLABORATEUR: Jairo Mesa Cock<br />
Jairo Mesa Cock (figure 47) consacra sa vie à l’enseignement au sein <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Caldas, à Manizales. Lors <strong>de</strong> sa retraite en 1994, il pensa que « <strong>la</strong> technologie<br />
<strong>de</strong>s ordinateurs et Internet seraient <strong>de</strong>s outils pouvant être utilisés pour<br />
atteindre divers objectifs, et chez les <strong>de</strong>rmatologues… à <strong>de</strong>s fins éducatives ». Il<br />
organisa progressivement à partir <strong>de</strong> 1998 une base d’adresses électroniques <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologues à qui il envoyait périodiquement <strong>de</strong>s résumés et <strong>de</strong>s commentaires<br />
sur <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong> publications diverses, ce qui fit p<strong>la</strong>ce au Club <strong>de</strong> Revistas. Mario<br />
Linares Barrios — qui dirige le Foro Dermatológico à Cádiz, Espagne — entreprit<br />
en 2000 <strong>la</strong> diffusion du Club <strong>de</strong> Revistas; en 2002, un autre collègue espagnol<br />
bril<strong>la</strong>nt, Paco Russo, mit en p<strong>la</strong>ce sur Internet un espace analogue, le Foro Bibliográfico,<br />
et invita le Dr Mesa à y participer.<br />
Le site Internet <strong>de</strong> l’association fut créé en septembre 2001, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce d’Ánge<strong>la</strong><br />
Zuluaga <strong>de</strong> Ca<strong>de</strong>na; elle obtint en 2002 le sponsoring <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires Aldoquín, grâce<br />
à son gérant Gabriel Peña. En octobre 2002, Jairo Mesa Cock exprima à <strong>la</strong> nouvelle prési<strong>de</strong>nte,<br />
Evelyne Halpert, son désir <strong>de</strong> créer un site Internet <strong>de</strong>stiné aux <strong>de</strong>rmatologues à <strong>de</strong>s<br />
fins éducatives, ce qu’il fit le 1 er janvier 2003. Désormais, il dirige sous le signe <strong>de</strong> l’excellence<br />
ce site marqué <strong>de</strong> sa personnalité, un site innovant, pédagogique et qui favorise le<br />
sentiment d’appartenance au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté scientifique; le site comporte actuellement<br />
<strong>de</strong>s espaces pour l’information générale, les communiqués, les événements académico-scientifiques,<br />
les membres associés, <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s courriers, les rési<strong>de</strong>nts, l’histoire, les<br />
délégations régionales, le club <strong>de</strong> revues, les mini-cas hebdomadaires, les perles <strong>de</strong>rmatologiques,<br />
le forum syndical, <strong>la</strong> revue électronique et <strong>la</strong> communication avec <strong>la</strong> communauté,<br />
entre autres, avec <strong>de</strong>s liens multiples. Ce site, <strong>la</strong> référence en termes d’unité,<br />
d’information et d’enseignement, est visité par <strong>de</strong>s collègues ibéro-américains.<br />
Activités scientifiques<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
■ Activités scientifiques<br />
Col<strong>la</strong>boratrice : Danielle Alencar-Ponte<br />
L’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique organisa,<br />
tout comme ses filiales, ses délégations régionales, ses services et ses écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
plusieurs événements académiques. Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce, nous ne détaillerons<br />
que ceux à caractère national et international.<br />
143<br />
Figure 45.<br />
F<strong>la</strong>vio Gómez<br />
Figure 46.<br />
Carlos E. Escobar<br />
Figure 47.<br />
Jairo Mesa
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
L’association effectua vingt-quatre congrès nationaux, le premier à Bogotá (8-10 décembre<br />
1960), le <strong>de</strong>uxième à Me<strong>de</strong>llin (1961), le troisième à Cali (1963), présidés respectivement<br />
par Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba, José Posada Trujillo et Hernán Tobón Pizarro.<br />
Les congrès suivants eurent lieu à Bucaramanga, Bogotá, Barranquil<strong>la</strong>, Manizales, Pereira,<br />
Paipa, Pasto, Cartagena, San Andrés, Santa Marta et Bogotá (2004).<br />
Six congrès nationaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique eurent également lieu (<strong>de</strong>puis<br />
1994, tous les <strong>de</strong>ux ans) et trois congrès nationaux <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique (<strong>de</strong>puis<br />
1999, tous les <strong>de</strong>ux ans).<br />
Le IX e Congrès ibéro-<strong>la</strong>tino-américain eut lieu à Me<strong>de</strong>llin en 1979, présidé par Alonso<br />
Cortés.<br />
D’autres événements furent organisés par les écoles et les délégations :<br />
— 10 symposiums internationaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Institut <strong>de</strong> sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (CES).<br />
— 1 symposium international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatite <strong>de</strong> contact (Pontificia U. Bolivariana) et 2 symposiums<br />
internationaux (université d’Antioquia, CES et U. Pontificia Bolivariana, à Me<strong>de</strong>llin).<br />
— 4 séminaires internationaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
— 7 symposiums <strong>de</strong> thérapie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
— 2 cours <strong>de</strong> l’International Society of Dermatology, université <strong>de</strong>l Valle.<br />
— 18 cours <strong>de</strong> l’International Society of Dermatology, organisés par María Mélida<br />
Durán, Bogotá.<br />
— Plusieurs journées <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Côte, Société bolivarense.<br />
— 2 séminaires et 1 cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique, École <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique,<br />
Institut national <strong>de</strong> cancérologie.<br />
— 4 symposiums <strong>de</strong>rmatologiques du Caraïbe, Association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong><br />
l’At<strong>la</strong>ntique.<br />
— le XV e Congrès bolivarien 2000 et <strong>la</strong> IV e Rencontre colombo-vénézuélienne, Pereira.<br />
Cercle <strong>de</strong>rmatologique Pedro Miguel Román Suárez, délégation nord-santandérienne.<br />
— 1 cours <strong>de</strong> progrès en <strong>de</strong>rmatologie, 1 cours <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale et <strong>de</strong>s Journées<br />
<strong>de</strong> prévention du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, hôpital militaire central, université <strong>de</strong> Nueva Granada.<br />
— 4 cours d’actualisation et ateliers, Association santandérienne.<br />
■ Enseignement Enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> spécialité <strong>la</strong> specialité : les écoles-servic : les écoles-services e <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
144<br />
En Colombie, l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, dans le cadre académique et <strong>de</strong> recherche<br />
et basant son action sur les hôpitaux universitaires, dont l’apport fut fondamental pour le<br />
soin <strong>de</strong>rmatologique, se fit au sein <strong>de</strong>s différents services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Neuf services<br />
proposent <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie dans les universités <strong>de</strong> Bogotá,<br />
Me<strong>de</strong>llin, Manizales et Cali; il existe également un programme en <strong>de</strong>rmatologie oncologique<br />
à Bogotá et un programme en chirurgie <strong>de</strong>rmatologique à Me<strong>de</strong>llin. Plusieurs<br />
villes abritent d’ailleurs <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui proposent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Dès leurs débuts au XIX e siècle, les services constituèrent <strong>de</strong> véritables écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
qui accompagnèrent le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité; dans les premières années,<br />
elles suivirent les principes <strong>de</strong>s écoles européennes, notamment française, qui<br />
dogmatisa le mon<strong>de</strong> médical, tandis qu’au début du XX e siècle, elles furent sous l’influence<br />
<strong>de</strong> l’école <strong>américaine</strong>, toujours en vigueur. Depuis <strong>la</strong> moitié du XX e siècle, elles reçurent<br />
aussi l’apport <strong>de</strong>s écoles <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>s, notamment argentine, brésilienne et mexicaine,<br />
car beaucoup <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues voyagèrent dans ces pays pour leur formation.<br />
Cette influence variée, ajoutée à l’empreinte personnelle <strong>de</strong>s illustres mé<strong>de</strong>cins qui dirigèrent<br />
les différentes écoles, conférèrent à chacune d’elles une i<strong>de</strong>ntité propre.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie (Bogotá)<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie débuta en 1886. Gabriel José Castañeda, le premier<br />
professeur, orienta <strong>la</strong> chaire vers l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie tropicale jusqu’en<br />
1898. Julio Escobar dirigea <strong>la</strong> chaire entre 1901 et 1903. Luis Cuervo Márquez y poursuivit<br />
l’enseignement, désormais sous le nom <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
; <strong>de</strong>puis 1908 y participa Luis J. Uricochea, tout comme José Ignacio Uribe à<br />
partir <strong>de</strong> 1910, lorsque <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut cataloguée en tant que spécialité.<br />
Manuel José Silva, l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s références dans le domaine toutes époques<br />
confondues, permit aux étudiants d’accé<strong>de</strong>r au Lazaret <strong>de</strong> Agua <strong>de</strong> Dios pour y prodiguer<br />
<strong>de</strong>s soins (1927) et créa le musée <strong>de</strong> cire <strong>de</strong> Dermatologie. L’illustre Pr. Gonzalo<br />
Reyes García enseigna <strong>de</strong> 1930 jusqu’à sa retraite en 1961 ; pendant ce temps col<strong>la</strong>borèrent<br />
les Prs Miguel Serrano Camargo, Carlos Cortés Enciso, José Ignacio Cha<strong>la</strong> Hidalgo,<br />
Alfredo Laver<strong>de</strong> Laver<strong>de</strong>, Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba et Tomás Henao B<strong>la</strong>nco.<br />
Alfonso Gamboa Amador commença à enseigner en 1936 en tant que professeur <strong>de</strong> syphiligraphie.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 50, ce fut le tour <strong>de</strong> Fabio Londoño González, qui entreprit le programme<br />
<strong>de</strong> spécialisation en 1958 dans le cadre <strong>de</strong>s nouvelles tendances <strong>américaine</strong>s; il<br />
occupa le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> service jusqu’à sa retraite en 1966. Son premier rési<strong>de</strong>nt, diplômé<br />
en 1961, fut Guillermo Gutiérrez Aldana, un col<strong>la</strong>borateur enthousiasmé par <strong>la</strong> rédaction<br />
<strong>de</strong> cet article, qui fut nommé chef en 1965, à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> Miguel Serrano Camargo.<br />
Le Dr Gutiérrez renouve<strong>la</strong> le service aux niveaux géographique, administratif et académique;<br />
il restaura le musée <strong>de</strong> cire et réforma le programme <strong>de</strong> spécialisation en 1973.<br />
En 1978, il étendit son champ d’action à l’Institut national <strong>de</strong> cancérologie, où il créa en<br />
1992 <strong>la</strong> spécialisation en oncologie <strong>de</strong>rmatologique (conçue par Michel Faizal Gragea et<br />
mise en route par Álvaro Enrique Acosta Madiedo <strong>de</strong> Hart). C’est ainsi que naquit l’ère <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chirurgie et <strong>de</strong> l’oncologie cutanées. Le <strong>de</strong>uxième diplômé fut Víctor Manuel Zambrano.<br />
Fernando García Jiménez occupa le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> service entre 1978 et 1984 ; on<br />
se souvient <strong>de</strong> lui pour son approche diagnostique et pathologique. À l’époque, Gerzaín<br />
Rodríguez Toro s’associa au département <strong>de</strong> pathologie, à l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
Víctor Manuel fut chef jusqu’en 1990 ; Manuel Forero débuta son travail en <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique vers <strong>la</strong> même époque. Luis Fernando Palma, pathologiste<br />
<strong>de</strong> l’université nationale et <strong>de</strong>rmatologue formé au Mexique et aux États-Unis, vint<br />
travailler en 1989 ; sa préparation académique sans égale et ses qualités humanistes<br />
firent <strong>de</strong> lui un soutien inestimable dans l’histopathologie ; son exercice est<br />
un exemple <strong>de</strong> savoir académique et <strong>de</strong> vie. Héctor José Castel<strong>la</strong>nos Lorduy débuta<br />
l’enseignement en 1992 ; il occupa le poste <strong>de</strong> chef du service entre 1994<br />
et 1998 et réforma le programme académique. Lui succéda José Rómulo Vil<strong>la</strong>mizar<br />
Betancourt (1999-2002), doté <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s qualités humaines et pédagogiques.<br />
Michel Faizal Geagea (figure 48), ancien élève, qui étudia en outre <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique à l’université <strong>de</strong> Sao Paulo et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale à l’université<br />
<strong>de</strong> Amazonas (Brésil), fut admis comme enseignant en 1991. Il fut chef du<br />
service à partir <strong>de</strong> 2002 et directeur du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne <strong>de</strong>puis<br />
2004 ; dès le début, il s’occupa <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique et <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique, oncologique, réparatrice et esthétique, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs. En<br />
1999, il remit en p<strong>la</strong>ce le service <strong>de</strong> soins au Sanatorio <strong>de</strong> Agua <strong>de</strong> Dios ; en 2000, il fut<br />
cofondateur du Centre <strong>de</strong> télémé<strong>de</strong>cine et créa le service <strong>de</strong> télé<strong>de</strong>rmatologie, centre<br />
pour l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et qui cherche <strong>de</strong>s solutions aux problèmes <strong>de</strong>rmatologiques<br />
dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> l’Amazonie colombienne, brésilienne et péruvienne.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 90, le gouvernement prit <strong>la</strong> décision regrettable <strong>de</strong> fermer l’hôpital<br />
San Juan <strong>de</strong> Dios ; cette crise fut surmontée par les dirigeants, les professeurs et les<br />
rési<strong>de</strong>nts. Luis Fernando Palma suggéra <strong>de</strong> transférer le service dans les hôpitaux La<br />
Victoria et Carlos Lleras ; à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 2002, il développa ses activités à <strong>la</strong> clinique Santa<br />
145<br />
Figure 48.<br />
Michel Faizal
Figure 49.<br />
Fernando Vallejo<br />
Figure 50.<br />
Myriam Mesa<br />
Figure 51.<br />
Heriberto Gómez<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
146<br />
Rosa <strong>de</strong> Lima et à l’hôpital La Samaritana à partir <strong>de</strong> 2003. Le service fut un bastion<br />
dans les domaines académique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, et plusieurs <strong>de</strong> ses diplômés sont<br />
chargés <strong>de</strong> l’enseignement dans différentes institutions.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université d’Antioquia (Me<strong>de</strong>llin)<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie démarra en 1920 avec Gustavo Uribe<br />
Escobar. Celui-ci en fut chargé pendant près <strong>de</strong> vingt ans et fut remp<strong>la</strong>cé par son disciple<br />
José Posada Trujillo (1936-1960) qui contribua beaucoup à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> sporotrichose, en<br />
col<strong>la</strong>boration avec Carlos Enrique Tobón. Les années 50 firent p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>américaine</strong>,<br />
à l’introduction <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong>s sciences basiques et au développement<br />
technologique. Gonzalo Calle Vélez, le promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie, rentra au pays en 1955<br />
<strong>de</strong>puis le Michigan; il apporta <strong>la</strong> première collection <strong>de</strong> champignons et entama <strong>la</strong><br />
recherche dans cette spécialité. L’année 1959 marqua le retour d’Alonso Cortés<br />
Cortés, homme <strong>de</strong> cœur et d’une gran<strong>de</strong> intelligence, un maître éminent, dont les<br />
cours <strong>de</strong> sémiologie captivaient ses disciples; sa soif in<strong>la</strong>ssable <strong>de</strong> connaissances<br />
lui procura un savoir immense. C’est avec eux que débuta en 1959 le programme<br />
<strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie (recevant l’approbation officielle en 1963). Le Pr.<br />
Cortés fut remp<strong>la</strong>cé à <strong>la</strong> chaire par Juan Pedro Velásquez Berruecos, Diego Elías<br />
Jaramillo et Fernando Vallejo Cadavid (figure 49). En 1959, les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
<strong>de</strong> pathologie et <strong>de</strong> mycologie fusionnèrent; le premier <strong>de</strong>rmato-pathologiste<br />
du pays, Mario Robledo Villegas, y joua un rôle important. Cet homme,<br />
humble et d’une sagesse incomparable, favorisa l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mycoses. La recherche<br />
mycologique se vit alors renforcée, fondamentalement dans les années 60, grâce à<br />
<strong>la</strong> mycologue et gran<strong>de</strong> chercheuse Ánge<strong>la</strong> Restrepo Moreno. Ses contributions à<br />
<strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> cette science, notamment <strong>la</strong> paracoccidioïdomycose, sont incalcu<strong>la</strong>bles;<br />
son esprit <strong>de</strong> recherche <strong>la</strong> mena à réaliser, jusqu’à aujourd’hui, les étu<strong>de</strong>s<br />
les plus complexes et les plus spécialisées au niveau national et international. En<br />
1969, Gonzalo Calle, Myriam Sanclemente (née Mesa) et Stel<strong>la</strong> Castañeda (née<br />
Prada), bril<strong>la</strong>nts et acharnés, introduisirent dans le pays <strong>la</strong> technique <strong>de</strong> l’immunofluorescence.<br />
Le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie Gustavo Uribe Escobar, dirigé<br />
par le grand <strong>de</strong>rmato-pathologiste et pédagogue Walter León Hernán<strong>de</strong>z, fut<br />
fondé en 1975.<br />
Soixante-trois <strong>de</strong>rmatologues obtinrent leur diplôme dans cette école, dont les<br />
premiers furent Laureano Guerrero, Enrique Saldarriaga Arango, Mario Henao,<br />
Heriberto Gómez, Víctor Cár<strong>de</strong>nas, Fabio Rivera, Fernando García, Juan Pedro<br />
Velásquez, Jorge Mesa et F<strong>la</strong>vio Gómez Vargas (intègre, strict dans l’enseignement,<br />
plein <strong>de</strong> cordialité, l’un <strong>de</strong>s enseignants les plus remarquables). La première<br />
femme <strong>de</strong>rmatologue du pays, Myriam Sanclemente (née Mesa) (figure 50),<br />
obtint son diplôme en 1971. Plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s diplômés <strong>de</strong> l’école se consacrèrent<br />
à l’enseignement et plusieurs d’entre eux se distinguèrent également dans <strong>la</strong><br />
fonction publique (sénateurs, gouverneurs, maires, recteurs, ambassa<strong>de</strong>urs et ministres).<br />
L’école s’adapta au développement scientifique mo<strong>de</strong>rne, consolidant <strong>la</strong><br />
recherche, toujours en quête <strong>de</strong> l’excellence académique et d’un développement<br />
régional et national.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Caldas (Manizales)<br />
L’école fut fondée en 1965 à l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Caldas par Heriberto<br />
Gómez Sierra (figure 51), <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> l’université d’Antioquia qui se rendit<br />
dans le Michigan pour étudier l’immunofluorescence. Jairo Mesa Cock fut le premier<br />
diplômé <strong>de</strong> l’école en 1968; il fut un éminent enseignant pendant plusieurs décennies,<br />
chef <strong>de</strong> service et doyen, précieux col<strong>la</strong>borateur dans <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong><br />
ce texte. Bernardo Giraldo Neira — <strong>de</strong>rmatologue et allergologue ayant étudié à
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Cleve<strong>la</strong>nd et dans le Minnesota — rejoignit le groupe en 1967. Les chefs <strong>de</strong> service furent<br />
Heriberto Gómez (1965-1980 et 1986-1994), Jairo Mesa (1980-1985) et Felipe Jaramillo<br />
Eyerbe (<strong>de</strong>puis 1994), diplômé <strong>de</strong> l’université nationale et <strong>de</strong>rmato-pathologiste disciple <strong>de</strong><br />
Bernard Ackerman; en qualité <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>puis 1988, il s’associa <strong>de</strong>s enseignants<br />
comme Lucía Van <strong>de</strong>n En<strong>de</strong>n, Ana María Hoyos, Martha Cecilia Bernal et Germán<br />
Santacoloma, <strong>de</strong> bril<strong>la</strong>nts anciens élèves, ainsi que John Harvey Gaviria et Josefina Danies.<br />
Le service, dirigé par les Drs Gómez Sierra et Mesa Cock, impulsa en 1965 <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Fédération bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. L’école se caractérise par son niveau scientifique,<br />
humaniste et culturel; vingt-<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues y obtinrent leur diplôme.<br />
Centre <strong>de</strong>rmatologique Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta – université Javeriana <strong>de</strong> Bogotá<br />
Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta fonda son <strong>la</strong>boratoire institut <strong>de</strong> recherche sur <strong>la</strong> lèpre à Bogotá<br />
dans les années 20; à partir <strong>de</strong> 1934, il reçut le nom <strong>de</strong> Laboratoire central pour les recherches<br />
sur <strong>la</strong> lèpre. Un décret national changea son nom pour celui d’institut Fe<strong>de</strong>rico<br />
Lleras Acosta, après sa mort en 1938. Cette institution, pionnière en Colombie dans <strong>la</strong> recherche<br />
biomédicale, développa <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> léprologie. En 1956, elle <strong>de</strong>vint l’Institut <strong>de</strong> recherches<br />
et d’étu<strong>de</strong>s spéciales en <strong>de</strong>rmatologie et sur <strong>la</strong> lèpre. Le bril<strong>la</strong>nt disciple Luis<br />
Patiño Camargo prit en charge <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’institut en 1938, succédant à son fondateur.<br />
Dès les années 50, <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> Fuad Muvdi Chaín fut précieuse. En 1957, lorsque<br />
Jorge Arenas Ramírez était directeur <strong>de</strong> l’institution, Fabio Londoño se présenta spontanément<br />
pour s’occuper <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>rmatologique. L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
y débuta en 1967. Elle s’adressait tout d’abord aux étudiants <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université Javeriana et ensuite aux étudiants du collège Mayor <strong>de</strong> Rosario. Le<br />
1 er août 1968 fut créée <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, par une convention conclue avec<br />
l’université Javeriana. Le passage <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> recherche au centre d’assistance revint<br />
à son fondateur, Fabio Londoño González (figure 52). Le Dr Londoño en fut le chef<br />
jusqu’en 1989, remp<strong>la</strong>cé pendant huit mois (entre 1984 et 1985) par María Mélida<br />
Durán Merchán. Au cours <strong>de</strong> ces années, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration pédagogique <strong>de</strong>s Drs Mundi,<br />
Luis Alfredo Rueda, Rafael Uribe, Jorge Humberto Reyes et plus tard Alfonso Quintero<br />
fut fondamentale. L’illustre Pr. Mariano López occupa le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> service<br />
entre 1989 et 1993, suivi <strong>de</strong> Luisa Quintana (née Porras).<br />
Le centre <strong>de</strong>rmatologique Fe<strong>de</strong>rico Lleras Acosta (comme on l’appelle aujourd’hui)<br />
fut un espace d’enseignement pour les étudiants <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> différentes universités. Il forma 108 <strong>de</strong>rmatologues ; son premier<br />
diplômé fut Mariano López López en 1970. Plusieurs <strong>de</strong> ses diplômés furent enseignants,<br />
fondateurs et chefs d’écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Dès ses débuts, l’école se préoccupa<br />
<strong>de</strong> favoriser chez les étudiants <strong>de</strong>s habiletés cliniques, thérapeutiques et<br />
pour <strong>la</strong> recherche ; à partir <strong>de</strong> 1993, l’accent fut mis sur <strong>la</strong> formation humaine intégrale,<br />
avec <strong>la</strong> conscience d’une responsabilité sociale, pour développer <strong>de</strong>s compétences<br />
pédagogiques, communicatives, administratives et en « lea<strong>de</strong>rship ».<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong>l Valle (Santiago <strong>de</strong> Cali)<br />
Hernán Tobón et Jaime Betancourt ouvrirent en 1956 <strong>la</strong> chaire et l’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures à l’université <strong>de</strong>l Valle. En 1970, Rafael<br />
Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> (figure 53) invita Jaime Betancourt Osorio et Nelson Giraldo Restrepo à<br />
fon<strong>de</strong>r le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital universitaire <strong>de</strong>l Valle Evaristo García,<br />
dans lequel <strong>la</strong> spécialisation fut entreprise en 1971. Hipólito González, originaire du<br />
Panama, fut le premier diplômé en 1973 ; plus tard s’y ajouteraient comme enseignants<br />
Antonio Torres et Carlos Escobar, le génie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie, troisième<br />
diplômé (1975). On dit qu’il était « simplement un homme hors du commun<br />
pour sa simplicité, sa bonté, son érudition et sa sagesse 21 . » Sans son apport, l’école<br />
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.<br />
147<br />
Figure 52.<br />
Fabio Londoño<br />
Figure 53.<br />
Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>
Figure 54.<br />
Luis H. Moreno<br />
Figure 55.<br />
J. Guillermo<br />
Chale<strong>la</strong><br />
Figure 56.<br />
Ánge<strong>la</strong> Zuluaga<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
148<br />
Nelson Giraldo, Antonio Torres et Ricardo Rueda furent les piliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie. Carlos Escobar ouvrit l’ère <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique, poursuivie dans les années 90 et enrichie par <strong>la</strong> technique <strong>de</strong><br />
Mohs grâce à C<strong>la</strong>udia Covelli et Carmen De La Hoz, et Pablo Tróchez en chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmocosmétique. En 1990, Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> créa le Fonds <strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong>rmatologique (PRODERMA), qui représente un soutien important<br />
pour le développement académique, <strong>la</strong> recherche et l’assistance aux patients ;<br />
Jairo Victoria s’y associa plus tard. L’école compte vingt-<strong>de</strong>ux professeurs, dont <strong>la</strong><br />
plupart travaillent ad honorem, comme Luis Hernando Moreno Macias (figure 54)<br />
— qui est en plus magister en microbiologie et se distingue en tant que pilier <strong>de</strong><br />
l’enseignement <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux décennies ; Martha Campo et María Isabel Barona<br />
qui soutiennent <strong>la</strong> recherche ; Adriana Arrunátegui, admirable enseignante ;<br />
Lucy García, chercheur et magister en microbiologie ; Luis Fernando Balcázar, Myriam<br />
Vargas, César Iván Vare<strong>la</strong> et Doralda Castro, entre autres. Le service approfondit <strong>la</strong> recherche<br />
sur les ma<strong>la</strong>dies du pigment, surtout le vitiligo, développant <strong>de</strong>s techniques chirurgicales<br />
pour son traitement. Il compte quarante-six diplômés, et son programme <strong>de</strong><br />
spécialisation fut é<strong>la</strong>rgi à quatre ans dès 2004. Depuis sa création, Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> en<br />
fut le chef, dont le service porte le nom à perpétuité <strong>de</strong>puis 2000.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital militaire central <strong>de</strong> l’université<br />
militaire Nueva Granada (Bogotá)<br />
Le service commença en 1969, rattaché au département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, avec<br />
les Prs Alberto Medina et Luis Alfredo Rueda. Julio César Me<strong>de</strong>llín et María Teresa Pa<strong>la</strong>cios<br />
s’y ajoutèrent vers 1975, ainsi que le pathologiste Gerzaín Rodríguez en 1980.<br />
Juan Guillermo Chale<strong>la</strong> Mantil<strong>la</strong> (figure 55), un maître bril<strong>la</strong>nt et distingué, fonda le<br />
service en 1983, dont il fut le chef jusqu’en 1991 ; un autre génie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
nationale lui succéda : Jaime Soto Mancipe (<strong>de</strong> 1992 à 1994), puis María C<strong>la</strong>udia<br />
Torres (entre 1995 et 2003) et Olga Patricia Escobar Gil. Le service organisa <strong>de</strong>s événements<br />
académiques sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et les ma<strong>la</strong>dies tropicales, tout comme<br />
d’importantes journées <strong>de</strong> prévention du cancer. Il fut pionnier dans <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> thérapie PUVA et le traitement <strong>de</strong>s mycoses fongoï<strong>de</strong>s. Trente-neuf spécialistes y<br />
obtinrent leur diplôme, dont <strong>la</strong> première fut Nancy Castro en 1984.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (CES) (Me<strong>de</strong>llin)<br />
La faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du CES fut fondée en 1978 ; José Ignacio Gómez, Jorge<br />
Mesa et plus tard Diego Elías Jaramillo furent les premiers professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire<br />
d’étu<strong>de</strong>s supérieures en <strong>de</strong>rmatologie, dont ils organisèrent le programme et le premier<br />
fonds d’archives photographiques. Ánge<strong>la</strong> Ca<strong>de</strong>na (née Zuluaga) (figure 56) fut<br />
le premier professeur nommé en 1984, suivie d’Amparo Ochoa. Le programme <strong>de</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, approuvé en 1988, fut rédigé par Ange<strong>la</strong> Zuluaga —<br />
désormais chef et professeur titu<strong>la</strong>ire — , Amparo Ochoa et Myriam Mesa. Laureano<br />
Osorio, Olga Lucía Castaño, C<strong>la</strong>udia Uribe, Sol Beatriz Jiménez, Guillermo Jiménez<br />
et Isabel Cristina Vásquez font également partie <strong>de</strong> l’équipe pédagogique. Ses rési<strong>de</strong>nts<br />
effectuèrent <strong>de</strong>s roulements en Espagne, au Guatema<strong>la</strong>, aux États-Unis, au Canada,<br />
au Mexique, en Argentine et en France. Depuis le premier diplôme délivré (à<br />
Luz Stel<strong>la</strong> Abisaad, en 1991), vingt-quatre <strong>de</strong>rmatologues y obtinrent leur diplôme.<br />
En 1994, le service fut pionnier grâce à <strong>la</strong> création du programme <strong>de</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique, dont le premier diplômé fut Guillermo Jiménez Calfat (1995). Ce<br />
service organisa <strong>de</strong>s événements académiques et scientifiques, possè<strong>de</strong> un espace<br />
d’archives photographiques d’excellence et mena plusieurs recherches reconnues<br />
dans le pays et à l’étranger.
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université El Bosque<br />
(Bogotá)<br />
Le célèbre Pr. Mariano López López (figure 57), qui<br />
fut le directeur du centre <strong>de</strong>rmatologique Fe<strong>de</strong>rico Lleras,<br />
entreprit en 1989 le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’école colombienne <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (<strong>de</strong> nos jours université<br />
El Bosque), qui fut approuvé en 1992. Entre 1994<br />
et 2003, ce service fut à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Juan Guillermo<br />
Chale<strong>la</strong> Mantil<strong>la</strong>, remp<strong>la</strong>cé par Adriana Motta Beltrán.<br />
Vingt et un <strong>de</strong>rmatologues, dont les premiers furent<br />
Eduardo Salcedo et Mónica Rivera, y obtinrent leur diplôme<br />
en 1997.<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université Pontificia<br />
Bolivariana <strong>de</strong> Me<strong>de</strong>llin<br />
En 1995, Guillermo Jiménez Calfat (<strong>de</strong>rmatologue-oncologue), Rodrigo Restrepo Molina<br />
(pathologiste) et Luz Marina Gómez Vargas (figure 58) (<strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> l’université<br />
Javeriana <strong>de</strong> Bogotá) é<strong>la</strong>borèrent le projet <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, approuvé en<br />
1996. Dix <strong>de</strong>rmatologues furent diplômés, dont <strong>la</strong> première fut Pau<strong>la</strong> Alexandra Mejía<br />
(1999). Ses rési<strong>de</strong>nts effectuèrent <strong>de</strong>s roulements à Barcelone, à Londres et à Buenos<br />
Aires. Le service participa à l’organisation d’événements scientifiques et <strong>de</strong> formation<br />
continue. Ce groupe <strong>de</strong> jeunes figures fut dirigé dès le départ par Luz Marina Gómez Vargas,<br />
qui lui imprima le dynamisme et <strong>la</strong> croissance propres à <strong>la</strong> région.<br />
École <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique, Institut national <strong>de</strong> cancérologie <strong>de</strong> Bogotá<br />
Appelé à l’origine (1934) Institut national <strong>de</strong> radium, il <strong>de</strong>vint l’Institut national<br />
<strong>de</strong> cancérologie en 1953. Il fut dirigé par le <strong>de</strong>rmatologue-oncologue Guillermo Gutiérrez<br />
Aldana dès 1979, qui créa en 1992 <strong>la</strong> sous-spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie oncologique,<br />
dont <strong>la</strong> conception fut à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Michel Faizal Geagea. Álvaro Enrique<br />
Acosta Madiedo <strong>de</strong> Hart (figure 59) prit en charge le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> l’école <strong>la</strong> même<br />
année. La première diplômée fut María Bernarda Durango (1993), suivie <strong>de</strong><br />
Guillermo Jiménez, Elkin Peñaranda, Gustavo Pérez et Ana Francisca Ramírez. Les<br />
rési<strong>de</strong>nts d’autres écoles effectuent leur roulement à l’institut lors <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>rnière<br />
année d’étu<strong>de</strong>s. L’université Javeriana <strong>de</strong> Bogotá commença en 1995 à octroyer le<br />
titre <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie oncologique aux diplômés <strong>de</strong> l’école, qui abrite<br />
avec succès <strong>de</strong>s séminaires et <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-spécialité.<br />
Dermatologie, art et culture<br />
Dermatologie, littérature et art<br />
César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z<br />
Des écrivains colombiens importants firent référence dans leurs ouvrages aux ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, comme Gabriel García Márquez : « Tandis qu’il tenait le rythme avec ses<br />
grands pieds <strong>de</strong> marcheur gercés par le salpêtre » (Cent ans <strong>de</strong> solitu<strong>de</strong>) 46 . D’autres auteurs<br />
s’inspirèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau :<br />
Je cherche une peau <strong>de</strong> femme :<br />
B<strong>la</strong>nche ou brune (peu importe <strong>la</strong> couleur).<br />
Tiè<strong>de</strong>, bien que je <strong>la</strong> préfère brû<strong>la</strong>nte.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
■ Dermatologie, art et culture<br />
149<br />
Figure 57.<br />
Mariano López<br />
Figure 58. Luz<br />
Marina Gómez<br />
Figura 59.<br />
Álvaro Acosta
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
150<br />
Qui permette toutes les caresses<br />
Et qu’en <strong>la</strong> parcourant ne l’assaille <strong>la</strong> pu<strong>de</strong>ur…<br />
(José Asunción Silva, « C<strong>la</strong>sificado »)<br />
La mé<strong>de</strong>cine, et notamment <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, a partie liée, dans son essence même,<br />
avec l’art; c’est pourquoi plusieurs <strong>de</strong>rmatologues le cultivent dans ses différents domaines.<br />
Distinguons parmi eux Mary Ann Robledo, Ánge<strong>la</strong> Londoño, Melba Labrada et<br />
Sergio Martínez dans <strong>la</strong> peinture; Milton Mejía dans le <strong>de</strong>ssin ; Norma González dans le<br />
travail du bois ; Jaime Betancourt dans le vitrail ; Lucía Van <strong>de</strong>n En<strong>de</strong>n et C<strong>la</strong>udia Lozada<br />
dans l’artisanat ; Jaime Betancourt et Hugo Espinal dans <strong>la</strong> sculpture; Jaime Betancourt,<br />
Luis Hernando Moreno, Adriana Arrunátegui, José Librado Vásquez, Martha Valbuena,<br />
Luis Arturo Gamboa, César Iván Vare<strong>la</strong> et B<strong>la</strong>nca Lilia Lesmes dans <strong>la</strong> poésie ; César Iván<br />
Vare<strong>la</strong> dans <strong>la</strong> composition musicale ; Juan Pedro Velásquez, Fernando Botero, Carlos<br />
Escobar, Jaime Gil, Carmen Alicia Martínez, Juan Jaime Atuesta, Xavier Rueda et Mabel<br />
Ávi<strong>la</strong> dans <strong>la</strong> photographie (figures 60, 61, 62, 63).<br />
Je regardai aujourd’hui une fleur, et sur ses pétales ton visage <strong>de</strong>ssiné<br />
Je sentis aujourd’hui une fleur, et dans son parfum ton souffle reflété<br />
Je touchai aujourd’hui une fleur, et dans sa douceur je sentis ta peau<br />
Je bus aujourd’hui une fleur, et dans son nectar l’arôme <strong>de</strong> tes lèvres<br />
J’observai aujourd’hui une fleur, et dans son éc<strong>la</strong>t le reflet <strong>de</strong> ton regard tendre<br />
[et pur<br />
J’entendis aujourd’hui le va-et-vient d’une fleur, et j’y perçus ta douce voix…<br />
(César Iván Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z, « Pensamientos »)<br />
Aujourd’hui je perdis une <strong>la</strong>rme,<br />
Elle s’échappa sans que je m’en aperçoive<br />
Lorsque je pensais à toi.<br />
C’était une <strong>la</strong>rme furtive<br />
Qui rou<strong>la</strong> agile<br />
Sur ma joue et mit<br />
En évi<strong>de</strong>nce ma nostalgie…<br />
(Carlos Aníbal Niño Calero, « À Tania »)<br />
… Et moi aussi je vous dis<br />
les yeux en <strong>la</strong>rmes,<br />
et l’âme endolorie,<br />
qu’il ne se passe rien<br />
qu’il faut suivre son cours<br />
à chercher <strong>de</strong>s petits oiseaux<br />
qui chantent parmi les branches…<br />
(Jaime Betancourt Osorio, « Ilusiones »)<br />
… Violons du crépuscule dans ton parler enivrant<br />
étoiles scintil<strong>la</strong>ntes bleutées comme <strong>la</strong> mer<br />
<strong>la</strong> nacre <strong>de</strong> ta peau sculptée dans les nuages<br />
inspirent sans égal mon être, ma lumière, mon amour.<br />
Le gazouillement <strong>de</strong> tes lèvres est le prélu<strong>de</strong> du <strong>la</strong>urier<br />
emportant notre voyage au va-et-vient <strong>de</strong> li<strong>la</strong>s<br />
mon idylle est paternelle, offran<strong>de</strong> au grand créateur.<br />
(César Iván Vare<strong>la</strong> H., « Cami<strong>la</strong> »)
… Lorsque ta préoccupation est accab<strong>la</strong>nte<br />
pense aux bonnes choses,<br />
aux beaux moments<br />
et aux personnes que tu aimes.<br />
Cherche au fond <strong>de</strong> ton cœur<br />
et tu trouveras le chemin <strong>de</strong>s étoiles.<br />
Songe, aie <strong>de</strong> l’espoir et sois patient,<br />
ce sont les trois lunes qui t’éc<strong>la</strong>ireront<br />
<strong>la</strong> nuit <strong>de</strong>s impossibles...<br />
(Martha Cecilia Valbuena Mesa, « Cuando »)<br />
Chaque peuple eut bien évi<strong>de</strong>mment comme<br />
idéal <strong>de</strong> beauté un type différent <strong>de</strong> peau ; <strong>la</strong><br />
couleur <strong>la</strong>iteuse, éburnéenne, argentée lunaire<br />
chez les Européens ; le doré pour les Indo-Américains<br />
; le noir comme « <strong>la</strong> nuit diamantine », ou d’ébène pour les Africains…<br />
(Jaime Gil Jaramillo, La piel, essai)<br />
La stupéfaction <strong>de</strong> te regar<strong>de</strong>r même si je ne peux pas te voir. Face à toi <strong>la</strong> petitesse<br />
<strong>de</strong> ma propre matière me surprend. Je voudrais bien te connaître, découvrir tous tes<br />
secrets. Mais je crois qu’à cet instant mon rêve enchanté éc<strong>la</strong>terait en mille morceaux<br />
et perdrait toute sa magie… (Luis Arturo Gamboa Suárez, Al universo)<br />
Telle une étoile qui resplendit en haut du zénith,<br />
tu vins avec ton éc<strong>la</strong>t éc<strong>la</strong>irer mes sentiments,<br />
tes grands yeux telle <strong>la</strong> savane au printemps,<br />
ta bouche peinte, ta peau telle <strong>la</strong> cannelle,<br />
ta grâce est un charme, ton parler est un poème.<br />
(César Iván Vare<strong>la</strong> H., « Natalia »)<br />
La mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire. Les guérisseurs. La magie<br />
COLLABORATEUR: Juan Pedro Velásquez Berruecos (figure 64)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Notre histoire médicale est basée sur le développement culturel <strong>de</strong>s sociétés aborigènes,<br />
dans lesquelles les mythes et les croyances se transmettaient <strong>de</strong> génération en<br />
151<br />
Figure 60.<br />
« Hommage à<br />
mon père »<br />
(huile), Mary Ann<br />
Robledo<br />
Figure 61. Détail<br />
<strong>de</strong> miroir (Mario<br />
Robledo Villegas)<br />
en figure 60<br />
Figure 62.<br />
« Fenêtre sur<br />
l’Afrique »<br />
(huile), Sergio<br />
Martínez<br />
Figure 63.<br />
Vitrail. Jaime<br />
Betancourt
Figure 64.<br />
J. Pedro Velásquez<br />
Berruecos<br />
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
152<br />
génération à travers l’information ancestrale. Les cultures primitives considéraient<br />
que <strong>la</strong> religion, <strong>la</strong> magie et le traitement médical <strong>de</strong>vaient être complètement inséparables.<br />
Le patient et le guérisseur primitifs cherchaient <strong>de</strong>s origines surnaturelles à<br />
un grand nombre <strong>de</strong> succès, même les ma<strong>la</strong>dies, et ils étaient psychologiquement<br />
prêts à accepter l’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> magie 47 .<br />
Les chamans <strong>de</strong>vaient être <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins-prêtres privilégiés et respectés, qui suivaient<br />
<strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> conduite <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine chibcha. Le mot tegua apparut au moment<br />
<strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols, bien qu’il s’agisse d’un mot indigène muisca. La communauté<br />
<strong>de</strong>s Teguas était installée (et l’est toujours) sur les terres du cacique <strong>de</strong> Quemuenchatocha,<br />
dans <strong>la</strong> commune boyacense <strong>de</strong> Campohermoso ; les Indiens y<br />
entretenaient un centre <strong>de</strong>stiné à l’éducation <strong>de</strong>s futurs zaques, caciques, prêtres et<br />
chamans <strong>de</strong>puis leur adolescence. Les élus se servaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> flore variée <strong>de</strong> <strong>la</strong> région<br />
pour leurs pratiques, et ils étudiaient les propriétés thérapeutiques <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Lorsque les Espagnols apprirent ces pratiques, ils appelèrent teguas les guérisseurs,<br />
les yuyeros, les sorciers et les natifs capables <strong>de</strong> guérir les ma<strong>la</strong>dies 2 .<br />
On par<strong>la</strong> indistinctement <strong>de</strong> guérisseurs, chamans, teguas et « hommes-mé<strong>de</strong>cine »<br />
chez les peuples primitifs, malgré leurs particu<strong>la</strong>rités différentes. Les chamans possédaient<br />
<strong>de</strong>s connaissances millénaires, et utilisaient diverses p<strong>la</strong>ntes psychotropes (dont<br />
quelques stimu<strong>la</strong>nts comme <strong>la</strong> coca ou le tabac, d’autres hallucinogènes comme le yagué,<br />
Banisteropsis caapi, ou le yopo, Viro<strong>la</strong> sp.). Ces p<strong>la</strong>ntes servaient à produire ou à accélérer<br />
<strong>de</strong>s états modifiés <strong>de</strong> <strong>la</strong> conscience à travers lesquels ils pouvaient guérir et établir le<br />
contact avec le mon<strong>de</strong> surnaturel. Certains groupes <strong>de</strong> colons métis admiraient dans leur<br />
tradition religieuse l’emploi <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes pscyhotropes et le chamanisme indigène comme<br />
solution alternative pour guérir. « Les chamans, interprètes <strong>de</strong>s faits naturels, ont une<br />
fonction politique, sociale et religieuse primordiale dans leurs contextes culturels, en<br />
même temps qu’ils protègent leur groupe face aux agressions <strong>de</strong>s êtres et <strong>de</strong>s forces et<br />
même <strong>de</strong>s attaques rituelles et chamanistiques provenant d’autres groupes 3 .» La<br />
connaissance, <strong>la</strong> maîtrise et l’emploi <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et d’autres éléments d’origine animale et<br />
minérale constituent une partie fondamentale du pouvoir du chaman, et bien évi<strong>de</strong>mment<br />
<strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong> ses pratiques pour déterminer les causes <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies.<br />
Aux temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> Découverte et au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonisation, l’apparition <strong>de</strong> guérisseurs,<br />
qui agissaient comme <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, et <strong>de</strong> barbiers, en guise <strong>de</strong> chirurgiens, s’expliqua<br />
en raison du besoin urgent <strong>de</strong> soins médicaux que ressentaient les popu<strong>la</strong>tions en<br />
l’absence <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins officiels. Le premier guérisseur dont on connaît l’existence fut<br />
Diego <strong>de</strong> Montes en 1535 9 . Les guérisseurs furent durement critiqués à cause <strong>de</strong> leur<br />
manque <strong>de</strong> connaissances ; cependant ils jouèrent un rôle convenable et/ou nécessaire<br />
dans l’histoire, dans <strong>de</strong>s circonstances données.<br />
Je transcris le paragraphe suivant du livre La Dermatologie en France — que lors du<br />
<strong>de</strong>rnier Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, nous reçûmes en ca<strong>de</strong>au à Paris (2002) — ,<br />
car il interprète <strong>de</strong> façon adéquate mon opinion sur le sujet traité : « En peu d’années, <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie a connu une évolution assez extraordinaire pour reléguer dans l’ombre <strong>de</strong>s<br />
siècles <strong>de</strong> croyances au cours <strong>de</strong>squelles <strong>la</strong> pratique médicale ne s’éloignait guère <strong>de</strong>s<br />
pratiques empiriques d’une mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire qui ne pouvait se référer qu’à <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s<br />
naturels ou à <strong>de</strong>s conceptions non étayées. Le développement d’une démarche<br />
scientifique et clinique rigoureuse et <strong>la</strong> généralisation d’essais thérapeutiques randomisés<br />
ont bouleversé <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong> soins au bénéfice <strong>de</strong> l’efficacité. Mais l’histoire <strong>de</strong><br />
notre pays nous enseigne que l’esprit n’accepte pas toujours <strong>de</strong> s’enfermer dans <strong>la</strong> raison<br />
: chacun s’est toujours réservé le droit <strong>de</strong> croire à l’irrationnel. Devant ce que nous<br />
appelons aujourd’hui l’‘‘effet p<strong>la</strong>cebo’’ et qui pouvait s’appeler autrefois ‘‘mystère’’, chacun<br />
restera libre <strong>de</strong> se référer à ses croyances, sa spiritualité, son imaginaire ou ses<br />
convictions 48 .»
Les mou<strong>la</strong>ges en cire: musée <strong>de</strong> cire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> Colombie<br />
COLLABORATEUR: Michel Faizal Geagea<br />
Manuel José Silva créa le musée <strong>de</strong> cire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’université nationale<br />
<strong>de</strong> Bogotá dans les années 30, dans le but <strong>de</strong> fournir à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du<br />
matériel pour les étu<strong>de</strong>s. Lui et d’autres professeurs <strong>de</strong> l’époque commandèrent<br />
l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s pièces aux sculpteurs Lisandro Morero Parra et au maître G. Restrepo,<br />
qui s’étaient préa<strong>la</strong>blement formés en France, qui possédait déjà <strong>de</strong>s musées<br />
magnifiques. Les maîtres é<strong>la</strong>borèrent plus <strong>de</strong> 300 sculptures <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
tropicales, infectieuses et vénériennes, à une échelle 1:1, maintenant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
travail secrète et parvenant à un réalisme surprenant (figure 65).<br />
Je transcris ensuite une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication <strong>de</strong> Guillermo Gutiérrez Aldana<br />
à Michel Faizal Geagea, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et du département<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, illustrant <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong> l’ouvrage: « Le Pr. Guillermo Pardo Vil<strong>la</strong>lba,<br />
présent à plusieurs reprises lors <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s pièces, me disait que<br />
l’artiste pratiquait un nettoyage strict à l’ai<strong>de</strong> d’antiseptiques <strong>de</strong> l’époque. Ultérieurement,<br />
il appliquait un mastic en gypse qu’il préparait lui-même secrètement,<br />
le <strong>la</strong>issait sécher et l’enlevait soigneusement. Il versait <strong>de</strong>ssus <strong>la</strong> paraffine, dont <strong>la</strong> couleur<br />
ressemb<strong>la</strong>it à <strong>la</strong> couleur du patient. Dès qu’il avait obtenu le masque, il le colorait en<br />
présence du patient avec <strong>de</strong>s teintures choisies selon les caractéristiques cliniques <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lésion sélectionnée, lui donnant un réalisme véritablement surprenant. Les figures ainsi<br />
obtenues étaient p<strong>la</strong>cées sur <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>nchettes, portaient une légen<strong>de</strong>, étaient c<strong>la</strong>ssifiées et<br />
rangées ensuite dans <strong>de</strong>s vitrines pour leur exhibition et l’enseignement 15 .»<br />
P<strong>la</strong>cées dans les pavillons <strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios, ces sculptures furent très<br />
utiles pour les cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pendant plusieurs années, pour le plus grand bonheur<br />
<strong>de</strong>s professeurs et <strong>de</strong>s étudiants. Cependant, le mo<strong>de</strong>rnisme, <strong>la</strong> création <strong>de</strong>s albums<br />
photographiques et plus tard les diapositives firent tomber en désuétu<strong>de</strong> les pièces du<br />
musée <strong>de</strong> cire. En 1960, le Pr. Gutiérrez Aldana se l’appropria et le transféra au pavillon<br />
San Pedro <strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios ; lors <strong>de</strong> sa retraite en 1979, le musée fut encore<br />
abandonné. Après <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’hôpital en 1995, le musée fut transféré à son emp<strong>la</strong>cement<br />
actuel : le musée <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’université nationale, aux bons soins <strong>de</strong> son directeur Emilio Quevedo et <strong>de</strong> l’étudiant en<br />
mé<strong>de</strong>cine A<strong>la</strong>ín Alexan<strong>de</strong>r Camacho. Le Dr Faizal s’occupe actuellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> restauration<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> récupération <strong>de</strong> ce bijou historique si précieux.<br />
Nous espérons que ce compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie, <strong>de</strong>puis<br />
<strong>la</strong> sagesse millénaire <strong>de</strong>s indigènes jusqu’à celle <strong>de</strong>s contemporains, vous aura diverti<br />
et apporté <strong>de</strong>s connaissances sur notre spécialité en Amérique Latine. ■<br />
Remerciements<br />
À nos collègues <strong>de</strong>rmatologues<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Septembre 2005<br />
Alfonso Rebolledo Muñoz, Álvaro Arévalo Durán, Álvaro Correa Sánchez, Álvaro Enrique<br />
Acosta Madiedo <strong>de</strong> Hart, Ánge<strong>la</strong> Ca<strong>de</strong>na (née Zuluaga), Armando Vásquez Lobo,<br />
153<br />
Figure 65.<br />
Pièce en cire :<br />
syphilis papulocroûteuse
CÉSAR IVÁN VARELA HERNÁNDEZ<br />
154<br />
B<strong>la</strong>nca Lilia E. Lesmes Rodríguez, Catalina Zárate Ortiz, Doris Stel<strong>la</strong> León Romero,<br />
Edgar Ricardo Altuzarra Galindo, Felipe Jaramillo Eyerbe, Fernando García Jiménez,<br />
Fernando Vallejo Cadavid, Germán Santacoloma Osorio, Germán Ve<strong>la</strong>sco Cár<strong>de</strong>nas, Gonzalo<br />
Marrugo Guardo, Héctor José Castel<strong>la</strong>nos Lorduy, Jaime Acevedo Ballesteros, Jaime<br />
Betancourt Osorio, Jaime Soto Mancipe, José Ignacio Gómez Uribe, José Rómulo Vil<strong>la</strong>mizar,<br />
Luis Arturo Gamboa Suárez, Luis Felipe Moreno, Luis Hernando Moreno Macias,<br />
Luis Miguel Covo Segrera, Luisa Porras <strong>de</strong> Quintana, Luz Marina Gómez Vargas, Luz<br />
Stel<strong>la</strong> Bayona (née Montoya), Martha Cecilia Valbuena Mesa, Mary Ann Robledo Prada,<br />
Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>, Ricardo F<strong>la</strong>minio Rojas López, Sergio Martínez Lecompte,<br />
Stel<strong>la</strong> Castañeda (née Prada), Víctor Otero Marrugo et Ximena Sánchez Angarita.<br />
À nos col<strong>la</strong>borateurs<br />
Dr Evelyne Halpert Ziskiend, prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
Dr Zoilo Cuel<strong>la</strong>r Montoya, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> colombie.<br />
Dr Hugo Armando Sotomayor Tribín, secrétaire <strong>de</strong> l’Association d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
colombienne.<br />
Dr Emilio Quevedo, directeur du Centre historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, université nationale<br />
<strong>de</strong> Colombie ; étudiant A<strong>la</strong>ín Alexan<strong>de</strong>r Camacho, moniteur.<br />
Dr Jaime Gómez-González, prési<strong>de</strong>nt du Cercle biographique médico-hispanique.<br />
Mlle Diana María Martínez Renza, communicant social et journaliste, assistante personnelle.<br />
Mlle Dilia Franz Valencia, correctrice grammaticale.<br />
Dr C<strong>la</strong>udia Juliana Díaz Gómez, rési<strong>de</strong>nt du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, université <strong>de</strong>l Valle.<br />
Mme Nelly Pinzón, secrétaire <strong>de</strong> l’Association colombienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique.<br />
Dr José Miguel Gaona R, mé<strong>de</strong>cin et historien.<br />
M. Fernando Joel Moreno, photographe.<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Ocampo L.J. Historia básica <strong>de</strong><br />
Colombia, 3ª ed. Bogotá:<br />
Bibliográfica Internacional;<br />
2000.<br />
2. Martínez Z.A. Fosas y Bronces.<br />
La Medicina en <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong><br />
Tunja. Su evolución histórica.<br />
Aca<strong>de</strong>mia Boyacense <strong>de</strong><br />
Historia. Bogotá: Kelly; 1989.<br />
3. Sotomayor Tribín H. A., Restrepo<br />
Z.E., Gómez L.J., Pérez G.M. El<br />
medicamento en <strong>la</strong> historia <strong>de</strong><br />
Colombia. Bogotá: Schering<br />
Plough - Nomos; 1997.<br />
4. Vasco L.G. Jaibanás los<br />
verda<strong>de</strong>ros hombres. Bogotá:<br />
Biblioteca Banco Popu<strong>la</strong>r;<br />
1985:77-101.<br />
5. Zubiría R. <strong>de</strong>. La medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cultura muisca. Bogotá:<br />
Universidad Nacional <strong>de</strong><br />
Colombia; 1986.<br />
6. Sotomayor Tribín H.A.<br />
Arqueomedicina <strong>de</strong> Colombia<br />
prehispánica. 2ª ed. Bogotá:<br />
Universidad Militar Nueva<br />
Granada. Edifarni;1999.<br />
7. Sotomayor Tribín H.A. « A<br />
propósito <strong>de</strong> <strong>la</strong> bartonellosis<br />
en una máscara ecuatoriana<br />
precolombina. » Medicina.<br />
Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong><br />
Medicina. Abr. 1994;36:28-9.<br />
8. Soriano Lleras A. La Medicina en<br />
el Nuevo Reino <strong>de</strong> Granada,<br />
durante <strong>la</strong> Conquista y <strong>la</strong><br />
Colonia. Bogotá: Imprenta<br />
Nacional; 1966.<br />
9. Gutiérrez V. Trasfondo histórico.<br />
Triple legado en <strong>la</strong> Medicina<br />
tradicional colombiana.<br />
Bogotá; 1983.<br />
10. Rodríguez Cuenca J.V. La<br />
antropología forense en <strong>la</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación humana.<br />
Universidad Nacional <strong>de</strong><br />
Colombia. Bogotá: Guadalupe;<br />
2004.<br />
11. Zuluaga G. El aprendizaje <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s p<strong>la</strong>ntas: en <strong>la</strong> senda <strong>de</strong> un<br />
conocimiento olvidado.<br />
Bogotá: Seguros Bolívar;<br />
1994:79.<br />
12. Oviedo B.V. <strong>de</strong>. Cualida<strong>de</strong>s y<br />
riquezas <strong>de</strong>l Nuevo Reino <strong>de</strong><br />
Granada. Bogotá: Biblioteca
<strong>de</strong> Historia Nacional;<br />
1930;45:25-6.<br />
13. Vargas M.B. <strong>de</strong>. Milicia y<br />
<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Indias.<br />
Madrid: Librería <strong>de</strong> Victoriano<br />
Suárez. 1892;2:90-91.<br />
14. Uzscátegui M.N. « El tabaco<br />
entre <strong>la</strong>s tribus indígenas <strong>de</strong><br />
Colombia. » Revista<br />
Colombiana <strong>de</strong> Antropología.<br />
Bogotá. 1956;5:50.<br />
15. Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z C.I. Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología en<br />
Colombia. Cali. Oct. 2005.<br />
16. Miranda C.N. La Medicina en<br />
Colombia. Gran Enciclopedia<br />
<strong>de</strong> Colombia. Tomo 5. Bogotá:<br />
Círculo <strong>de</strong> lectores - Printer<br />
Colombia; 1992.<br />
17. Miranda C.N. La Medicina<br />
colombiana <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Regeneración a los años <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Segunda Guerra Mundial.<br />
Nueva Historia <strong>de</strong> Colombia.<br />
Tomo 4. Bogotá: P<strong>la</strong>neta;<br />
1989.<br />
18. Zambrano V.M. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina, reseña histórica. »<br />
Rev. Fac. Med. Univ. Nac.<br />
Colomb. 1993;41:50-51.<br />
19. Vargas R.A. Trabajos científicos.<br />
1ª ed. Bogotá: Imprenta La<br />
Luz; 1856. Reimpreso por Ed.<br />
Guadalupe; 1972.<br />
20. Barrera A.A. « Semb<strong>la</strong>nza <strong>de</strong>l<br />
doctor Luis Alfredo Rueda. »<br />
Rev. Asoc. Colomb. Dermatol.<br />
1999;7:156-157.<br />
21. Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z C.I. Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
vallecaucana 1939-2003. 2ª<br />
ed. Cali: Impresora Feria;<br />
2004.<br />
22. García U.J. Retratos <strong>de</strong><br />
médicos. Cartagena; 2000.<br />
23. Montoya y Flórez J.B.<br />
Contribución al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lepra. Me<strong>de</strong>llín. Jul. 1910: 55-<br />
56.<br />
24. Lleras Acosta F. « Algunas<br />
consi<strong>de</strong>raciones sobre <strong>la</strong><br />
biología <strong>de</strong>l bacilo <strong>de</strong><br />
Hansen. » Rev. Fac. Med. Univ.<br />
Nac. Colomb. 1932;1:929-35.<br />
25. Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> R. « Epi<strong>de</strong>rmal<br />
grafting and its application in<br />
achromic and granu<strong>la</strong>ting<br />
areas. An original technique. »<br />
Arch. Dermatol.<br />
1971;104:592-600.<br />
26. Londoño F. « Thalidomi<strong>de</strong> in<br />
the treatment of actinic<br />
prurigo. » Int. J. Dermatol.<br />
1973;12:326.<br />
27. Londoño F., Muvdi F., Giraldo F.,<br />
Rueda L., Caputo A. « Familial<br />
actinic prurigo. » Arch. Argent.<br />
Dermatol. 1966;16(4):290-<br />
307.<br />
28. Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> R. « Repigmentation<br />
of segmental vitiligo by<br />
autologous minigrafting. »<br />
J. Am. Acad. Dermatol.<br />
1983;9:514-21.<br />
29. Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> R. « Idiopathic<br />
guttate hypome<strong>la</strong>nosis. »<br />
Dermatol. Clin. 1983;6:241-7.<br />
30. Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> R., Escobar C.,<br />
Carrascal E., Arroyave J.<br />
« Leuko<strong>de</strong>rma punctata. »<br />
J. Am. Acad. Dematol.<br />
1988;18:485-94.<br />
31. Acosta <strong>de</strong> Hart A. « Clinical<br />
parameters of tumescent<br />
anesthesia in skin cancer<br />
reconstructive surgery. » Arch.<br />
Dermatol. 1997;5:451-4.<br />
32. Rueda R., Valencia I.C.,<br />
Sanclemente G., Alzate A.,<br />
B<strong>la</strong>nk A., Saldarriaga B.,<br />
Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong> R. « Eosinophilic,<br />
Polymorphic and Pruritic<br />
Eruption Associated with<br />
Radiotherapy. » Arch.<br />
Dermatol. 1999;135:804-810.<br />
33. Carrasquil<strong>la</strong> J. <strong>de</strong> D. « Datos<br />
biográficos. » Rev. Fac. Med.<br />
Univ. Nac. Colomb. Mar.<br />
1933;I(10):759.<br />
34. Carrasquil<strong>la</strong> J. <strong>de</strong> D. « Memoria<br />
sobre <strong>la</strong> lepra griega en<br />
Colombia. » Rev. Fac. Med.<br />
Univ. Nac. Colomb. Mar.<br />
1933;I(10):797-822.<br />
35. Obregón D. « Lepra e<br />
investigación bacteriológica<br />
en Colombia: los casos <strong>de</strong><br />
Carrasquil<strong>la</strong> y <strong>de</strong> Lleras. »<br />
Biomédica. 2000;20:181-9.<br />
36. Departamento <strong>de</strong> Farmacia.<br />
Historia. Bogotá: Universidad<br />
Nacional <strong>de</strong> Colombia.<br />
Disponible en:<br />
http://farmacia.unal.edu.co/<br />
37. Patiño L. « Instituto <strong>de</strong><br />
Investigación Fe<strong>de</strong>rico Lleras:<br />
objeto <strong>de</strong> este centro <strong>de</strong><br />
investigación, organización<br />
técnica y estudios que se<br />
a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntan. » Revista<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Colombie<br />
Colombiana <strong>de</strong> Leprología.<br />
1940;1.<br />
38. Rueda L.A. « Epi<strong>de</strong>rmodisp<strong>la</strong>sia<br />
verruciforme. Un mo<strong>de</strong>lo para<br />
<strong>la</strong> investigación <strong>de</strong>l cáncer<br />
humano. » Derm. Rev. Mex.<br />
1981;25:424-40.<br />
39. Rodríguez G. Rueda L.A.<br />
« Morfogénesis viral en <strong>la</strong><br />
epi<strong>de</strong>rmodisp<strong>la</strong>sia<br />
verruciforme (EV). » Rev. Micr.<br />
Elect. 1972;1:100.<br />
40. Rivares A.V., Navarrete I.G.,<br />
Pueyo C.G., Torrent A.M.,<br />
Duran M.M., Gatius J.R.,<br />
Mussol L.R., So<strong>la</strong>no M.<br />
Evaluation of re<strong>la</strong>tionships<br />
between haemodialysis unit<br />
professionals. EDTNA ERCA J.<br />
2004;30:27-30.<br />
41. Duran M.M., Bernal J. « HLA<br />
typing in actinic prurigo. »<br />
J. Am. Acad. Dermatol.<br />
1992;26:658.<br />
42. Gutiérrez A.G. « Carcinoma<br />
Basocelu<strong>la</strong>r: revisión <strong>de</strong> los<br />
primeros 348 casos<br />
registrados por primera vez en<br />
el Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
Cancerología. » Revista <strong>de</strong>l<br />
Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
Cancerología. Bogotá.<br />
1992;1:1.<br />
43. Soto M.J. « Treatment of<br />
American Cutaneous<br />
Leishmaniasis with Miltefosine,<br />
an Oral Agent. » Clin. Infect.<br />
Dis. 2001;33:57-61.<br />
44. Soto M.J. « Primary Neuritic<br />
Leprosy. » J. Am. Acad.<br />
Dermatol. 1993;29:1050-2.<br />
45. Faizal M., Jiménez G., Burgos C.,<br />
Del Portillo P., Romero R.E.,<br />
Patarroyo M.E. « Diagnosis of<br />
cutaneous tuberculosis by<br />
polymerase chain reaction using<br />
a species-specific gene. » Int. J.<br />
Dermatol. 1996;35:185-8.<br />
46. García Márquez G. Cien años<br />
<strong>de</strong> soledad. Bogotá: Norma;<br />
1997.<br />
47. Lyons A.S., Petrucelli R.J.<br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina.<br />
Barcelona: Doyma; 1984.<br />
48. Guillet G. « Antiguas creencias,<br />
antiguas prácticas », dans<br />
Dermatología. La<br />
Dermatología en Francia. D.<br />
Wal<strong>la</strong>ch y G. Tilles editores;<br />
París: Privat; 2002:707-13.
COMPTE RENDU<br />
HISTORIQUE DE LA<br />
DERMATOLOGIE À CUBA<br />
Le présent travail retrace <strong>la</strong> chronologie <strong>de</strong> l’histoire cubaine: <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> coloniale<br />
(1509-1902), <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> république libérale bourgeoise (1902-1958), <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
révolution socialiste (<strong>de</strong>puis 1959 jusqu´à nos jours).<br />
Pério<strong>de</strong> coloniale (1509-1902)<br />
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
■ Pério<strong>de</strong> coloniale (1509-1902)<br />
L’histoire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau remonte aux origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> civilisation. Aux XVI e et<br />
XVII e siècles on connaissait déjà <strong>de</strong> nombreuses ma<strong>la</strong>dies traitées <strong>de</strong> manière empirique<br />
en utilisant <strong>de</strong>s préparations à partir <strong>de</strong> substances <strong>de</strong> natures variées, toutes soutenues<br />
par <strong>de</strong>s prières religieuses et l’invocation <strong>de</strong>s divinités.<br />
Tout comme le reste <strong>de</strong> l’humanité, les premiers habitants <strong>de</strong> Cuba (siboneyes, taínos<br />
et guanahatabeyes) souffrirent <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées. Selon le frère Bartolomé <strong>de</strong> Las<br />
Casas et d’autres chroniqueurs, les natifs cubains qui n’avaient pas reçu l’influence <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> culture européenne étaient sains. Cependant, ils firent référence à certaines ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau observées chez les habitants, comme <strong>la</strong> bouba (appelée bipa ou buaynara par<br />
les aborigènes) et <strong>de</strong>s lésions produites par le Pulex penetrans, connu sous le nom <strong>de</strong><br />
nigua (chique).<br />
Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo, cité par Pardo Castelló 1 , rapporta qu’en plus <strong>de</strong>s maux<br />
signalés par le frère <strong>de</strong> Las Casas, les premiers habitants souffrirent également d’affections<br />
très désagréables, comme <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatite venenata causée par le <strong>la</strong>tex <strong>de</strong>s arbres<br />
connus sous le nom <strong>de</strong> guao et manzanillo 2 . Les observations <strong>de</strong>s conquistadors ont une<br />
valeur extraordinaire car elles furent réalisées avant que <strong>la</strong> culture européenne n’ait une<br />
influence sur les natifs.<br />
Par ailleurs, dans sa monographie Étu<strong>de</strong> médicale <strong>de</strong> l’Indien cubain S. Picaza exposa<br />
avec une gran<strong>de</strong> c<strong>la</strong>rté les principales affections dont souffraient nos aborigènes, citant<br />
<strong>la</strong> framboesia ou pian et d’autres avitaminoses 3 . Pour sa part Gordon (1894) mentionna,<br />
parmi les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau dont souffraient les siboneyes et les taínos, une affection<br />
appelée caracol, que certains auteurs i<strong>de</strong>ntifièrent comme étant <strong>la</strong> pel<strong>la</strong>gre. Les habitants<br />
<strong>de</strong> notre pays connurent également l’acné, les ulcères, <strong>de</strong>s cas d’albinisme, <strong>de</strong>s lésions<br />
causées par <strong>de</strong>s piqûres d’insectes et d’autres affections.<br />
Le 17 janvier 1613 parut le premier document annonçant le début <strong>de</strong> l’endémie<br />
lépreuse à Cuba. L’arrêté du conseil municipal tenu ce jour-là à La Havane énonça<br />
157
Figure 1.<br />
Raimundo<br />
G. Menocal<br />
(1856-1917)<br />
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
littéralement : « MM. les conseillers municipaux ou <strong>de</strong>s voisins <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville ont dit avoir été<br />
informés que quatre ou six personnes venues d’ailleurs sont atteintes du mal <strong>de</strong> Saint-<br />
Lazare et se promènent dans les rues pour le grand dommage et préjudice <strong>de</strong> cette ville<br />
et <strong>de</strong> ses voisins en raison du caractère contagieux <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die 4 .»<br />
L’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre s’accrut progressivement et <strong>de</strong> nouveaux cas apparurent chez<br />
les habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, chez les Espagnols et chez les esc<strong>la</strong>ves africains qui venaient<br />
d’arriver, inquiétant les autorités d’alors. Les arrêtés du conseil municipal ultérieurs au<br />
10 mars 1662 consignent un accord pour « prévoir une cabane » qui hébergerait tous les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints du mal <strong>de</strong> Saint-Lazare.<br />
La première réunion scientifique sur <strong>la</strong> lèpre à Cuba eut lieu au XVIII e siècle (1793),<br />
au siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société économique d’amis du pays ; le mé<strong>de</strong>cin italien Fernando Rivas, le<br />
conférencier invité, exposa sa Dissertation sur le mal <strong>de</strong> Saint-Lazare 5 .<br />
En 1840 débuta <strong>la</strong> publication <strong>de</strong>s revues médicales <strong>de</strong> La Havane, dans lesquelles<br />
parurent <strong>de</strong> nombreux articles sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’année 1873 vit naître <strong>la</strong> première initiative officielle qui dévoi<strong>la</strong> <strong>la</strong> préoccupation<br />
<strong>de</strong>s autorités sanitaires <strong>de</strong> l’époque envers les ma<strong>la</strong>dies vénériennes : l’hôpital d’hygiène<br />
fut fondé pour faire face à l’a<strong>la</strong>rmante quantité <strong>de</strong> prostituées qui vivaient à La Havane,<br />
et une réglementation sur <strong>la</strong> prostitution, par un arrêté spécial sur l’hygiène publique,<br />
fut promulguée 6 .<br />
En novembre 1879 le savant cubain Carlos Juan Fin<strong>la</strong>y participa à un important débat<br />
— qui eut lieu à l’Académie <strong>de</strong>s sciences médicales, physiques et naturelles <strong>de</strong> La Havane —<br />
sur <strong>la</strong> contagion et l’isolement obligatoire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s souffrant <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre 7 .<br />
Pendant le XIX e siècle <strong>la</strong> syphiligraphie fut définitivement associée à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
grâce aux travaux irréfutables <strong>de</strong> Ricard et Fournier, les fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphiligraphie<br />
clinique 8 .<br />
À <strong>la</strong> fin du siècle (1899), le Dr Raimundo G. Menocal (figure 1) fut nommé professeur<br />
<strong>de</strong> clinique chirurgicale à l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> La Havane ; cette<br />
matière comportait l’actuelle spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui comprend <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong><br />
syphilis 9 .<br />
■ Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> République <strong>la</strong> république libérale bourgeoise libérale (1902-1958) bourgeoise (1902-1958)<br />
158<br />
En 1901, pendant l’intervention <strong>de</strong>s États-Unis, le Pr. Raimundo G. Menocal <strong>de</strong>vint<br />
responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie qui venait d’être créée<br />
suite à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> l’enseignement connue sous le nom <strong>de</strong> p<strong>la</strong>n<br />
Varona.<br />
Le Pr. Menocal naquit en 1856 à San Felipe, San Antonio <strong>de</strong> Las Vegas. Il étudia à l’université<br />
<strong>de</strong> Madrid et obtint sa licence à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1876, réussissant un<br />
doctorat au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année à l’université <strong>de</strong> La Havane. Son travail à l’hôpital<br />
Saint-Louis <strong>de</strong> Paris, entouré <strong>de</strong>s bril<strong>la</strong>nts professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> glorieuse époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
française au XIX e siècle, témoignait <strong>de</strong> son expérience en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il contribua à l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> patrie en fondant le club révolutionnaire Oscar<br />
Primelles à New York.<br />
Il commença l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1903, en dispensant <strong>de</strong>s cours<br />
complémentaires d’une durée <strong>de</strong> trois mois pour les étudiants en mé<strong>de</strong>cine. Cette activité<br />
pourrait être considérée comme étant le premier cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie connu à<br />
Cuba 10 . Homme d’un grand savoir-faire pédagogique et d’une vaste culture médicale, il<br />
fut parmi les pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />
Il enseigna dans l’ancien hôpital Nuestra Señora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s (fondé en 1886), héritier<br />
du Real Hospital <strong>de</strong> San Felipe et Santiago, également appelé San Juan <strong>de</strong> Dios<br />
(fondé en 1598) 11 (figure 2).
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cuba<br />
À l’hôpital Nuestra Señora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s, le Pr. G. Menocal créa<br />
le premier <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie <strong>de</strong> Cuba et fonda un musée <strong>de</strong><br />
mou<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> cire où étaient exhibées <strong>de</strong>s reproductions <strong>de</strong> diverses<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques d’une très gran<strong>de</strong> fidélité par rapport à<br />
l’original.<br />
La première salle <strong>de</strong>stinée à soigner les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre fut<br />
inaugurée en 1906 à l’hôpital n° 1 (actuellement hôpital universitaire<br />
général Calixto García) et dirigée par le Dr Matías Duque Perdomo,<br />
premier secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bienfaisance, mé<strong>de</strong>cin généraliste<br />
et chirurgien, qui étudiait <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die 11 (figure 3).<br />
Après avoir enseigné aux étudiants en mé<strong>de</strong>cine pendant plusieurs<br />
années, le Pr. Menocal ressentit le besoin d’éditer un texte<br />
qui ai<strong>de</strong>rait à comprendre les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques (1907).<br />
C’est dans ce but qu’il publia le livre Nociones <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> piel y sífilis [Notions sur les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>la</strong> syphilis],<br />
suivi du Manual <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> piel y sífilis [Manuel <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis] en 1911.<br />
Entre autres mérites nous pouvons citer celui d’avoir suscité<br />
chez ses élèves <strong>de</strong> l’intérêt pour les ma<strong>la</strong>dies cutanées. Les Drs<br />
Braulio Sáenz et Vicente Pardo Castelló furent ses élèves les plus<br />
remarquables, assurant <strong>la</strong> pérennité <strong>de</strong> son œuvre. Ils complétèrent<br />
leur formation <strong>de</strong>rmatologique grâce aux bourses obtenues en tant qu’élèves éminents<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> La Havane.<br />
Le Dr Sáenz obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1909 et se pencha aussitôt vers <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-syphiligraphie,<br />
poursuivant ses étu<strong>de</strong>s à Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie, à Paris, à Vienne et à Berlin.<br />
Il retourna à Cuba en 1914, où il fut nommé ai<strong>de</strong> diplômé au sein du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et syphiligraphie à <strong>la</strong> charge du Pr. Menocal 9 (figure 4).<br />
Pour sa part, le Dr Pardo, diplômé en 1914, acquit ses premières connaissances <strong>de</strong>rmatologiques<br />
dans le service dirigé par le Pr. G. Menocal en qualité d’interne. En 1915 il<br />
voyagea aux États-Unis, où il travail<strong>la</strong> avec d’importants <strong>de</strong>rmatologues (figure 5).<br />
Le Pr Menocal décéda en 1917 ; un an plus tard, le 4 septembre 1918, le Dr Sáenz obtint<br />
par concours le poste <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire. Désormais <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>vint une<br />
spécialité à part entière, avec une chaire propre dont le<br />
siège se trouve à l’hôpital Nuestra Señora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s.<br />
Le Dr Pardo, pour sa part, fut nommé professeur auxiliaire<br />
en chef à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-syphiligraphie, suite à <strong>la</strong><br />
mise en vigueur <strong>de</strong> <strong>la</strong> réforme universitaire.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Calixto García fut<br />
inauguré en 1925, à <strong>la</strong> charge du Pr. Pardo. Il comportait les<br />
sections <strong>de</strong> mycologie, <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire<br />
clinique, <strong>de</strong> radiothérapie, <strong>de</strong> chirurgie, <strong>de</strong> lèpre et <strong>de</strong><br />
syphilis, entre autres services sociaux.<br />
Le doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine décida <strong>de</strong> diviser le<br />
cours en <strong>de</strong>ux groupes, suivant les critères <strong>de</strong>s Prs Sáenz et<br />
Pardo : le premier groupe à <strong>la</strong> charge du Pr. Sáenz à l’hôpital<br />
Nuestra Señora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s et le <strong>de</strong>uxième dirigé par<br />
le Pr. Pardo, à l’hôpital Calixto García 10 ; désormais l’enseignement eut lieu dans les <strong>de</strong>ux<br />
centres hospitaliers les plus réputés du pays.<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année (1925), <strong>la</strong> Ligue d’hygiène sociale fut créée suite à une<br />
entreprise <strong>de</strong> l’action sociale privée. Son existence fut éphémère et elle fut remp<strong>la</strong>cée en<br />
1928 par <strong>la</strong> Ligue cubaine <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie sociale, qui mena <strong>de</strong>s activités d’information<br />
et <strong>de</strong> vulgarisation.<br />
159<br />
Figure 2.<br />
Hôpital Nuestra<br />
Señora <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
Merce<strong>de</strong>s (1886)<br />
Figure 3.<br />
Hôpital n° 1,<br />
actuellement hôpital<br />
universitaire général<br />
Calixto García (1896)<br />
Figure 4.<br />
Braulio Sáenz Ricard<br />
(1886-1961)<br />
Figure 5.<br />
Vicente Pardo Castelló<br />
(1892-1967)
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
160<br />
En 1927 le Pr. Pardo publia son livre Nociones <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatología y sifilografía [Notions<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie], réédité en 1941, en 1945 et en 1953 sous le titre<br />
Dermatología y sifilografía [Dermatologie et syphiligraphie]. Des <strong>de</strong>rmatologues réputés<br />
du Brésil, du Mexique, du Pérou et du Salvador et vingt et un auteurs cubains col<strong>la</strong>borèrent<br />
à ces rééditions.<br />
L’année 1928 témoigna <strong>de</strong> l’expansion <strong>de</strong> l’hôpital NS <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s, avec <strong>la</strong><br />
construction d’un pavillon <strong>de</strong>stiné au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie baptisé Raimundo Menocal.<br />
Il comportait toutes les sections propres à un service d’enseignement et <strong>de</strong> soins. En<br />
1934 fut construit le <strong>de</strong>uxième étage du pavillon grâce à un don du Pr. Sáenz, à <strong>la</strong> mémoire<br />
<strong>de</strong> son épouse et <strong>de</strong> leurs enfants tragiquement disparus lors du désastre maritime<br />
du Morro Castle 12 .<br />
Autres faits remarquables <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong><br />
L’hôpital San Lázaro, dans <strong>la</strong> localité <strong>de</strong> Rincón ou Santiago <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Vegas, fut inauguré<br />
le 26 février 1917, après un long pèlerinage <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s dans divers endroits inhospitaliers<br />
et inhumains. Le Dr José A. C<strong>la</strong>rk en fut le premier directeur, remp<strong>la</strong>cé peu après<br />
par le Dr Benjamín Primelles.<br />
En 1920 fut créé le dispensaire <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie vénérienne du secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé,<br />
qui disparut progressivement en raison <strong>de</strong> problèmes économiques. La Casa <strong>de</strong> Socorros<br />
<strong>de</strong>l Cerro, dirigée par le Dr Matías Duque, mit en p<strong>la</strong>ce par <strong>la</strong> suite un cabinet pour soigner<br />
les ma<strong>la</strong>dies vénériennes. Ce service fut à l’origine <strong>de</strong> l’institut municipal <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie<br />
vénérienne Joaquín Albarrán tout comme ceux qui fonctionnaient à l’hôpital<br />
<strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong>puis 1921 6 .<br />
La Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie fut fondée le 26 juin 1928<br />
dans le but <strong>de</strong> favoriser les échanges scientifiques à travers <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> cas cliniques<br />
et l’exposition <strong>de</strong> travaux, aidant ainsi à renforcer les liens entre les <strong>de</strong>rmatologues<br />
du pays et ceux <strong>de</strong> l’étranger 9 . La première commission directive <strong>de</strong> <strong>la</strong> société fut<br />
présidée par les Prs Sáenz et Pardo.<br />
En juin 1929 parut le premier numéro du Bulletin <strong>de</strong> <strong>la</strong> société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et syphiligraphie; <strong>la</strong> publication dut cesser au cours du troisième trimestre <strong>de</strong> 1930<br />
à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation politique dramatique du pays. Elle reprit en 1946 sous <strong>la</strong> direction<br />
d’Ovidio <strong>de</strong> Laosa et <strong>de</strong> J.R. Morales Coello. La même année fut fondé l’institut <strong>de</strong><br />
prophy<strong>la</strong>xie vénérienne Joaquín Albarrán, une institution regroupant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
réputés <strong>de</strong> La Havane et qui fut primordiale pour le soin <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
vénériennes.<br />
Avant l’inauguration <strong>de</strong> cet institut, les seuls services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui existaient<br />
étaient ceux <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> l’hôpital Calixto García, et les services <strong>de</strong><br />
traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis du dispensaire Tamayo et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Croix-Rouge. Les<br />
services <strong>de</strong> l’État étaient peu nombreux et insuffisants car ils ne se trouvaient qu’à<br />
La Havane et dans les capitales <strong>de</strong>s provinces ayant <strong>de</strong>s ressources très limitées.<br />
La Ligue antilépreuse <strong>de</strong> Cuba fut fondée en 1936 ; cette institution privée, en partie<br />
subventionnée par le gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> La Havane, menait <strong>de</strong>s campagnes<br />
<strong>de</strong> vulgarisation à travers <strong>la</strong> presse écrite et <strong>la</strong> radio, et publiait aussi le Bulletin <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Ligue antilépreuse <strong>de</strong> Cuba.<br />
Le décret prési<strong>de</strong>ntiel du 5 décembre 1938 créa le Patronat pour <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lèpre, <strong>la</strong> syphilis et les ma<strong>la</strong>dies cutanées (PLESC, en espagnol), dont <strong>la</strong> direction fut<br />
confiée au Pr. Pardo 13 . Il n’y avait jamais eu auparavant d’organisme officiel pour soigner<br />
et contrôler ces ma<strong>la</strong>dies. Dirigée par une confédération <strong>de</strong> patrons, l’institution ne<br />
dépendait pas <strong>de</strong> l’administration étatique. Cette <strong>de</strong>rnière fit les démarches pour acheter<br />
à Santiago <strong>de</strong> Cuba les terrains <strong>de</strong>stinés à <strong>la</strong> construction d’un hôpital pour les lépreux,<br />
et inaugura <strong>de</strong>s dispensaires dans toutes les provinces du pays. La première
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cuba<br />
campagne nationale contre <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> syphilis se mit en route au même moment, ses<br />
résultats ayant été présentés au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> 1 re Conférence nationale <strong>de</strong> léprologie, qui<br />
eut lieu à Santa C<strong>la</strong>ra en 1944 14 .<br />
Le 3 août 1936 se produisit un fait très important pour <strong>la</strong> science et notamment pour<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie cubaine : <strong>la</strong> découverte du tréponème du pian à l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s,<br />
à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> lymphe <strong>de</strong>s lésions cutanées suivant une technique mise au point<br />
par les Drs José Alfonso Armenteros et Juan Grau Triana 15 . L’importance <strong>de</strong> cette découverte<br />
fut reconnue dès <strong>la</strong> première communication <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>américaine</strong>s et européennes du plus haut niveau.<br />
Les chercheurs <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s hôpitaux <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s et Calixto<br />
García i<strong>de</strong>ntifièrent pour <strong>la</strong> première fois à Cuba (1941) le champignon à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chromomycose 16 .<br />
Le recensement réalisé en 1942 dénombra un total <strong>de</strong> 1900 ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre.<br />
En 1943 fut fondée <strong>la</strong> revue du PLESC — Revista <strong>de</strong> Sifilografía, Leprología y Dermatología<br />
— dont le premier numéro parut un an plus tard. La même année, <strong>la</strong> lèpre fut<br />
traitée à l’hôpital San Lázaro <strong>de</strong>l Rincón (dirigé par le Dr Fernando Trespa<strong>la</strong>cios) avec <strong>la</strong><br />
sulfone, apparue en 1941 pour remp<strong>la</strong>cer l’huile <strong>de</strong> Chaulmoogra.<br />
Le 24 février 1944 fut inauguré l’hôpital national San Luis <strong>de</strong> Jagua (à Alto Songo, province<br />
d’Orient), pour héberger les patients souffrant <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre; le Dr Miguel A. González<br />
Pren<strong>de</strong>s en fut le premier directeur. Les 1 er et 2 avril <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année eut lieu à Santa<br />
C<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> 1 re Conférence cubaine <strong>de</strong> léprologie, au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle le Dr Enrique Ríos<br />
León, célèbre <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> cette localité, inaugura un dispensaire du PLESC.<br />
En 1946, le Dr Victoriano Bermú<strong>de</strong>z appliqua pour <strong>la</strong> première fois à Cuba, dans le<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Calixto García, un traitement par le BAL (antidote<br />
spécifique à l’intoxication par métaux lourds tels que l’arsenic et le mercure, employés<br />
pour traiter <strong>la</strong> syphilis) 17 .<br />
L’année suivante les Prs Pardo Castelló, Francisco Tiant et Raúl Piñeiro soutinrent<br />
dans plusieurs publications que les lésions <strong>de</strong>s troncs nerveux périphériques sont une<br />
constante dans toute forme clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, affirmation qui fut acceptée par <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong>s auteurs 18 .<br />
Le 5 e Congrès international <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, organisé par <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en col<strong>la</strong>boration avec l’Association internationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, eut lieu à La Havane<br />
entre le 3 et le 11 avril 1948. La commission nationale organisatrice dudit congrès avait<br />
été créée par un décret prési<strong>de</strong>ntiel (n° 4500, du 18 décembre 1947) ; les Drs Alberto<br />
Oteiza et Ismael Ferrer furent nommés respectivement prési<strong>de</strong>nt et secrétaire 18 . L’Association<br />
internationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre fut représentée par son prési<strong>de</strong>nt, H. W. Wa<strong>de</strong>, et par<br />
le Dr Ernest Muir, vice-prési<strong>de</strong>nt du congrès 13 . La c<strong>la</strong>ssification pan<strong>américaine</strong> fut adoptée<br />
comme c<strong>la</strong>ssification internationale au cours <strong>de</strong> cet événement et l’inclusion du<br />
groupe incaracterístico (appelé aussi « indéterminé »), proposé par le Pd. Latapí fut approuvée.<br />
Cette c<strong>la</strong>ssification fut d’abord adoptée en Amérique et plus tard dans le mon<strong>de</strong><br />
entier 19 .<br />
Le gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> République <strong>de</strong> Cuba émit un timbre commémoratif en souvenir<br />
<strong>de</strong> ce congrès majeur. Il fut mis en circu<strong>la</strong>tion le 9 avril 1948.<br />
Une fois le congrès terminé, les <strong>de</strong>rmatologues ibéro-<strong>la</strong>tino-américains qui y avaient<br />
participé, réunis autour du Dr Pastor Fariñas (prési<strong>de</strong>nt), <strong>de</strong> Guillermo González Pérez<br />
et d’Ovidio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Osa (secrétaires), décidèrent <strong>la</strong> fondation d’une organisation rassemb<strong>la</strong>nt<br />
les spécialistes <strong>de</strong> tous les pays hispanophones et lusophones, qu’ils appelèrent Collège<br />
ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et dont l’objectif principal était<br />
d’encourager les échanges scientifiques entre les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux continents.<br />
Les statuts <strong>de</strong> cette institution furent approuvés au moment même <strong>de</strong> sa constitution. La<br />
première commission fut intégrée par le Dr José Aguiar Pupo (Brésil) en tant que prési<strong>de</strong>nt,<br />
et par trois vice-prési<strong>de</strong>nts : Braulio Sáenz Ricard (Cuba), José Gay Prieto (Espagne)<br />
161
Figure 6.<br />
Carlos Castanedo<br />
Pardo (1913-1998)<br />
Figure 7.<br />
Guillermo Fernán<strong>de</strong>z<br />
Hernán<strong>de</strong>z-Baquero<br />
(1920-1987)<br />
Figure 8.<br />
Serafín Ruiz <strong>de</strong> Zárate<br />
(1923-1991)<br />
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
162<br />
et Marcial Quiroga (Argentine) ; le Dr Humberto Cerruti (Brésil) fut élu secrétaire. Le premier<br />
congrès eut lieu à Rio <strong>de</strong> Janeiro en 1950 20 .<br />
Le 4 mai 1951 fut créée <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> léprologie dans <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> conférences<br />
<strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Merce<strong>de</strong>s ; elle regroupait les <strong>de</strong>rmatologues consacrés principalement<br />
au traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s lépreux.<br />
En mai 1954 un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues qui s’étaient <strong>la</strong>ncés dans <strong>la</strong> cosmétologie<br />
se réunirent à La Havane et créèrent, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
du Pr. Carlos Castanedo, <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> cosmétologie<br />
(figure 6).<br />
La 2 e Conférence nationale <strong>de</strong> léprologie, sponsorisée<br />
par <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> léprologie et présidée par le<br />
Dr Pastor Fariñas, eut lieu les 26 et 27 mars 1955 à La Havane.<br />
La portée <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification sud-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lèpre, approuvée lors du 5 e Congrès international, fut exposée<br />
en détail au cours <strong>de</strong> cet événement.<br />
Durant <strong>la</strong> même année, le Dr Horacio Abascal, directeur<br />
du service <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie vénérienne, publia un travail<br />
intéressant sur <strong>la</strong> pel<strong>la</strong>gre et <strong>la</strong> framboesia, fixant une règle définitive pour <strong>la</strong><br />
question philologique qui se posait 21 .<br />
En 1956 le gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> République <strong>de</strong> Cuba émit un timbre commémoratif du<br />
centenaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> naissance du pionnier <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, le Pr. Raimundo<br />
G. Menocal.<br />
En juin 1958 les Drs Guillermo Fernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z-Baquero (figure 7) et Fernando<br />
Trespa<strong>la</strong>cios publièrent un écrit sur le premier cas <strong>de</strong> piedra observé à Cuba et provoqué<br />
par le Trichosporum beigeli 22 . Au mois <strong>de</strong> décembre, José Alfonso Armenteros et<br />
Oscar Romero présentèrent une nouvelle forme clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> chromomycose qu’ils appelèrent<br />
pseudochéloïdienne 23 .<br />
■ Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution socialiste<br />
(<strong>de</strong> 1959 jusqu´à nos jours)<br />
Pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Révolution Socialiste (<strong>de</strong>puis 1959 jusqu´à nos jours)<br />
Le 1 er janvier 1959 triompha <strong>la</strong> Révolution, événement historique qui entraînera <strong>de</strong><br />
profon<strong>de</strong>s transformations politiques, économiques et sociales dans notre pays.<br />
L’étape précé<strong>de</strong>nte avait été caractérisée par un manque <strong>de</strong> politiques sanitaires, un<br />
développement insuffisant <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique, l’absence d’assistance<br />
médicale envers <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale et l’inexistence d’un programme <strong>de</strong> formation <strong>de</strong><br />
spécialistes. Le pays se trouvait dans une situation précaire où prédominaient <strong>la</strong> corruption<br />
administrative et l’abandon social, avec <strong>de</strong>s taux élevés <strong>de</strong> misère, d’analphabétisme,<br />
<strong>de</strong> chômage et <strong>de</strong> parasitisme entre autres ; les services <strong>de</strong> santé étaient rares et<br />
les taux <strong>de</strong> mortalité infantile élevés, <strong>de</strong> même que les taux <strong>de</strong> morbidité et <strong>de</strong> mortalité<br />
causées par <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies pouvant être prévenues.<br />
Le fait que <strong>la</strong> santé fût reconnue comme un droit <strong>de</strong> l’être humain et une obligation<br />
<strong>de</strong> l’État contribua à éliminer tous les vices et les facteurs négatifs qui s’opposaient à ce<br />
droit inaliénable.<br />
Les premières mesures révolutionnaires furent orientées vers une assistance médicale<br />
gratuite et accessible dans tout le pays et une organisation <strong>de</strong>s activités curatives et<br />
préventives, afin <strong>de</strong> réduire et d’éradiquer les ma<strong>la</strong>dies grâce au développement d’un<br />
système national <strong>de</strong> santé. Tout ceci <strong>de</strong>vait compter sur <strong>la</strong> participation importante <strong>de</strong>s<br />
masses popu<strong>la</strong>ires organisées.<br />
Le Dr Serafín Ruiz <strong>de</strong> Zárate, célèbre <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Vil<strong>la</strong> C<strong>la</strong>ra, fut<br />
nommé ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique au mois <strong>de</strong> juin 1959 24 (figure 8).
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cuba<br />
Un exo<strong>de</strong> important <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins vers l’étranger eut lieu pendant les premières années<br />
<strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>. Le nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues qui restèrent dans le pays était alors<br />
limité, mais ceux-ci assurèrent avec honneur leur tâche et contribuèrent à <strong>la</strong> formation<br />
<strong>de</strong>s nouvelles générations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong> spécialistes, face au besoin impérieux du<br />
développement <strong>de</strong>s programmes sociaux et sanitaires que <strong>la</strong> direction du pays proposa<br />
dès les premiers temps.<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ayant été supprimée par <strong>la</strong> réforme universitaire, <strong>de</strong> nouveaux<br />
enseignants — élus par concours et travail<strong>la</strong>nt déjà comme attachés, instructeurs,<br />
associés ou rési<strong>de</strong>nts — arrivèrent au cours du <strong>de</strong>uxième semestre <strong>de</strong> 1960. C’est ainsi<br />
que les activités re<strong>de</strong>vinrent peu à peu normales.<br />
Le PLESC disparut en 1960 et fit p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> Section <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (qui <strong>de</strong>viendrait plus<br />
tard le Département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie), sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’Assistance hospitalière du<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique.<br />
La loi 723 du 22 janvier 1960 créa le Service médical rural, décision d’une gran<strong>de</strong> importance<br />
pour les popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s zones reculées du pays, et surtout <strong>de</strong>s régions montagneuses<br />
auxquelles aucun mé<strong>de</strong>cin n’était parvenu jusqu’alors.<br />
Entre 1961 et 1962 le conseil universitaire nomma les Drs Raúl Piñeiro et Guillermo<br />
Fernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z-Baquero comme professeurs titu<strong>la</strong>ires, et les Drs Andrés Valdés<br />
Alvariño, Bartolomé Sagaró (figure 9) et Carlos Castanedo comme professeurs auxiliaires,<br />
promus titu<strong>la</strong>ires un peu plus tard.<br />
Le premier programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, mis à jour suivant les nouvelles<br />
connaissances scientifiques et le développement du système national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, fut établi<br />
et dirigé par le Pr. Bartolomé Sagaró.<br />
Durant <strong>la</strong> première moitié <strong>de</strong>s années 60 furent créés les internats obligatoires pour<br />
tous les élèves, ainsi que le résidanat <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; l’internat s’effectuait pendant <strong>la</strong><br />
sixième année <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et le résidanat lors d’une spécialisation d’une<br />
durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans. Les premiers instructeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie furent nommés<br />
en 1966 : José Díaz Almeida, Alfredo Abreu, José Díaz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rocha, Fernando<br />
Fernán<strong>de</strong>z et Pedro Rega<strong>la</strong>do Ortiz ; en 1969 ils furent promus professeurs auxiliaires et<br />
titu<strong>la</strong>risés en 1977.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine — et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie — s’étendit dans tout le pays au<br />
cours <strong>de</strong> ce processus. L’activité pédagogique dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Cuba débuta en<br />
1966 avec le prestigieux spécialiste Miguel Ángel D’Alessandro; dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Camagüey,<br />
<strong>la</strong> nomination revint au Dr Enrique L<strong>la</strong>nos, célèbre <strong>de</strong>rmatologue <strong>de</strong> <strong>la</strong> région; à<br />
Santa C<strong>la</strong>ra, le prestigieux spécialiste Serafín Ruiz <strong>de</strong> Zárate fut nommé professeur <strong>de</strong> cette<br />
région centrale du pays. Quant à <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Matanzas, l’enseignement débuta en 1969:<br />
le Dr Zobeida Lovio, faisant preuve d’éminentes qualités pédagogiques et d’un grand travail<br />
d’assistance, y fut désignée professeur. Enfin, dans <strong>la</strong> province Pinar <strong>de</strong>l Río, l’enseignement<br />
fut assuré par le Dr Luis Ruqué, qui exerçait <strong>la</strong> profession <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue jusqu’alors.<br />
La structure administrative du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique comportait <strong>de</strong>s groupes<br />
nationaux et provinciaux ; <strong>de</strong>s professionnels prestigieux, <strong>de</strong> niveau scientifique élevé et<br />
prodiguant <strong>de</strong>s conseils dans les différentes spécialités médicales, en faisaient partie. Le<br />
Dr Bartolomé Sagaró fut nommé chef du groupe national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; il fut remp<strong>la</strong>cé<br />
à partir <strong>de</strong> 1972 par le Dr Alfredo Abreu, qui occupe toujours le poste.<br />
Plus <strong>de</strong> vingt livres et monographies furent publiés au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, parmi<br />
lesquels on distingue : Propedéutica Dermatológica [Propé<strong>de</strong>utique <strong>de</strong>rmatologique], du<br />
Pr. Hernán<strong>de</strong>z-Baquero; Dermatología para estudiantes y el médico práctico [Dermatologie<br />
pour les étudiants et le praticien], du Pr. Carlos Castanedo ; Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en<br />
Cuba [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre à Cuba], du Pr. Miguel A. González Pren<strong>de</strong>s ; Histomorfología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> piel [Histomorphologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau], du Dr Darío Argüelles ; Micología [Mycologie],<br />
du Dr Alfonso Armenteros, et le premier manuel officiel pour les élèves rédigé par l’ensemble<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
163<br />
Figure 9.<br />
Bartolomé Sagaró<br />
Delgado (1919-2001)
Figure 10.<br />
De gauche à droite :<br />
Andrés Valdés Albariño,<br />
José Díaz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rocha,<br />
José Díaz Almeida, José<br />
<strong>de</strong> J. Arvelo, Vicente<br />
Menén<strong>de</strong>z García,<br />
Alfredo Abreu Daniel<br />
Figure 11.<br />
José G. Díaz Almeida<br />
Figure 12.<br />
Dermatologues<br />
participant à <strong>de</strong>s<br />
activités scientifiques<br />
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
164<br />
Dès <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> première décennie, <strong>la</strong> spécialité se<br />
vit renforcée, avec un plus grand nombre <strong>de</strong> spécialistes<br />
diplômés, une meilleure organisation <strong>de</strong>s services<br />
et une assistance qui s’étendit à toutes les<br />
provinces cubaines.<br />
En octobre 1970, le Dr José Arvelo, consultant à<br />
l’Organisation pan<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, vint donner<br />
<strong>de</strong>s conseils sur le thème prévention et rémission <strong>de</strong>s<br />
malformations physiques chez les lépreux. Sa visite intervint<br />
au moment où se réalisait le 1 er Cours international<br />
<strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> rémission <strong>de</strong>s malformations<br />
physiques causées par <strong>la</strong> lèpre (figure 10).<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, on effectua un audit<br />
et une restructuration <strong>de</strong> l’hôpital national San Luis <strong>de</strong> Jagua dans le but <strong>de</strong> le fermer.<br />
Ce<strong>la</strong> répondait aux critères mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> l’épidémiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, selon lesquels les<br />
patients étaient réhabilités et l’hospitalisation obligatoire proscrite.<br />
En 1972, le Pr. Carlos Castanedo publia le livre Alergia, <strong>de</strong>rmatología y fenómenos<br />
asociados [Allergie, <strong>de</strong>rmatologie et phénomènes associés], dans lequel il exposa ses<br />
propres expériences.<br />
En 1973, le Pr. José Díaz Almeida (figure 11) dirigea <strong>la</strong> première étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en<br />
macrophages péritonéaux du rat réalisée à Cuba par microscopie électronique.<br />
En décembre 1975, <strong>la</strong> 2 e Journée provinciale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu à Matanzas,<br />
siège <strong>de</strong> l’annexe <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans cette province. Cette journée<br />
clotura le 2 e Séminaire provincial d’enquêteurs-chercheurs.<br />
Entre le 14 et le 19 juin 1976, un cours sur « <strong>la</strong> rémission et <strong>la</strong> prévention <strong>de</strong>s malformations<br />
physiques chez les lépreux » fut dispensé aux <strong>de</strong>rmatologues à l’hôpital-clinique<br />
chirurgical Ambrosio Grillo (à Santiago <strong>de</strong> Cuba). Le Dr José M. Pereira coordonna<br />
ce travail.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année 1976 se dérou<strong>la</strong> le 2 e Séminaire<br />
national d’épidémiologie et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies vénériennes avec <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
et d’épidémiologistes <strong>de</strong> tout le pays. Ce séminaire<br />
fut très important pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en raison<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> thématique <strong>de</strong>s ateliers organisés.<br />
Un nouveau programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (qui incluait<br />
l’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> rifampicine dans le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die) fut appliqué en 1977. Le Dr Alfredo Abreu fut désigné<br />
consultant <strong>de</strong> l’OMS spécialisé dans l’étu<strong>de</strong> et le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année. Il donna<br />
<strong>de</strong>s conseils dans les pays asiatiques et africains sur leurs<br />
programmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et fut nommé par<br />
<strong>la</strong> suite membre du panel d’experts <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre à l’OMS.<br />
Au cours du 1 er Congrès national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cienfuegos (1979), Carlos Miyares<br />
Cao et Manuel Táboas exposèrent leurs travaux sur l’étu<strong>de</strong> expérimentale et clinique <strong>de</strong><br />
l’effet <strong>de</strong> pigmentation épi<strong>de</strong>rmique <strong>de</strong> l’extrait p<strong>la</strong>centaire humain — connu sous le nom<br />
<strong>de</strong> me<strong>la</strong>génine — dans le traitement du vitiligo (figure 12).<br />
Le 12 mai 1980 les professeurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Guillermo Fernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z-Baquero,<br />
Bartolomé Sagaró, José Díaz Almeida et Fernando Fernán<strong>de</strong>z reçurent une médaille<br />
du 250 e anniversaire <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> La Havane. Au mois <strong>de</strong> juin <strong>de</strong> <strong>la</strong> même<br />
année, le Dr Alfredo Abreu fut élu prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, poste<br />
auquel il fut réélu trois ans plus tard lors du 2 e Congrès national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
province <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Cuba.
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cuba<br />
En 1982 fut inauguré à La Havane l’hôpital-clinique chirurgical Frères Ameijeiras,<br />
son service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie étant alors dirigé par le Pr. Bartolomé Sagaró.<br />
Un nouveau modèle d’assistance médicale, incluant un mé<strong>de</strong>cin et une infirmière <strong>de</strong><br />
famille dans tous les cabinets, fut créé en 1984 ; ce modèle modifia <strong>de</strong> manière bénéfique<br />
<strong>la</strong> forme, le contenu et <strong>la</strong> pratique du soin médical. La préparation <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong><br />
ces professionnels eut une gran<strong>de</strong> importance en raison <strong>de</strong> l’inci<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévalence<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées dans <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
Le 24 juillet 1984 fut inaugurée <strong>la</strong> clinique du psoriasis à Santa María <strong>de</strong>l Mar, fondée<br />
par le Pr. Baquero et dont <strong>la</strong> première directrice fut Marta Cortés.<br />
En 1985, <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> <strong>de</strong>grés scientifiques du Ministère <strong>de</strong> l’Éducation supérieure<br />
octroya le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> docteur ès sciences à Guillermo Fernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z-Baquero<br />
et à Bartolomé Sagaró. Plus tard, José Díaz Almeida, Pedro Rega<strong>la</strong>do Ortiz, Julián<br />
Manzur et Rafael Grillo reçurent <strong>la</strong> même distinction.<br />
En 1986 le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique mit en p<strong>la</strong>ce à travers l’Institut Supérieur<br />
<strong>de</strong>s Sciences Médicales <strong>de</strong> La Havane, un programme national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie basé sur<br />
une activité (dont <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique) par séjour d’une durée <strong>de</strong> trois semaines.<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année parut une nouvelle édition du manuel du Pr. Baquero et<br />
<strong>de</strong> ses col<strong>la</strong>borateurs. Au mois <strong>de</strong> juillet, le Pr. Marta Cortés obtint le titre <strong>de</strong> docteur ès<br />
sciences médicales à l’Institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Moscou, <strong>de</strong>venant ainsi <strong>la</strong> première<br />
femme <strong>de</strong>rmatologue ayant acquis un tel gra<strong>de</strong> scientifique à l’étranger.<br />
Le premier cas <strong>de</strong> sida à Cuba fut diagnostiqué en 1986. Il faut noter que déjà en<br />
1983, le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, ayant connaissance <strong>de</strong> l’ampleur <strong>de</strong> <strong>la</strong> pandémie,<br />
avait créé une commission nationale chargée d’é<strong>la</strong>borer un programme <strong>de</strong>stiné à<br />
éviter <strong>la</strong> propagation <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die dans le pays.<br />
En 1988, un nouveau programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre entra en vigueur à Cuba,<br />
consolidant le traitement standardisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> polichimiothérapie conseillée par l’OMS dans<br />
<strong>la</strong> prévalence et l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Par ailleurs, le 3 e Congrès national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Camagüey,<br />
auquel participèrent les professeurs invités Amado Saúl, Roberto Arenas,<br />
Lour<strong>de</strong>s Tamayo et Juan Manuel Garibay.<br />
En septembre 1989 eut lieu le 7 e Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> lutte contre les ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles au pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Conventions <strong>de</strong> La Havane ; cet événement<br />
très important favorisa l’échange scientifique entre les Cubains et les participants<br />
étrangers.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 80, le pays connut une certaine stabilité socio-économique : les<br />
soins <strong>de</strong>rmatologiques se maintinrent et le nombre <strong>de</strong> spécialistes diplômés en <strong>de</strong>rmatologie<br />
(formés dans toutes les provinces cubaines) s’accrut. Les programmes axés sur <strong>la</strong><br />
lèpre et les infections sexuellement transmissibles se développèrent avec succès.<br />
À partir <strong>de</strong> 1990, <strong>la</strong> crise du communisme s’accentua sur <strong>la</strong> scène internationale, entraînant<br />
sa disparition ; ceci provoqua un coup très dur pour notre pays en raison <strong>de</strong>s<br />
graves conséquences qu’elle induisit dans tous les secteurs et les branches <strong>de</strong> l’économie,<br />
notamment dans <strong>la</strong> santé et l’éducation. Cette situation fut aggravée par l’aggravation<br />
<strong>de</strong> l’embargo que le gouvernement américain impose à Cuba <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> quatre<br />
décennies.<br />
Au cours <strong>de</strong>s premières années <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crise économique, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
tout comme les autres spécialités, s’est vue affectée, surtout en ce qui<br />
concerne les médicaments et les équipements. Cependant, le niveau d’assistance<br />
médicale <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et du développement <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s spécialistes dans les facultés du pays se maintint ces <strong>de</strong>rnières<br />
années.<br />
La Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie disposait déjà d’annexes dans toutes les provinces<br />
du pays. Cette nouvelle étape marqua une organisation territoriale différente pour les<br />
165
Figure 13.<br />
Alfredo Abreu Daniel<br />
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
166<br />
activités scientifiques : les provinces se regroupèrent en annexes occi<strong>de</strong>ntales, centrales<br />
et orientales, accueil<strong>la</strong>nt tour à tour les différents événements.<br />
L’année 1990 vit se produire <strong>de</strong>s promotions pour les enseignants et nos <strong>de</strong>rmatologues<br />
obtinrent <strong>de</strong>s gra<strong>de</strong>s scientifiques : le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> docteur ès sciences médicales fut<br />
octroyé au Dr Damise<strong>la</strong> López Osorio, au Pr. Ramón Daniel Simón et au Pr. Myra Guerra<br />
Castro.<br />
Le cours d’administration et d’épidémiologie du contrôle <strong>de</strong>s MST eut lieu à La Havane<br />
du 19 octobre au 7 novembre 1991 ; il avait pour but <strong>de</strong> former les <strong>de</strong>rmatologues<br />
et les épidémiologistes et <strong>de</strong> les tenir informés <strong>de</strong>s principes administratifs et épidémiologiques<br />
récents pour é<strong>la</strong>borer et perfectionner un programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles.<br />
En 1993, grâce au développement du programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre basé sur<br />
l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> polichimiothérapie, le pays montra <strong>de</strong>s valeurs inférieures à<br />
1 pour 10 000 habitants.<br />
Au cours du <strong>de</strong>uxième semestre <strong>de</strong> 1993, l’enseignement supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à l’hôpital-clinique chirurgical Luis Díaz Soto <strong>de</strong> La Havane <strong>de</strong> l’Est fut inauguré pour<br />
les étudiants <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine militaire; le Pr. Santiago Alfonso fut nommé chef du service.<br />
Le 31 janvier 1994, <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’enseignement du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique<br />
publia un nouveau règlement pour le résidanat <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Le 7 juillet 1995 eut lieu <strong>la</strong> 1 re Journée interne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Calixto<br />
García (<strong>la</strong> 9 e Provinciale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie) pour commémorer le centenaire <strong>de</strong> l’institution<br />
; cet événement fut p<strong>la</strong>cé sous les auspices du Pr. Díaz Almeida Fernanda Pastrana<br />
(chef du groupe provincial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> La Havane), et compta<br />
sur <strong>la</strong> coordination du Pr. Adis Abad.<br />
L’appel pour intégrer <strong>la</strong> commission directive <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
figura comme suit : Alfredo Abreu (prési<strong>de</strong>nt) (figure 13), José Díaz Almeida (viceprési<strong>de</strong>nt),<br />
Zobeida Lovio (secrétaire) et María Antonia Díaz (trésorière).<br />
Au mois <strong>de</strong> juillet 1996 eut lieu <strong>la</strong> Journée territoriale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Santa<br />
C<strong>la</strong>ra — Journée <strong>de</strong> Cienfuegos —, coordonnée par le Dr Roberto Seife, à <strong>la</strong>quelle assistèrent<br />
les <strong>de</strong>rmatologues et les épidémiologistes <strong>de</strong> toutes les localités du pays. Le<br />
8 et le 9 novembre eut lieu à Santiago <strong>de</strong> Cuba <strong>la</strong> 13 e Journée provinciale (<strong>la</strong> 2 e journée<br />
territoriale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie), sponsorisée par une annexe <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société cubaine<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie située à Santiago <strong>de</strong> Cuba et par le groupe provincial spécialisé, et<br />
p<strong>la</strong>cé sous <strong>la</strong> coordination du Dr Yo<strong>la</strong>nda Columbié. Le 28 novembre se tint à Camagüey<br />
<strong>la</strong> Journée scientifique du 37 e anniversaire <strong>de</strong> l’hôpital-clinique chirurgical Amalia Simoní<br />
; le Pr. José Rodríguez Machado, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fit référence au<br />
cours <strong>de</strong> cette journée à l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> cryochirurgie introduite dans son service <strong>de</strong>puis<br />
1991 et eut le grand mérite d’utiliser <strong>de</strong>s instruments conçus par son groupe et fabriqués<br />
par l’industrie mécanique <strong>de</strong> <strong>la</strong> province. La 1 re Journée luso-cubano-espagnole<br />
du groupe <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique fut organisée le 30 novembre à l’hôpital-clinique<br />
chirurgical Miguel Enríquez (<strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> La Havane), au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle eut lieu<br />
une séance intéressante sur <strong>de</strong>s cas cliniques.<br />
Entre le 3 et le 7 février 1997 eut lieu à La Havane <strong>la</strong> 1 re Conférence internationale<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie cubano-italienne ; <strong>de</strong>s professeurs cubains et italiens y donnèrent <strong>de</strong>s<br />
conférences. La même année, l’Institut supérieur <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> La Havane<br />
attribua le titre <strong>de</strong> professeurs consultants à José Díaz Almeida, Alfredo Abreu, Julián<br />
Manzur et Pedro Rega<strong>la</strong>do Ortiz.<br />
La 1 re Journée luso-cubaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> clinique générale fut organisée le<br />
2 et le 3 septembre 1998 dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> La Havane, à l’hôpital Miguel Enríquez ; elle révé<strong>la</strong><br />
le niveau <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les <strong>de</strong>ux pays. Le 17 et 18 décembre<br />
eut lieu <strong>la</strong> Journée Fototer 98 sponsorisée par l’université <strong>de</strong> La Havane ; <strong>de</strong><br />
nombreux travaux liés à l’application du Fototer en <strong>de</strong>rmatologie furent présentés au
cours <strong>de</strong> cette manifestation, tels ceux d’Esperanza Furones, promotrice <strong>de</strong> cette procédure,<br />
ainsi que les travaux <strong>de</strong> José Díaz Almeida, Adis Abad, Victoria Fundora et Pedro<br />
Ba<strong>la</strong>guer, <strong>de</strong>rmatologues à l’hôpital général Calixto García.<br />
Finalement, nous connaissons en l’an 2000 une nette amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation économique<br />
et sociale du pays ; cette amélioration est soutenue <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié<br />
<strong>de</strong>s années 90. Nous en distinguons les principaux indicateurs :<br />
• L’éducation est présente à tous les niveaux.<br />
• Le nombre <strong>de</strong> spécialistes diplômés en <strong>de</strong>rmatologie augmente, et atteint le chiffre<br />
<strong>de</strong> 546 pour une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> 11 229 688 habitants, c’est-à-dire en moyenne 1 <strong>de</strong>rmatologue<br />
pour 20 567 habitants.<br />
• Les instituts supérieurs <strong>de</strong> sciences médicales du pays se développent, et le nombre<br />
<strong>de</strong> facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine augmente : vingt-<strong>de</strong>ux facultés, y compris l’École <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> sciences médicales (ELAM).<br />
• La <strong>de</strong>rmatologie est présente dans toutes les polycliniques du pays.<br />
• Un groupe <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong>s instituts supérieurs <strong>de</strong> sciences médicales <strong>de</strong> La Havane,<br />
<strong>de</strong> Vil<strong>la</strong> C<strong>la</strong>ra et <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Cuba parachève le manuel le plus récent <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
pour les élèves et les rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
• Les cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie se multiplient dans toutes les facultés.<br />
• La formation et <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong>s enseignants se poursuivent, et le nombre <strong>de</strong><br />
professeurs.<br />
• D’importantes réunions nationales et provinciales sont organisées pour discuter et<br />
analyser les programmes sur <strong>la</strong> lèpre et les MST.<br />
• La lèpre ne constitue plus un problème <strong>de</strong> santé publique, atteignant un taux <strong>de</strong><br />
prévalence <strong>de</strong> 0,2 pour 10 000 habitants.<br />
• La syphilis congénitale est pratiquement éradiquée.<br />
• Concernant le VIH/sida, le programme <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> promotion est perfectionné<br />
par une assistance intégrale pour tous les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s.<br />
• L’ai<strong>de</strong> internationale apportée par nos <strong>de</strong>rmatologues augmente. ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Pardo Castelló V. « Skin Diseases<br />
in the New World. » Arch. Derm.<br />
and Syph. 1933; 28:22-28.<br />
2. González Pren<strong>de</strong>s M.A., Ibarra<br />
Reig R. Origen e introducción<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Cuba.<br />
5º Congreso Internacional <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Lepra. La Habana: CENIT;<br />
1949:623-633.<br />
3. Gordon A. Medicina indígena<br />
<strong>de</strong> Cuba y su valor histórico.<br />
La Habana: Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Aca<strong>de</strong>mia <strong>de</strong> Ciencias; 1894.<br />
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Cuba<br />
4. González Pren<strong>de</strong>s M.A.<br />
Bosquejo histórico <strong>de</strong>l<br />
Hospital San Lázaro hasta<br />
mediados <strong>de</strong>l siglo XVIII. La<br />
Habana: CENIT; 1952.<br />
5. Beato Núñez V. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Parasitología y <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina Tropical en Cuba. »<br />
Dans : Kourí P., Lecciones <strong>de</strong><br />
Parasitología y Medicina<br />
Tropical. La Habana: El Siglo<br />
XX; 1948.<br />
6. Ferrer I., Pardo Castelló V.<br />
Profi<strong>la</strong>xis <strong>de</strong> <strong>la</strong> sífilis.<br />
Patronato para <strong>la</strong> Profi<strong>la</strong>xis<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Lepra, Enfermeda<strong>de</strong>s<br />
Cutáneas y Sífilis. La Habana:<br />
CARASA; 1940.<br />
Septembre 2005<br />
7. González Pren<strong>de</strong>s M.A. « Fin<strong>la</strong>y<br />
ante <strong>la</strong> lepra. » Rev. Sif. Lep. y<br />
Derm. 1957;13(2):5-43.<br />
8. Pardo Castelló V. « La<br />
Dermatología <strong>de</strong>l pasado, <strong>de</strong>l<br />
presente y <strong>de</strong>l futuro. » Bol.<br />
Soc. Cub. Derm. y Sif. 1951;<br />
VIII(1):1-11.<br />
9. Fariñas P. « Breve historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en Cuba. »<br />
Arch. <strong>de</strong>l Hosp. Univ.<br />
1958;X(1):23-31.<br />
10. Ortiz González P.R. « Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología. » Rev.<br />
Cub. Med. 1971;10(3):259-<br />
278.<br />
11. Delgado García G. « Hospital<br />
167
JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA, ALFREDO ABREU DANIEL<br />
Clínico Quirúrgico Docente<br />
General Calixto García.<br />
« Recuento histórico en su<br />
centenario. » Boletín<br />
Epi<strong>de</strong>miológico <strong>de</strong>l Hospital<br />
General Calixto García. 1996;<br />
XI-XII(1-2): 4-20.<br />
12. Argüelles Casals D. « Braulio<br />
Sáenz. » Bol. Soc. Cub. Derm.<br />
y Sif. 1961; XVIII(1-2): 5-18.<br />
13. González Pren<strong>de</strong>s M.A.<br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en Cuba.<br />
Publicaciones Museo Ciencias<br />
Médicas Carlos J. Fin<strong>la</strong>y. La<br />
Habana: CENIT; 1963.<br />
14. Fariñas P. « 2ª Conferencia<br />
Nacional <strong>de</strong> Leprología. » Bol.<br />
Soc. Cub. Derm. y Sif. 1955;<br />
XII(3): 121-125.<br />
15. Alfonso Armenteros J.<br />
« Reseña histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> pinta<br />
en Cuba y <strong>de</strong>scubrimiento <strong>de</strong>l<br />
germen productor. » Rev. Cub.<br />
Med. 1967; VI(6): 643-651.<br />
16. Alfonso Armenteros J.<br />
Micología médica. Micosis<br />
observadas en Cuba. La<br />
Habana: Editorial Científica;<br />
1965.<br />
17. Bermú<strong>de</strong>z A.V. « El BAL en el<br />
tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
intoxicaciones por<br />
preparados arsenicales y<br />
áuricos. » Bol. Soc. Cub. Derm.<br />
y Sif. 1949; VI(2): 45-62.<br />
18. Pardo Castelló V. Piñeiro R.<br />
Memoria <strong>de</strong>l 5º Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra. La<br />
Habana: CENIT; 1949.<br />
19. Rodríguez O. « C<strong>la</strong>sificación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra. » Derm. Rev. Mex.<br />
1972; XVI(1): 73-81.<br />
20. Colegio Ibero-<br />
Latinoamericano <strong>de</strong><br />
Dermatología. « Estatutos.<br />
Breve Historial. » Med. Cut.<br />
ILA. 1974; 2(3): 239-246.<br />
21. Abascal H. Reseña histórica y<br />
sinonimia <strong>de</strong> <strong>la</strong> frambuesia y<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pe<strong>la</strong>gra. Cua<strong>de</strong>rno <strong>de</strong><br />
Historia Sanitaria. La<br />
Habana: Publicaciones <strong>de</strong>l<br />
Ministerio <strong>de</strong> Sanidad y<br />
Asistencia Social. 1955; 1-<br />
35.<br />
22. Fernán<strong>de</strong>z Baquero G. « Tres<br />
Pa<strong>la</strong>cios F. Piedra: primer<br />
caso observado en Cuba.<br />
Nota preliminar. » Bol. Soc.<br />
Cub. Derm. y Sif. 1958; XV(2):<br />
73.<br />
23. Alfonso Armenteros J.,<br />
Romero Jordán O. « Una<br />
nueva forma clínica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cromob<strong>la</strong>stomicosis. » Bol.<br />
Soc. Cub. Derm. y Sif. 1958;<br />
XV(3-4): 152-58.<br />
24. Bush Rodríguez L.M.<br />
Gobierno revolucionario<br />
cubano: génesis y primeros<br />
pasos. La Habana: Ciencias<br />
Sociales; 1999.
ESQUISSE HISTORIQUE<br />
DE LA DERMATOLOGIE<br />
CHILIENNE<br />
Le présent travail constitue une étu<strong>de</strong> préliminaire <strong>de</strong> quelques aspects principaux <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Chili, selon les documents et les divers témoignages oraux que nous<br />
avons pu rassembler. En conséquence, ce compte rendu est loin d’être exhaustif et il<br />
<strong>de</strong>vra être révisé et complété dans les années à venir.<br />
Plusieurs sujets très intéressants n’ont pas été traités ici étant donné l’urgence<br />
d’écrire cette esquisse pour le XXI e Congrès mondial. Nous évoquerons ici :<br />
1) une recherche historiographique <strong>de</strong> certaines facettes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Chili précolombien,<br />
colonial et républicain (y compris le Chili indigène diachronique) jusqu’à <strong>la</strong><br />
moitié du XX e siècle, tout comme les pathologies <strong>de</strong>rmatologiques qui y prévalent, <strong>la</strong> pratique<br />
et l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> paramé<strong>de</strong>cine, <strong>la</strong> thérapeutique <strong>de</strong> chaque<br />
époque et les apports individuels <strong>de</strong>s figures réputées ; 2) l’évolution <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong>s<br />
entités publiques et privées au sujet <strong>de</strong>s aspects préventifs, curatifs et <strong>de</strong> réhabilitation<br />
<strong>de</strong> plusieurs <strong>de</strong>rmatoses et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles (MST) ; 3) une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’hôpital San Luis <strong>de</strong> Santiago (actuellement disparu), comportant son origine,<br />
son développement et son impact sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-vénéréologie chilienne ; 4) <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
sur d’autres disciplines <strong>de</strong>rmatologiques, comme <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, les <strong>de</strong>rmatoses<br />
professionnelles, l’oncologie cutanée et les pathologies régionales à impact cutané (par<br />
exemple l’hydroarsenicisme chronique) ; 5) l’exercice médical privé <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans les cabinets et les gran<strong>de</strong>s cliniques du pays, et son impact sur le contrôle <strong>de</strong>s affections<br />
<strong>de</strong>rmatologiques et <strong>de</strong>s MST.<br />
La Dermatologie comme spécialité au Chili<br />
Première moitié du XX e siècle<br />
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité au Chili<br />
L’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Chili et sa reconnaissance en tant que spécialité furent<br />
affectées par l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine européenne, par <strong>la</strong> création tardive et le<br />
nombre limité d’écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine au Chili (par rapport à l’Europe, aux États-Unis et à<br />
plusieurs pays <strong>la</strong>tino-américains) et par l’isolement géographique du pays dans le mon<strong>de</strong>.<br />
Au cours <strong>de</strong>s premières décennies du XX e siècle, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-vénéréologie commença<br />
à poindre au Chili comme une spécialité nécessaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, aussi bien par <strong>la</strong><br />
complexité <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong>rmatologiques et vénériennes que par <strong>la</strong> difficulté <strong>de</strong>s<br />
169
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
170<br />
mé<strong>de</strong>cins généralistes et internes à gérer ces pathologies. Et ce au moment où <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
française (phare du savoir et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique médicales en Amérique du Sud à<br />
l’époque) reconnut <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que spécialité.<br />
Vers 1914, l’université du Chili (UCH) introduisit l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine ; suivront plus tard l’université <strong>de</strong> Concepción, <strong>la</strong> Pontificia<br />
Universidad Católica (PUC), entre autres. Deux centres <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>rmatologique furent<br />
à <strong>la</strong> tête non seulement du soin <strong>de</strong>s patients <strong>de</strong>rmatologiques et vénériens mais<br />
aussi <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> légitimation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité : l’hôpital San Luis, fondé<br />
vers <strong>la</strong> fin du XIX e siècle pour soigner les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques et vénériennes, et <strong>la</strong><br />
clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis <strong>de</strong> l’hôpital général San Vicente <strong>de</strong> Paul, créée au<br />
début du XX e siècle.<br />
Nul doute que <strong>la</strong> cruauté visuelle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, <strong>la</strong> réticence sociale<br />
face aux affections vénériennes et le manque <strong>de</strong> ressources thérapeutiques contribuèrent<br />
au fait que les jeunes mé<strong>de</strong>cins furent peu attirés par <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Quel que fût<br />
le mécanisme d’accès, elle constitua toujours un choix secondaire au Chili. Ceux qui l’ont<br />
finalement exercée y arrivèrent <strong>de</strong> façon acci<strong>de</strong>ntelle ; en fait, il ne s’agit jamais <strong>de</strong>s<br />
meilleurs diplômés <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, sauf quelques honorables exceptions comme<br />
Hernán Hevia Parga, le meilleur élève <strong>de</strong> <strong>la</strong> promotion 1938 <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC.<br />
Le manque <strong>de</strong> concurrence pour occuper les postes <strong>de</strong> travail rendaient l’accès à <strong>la</strong><br />
spécialité re<strong>la</strong>tivement facile : il fal<strong>la</strong>it s’affilier aux services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Santiago,<br />
Valparaíso ou Concepción afin d’acquérir une formation variée, qui s’obtenait par <strong>la</strong> pratique<br />
— rémunérée ou non — <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité pendant <strong>de</strong>s semaines, <strong>de</strong>s mois ou <strong>de</strong>s années<br />
; ce<strong>la</strong> permettait au mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> s’attribuer le titre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue. Néanmoins, les<br />
mé<strong>de</strong>cins se sentirent toujours peu attirés par <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, provoquant un manque<br />
important <strong>de</strong> spécialistes, surtout dans les provinces. Il était fréquent d’entendre les mé<strong>de</strong>cins<br />
non <strong>de</strong>rmatologues dire que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie était une spécialité facile, peu sérieuse<br />
et peu scientifique ; cette image discréditée était ravivée par l’opinion très<br />
répandue que ceux qui échouaient dans les autres spécialités réussissaient en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
C’est pour cette raison qu’il n’y eut au Chili que quelques douzaines <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
suffisamment préparés pour exercer, quasiment tous concentrés à Santiago et quelquesuns<br />
à Valparaíso et à Concepción. Cette carence, notamment dans les provinces, conduisit<br />
quelques mé<strong>de</strong>cins généralistes ou urologues à soigner — pour <strong>de</strong>s raisons<br />
humanitaires ou économiques mais sans une préparation majeure — <strong>de</strong>s patients souffrant<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatoses et/ou <strong>de</strong> MST rejetés par d’autres collègues, <strong>de</strong>venant ainsi les<br />
<strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> leur région.<br />
Après 1952<br />
La création du Service national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (SNS) en 1952 par <strong>la</strong> loi 10 076 révé<strong>la</strong> le<br />
besoin d’établir une politique <strong>de</strong> couverture sanitaire obligatoire pour tous les habitants<br />
du pays ; ceci entraîna <strong>la</strong> fusion en une seule structure <strong>de</strong> tous les hôpitaux et les polycliniques<br />
communautaires chiliens, quelle que fût leur hiérarchie. Les actions du SNS révélèrent<br />
alors une carence importante <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> plusieurs spécialités, y compris <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, du point <strong>de</strong> vue qualitatif et/ou quantitatif, tant pour les actions préventives<br />
(materno-infantile, tuberculose, MST, entre autres) que curatives. Les causes <strong>de</strong> ce<br />
manque furent, d’une part, l’inégale distribution <strong>de</strong>s spécialistes, qui préféraient travailler<br />
à Santiago ; d’autre part, l’absence <strong>de</strong> politiques <strong>de</strong> stimu<strong>la</strong>tion envers les jeunes<br />
mé<strong>de</strong>cins visant à une diversification et à un quota <strong>de</strong> spécialistes pour pourvoir aux besoins<br />
du pays. Par ailleurs, le nombre réduit <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins diplômés déterminait le choix<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, qui n’était basée que sur <strong>la</strong> décision personnelle <strong>de</strong> chaque mé<strong>de</strong>cin,<br />
généralement liée à une offre ponctuelle <strong>de</strong> travail dans un centre hospitalier.
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
Cette situation changea radicalement pour toutes les spécialités — sauf pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
— lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce en 1958 du système <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> zone: faisant partie<br />
<strong>de</strong>s programmes nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique, les mé<strong>de</strong>cins récemment diplômés al<strong>la</strong>ient<br />
travailler dans les provinces (principalement dans les zones manquant <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins), pour<br />
une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois à cinq ans, avec une rémunération considérable. À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>,<br />
ils pouvaient accé<strong>de</strong>r en récompense à une formation dans une spécialité et un centre<br />
hospitalier <strong>de</strong> leur choix (en percevant toujours un sa<strong>la</strong>ire). Nonobstant, les mé<strong>de</strong>cins<br />
n’éprouvèrent aucun intérêt à exercer <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong> considérant peu attirante.<br />
Le manque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues au Chili fut notoire: en 1970, il y avait environ trente<br />
<strong>de</strong>rmatologues qualifiés et une vingtaine non qualifiés. Le drame <strong>de</strong>s patients était triple :<br />
le groupe communautaire rejetait leurs corps estropiés, une assistance médicale suffisante<br />
et régulière était pénible à trouver et les médicaments efficaces pour le traitement<br />
<strong>de</strong> leurs pathologies faisaient défaut, du fait du progrès limité <strong>de</strong> <strong>la</strong> science <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong> l’époque. Cette situation menait à <strong>la</strong> chronicité et à l’aggravation <strong>de</strong>s lésions,<br />
entraînant un rejet encore plus important du groupe familial et, plus grave encore, une<br />
réticence <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins à l’égard <strong>de</strong> ces patients. Ce n’est qu’après 1980 que les jeunes<br />
mé<strong>de</strong>cins éprouvèrent un intérêt consistant pour <strong>la</strong> spécialité.<br />
Choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> pénurie <strong>de</strong> spécialistes<br />
Durant les quinze <strong>de</strong>rnières années du XX e siècle et les premières du siècle présent, l’intérêt<br />
<strong>de</strong>s jeunes mé<strong>de</strong>cins pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie augmenta considérablement. Pendant cette<br />
pério<strong>de</strong>, <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> croissante dépassa l’offre <strong>de</strong> postes vacants <strong>de</strong>s grands centres <strong>de</strong>rmatologiques<br />
pour les rési<strong>de</strong>nts en formation. Plusieurs raisons expliquèrent ce changement:<br />
1) <strong>la</strong> création d’un programme national <strong>de</strong> spécialisation rigoureusement agencé dans les<br />
domaines théoriques et pratiques, qui reçut le soutien <strong>de</strong>s principaux <strong>de</strong>rmatologues du<br />
pays; 2) l’ascension spectacu<strong>la</strong>ire du statut scientifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie parmi les spécialités<br />
médicales, du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> pénétration marquante <strong>de</strong>s sciences basiques (<strong>la</strong> génétique, <strong>la</strong><br />
biochimie, l’immunologie, <strong>la</strong> physiologie) dans <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> ses pathologies;<br />
3) le progrès significatif <strong>de</strong> traitements efficaces (antibiotiques, corticostéroï<strong>de</strong>s); 4) <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tive absence d’urgence en <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> possibilité d’aménager les horaires <strong>de</strong><br />
consultation, attrait spécial pour les femmes mé<strong>de</strong>cins; 5) un revenu économique stable<br />
grâce aux consultations privées, 6) l’attrait considérable, dans les <strong>de</strong>rnières cinq années, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmato-cosmétique. Les conséquences furent les suivantes: <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie fait<br />
partie <strong>de</strong>s cinq spécialités préférées <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins récemment diplômés possédant les<br />
meilleures qualifications; une nette réduction du manque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues dans le pays; et<br />
une amélioration nette du soin <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong>s patients <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes.<br />
Cependant, le grave problème d’une distribution inégale <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues persiste :<br />
notre pays est si vaste que certains endroits manquent toujours <strong>de</strong> spécialistes. Plusieurs<br />
raisons contribuent à cette inégalité : non seulement <strong>la</strong> préférence naturelle pour <strong>la</strong> qualité<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s centres urbains (notamment Santiago) et <strong>la</strong> qualité du progrès professionnel<br />
dans les grands hôpitaux, mais aussi l’insuffisance <strong>de</strong> moyens du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santé et <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé régionaux. Cette situation les empêche <strong>de</strong> stimuler économiquement<br />
les diplômés pour leur offrir une formation dans <strong>la</strong> spécialité ou pour favoriser<br />
leur accès à <strong>de</strong>s ressources matérielles et humaines afin <strong>de</strong> soigner les patients<br />
et mener <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> prévention.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie chilienne en tant que jeune spécialité,<br />
à prédominance féminine<br />
Un écart considérable entre les générations se produisit au Chili vers 1970: d’un côté, <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rmatologues âgés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ans; <strong>de</strong> l’autre, un début timi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s jeunes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong><br />
171
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
172<br />
30 ans; entre les <strong>de</strong>ux, <strong>de</strong>s professionnels peu nombreux. Du fait <strong>de</strong> l’augmentation récente<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> jeunes <strong>de</strong>rmatologues et du départ à <strong>la</strong> retraite ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort <strong>de</strong>s anciens,<br />
<strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues sont actuellement âgés <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 50 ans, ce qui représente<br />
un potentiel capital pour le progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne.<br />
Par ailleurs, tandis qu’avant 1960 il n’y avait pas <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> sexe féminin, <strong>de</strong><br />
nos jours une nette majorité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues sont <strong>de</strong>s femmes, non seulement parce<br />
qu’elles ont <strong>de</strong> meilleures qualifications que les hommes dans les étu<strong>de</strong>s supérieures, ce<br />
qui leur permet d’accé<strong>de</strong>r aux bourses/résidanat (plusieurs femmes furent les meilleures<br />
élèves <strong>de</strong> leurs écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine respectives), mais encore parce que, comme nous<br />
l’avons déjà dit, l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité est très compatible avec les responsabilités familiales.<br />
Plusieurs femmes se distinguèrent dans différents domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et dans <strong>de</strong>s rôles <strong>de</strong> direction : quatre <strong>de</strong>s six <strong>de</strong>rniers prési<strong>de</strong>nts, six <strong>de</strong>s sept <strong>de</strong>rniers<br />
vice-prési<strong>de</strong>nts et les huit <strong>de</strong>rniers secrétaires généraux <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV sont <strong>de</strong>s femmes.<br />
La légitimation approximative <strong>de</strong>s spécialistes dans un passé proche<br />
Le manque <strong>de</strong> normes juridiques, définissant les spécialités médicales et leur exercice,<br />
est commun aux pays sud-américains, et il en est certainement <strong>de</strong> même pour le<br />
Chili. N’importe quel mé<strong>de</strong>cin peut s’attribuer une spécialité, même s’il <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> plus<br />
en plus difficile <strong>de</strong> <strong>la</strong> soutenir face à ses pairs, aux patients et à <strong>la</strong> communauté. De nos<br />
jours, les droits <strong>de</strong>s patients et certaines raisons juridiques (poursuites pour mauvaise<br />
pratique, <strong>de</strong>s erreurs, entre autres) justifient et nécessitent une formation consistante et<br />
soli<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Étant donné le manque <strong>de</strong> spécialisation à travers les bourses ou le résidanat jusqu’en<br />
1966, et l’inexistence d’un système national <strong>de</strong> certification fiable jusqu’en 1991,<br />
<strong>la</strong> qualification d’un mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue compétent fut essentiellement estimative et<br />
informelle. Son affiliation précé<strong>de</strong>nte — payée ou pas — à un service ou une unité <strong>de</strong>rmatologique<br />
dans un hôpital public ou universitaire, par un système appelé au Chili « entraînement<br />
à <strong>la</strong> pratique », intervenait jusqu’à présent dans sa légitimation. En fait, tous<br />
les professionnels qui avaient travaillé pendant plusieurs années au sein <strong>de</strong>s unités <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s grands centres hospitaliers furent acceptés en tant que <strong>de</strong>rmatologues<br />
qualifiés (hôpitaux San Luis, San Vicente <strong>de</strong> Paul — appelé plus tard José Joaquín<br />
Aguirre —, San Juan <strong>de</strong> Dios, Barros Luco, Régional <strong>de</strong> Concepción et autres) ; plus encore<br />
si ces hôpitaux étaient associés à l’enseignement médical. Néanmoins, dans certains<br />
cas, <strong>la</strong> durée <strong>de</strong>s passages dans les centres <strong>de</strong>rmatologiques était très courte (entre un<br />
et six mois) ; dans d’autres cas (plus rares), seules <strong>de</strong>s visites occasionnelles dans les<br />
centres avaient eu lieu. Comme nous l’avons déjà dit, quelques mé<strong>de</strong>cins obtinrent leur<br />
autolégitimation grâce aux soins prodigués aux patients atteints d’affections <strong>de</strong>rmatologiques<br />
ou <strong>de</strong> MST dans les provinces ou certains quartiers métropolitains.<br />
L’accréditation formelle en tant que spécialiste dans le passé immédiat<br />
Plusieurs pas directs et indirects furent faits en faveur <strong>de</strong> l’accréditation au Chili d’un<br />
mé<strong>de</strong>cin en tant que spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie. Le premier fut <strong>la</strong> fondation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-syphiligraphie (SCDS), qui changea son nom en<br />
1938 pour celui <strong>de</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie (SCDV). Ses associés<br />
furent alors naturellement légitimés auprès <strong>de</strong> leurs pairs et <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société médicale <strong>de</strong> Santiago, dont <strong>la</strong> SCDS était une filiale au moment <strong>de</strong> sa naissance.<br />
Cependant, le reste <strong>de</strong>s institutions et <strong>la</strong> communauté nationale considérèrent cette affiliation<br />
comme étant une estimation consensuelle (ne suivant aucune norme) du métier<br />
<strong>de</strong> spécialiste. Nous ignorons les conditions requises pour <strong>de</strong>venir membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDS<br />
(plus tard SCDV) pendant sa première phase historique (1938-1980) (cf. infra).
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
Le <strong>de</strong>uxième pas consista dans <strong>la</strong> mise en route du programme <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> spécialiste<br />
en <strong>de</strong>rmatologie octroyé par l’UCH dès 1966. Jusqu’en 1990, seul une minorité<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues exerçant au Chili avaient obtenu leur diplôme par ce programme ;<br />
néanmoins, leur nombre augmenta <strong>de</strong> façon significative pendant les <strong>de</strong>rnières années.<br />
Le troisième pas fut fait par <strong>la</strong> SCDV : moyennant un travail intensif face à l’absence<br />
<strong>de</strong> registres <strong>de</strong>s membres affiliés à <strong>la</strong> société <strong>de</strong>puis sa fondation, elle entreprit en 1986<br />
une révision rigoureuse <strong>de</strong>s antécé<strong>de</strong>nts, conformément aux statuts <strong>de</strong> 1985, afin <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r<br />
à <strong>la</strong> validation <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins en tant que <strong>de</strong>rmatologues et membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV<br />
par là même ; cette tâche fut achevée en novembre 1987, et une liste officielle <strong>de</strong><br />
130 membres titu<strong>la</strong>ires, qui se reconnurent ainsi formellement comme pairs, fut établie.<br />
Le quatrième pas se produisit en 1988 : <strong>la</strong> Corporation nationale d’accréditation <strong>de</strong><br />
spécialités médicales (CONACEM) — une corporation autonome <strong>de</strong> droit privé formée par<br />
le Collège médical du Chili, les différentes sociétés <strong>de</strong> spécialités médicales chiliennes et<br />
l’Association <strong>de</strong> facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du Chili (ASOFAMECH) — invita <strong>la</strong> SCDV à entamer<br />
un processus formel d’accréditation <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins en <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie, basé<br />
sur les règles générales <strong>de</strong> <strong>la</strong> CONACEM, rejoignant ainsi d’autres sociétés médicales qui<br />
avaient déjà entrepris cette accréditation. Une commission spécifique <strong>de</strong> cinq membres<br />
fut constituée à cette fin : Rubén Guarda (prési<strong>de</strong>nt désigné par <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> CONA-<br />
CEM), Juan Honeyman et Daniel Vil<strong>la</strong>lobos (désignés par l’ASOFAMECH) et Manuel Melis<br />
et Julia Oroz (désignés par <strong>la</strong> SCDV).<br />
Après plusieurs propositions et modifications, <strong>la</strong> commission et <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> CO-<br />
NACEM se mirent d’accord en 1990 sur le document final <strong>de</strong>s conditions requises pour<br />
l’accréditation en <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie. Les principaux problèmes du travail <strong>de</strong><br />
cette commission furent les suivants : 1) une formu<strong>la</strong>tion limitée et régulière <strong>de</strong> spécialistes<br />
adaptée à <strong>la</strong> réalité nationale ; 2) l’incorporation du mot vénéréologie à <strong>la</strong> spécialité<br />
(étant donné que <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins d’autres spécialités traitaient <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong><br />
MST) ; 3) <strong>la</strong> qualification <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> vénéréologie en tant que spécialités primaires<br />
; 4) <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> conditions requises permettant l’accréditation <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
ayant prouvé un exercice long et <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité (surtout dans les provinces)<br />
mais manquant, et empêchant en même temps l’accréditation imméritée <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
sans préparation suffisante.<br />
En résumé, <strong>la</strong> commission détermina que pourraient être accrédités : 1) les professeurs<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine réputées ; 2) les diplômés <strong>de</strong>s<br />
programmes officiels <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie <strong>de</strong>s facultés<br />
accréditées ; 3) les mé<strong>de</strong>cins ayant pratiqué pendant cinq ans dans <strong>de</strong>s centres<br />
<strong>de</strong>rmatologiques chiliens respectant les conditions requises stipulées ; 4) les mé<strong>de</strong>cins<br />
formés dans <strong>la</strong> spécialité au sein <strong>de</strong> facultés étrangères avec <strong>de</strong>s programmes<br />
semb<strong>la</strong>bles à ceux <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine chiliennes. Les mé<strong>de</strong>cins qualifiés<br />
pour ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers groupes <strong>de</strong>vaient passer un examen pratique <strong>de</strong> cinq jours ;<br />
en 2002 s’y ajouta un examen théorique, sorte <strong>de</strong> préqualification à l’examen pratique.<br />
Le processus <strong>de</strong> certification <strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie débuta<br />
en 1991 et il est toujours en vigueur. L’organisme technique appelé commission <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et vénéréologie analyse les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins envoyées par <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> CONACEM. Cette commission est composée <strong>de</strong> cinq membres : le prési<strong>de</strong>nt est désigné<br />
par <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> CONACEM, <strong>de</strong>ux membres sont désignés par <strong>la</strong> SCDV et les<br />
<strong>de</strong>ux autres par l’ASOFAMECH. Trois <strong>de</strong>rmatologues ont intégré cette commission dès sa<br />
création : Rubén Guarda (prési<strong>de</strong>nt), Manuel Melis (SCDV) et Juan Honeyman (ASOFA-<br />
MECH). Les <strong>de</strong>ux autres membres furent Julia Oroz et Félix Fich (SCDV), Daniel Vil<strong>la</strong>lobos,<br />
Mirtha Cifuentes et María Luisa Pérez-Cotapos (ASOFAMECH). Jusqu’en<br />
septembre 2004, 179 mé<strong>de</strong>cins furent accrédités comme spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie et<br />
vénéréologie par cette commission.<br />
173
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
Le manque <strong>de</strong> loi sur les spécialités médicales au Chili fait <strong>de</strong> l’accréditation <strong>de</strong> <strong>la</strong> CO-<br />
NACEM <strong>la</strong> seule instance légitime auprès <strong>de</strong>s institutions privées <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, <strong>de</strong>s universités<br />
et <strong>de</strong>s associations médicales syndicales et scientifiques. Il n’y a que le ministère <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Santé qui renâcle à légitimer ces accréditations et à les exiger lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> nomination <strong>de</strong>s<br />
spécialistes pour les postes <strong>de</strong>s hôpitaux publics; ceci est essentiellement dû à une politique<br />
imprévisible, qui vise à retenir <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> nomination <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins pour <strong>de</strong>s<br />
raisons qui ne sont pas strictement techniques. Ainsi, <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> spécialistes<br />
n’est pas tout à fait complète au Chili et elle ne constituera un outil vraiment efficace que<br />
lorsque toutes les institutions nationales s’accor<strong>de</strong>ront sur un processus unique.<br />
■ L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> au <strong>de</strong>rmatologie Chili<br />
au Chili<br />
174<br />
Introduction<br />
L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique se limita jusqu’en 1966 à l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> discipline<br />
aux élèves <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et à l’enseignement <strong>de</strong><br />
certains thèmes liés à l’hygiène sociale aux élèves <strong>de</strong>s autres écoles. Nous ne possédons<br />
pas d’information <strong>de</strong> source sûre (dates ou circonstances) sur le début <strong>de</strong> l’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme discipline isolée au cours <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures. Traditionnellement,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut considérée au Chili comme une discipline subordonnée et<br />
moins importante dans le curriculum général <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s. À présent les élèves ne disposent<br />
que <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux semaines à temps complet pour <strong>de</strong>s activités pratiques et le cours théorique,<br />
ce qui est jugé insuffisant du fait <strong>de</strong> l’impact et <strong>de</strong> <strong>la</strong> prévalence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatoses<br />
dans <strong>la</strong> pratique quotidienne <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins généralistes et <strong>de</strong>s pédiatres.<br />
Cette contribution ne s’étendra pas sur <strong>la</strong> vie et l’apport <strong>de</strong>s professeurs les plus renommés<br />
du Chili (sauf quelques exceptions), ni sur <strong>la</strong> mention <strong>de</strong> tous les <strong>de</strong>rmatologues<br />
qui travaillèrent dans les services et les chaires liés à l’enseignement supérieur et <strong>de</strong> spécialisation.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures à Santiago<br />
L’UCH fut pionnière et seule responsable <strong>de</strong> cet enseignement jusqu’en 1983. Les débuts<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans le programme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université sont aussi méconnus<br />
que ses premiers professeurs. La première appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> discipline fut « Peau<br />
et syphiligraphie » et son premier professeur Mamerto Cádiz, mé<strong>de</strong>cin épidémiologiste ;<br />
cependant on ignore le poste qu’il occupait, son lieu <strong>de</strong> travail ainsi que ses références<br />
personnelles. À l’origine, les cours se faisaient exclusivement à l’hôpital San Luis jusqu’à<br />
<strong>la</strong> création d’une autre chaire à l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul. Luis Puyó Medina, formé<br />
à Paris, fonda – semble-t-il – <strong>la</strong> première chaire formelle et fournit à l’enseignement<br />
l’empreinte <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie française qui prédominait dans les pays d’Amérique du<br />
Sud pendant <strong>la</strong> première moitié du XX e siècle ; toutefois nous ne possédons pas <strong>de</strong> renseignements<br />
sûrs sur l’endroit où travail<strong>la</strong>it le Dr Puyó ni sur sa pério<strong>de</strong> d’enseignement.<br />
Par ailleurs, nous ignorons <strong>la</strong> date <strong>de</strong> création <strong>de</strong>s gra<strong>de</strong>s <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire et <strong>de</strong><br />
professeur extraordinaire en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Même si nous savons que pendant <strong>la</strong> première moitié du XX e siècle il existait <strong>de</strong>ux<br />
chaires d’étu<strong>de</strong>s supérieures (hôpitaux San Luis et San Vicente <strong>de</strong> Paul), avec leurs professeurs<br />
respectifs ou les titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s chaires, nous ignorons l’importance <strong>de</strong> ces<br />
chaires en termes <strong>de</strong> nombre d’élèves, <strong>de</strong> budget ou <strong>de</strong> nombre d’enseignants. En 1938<br />
coexistaient un professeur titu<strong>la</strong>ire (Luis Prunés Risetti) et un professeur extraordinaire<br />
(Roberto Jaramillo Bruce), tous <strong>de</strong>ux professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne et<br />
rivaux.
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
En 1938 coexistaient un professeur titu<strong>la</strong>ire (Luis Prunéo Risetti) et un professeur<br />
extra (Roberto Jaramillo Bruce), tous <strong>de</strong>ux grands professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
et rivaux. Apparemment ces postes étaient attribués sur concours et cours magistraux.<br />
A une date non précisée, il fut établi que le professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>vait travailler<br />
à l’Hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul, tandis que les autres professeurs pouvaient travailler<br />
dans n’importe lequel <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux hôpitaux.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures dans les hôpitaux San Vicente <strong>de</strong> Paul<br />
et José Joaquín Aguirre<br />
L’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul, situé au nord <strong>de</strong> Santiago, fut le siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> première<br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie autonome du pays au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UCH. Luis<br />
Montero Rivera fut titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> cette chaire entre 1914 et 1938, tandis que Luis Prunés Risetti<br />
lui succéda entre 1938 et 1954. On ignore tout du Dr Montero. Le Dr Prunés (1883-<br />
1970) se forma pendant trois ans à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> Paris après <strong>la</strong> Première Guerre<br />
mondiale, aux côtés <strong>de</strong>s Prs Darier, Brocq, Civatte et Sabouraud. À son retour au Chili, il<br />
fut admis dans les années 20 à l’hôpital San Luis <strong>de</strong> Santiago; c’est là qu’il atteignit le<br />
gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section B et <strong>de</strong> professeur extraordinaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en<br />
1938, quand il fut désigné chef et professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique universitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis <strong>de</strong> l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul. Cette clinique disposait <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
salles avec trente lits chacune (hommes et femmes), ainsi qu’un cabinet externe.<br />
On gar<strong>de</strong> le souvenir du Dr Prunés en tant que figure illustre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
; il fut, avec Roberto Jaramillo, à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmato-syphiligraphie (1938), dont il fut le premier prési<strong>de</strong>nt ; il introduisit au Chili les<br />
métho<strong>de</strong>s diagnostiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis (ultramicroscopie et sérologie) et l’emploi d’arsenicaux<br />
pour son traitement ; il préconisa également l’importance diagnostique <strong>de</strong> <strong>la</strong> biopsie<br />
cutanée. Il fut un humaniste/moraliste <strong>de</strong> haut rang et un éducateur admiré. Il fut<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago et ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé <strong>de</strong> <strong>la</strong> République,<br />
travail<strong>la</strong>nt remarquablement pour l’hygiène sociale et le contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles. Il décéda en 1970.<br />
À <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul en 1952, <strong>la</strong> clinique universitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis fut transférée dans le nouvel hôpital José Joaquín Aguirre <strong>de</strong> l’UCH; elle <strong>de</strong>vint<br />
ensuite le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, toujours en vigueur. Suite à <strong>la</strong> retraite du Dr Prunés<br />
(1954), <strong>de</strong>ux nouveaux professeurs titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie furent nommés, tous <strong>de</strong>ux provenant<br />
<strong>de</strong> l’hôpital San Luis: Florencio Prats González fut affecté à l’hôpital Aguirre et Mauricio<br />
Weinstein Rudoy à <strong>la</strong> nouvelle chaire créée à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios. Le Dr Prats<br />
(décédé en 1960) avait été chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section B et professeur extraordinaire à l’hôpital San<br />
Luis. Quelques mois avant sa mort, il publia le premier ouvrage chilien sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> plusieurs auteurs; bien que <strong>de</strong>stiné aux étu<strong>de</strong>s supérieures, cet ouvrage<br />
s’avéra plutôt un livre <strong>de</strong> consultation pour les <strong>de</strong>rmatologues et les mé<strong>de</strong>cins généralistes,<br />
en raison <strong>de</strong> son envergure. La liste <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues réputés enseignant dans les<br />
hôpitaux San Vicente <strong>de</strong> Paul et Aguirre jusqu’en 1970 est composée <strong>de</strong> Roger Lamas, d’Ignacio<br />
González Díaz, d’Eugenio Robles, <strong>de</strong> Mauricio Weinstein, <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>rico Pescetto, d’Oscar<br />
Klein, <strong>de</strong> Raúl A<strong>la</strong>rcón et <strong>de</strong> Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra. La chaire <strong>de</strong> l’hôpital Aguirre (région<br />
nord) comptait presque toujours neuf mé<strong>de</strong>cins permanents jusqu’en 1970.<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 60-70 l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UCH fut réparti en<br />
cinq sièges situés à Santiago : zone nord, orientale, centrale, sud et occi<strong>de</strong>ntale ; <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était indépendante <strong>de</strong> chaque siège. Nous citerons ci-<strong>de</strong>ssous les principaux<br />
titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> ces chaires.<br />
Hernán Hevia Parga remp<strong>la</strong>ça le Dr Prats au poste <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire entre 1961<br />
et 1969. Au départ, le Dr Hevia (1914-1997) travail<strong>la</strong> comme <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital<br />
San Vicente <strong>de</strong> Paul, où il avait été nommé professeur extraordinaire en 1951. Il est<br />
175
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
176<br />
unanimement considéré comme <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> figure <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong>rmatologique chilien<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle. Il ne fut pas très prolifique en articles scientifiques<br />
cliniques ou <strong>de</strong> recherche (il écrivit surtout sur <strong>la</strong> syphilis), mais ce fut le prototype<br />
<strong>de</strong> l’éminent professeur et il se distingua jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> sa carrière par son dévouement<br />
envers les patients <strong>de</strong>s hôpitaux publics et ses élèves. Lecteur in<strong>la</strong>ssable <strong>de</strong>s revues<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mondiale, l’idée que <strong>la</strong> lecture est <strong>la</strong> meilleure métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise à jour<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour les générations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins du Chili ; il fut un généraliste remarquable<br />
qui présentait <strong>de</strong>s diagnostics différentiels graves, un expert en histopathologie<br />
cutanée, un bon conseiller et celui qui stimu<strong>la</strong>it les jeunes mé<strong>de</strong>cins. Il fut toujours<br />
très attaché à l’enseignement : en tant que professeur, au milieu <strong>de</strong>s couloirs, lors <strong>de</strong>s<br />
consultations et <strong>de</strong>s réunions cliniques, à travers ses écrits personnels pour chaque sujet<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’époque, <strong>de</strong>stinés à faciliter <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
élèves. Cependant, il ne supportait pas le <strong>la</strong>isser-aller <strong>de</strong>s étudiants ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
qui enseignaient. Après sa retraite en 1969, il continua à travailler et à enseigner<br />
à l’hôpital Aguirre jusqu’à sa mort en 1997, à 83 ans, alors qu’il se rendait à <strong>la</strong> réunion<br />
clinique du mardi dans cet hôpital. En 1988, il fut désigné membre honoraire post mortem<br />
<strong>de</strong> l’Académie chilienne <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’institut du Chili pour son apport remarquable<br />
à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine du pays.<br />
Oscar Klein Kohn occupa entre 1969 et 1971 le poste <strong>la</strong>issé par le Dr Hevia Parga. Ce<br />
fut un grand professeur clinique et un lea<strong>de</strong>r syndical enthousiaste (il fut même vice-prési<strong>de</strong>nt<br />
du Collège médical du Chili).<br />
Entre 1971 et 1973, le poste <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire fut occupé par Marco Antonio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra Enríquez, <strong>de</strong>rmatologue et microbiologiste, qui se consacra à organiser<br />
l’enseignement <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures. Suite au coup d’État militaire du 11 septembre<br />
1973 et pour <strong>de</strong>s raisons politiques, il fut injustement privé <strong>de</strong> son poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> service<br />
par l’intervention militaire <strong>de</strong> l’hôpital Aguirre (bien qu’il fût plus tard réintégré<br />
dans le même service, avec d’autres fonctions). Quelques jours après cet événement,<br />
Juan Honeyman Mauro fut désigné chef intérimaire du service, confirmé plus tard dans<br />
ses fonctions et nommé professeur titu<strong>la</strong>ire en 1975, fonction qu’il exerce encore aujourd’hui.<br />
Les réformes structurelles universitaires motivèrent <strong>la</strong> création en 1991 du département<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UCH afin <strong>de</strong> centraliser l‘enseignement<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie dans les hôpitaux <strong>de</strong><br />
Santiago associés à cette université ; les fonctions d’assistance du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Aguirre furent donc dissociées. Le Dr Honeyman fut alors nommé directeur<br />
dudit département, tandis que María Elsa Maira fut désignée chef <strong>de</strong> service (tous<br />
<strong>de</strong>ux occupant actuellement ces postes). Outre son intérêt rare envers l’enseignement<br />
personnel et direct auprès <strong>de</strong>s élèves, le Dr Honeyman détient un rôle très important au<br />
sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures furent coordonnées par Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra et Raquel<br />
Nahuel jusqu’en 1983, par María Elsa Maira <strong>de</strong>puis 1983 et par Rodrigo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra <strong>de</strong>puis<br />
1987. La liste <strong>de</strong>s grands <strong>de</strong>rmatologues qui enseignèrent à partir <strong>de</strong> 1970 – pour<br />
les étu<strong>de</strong>s supérieures aussi bien que pour <strong>la</strong> spécialisation – comprend également les<br />
Prs René Wolf, Raquel Nahuel, Ana María Cabezas, Gonzalo Eguiguren, Rubén Guarda,<br />
Leonardo Sánchez, María Teresa Molina, Tirza Saavedra, Pi<strong>la</strong>r Valdés, Iván Jara, Raúl<br />
Cabrera, Walter Gübelin, Emilia Zegpi, Hilda Rojas et Orietta Gómez.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures dans les hôpitaux San Luis et <strong>de</strong>l Salvador<br />
L’hôpital San Luis, situé dans <strong>la</strong> zone orientale <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santiago, entreprit au<br />
cours du passage du XIX e au XX e siècle ses activités <strong>de</strong> soin <strong>de</strong>s patients <strong>de</strong> tout le pays<br />
atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées et vénériennes ; avec le temps, il reçut également les
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
patients chroniques présentant <strong>de</strong>s ulcères <strong>de</strong> toute origine (<strong>de</strong> préférence les ulcères<br />
vascu<strong>la</strong>ires), <strong>de</strong>s brûlures importantes avec séquelles, <strong>de</strong>s paraplégies et d’autres pathologies<br />
non cutanées. Vers 1950, on comptait environ autour <strong>de</strong> 300 patients hospitalisés,<br />
plus <strong>de</strong> 100 patients soignés par jour en unité ambu<strong>la</strong>toire et une équipe <strong>de</strong> dix à<br />
quinze mé<strong>de</strong>cins. L’hôpital possédait <strong>de</strong>ux sections (A et B), chacune ayant un chef<br />
propre et une équipe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues. Plusieurs mé<strong>de</strong>cins formés à l’hôpital San Luis<br />
occupèrent <strong>de</strong>s postes ou <strong>de</strong>s chaires à l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul et vice-versa. C’est<br />
à l’hôpital San Luis que furent dispensées les premières étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
au Chili (ad honorem). La chaire était à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> l’un ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux chefs <strong>de</strong> section,<br />
qui pouvaient avoir le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> professeur octroyé par l’UCH ou pas. Nous ignorons<br />
<strong>la</strong> liste complète <strong>de</strong>s chefs ou <strong>de</strong>s personnes titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, mais nous savons<br />
qu’elle inclut Mamerto Cádiz, Luis Puyó, Roberto Jaramillo, Florencio Prats, Gastón<br />
Ramírez et Raúl A<strong>la</strong>rcón. Parmi eux, Roberto Jaramillo (chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section A), Florencio<br />
Prats (chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section B) et Gastón Ramírez furent professeurs extraordinaires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’UCH.<br />
Le Dr Jaramillo (1884-1951) fut l’une <strong>de</strong>s figures les plus notables <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
chilienne entre 1935 et 1950 ; il se forma en Europe, à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> Paris,<br />
parmi d’autres institutions qu’il fréquenta, dans les années qui précédèrent <strong>la</strong> Première<br />
Guerre mondiale. Il fut un ennemi déc<strong>la</strong>ré du dogmatisme scientifique et le pionnier <strong>de</strong><br />
l’histopathologie au Chili, <strong>de</strong> l’envergure <strong>de</strong>s pathologistes européens célèbres du début<br />
du XX e siècle. Suivant son conseil, le <strong>la</strong>boratoire d’histopathologie fut installé à l’hôpital<br />
San Luis. En 1951, <strong>la</strong> chaire qu’il occupait fut reprise par Gastón Ramírez, jusqu’en<br />
1968.<br />
Le Dr Ramírez (1904-1996) se forma à l’hôpital San Luis d’abord et à l’hôpital San Vicente<br />
<strong>de</strong> Paul par <strong>la</strong> suite, où il obtint le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> professeur extraordinaire en 1947 ; en<br />
1954, il regagna l’hôpital San Luis.<br />
Au sein du <strong>la</strong>boratoire d’histopathologie, le Dr Jaramillo fut tout d’abord remp<strong>la</strong>cé par<br />
un bril<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>rmato-pathologiste, Luis Toro Genkel, et ensuite par Raúl A<strong>la</strong>rcón Casanueva.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier obtint par concours le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> l’hôpital San Luis en 1969; au<br />
cours <strong>de</strong> son mandat, lorsque l’hôpital San Luis cessa ses activités en 1978, le service et <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie furent transférés à l’hôpital <strong>de</strong>l Salvador. Pendant cette pério<strong>de</strong>,<br />
A<strong>de</strong><strong>la</strong>ida Tolic et Fernando Oyarzún se distinguèrent également dans l’enseignement.<br />
Carlos Vera Mora fut désigné chef <strong>de</strong> service en 1982, suite au départ à <strong>la</strong> retraite du<br />
Dr A<strong>la</strong>rcón. Il désigna tout <strong>de</strong> suite Ximena Raggio pour prendre en charge l’enseignement,<br />
qui s’en occupa jusqu’en 1998, suivie par Enrique Mullins (actuellement en fonction).<br />
C’est ainsi que le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>l Salvador (l’héritier <strong>de</strong><br />
l’hôpital San Luis) est le plus ancien du pays en termes d’enseignement au niveau <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s supérieures et d’assistance aux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologiques et vénériens.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures dans les hôpitaux <strong>de</strong>s zones centrale<br />
et occi<strong>de</strong>ntale <strong>de</strong> Santiago associés à l’université du Chili<br />
Le Dr Hernán Hevia fut chargé <strong>de</strong>s premiers cours d’étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
au sein <strong>de</strong> l’hôpital San Borja (zone centrale), dans les années 50, tandis que le<br />
Dr Florencio Prats enseignait à l’hôpital Aguirre. Lorsque le Dr Hevia assuma le poste <strong>de</strong><br />
professeur titu<strong>la</strong>ire dans ce <strong>de</strong>rnier (1960), <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> l’hôpital San Borja fut interrompue.<br />
L’enseignement fut réinstauré en 1972, à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, et se maintint<br />
jusqu’à sa retraite, en 1990, date à <strong>la</strong>quelle il disparut <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone.<br />
Quant à <strong>la</strong> zone sud, l’UCH désigna Ignacio González Díaz comme premier chargé <strong>de</strong><br />
l’enseignement dans les hôpitaux Barros Luco et Tru<strong>de</strong>au (<strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 50<br />
jusqu’à 1972), suivi <strong>de</strong> Jaime Ruiz (1972-1996), Alfredo Car<strong>de</strong>mil (1996-2002) et Héctor<br />
Fuenzalida (à partir <strong>de</strong> 2003).<br />
177
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
178<br />
L’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios (zone occi<strong>de</strong>ntale), associé à l’UCH, accueillit entre 1954<br />
et 1970 Mauricio Weinstein, qui avait débuté à l’hôpital San Luis, rejoignant ensuite l’hôpital<br />
San Vicente <strong>de</strong> Paul, en qualité <strong>de</strong> premier professeur extraordinaire. Pasmanik lui<br />
succéda <strong>de</strong> 1970 jusqu’à sa retraite en 1990. Depuis, cet hôpital n’eut pas <strong>de</strong> professeurs<br />
accrédités, mais <strong>de</strong>s titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures tels que María Isabel<br />
Benavi<strong>de</strong>s (1982-1993), María Isabel Herane (1993-1998) et Emilio Sudy (<strong>de</strong>puis 1999).<br />
Parmi les enseignants <strong>de</strong>rmatologues remarquables, nous pouvons également citer<br />
Ximena Ancic, Ximena Moncada et Francisco Urbina.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures à <strong>la</strong> Pontificia Universidad Católica <strong>de</strong> Chile<br />
À partir <strong>de</strong> l’incorporation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au programme <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
(à une date inconnue), <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC à Santiago délégua son enseignement<br />
à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul (plus tard hôpital Aguirre <strong>de</strong> l’UCH),<br />
et ce jusqu’en 1989.<br />
En mars 1954, <strong>la</strong> PUC créa <strong>la</strong> chaire formelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; le Dr Hernán Hevia<br />
Parga, qui travail<strong>la</strong>it déjà à l’hôpital Aguirre, fut nommé professeur. Vers 1975, <strong>la</strong> PUC<br />
forma un petit groupe d’enseignants associé à l’hôpital Aguirre pour dispenser les cours<br />
aux élèves et aux internes en col<strong>la</strong>boration avec le Dr Hevia ; ce groupe fut intégré par<br />
les Drs Honeyman, Eguiguren et Guarda.<br />
En 1980, le Dr Hevia fut nommé premier professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC.<br />
Ayant pris sa retraite en 1983, <strong>la</strong> chaire passa entre les mains <strong>de</strong> Juan Honeyman Mauro, désigné<br />
professeur titu<strong>la</strong>ire en 1990. En 1983, <strong>la</strong> PUC créa l’unité d’enseignement associée <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, dont le siège autonome se trouve au cabinet externe du campus universitaire<br />
sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC et qui compte un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues propres. À l’origine, cette unité ne<br />
remplissait que <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> soutien; le Dr Mirtha Cifuentes fut <strong>la</strong> première <strong>de</strong>rmatologue<br />
à y être recrutée. Plus tard, l’enseignement pour les élèves <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures fut envisagé.<br />
Parmi les enseignants <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC nous citerons également María Luisa Pérez-Cotapos,<br />
Montserrat Molgó, María Soledad Zegpi, Rosamary Soto, Ariel Hasson et Sergio Silva, entre<br />
autres. Depuis 2000, le Dr Pérez-Cotapos est le chef du service et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC.<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures dans les universités <strong>de</strong> province<br />
Nous allons mentionner ici uniquement les facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s provinces appartenant<br />
à l’ASOFAMECH. Raúl Puga fut le premier mé<strong>de</strong>cin lié à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’université <strong>de</strong> Concepción ; il s’occupa <strong>de</strong> l’assistance et, semble-t-il, col<strong>la</strong>bora également<br />
à l’enseignement, mais nous ne possédons pas <strong>de</strong> données supplémentaires.<br />
Vers 1950, <strong>la</strong> chaire autonome <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut créée, Alberto Brieva Durán étant<br />
nommé son premier professeur et exerçant cette fonction jusqu’en 1964. Il fut remp<strong>la</strong>cé<br />
par Juan González Martin (1964-1972), Ezio Olivari (1972-1987), Lidia Medina (1987-<br />
2003) et Rosario A<strong>la</strong>rcón (à partir <strong>de</strong> 2004).<br />
Jusqu’en 1973, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université australe <strong>de</strong> Valdivia envoyait ses<br />
élèves à Santiago afin qu’ils suivent <strong>de</strong>s cours très brefs en <strong>de</strong>rmatologie et dans d’autres<br />
spécialités médicales ; en 1974 et 1975, elle invita Ignacio González Díaz (<strong>de</strong> l’UCH) à Valdivia<br />
pour <strong>de</strong>s cours sur <strong>de</strong>s pathologies cutanées, d’une durée <strong>de</strong> cinq jours par an.<br />
Entre 1976 et 1979, le premier cours formel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu à Valdivia, avec <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> Daniel Vil<strong>la</strong>lobos (professeur invité et titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire), Manuel Melis et<br />
Félix Fich (col<strong>la</strong>borateurs), <strong>de</strong>rmatologues du complexe hospitalier San Borja-Arriarán<br />
<strong>de</strong> Santiago. Pour leur part, ces <strong>de</strong>rmatologues dispensèrent à Santiago <strong>la</strong> formation en<br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s Drs Isabel Moreno et Mónica Hering afin qu’elles assument plus tard<br />
<strong>de</strong>s responsabilités pédagogiques. En conséquence, <strong>de</strong>puis 1980, le Dr Moreno est titu<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, en col<strong>la</strong>boration avec le Dr Hering <strong>de</strong>puis 1984.
Patricio Rifo est à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> frontière <strong>de</strong> Temuco, <strong>de</strong>puis sa création en 1975 et jusqu’à nos jours. Par ailleurs, à<br />
l’université <strong>de</strong> Valparaíso, le premier titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire fut Ramón Staforelli (1974-<br />
1990), suivi par Jorge Testart (1990-1991) et Antonio Guglielmetti (<strong>de</strong>puis 1992).<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures dans les nouvelles écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong>s universités traditionnelles ou privées<br />
Le premier cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Santiago eut lieu en 1998, les responsables<br />
<strong>de</strong> l’enseignement étant successivement Alfredo Car<strong>de</strong>mil et Héctor Fuenzalida.<br />
De son côté, l’université <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s — <strong>la</strong> première université privée possédant une<br />
école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine — entama les cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1995, avec Walter Gübelin en<br />
qualité <strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire jusqu’à nos jours. À l’université Mayor, le premier<br />
cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu en 1991 ; Lilian Pérez en est <strong>la</strong> responsable. A l’Université<br />
catholique <strong>de</strong> Concepción, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie est une discipline qui n’est jamais dissociée<br />
du cours <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine générale. À l’université San Sebastián <strong>de</strong> Concepción, <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie est enseignée <strong>de</strong>puis 1998, à <strong>la</strong> charge d’Enrique Wageman.<br />
Nous ne citons pas d’autres nouvelles écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du fait qu’elles sont très récentes,<br />
que leur enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en est encore à ses débuts ou qu’il est<br />
difficile d’en obtenir <strong>de</strong>s renseignements.<br />
Textes pour l’enseignement au niveau <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
Jusqu’en 1960, il n’y avait pas <strong>de</strong> manuels <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour les étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
publiés par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues chiliens ; on utilisait alors seulement les éditions<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie française et les textes publiés par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues espagnols ou argentins.<br />
Le texte <strong>de</strong> Jean Darier, réédité plus tard par ses disciples (Jean Civatte entre<br />
autres), fut le référent principal pour les spécialistes. Les élèves utilisaient en général les<br />
notes informelles <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>s années précé<strong>de</strong>ntes ou celles que les professeurs euxmêmes<br />
remettaient en guise d’esquisses ; mais en 1960, Florencio Prats publia un livre<br />
qu’il écrivit avec ses col<strong>la</strong>borateurs <strong>de</strong> l’hôpital Aguirre. Néanmois, ce livre ne put jamais<br />
être un manuel d’usage courant dans les étu<strong>de</strong>s supérieures, son contenu étant plus ambitieux.<br />
Un précis <strong>de</strong> notes <strong>de</strong> cours inédit, écrit par Hernán Hevia et quelques col<strong>la</strong>borateurs,<br />
fut utilisé ensuite pendant longtemps ; ce précis servit <strong>de</strong> base à l’édition en 1990, convenablement<br />
mise à jour, d’un manuel écrit par plusieurs professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> même chaire<br />
et dont les éditeurs furent Juan Honeyman et Raquel Nahuel.<br />
Il existe <strong>de</strong>ux autres textes : le premier édité en 2001 par María Isabel Herane et<br />
Francisco Urbina, l’autre en 2003, par María Luisa Pérez-Cotapos et Ariel Hasson, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
PUC. Ces <strong>de</strong>ux livres représentent un apport grand, mais ils vont au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s dimensions<br />
d’un cours d’étu<strong>de</strong>s supérieures.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité, <strong>de</strong>stiné aux mé<strong>de</strong>cins dans le<br />
but explicite <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s spécialistes, fut, jusqu’aux années 60, informel et irrégulier,<br />
ayant lieu dans les grands centres hospitaliers. En général, <strong>la</strong> formation était acquise<br />
par <strong>la</strong> pratique (rémunérée ou non) <strong>de</strong>s jeunes mé<strong>de</strong>cins au sein <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s<br />
chaires, qui apprenaient <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie par une observation stricte <strong>de</strong>s conduites diagnostiques<br />
et thérapeutiques <strong>de</strong>s professeurs ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues plus expérimentés.<br />
Les <strong>de</strong>rmatologues déjà formés qui étaient liés aux hôpitaux où l’on enseignait, tout<br />
comme ceux qui se consacraient exclusivement aux soins, assumèrent toujours <strong>de</strong> bon<br />
179
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
180<br />
gré <strong>la</strong> responsabilité <strong>de</strong> former ces nouveaux jeunes mé<strong>de</strong>cins qui s’inscrivaient volontairement.<br />
L’offre <strong>de</strong> postes <strong>de</strong> l’UCH pour <strong>de</strong>s bourses <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce en <strong>de</strong>rmatologie (d’une durée<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans), avec remise du diplôme <strong>de</strong> spécialiste, débuta en 1966. Ceci constitua le premier<br />
pas réalisé par une université chilienne pour offrir <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie;<br />
le premier mé<strong>de</strong>cin diplômé fut A<strong>la</strong>n Rojas Cana<strong>la</strong> (1966-1968).<br />
Pendant plusieurs années, aucun élève ne postu<strong>la</strong> aux offres <strong>de</strong> l’UCH, en raison du<br />
manque d’intérêt pour <strong>la</strong> spécialité. Un fait que l’on a déjà évoqué par ailleurs; il y eut tout<br />
<strong>de</strong> même quelques exceptions : Carlos Vera et Fernando Oyarzún s’intéressèrent à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Entre 1966 et 1980, seuls 12 élèves mé<strong>de</strong>cins suivirent le cursus. Les centres<br />
<strong>de</strong> l’UCH <strong>de</strong>stinés à former <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues furent alors les hôpitaux Aguirre, San Juan<br />
<strong>de</strong> Dios et San Luis/<strong>de</strong>l Salvador. Pendant ces quatorze années, <strong>la</strong> formation fut aléatoire,<br />
sans un programme <strong>de</strong> stage défini ni <strong>de</strong> cours théoriques; elle comprenait le soin <strong>de</strong>s patients<br />
aussi bien <strong>de</strong>s cabinets externes (général et MST) que les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hospitalisés, sous<br />
<strong>la</strong> tutelle partielle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues enseignants. Les rési<strong>de</strong>nts en formation se souviennent<br />
notamment durant cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> tuteurs remarquables comme Hernán Hevia,<br />
Roger Lamas, Ignacio González Díaz, Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra, Raúl A<strong>la</strong>rcón, Isidoro<br />
Pasmanik, Daniel Vil<strong>la</strong>lobos et René Wolf.<br />
En 1980, le professeur titu<strong>la</strong>ire Juan Honeyman nomma Rubén Guarda comme coordinateur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation et le chargea <strong>de</strong> revoir le programme <strong>de</strong> formation <strong>de</strong><br />
spécialistes <strong>de</strong> l’UCH. Ce nouveau programme, débutant en avril 1980 et dont le siège<br />
se trouvait à l’hôpital Aguirre, établit : 1) un système obligatoire <strong>de</strong> stages dans tous<br />
les domaines pratiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, comprenant MST, <strong>la</strong>boratoire, histopathologie,<br />
immuno<strong>de</strong>rmatologie et chirurgie, entre autres ; 2) <strong>de</strong>s cours théoriques obligatoires<br />
dans les matières échappant à <strong>la</strong> pratique ordinaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, telles<br />
<strong>la</strong> physiopathologie cutanée (y compris <strong>la</strong> génétique et <strong>la</strong> biochimie), l’immunologie, <strong>la</strong><br />
pharmacologie et <strong>la</strong> thérapeutique, l’histopathologie et <strong>la</strong> chirurgie fondamentale, afin<br />
<strong>de</strong> mettre à jour et d’élever le niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne, jusqu’alors considérée<br />
peu prestigieuse par les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>s autres spécialités ; 3) une évaluation rigoureuse<br />
<strong>de</strong>s activités pratiques et théoriques, avec un examen final obligatoire pour<br />
l’obtention du diplôme ; 4) un système intégrant les meilleurs professeurs <strong>de</strong> Santiago<br />
(quel que soit leur lieu <strong>de</strong> travail) à l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation pour optimaliser<br />
<strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts. Ce programme se vit complété à partir <strong>de</strong> 1983 par<br />
l’incorporation graduelle <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Santiago pour y effectuer les<br />
pratiques.<br />
Dans le but <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>riser cette intégration aussi bien <strong>de</strong> professeurs que <strong>de</strong> services<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Santiago, le Dr Guarda rédigea un nouveau programme d’étu<strong>de</strong>s qui<br />
comprenait les quatre points énoncés ci-<strong>de</strong>ssus et fut approuvé en 1985 au cours d’une<br />
séance solennelle à l’école <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UCH, en <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong>s signataires Isidoro Pasmanik, Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, Juan Honeyman, Carlos<br />
Vera et Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra (en tant que représentants <strong>de</strong> toutes les aires hospitalières<br />
<strong>de</strong> Santiago) et du Dr Guarda et Mauricio Parada, directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite école.<br />
Par conséquent, en peu d’années, <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> manque <strong>de</strong> formation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
s’inversa, <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong>venant l’une <strong>de</strong>s options les plus sollicitées par les jeunes<br />
mé<strong>de</strong>cins. L’admission <strong>de</strong> plusieurs mé<strong>de</strong>cins ayant obtenu les meilleures notes dans les<br />
facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine entraîna une croissance explosive du nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues.<br />
Dans le cas <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> spécialisation déjà mentionnée, le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins inscrits<br />
à <strong>la</strong> formation en <strong>de</strong>rmatologie évolua comme suit : sept mé<strong>de</strong>cins entre 1966 et 1972,<br />
dix mé<strong>de</strong>cins entre 1973 et 1979 et cinquante et un professionnels entre 1980 et 1986,<br />
chiffres qui continuent d’augmenter actuellement.<br />
À partir <strong>de</strong> 1991, l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> l’UCH dépendit du tout récent<br />
département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Depuis 1993, le programme <strong>de</strong>
formation a une durée <strong>de</strong> trois ans (auparavant <strong>de</strong>ux ans) et comprend <strong>de</strong>s matières exclusivement<br />
<strong>de</strong>rmatologiques (mis à part <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine clinique générale). En 2004, vingtcinq<br />
mé<strong>de</strong>cins au total ont bénéficié d’une bourse <strong>de</strong> résidanat à l’UCH au cours <strong>de</strong>s<br />
trois ans <strong>de</strong> formation, <strong>la</strong> quote-part annuelle pour les nouveaux rési<strong>de</strong>nts étant d‘environ<br />
dix p<strong>la</strong>ces. La liste <strong>de</strong>s coordinateurs du programme inclut Rubén Guarda (1980-1986),<br />
María Elsa Maira (1987-2001) et Iván Jara (<strong>de</strong>puis 2001); en ce qui concerne <strong>la</strong> coordination<br />
<strong>de</strong>s cours théoriques et pratiques, nous remarquons l’activité d’Augusto Alvarez Sa<strong>la</strong>manca<br />
(chirurgie); Rubén Guarda, Raúl Cabrera et Iván Jara (immuno<strong>de</strong>rmatologie et<br />
physiopathologie cutanée); Hernán Hevia, Immo Rohmann, María Elsa Maira et Hilda<br />
Rojas (<strong>de</strong>rmato-pathologie); Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, Walter Gübelin et Orietta Gómez (MST);<br />
Juan Honeyman (thérapeutique) ainsi que Rodrigo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra (<strong>la</strong>boratoire), entre autres.<br />
De son côté, <strong>la</strong> PUC octroya en 1972 à Gonzalo Eguiguren <strong>la</strong> première bourse pour le<br />
résidanat en <strong>de</strong>rmatologie. Ces formations offertes par <strong>la</strong> PUC se développèrent au sein<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Aguirre (<strong>de</strong> l’UCH) mais, en 1993, un programme propre à l’université fut entrepris<br />
pour <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie, à <strong>la</strong> base semb<strong>la</strong>ble à celui <strong>de</strong><br />
l’UCH et intégré à celui-ci pour les cours théoriques et quelques stages pratiques. En<br />
2004, on comptait quatre rési<strong>de</strong>nts boursiers pour les trois ans <strong>de</strong> formation.<br />
Jusqu’à présent, seules l’UCH et <strong>la</strong> PUC proposent <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> formation <strong>de</strong><br />
spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie au Chili.<br />
Textes pour l’enseignement au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation<br />
Jusqu’en 1970, les principaux textes <strong>de</strong> référence furent successivement les éditions<br />
<strong>de</strong> Jean Darier et ses disciples, Florencio Prats et al. (1960) ainsi que l’Encyclopédie médico-chirurgicale<br />
française. Depuis lors et jusqu’à nos jours, les principaux textes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie générale sont les éditions successives <strong>de</strong>s livres d’Arthur Rook et al. et<br />
Thomas Fitzpatrick et al.; en ce qui concerne les matières spécialisées, on utilise les éditions<br />
<strong>de</strong> Sydney Hurwitz (<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique), Mark Dahl (immuno<strong>de</strong>rmatologie),<br />
Walter Lever et Bernard Ackerman (<strong>de</strong>rmato-pathologie), entre autres. Ceci révèle un<br />
changement significatif d’influences : <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne, qui s’inspirait <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
française, s’est tournée vers <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie britannique et <strong>américaine</strong>.<br />
■ Compte rendu <strong>de</strong> rendu quelques disciplines <strong>de</strong> quelques <strong>de</strong>rmatologiques disciplines <strong>de</strong>rmatologiques<br />
Dermatologie pédiatrique<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
Jusqu’en 1950, les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>s enfants étaient traités par les pédiatres<br />
et les <strong>de</strong>rmatologues, qui n’exploraient pas davantage leur vaste spectre ni n’y<br />
voyaient un objectif curatif majeur.<br />
Deux mé<strong>de</strong>cins, Ignacio González Díaz (<strong>de</strong>rmatologue) et Pedro Cofré (pédiatre), ouvrirent<br />
les voies au développement et au progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie infantile; à Santiago, ils s’y consacrèrent<br />
dans les hôpitaux pédiatriques Roberto <strong>de</strong>l Río et Calvo Mackenna respectivement.<br />
En 1958, l’UCH chargea le Dr González <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux tâches cruciales : créer <strong>la</strong> chaire<br />
d’étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>rmatologique à l’hôpital Barros Luco (qui entraîna<br />
<strong>la</strong> création du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dudit hôpital), et ouvrir <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’hôpital Roberto <strong>de</strong>l Río, qui appartenait à l’université ; il fut le premier <strong>de</strong>rmatologue<br />
lié à un hôpital pédiatrique chilien. Depuis cette position il contribua non seulement à <strong>la</strong><br />
formation <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nts boursiers en pédiatrie générale et en <strong>de</strong>rmatologie mais aussi à<br />
poser les bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie infantile.<br />
C’est à l’hôpital Roberto <strong>de</strong>l Río que fut créée à une date non précisée (probablement<br />
avant 1960) <strong>la</strong> seule structure dans les hôpitaux chiliens à recevoir l’appel<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
181
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
182<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie infantile (disposant <strong>de</strong> lits et d’un soin externe). Ignacio González,<br />
María Elsa Maira et Julia Oroz se succédèrent à sa tête, jusqu’à sa suppression en 1976.<br />
Á partir <strong>de</strong> 1966 et pendant quelques années, A<strong>la</strong>n Rojas col<strong>la</strong>bora avec le Dr González<br />
dans les tâches <strong>de</strong> soins.<br />
Ayant fini son résidanat en pédiatrie en 1965, Julia Oroz suivit entre 1968 et 1970 <strong>de</strong>s<br />
formations en <strong>de</strong>rmatologie avec le Dr González à l’hôpital <strong>de</strong>l Río ainsi qu’avec le<br />
Dr Hevia à l’hôpital Aguirre. Elle travail<strong>la</strong> un temps à Valdivia et retourna à l’hôpital <strong>de</strong>l<br />
Río en 1973 pour s’y occuper <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie infantile, poste vacant après le départ<br />
à <strong>la</strong> retraite du Dr González (1972). Entre-temps, c’est le pédiatre María Elsa Maira, qui<br />
avait travaillé avec le Dr González entre 1970 et 1972, qui prit en charge <strong>la</strong> consultation.<br />
Depuis son arrivée à l’hôpital, le Dr Oroz est <strong>la</strong> responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation pratique<br />
et théorique en <strong>de</strong>rmatologie infantile <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts boursiers que les universités<br />
chiliennes lui envoient ; elle constitue alors un pilier du développement <strong>de</strong> cette<br />
spécialité grâce à son entrain, sa volonté <strong>de</strong> perfectionnement et sa capacité à stimuler<br />
les nouvelles générations.<br />
Un autre pédiatre, Winston Martínez, vint travailler avec elle <strong>de</strong> 1976 à 1990, complétant<br />
parallèlement sa formation en <strong>de</strong>rmatologie. Le Dr Martínez fut remp<strong>la</strong>cé par<br />
Sergio Silva en 1990. En 1983 fut créé un autre poste pour <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong>rmatologique,<br />
occupé successivement par Gabrie<strong>la</strong> Smoje, Paulina Grandi et Pau<strong>la</strong> Castillo.<br />
L’autre figure centrale <strong>de</strong>s débuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique au Chili fut Pedro<br />
Cofré, un pédiatre <strong>de</strong> l’hôpital Calvo Mackenna (zone orientale), très intéressé à l’idée <strong>de</strong><br />
soigner les enfants présentant <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>rmatologiques. Cet intérêt le poussa à se<br />
former en parallèle en <strong>de</strong>rmatologie, avec son ami et camara<strong>de</strong> Hernán Hevia à l’hôpital<br />
Aguirre (entre 1959 et 1960); plus tard, vers 1961, il travail<strong>la</strong> à plein temps à l’hôpital Calvo<br />
Mackenna dans le <strong>de</strong>uxième cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie d’un hôpital pédiatrique<br />
chilien, jusqu’à sa retraite en 1973 (il y fut le seul <strong>de</strong>rmatologue). Sa fille Julita Cofré le<br />
remp<strong>la</strong>ça pendant plus d’un an, suivie <strong>de</strong> Jaime Ferrer (1976-1981), Mónica Jara (1981-<br />
2000) et Gabrie<strong>la</strong> Smoje (<strong>de</strong>puis 2000).<br />
Manuel Melis fut <strong>la</strong> figure principale <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dans <strong>la</strong> zone centrale. Suite à sa<br />
spécialisation en pédiatrie, il suivit une formation en pratique en <strong>de</strong>rmatologie infantile<br />
avec Ignacio González Díaz et Pedro Cofré (1970-1972) et en <strong>de</strong>rmatologie générale avec<br />
Daniel Vil<strong>la</strong>lobos à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios (1973). En avril 1974, il assuma ses fonctions<br />
au sein <strong>de</strong> l’hôpital pédiatrique Arriarán, dans le complexe hospitalier San Borjaarriarán,<br />
dont le chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut Daniel Vil<strong>la</strong>lobos à partir <strong>de</strong> 1974.<br />
Actuellement, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique constitue au Chili une discipline à <strong>la</strong>quelle<br />
parviennent uniquement les mé<strong>de</strong>cins ayant obtenu le diplôme <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> vénéréologie ; le diplôme <strong>de</strong> pédiatrie, lui n’est pas obligatoire. Elle ne<br />
représente pas une sous-spécialité authentique, avec <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation ad<br />
hoc ; les hôpitaux pédiatriques chiliens n’incluent pas <strong>de</strong> nos jours une structure nommée<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie infantile dans leur organigramme. En 2004, environ<br />
vingt <strong>de</strong>rmatologues se consacrent <strong>de</strong> préférence à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique et une<br />
dizaine exclusivement aux enfants. Ils animent <strong>de</strong>puis 1990, avec une qualité et une<br />
ar<strong>de</strong>ur remarquables, le groupe <strong>de</strong> travail en <strong>de</strong>rmatologie infantile qui organise <strong>de</strong>s<br />
réunions périodiques très réussies, étudie <strong>de</strong>s cas cliniques et abor<strong>de</strong> <strong>de</strong> grands<br />
thèmes très attractifs pour les <strong>de</strong>rmatologues du pays. Ce groupe, créé avec le soutien<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV, connaît beaucoup <strong>de</strong> succès ; María Soledad Zegpi fut chargée pour <strong>la</strong> première<br />
fois <strong>de</strong> sa coordination, suivie par d’autres professionnels.<br />
Julia Oroz, Manuel Melis, Julita Cofré, Mónica Jara, Winston Martínez, Jaime Ferrer,<br />
María Soledad Zegpi, Fanny Guerstein, Sergio Silva, Gabrie<strong>la</strong> Smoje, Paulina Grandi, Lilian<br />
Pérez, Christel Bolte et Pau<strong>la</strong> Castillo sont quelques-uns <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues pédiatriques<br />
réputés dans le pays et à l’étranger.
Immuno<strong>de</strong>rmatologie<br />
L’immuno<strong>de</strong>rmatologie constitue une discipline qui mit <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne à<br />
l’avant-gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sud-<strong>américaine</strong> durant les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières décennies.<br />
Ses principaux promoteurs furent Juan Honeyman et Rubén Guarda ; ils diffusèrent et<br />
enseignèrent l’approche immunologique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques. Iván Jara et<br />
Raúl Cabrera, qui continuèrent leur œuvre, se distinguent parmi leurs disciples.<br />
Lors <strong>de</strong> sa spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie dans l’Oregon (USA), entre 1969 et 1971, le<br />
Dr Honeyman faisait partie <strong>de</strong> l’équipe <strong>de</strong> travail en immunologie <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my<br />
of Dermatology. En 1971, il introduisit au Chili l’étu<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies bulleuses<br />
auto-immunes avec <strong>de</strong>s techniques d’immunofluorescence ; il publia quelques<br />
articles importants sur les pathologies bulleuses dans Archives of Dermatology et il fut le<br />
premier à mesurer l’impact futur <strong>de</strong> l’immunologie dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il contribua à<br />
l’intégration du Dr Guarda à l’hôpital Aguirre en 1972, qui venait <strong>de</strong> compléter sa bourse<br />
<strong>de</strong> résidanat en mé<strong>de</strong>cine interne et sa formation en immunologie et qui, en plus <strong>de</strong> sa<br />
formation en <strong>de</strong>rmatologie, maîtrisait les pathologies du mésenchyme ainsi que les <strong>de</strong>rmatoses<br />
d’hypersensibilité immunologique. Tous <strong>de</strong>ux travaillèrent pendant longtemps<br />
au département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine expérimentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UCH, et<br />
contribuèrent à diffuser les bases théoriques <strong>de</strong> l’immunologie appliquées à <strong>la</strong> clinique à<br />
travers leur participation au cours <strong>de</strong> spécialisation, non seulement en <strong>de</strong>rmatologie<br />
mais aussi en mé<strong>de</strong>cine interne, en pédiatrie, en gynécologie et obstétrique, en neurologie<br />
et en chirurgie générale.<br />
Entre 1970 et 1975, l’immunologie clinique <strong>de</strong>vint le centre <strong>de</strong> l’activité quotidienne<br />
<strong>de</strong> certains mé<strong>de</strong>cins généralistes chiliens, parmi lesquels les Drs Honeyman, Guarda,<br />
Marta Ve<strong>la</strong>sco (hépatologue), Ricardo Sorensen (pédiatre), Mario Andreis et Sergio Aguilera<br />
(rhumatologues), Ricardo Sepúlveda (pneumologue), Alberto Daiber et Timoleón Anguita<br />
(hématologues). Le Dr Honeyman fut membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne<br />
d’immunologie ; pour sa part, le Dr Guarda introduisit en 1980 l’enseignement théorique<br />
obligatoire <strong>de</strong> l’immuno<strong>de</strong>rmatologie dans le programme <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie,<br />
toujours en vigueur. Tous <strong>de</strong>ux se distinguèrent pour <strong>la</strong> diffusion précoce <strong>de</strong>s<br />
concepts immuno<strong>de</strong>rmatologiques en Amérique du Sud. Les Drs Honeyman, Guarda, Cabrera<br />
et Jara furent à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> cours et <strong>de</strong> symposiums très importants sur le sujet au<br />
cours <strong>de</strong>s principaux événements <strong>de</strong>rmatologiques hispano-américains <strong>de</strong>s vingt <strong>de</strong>rnières<br />
années.<br />
Vénéréologie<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
L’hôpital San Luis fut le grand centre <strong>de</strong> référence pour le soin <strong>de</strong>s patients atteints<br />
<strong>de</strong> MST, principalement <strong>la</strong> syphilis, pendant toute <strong>la</strong> première moitié du XX e siècle ; <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong> ses 300 lits étaient occupés par <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s qui traversaient les différentes<br />
phases <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis et <strong>de</strong>s autres MST. Progressivement, d’autres hôpitaux à Santiago,<br />
Valparaíso et Concepción jouèrent un rôle actif dans l’assistance ambu<strong>la</strong>toire et intrahospitalière<br />
<strong>de</strong>s MST (par exemple, l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paul). Nous n’avons trouvé<br />
aucune référence bibliographique sur les caractéristiques ou les personnes qui se consacraient<br />
aux MST avant 1950 ; nous savons cependant qu’après 1940, <strong>la</strong> création du service<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale entraîna <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> tests sérologiques massifs pour <strong>la</strong><br />
syphilis, dévoi<strong>la</strong>nt que 10 % <strong>de</strong>s Chiliens assurés étaient positifs. Ceci motiva l’utilisation<br />
massive d’arsenoxy<strong>de</strong> pour <strong>la</strong> phléboclise, qui provoqua un fait extraordinaire: <strong>la</strong> diminution<br />
<strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> prévalence et d’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis avant l’arrivée <strong>de</strong> <strong>la</strong> pénicilline.<br />
Entre 1953 et 1970, grâce à l’utilisation massive d’antibiotiques et aux programmes<br />
<strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles, <strong>la</strong> syphilis perdit son importance<br />
épidémiologique et clinique, au Chili comme ailleurs, et ne fut plus une référence<br />
183
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
184<br />
obligée du diagnostic différentiel <strong>de</strong>s affections cutanées. La négligence qui s’en suivit<br />
provoqua une augmentation <strong>de</strong> l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> gonorrhées et d’urétrites non gonococciques<br />
et <strong>de</strong> syphilis. L’Organisation pan<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (OPS) impulsa alors <strong>la</strong><br />
restauration <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s MST examinés par le Service national <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
santé et désigna le Chili (spécifiquement l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios) pour développer <strong>de</strong>s<br />
programmes pilotes <strong>de</strong> contrôle, <strong>de</strong> suivi épidémiologique et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s MST, sous<br />
<strong>la</strong> direction d’Isidoro Pasmanik. Le résultat <strong>de</strong> ces programmes fut au Chili caution <strong>de</strong><br />
cas <strong>de</strong> syphilis congénitale.<br />
Pendant dix ans, <strong>de</strong>s cours internationaux, qui reçurent le soutien <strong>de</strong> l’OPS, <strong>de</strong> l’ULA-<br />
CETS, du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique du Chili, furent dispensés<br />
pour gérer les programmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s MST. Ces cours, dirigés par Isidoro<br />
Pasmanik avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, accueillirent les chefs <strong>de</strong>s programmes<br />
et <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> plusieurs pays <strong>la</strong>tino-américains. Le Dr Vil<strong>la</strong>lobos<br />
avait col<strong>la</strong>boré dans les années 80 à <strong>de</strong>s programmes d’éducation pour contrôler<br />
les MST, sponsorisés par l’IDRC du Canada ainsi que par l’Association <strong>de</strong> protection <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> famille.<br />
Au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> l’hôpital San Luis en 1972 et malgré <strong>la</strong> centralisation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte antivénérienne à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios, le traitement <strong>de</strong>s patients qui<br />
souffraient <strong>de</strong> MST s’est révélé insuffisant et coïncida avec une hausse <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies.<br />
Cependant, l’ingérence décidée du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé contribua à améliorer<br />
substantiellement <strong>la</strong> situation. De 1980 à 1987, Daniel Vil<strong>la</strong>lobos fut chargé du contrôle<br />
national <strong>de</strong>s MST au sein dudit ministère; les premières normes nationales pour le traitement<br />
et le contrôle <strong>de</strong>s MST (avec le soutien <strong>de</strong> l’OPS) furent é<strong>la</strong>borées sous sa direction,<br />
ce qui constitua un événement marquant pour <strong>la</strong> santé publique dans le pays.<br />
B<strong>la</strong>nca Campos fut désignée en 1987 pour succé<strong>de</strong>r au Dr Vil<strong>la</strong>lobos.<br />
Les <strong>de</strong>uxièmes normes nationales furent é<strong>la</strong>borées en 1990 et les troisièmes en 2000 ;<br />
Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, B<strong>la</strong>nca Campos, Aurelio Salvo, Liliana Urra, Félix Fich, Aníbal Hurtado,<br />
Rinna Ortega et Ester Santan<strong>de</strong>r participèrent à leur é<strong>la</strong>boration.<br />
Au cours <strong>de</strong>s années 70, tous les <strong>de</strong>rmatologues étaient formés aux soins courants <strong>de</strong>s<br />
MST ; ultérieurement et à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversification dans d’autres domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
ce dévouement universel aux MST céda un peu <strong>de</strong> terrain, malgré l’intérêt <strong>de</strong>s<br />
élèves <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie pour ces ma<strong>la</strong>dies.<br />
Nonobstant, le soin <strong>de</strong>s MST (hormis le sida) est toujours à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues,<br />
mais en nombre plus limité ; le traitement <strong>de</strong> ces patients fut concentré dans les<br />
centres MST, <strong>de</strong>s dépendances associées aux vingt-huit services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé sur tout le<br />
territoire chilien, dont les six <strong>de</strong> <strong>la</strong> région métropolitaine sont à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>rmatologues. Ces centres sont les héritiers mo<strong>de</strong>rnisés <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong> lutte antivénérienne<br />
créés dans les hôpitaux chiliens par Isidoro Pasmanik et d’autres <strong>de</strong>rmatologues<br />
dans les années 60. En dressant une liste sommaire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues les plus remarquables<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s MST pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle, nous pouvons<br />
citer les Drs Pasmanik, Vil<strong>la</strong>lobos et Fich (déjà mentionnés), ainsi que Horacio<br />
Espoz, Rafael Arroyave, Carmen Bruning, Aurelio Salvo, Rinna Ortega, Vesna Dragicevic,<br />
Ximena Moncada, Walter Gubelin, Orietta Gómez, Aníbal Hurtado, Ester Santan<strong>de</strong>r,<br />
Enrique Araya et B<strong>la</strong>nca Campos, entre autres.<br />
L’Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les MST (ULACETS), appuyée par l’OPS, eut une<br />
gran<strong>de</strong> importance dans <strong>la</strong> lutte antivénérienne au Chili, tant pour son soutien aux programmes<br />
et aux personnes que pour l’organisation <strong>de</strong> cours internationaux dans différentes<br />
villes sud-<strong>américaine</strong>s. La filiale chilienne d’ULACETS joua un rôle notable lors <strong>de</strong><br />
l’apparition du sida, en créant le premier <strong>la</strong>boratoire (gratuit et d’une durée d’un an) <strong>de</strong>stiné<br />
à détecter les anticorps anti-HIV, ainsi que le service <strong>de</strong> consultation téléphonique.<br />
Plusieurs <strong>de</strong>rmatologues chiliens participèrent remarquablement à l’ULACETS : le Dr<br />
Pasmanik en fut le fondateur et vice-prési<strong>de</strong>nt, tandis que le Dr Vil<strong>la</strong>lobos en fut le
secrétaire et le trésorier. Les conseils du Dr Fich (vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> 1995 à 1999) furent<br />
utiles à Hilda Abreu, <strong>de</strong>rmatologue uruguayenne, dans l’organisation <strong>de</strong> l’événement le<br />
plus important en Amérique du Sud dans le domaine <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
: le Congrès mondial <strong>de</strong> MST et sida (Punta <strong>de</strong>l Este, Uruguay, 2003). Par<br />
ailleurs, B<strong>la</strong>nca Campos présida le congrès ULACETS à Santiago en 1995.<br />
L’apparition du sida provoqua un changement graduel et substantiel <strong>de</strong>s structures et<br />
<strong>de</strong>s personnes en rapport avec les MST. En 1984, les premiers cas chiliens <strong>de</strong> VIH/sida<br />
furent diagnostiqués par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues (Juan Honeyman, Daniel Vil<strong>la</strong>lobos et Félix<br />
Fich, dans l’ordre). Depuis 1985, le Chili participe activement au travail international <strong>de</strong><br />
contrôle du sida. De 1985 à 1990, le sida faisait partie <strong>de</strong>s MST intégrant le programme<br />
national <strong>de</strong> contrôle déjà mentionné. Par ailleurs, <strong>de</strong>s infectiologues et <strong>de</strong>s épidémiologistes<br />
s’intéressent à <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s programmes du sida et au traitement <strong>de</strong>s patients.<br />
La Commission nationale du sida (CONASIDA) fut créée en 1990 ; elle dépendait du<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et était dirigée par une épidémiologiste (Raquel Child) ; à l’époque<br />
le programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s MST dirigé par le Dr Campos était toujours en vigueur. Cependant,<br />
vers 1993, <strong>la</strong> CONASIDA prit en charge ledit programme et mit à sa tête le Dr<br />
Aníbal Hurtado (<strong>de</strong>rmatologue). Une décision politique du ministère suspendit en 2003<br />
<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues à <strong>la</strong> CONASIDA.<br />
■ <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong> Société Chilienne <strong>de</strong> chilienne Dermatologie et <strong>de</strong> Vénéréologie <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie<br />
Fondation<br />
La Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie (SCDV) fut fondée le 29 mars<br />
1938, à l’origine sous le nom <strong>de</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie,<br />
et comme filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago. Elle porte son nom actuel <strong>de</strong>puis<br />
1976, définitivement stipulé dans les statuts <strong>de</strong> 1985. L’acte <strong>de</strong> sa fondation disparut<br />
<strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago. Selon un document <strong>de</strong>mandé en 1987<br />
par <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV à une commission formée par Hernán Hevia, Eduardo Silvestre,<br />
Gastón Ramírez et Antonio Mascaró, les membres fondateurs auraient été les<br />
mé<strong>de</strong>cins suivants : Cristián Barría Morales, Gustavo Ben<strong>de</strong>ck, Raquel Bravo, Manuel<br />
Castellón, Juana Díaz Muñoz, Israel Drapkin, Rodolfo Frey Gabler, Julio González<br />
Chacón, Héctor González Rioseco, Víctor Gianelli, Norberto Heins, Hernán Hevia Parga,<br />
Roberto Jaramillo Bruce, Néstor López Cortés, Antonio Mascaró B<strong>la</strong>nco, Raúl Morales<br />
Beltramí, Luis Montero Riveros, Manuel Oporto Gatica, Gonzalo Pérez <strong>de</strong> Arce, Florencio<br />
Prats González, Luis Prunés Rissetti, Gastón Ramírez Bravo, Eduardo Sylvester<br />
Rasch, Luis Toro Genke, Bernardo Vaisman, Mauricio Weinstein Rudoy et Daniel Yáñez<br />
Garrido.<br />
Première phase historique<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
Il s’agit <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> comprise entre <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV et 1980, caractérisée<br />
par <strong>de</strong>s réunions scientifiques périodiques appuyées institutionnellement par <strong>la</strong> Société<br />
médicale <strong>de</strong> Santiago (sans autres fonctions sociétaires soutenues). Ces activités, basées<br />
sur <strong>la</strong> bonne volonté <strong>de</strong>s membres associés, manquaient <strong>de</strong> personnalité juridique, <strong>de</strong><br />
statuts, <strong>de</strong> normes, <strong>de</strong> règlement, <strong>de</strong> siège et d’archives <strong>de</strong> secrétariat pouvant être récupérés<br />
; par conséquent, il n’existe aucune information écrite illustrative.<br />
Entre 1938 et 1985, <strong>la</strong> SCDV fonctionna sous <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> personnalité juridique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago, dont elle était une filiale ; on organisait <strong>de</strong>s réunions<br />
cliniques-scientifiques une ou <strong>de</strong>ux fois par mois, qui avaient lieu en général à l’hôpital<br />
San Luis (à sa fermeture en 1972, à l’hôpital José Joaquín Aguirre).<br />
185
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
186<br />
À partir <strong>de</strong> 1976, <strong>la</strong> SCDV organisa les Journées annuelles, qui avaient lieu au printemps.<br />
Faute <strong>de</strong> siège physique propre, l’activité <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV était centrée autour <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
personne même du prési<strong>de</strong>nt, qui travail<strong>la</strong>it cou<strong>de</strong> à cou<strong>de</strong> avec son secrétaire dans les<br />
hôpitaux hébergeant leurs activités professionnelles. Le prési<strong>de</strong>nt était parfois son<br />
propre secrétaire, gérant personnellement l’information écrite et orale propre à son<br />
mandat, information dont nous n’avons pas <strong>de</strong> trace. Les prési<strong>de</strong>nts étaient désignés oralement<br />
par les membres associés pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> poids scientifique et d’influence<br />
groupale. Malheureusement, nous ne connaissons pas <strong>la</strong> liste complète <strong>de</strong>s prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> SCDV ni leur pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mandat au cours <strong>de</strong> cette phase historique ; ni les actes <strong>de</strong>s<br />
réunions <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction ou <strong>de</strong>s assemblées <strong>de</strong>s associés (au cas où elles avaient eu lieu),<br />
ni les renseignements sur les gestionnaires ou sur les participants <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />
ne sont conservés. Certaines données récemment recueillies par voie orale nous apprennent<br />
que le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV et l’un <strong>de</strong> ses principaux promoteurs fut<br />
Luis Prunés Rissetti, élu plus tard prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago ; un autre<br />
pilier important fut Roberto Jaramillo Bruce. Nous savons que parmi les prési<strong>de</strong>nts se trouvent:<br />
Daniel Yáñez Garrido (<strong>de</strong> l’hôpital San Luis) en 1945 (Hernán Hevia Parga était son<br />
secrétaire) ; Gastón Ramírez entre 1946 et 1947, et Hernán Hevia entre 1952 et 1953.<br />
Des sources orales signalent une liste partielle <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nts avant 1958 : Luis Toro<br />
Genkel, Bernardo Vaisman, Joaquín Peragallo, Ricardo Sepúlveda, Mauricio Weinstein<br />
Rudoy, Héctor González Rioseco, Manuel Castellón, Florencio Prats González, Gonzalo<br />
Pérez <strong>de</strong> Arce et Ignacio González Díaz ; nous ne connaissons ni l’ordre chronologique ni<br />
<strong>la</strong> durée <strong>de</strong> leur mandat. À partir <strong>de</strong> 1958, les prési<strong>de</strong>nts se sont succédé comme suit :<br />
Roger Lamas Grubesich (1958-1959), Samuel Abeliuk Raschokvan (1960-1961), Raúl<br />
A<strong>la</strong>rcón Casanueva (1962-1963), Oscar Klein Kohn (1964-1965), Isidoro Pasmanik<br />
Guiñerman (1968-1969), Pedro Cofré (1970-1972), Daniel Vil<strong>la</strong>lobos Toro (1972-1974),<br />
A<strong>la</strong>n Rojas Cana<strong>la</strong> (1974-1976), Oscar Klein Kohn (1976-1978) et Marco Antonio De <strong>la</strong><br />
Parra Enríquez (1978-1980), <strong>la</strong> durée indiquée <strong>de</strong>s mandats étant approximative.<br />
Phase <strong>de</strong> transition<br />
Sous les prési<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> Julia Oroz Montiglio (1980-1981), Gonzalo Eguiguren Lira<br />
(1982-1983) et Carlos Vera Mora (1984-1986), <strong>la</strong> SCDV vécut une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> transition,<br />
caractérisée par l’envie d’améliorer <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> l’entité et <strong>de</strong> rédiger les statuts qui<br />
<strong>la</strong> rendraient indépendante <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago. Ce processus fut entamé<br />
en 1981 et se termina en 1985, lorsque <strong>la</strong> personnalité juridique et les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV<br />
furent approuvés. La Revista Chilena <strong>de</strong> Dermatología, appelée à l’origine Dermatología<br />
(Chile), parut en 1985 en tant qu’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, encouragée par Carlos Vera<br />
et Juan Honeyman ; les trois premiers numéros parurent pendant l’année <strong>de</strong> sa création,<br />
son éditeur-directeur étant toujours le Dr Honeyman. Quelques séances scientifiques eurent<br />
lieu au cours <strong>de</strong> cette phase, tandis que les Journées annuelles se dérou<strong>la</strong>ient au<br />
printemps. Tout comme les informations précédant l’année 1986, cette phase <strong>de</strong> transition<br />
ne fournit aucun renseignement écrit sur les activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV pour <strong>de</strong>s raisons<br />
simi<strong>la</strong>ires à celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> première phase historique.<br />
Deuxième phase historique<br />
Cette pério<strong>de</strong> débuta en 1986 et fut caractérisée par <strong>la</strong> préservation d’informations<br />
écrites complètes et dignes <strong>de</strong> foi concernant <strong>la</strong> SCDV. En mai 1986 eut lieu <strong>la</strong> première<br />
élection du prési<strong>de</strong>nt par un vote démocratique, ce qui signifia le début <strong>de</strong> l’application<br />
rigoureuse et systématique <strong>de</strong>s statuts récemment approuvés (1985), avec <strong>de</strong>s élections<br />
périodiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission directive. Lorsque Rubén Guarda assuma <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
(1986), il lui fut impossible <strong>de</strong> rassembler <strong>de</strong>s documents ou <strong>de</strong>s actes antérieurs à <strong>la</strong>
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
société, étant donné l’absence <strong>de</strong> pérennité du secrétariat ou <strong>de</strong> l’information d’un directoire<br />
à un autre.<br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> furent : Rubén Guarda Tatín (1986-1988, réélu pour<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1988-1990), Juan Honeyman Mauro (1990-1992), Félix Fich Schilcrot (1992-<br />
1994), Tirza Saavedra Umpierrez (1994-1996), María Isabel Herane (1996-1998), Iván<br />
Jara Padil<strong>la</strong> (1998-2000), Mirtha Cifuentes Mutinelli (2000-2002), Raúl Cabrera Moraga<br />
(2002-2004) et Hilda Rojas (2004-2006).<br />
Les faits marquants <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>uxième phase historique furent les suivants :<br />
— Élections démocratiques du prési<strong>de</strong>nt et <strong>de</strong> sa commission directive tous les <strong>de</strong>ux<br />
ans (en avril).<br />
— Continuité du secrétariat, archivage <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation et administration. La secrétaire<br />
administrative, Sandra Díaz, embauchée en juin 1986, est à présent un facteur<br />
central pour <strong>la</strong> continuité du système.<br />
— Réunions mensuelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission directive, entre mars et décembre.<br />
— Assemblées générales <strong>de</strong>s membres associés, habituellement mensuelles entre<br />
mars et décembre, avec <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> sujets scientifiques, <strong>de</strong>s rapports du prési<strong>de</strong>nt<br />
en exercice sur les actions et les accords <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction et <strong>de</strong>s commissions ainsi que <strong>la</strong><br />
discussion <strong>de</strong>s affaires sociétaires.<br />
— Siège : le premier siège autonome <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV (avec les fonctions <strong>de</strong> secrétariat, documentation,<br />
séances <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction et <strong>de</strong>s commissions) fut une pièce louée dans <strong>la</strong> rue<br />
Salvador Donoso, dans le quartier Bel<strong>la</strong>vista, commune <strong>de</strong> Provi<strong>de</strong>ncia, entre janvier et<br />
décembre 1987, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Rubén Guarda. Plus tard et grâce à l’ai<strong>de</strong> financière<br />
du <strong>la</strong>boratoire Alcon, <strong>la</strong> SCDV acheta un bureau dans l’immeuble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale<br />
<strong>de</strong> Santiago, rue Presi<strong>de</strong>nte Riesco, commune <strong>de</strong> Las Con<strong>de</strong>s, où elle déménagea<br />
au mois <strong>de</strong> décembre 1987 ; ce bureau dut être abandonné en 1994 lors du départ <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société médicale <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> l’immeuble. La pério<strong>de</strong> suivante se caractérisa par l’absence<br />
<strong>de</strong> siège et <strong>la</strong> dispersion <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> et <strong>la</strong> bibliothèque et un travail distribué<br />
entre les maisons ou les bureaux <strong>de</strong>s membres du comité exécutif et <strong>la</strong> secrétaire administrative.<br />
Cependant, en 1993 et sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Félix Fich, l’achat d’un nouveau<br />
bureau-siège fut accordé, concrétisé au mois <strong>de</strong> décembre 1995, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong><br />
Tirza Saavedra. Il était situé rue La Concepción, commune <strong>de</strong> Provi<strong>de</strong>ncia, et fut utilisé<br />
par <strong>la</strong> SCDV jusqu’au moment d’être vendu, en 2002. En juin 2003, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> Raúl Cabrera, <strong>la</strong> SCDV acheta son troisième siège, plus vaste, rue Luis Pasteur, commune<br />
<strong>de</strong> Vitacura, désormais en fonctionnement.<br />
— Nombre d’associés : après un processus <strong>de</strong> plusieurs mois, <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV<br />
présenta en mai 1987 le premier registre officiel <strong>de</strong>s membres titu<strong>la</strong>ires (127 au total) ;<br />
en octobre 2004, on dénombre 222 membres, dont <strong>la</strong> qualification dépend du respect <strong>de</strong>s<br />
conditions requises d’admission stipulés dans les statuts. Ces chiffres doivent être comparés<br />
avec les trente membres présumés existants en 1970. L’augmentation notable <strong>de</strong><br />
membres en trente-quatre ans démontre l’efficacité <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> nouveaux<br />
spécialistes, l’intérêt renouvelé pour <strong>la</strong> spécialité et l’effort commun <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens pour assurer l’enseignement.<br />
— Filiales : le Chili étant un pays très étendu, il existe un certain isolement géographique<br />
<strong>de</strong>s villes éloignées <strong>de</strong> Santiago ; il <strong>de</strong>vait donc y avoir <strong>de</strong>s filiales afin <strong>de</strong> rapprocher<br />
les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV qui étaient proches. Sous <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, les<br />
filiales sud et nord firent leur apparition vers <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s années 80, promues par Patricio<br />
Rifo (Temuco) et Alex Arroyo (Antofagasta) respectivement. Le premier règlement<br />
<strong>de</strong>s filiales fut approuvé en 1988, et modifié ultérieurement. De nous jours fonctionnent<br />
les filiales nord (dont le siège se trouve à Antofagasta), Quinta Región (siège Valparaíso/Viña),<br />
Bío-Bío (siège Concepción) et sud (siège Temuco). Ces filiales organisèrent<br />
plusieurs réunions scientifiques intra-régionales — parfois avec <strong>de</strong>s invités <strong>de</strong> Santiago<br />
— et <strong>de</strong> nombreuses Journées nationales annuelles.<br />
187
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
188<br />
— Commissions permanentes: elles furent mises en route en 1986, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> Rubén Guarda, dans le but <strong>de</strong> conseiller <strong>la</strong> direction à propos <strong>de</strong> sujets statutaires, administratifs<br />
et <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions internes et externes, ce qui permit en même temps d’é<strong>la</strong>rgir <strong>la</strong><br />
représentativité <strong>de</strong>s décisions. Les commissions se réunissent <strong>de</strong> façon autonome ou à <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction; ses membres occupent leur poste pendant <strong>de</strong>ux ans; les fonctions<br />
sont soumises à <strong>de</strong>s règlements et les résolutions prises nécessitent l’approbation finale <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> direction. Les commissions fonctionnant <strong>de</strong>puis 1986 sont: 1) statuts, règlements et admission<br />
<strong>de</strong>s membres associés; 2) éthique, discipline et re<strong>la</strong>tions professionnelles; 3) tarifs<br />
et prestations; 4) commission scientifique et formation continue; 5) re<strong>la</strong>tions internationales;<br />
6) comité éditorial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Chilena <strong>de</strong> Dermatología. S’y ajoutèrent plus tard<br />
les commissions suivantes: 7) bibliothèque et informatique; 8) bien-être.<br />
— Groupes <strong>de</strong> travail : certains groupes <strong>de</strong> travail (<strong>de</strong>rmatoses professionnelles, <strong>de</strong>rmatite<br />
<strong>de</strong> contact) fonctionnaient auparavant <strong>de</strong> manière sporadique ; toutefois, sous <strong>la</strong><br />
prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Juan Honeyman, <strong>la</strong> SCDV fixa leur réglementation et stimu<strong>la</strong> leur formation<br />
(1990) ; ces groupes, conçus comme <strong>de</strong>s rassemblements d’associés ayant <strong>de</strong>s affinités<br />
pour certaines matières scientifiques, avaient pour but d’ai<strong>de</strong>r à l’échange<br />
d’expériences et <strong>de</strong> susciter <strong>de</strong>s documents ou <strong>de</strong>s positions <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV, à travers <strong>de</strong>s<br />
réunions périodiques <strong>de</strong> travail. Les groupes plus régulièrement actifs à présent sont<br />
ceux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, d’acné/rosacée et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>ser. D’autres groupes travaillent sur les MST, <strong>la</strong> cosmétologie, l’oncologie cutanée, le<br />
psoriasis et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine interne.<br />
— Séances d’éducation continue : afin <strong>de</strong> passer en révision et <strong>de</strong> mettre à jour <strong>la</strong><br />
connaissance <strong>de</strong> sujets spécifiques dans <strong>de</strong>s horaires du soir, <strong>la</strong> SCDV mit en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
1986 à 1989 plusieurs séances d’éducation continue, reprises en 2002.<br />
— Congrès chiliens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie tous les <strong>de</strong>ux ans.<br />
— Journées annuelles et Journée <strong>de</strong> printemps.<br />
— Revista Chilena <strong>de</strong> Dermatología.<br />
— <strong>Bibliothèque</strong> et informatique : <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> bibliothèque commença en 1989,<br />
composée <strong>de</strong>s principales revues internationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> quelques livres<br />
pour l’utilisation <strong>de</strong>s associés, qui fonctionna au siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV. En 2001 fut inauguré<br />
le site Internet <strong>de</strong> <strong>la</strong> société : < www.sochi<strong>de</strong>rm.cl >.<br />
— Bourses <strong>de</strong> perfectionnement: sur une suggestion du prési<strong>de</strong>nt Raúl Cabrera, <strong>la</strong><br />
SCDV créa en 2002 <strong>de</strong>s bourses <strong>de</strong>stinées à ses membres, d’une courte durée (cinq semaines<br />
minimum) pour <strong>de</strong>s séjours dans les centres étrangers sur <strong>de</strong>s matières spécifiques<br />
qualifiées, pour qu’elles puissent être ultérieurement appliquées au Chili; le montant fixé<br />
pour ces bourses est <strong>de</strong> 3000 USD (dol<strong>la</strong>rs américains), financées par les grands <strong>la</strong>boratoires<br />
pharmaceutiques et adjugeables par concours d’antécé<strong>de</strong>nts face à un juré. Trois<br />
bourses, financées par Gal<strong>de</strong>rma, G<strong>la</strong>xoSmithKline et Stiefel, ont déjà été attribuées.<br />
— CONACEM : <strong>la</strong> SCDV fut incorporée à <strong>la</strong> CONACEM en 1987 ; <strong>de</strong>ux ans plus tard les<br />
conditions requises pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> vénéréologie furent approuvées et, <strong>de</strong>puis<br />
1990, <strong>la</strong> société intègre <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie dudit organisme<br />
à travers <strong>de</strong>ux représentants.<br />
— Re<strong>la</strong>tions internationales : <strong>la</strong> SCDV fait partie <strong>de</strong> l’International League of Dermatological<br />
Societies (ILDS) et constitue le porte-parole le plus important <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens auprès <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology (USA).<br />
— Re<strong>la</strong>tions nationales : <strong>la</strong> SCDV est affiliée à <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> Santiago, à <strong>la</strong> CO-<br />
NACEM, et à l’Association nationale <strong>de</strong> sociétés scientifiques.<br />
— Campagnes pour <strong>la</strong> communauté : lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> María Isabel Herane<br />
(1997), <strong>la</strong> société organisa une série <strong>de</strong> campagnes annuelles <strong>de</strong> prévention du cancer<br />
cutané qui eurent un impact très fort; elles furent poursuivies par les directions ultérieures,<br />
comptant sur le soutien du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires pharmaceutiques.
— Nouveaux statuts en novembre 1999 : l’assemblée générale <strong>de</strong>s membres approuva<br />
une modification <strong>de</strong>s statuts <strong>de</strong> 1985. Les nouveaux statuts atten<strong>de</strong>nt actuellement l’approbation<br />
finale <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice.<br />
Directeurs connus <strong>de</strong> <strong>la</strong> première phase historique<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> transition<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
(Registres conservés <strong>de</strong> façon incomplète)<br />
1958 – 1960 Prési<strong>de</strong>nt : Roger Lamas Grubesich<br />
1960 – 1962 Prési<strong>de</strong>nt : Samuel Abeliuk Raschokvan<br />
1962 – 1964 Prési<strong>de</strong>nt : Raúl A<strong>la</strong>rcón Casanueva ; secrétaire: Samuel Abeliuk Raschokvan<br />
1964 – 1966 Prési<strong>de</strong>nt : Oscar Klein Kohn ; secrétaire: Fe<strong>de</strong>rico Pescetto<br />
1966 – 1968 Pas <strong>de</strong> registres conservés<br />
1968 – 1970 Prési<strong>de</strong>nt : Isidoro Pasmanik Guiñerman<br />
1970 – 1972 Prési<strong>de</strong>nt : Pedro Cofré ; secrétaire: A<strong>la</strong>n Rojas Cana<strong>la</strong><br />
1972 – 1974 Prési<strong>de</strong>nt : Daniel Vil<strong>la</strong>lobos Toro; secrétaire: A<strong>de</strong><strong>la</strong>ida Tolic Rodríguez<br />
1974-1976 Prési<strong>de</strong>nt : A<strong>la</strong>n Rojas Cana<strong>la</strong> ; secrétaire: Fernando Oyarzún Carrillo<br />
1976 – 1978 Prési<strong>de</strong>nt : Oscar Klein Kohn<br />
1978 – 1980 Prési<strong>de</strong>nt : Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Parra Enríquez; secrétaire général : Jorge<br />
Abeliuk Sharager<br />
1980 – 1982 Prési<strong>de</strong>nte : Julia Oroz Montiglio ; secrétaire générale : María Elsa Maira<br />
Palma<br />
1982 – 1984 Prési<strong>de</strong>nt : Gonzalo Eguiguren Lira ; secrétaire général : Leonardo Sánchez<br />
Millán<br />
1984 – 1986 Prési<strong>de</strong>nt : Carlos Vera Mora ; secrétaire générale : Mónica Ross Maldonado.<br />
Directeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième phase historique (1986-2004)<br />
1986 – 1988 Prési<strong>de</strong>nt : Rubén Guarda Tatin ; vice-prési<strong>de</strong>nt : Manuel Melis <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Vega ; secrétaire général: Raúl Cabrera Moraga<br />
1988 – 1990 Prési<strong>de</strong>nt : Rubén Guarda Tatín ; vice-prési<strong>de</strong>nt : Félix Fich Schilcrot ;<br />
secrétaire général: Iván Jara Padil<strong>la</strong><br />
1990 – 1992 Prési<strong>de</strong>nt : Juan Honeyman Mauro; vice-prési<strong>de</strong>nt : Félix Fich Schilcrot ;<br />
secrétaire générale: María Luisa Pérez-Cotapos Subercaseaux<br />
1992 – 1994 Prési<strong>de</strong>nt : Félix Fich Schilcrot ; vice-prési<strong>de</strong>nte : María Isabel Herane ;<br />
secrétaire générale: Monserrat Molgó Novell<br />
1994 – 1996 Prési<strong>de</strong>nte : Tirza Saavedra Umpierrez ; vice-prési<strong>de</strong>nte : María Isabel<br />
Herane ; secrétaire générale: Pi<strong>la</strong>r Valdés Arrieta<br />
1996 – 1998 Prési<strong>de</strong>nte : María Isabel Herane ; vice-prési<strong>de</strong>nte : Mirtha Cifuentes<br />
Mutinelli ; secrétaire générale: Ximena Ancic Cortéz<br />
1998 – 2000 Prési<strong>de</strong>nt: Iván Jara Padil<strong>la</strong>; vice-prési<strong>de</strong>nte: Tirza Saavedra Umpierrez;<br />
secrétaire générale: Hilda Rojas Pizarro<br />
2000 – 2002 Prési<strong>de</strong>nte : Mirtha Cifuentes Mutinelli ; vice-prési<strong>de</strong>nte : Monserrat<br />
Molgó Novell ; secrétaire générale: Emilia Zegpi Trueba<br />
2002 – 2004 Prési<strong>de</strong>nt : Raúl Cabrera Moraga ; vice-prési<strong>de</strong>nte : Hilda Rojas Pizarro;<br />
secrétaire générale: Orietta Gómez Hanssen<br />
2004 – 2006 Prési<strong>de</strong>nte : Hilda Rojas Pizarro; vice-prési<strong>de</strong>nt : Félix Fich Schilcrot ;<br />
secrétaire générale: Orietta Gómez Hanssen.<br />
189
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
■ Publications <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>rmatologiques au Chili au Chili<br />
Le Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Chilena <strong>de</strong> Dermatología y Sifilología (son organe officiel),<br />
paru en 1945 et publié trois fois, fut <strong>la</strong> première publication connue <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV ; nous<br />
ignorons les causes <strong>de</strong> sa disparition. Le principal responsable <strong>de</strong> ce bulletin fut Hernán<br />
Hevia, secrétaire à l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, aidé par Florencio Prats, Mauricio Weinstein<br />
et Roger Lamas. Au cours <strong>de</strong> sa prési<strong>de</strong>nce (1972-1974) Daniel Vil<strong>la</strong>lobos, publia plusieurs<br />
bulletins, <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV à contenus scientifiques et syndicaux. Carlos Vera fonda,<br />
quant à lui, l’éphémère revue Dermosur, consacrée aux <strong>de</strong>rmatoses <strong>de</strong> contact et occupationnelles.<br />
L’existence <strong>de</strong> cette revue fut courte.<br />
La première revue <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie d’envergure au Chili fut impulsée par <strong>la</strong> SCDV en<br />
tant qu’organe officiel et parut en 1985 sous le nom <strong>de</strong> Dermatología (Chile) sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong> Carlos Vera. Juan Honeyman en est le directeur <strong>de</strong>puis le premier numéro.<br />
Son travail in<strong>la</strong>ssable et minutieux, ainsi que celui <strong>de</strong>s comités éditoriaux successifs<br />
(composés par <strong>de</strong>s membres réputés <strong>de</strong> <strong>la</strong> société), notamment Pi<strong>la</strong>r Valdés, Soledad<br />
Bertoló et Félix Fich, permirent que <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> cette revue ne soit pas interrompue<br />
jusqu’à nos jours ; elle fut publiée <strong>de</strong>ux fois par an jusqu’en 1993, trois fois par an<br />
un peu plus tard et <strong>de</strong>puis 1998 elle paraît quatre fois par an. Sa structure comprend <strong>de</strong>s<br />
travaux originaux, cliniques ou expérimentaux, <strong>de</strong>s révisions bibliographiques, <strong>de</strong>s minicas<br />
et <strong>de</strong>s informations d’intérêt sociétaire. La revue reçoit fréquemment l’apport <strong>de</strong><br />
quelques auteurs étrangers ; elle est distribuée sur le territoire national et dans les pays<br />
voisins.<br />
■ Réunions scientifiques scientifiques nationales nationales<br />
190<br />
Pendant <strong>la</strong> première phase historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV, ses membres se rassemb<strong>la</strong>ient une<br />
ou <strong>de</strong>ux fois par mois, <strong>de</strong> préférence à l’hôpital San Luis ; lors <strong>de</strong> ces réunions ou assemblées<br />
scientifiques, ils discutaient <strong>de</strong> cas, présentaient leurs expériences originales<br />
ou révisaient certains sujets. Bien que <strong>la</strong> principale source <strong>de</strong> cas pour ces réunions provienne<br />
majoritairement <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>s hôpitaux San Luis et San Vicente <strong>de</strong> Paul, les<br />
autres hôpitaux <strong>de</strong> Santiago et même ceux <strong>de</strong>s provinces (par exemple Valparaíso) exposaient<br />
également leur expérience.<br />
Un mémoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> 1945 montre qu’au cours <strong>de</strong> cette année, 16 séances<br />
eurent lieu : 21 travaux originaux et 56 cas cliniques furent présentés, publiés dans les<br />
trois numéros du Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Chilena <strong>de</strong> Dermatología y Sifilología déjà cité.<br />
Hernán Hevia (environ 200 communications) fut l’auteur le plus prolifique <strong>de</strong> travaux<br />
présentés à <strong>la</strong> SCDV <strong>de</strong>puis sa création jusqu’à 1980.<br />
La SCDV organisa en décembre 1968 <strong>la</strong> réunion du 30 e anniversaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV, qui<br />
eut lieu à l’hôpital San Luis et dura trois jours — <strong>de</strong>puis très tôt le matin jusqu’à très tard<br />
le soir —, avec <strong>de</strong>s présentations <strong>de</strong> cas cliniques et <strong>de</strong> travaux originaux. Cette réunion<br />
permit <strong>de</strong> convoquer tous les <strong>de</strong>rmatologues chiliens et fut suivie <strong>de</strong> réunions simi<strong>la</strong>ires<br />
organisées par <strong>la</strong> société, appelées Journées chiliennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (Santiago et Valparaíso<br />
en 1970), présidées par Pedro Cofré ; Journées nationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (Santiago,<br />
1974 et 1975). À partir <strong>de</strong> 1976, elles prirent le nom <strong>de</strong> Journées annuelles <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie, réalisées habituellement à Santiago jusqu’en 1985. Cependant,<br />
à partir <strong>de</strong> 1990 (sauf en 1999) et en partie en raison du succès <strong>de</strong>s Journées<br />
<strong>de</strong> printemps, ces Journées annuelles eurent lieu dans les villes <strong>de</strong> province afin <strong>de</strong> promouvoir<br />
<strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ainsi que <strong>la</strong> décentralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV. Ces réunions<br />
à caractère scientifique (progrès en <strong>de</strong>rmatologie et présentation <strong>de</strong> travaux<br />
originaux, participation d’invités étrangers <strong>de</strong> haut niveau) sont aussi <strong>de</strong>s occasions <strong>de</strong><br />
se retrouver puisque l’unité, <strong>la</strong> convivialité et l’amitié entre les <strong>de</strong>rmatologues chiliens
est une <strong>de</strong>s priorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV. Depuis 1997, ces réunions reçoivent le nom <strong>de</strong> Journées<br />
annuelles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie Pr. Hernán Hevia Parga, en l’honneur<br />
du grand professeur chilien.<br />
Les Journées <strong>de</strong> printemps, proposées par Leonardo Sánchez et Patricio Rifo, eurent<br />
lieu à Santiago entre 1986 et 1989 une fois par an (quatre au total). Organisées<br />
sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Rubén Guarda, elles visaient à ce que les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s provinces<br />
présentent leurs travaux et les cas problématiques qu’ils rencontraient afin d’en<br />
discuter avec les spécialistes <strong>de</strong> Santiago ; ces discussions s’enrichissaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence<br />
d’un invité étranger par jour. Ces journées eurent un grand succès en termes<br />
d’assistance et contribuèrent non seulement à renforcer <strong>la</strong> solidarité entre les <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens mais aussi, à annihiler <strong>la</strong> résistance chronique <strong>de</strong>s associés à payer<br />
leur cotisation.<br />
Quand Rubén Guarda assuma <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV (mai 1986), il proposa <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong> congrès chiliens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie en les présentant comme <strong>de</strong>s<br />
réunions périodiques importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne, d’une durée <strong>de</strong> trois<br />
jours, qui comporteraient notamment <strong>de</strong>s apports choisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong> l’expérience,<br />
<strong>de</strong>s symposiums, <strong>de</strong>s ateliers et <strong>de</strong>s conférences, avec <strong>la</strong> participation d’invités<br />
étrangers hautement qualifiés. Le premier congrès chilien, présidé par le Dr Guarda luimême,<br />
eut lieu en avril 1988 en présence <strong>de</strong> quatre invités provenant <strong>de</strong>s États-Unis :<br />
Mark Dahl, Marcus Conant, Bijan Safai et Jon Hanifin. Depuis, huit congrès eurent lieu<br />
à Santiago (tous les <strong>de</strong>ux ans, au mois d’avril, sauf en 1992 à cause du congrès RADLA<br />
dans notre capitale), avec <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> nombreux <strong>de</strong>rmatologues réputés d’Europe,<br />
<strong>de</strong>s États-Unis et d’Amérique <strong>la</strong>tine et une assistance d’environ 200 à 400 mé<strong>de</strong>cins.<br />
Ces congrès furent présidés par Rubén Guarda (1988), Daniel Vil<strong>la</strong>lobos (1990),<br />
Félix Fich (1994), Tirza Saavedra (1996), María Isabel Herane (1998), Iván Jara (2000),<br />
Mirtha Cifuentes (2002) et Raúl Cabrera (2004).<br />
Plusieurs réunions <strong>de</strong>rmatologiques d’un niveau scientifique remarquable et qui<br />
comptèrent sur <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> plusieurs invités étrangers furent organisées par diverses<br />
institutions ; parmi les plus traditionnelles et les plus fréquentées nous citerons<br />
: 1) le cours - journée annuelle du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Aguirre<br />
(<strong>de</strong>puis 1988), consacré <strong>de</strong>rnièrement à <strong>la</strong> thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique et généralement<br />
dirigé par Juan Honeyman ; 2) le symposium - cours annuel <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> PUC (<strong>de</strong>puis 1990), ses directeurs se re<strong>la</strong>yant pour l’organisme ; 3) le<br />
cours - journée annuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santiago : le premier (1991) fut dirigé<br />
par Rubén Guarda, tandis que <strong>de</strong>puis 1995, il est dirigé <strong>de</strong> façon ininterrompue<br />
par Raúl Cabrera.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie chilienne Sur le p<strong>la</strong>n international<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie chilienne sur le p<strong>la</strong>n international<br />
Présence <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues chiliens dans les réunions internationales<br />
Le fait que le Chili soit le pays américain le plus éloigné d’Europe et le pays sud-américain<br />
le plus éloigné <strong>de</strong>s États-Unis explique <strong>la</strong> faible représentation <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens dans les institutions et les réunions internationales jusqu’aux années 70. Malgré<br />
quelques contacts personnels avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie française par le biais <strong>de</strong> certains professeurs<br />
(Puyó, Jaramillo et Prunés par exemple) et avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie argentine<br />
(Prats et Brieva), les premiers contacts institutionnels fructueux eurent lieu grâce aux<br />
mé<strong>de</strong>cins liés aux MST, notamment Isidoro Pasmanik et Daniel Vil<strong>la</strong>lobos.<br />
Le Dr Pasmanik participa à plusieurs actions communes avec <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s<br />
autres pays <strong>la</strong>tino-américains, en tant que responsable au Chili du programme pilote <strong>de</strong><br />
l’OMS pour contrôler les MST <strong>de</strong>puis 1960 ; il voyagea in<strong>la</strong>ssablement pour participer<br />
191
RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
192<br />
aux congrès <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> MST et y fut quasiment le seul Chilien présent jusqu’en<br />
1975. Il participa activement en compagnie <strong>de</strong>s Drs Vil<strong>la</strong>lobos et Fich aux réunions<br />
internationales sur les MST et le sida, y compris les congrès ULACETS. Par ailleurs, notons<br />
que le Dr Félix Fich fut vice-prési<strong>de</strong>nt d’ULACETS entre 1995 et 1999.<br />
Le rôle <strong>de</strong> Juan Honeyman entre 1976 et 1990 dans <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens (présence aux réunions médicales internationales et présentation <strong>de</strong> leurs communications)<br />
fut crucial. Nous pourrions résumer son parcours comme suit: 1) dès sa formation<br />
<strong>de</strong>rmatologique dans l’État <strong>de</strong> l’Oregon, il fut le principal promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
participation <strong>de</strong>s jeunes <strong>de</strong>rmatologues au sein <strong>de</strong>s meetings <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of<br />
Dermatology (AAD) et <strong>de</strong> leur affiliation à celle-ci; 2) il promut également l’affiliation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
SCDV à l’International League of Dermatological Societies; 3) il favorisa dès sa première<br />
participation à <strong>la</strong> RADLA, à Guarujá en 1976, <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’un grand nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
chiliens au principal événement annuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sud-<strong>américaine</strong> —<br />
<strong>la</strong> Réunion annuelle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains du cône sud (RADLA) —, ainsi<br />
que leur participation à travers <strong>de</strong>s communications; 4) finalement, il promut aussi <strong>la</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong>s congrès du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD).<br />
Les <strong>de</strong>rmatologues chiliens participèrent très activement aux RADLA du cône sud <strong>de</strong>puis<br />
1977, soit en y assistant, soit en qualité <strong>de</strong> conférenciers ou <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction.<br />
Juan Honeyman, Carlos Vera et Rubén Guarda présidèrent l’organisation et, par<br />
conséquent, furent délégués permanents <strong>de</strong> son conseil. Isidoro Pasmanik, Gonzalo Eguiguren,<br />
Julia Oroz, Leonardo Sánchez, Iván Jara, Raúl Cabrera, Félix Fich, Montserrat<br />
Molgó et Orietta Gómez furent les délégués renouve<strong>la</strong>bles. La participation du Chili à <strong>la</strong><br />
coordination d’activités scientifiques et <strong>de</strong> comptes rendus est désormais habituelle, notamment<br />
en immuno<strong>de</strong>rmatologie et en oncologie cutanée.<br />
Quant au CILAD, <strong>la</strong> présence chilienne y est un peu moins nombreuse. Juan Honeyman<br />
fut délégué national du CILAD pour le Chili <strong>de</strong> 1975 à 1999, vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> zone<br />
entre 1995 et 1999 et premier vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> 1999 à 2003. Rubén Guarda fut élu délégué<br />
national en 2000 et réélu en 2003.<br />
En résumé, <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues chiliens aux meetings <strong>de</strong> l’AAD, aux<br />
congrès mondiaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, au CILAD, aux<br />
RADLA et à un grand nombre d’événements américains et européens est constante et<br />
parfois massive. Ceci contribua à rehausser et à mettre au jour <strong>la</strong> science <strong>de</strong>rmatologique<br />
chilienne.<br />
Les Drs Juan Honeyman, Rubén Guarda, Raúl Cabrera, Iván Jara, María Isabel Herane<br />
et tant d’autres sont fréquemment invités à participer aux congrès <strong>de</strong>rmatologiques<br />
nationaux <strong>de</strong> divers pays <strong>la</strong>tino-américains. Le Dr Honeyman fait partie <strong>de</strong> plusieurs sociétés<br />
nationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; il est un voyageur in<strong>la</strong>ssable, comme le fut auparavant<br />
le Dr Pasmanik, ainsi qu’un conférencier assidu dans les réunions médicales qui ont<br />
lieu dans différents pays. Pour sa part, le Dr Guarda est aussi un conférencier constamment<br />
invité aux congrès d’allergie et d’immunologie organisés dans les pays voisins.<br />
L’échange institutionnel <strong>de</strong> jeunes mé<strong>de</strong>cins entre l’AAD et <strong>la</strong> SCDV pour ai<strong>de</strong>r à leur<br />
participation aux congrès respectifs est fructueux, car les <strong>de</strong>ux sociétés facilitent les séjours<br />
et les inscriptions.<br />
Principaux événements <strong>de</strong>rmatologiques internationaux au Chili<br />
Le Chili fut le siège <strong>de</strong>s événements <strong>de</strong>rmatologiques internationaux suivants :<br />
1) RADLA du cône sud en 1985, <strong>la</strong> première réunion réalisée à Santiago (prési<strong>de</strong>nt : Juan<br />
Honeyman ; secrétaire général : Gonzalo Eguiguren), avec <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> 400 mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>s pays RADLA (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Pérou, Paraguay et Uruguay) ;<br />
2) RADLA du cône sud en 1992, qui eut lieu à Santiago (prési<strong>de</strong>nt : Carlos Vera ; secrétaire<br />
générale : Mirtha Cifuentes), en présence <strong>de</strong> 500 mé<strong>de</strong>cins ; 3) RADLA du cône sud
en 1997, également à Santiago (présidée par Rubén Guarda et dont le secrétaire général<br />
fut Raúl Cabrera), avec une assistance <strong>de</strong> 950 mé<strong>de</strong>cins ; 4) congrès ULACETS à Santiago<br />
en 1995 (prési<strong>de</strong>nte : B<strong>la</strong>nca Campos ; prési<strong>de</strong>nt du comité scientifique : Félix Fich),<br />
en <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> 1 800 participants <strong>de</strong> trente-cinq pays. La ville <strong>de</strong> Santiago vient d’être<br />
le siège d’une nouvelle réunion RADLA en 2006, présidée par Raúl Cabrera.<br />
Autres événements <strong>de</strong>rmatologiques internationaux au Chili<br />
Deux cycles <strong>de</strong> réunions entre les <strong>de</strong>rmatologues chiliens et argentins (principalement<br />
<strong>de</strong> Cuyo, <strong>la</strong> région argentine <strong>la</strong> plus proche <strong>de</strong> Santiago) eurent lieu dans <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle : 1) le premier cycle correspond aux Réunions andines <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, réalisées à Mendoza (1969) et à Santiago (1970), selon les suggestions<br />
d’Isidoro Pasmanik et d’Alberto Torres Cortijo (Mendoza), et organisées par <strong>la</strong> SCDV et<br />
<strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (filiale Cuyo), une réussite en termes <strong>de</strong> fraternité<br />
entre Chiliens et Argentins ; 2) <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième série, plus longue (1989 à 1995), correspond<br />
aux Journées transandines <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, organisées une fois par an alternativement<br />
à Santiago en automne et à Cuyo au printemps, initialement proposées par Cristóbal<br />
Parra (Mendoza) et Rubén Guarda (Santiago) et avec l’accord <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> SCDV<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiale Cuyo <strong>de</strong> l’Association argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (Nélida Pizzi, Cristóbal<br />
Parra, José Leonforte et Elías Bittar) ; <strong>la</strong> SCDV chargea sa filiale Quinta Región d’assumer<br />
<strong>la</strong> responsabilité chilienne <strong>de</strong> ces journées, qui comptèrent une participation massive<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> Cuyo et du Chili.<br />
Les Journées interandines, effectuées entre 1994 et 2000 et rassemb<strong>la</strong>nt les <strong>de</strong>rmatologues<br />
du nord du Chili, les Argentins <strong>de</strong> Salta, les Boliviens <strong>de</strong> La Paz et Cochabamba<br />
et les Péruviens du Sud (Arequipa, Cuzco et Tacna), outre plusieurs spécialistes <strong>de</strong> Santiago<br />
et <strong>de</strong> Lima, formèrent une autre série <strong>de</strong> réunions. Celles-ci furent encouragées par<br />
Juan Pedro Lonza et d’autres <strong>de</strong>rmatologues du nord du Chili et soutenues par Juan Honeyman<br />
(Santiago), Fernando Magill et Emilio Carranza (Lima), bénéficiant d’une assistance<br />
nombreuse. Quatre journées furent organisées à Iquique (1994), Cuzco (1996),<br />
Cochabamba (1998) et Salta (2000). ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Hevia Parga H. « Roberto Jaramillo:<br />
obituario. » Rev. Chil. Dermatol.<br />
1989; 5: 88-89.<br />
Klein Kohn O. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología chilena : una<br />
versión personal<br />
[monografía]. Laboratorios<br />
Vichy ; 1999.<br />
Lama, R. « Dr Gastón Ramírez<br />
Bravo : nota necrológica. »<br />
Rev. Chil. Dermatol. 1996;<br />
12 : 60.<br />
Esquisse historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie chilienne<br />
Maira M.E., Margozzini J.<br />
« Historia <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />
Dermatología. » Dans :<br />
Braghetto I., Korn O. editores.<br />
Historia <strong>de</strong>l Hospital Clínico<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Chile.<br />
Hospital Clínico <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad <strong>de</strong> Chile ; 2002.<br />
p. 309-332.<br />
Ramírez Bravo G. « El profesor<br />
Roberto Jaramillo Bruce :<br />
semb<strong>la</strong>nzas. » Rev. Chil.<br />
Dermatol. 1989 ; 5 : 87.<br />
Autres sources<br />
Communications écrites<br />
Octobre 2005<br />
approuvées par les<br />
<strong>de</strong>rmatologues Daniel<br />
Vil<strong>la</strong>lobos, Julia Oroz et<br />
Isabel Moreno.<br />
Communications verbales <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rmatologues Roger Lamas,<br />
Isidoro Pasmanik, Raúl<br />
A<strong>la</strong>rcón, Julita Cofré,<br />
A<strong>de</strong><strong>la</strong>ida Tolic, Antonio<br />
Guglielmetti, Ramón<br />
Staforelli, Manuel Melis, Félix<br />
Fich, Juan Honeyman, Juan<br />
Pedro Lonza, Alfredo<br />
Car<strong>de</strong>mil, Patricio Rifo,<br />
Ximena Ancic, María Elsa<br />
Maira, Walter Gübelin.
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
ÉQUATORIENNE<br />
Mauro Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre, Franklin Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre<br />
La région <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte ou littoral <strong>de</strong> l’Équateur s’étend entre l’océan Pacifique à l’ouest,<br />
les contreforts <strong>de</strong> <strong>la</strong> cordillère <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s à l’est, les frontières avec <strong>la</strong> Colombie au nord<br />
et avec le Pérou au sud.<br />
Cette étendue territoriale <strong>de</strong> 800 km <strong>de</strong> long et d’environ 80 000 km 2 <strong>de</strong> superficie est<br />
pour <strong>la</strong> plupart une p<strong>la</strong>ine littorale avec quelques élévations <strong>de</strong> faible hauteur, notamment<br />
dans les parties centrale et nord.<br />
Du fait <strong>de</strong> sa situation dans une zone équatoriale — comme d’ailleurs le reste du pays<br />
— et au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer, cette région littorale présente un climat tropical avec <strong>de</strong>s températures<br />
moyennes comprises entre 23º C et 26º C et <strong>de</strong>ux saisons climatiques: l’une <strong>de</strong><br />
décembre à avril — caractérisée par <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> pluies abondantes et par l’augmentation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> température moyenne — et une autre s’étendant <strong>de</strong> mai à novembre, avec<br />
<strong>de</strong>s précipitations rares et un climat plus frais.<br />
Aspects historiques<br />
Époque préhispanique<br />
MAURO MADERO IZAGUIRRE, FRANKLIN MADERO IZAGUIRRE,<br />
GALO MONTENEGRO LÓPEZ, MAURICIO COELLO URIGUEN,<br />
CLAUDIO ARIAS ARGUDO<br />
■ I. La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région côtière ou littoral<br />
Parmi les différents peuples aborigènes qui habitèrent le littoral équatorien avant<br />
l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols, les Huancavilcas attirèrent davantage l’attention <strong>de</strong>s chercheurs<br />
<strong>de</strong> notre passé médical. C’est pour ce<strong>la</strong> que notre article est basé sur les renseignements<br />
obtenus concernant ce peuple, constitué par <strong>de</strong> nombreuses tribus qui peuplèrent <strong>la</strong><br />
zone <strong>de</strong> l’actuelle province du Guayas et une partie <strong>de</strong>s provinces <strong>de</strong> Manabí et Los Ríos.<br />
Installés en pleine région tropicale, les Huancavilcas subirent <strong>la</strong> rigueur du climat;<br />
cependant, leur pathologie n’était pas très variée et ce<strong>la</strong> détermina le fait que les<br />
conquistadors espagnols aient considéré ces terres comme très saines. La pathologie cutanée<br />
pourrait être résumée à quelques ma<strong>la</strong>dies infectieuses, <strong>de</strong>s affections parasitaires<br />
195
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
196<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, <strong>de</strong>s piqûres d’insectes et <strong>de</strong>s manifestations cutanées d’intoxications provoquées<br />
par l’ingestion <strong>de</strong> boissons fermentées ou d’empoisonnements causés par <strong>de</strong>s substances<br />
qu’ils avaient ingérées ou utilisées dans leurs <strong>la</strong>nces.<br />
Selon <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s historiens, <strong>la</strong> syphilis exista dans cette zone avant <strong>la</strong> venue <strong>de</strong>s<br />
Espagnols. Ses manifestations externes étaient signalées sous les noms <strong>de</strong> boubas ou<br />
verrues, fréquemment observées non seulement parmi les habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone mais<br />
aussi les nombreuses personnes « venues d’ailleurs » qui s’y rendaient car <strong>la</strong> région<br />
était considérée « <strong>de</strong> bon tempérament » pour <strong>la</strong> guérison <strong>de</strong> plusieurs ma<strong>la</strong>dies ; ce<strong>la</strong><br />
était dû aussi bien à son climat tempéré qu’à <strong>la</strong> notoriété <strong>de</strong> ses herboristeries, notamment<br />
parce que les Guayas faisaient pousser <strong>la</strong> salsepareille au bord <strong>de</strong>s rivières, p<strong>la</strong>nte<br />
à <strong>la</strong>quelle on attribuait d’importants bienfaits thérapeutiques, même pour traiter <strong>la</strong> syphilis.<br />
Cieza <strong>de</strong> León dit à ce propos : « Et nombre <strong>de</strong> ceux qui arrivaient, les abats endommagés<br />
et le corps pourri, en buvant simplement l’eau <strong>de</strong> ces racines étaient guéris<br />
[...] et d’autres qui venaient l’état aggravé par <strong>de</strong>s boubas et qui les portaient à l’intérieur<br />
<strong>de</strong> leur corps, en buvant <strong>de</strong> cette eau les jours convenables, guérissaient aussi.<br />
Enfin, plusieurs étaient gonflés et d’autres avaient <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies et ils sont rentrés chez eux<br />
guéris. »<br />
Parmi les parasites <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, il y avait <strong>la</strong> nigua (chique), qui fut par <strong>la</strong> suite l’un <strong>de</strong>s<br />
fléaux les plus cruels pour les Espagnols, provoquant <strong>de</strong>s ulcérations; existait aussi le<br />
pou du corps et <strong>de</strong>s cheveux.<br />
Cette mé<strong>de</strong>cine aborigène est essentiellement connue à travers les récits <strong>de</strong>s premiers<br />
Espagnols; les chroniqueurs <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s nous décrivent une mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pré-Conquête instinctive, démoniaque, magique et sacerdotale; selon González Suárez,<br />
« tout le système thérapeutique se réduisait à <strong>de</strong>s bains, à <strong>de</strong>s boissons et à <strong>de</strong>s frictions;<br />
l’expérience leur en avait appris l’efficacité ».<br />
La Conquête<br />
Depuis l’arrivée <strong>de</strong> Bartolomé Ruiz — pilote espagnol habile et premier Européen à<br />
mettre le pied sur le territoire équatorien, suivi par le grand conquistador Francisco Pizarro<br />
—, les Espagnols rencontrèrent sur ces terres <strong>de</strong>s pathologies conditionnées par le<br />
milieu tropical.<br />
Le paludisme fut peut-être <strong>la</strong> pathologie <strong>la</strong> plus grave et <strong>la</strong> plus fréquente qu’ils durent<br />
affronter. Cette ma<strong>la</strong>die était endémique parmi les tribus <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte équatorienne;<br />
les Espagnols souffraient encore plus durement <strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong>s piqûres <strong>de</strong>s moustiques<br />
infectés par l’hématozoaire à tel point que, selon les chroniqueurs, ces piqûres<br />
« en conduisirent plus d’un dans <strong>la</strong> tombe et <strong>la</strong> plupart d’entre eux tombèrent ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ».<br />
Lors <strong>de</strong> son troisième voyage sur les côtes du sud, Francisco Pizarro débarqua dans<br />
<strong>la</strong> baie <strong>de</strong> San Mateo au début <strong>de</strong> 1531 et continua vers les popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> Coaque et<br />
Puerto Viejo, dans l’actuelle province <strong>de</strong> Manabí, où les Espagnols subirent une peste<br />
terrible et inconnue, qu’ils appelèrent « peste <strong>de</strong> verrues ». Cette épidémie — selon<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s réalisées au XX e siècle par certains chercheurs — semble avoir correspondu<br />
au pian, bien que certains pensent encore que ce<strong>la</strong> aurait pu être <strong>la</strong> verrue<br />
péruvienne.<br />
La variole était une autre ma<strong>la</strong>die courante à l’époque. Le Frère Pedro Ruiz Naharro,<br />
religieux <strong>de</strong> l’Ordre Notre-Dame <strong>de</strong> <strong>la</strong> Merci, dit, en évoquant au mois <strong>de</strong> mars 1531:<br />
« Dans <strong>la</strong> baie <strong>de</strong> Quaque, quelques-uns <strong>de</strong> nos Espagnols tombèrent ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s à cause <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> variole et <strong>de</strong>s boubas ; certains en moururent et d’autres restèrent le visage troué et<br />
extrêmement <strong>la</strong>ids. »<br />
Peu après avoir été fondée, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guayaquil, principal port équatorien, comptait<br />
un hôpital fréquenté par beaucoup <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> différents endroits du littoral, attirés<br />
par <strong>la</strong> réputation curative <strong>de</strong> <strong>la</strong> salsepareille fraîche. Cet hôpital disposait d’une
apothicairerie où se trouvaient tous les médicaments utilisés à l’époque, y compris le<br />
« savon brun » dont <strong>la</strong> préparation — enseignée par les Espagnols — se faisait avec<br />
l’eau <strong>de</strong> Javel obtenue <strong>de</strong>s cendres <strong>de</strong> certains bois mé<strong>la</strong>ngé à du sébum ; ce produit<br />
était popu<strong>la</strong>irement utilisé pour le bain et en particulier pour <strong>la</strong>ver les cheveux et éliminer<br />
les poux.<br />
Époque coloniale<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Vers le début du XVII e siècle, les aborigènes huancavilcas avaient quasiment disparu,<br />
en gran<strong>de</strong> partie à cause du manque <strong>de</strong> soin <strong>de</strong>s colons espagnols pour les Indiens. La<br />
santé <strong>de</strong>s habitants du littoral équatorien était entre les mains <strong>de</strong>s guérisseurs, et l’apparition<br />
d’un mé<strong>de</strong>cin titré dans ces terres était considérée par beaucoup comme<br />
l’œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Divine Provi<strong>de</strong>nce. À l’hôpital <strong>de</strong> Guayaquil, c’était en général un prêtre catholique<br />
avec <strong>de</strong>s connaissances pratiques qui soignait les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s.<br />
Il y a peu d’informations sur les ma<strong>la</strong>dies du XVII e siècle. Les chroniques mentionnent<br />
les épidémies <strong>de</strong> rougeole et <strong>de</strong> variole comme les causes <strong>de</strong>s plus grands ravages parmi<br />
notre popu<strong>la</strong>tion.<br />
Au début du XVIII e siècle, Guayaquil subit une autre épidémie <strong>de</strong> variole qui causa <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s pertes parmi sa popu<strong>la</strong>tion, s’élevant à environ 4000 habitants en 1708. Vers <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième moitié du siècle, Guayaquil ne fut plus une ville abandonnée par <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine;<br />
un grand nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins apparurent et ils prirent en charge le soin <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s,<br />
soit à l’hôpital, soit <strong>de</strong> façon particulière.<br />
La présence <strong>de</strong> ces mé<strong>de</strong>cins permit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions plus techniques <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong><br />
l’époque; <strong>de</strong>s rapports plus détaillés portèrent sur certaines affections cutanées et les<br />
différentes façons <strong>de</strong> les traiter. Un exemple en est l’emploi en 1776 d’un « remè<strong>de</strong> merveilleux<br />
» utilisé pour extirper un parasite <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau qui fut un véritable fléau, <strong>la</strong> nigua,<br />
aussi bien pour les Espagnols que pour les métis. Ce remè<strong>de</strong> merveilleux consistait à « enduire<br />
les parties où rési<strong>de</strong>nt les niguas avec <strong>de</strong> l’huile d’olive sans <strong>la</strong> réchauffer et, les<br />
niguas mourant, les petites poches qui les contiennent se décollent facilement ».<br />
La nigua et les poux, <strong>de</strong>s parasites existant <strong>de</strong>puis l’époque <strong>de</strong>s aborigènes, survécurent<br />
jusqu’à nos jours à travers <strong>la</strong> Conquête et <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> coloniale. La nigua provoque<br />
les traditionnels troubles locaux, tandis que les poux transmettent même le typhus exanthématique,<br />
que les chroniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonie mentionnent plusieurs fois.<br />
Comme au cours <strong>de</strong>s siècles précé<strong>de</strong>nts, <strong>la</strong> variole et <strong>la</strong> rougeole représentaient couramment,<br />
même au XVIII e siècle <strong>de</strong> graves problèmes. Il faut dire que durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
coloniale, ces <strong>de</strong>ux ma<strong>la</strong>dies furent endémiques sur notre littoral particulièrement à<br />
Guayaquil, mais prenaient occasionnellement un caractère épidémique, telle <strong>la</strong> nouvelle<br />
épidémie <strong>de</strong> variole <strong>de</strong> 1785.<br />
Les archives <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête ne contiennent pas d’indices sur l’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
dans notre pays à cette époque-là. Suivant <strong>la</strong> croyance d’autres pays d’Amérique, il est<br />
probable que nos aborigènes n’aient pas connu cette ma<strong>la</strong>die et qu’elle ait été importée<br />
d’Europe et peut-être aussi d’Afrique, à travers <strong>de</strong>s individus <strong>de</strong> race noire amenés pour<br />
réaliser certains travaux.<br />
Ce ne fut qu’au XVIII e siècle que <strong>la</strong> décision fut prise d’envoyer les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s souffrant<br />
<strong>de</strong> lèpre au <strong>la</strong>zaret <strong>de</strong> Carthagène <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s, ce qui s’avéra difficile du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> distance<br />
et <strong>de</strong>s mauvaises routes; les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s se promenaient alors librement dans les rues <strong>de</strong><br />
Guayaquil. C’est pour ce<strong>la</strong> que l’idée naquit d’i<strong>de</strong>ntifier tous les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville<br />
atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et <strong>de</strong> projeter <strong>la</strong> construction d’un endroit spécial où les reclure et les<br />
isoler.<br />
En 1795, un recensement <strong>de</strong>s personnes affectées par <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die révé<strong>la</strong> <strong>la</strong> présence<br />
<strong>de</strong> vingt-quatre ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s à Guayaquil; on décida alors <strong>de</strong> les envoyer soit au <strong>la</strong>zaret <strong>de</strong><br />
Carthagène <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s, soit au <strong>la</strong>zaret <strong>de</strong> Quito récemment créé.<br />
197
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
198<br />
En raison <strong>de</strong>s nouveaux cas <strong>de</strong> lèpre qui se présentaient, le besoin <strong>de</strong> disposer d’un<br />
endroit pour enfermer ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong>vint évi<strong>de</strong>nt; le premier <strong>la</strong>zaret du littoral équatorien,<br />
établi à Guayaquil, entra en fonction en 1818.<br />
L’indépendance (1820-1830)<br />
Durant cette pério<strong>de</strong>, l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine conserva les pratiques coutumières établies<br />
à l’époque coloniale et les apports scientifiques furent rares; s’ils existèrent, c’est grâce au retour<br />
sur ces terres <strong>de</strong>s rares personnes parties faire <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’étranger.<br />
Un fait très curieux et digne d’être mentionné, dont plusieurs auteurs <strong>de</strong> l’époque<br />
parlent en rapport à <strong>la</strong> couleur <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> Guayaquil, notamment <strong>de</strong>s<br />
femmes. Dans son livre Extractos <strong>de</strong> un diario escrito en <strong>la</strong>s costas <strong>de</strong> Chile, Perú y<br />
México en los años <strong>de</strong> 1820, 1821 y 1822 [Extraits d’un journal écrit sur les côtes du<br />
Chili, du Pérou et du Mexique dans les années 1820, 1821 et 1822], Basil Hall fait référence<br />
aux femmes habitant Guayaquil <strong>de</strong> <strong>la</strong> façon suivante: « Nous avions souvent entendu<br />
les éloges sur le teint c<strong>la</strong>ir <strong>de</strong>s guayaquileñas, mais nous croyions qu’il ne<br />
s’agissait que <strong>de</strong> louanges. Nous fûmes donc surpris en découvrant ces dames, b<strong>la</strong>nches<br />
et blon<strong>de</strong>s, comme n’importe quelle Européenne. Leurs yeux, différents <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong>s Espagnols,<br />
étaient bleus, et leurs cheveux c<strong>la</strong>irs. Ce<strong>la</strong> est d’autant plus extraordinaire que<br />
Guayaquil est située à un peu plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>grés au sud <strong>de</strong> l’équateur et, restant au niveau<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mer, <strong>la</strong> ville est excessivement chau<strong>de</strong> pendant toute l’année. »<br />
Dans leur Viaje a <strong>la</strong> América Meridional [Voyage en Amérique méridionale], Jorge<br />
Juan et Antonio <strong>de</strong> Ulloa soulignent aussi le fait que « ce pays étant si chaud, les habitants<br />
natifs ne sont pas basanés et que les Espagnols n’ayant pas naturellement le teint<br />
aussi b<strong>la</strong>nc, comme les nations du Nord, leurs enfants nés là sont blonds. »<br />
Les raisons que le Dr Abel Brandín fournissait en 1826 pour expliquer cette caractéristique<br />
étaient « l’influence <strong>de</strong> l’humidité du climat, <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière <strong>de</strong> vivre <strong>de</strong>s femmes,<br />
<strong>de</strong> leur parfaite inaction et soustraction à <strong>la</strong> lumière; <strong>de</strong> même que les p<strong>la</strong>ntes, qui se<br />
privent <strong>de</strong> l’impression du soleil et <strong>de</strong> toute lumière et qui fanent, per<strong>de</strong>nt leurs couleurs<br />
[…] Le manque d’exercice, <strong>de</strong> mouvement, avec <strong>la</strong> chaleur et l’humidité, favorisent le développement<br />
du tissu cellu<strong>la</strong>ire, le saturent, l’imprègnent d’humidité, et favorisent <strong>la</strong><br />
b<strong>la</strong>ncheur <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rme du visage ».<br />
Les ma<strong>la</strong>dies les plus communes parmi <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Guayaquil étaient à l’époque<br />
le paludisme, <strong>la</strong> dysenterie, <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> tuberculose, <strong>la</strong> rougeole et <strong>la</strong> syphilis.<br />
Époque républicaine (1830-1900)<br />
Dès le début <strong>de</strong> cette époque, ce qui avait été <strong>la</strong> province libre <strong>de</strong> Guayaquil et faisait<br />
désormais partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> République <strong>de</strong> l’Équateur connut un essor soutenu dans tous les<br />
domaines; suite à l’arrivée <strong>de</strong> quelques mé<strong>de</strong>cins qui décidèrent <strong>de</strong> s’installer à cet endroit,<br />
<strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine connut également un développement notable.<br />
Pendant les premières décennies <strong>de</strong> l’ère républicaine, les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine se faisaient<br />
à Quito, <strong>la</strong> seule ville d’Équateur à avoir une école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’époque; pour<br />
cette raison, les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> notre région littorale étaient <strong>de</strong>s natifs qui <strong>de</strong>vaient se<br />
dép<strong>la</strong>cer pour poursuivre leurs étu<strong>de</strong>s ou bien <strong>de</strong>s étrangers qui restaient principalement<br />
à Guayaquil. Ce<strong>la</strong> n’empêcha pas les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> Guayaquil, désireux <strong>de</strong> se surpasser<br />
scientifiquement, <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r en 1835 le Conseil départemental <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, et peu <strong>de</strong><br />
temps après <strong>la</strong> Société médicale du Guayas.<br />
L’apparition <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale du Guayas représenta une étape <strong>de</strong> surpassement et <strong>de</strong><br />
progrès dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Guayaquil, car les objectifs <strong>de</strong> cette société au cours <strong>de</strong> sa longue<br />
et fructueuse existence étaient <strong>de</strong> fixer les normes pour combattre les épidémies, défendre les<br />
mé<strong>de</strong>cins, nommer les autorités médicales <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville et participer à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong>s hôpitaux.
L’intervention du Dr Mariano Arcia mérite d’être rappelée; possiblement influencé<br />
par les récits <strong>de</strong>s guérisons d’Alibert dans les eaux sulfureuses <strong>de</strong> Tivoli, ce mé<strong>de</strong>cin pensait<br />
que nos lépreux pouvaient guérir avec les eaux sulfureuses <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Santa<br />
Elena. Il obtint alors les moyens pour faire construire un <strong>la</strong>zaret dans les mêmes endroits<br />
où jaillissaient les eaux thermales <strong>de</strong> Santa Elena, établissement qui entra en fonction à<br />
<strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1837.<br />
Entre 1842 et 1867, le littoral équatorien et particulièrement <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guayaquil subirent<br />
trois épidémies <strong>de</strong> fièvre jaune qui provoquèrent <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s pertes parmi leurs<br />
habitants.<br />
Le Comité universitaire naquit à Guayaquil en décembre 1867; cet organisme avait<br />
pour fonction d’organiser les examens d’admission <strong>de</strong> ceux qui vou<strong>la</strong>ient exercer à<br />
Guayaquil ou en province. Dix ans plus tard, en 1877, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Guayaquil<br />
ouvrit ses portes, entamant une nouvelle pério<strong>de</strong> florissante pour <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine locale.<br />
Guayaquil subit une nouvelle épidémie <strong>de</strong> fièvre jaune en 1880. Cette ma<strong>la</strong>die, avec<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>ngue, <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> rougeole, le choléra et les dysenteries, furent les maux les plus<br />
fréquents <strong>de</strong> <strong>la</strong> région pendant le <strong>de</strong>rnier quart du XIX e siècle.<br />
Première partie du XX e siècle (1900-1950)<br />
Au début du siècle, on observait déjà un certain penchant pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins généralistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte équatorienne, et leurs précieuses observations<br />
commencèrent à être divulguées dans les revues <strong>de</strong> l’époque. Nous citerons parmi ces<br />
publications:<br />
— José Ramón Boloña, « ¿Existen <strong>la</strong> B<strong>la</strong>stomicosis y <strong>la</strong> Leishmaniasis en el Ecuador?<br />
» [Est-ce que <strong>la</strong> b<strong>la</strong>stomycose et <strong>la</strong> leishmaniose existent en Équateur?], Act. Trab.<br />
I Cong. Med. Ecuat. Vol II, 97, 1917.<br />
— José Darío Moral, « Leishmaniasis Americana » [Leishmaniose <strong>américaine</strong>], Bol.<br />
Med. Cir. Año XVIII, 132, 73, 1920; et « Dermatitis Bullosa P<strong>la</strong>ntaris » [Dermatite bulleuse<br />
p<strong>la</strong>ntaire], Bol. Med. Cir. Año XXIII, 140, 67, 1921.<br />
— Juan Fe<strong>de</strong>rico Heinert, « Dermatitis Vesicu<strong>la</strong>r Aguda » [Dermatite vésicu<strong>la</strong>ire<br />
aiguë], An. Soc. Med. Quir. Guay. Vol VII, 163, 1927.<br />
— J. Insua Hi<strong>la</strong>ron, « Micetos que originan <strong>de</strong>rmatomicosis <strong>de</strong>l hombre más comunes<br />
en Guayaquil » (thèse <strong>de</strong> doctorat) [Champignons à l’origine <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatomycoses les plus<br />
fréquentes chez l’homme à Guayaquil], Rev. Univ. Guay. Año IV, 1, 128, 1933.<br />
Au fur et à mesure que le siècle avançait, l’attention prêtée aux affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
s’accrut. Les noms d’éminents généralistes publiant <strong>de</strong>s articles sur le sujet — comme<br />
Alfredo Valenzue<strong>la</strong> Valver<strong>de</strong>, Armando Pareja Coronel, José Falconí Vil<strong>la</strong>gómez — se joignirent<br />
à ceux d’autres mé<strong>de</strong>cins qui commencèrent à montrer un intérêt particulier<br />
pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, tel José Víctor Payese Gault, qui fut à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Guayaquil, appelée en son honneur<br />
chaire d’urologie, ma<strong>la</strong>dies vénériennes et <strong>de</strong>rmatologie.<br />
À sa mort, le Dr Payese fut remp<strong>la</strong>cé par le Dr Gustavo Adolfo Fassio; <strong>la</strong> scission <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chaire se produisit à ce moment-là, <strong>de</strong>venant <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité (1950-2005)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Jusqu’à <strong>la</strong> moitié du XX e siècle, sur le littoral équatorien et spécifiquement à Guayaquil<br />
— nous prenons cette ville comme référence car elle concentre <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
et le développement médical <strong>de</strong> <strong>la</strong> région —, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie était considérée comme une<br />
partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine interne et, en tant que telle, elle était exercée par les mé<strong>de</strong>cins généralistes.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 40, quelques mé<strong>de</strong>cins commencèrent à se consacrer aux<br />
199
Figure 1.<br />
Bâtiment situé au<br />
croisement <strong>de</strong><br />
l’avenue 9 Octobre et<br />
Baquerizo Moreno<br />
(Guayaquil), où<br />
fonctionnait au 4 e<br />
étage le Club médical,<br />
où fut fondée <strong>la</strong><br />
Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
200<br />
problèmes <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, entraînant le développement d’une nouvelle mentalité qui ébaucha<br />
les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que spécialité.<br />
Le changement définitif se produisit à partir <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux faits qui eurent lieu durant <strong>la</strong><br />
décennie 50-60. Le premier fut <strong>la</strong> création <strong>de</strong> services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans nos hôpitaux<br />
; le <strong>de</strong>uxième, l’apparition <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins exclusivement consacrés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
parmi lesquels se trouvaient les premiers spécialistes ayant le titre <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologues à l’étranger, apportant <strong>de</strong> nouvelles idées qui furent immédiatement<br />
accueillies.<br />
Le premier service hospitalier <strong>de</strong> soin <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guayaquil fut créé<br />
en 1952 dans <strong>la</strong> salle Santa Luisa <strong>de</strong> l’hôpital Luis Vernaza du conseil <strong>de</strong> bienfaisance <strong>de</strong><br />
Guayaquil; le créateur et premier chef du service fut le Dr Enrique Uraga Peña.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vernaza admit peu après les Drs Wences<strong>la</strong>o<br />
Ol<strong>la</strong>gue Loayza — diplômé en <strong>de</strong>rmatologie à l’école professionnelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
Madrid — et Luis Carvajal Huerta, qui furent tout comme le Dr Uraga Peña les initiateurs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Guayaquil.<br />
Ces antécé<strong>de</strong>nts furent propices au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et, par conséquent,<br />
le nombre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins qui se consacraient à <strong>la</strong> spécialité augmenta. Quelquesuns<br />
se formèrent dans nos salles d’hôpitaux tandis que d’autres eurent <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong><br />
poursuivre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s à l’étranger. Apparurent alors entre autres les Drs Espinoza<br />
Bravo, Arcos, Lasso et Murgueytio à Quito ; L. Cor<strong>de</strong>ro, J. Vintimil<strong>la</strong>, A. Quezada et<br />
C. Arias à Cuenca ; G. Fassio, W. Ol<strong>la</strong>gue et L. Carvajal à Guayaquil. Ceux-ci, avec les<br />
mé<strong>de</strong>cins déjà cités et <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’autres collègues qui se consacraient partiellement<br />
à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, firent peu à peu une p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> spécialité dans notre pays.<br />
Fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Dans les circonstances citées, le début <strong>de</strong>s années 60 fournissait un champ propice<br />
pour que tous ces spécialistes se rassemblent dans un seul ordre professionnel pleinement<br />
consacré au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, <strong>la</strong> diffusion et l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité. L’idée naquit à Guayaquil et les Drs Enrique Uraga Peña, Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue<br />
Loayza et Luis Carvajal Huerta se chargèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> concrétiser: ils entreprirent <strong>de</strong>s réunions<br />
préliminaires avec différents mé<strong>de</strong>cins du pays qui exerçaient <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie ou<br />
d’autres spécialités voisines. Le besoin apparut alors <strong>de</strong> créer une Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et on fixa <strong>la</strong> date et le lieu pour une réunion nationale au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle<br />
l’entité serait fondée.<br />
C’est ainsi que le 15 mai 1963, vingt-trois professionnels prestigieux se réunirent à<br />
Guayaquil, dans les bureaux du Club médical (figure 1) situé au quatrième étage du bâtiment<br />
qui existe encore au coin nord-ouest du croisement <strong>de</strong>s rues Baquerizo Moreno<br />
et 9 octobre, et décidèrent <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, dont nous transcrivons l’acte <strong>de</strong> constitution:<br />
ACTE DE CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ÉQUATORIENNE DE DERMATOLOGIE<br />
À Guayaquil, le quinze mai mille neuf cent soixante-trois, se réunirent dans les<br />
salles du Club médical, préa<strong>la</strong>blement convoqués par les Drs Enrique Uraga Peña,<br />
Luis Carvajal Huerta et Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza, les Drs Edmundo Blum, Bertha<br />
Rendón (née Duarte), Elena Yerovi, Silvio Torres, Germán Moreno Valero, Carlos<br />
Hidalgo González, Otto Arias, C<strong>la</strong>udio Arias, Carlos Timm, Bolívar Estrel<strong>la</strong>, Francisco<br />
Parra, Roberto Jalón, Eduardo Reina, Domingo Pare<strong>de</strong>s, Jorge Ramírez, Eudoro<br />
Moscoso, Jorge Bermeo, Carlos Espín, Felipe Aroca et Servio Peñaherrera ; qui<br />
après avoir entendu le discours prononcé par le Dr Uraga Peña, au cours duquel il<br />
annonçait que l’objectif fondamental <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion était <strong>la</strong> constitution, si on <strong>la</strong> ju-
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
geait appropriée, d’une entité qui rassemblerait tous les mé<strong>de</strong>cins enclins à un dévouement<br />
spécial pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong> syphiligraphie et <strong>la</strong> léprologie, en vue<br />
d’accroître l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces spécialités médicales et <strong>de</strong> participer par tous les moyens<br />
à leur diffusion et à leur rayonnement, accordèrent <strong>de</strong> se constituer en assemblée<br />
et désignèrent ainsi comme le Dr Uraga Peña directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite assemblée et le Dr<br />
Ol<strong>la</strong>gue Loayza comme son secrétaire, et après plusieurs commentaires favorables<br />
à cette création, il fut décidé <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> société ; le pouvoir exécutif récemment<br />
approuvé donna son accord pour <strong>la</strong> nomination du directeur et du secrétaire selon<br />
les dispositions légales en vigueur.<br />
Dr Servio Peñaherrera A. Dr Enrique Uraga P.<br />
Les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> société furent é<strong>la</strong>borés immédiatement après sa constitution, discutés et<br />
approuvés lors <strong>de</strong>s séances <strong>de</strong> l’assemblée <strong>de</strong>s 19, 21 et 22 mai <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année. Ces statuts<br />
comptaient à l’origine soixante-dix-neuf articles, dont nous citons le premier et le <strong>de</strong>rnier:<br />
Art. 1. Sous le nom <strong>de</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est créée une association<br />
scientifique <strong>de</strong> droit privé et à caractère national, dont le siège est à Guayaquil,<br />
et qui sera régie par les statuts suivants.<br />
Art. 79. L’assemblée propose un Comité <strong>de</strong> direction provisoire pour cette fois, jusqu’au<br />
mois <strong>de</strong> mai prochain.<br />
L’assemblée réunie pour approuver les statuts et observant <strong>la</strong> disposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> résolution<br />
<strong>de</strong> l’article 79 élut <strong>la</strong> commission directive provisoire; le Dr Enrique Uraga Peña<br />
<strong>de</strong>vint le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société.<br />
Peu après, le 31 juillet 1963, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> première séance au Paraninfo <strong>de</strong> l’université,<br />
le Dr Uraga Peña, en qualité <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt, déc<strong>la</strong>ra l’inauguration <strong>de</strong> <strong>la</strong> société.<br />
Dès sa fondation, le siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était à Guayaquil,<br />
ville où <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie occupait une p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> choix à l’époque. Cette particu<strong>la</strong>rité<br />
se maintint jusqu’en 1986, au moment où <strong>la</strong> réforme statutaire (que nous décrirons<br />
plus tard) al<strong>la</strong>it permettre à <strong>la</strong> société d’être intégrée et représentée à l’échelle nationale.<br />
En 1965, le Dr Uraga fut réélu prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société pour une <strong>de</strong>uxième pério<strong>de</strong>.<br />
L’entité connut au cours <strong>de</strong> sa gestion un développement efficace, aussi bien au niveau<br />
national que dans les rapports avec les sociétés <strong>de</strong>rmatologiques d’Amérique et d’Europe.<br />
LA PREMIÈRE REVUE DERMATOLOGIQUE<br />
Le Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza fut élu<br />
prési<strong>de</strong>nt le 21 juillet 1966; le Dr Luis Carvajal<br />
Huerta était le vice-prési<strong>de</strong>nt, tandis<br />
que le Dr Servio Peñaherrera Astudillo fut<br />
élu secrétaire. Cette commission établit un<br />
vaste p<strong>la</strong>n d’activités tendant à diffuser et<br />
à glorifier <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans tout l’Équateur;<br />
ce p<strong>la</strong>n comportait l’idée notable<br />
du Dr Ol<strong>la</strong>gue <strong>de</strong> disposer d’une revue<br />
propre à <strong>la</strong> spécialité dans <strong>la</strong>quelle tous les<br />
<strong>de</strong>rmatologues pourraient communiquer<br />
leurs expériences et diffuser ainsi <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans tout le pays. C’est ainsi qu’en septembre<br />
1966, parut le premier numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue Dermatología; plusieurs numéros furent<br />
publiés jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1969, où <strong>la</strong> publication fut suspendue pour <strong>de</strong>s problèmes économiques<br />
(figures 2 et 3).<br />
201<br />
Figure 2.<br />
Commission directive<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
équatorienne <strong>de</strong><br />
Dermatologie pour <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> 1966-1967.<br />
Assis : Dr Elena<br />
Yerovi, Dr Enrique<br />
Uraga, Dr Wences<strong>la</strong>o<br />
Ol<strong>la</strong>gue (prési<strong>de</strong>nt) et<br />
Dr Alfonso Coronel.<br />
Debout : Dr Tarquino<br />
Viteri, Dr Wilson<br />
Correa, Dr Servio<br />
Peñaherrera et Dr<br />
Carlos Timm<br />
Figure 3.<br />
Couverture du premier<br />
numéro<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> revue<br />
Dermatología, publié<br />
en septembre 1966
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
202<br />
FONDATION DU NOYAU DE CUENCA<br />
La commission directive <strong>de</strong> l’époque, présidée par Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue L. et Servio<br />
Peñaherrera A., se réunit à Cuenca en 1971 avec un groupe <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins — Leoncio Cor<strong>de</strong>ro<br />
J., Julio Sempértegui V., Enmanuel Peña U., Eudoro Moscoso S., Jaime Vintimil<strong>la</strong> A.,<br />
Vicente Ruilova S., Octavio Neira P., C<strong>la</strong>udio Arias A. et Jorge Pa<strong>la</strong>cios A., entre autres<br />
— et procéda à <strong>la</strong> constitution du Noyau <strong>de</strong> l’Azuay <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
choisissant en même temps sa première commission directive présidée par le<br />
Dr C<strong>la</strong>udio Arias Argudo.<br />
LES JOURNÉES ÉQUATORIENNES DE DERMATOLOGIE<br />
L’organisation du II e Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1973 à Guayaquil fut un<br />
fait marquant <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne. Cet événement permit aux spécialistes<br />
équatoriens <strong>de</strong> montrer aux nombreux <strong>de</strong>rmatologues étrangers leur capacité <strong>de</strong> recherche<br />
en présentant leurs travaux sur l’amyloïdose cutanée avec une nouvelle c<strong>la</strong>ssification<br />
qui résultait d’un recueil <strong>de</strong> cas très complet.<br />
Les I res Journées équatoriennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, précurseurs <strong>de</strong>s Congrès équatoriens<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, débutèrent en même temps et eurent lieu trois fois entre 1973<br />
et 1979.<br />
FONDATION DU NOYAU DE QUITO<br />
La <strong>de</strong>rmatologie équatorienne grandissait <strong>de</strong> manière continue. L’un <strong>de</strong> ses promoteurs,<br />
le Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza, parcourait périodiquement avec un groupe <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> Guayaquil les différentes régions du pays pour effectuer <strong>de</strong>s recherches<br />
sur <strong>de</strong>s pathologies cutanées propres à <strong>la</strong> zone et diffuser en même temps <strong>de</strong>s<br />
connaissances sur <strong>la</strong> spécialité.<br />
L’initiative, <strong>la</strong> médiation et l’intervention directe du Dr Ol<strong>la</strong>gue, aboutirent au rassemblement<br />
d’un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Quito pour fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Société<br />
équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–Noyau <strong>de</strong> Quito, en juin 1978. Ses fondateurs furent Raúl<br />
Murgueytio Stacey, Jorge Ruiz Espinoza, Magdalena Vanoni Martínez, Galo Montenegro<br />
López et Ernesto Cavie<strong>de</strong>s López. La première commission directive du Noyau <strong>de</strong> Quito<br />
fut intégrée comme suit: Dr Raúl Murgueytio, prési<strong>de</strong>nt; Dr Magdalena Vanoni, vice-prési<strong>de</strong>nte;<br />
Dr Galo Montenegro, secrétaire.<br />
LES TRIANGULAIRES DE DERMATOLOGIE<br />
Un autre événement important pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne fut conçu pendant<br />
le mandat du Dr Gonzalo Calero H.: les Triangu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie naquirent en<br />
1978, suivant le désir d’échanger <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong>s expériences et <strong>de</strong> renforcer<br />
les liens humains entre les <strong>de</strong>rmatologues équatoriens. Ces réunions furent initialement<br />
p<strong>la</strong>nifiées pour avoir lieu trois fois par an alternativement à Guayaquil, à Quito et à<br />
Cuenca, comptant sur <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong> ces trois villes. Dès le début, les Triangu<strong>la</strong>ires<br />
<strong>de</strong>vinrent les réunions les plus appréciées et les plus suivies <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
équatorienne du fait que, outre l’échange et l’actualisation <strong>de</strong>s connaissances, elles<br />
comportaient <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> cas <strong>de</strong>rmatologiques rares <strong>la</strong>rgement discutés et commentés<br />
par les assistants.<br />
Les Triangu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie conservent aujourd’hui le même esprit et <strong>la</strong> même<br />
motivation qu’elles avaient au moment <strong>de</strong> leur création; cependant, à partir <strong>de</strong> 1980, et<br />
suite à <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> sponsorisation, elles furent appelées Journées régionales <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie. Plus tard, <strong>de</strong>puis 1991 et jusqu’à nos jours, on les appe<strong>la</strong> Journées nationales<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du fait <strong>de</strong> l’inclusion d’autres villes dans l’organisation et <strong>la</strong> participation<br />
active grâce à <strong>la</strong> vaste diffusion <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Dans les <strong>de</strong>rnières années, ces<br />
journées (trente-quatre réunions déjà effectuées) sont organisées un an sur <strong>de</strong>ux pour<br />
éviter qu’elles coïnci<strong>de</strong>nt avec les congrès nationaux.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
CONGRÈS ÉQUATORIENS DE DERMATOLOGIE<br />
Les Journées équatoriennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie réalisées dans les années 70 servirent<br />
<strong>de</strong> soutien à <strong>la</strong> réalisation ultérieure <strong>de</strong>s Congrès équatoriens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui débutèrent<br />
à Guayaquil en juillet 1981 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Wilson Correa Bustamante.<br />
Depuis lors, onze congrès nationaux eurent lieu tous les <strong>de</strong>ux ans; cet événement attire<br />
un grand nombre <strong>de</strong> spécialistes équatoriens.<br />
Nous présentons ci-<strong>de</strong>ssous une chronologie <strong>de</strong>s congrès <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie réalisés en<br />
Équateur:<br />
• I er Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Guayaquil, 22 au 22 juillet 1981.<br />
• II e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Quito, 9-12 novembre 1983.<br />
• III e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Cuenca, 9-12 octobre 1985.<br />
• IV e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Guayaquil, 8-11 octobre 1987.<br />
• V e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et IX e Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
Quito, 7-12 octobre 1990.<br />
• VI e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Cuenca, 12 au 12 avril 1993.<br />
• VII e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Guayaquil, 20 au 20 juillet 1995.<br />
• VIII e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et I re Rencontre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zone bolivarienne, Quito, 1-6 mai 1997.<br />
• IX e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Cuenca, 29 avril — 3 mai 1999.<br />
• X e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Guayaquil, 19 au 19 juillet 2001.<br />
• XI e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Quito, 23 au 23 juillet 2003.<br />
LA SPÉCIALISATION EN DERMATOLOGIE EN ÉQUATEUR<br />
Jusqu’au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> décennie 80, les <strong>de</strong>rmatologues équatoriens <strong>de</strong>vaient poursuivre<br />
leur formation à l’étranger pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste; ils étudiaient en Espagne,<br />
en France, aux États-Unis, au Mexique et au Brésil, entre autres pays.<br />
La première spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie fut ouverte à l’université <strong>de</strong> Guayaquil à<br />
partir <strong>de</strong> 1982, dirigée par son promoteur, le Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza, à l’unité <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> vénéréologie et d’allergie du Dispensaire 31 <strong>de</strong> l’Institut équatorien <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sécurité sociale.<br />
Les trois premiers <strong>de</strong>rmatologues diplômés dans une université équatorienne obtinrent<br />
leur titre en juillet 1985. Désormais, les admissions <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues se font annuellement<br />
et il y a trois écoles <strong>de</strong> spécialisation: <strong>de</strong>ux à Guayaquil et une à Quito.<br />
RÉFORME ET APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIÉTÉ DE DERMATOLOGIE<br />
Jusqu’en 1986, <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fondée à Guayaquil avait travaillé<br />
efficacement en diffusant <strong>de</strong> plusieurs façons <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme spécialité<br />
dans tout le pays. C’est dans ce but, comme nous l’avons déjà dit, qu’elle avait également<br />
encouragé et participé activement à <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s Noyaux <strong>de</strong> l’Azuay et <strong>de</strong> Quito. Cependant,<br />
le cadre légal propre à <strong>la</strong> société rendait indépendant chaque noyau constitué,<br />
faisant fi <strong>de</strong> l’intégration à <strong>la</strong>dite société exigée par les statuts qui lui octroierait une véritable<br />
représentation nationale.<br />
Les représentants <strong>de</strong>s noyaux du pays organisèrent alors à partir <strong>de</strong> 1984 une série<br />
<strong>de</strong> réunions <strong>de</strong>stinées à réformer les statuts pour donner un véritable caractère national<br />
à <strong>la</strong> société.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1985, un projet <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong>s statuts fut é<strong>la</strong>boré, présenté pour son<br />
approbation légale à travers l’accord ministériel nº 697 du 26 mai 1986 et signé par le<br />
Dr Jorge Bracho Oña, le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé <strong>de</strong> l’époque.<br />
Désormais, le siège national qui avait été pendant vingt-trois ans exclusivement à<br />
Guayaquil n’est plus fixe: il doit changer tous les <strong>de</strong>ux ans et coïnci<strong>de</strong>r avec le noyau<br />
203
Figure 4.<br />
I res Journées<br />
équatoriennespéruviennes<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie dans<br />
<strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Macha<strong>la</strong>,<br />
Équateur, mai 1999<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
204<br />
siège du congrès; en même temps, le conseil dudit noyau <strong>de</strong>vient commission directive<br />
au niveau national pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> correspondante.<br />
NOUVELLES PUBLICATIONS EN DERMATOLOGIE<br />
Comme nous l’avons déjà mentionné, <strong>la</strong> première revue <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Équateur<br />
parut en 1966; quelques numéros furent imprimés <strong>de</strong> façon irrégulière jusqu’à <strong>la</strong> cessation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> publication en 1969. Désormais, seuls quelques numéros spéciaux furent publiés,<br />
isolés, mais l’entrain du Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza fit qu’une nouvelle revue,<br />
appelée Dermatología Ecuatoriana, l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
vit le jour à partir <strong>de</strong> 1986.<br />
En janvier 1992, les Drs Patricio Freire, Santiago Pa<strong>la</strong>cios et Luis Moncayo, membres<br />
du Noyau <strong>de</strong> Quito, prirent l’initiative <strong>de</strong> poursuivre les publications <strong>de</strong> nos spécialistes<br />
au moyen d’une revue appelée comme celle que le Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue avait éditée initialement<br />
en 1966. C’est grâce à l’enthousiasme et au dévouement <strong>de</strong> ses éditeurs que<br />
cette nouvelle Dermatología est encore aujourd’hui l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, plus <strong>de</strong><br />
vingt numéros d’un haut niveau scientifique étant déjà publiés.<br />
FONDATION DU PRÉ-NOYAU DE LOJA<br />
La <strong>de</strong>rmatologie équatorienne connut une croissance importante dans les années 90; les spécialistes<br />
<strong>de</strong> plusieurs villes du pays, en plus <strong>de</strong> participer activement à <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, commencèrent à former <strong>de</strong>s groupes, aspirant à <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s noyaux.<br />
Dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Loja, le Dr Jorge Bermeo Vivanco fut l’un <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie;<br />
en 1962, il étudia aux côtés <strong>de</strong>s Prs Ol<strong>la</strong>gue et Uraga à Guayaquil et, en 1978, il<br />
fut désigné professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Loja.<br />
Le Dr Juan Jaramillo Puertas, pour sa part, était chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ville <strong>de</strong>puis 1968.<br />
Les premiers mé<strong>de</strong>cins formés et diplômés comme <strong>de</strong>rmatologues avec le Pr. Ol<strong>la</strong>gue<br />
à Guayaquil arrivèrent à Loja à partir <strong>de</strong> 1985. Beatriz Ojeda fut <strong>la</strong> première, suivie par<br />
Antonio Reyes; tous <strong>de</strong>ux formèrent en 1994 le pré-Noyau <strong>de</strong> Loja, auquel d’autres spécialistes<br />
s’ajoutèrent plus tard.<br />
JOURNÉES ÉQUATORIENNES-PÉRUVIENNES DE DERMATOLOGIE<br />
Les Journées équatoriennes-péruviennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
constituent un véritable fait marquant <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
équatorienne; ces rencontres scientifiques et amicales entre<br />
professionnels <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux pays représentèrent non seulement un<br />
échange international précieux mais aussi un événement significatif<br />
en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> et <strong>de</strong>s circonstances singulières, <strong>la</strong><br />
guerre du Cenepa entre l’Équateur et le Pérou.<br />
Le promoteur <strong>de</strong> ces journées fut le Dr Gonzalo Calero Hidalgo,<br />
conjointement avec le Dr Luis Chiriboga Ardito, prési<strong>de</strong>nt à<br />
l’époque du Noyau du Guayas.<br />
Les premières Journées équatoriennes-péruviennes eurent lieu<br />
entre le 28 et le 30 mai 1999 dans <strong>la</strong> ville équatorienne <strong>de</strong> Macha<strong>la</strong>.<br />
Désormais et alternativement dans différentes villes équatoriennes et péruviennes,<br />
quatre journées furent organisées avec succès; <strong>la</strong> cinquième réunion a eu lieu<br />
à Guayaquil en juillet 2005 (figure 4).<br />
La <strong>de</strong>rmatologie équatorienne actuelle<br />
Actuellement, <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
équatorienne; <strong>la</strong> société est présente sur tout le territoire national à travers
ses 119 associés qui exercent dans les principales villes du pays. Le nombre total <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
en Équateur est légèrement supérieur à ce chiffre, mais certains spécialistes,<br />
pour diverses raisons, ne sont pas inscrits à <strong>la</strong> société.<br />
La direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> société est exercée en alternance par les noyaux <strong>de</strong> Guayaquil,<br />
Quito et Cuenca pour <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans. Actuellement (2003-2005), c’est le Noyau<br />
<strong>de</strong> l’Azuay qui dirige <strong>la</strong> société, dont le prési<strong>de</strong>nt — du noyau, et donc au niveau national<br />
— est le Dr Víctor León Chérrez, <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Cuenca.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie est enseignée dans les trois écoles <strong>de</strong> spécialisation déjà mentionnées,<br />
qui admettent annuellement une moyenne <strong>de</strong> dix <strong>de</strong>rmatologues.<br />
L’hospitalisation <strong>de</strong>s patients souffrant d’affections <strong>de</strong>rmatologiques est actuellement<br />
une constante dans les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s hôpitaux <strong>de</strong>s principales villes équatoriennes.<br />
Le soin <strong>de</strong>rmatologique ambu<strong>la</strong>toire se fait dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s hôpitaux du<br />
pays ainsi que dans <strong>de</strong>s unités plus petites ou <strong>de</strong>s dispensaires consacrés à <strong>la</strong> spécialité.<br />
Au niveau national, <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité est constante à travers <strong>la</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong> cours, <strong>de</strong> journées et <strong>de</strong> congrès; nos <strong>de</strong>rmatologues assistent régulièrement aux événements<br />
internationaux les plus importants pour partager et acquérir <strong>de</strong>s connaissances.<br />
PRÉSIDENTS DE LA SOCIÉTÉ ÉQUATORIENNE DE DERMATOLOGIE<br />
Dr Enrique Uraga Peña: 1964-1965, 1965-1966.<br />
Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza: 1966-1967, 1967-1968, 1970-1971, 1981-1983.<br />
Dr Luis Carvajal Huerta: 1968-1969, 1969-1970, 1973-1974.<br />
Dr Servio Peñaherrera Astudillo: 1971-1972, 1972-1973, 1974-1975, 1975-1976.<br />
Dr Gonzalo Calero Hidalgo: 1976-1977, 1977-1978, 1993-1995.<br />
Dr Humberto Ferretti Jurado: 1978-1979.<br />
Dr Wilson Correa Bustamante: 1979-1980, 1980-1981.<br />
Dr Luis Chiriboga Ardito: 1983-1985.<br />
Dr José Ol<strong>la</strong>gue Torres: 1986-1988.<br />
Dr Carlos Carvajal Hernán<strong>de</strong>z: 1988-1990.<br />
Dr Franklin Enca<strong>la</strong>da Córdova: 1990-1992.<br />
Dr Oswaldo Reyes Baca: 1995-1997.<br />
Dr Marcelo Merchán Manzano: 1997-1999.<br />
Dr Franklin Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre: 1999-2001.<br />
Dr Santiago Pa<strong>la</strong>cios Álvarez: 2001-2003.<br />
Dr Víctor León Chérrez: 2003-2005.<br />
Grands <strong>de</strong>rmatologues équatoriens<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Nous présentons ici une brève biographie <strong>de</strong> quelques-uns <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues les plus<br />
influents du pays, choisis entre ceux qui ne sont plus parmi nous, en hommage à leur<br />
mémoire et à leur œuvre dans l’intérêt <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne.<br />
DR ENRIQUE URAGA PEÑA (1902-1980)<br />
Né à Guayaquil, il fut le fondateur et le premier directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, charge qu’il exerça pendant <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s, étant désigné par <strong>la</strong> suite<br />
prési<strong>de</strong>nt honoraire. Fondateur du premier service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Guayaquil. Professeur<br />
titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’université <strong>de</strong> Guayaquil. Doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s<br />
sciences médicales <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Guayaquil. Membre <strong>de</strong> plusieurs sociétés <strong>de</strong>rmatologiques<br />
d’Amérique Latine (figure 5).<br />
DR WENCESLAO OLLAGUE LOAYZA (1927-1990)<br />
Il naquit à Santa Rosa, province <strong>de</strong> El Oro, mais il déploya son activité professionnelle<br />
à Guayaquil. Considéré par beaucoup comme le <strong>de</strong>rmatologue équatorien le plus réputé,<br />
205
Figure 5.<br />
Dr Enrique Uraga<br />
Figure 6.<br />
Dr Wences<strong>la</strong>o<br />
Ol<strong>la</strong>gue Loayza<br />
Figure 7.<br />
Dr Raúl<br />
Murgueytio<br />
Stacey<br />
Figure 8.<br />
Dr Servio<br />
Peñaherrera<br />
Astudillo<br />
Figure 9.<br />
Dr Luis Carvajal<br />
Huerta<br />
Figure 10.<br />
Dr Franklin<br />
Enca<strong>la</strong>da Córdova<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
206<br />
il fut formé à Madrid aux côtés <strong>de</strong> Gay Prieto et<br />
Gómez Orbaneja. Fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, il en fut le prési<strong>de</strong>nt à<br />
plusieurs occasions. Il remplit les plus hautes<br />
fonctions au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération bolivarienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Fondateur <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, vénéréologie et allergie du IESS à<br />
Guayaquil, qui porte actuellement son nom. Professeur<br />
principal <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie aux facultés<br />
<strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Guayaquil<br />
et <strong>de</strong> l’université catholique <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong><br />
Guayaquil. Auteur du Manual <strong>de</strong> Dermatología<br />
[Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie]. Chercheur notable, il<br />
réalisa plusieurs travaux scientifiques publiés<br />
dans <strong>de</strong>s revues nationales et étrangères. Son<br />
plus grand mérite fut <strong>de</strong> mener <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
équatorienne au plus haut niveau mondial (figure<br />
6).<br />
DR RAÚL MURGUEYTIO STACEY (1924-1992)<br />
Né dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Jipijapa, province <strong>de</strong> Manabí,<br />
il exerça sa profession à Quito. Formé dans<br />
les hôpitaux <strong>de</strong> Baltimore, Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie et New York, il retourna au pays pour travailler<br />
comme <strong>de</strong>rmatologue dans les hôpitaux Baca Ortiz, Andra<strong>de</strong> Marín et <strong>de</strong> SOLCA. Professeur<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université centrale <strong>de</strong> Quito. Fondateur<br />
et premier directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Noyau <strong>de</strong> Quito.<br />
Membre <strong>de</strong> l’académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> société équatorienne <strong>de</strong> pédiatrie et <strong>de</strong> l’académie équatorienne <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine (figure 7).<br />
DR SERVIO PEÑAHERRERA ASTUDILLO (1932-1995)<br />
Originaire <strong>de</strong> Girón, province <strong>de</strong> l’Azuay, il exerça son activité à Guayaquil. Il se spécialisa<br />
en santé publique et <strong>de</strong>rmatologie au Brésil. Il fut membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />
équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et son prési<strong>de</strong>nt à quatre reprises. Il fut également professeur<br />
d’épidémiologie et <strong>de</strong> bio-statistique, professeur <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, sous-doyen et doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales<br />
<strong>de</strong> l’université catholique <strong>de</strong> Guayaquil, sous-secrétaire régional <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et auteur <strong>de</strong><br />
plusieurs travaux scientifiques et <strong>de</strong> publications médicales (figure 8).<br />
DR LUIS CARVAJAL HUERTA (1925-2001)<br />
Né à Quito, il fit ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Argentine et aux États-Unis pour exercer<br />
ensuite <strong>la</strong> spécialité à Guayaquil. Il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Luis Vernaza, professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Guayaquil,<br />
professeur et directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie à l’université catholique<br />
<strong>de</strong> Guayaquil et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il est l’auteur <strong>de</strong><br />
plusieurs recherches originales méritant <strong>la</strong> reconnaissance internationale (figure 9).<br />
DR FRANKLIN ENCALADA CÓRDOVA (1944-1991)<br />
Originaire <strong>de</strong> Limón, province <strong>de</strong> l’Azuay, il commença ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
avec le Pr. Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue; il se rendit ensuite en Argentine où il obtint son titre<br />
<strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie. Il travail<strong>la</strong> à Cuenca comme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue à
l’hôpital Vicente Corral Moscoso. Professeur principal <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca et prési<strong>de</strong>nt du Collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Azuay ainsi<br />
que <strong>de</strong> <strong>la</strong> société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (figure 10).<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Ecuatoriana<br />
<strong>de</strong> Dermatología. 1963-1986.<br />
Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Ecuatoriana<br />
<strong>de</strong> Dermatología. Núcleo <strong>de</strong>l<br />
Guayas. 1986–1998.<br />
Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Ecuatoriana<br />
<strong>de</strong> Dermatología. Núcleo <strong>de</strong><br />
Quito. 1978–1998.<br />
Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Ecuatoriana<br />
<strong>de</strong> Dermatología. Núcleo <strong>de</strong>l<br />
Azuay. 1971–1998.<br />
Coello Uriguen M., « Arias<br />
Argudo C. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en el Azuay. »<br />
Dermatología. 1997; V(2).<br />
Correa Bustamante W. « Discurso<br />
<strong>de</strong> Inauguración <strong>de</strong>l 1º<br />
Congreso Ecuatoriano <strong>de</strong><br />
Dermatología. » Dermatología.<br />
En.-jun. 1983; V(1).<br />
II. La Dermatologie à Quito<br />
Freire P., Moncay L. « Nota<br />
Necrológica. Dr. Raúl<br />
Murgueytio Stacey. »<br />
Dermatología. 1992; 1(2).<br />
Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre M. « Homenaje<br />
póstumo al Dr. Servio<br />
Peñaherrera A. Discurso en <strong>la</strong><br />
sesión inaugural <strong>de</strong>l 7º<br />
Congreso Ecuatoriano <strong>de</strong><br />
Dermatología. »<br />
Dermatología. 1995; 4(2-3).<br />
Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre M., Ma<strong>de</strong>ro<br />
Izaguirre F. Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología. Guayaquil;<br />
2001.<br />
Ma<strong>de</strong>ro Moreira M. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en <strong>la</strong> provincia <strong>de</strong>l<br />
Guayas. Imprenta <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casa<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Cultura, Núcleo <strong>de</strong>l<br />
Guayas. 1955.<br />
Ma<strong>de</strong>ro Moreira M. Índice <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Bibliografía Médica<br />
Ecuatoriana. Casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cultura,<br />
Núcleo <strong>de</strong>l Guayas. 1971.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Ol<strong>la</strong>gue Loayza W. « Discurso <strong>de</strong><br />
agra<strong>de</strong>cimiento al recibir<br />
con<strong>de</strong>coración <strong>de</strong>l Gobierno<br />
Nacional en el 1º Congreso<br />
Ecuatoriano <strong>de</strong> Dermatología. »<br />
Dermatología. En.-jun. 1983;<br />
V(1).<br />
Ol<strong>la</strong>gue Torres J.M. Directorio<br />
Nacional Dermatológico<br />
Ecuatoriano; 1988.<br />
Ol<strong>la</strong>gue Torres J.M. « Precursores<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología: Dr.<br />
Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza. »<br />
Dermatología. 1994; 3(2).<br />
Saeteros <strong>de</strong> García A. 3º<br />
Congreso Ecuatoriano <strong>de</strong><br />
Dermatología. Dermatología<br />
Ecuatoriana. Jun. 1986; 1(1).<br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología. Boletín<br />
Informativo Nº4; Sept. 1999.<br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología. Boletín<br />
Informativo Nº5; Ag. 2000.<br />
■ II. La <strong>de</strong>rmatologie à Quito<br />
Galo Montenegro López<br />
Il est important <strong>de</strong> connaître le passé pour vivre le présent<br />
et se projeter dans le futur.<br />
Je trouve opportun <strong>de</strong> distinguer dans ce chapitre quelques renseignements re<strong>la</strong>tifs à<br />
l’avènement, au développement et aux réussites <strong>de</strong> cette jeune société, ainsi qu’aux mé<strong>de</strong>cins<br />
qui furent à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Quito et qui <strong>la</strong> portèrent<br />
à l’échelle nationale et internationale.<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne et notamment celle <strong>de</strong> notre ville ne sont pas<br />
récentes. Plusieurs ma<strong>la</strong>dies cutanées furent traitées par <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins équatoriens uniquement<br />
connus <strong>de</strong>s générations qui eurent le privilège d’être soignées par eux.<br />
Cependant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie débuta à Quito comme une branche spéciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
en 1910. Le pionnier fut le Dr Ricardo Vil<strong>la</strong>vicencio Ponce, qui à son retour d’Europe<br />
comme mé<strong>de</strong>cin chirurgien exerça aussi <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, à <strong>la</strong>quelle il consacra avec<br />
enthousiasme une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> son temps.<br />
Les notices biographiques <strong>de</strong> Don Eduardo Samaniego y Álvarez 1 rapportent les propos<br />
du Dr Vil<strong>la</strong>vicencio: « J’ai créé <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Comment soignait-on les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau auparavant à l’hôpital? Tous avec l’onguent du soldat. N’ai-je pas<br />
formé <strong>de</strong>s disciples dans cette branche? Voilà les <strong>de</strong>rmatologues Espinoza Bravo, Lasso,<br />
207
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
208<br />
Arcos; en syphiligraphie Zambrano et Ricardo Pare<strong>de</strong>s. Je m’intéresse aux lépreux en<br />
<strong>de</strong>mandant qu’on envoie un jeune mé<strong>de</strong>cin aux États-Unis d’Amérique pour étudier le<br />
progrès du traitement <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die. » En juillet 1929, sa nomination en tant que professeur<br />
aux chaires <strong>de</strong> clinique chirurgicale, gynécologie, <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie<br />
fut ratifiée et prolongée.<br />
Notons également que le Dr Vil<strong>la</strong>vicencio occupa <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s députés,<br />
où il se distingua pour son esprit patriotique, très propre à l’époque. Après un long<br />
et fructueux travail, il décéda le 10 avril 1934.<br />
Son disciple, le Dr Manuel Vil<strong>la</strong>cís, qui prit en charge <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en<br />
1948 et fut chef <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios, lui succéda alors. Il effectua<br />
plusieurs travaux sur <strong>la</strong> lèpre, <strong>la</strong> teigne, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatite exfoliative et le charbon,<br />
entre autres, qui furent publiés dans <strong>la</strong> revue <strong>de</strong> l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios. Il dédia à<br />
son fils, le Dr Eduardo Vil<strong>la</strong>cís, un travail sur Elephantiasis nostras, publié dans <strong>la</strong> Gaceta<br />
Médica <strong>de</strong> Guayaquil. Il mourut le 27 décembre 1979 à l’âge <strong>de</strong> 80 ans, incarnant<br />
un exemple <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong> dévouement pour les générations futures.<br />
Nous pouvons aussi mentionner le Dr Luis Rendón, qui donna <strong>de</strong>s cours comme professeur<br />
adjoint et poursuivit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité aux États-Unis.<br />
Pour <strong>de</strong>s raisons d’ordre politique, <strong>la</strong> chaire fut suspendue en 1959-1960, mais elle<br />
fut rouverte en septembre 1961, à <strong>la</strong> charge du Dr Ernesto Cavie<strong>de</strong>s. Ultérieurement, le<br />
Dr Raúl Murgueytio, spécialisé aux États-Unis, assuma <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, à <strong>la</strong>quelle<br />
il apporta ses connaissances.<br />
L’œuvre du Dr Luis A. León est remarquable: disciple du Dr Vil<strong>la</strong>vicencio, il fonda en<br />
1944 <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale en vigueur jusqu’en 1972 (incluse dans l’épidémiologie),<br />
année <strong>de</strong> sa disparition pour <strong>de</strong>s raisons d’ordre politique. Le Dr Luis A. León<br />
apporta plusieurs travaux à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale; parmi les plus importants nous citerons<br />
Étiologie tréponémique <strong>de</strong> <strong>la</strong> pinta, ainsi que <strong>de</strong>s recherches diverses sur <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
en col<strong>la</strong>boration avec son fils Renato. Il fit d’autres apports dans le domaine<br />
<strong>de</strong>s mycoses profon<strong>de</strong>s telles les rhinosporidioses, les coccidioïdomycoses et les paracoccidioïdomycoses.<br />
Au cours du Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Guayaquil en<br />
1973, il présenta le travail Gale en Amérique. Il fit ressortir également en 1952 l’existence<br />
<strong>de</strong> l’onchocercose dans le pays, dans son travail À propos <strong>de</strong>s simuli<strong>de</strong>s qui transmettent<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Signalons que le Dr León fut le mé<strong>de</strong>cin équatorien qui édita le plus<br />
grand nombre <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité: plus <strong>de</strong> 150 étu<strong>de</strong>s publiées dans <strong>de</strong>s revues<br />
étrangères et nationales.<br />
Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années les noms <strong>de</strong>s Drs Holger Garzón, Jorge Ruiz et Galo<br />
Montenegro — ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers suivant leur spécialisation au Brésil — furent liés à <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
La formation <strong>de</strong> notre société fut consubstantiellement liée à <strong>la</strong> spécialité. Après plusieurs<br />
tentatives infructueuses, <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–Noyau <strong>de</strong> Quito fut fondée au<br />
mois <strong>de</strong> novembre 1977, ce qui <strong>de</strong>vint effectif à travers l’accord ministériel nº 9956 du<br />
20 juin 1978 (le Dr Asdrúbal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Torre était ministre). Le Dr Raúl Murgueytio en fut le<br />
premier prési<strong>de</strong>nt et le groupe était intégré par les Drs Jorge Ruiz, Mario Sarzosa, Holger<br />
Garzón, Magdalena Vanoni et Galo Montenegro.<br />
L’article 1 er <strong>de</strong>s statuts stipule: « La société fut fondée pour stimuler l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong>rmatologiques et pour développer l’amitié et <strong>la</strong> coopération professionnelle<br />
entre ses membres. »<br />
La commission directive est renouvelée tous les <strong>de</strong>ux ans. Ses prési<strong>de</strong>nts furent les<br />
Drs Magdalena Vanoni, Jorge Ruiz, Galo Montenegro, Carlos Carvajal, Dolores Fusseu,<br />
Ramiro Campuzano, Oswaldo Reyes, Julia Vil<strong>la</strong>nueva, Santiago Pa<strong>la</strong>cios et actuellement<br />
le Dr Eduardo Garzón.<br />
Depuis sa fondation, <strong>la</strong> société organise <strong>de</strong>s réunions mensuelles auxquelles participent<br />
ses membres et qui ont lieu le troisième jeudi du mois dans les hôpitaux Enrique
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Garcés du Sud, militaire, hôpital du IESS, <strong>de</strong>rmatologique Gonzalo González, et parfois à<br />
l’hôpital Voz An<strong>de</strong>s. La présentation <strong>de</strong> cas cliniques est importante, ainsi que les considérations<br />
sur les problèmes <strong>de</strong> l’actualité médicale.<br />
L’organisation <strong>de</strong>s Triangu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, sponsorisées par <strong>la</strong> maison Schering-<br />
Plough, débuta après <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> société; c’est ainsi que le nom du responsable <strong>de</strong><br />
l’époque, Mauricio Camilo E<strong>de</strong>, se vit lié à l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Les villes <strong>de</strong> Guayaquil,<br />
Quito et Cuenca reçurent toujours cordialement tous les associés pour commenter les<br />
sujets les plus intéressants <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et observer les cas cliniques dont le diagnostic<br />
s’avère difficile. Les Triangu<strong>la</strong>ires transformées ultérieurement en Journées, aspirèrent<br />
toujours au progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et à l’échange entre ses membres.<br />
Le 2 e Congrès <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu à Quito en 1983. Des professeurs aussi bien<br />
nationaux qu’étrangers y assistèrent; le sujet principal traité avec l’apport du Noyau <strong>de</strong><br />
Quito fut « Principales <strong>de</strong>rmatoses dans les régions <strong>de</strong> l’Équateur ».<br />
La leishmaniose fut également abordée par le Noyau <strong>de</strong> Quito lors du 1 er Congrès <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> spécialité à Guayaquil en 1981. Au cours du 3 e Congrès, à Cuenca, le sujet fut « Étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’épithéliome basocellu<strong>la</strong>ire dans les hôpitaux <strong>de</strong> Quito ».<br />
Il est important <strong>de</strong> parler ici <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>rmatologique Gonzalo González,<br />
dont <strong>la</strong> croissance fut parallèle à celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Quito. En 1785, les patients<br />
lépreux étaient hébergés à l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> Misericordia <strong>de</strong>l Señor. En 1882, ils<br />
étaient isolés à l’hôpital et asile San Lázaro, où ils recevaient un traitement rigoureux et<br />
inhumain car on les poursuivait et ils étaient ensuite abandonnés à leur sort.<br />
En 1911, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du général Eloy Alfaro, les patients furent transférés à Pifo,<br />
dans un immeuble qui avait appartenu à <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong>s pères jésuites, déjà expulsés.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Isidro Ayora, on construisit <strong>la</strong> léproserie Ver<strong>de</strong> Cruz qui<br />
pouvait héberger 150 patients; elle fut inaugurée le 2 avril 1927, à caractère national.<br />
Son premier directeur fut le Dr Eduardo Egas, qui exerça sa charge jusqu’en 1933. La<br />
léproserie fut construite dans le but d’isoler les patients, c’était un hôpital prison. De petites<br />
murailles <strong>de</strong> cette époque subsistent actuellement. Il y avait <strong>de</strong>s parloirs, <strong>de</strong>s fenêtres<br />
gril<strong>la</strong>gées à travers lesquelles les patients par<strong>la</strong>ient avec leur famille ou dictaient<br />
<strong>de</strong>s lettres. La circu<strong>la</strong>tion d’argent y était interdite et on avait instauré à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce un système<br />
<strong>de</strong> tampons. L’assistance sociale aidait au moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> « petite pâte », une subvention<br />
quotidienne qui conserve toujours son nom, provenant d’un morceau <strong>de</strong> pâte à pain<br />
que l’on donnait aux patients lors <strong>de</strong> leur séjour à l’hôpital San Lázaro. Ils y étaient isolés<br />
et enfermés à vie.<br />
Le Dr Luis Rendón — il avait fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie aux États-Unis — en fut nommé<br />
directeur à partir <strong>de</strong> 1933, exerçant sa charge pendant dix-sept ans consécutifs; il eut <strong>la</strong> chance<br />
d’être témoin <strong>de</strong> l’apparition du traitement miraculeux contre <strong>la</strong> lèpre: les sulfones. Il entreprit<br />
les démarches pour le faire venir dans le pays, où ils commencèrent à être administrés en 1947.<br />
C’est avec le Dr Rendón que commença <strong>la</strong> campagne antilépreuse en Équateur.<br />
En 1948, le Dr Gonzalo Hernán<strong>de</strong>z réalisa à Quito sa thèse <strong>de</strong> doctorat Recensement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Équateur et il remp<strong>la</strong>ça le Dr Rendón dans <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne; il<br />
découvrit que les provinces les plus affectées étaient El Oro, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar<br />
et Carchi.<br />
Le Dr Gonzalo González, qui avait fait sa thèse <strong>de</strong> doctorat en 1947 sur le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre avec <strong>la</strong> promanada, fut nommé directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie en 1957. À<br />
l’époque, l’institution subit <strong>de</strong>s changements et <strong>de</strong>s transformations notables. Les anciennes<br />
barrières <strong>de</strong> méfiance s’effondrèrent. On permit <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> l’argent et<br />
l’échange libre <strong>de</strong> correspondance ; les parloirs disparurent et l’endroit prit peu à peu<br />
l’apparence d’un véritable hôpital. Grâce à <strong>la</strong> fondation catholique alleman<strong>de</strong> Har<strong>de</strong>seen,<br />
on entreprit <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> <strong>la</strong> cita<strong>de</strong>lle du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Hansen. Le Dr González<br />
occupa son poste <strong>de</strong> directeur jusqu’en 1968, quand <strong>la</strong> mort le surprit <strong>de</strong> façon prématurée.<br />
209
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
C’est le Dr Mario Sarzosa qui prit <strong>la</strong> relève, travail<strong>la</strong>nt avec le même enthousiasme<br />
pour <strong>la</strong> réhabilitation du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Hansen. La léproserie <strong>de</strong>vint clinique, portant le nom<br />
<strong>de</strong> l’illustre mé<strong>de</strong>cin Gonzalo González. Le Dr Sarzosa consacra plus <strong>de</strong> trente ans <strong>de</strong> sa<br />
vie à <strong>la</strong> réhabilitation du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> hansénien.<br />
Le Dr Holger Garzón (dont <strong>la</strong> thèse <strong>de</strong> doctorat traita <strong>de</strong> l’Épineurolyse <strong>de</strong> nerfs périphériques)<br />
en fut nommé directeur en février 1970. Il s’occupa <strong>de</strong> poursuivre <strong>la</strong> transformation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique, donna une autre physionomie aux services d’infirmerie, créa <strong>la</strong><br />
consultation externe <strong>de</strong>rmatologique et acheva <strong>la</strong> construction <strong>de</strong> seize maisons pour les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>de</strong> Hansen.<br />
En accord avec les requêtes <strong>de</strong> l’OMS, il <strong>de</strong>manda et obtint <strong>la</strong> transformation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
clinique en hôpital <strong>de</strong>rmatologique Gonzalo González par l’accord ministériel Nº 3131 du<br />
14 août 1980 publié dans le registre officiel nº 257 du 21 août <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, signé<br />
par le Dr Humberto Guillén, ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Quito connut une croissance constante pendant les <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières<br />
décennies du XX e siècle. Les congrès, les journées, tout événement <strong>de</strong>rmatologique ayant<br />
lieu au niveau national compte toujours <strong>la</strong> présence active <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>rmatologues. Ajoutons<br />
à cette participation l’organisation et <strong>la</strong> réalisation à Quito <strong>de</strong>s événements <strong>de</strong>rmatologiques<br />
les plus importants, tels les II e , V e , VIII e et XI e Congrès équatoriens <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, ce <strong>de</strong>rnier ayant eu lieu en juillet 2003. Les anciennes Triangu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie eurent lieu à Quito <strong>de</strong>ux fois, tandis que les Journées nationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
s’y déroulèrent à plus <strong>de</strong> dix occasions.<br />
Des réunions <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> nature diverse y furent organisées: <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>de</strong> cosmétologie, <strong>de</strong> remise à niveau en <strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong> Semaine<br />
du grain <strong>de</strong> beauté — travail <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> service à <strong>la</strong> communauté —, le<br />
Symposium sur les manifestations cutanées du sida, les ateliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie générale,<br />
<strong>la</strong> réunion d’anniversaire <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>rmatologique Gonzalo González, <strong>de</strong>s rencontres<br />
<strong>de</strong>rmatologiques et <strong>de</strong>s réunions interhospitalières. Notons aussi <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Fondation équatorienne <strong>de</strong> psoriasis.<br />
Le Noyau <strong>de</strong> Quito réussit également à faciliter l’échange scientifique, culturel et social<br />
<strong>de</strong> ses membres à travers <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Maison du <strong>de</strong>rmatologue qui ouvrit ses<br />
portes en novembre 1997, et acheta peu après, en 1999, un bureau qui abrite son siège<br />
actuel.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie se vit renforcé avec l’ouverture <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie, intégrée à l’université centrale et vivier actuel <strong>de</strong>s futures<br />
générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> Quito.<br />
■ III. La Dermatologie <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Azuay <strong>de</strong> l’Azuay<br />
210<br />
■ Référence<br />
bibliographique<br />
Mauricio Coello Uriguen, C<strong>la</strong>udio Arias Argudo<br />
1. Samaniego y Alvarez, E.<br />
« Apuntes biográficos. »<br />
Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fe<strong>de</strong>ración<br />
Médica <strong>de</strong>l Ecuador, Quito,<br />
1954, 58 (XII): 17.<br />
Pour savoir comment s’est forgé notre présent, pour pouvoir<br />
l’apprécier et oser changer, améliorer et se projeter dans<br />
l’avenir, il faut fouiller dans les profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> notre passé<br />
sans méconnaître nos racines et vouloir ignorer l’histoire.
Eu égard à tout ce qui vient d’être dit, et en préambule à <strong>la</strong> véritable histoire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Azuay, il nous semble nécessaire et indispensable <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à<br />
une rétrospection rapi<strong>de</strong> et succincte <strong>de</strong> quelques faits marquants <strong>de</strong> notre histoire difficilement<br />
préservés et rappelés.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque préhispanique<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
« La paléontologie nous permit <strong>de</strong> connaître certaines représentations <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>de</strong> l’époque précolombienne; <strong>de</strong>s poteries très intéressantes représentent <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
telles que <strong>la</strong> variole 1 .»<br />
Pendant le XV e siècle, <strong>la</strong> région interandine était habitée par plusieurs tribus aborigènes:<br />
les Quitus (Pastos, Quil<strong>la</strong>cingas, Caranquis, Otavalos, Panzaleos), les Puruhaes<br />
(Liribamba), les Cañaris (Tomebamba, Guapondélig) et les Paltas, Zarzas 2 . Guapondélig<br />
— en <strong>la</strong>ngue cañari, « p<strong>la</strong>ine gran<strong>de</strong> comme le ciel » — occupait une zone territoriale<br />
bénie par <strong>la</strong> nature pour sa beauté et <strong>la</strong> générosité <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre; cette région correspond<br />
principalement aux provinces <strong>de</strong> Cañar et d’Azuay. De 8000 à 6000 ans av. J.-C. les Ayllus<br />
Cañaris (communautés cañaris), et avant eux les colonies noma<strong>de</strong>s <strong>de</strong> chasseurscueilleurs,<br />
<strong>la</strong>issèrent progressivement leurs traces dans <strong>de</strong>s vestiges archéologiques<br />
(grotte <strong>de</strong> Chobshi: Sigsig). Des communautés agro-potières dérivées <strong>de</strong>s premiers habitèrent<br />
les vallées <strong>de</strong> Guapondélig et imprimèrent à <strong>la</strong> race un <strong>de</strong>stin <strong>de</strong> céramistes, d’artisans<br />
et d’agriculteurs 3 .<br />
Après une incursion longue et prolongée qui al<strong>la</strong>it commencer en 1450, <strong>la</strong> conquête inca<br />
tint sous son joug, avec Yupanqui (grand-père <strong>de</strong> Huayna-Cápac), toute <strong>la</strong> région interandine<br />
suite à <strong>de</strong>s batailles sang<strong>la</strong>ntes, aboutissant à <strong>la</strong> soumission stratégique <strong>de</strong>s Cañaris et<br />
à l’imposition <strong>de</strong> certaines conditions antérieures à l’occupation <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine qu’ils appelèrent<br />
Tomebamba, et qui <strong>de</strong>viendrait <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième capitale <strong>de</strong> l’empire 4 ; ils imposèrent <strong>de</strong> ce<br />
fait leur culture cuzqueña en apportant <strong>de</strong>s éléments quechuas à <strong>la</strong> vie <strong>de</strong>s natifs.<br />
L’Inca Túpac-Yupanqui emmena <strong>de</strong>puis Cuzco son épouse principale Mama Ocllo<br />
(1450), et c’est ici que naquit l’héritier <strong>de</strong>s « Enfants du soleil »: Huayna-Cápac (1452).<br />
« Tomebamba <strong>de</strong>vint l’endroit et le sanctuaire majeur, après <strong>la</strong> mythique capitale <strong>de</strong><br />
l’empire messianique »; elle fut alors <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième capitale qui prétendait imiter <strong>la</strong>rgement<br />
<strong>la</strong> splen<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> Cuzco. Les plus hautes fonctions militaires, administratives et religieuses<br />
se concentrèrent ici; et c’est ici aussi que le plus grand <strong>de</strong>s souverains incas,<br />
Huayna-Cápac, vécut pendant <strong>de</strong>s lustres 4 .<br />
La mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s sorciers et <strong>de</strong>s amautas <strong>de</strong> l’époque précolombienne fut principalement<br />
teothérapique (conjurations et amulettes), phytothérapique (antitoxique, cathartique<br />
narcotique, fébrifuge), magique et religieuse (utilisation d’herbes et <strong>de</strong> produits<br />
végétaux, étant très probablement à l’origine <strong>de</strong> beaucoup <strong>de</strong> cas <strong>de</strong> nos phyto<strong>de</strong>rmatoses<br />
actuelles), mais aussi chirurgicale (guérison <strong>de</strong>s ulcères, momification, trépanation, orification<br />
<strong>de</strong>ntaire, réduction crânienne — tzantzas) et ne manquait pas <strong>de</strong> quelques<br />
connaissances anatomiques et d’un certain discernement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies, <strong>de</strong>s épidémies et<br />
<strong>de</strong>s endémies 2 .<br />
Parmi les épidémies, <strong>la</strong> variole décima <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène et même les colonisateurs<br />
espagnols 1, 2 . D’après Cieza <strong>de</strong> León, en 1526, l’empereur du Tahuantinsuyo,<br />
Huayna Cápac, contracta <strong>la</strong> variole et mourut finalement <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die 5 . Cependant,<br />
outre <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène subit également <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Chagas, <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
<strong>la</strong> tuberculose et <strong>la</strong> syphilis 1 .<br />
À <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Huayna Cápac, son testament divisa le royaume entre ses <strong>de</strong>ux fils:<br />
Huáscar au sud (Cuzco) et Atahualpa (fils d’une princesse <strong>de</strong> Quito) au nord; c’est ainsi<br />
que l’unité <strong>de</strong> l’empire fut dissoute.<br />
Vers 1530-1531, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> Huáscar par Atahualpa à Huamachuco,<br />
une épidémie <strong>de</strong> typhus sur le territoire équatorien fut décrite pour <strong>la</strong> première fois.<br />
211
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
212<br />
En 1533, l’histoire fait mention <strong>de</strong> <strong>la</strong> première épidémie <strong>de</strong> variole en Équateur 2 .<br />
Quelques années plus tard, en 1536, Atahualpa fut assassiné à coups <strong>de</strong> gourdin à Cajamarca<br />
5 .<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l´époque hispanique et prérépublicaine<br />
Afin <strong>de</strong> traiter l’époque hispanique et pré républicaine, il faut réviser certains aspects<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine traditionnelle. À partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête du Nouveau<br />
Mon<strong>de</strong>, l’Espagne s’émerveil<strong>la</strong> pour les p<strong>la</strong>ntes curatives référencées qui enthousiasmèrent<br />
les mé<strong>de</strong>cins et <strong>la</strong> société du XVI e siècle. Même Philippe ll ordonna <strong>la</strong> récolte <strong>de</strong>s espèces<br />
les plus fameuses du Mexique pour les apporter sur <strong>la</strong> péninsule.<br />
De historia p<strong>la</strong>ntarum novae hispanie est un ouvrage révolutionnaire du mé<strong>de</strong>cin Francisco<br />
Hernán<strong>de</strong>z 6 qui énumère toutes les p<strong>la</strong>ntes connues <strong>de</strong>s Indiens, servant à guérir les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s abandonnés par les mé<strong>de</strong>cins. Des explorateurs et <strong>de</strong>s aventuriers plus ou moins<br />
chanceux parcoururent <strong>la</strong> route <strong>de</strong> Colomb avec <strong>de</strong>s cargaisons <strong>de</strong> végétaux prodigieux.<br />
Nous sommes ainsi face à <strong>la</strong> « mé<strong>de</strong>cine alternative », marginalisée avec un certain<br />
dédain et considérée comme étant <strong>la</strong> science <strong>de</strong>s « guérisseurs ». L’existence <strong>de</strong> cette mé<strong>de</strong>cine,<br />
qui remonte à l’origine <strong>de</strong>s peuples, fut reconnue par l’OMS 7 ; d’origine popu<strong>la</strong>ire,<br />
elle fut jugée empirique, basée sur certaines expériences ou connaissances, explicables<br />
ou non, ce qui ne l’empêcha pas <strong>de</strong> franchir les limites <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine orthodoxe et <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>meurer une activité parfois complémentaire, comme une réponse aux convictions profondément<br />
ancrées dans un peuple qui est le produit d’un métissage culturel. Le territoire<br />
entre ces <strong>de</strong>ux « écoles » fut délimité par <strong>la</strong> conception aborigène <strong>de</strong> <strong>la</strong> nosologie<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies.<br />
En effet, on par<strong>la</strong>it <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue, et <strong>de</strong> « ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> Dieu » 8 .<br />
Les premières avaient une origine surnaturelle; <strong>la</strong> tradition magico-religieuse en fit<br />
l’apanage <strong>de</strong>s guérisseurs, tandis que les <strong>de</strong>uxièmes appartenaient au domaine du mé<strong>de</strong>cin.<br />
Un certain critère fondamentaliste prétendait qu’un mé<strong>de</strong>cin ne guérissait pas une<br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> <strong>la</strong> rue; <strong>de</strong> même, si le guérisseur n’arrivait pas à l’améliorer, elle était du ressort<br />
du mé<strong>de</strong>cin.<br />
Les connaissances plus ou moins éc<strong>la</strong>irées en herboristerie, ajoutées à <strong>la</strong> conception<br />
que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die était liée à <strong>de</strong>s phénomènes cosmiques et <strong>de</strong>s convictions magico-religieuses,<br />
favorisèrent l’apparition d’une thérapeutique basée sur ces mêmes facteurs.<br />
L’utilisation <strong>de</strong> certains végétaux comme <strong>la</strong> rue (Ruta graveolens), l’herbe <strong>de</strong> Sainte-<br />
Marie (Pyrethrum parthenium), <strong>la</strong> figue (Ficus carica) et l’ail, employés pour les « nettoyages<br />
» et autres soins, provoquèrent quelques <strong>de</strong>rmatites sur le front, le nombril et<br />
sur le reste du corps, là où étaient appliquées les herbes sensibilisatrices. On procédait<br />
à cette pratique pour conjurer le mauvais œil, le « mal <strong>de</strong> l’air et l’épouvante » (ces maux<br />
faisaient partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie cosmique et surnaturelle, avec <strong>de</strong>s tableaux cliniques<br />
définis selon l’expérience).<br />
Le vitiligo était perçu comme un mal causé par l’homme; l’iguane joua ici un rôle majeur<br />
dans <strong>la</strong> croyance d’une punition, d’un stigmate contre les voleurs. Vega G. 6 écrivait :<br />
« Une personne a le mauvail oeil quand le jeteur <strong>de</strong> sort s’en prend à elle: ses cheveux<br />
tombent alors... » Pour cette pathologie, l’alopécie areata enigmatique et le vitiligo<br />
concor<strong>de</strong>nt avec certains arguments interprétatifs.<br />
En 1526, sous le règne <strong>de</strong> Charles Quint (1520-1556) — vingt-quatre ans après <strong>la</strong> découverte<br />
<strong>de</strong> l’Amérique et treize ans après celle <strong>de</strong> l’océan Pacifique —, les Espagnols<br />
débarquèrent à Esmeraldas, sur <strong>la</strong> côte équatorienne, commandés par le pilote Bartolomé<br />
Ruiz 2 . Entre 1531 et 1532, les troupes espagnoles provenant du Panama, commandées<br />
par Francisco Pizarro, firent leur incursion sur le territoire actuellement occupé par<br />
l’Équateur; ils arrivèrent par les côtes <strong>de</strong> Manabí, secteur <strong>de</strong> Coaque. Ce fut là qu’ils découvrirent<br />
pour <strong>la</strong> première fois <strong>la</strong> pathologie régionale: <strong>la</strong> verrue péruvienne que les
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
chroniqueurs appe<strong>la</strong>ient bouba, <strong>la</strong> confondant avec <strong>la</strong> syphilis; certains auteurs pensent<br />
qu’il s’agissait probablement d’un premier signe <strong>de</strong> pian qui contamina plusieurs soldats<br />
espagnols 5 .<br />
Parmi les faits historiques les plus importants nous citerons <strong>la</strong> fondation espagnole <strong>de</strong><br />
Quito en 1534. En 1535 furent fondées Guayaquil, Portoviejo et Lima, et une<br />
nouvelle épidémie <strong>de</strong> variole sévit en Équateur. En 1537, Guayaquil fut nouvellement<br />
fondée, avec 150 habitants; <strong>la</strong> bulle <strong>de</strong> Paul lll condamnant l’esc<strong>la</strong>vage<br />
<strong>de</strong>s Indiens et déc<strong>la</strong>rant qu’eux et les Noirs « (étaient) vraiment <strong>de</strong>s<br />
hommes » fut émise au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année. Le décret royal ordonnant <strong>la</strong><br />
fondation d’hôpitaux fut proc<strong>la</strong>mé à <strong>la</strong> même époque. La ville <strong>de</strong> Loja fut fondée<br />
en 1547, tandis que <strong>de</strong>s décrets royaux furent émis pour protéger <strong>la</strong> santé<br />
<strong>de</strong>s Indiens. En 1555 fut fondée l’université <strong>de</strong> San Marcos <strong>de</strong> Lima. Durant le<br />
gouvernement <strong>de</strong> Philippe II, Andrés Hurtado <strong>de</strong> Mendoza,<br />
vice-roi du Pérou et marquis <strong>de</strong> Cañete, expédia à Lima le<br />
15 mai 1550 un décret pour fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Cuenca. Gil<br />
Ramírez Dávalos choisit le lieu dit « Paucarbamba » (Tomebamba)<br />
pour <strong>la</strong> nouvelle ville; ce fut ainsi que <strong>la</strong> ville <strong>de</strong><br />
Cuenca entra dans l’histoire un lundi <strong>de</strong> Pâques (le 12 avril<br />
1557) et délimita les territoires sous son autorité, à savoir: au<br />
nord jusqu’au vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> natifs appelé Tiquizambi, au sud jusqu’aux<br />
villes <strong>de</strong> Loja et Zamora, à l’est jusqu’à Macas, Cuyena<br />
et Zuña, et vers l’ouest jusqu’aux limites <strong>de</strong> l’île Puná. Les terrains<br />
furent partagés et on appe<strong>la</strong> <strong>la</strong> rue qui traverse <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
d’armes <strong>la</strong> rue Santa Ana 9, 10 (figures 11 et 12). D’autres décrets<br />
royaux furent émis vers <strong>la</strong> même époque: <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s communs et pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s contagieux <strong>de</strong>vaient<br />
exister séparément dans toutes les villes 2 .<br />
Une nouvelle épidémie <strong>de</strong> variole en Équateur, combattue avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> salsepareille et<br />
du bâton <strong>de</strong> guayacán, fut décrite en 1558. L’audience royale et <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Quito<br />
(Hernando <strong>de</strong> Santillán) débutèrent en 1564, en même temps que l’organisation coloniale<br />
2 . En 1565 fut fondé le premier hôpital, celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Caridad y Misericordia <strong>de</strong><br />
Nuestro Señor Jesucristo à Quito.<br />
Au cours <strong>de</strong>s années 1580, 1581, 1587, 1589 et 1590 se produisirent <strong>de</strong> nouvelles épidémies<br />
<strong>de</strong> variole et <strong>de</strong> rougeole en Équateur, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière provoquant environ 30000<br />
morts. Le premier hôpital <strong>de</strong> Guayaquil, administré par le frère Baltasar <strong>de</strong> Peralta, fut<br />
fondé en 1660, tout comme <strong>la</strong> première apothicairerie. Une bulle <strong>de</strong> 1596 permit <strong>la</strong> création<br />
à Quito <strong>de</strong> <strong>la</strong> première université du pays — <strong>la</strong> quatrième en Amérique, San Fulgencio,<br />
à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s religieux augustiniens. Elle fonctionna à partir <strong>de</strong> 1603 2 , mais <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine n’y était pas enseignée. En 1608, le conseil <strong>de</strong> Quito nomma Jerónimo Leyton<br />
comme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, mais il ne recevait aucun sa<strong>la</strong>ire pour ce<strong>la</strong>. Après <strong>la</strong> découverte<br />
<strong>de</strong> plusieurs morts à Quito à cause d’une épidémie inconnue, le conseil décida en<br />
1609 d’embaucher le Dr Meneses et <strong>de</strong> lui payer « 300 patacons <strong>de</strong> huit reals chacun »<br />
2 . En 1611 et 1612 se succédèrent à Quito <strong>de</strong>s épidémies <strong>de</strong> tabardillo, rougeole et esquinencia<br />
(diphtérie), <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière se prolongeant jusqu’en 1614; le roi d’Espagne ordonna<br />
l’inspection régulière <strong>de</strong>s hôpitaux 2 .<br />
En 1622 fut fondée <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième université d’Équateur, <strong>la</strong> Real<br />
Pontificia Universidad <strong>de</strong> San Gregorio Magno, à Quito, à <strong>la</strong> charge<br />
<strong>de</strong>s pères jésuites; le roi d’Espagne conseil<strong>la</strong> <strong>de</strong> créer davantage<br />
d’asiles et d’hôpitaux 2 .<br />
Les propriétés anti-paludéennes <strong>de</strong> <strong>la</strong> quinine furent découvertes<br />
à Ma<strong>la</strong>catus-Loja vers 1630. Notre pays contribua <strong>de</strong> cette<br />
manière à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine mondiale car <strong>la</strong> quinine ayant été pendant<br />
213<br />
Figure 11.<br />
Fondateurs <strong>de</strong> Cuenca :<br />
Andrés Hurtado <strong>de</strong><br />
Mendoza, vice-roi du<br />
Pérou et marquis <strong>de</strong><br />
Cañete, et Don Gil<br />
Ramírez Dávalos<br />
Figure 12.<br />
P<strong>la</strong>n original du<br />
premier tracé <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> Cuenca<br />
Figure 13.<br />
Monastère <strong>de</strong>l Carmen,<br />
fondé en 1682
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
214<br />
plusieurs siècles pratiquement le seul traitement contre le paludisme 2 . Plusieurs épidémies<br />
se répandirent à Quito ultérieurement: <strong>la</strong> variole, l’alfombril<strong>la</strong>, le garrotillo (diphtérie)<br />
en 1645, et <strong>la</strong> dysenterie en 1672 et 1679. (Nous faisons allusion au monastère <strong>de</strong>l<br />
Carmen, fondé en 1682, figure 13.)<br />
L’université Santo Tomás <strong>de</strong> Aquino fut fondée à Quito en 1688 et p<strong>la</strong>cée sous <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong>s religieux dominicains; cependant, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine n’y était pas non plus enseignée.<br />
La première chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut ouverte à Quito, dans le couvent dominicain<br />
<strong>de</strong> San Fernando, en 1693, coïncidant avec une nouvelle épidémie <strong>de</strong> variole et <strong>de</strong> rougeole<br />
en Équateur. En 1694 arrivèrent les premiers mé<strong>de</strong>cins diplômés à Quito: le Dr<br />
Diego <strong>de</strong> Herrera, protomedico, qui combattit une nouvelle épidémie <strong>de</strong> variole avec <strong>la</strong><br />
« casse », et le Dr Diego Cevallos.<br />
Une gran<strong>de</strong> épidémie <strong>de</strong> variole, <strong>de</strong> rougeole et d’alfombril<strong>la</strong> eut lieu à Cuenca vers <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> 1692, se prolongeant jusqu’à octobre 1693, avec <strong>de</strong>s pertes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
moyenne (<strong>de</strong>ux par mois); cinquante-neuf personnes moururent pendant le mois <strong>de</strong> mai<br />
1693 11 .<br />
En 1706, l’ordre <strong>de</strong>s bethléemites prit en charge l’administration <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong><br />
Quito, qu’on appe<strong>la</strong> hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santa Misericordia <strong>de</strong> Nuestro Señor Jesucristo ; Luis<br />
Espejo, chirurgien, père du célèbre Eugenio Espejo, fut un <strong>de</strong> ses premiers administrateurs<br />
5 . Mentionnons comme un fait lié à notre spécialité l’arrivée au pays en 1709<br />
du mé<strong>de</strong>cin ang<strong>la</strong>is C. Dover (1660-1741), grand connaisseur <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie tropicale<br />
et promoteur <strong>de</strong>s poudres pour <strong>la</strong> dysenterie qui portent le nom <strong>de</strong> C. Dover (ipéca,<br />
opium, nitrate <strong>de</strong> potassium). Il faut aussi signaler qu’en 1730 le Dr Pablo Petit introduisit<br />
à Lima le traitement mercuriel contre <strong>la</strong> syphilis. Pour les Équatoriens et les habitants<br />
<strong>de</strong> l’Azuay, 1747 marqua, d’un côté, <strong>la</strong> naissance à Quito du célèbre Eugenio <strong>de</strong><br />
Santa Cruz y Espejo et, <strong>de</strong> l’autre, le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> véritable mé<strong>de</strong>cine à Cuenca à travers<br />
l’administration <strong>de</strong> son hôpital par les bethléemites ; ils firent construire l’hôpital Real,<br />
qui fonctionna dans <strong>la</strong> ville jusqu’en 1868, date <strong>de</strong> son transfert face à l’« ermitage <strong>de</strong><br />
Todos Santos 5 .»<br />
La ville <strong>de</strong> Cuenca subit <strong>de</strong>ux nouvelles épidémies <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> ampleur: <strong>la</strong> première en<br />
mars 1748, présentant <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong> fièvre, <strong>de</strong> diarrhée et <strong>de</strong> dysenterie; ensuite, entre<br />
octobre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année et novembre 1749, <strong>de</strong>s épidémies <strong>de</strong> variole, <strong>de</strong> rougeole et<br />
d’alfombril<strong>la</strong>. Le taux <strong>de</strong> mortalité le plus important fut constaté en avril et en mai 1749:<br />
quarante-quatre personnes moururent par mois 11 . Lors <strong>de</strong>s épidémies ou <strong>de</strong>s phénomènes<br />
telluriques, face à l’impuissance humaine (<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, <strong>de</strong>s guérisseurs, <strong>de</strong>s<br />
yuyeros et <strong>de</strong>s sorciers) pour contrôler les épidémies, le peuple croyant <strong>de</strong> Cuenca voyait<br />
dans celles-ci le châtiment divin <strong>de</strong>s mœurs supposées licencieuses, et invoquait le secours<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Divine Provi<strong>de</strong>nce à travers <strong>de</strong>s intercesseurs afin <strong>de</strong> « calmer <strong>la</strong> colère <strong>de</strong><br />
Dieu », <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le pardon <strong>de</strong>s péchés et obtenir <strong>la</strong> Divine Pitié 11 .<br />
Lors du processus <strong>de</strong> béatification <strong>de</strong> Mariana <strong>de</strong> Jesús (sainte équatorienne) en<br />
1749, le Dr Pedro Pazmiño, mé<strong>de</strong>cin né à Quito, déc<strong>la</strong>ra avoir soigné <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> lues venerea<br />
(en utilisant <strong>de</strong>s pilules <strong>de</strong> mercure doux jusqu’à <strong>la</strong> salivation), <strong>de</strong> blennorragie,<br />
<strong>de</strong> goitre, etc., dont quelques-uns furent guéris avec <strong>de</strong>s reliques (revue Museo Histórico,<br />
organe du musée d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Quito, nº 2, 11 juillet 1949). L’an 1750 marqua<br />
l’arrivée <strong>de</strong>s bethléemites à l’hôpital <strong>de</strong> Guayaquil 2 .<br />
En 1765, Guayaquil subit une épidémie d’affections vénériennes « à cause <strong>de</strong> l’arrivée<br />
en ville <strong>de</strong>s troupes étrangères, très nombreuses: <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong> mauvaise<br />
réputation, attaqués du mal vénérien… », selon <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription du jésuite <strong>de</strong> Guayaquil<br />
Dom Juan Arteta 5 . Eugenio Espejo obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1777 (à l’âge <strong>de</strong><br />
20 ans) 5 ; il reçut le titre <strong>de</strong> docteur en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s mains du recteur <strong>de</strong> l’université<br />
Santo Tomás <strong>de</strong> Aquino, le père Nicolás García, qui en lui remettant <strong>la</strong> bague symbolisant<br />
sa réussite, prononça les mots consacrés: « Voici le symbole <strong>de</strong> ton mariage avec <strong>la</strong><br />
sagesse, qui sera désormais ta très chère épouse 26 . » Espejo, bibliothécaire public,
approfondit ses étu<strong>de</strong>s et acquit une vaste érudition médicale et philosophique 5 . Le gouvernement<br />
<strong>de</strong> Cuenca effectua en 1778 un recensement divulguant un total <strong>de</strong> 11824 habitants<br />
et signa<strong>la</strong>nt qu’il y avait six ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s, six serviteurs et un aumônier hospitalisés à<br />
l’hôpital <strong>de</strong> Cuenca, dont le préfet était le frère Matías <strong>de</strong> los Dolores (bethléemite). En<br />
1779, le seul chirurgien <strong>de</strong> Cuenca, le frère Santiago <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ánimas, procéda à l’i<strong>de</strong>ntification<br />
du cadavre <strong>de</strong> Juan Mariano Zaba<strong>la</strong>, tué par une balle du gouverneur.<br />
En 1782, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Cuenca fut touchée une nouvelle fois par une grave épidémie<br />
(rougeole, variole et typhus) due à un « manque excessif <strong>de</strong> pluie ». Pour<br />
obtenir du secours face à une telle ca<strong>la</strong>mité, on fit apporter dans <strong>la</strong> ville le Saint-<br />
Christ <strong>de</strong> Girón 11 (figure 14).<br />
En 1785, une épidémie <strong>de</strong> rougeole et <strong>de</strong> scorbut tua 8000 personnes; le<br />
Dr Eugenio Espejo — qui en plus d’être hygiéniste se révé<strong>la</strong> le précurseur <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> microbiologie — publia ses Reflexiones acerca <strong>de</strong> <strong>la</strong>s virue<strong>la</strong>s y <strong>la</strong> higiene<br />
<strong>de</strong> Quito [Réflexions sur les varioles et l’hygiène <strong>de</strong> Quito]. La Couronne espagnole<br />
recommanda d’isoler les cas <strong>de</strong> variole 2 .<br />
L’hôpital <strong>de</strong> San Lázaro, annexé à l’asile, fut fondé à Quito en 1786 pour recevoir les lépreux.<br />
La royale expédition phi<strong>la</strong>nthropique du vaccin dans toutes les colonies espagnoles<br />
fut proc<strong>la</strong>mée en 1803 : au départ <strong>de</strong> La Coruña le 3 novembre, <strong>la</strong> corvette María Pinta<br />
emmena vingt-<strong>de</strong>ux enfants vaccinés dans le but <strong>de</strong> propager l’immunisation.<br />
Enfin, dans cet aperçu <strong>de</strong>s faits qui marquèrent notre histoire, notamment l’histoire<br />
médicale, nous <strong>de</strong>vons rappeler que le 10 août 1809, lorsque Dom Manuel Urríes, comte<br />
Ruiz <strong>de</strong> Castil<strong>la</strong>, était prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’audience royale, les patriotes équatoriens réunis<br />
chez Doña Manue<strong>la</strong> <strong>de</strong> Cañizares, influencés par les idées libertaires du grand précurseur<br />
Eugenio <strong>de</strong> Santa Cruz y Espejo, et avec à leur tête Antonio Ante, Pío Montúfar, Quiroga,<br />
Ascázubi et Don Juan <strong>de</strong> Salinas, proc<strong>la</strong>mèrent le premier cri d’indépendance en<br />
Amérique 12, 13 , aboutissant à cette liberté si convoitée.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque républicaine<br />
La <strong>de</strong>rmatologie fut davantage représentée à l’époque républicaine et se<br />
développa en même temps que les hôpitaux et les soins hospitaliers 1, 2, 5 .<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> Cuenca en 1557, les espaces <strong>de</strong>stinés à l’église,<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce d’armes et les hôpitaux furent projetés, mais leur construction fut<br />
retardée 1 . Avant <strong>la</strong> fondation officielle <strong>de</strong> l’université, un précé<strong>de</strong>nt décret<br />
permit <strong>la</strong> création d’une chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine au sein <strong>de</strong> l’hôpital<br />
(figure 15).<br />
Le conseil universitaire <strong>de</strong> l’Azuay, fondé en 1868, créé en 1870 à <strong>la</strong><br />
charge <strong>de</strong>s pères jésuites (appelé San Luis, ensuite Benigno Malo, dès 1910), s’organisa<br />
comme une dépendance du collège national; il ne disposait pas <strong>de</strong> bureaux ni <strong>de</strong> professeurs<br />
propres et occupait initialement le bureau <strong>de</strong>s pères dominicains, acheté plus<br />
tard après quelques négociations. Ce local était situé sur l’actuelle P<strong>la</strong>zoleta <strong>de</strong> Santo Domingo,<br />
occupée par le collège Octavio Cor<strong>de</strong>ro Pa<strong>la</strong>cios 16 .<br />
Fondation officielle <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
Sous le gouvernement du Dr Jerónimo Carrión, les Drs Juan Bautista Vázquez et Luis<br />
Cor<strong>de</strong>ro Carrión aboutirent à l’approbation du décret qui créa l’université <strong>de</strong> Cuenca,<br />
avec ses facultés <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (octobre 1867); l’université fut officiellement<br />
inaugurée le 1 er janvier 1868 2, 14 .<br />
Suite à l’officialisation <strong>de</strong> cette université, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut également inaugurée,<br />
son premier doyen étant le Dr Agustín Cueva Vallejo (figure 16), né à Cuenca en<br />
1820, diplômé à Quito en 1843, décédé en 1873 2, 15 . Outre les légis<strong>la</strong>teurs déjà nommés,<br />
215<br />
Figure 14.<br />
Arrivée du Saint<br />
Christ <strong>de</strong> Girón dans<br />
<strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Cuenca<br />
Figure 15.<br />
Premier siège <strong>de</strong><br />
l’Université <strong>de</strong> Cuenca
Figure 16.<br />
Dr Agustín Cueva Vallejo,<br />
premier doyen<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine<br />
Figure 17.<br />
Secteur <strong>de</strong> San B<strong>la</strong>s,<br />
où fonctionna<br />
l’hôpital <strong>de</strong>s<br />
Bethléemites<br />
Figure 18.<br />
Vue panoramique <strong>de</strong><br />
l’hôpital San Vicente<br />
<strong>de</strong> Paúl<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
216<br />
ses protecteurs et promoteurs furent les Drs Agustín Cueva, Manuel Coronel et Antonio<br />
Ortega 14 .<br />
À <strong>la</strong> fin du XVIII e siècle, il y avait déjà <strong>de</strong>s hôpitaux à Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja<br />
et Riobamba, il existait <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soins et d’apothicairerie, mais seuls les indigènes<br />
s’y rendaient, et c’était considéré comme un signe <strong>de</strong> malheur. Depuis 1747, l’hôpital administré<br />
par les bethléemites fonctionnait à Cuenca; le frère Santiago <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Ánimas y<br />
travail<strong>la</strong>it en tant que chirurgien et, en 1779, il fut chargé d’effectuer l’autopsie du « chevalier<br />
Zaba<strong>la</strong> 5 .»<br />
L’hôpital <strong>de</strong>s bethléemites fonctionna à San B<strong>la</strong>s jusqu’en 1872, lorsqu’il fut remp<strong>la</strong>cé<br />
par l’hôpital <strong>de</strong>l Ejido, appelé San Vicente <strong>de</strong> Paúl en l’honneur du patron et fondateur<br />
<strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>s sœurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité, les seules infirmières qui travaillèrent<br />
pendant les cent ans d’existence <strong>de</strong> l’hôpital 16 (figures 17 et 18). Le 28 août 1869, un<br />
décret légis<strong>la</strong>tif disposa officiellement que le pouvoir exécutif mette à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s<br />
sœurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité les hôpitaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> République qui disposaient <strong>de</strong> fonds suffisants ;<br />
<strong>de</strong>s contrats furent signés et toutes les<br />
dispositions visant à cet important objectif<br />
furent prises. En octobre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
même année, un contrat fut souscrit à<br />
Paris permettant l’établissement officiel<br />
<strong>de</strong>s sœurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité dans notre pays,<br />
approuvé le 4 décembre par le ministre<br />
<strong>de</strong>s Affaires étrangères 5 .<br />
L’enseignement débuta à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Cuenca en 1868, probablement par un programme copié du p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> matières<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Quito; au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> première étape, ce p<strong>la</strong>n fut réduit à<br />
cinq ans. Le manque <strong>de</strong> moyens économiques et les rares professeurs firent que le p<strong>la</strong>n<br />
était en gran<strong>de</strong> partie théorique et que le même professeur enseignait dans plusieurs<br />
chaires. Le premier doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut son fondateur, le Dr Agustín<br />
Cueva Vallejo, né à Cuenca le 24 août 1820; en 1838, il voyagea à Quito pour suivre <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, où il obtint son titre <strong>de</strong> docteur. En 1856, il se rendit en Europe où<br />
il se forma avec les grands maîtres <strong>de</strong> l’époque: Trusseau, Ricord, entre autres. Le Dr<br />
Cueva Vallejo occupa le poste <strong>de</strong> recteur jusqu’en 1873, quelques mois avant sa mort; il<br />
avait été dépouillé <strong>de</strong> ses fonctions à cause <strong>de</strong> son opposition à <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> l’époque.<br />
Il fut remp<strong>la</strong>cé par le Dr José Oramas 14, 15 .<br />
À l’époque (1870), on par<strong>la</strong>it à Quito du pouvoir curatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte du condurango<br />
(liane du condor), que le Dr Camilo Cáceres, chirurgien <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Quito, dit avoir<br />
utilisée avec succès pour le traitement du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> cuisse et <strong>de</strong>s paupières, et <strong>de</strong>s cas<br />
<strong>de</strong> syphilis, <strong>de</strong> blennorragie et d’ulcères scrofuleuses.<br />
Le 24 août 1870, le gouverneur <strong>de</strong> l’Azuay transcrivit au ministre une communication<br />
du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence Saint-Vincent-<strong>de</strong>-Paul. Il l’informa que le 8 août, <strong>la</strong><br />
conférence, après avoir pris en charge l’usine <strong>de</strong> <strong>la</strong> colline <strong>de</strong> Cullca afin d’y établir le<br />
<strong>la</strong>zaret féminin, s’était heurtée à plusieurs obstacles qui l’empêchèrent d’accomplir<br />
l’objectif <strong>de</strong> <strong>la</strong> municipalité : les lépreux ne <strong>de</strong>vaient pas être avec les hommes éléphantiasiques<br />
au Jordán (léproserie créée à Cuenca en 1816 et transférée ensuite à l’endroit<br />
appelé « le Jordán » en 1844) ; il exprima aussi les avantages <strong>de</strong> construire le <strong>la</strong>zaret à<br />
Machángara. Ceci ayant été approuvé, <strong>la</strong> construction fut entreprise en 1882 2 (figure<br />
19).<br />
La faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Cuenca commença à délivrer <strong>de</strong>s diplômes <strong>de</strong> façon régulière<br />
et annuelle à partir <strong>de</strong> 1873; le premier diplômé fut le Dr Manuel Pa<strong>la</strong>cios qui, malgré<br />
son incorporation à Cuenca, ratifia son titre à l’université centrale <strong>de</strong> Quito 14 ;<br />
Agustín Yerovi, Fi<strong>de</strong>l <strong>de</strong>l Castillo et Eduardo Cor<strong>de</strong>ro 2 obtinrent leur diplôme plus tard.<br />
À <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution libérale <strong>de</strong> 1895, l’université <strong>de</strong>vint indépendante du collège
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
et les facultés <strong>de</strong> jurispru<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine ouvrirent; celle-ci s’appuya<br />
sur <strong>de</strong>s programmes et <strong>de</strong>s professeurs, et vers 1910, elle accueil<strong>la</strong>it <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
et <strong>de</strong>s professeurs venus d’Europe tels que les Drs Emiliano J. Crespo<br />
et David Díaz 14 . La présence obligatoire à l’hôpital et à l’amphithéâtre fut<br />
probablement instituée en janvier 1905. Le 2 janvier 1910, le gouvernement<br />
du général Eloy Alfaro promulgua un décret ordonnant aux professeurs d’assumer<br />
le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> salle à l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paúl; dans le respect<br />
<strong>de</strong> cette résolution, le conseil d’assistance décida que les professeurs <strong>de</strong><br />
pathologie, <strong>de</strong> clinique et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>viendraient les titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s services respectifs.<br />
Il fut également décidé <strong>de</strong> nommer les internes parmi les élèves <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années envoyés<br />
par <strong>la</strong> faculté. Le Dr Manuel Farfán administra fermement l’hôpital; en 1913, il<br />
nomma le Dr Agustín Cueva Vallejo, qui était doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, mé<strong>de</strong>cin<br />
<strong>de</strong> l’hôpital, tandis que Farfán lui-même fut désigné mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie et inspecteur<br />
<strong>de</strong>s finances <strong>de</strong> l’hôpital.<br />
Un fait historique se produisit en 1911: l’enseignement pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie externe<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique chirurgicale débuta à l’hôpital San Juan <strong>de</strong> Dios <strong>de</strong> Quito; <strong>la</strong> chaire<br />
fut à <strong>la</strong> charge du Dr Ricardo Vil<strong>la</strong>vicencio Ponce 32 , professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie spécialisé<br />
en Europe et aux États-Unis, qui fut doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté et l’un <strong>de</strong>s responsables <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> construction et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conformité <strong>de</strong>s nouveaux hôpitaux <strong>de</strong> Quito. À cette même<br />
époque, <strong>la</strong> colonie <strong>de</strong> lépreux <strong>de</strong> Quito (située jusqu’alors à l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, qui servait<br />
également d’asile) fut transférée à Pifo. L’office <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie vénérienne fut aussi<br />
créé dans <strong>la</strong> ville capitale (1911).<br />
Par ailleurs, les premières applications<br />
du dioxydiamido-arsenobenzol,<br />
contrôlées au préa<strong>la</strong>ble par <strong>la</strong><br />
réaction <strong>de</strong> Wasserman, furent effectuées<br />
à Guayaquil 2 . Le 11 mai<br />
1911 fut aménagée une salle <strong>de</strong> chirurgie<br />
pour le service <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong> l’hôpital, présageant <strong>la</strong> possibilité<br />
pour les étudiants <strong>de</strong> l’utiliser pour<br />
leurs stages, ce qui arriva bien plus<br />
tard (figure 20).<br />
À <strong>la</strong> fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle, les élèves connaissaient les organes<br />
internes uniquement grâce aux références <strong>de</strong>s manuels; ils n’avaient jamais fait jusquelà<br />
une véritable dissection. La salle Santa Juana <strong>de</strong> Arco, <strong>de</strong>stinée aux ma<strong>la</strong>dies vénériennes,<br />
fut créée à l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paúl (figure 21) en 1912; elle <strong>de</strong>vint plus tard<br />
une salle <strong>de</strong> gynécologie, sous le nom Agustín Cueva V.; <strong>la</strong> salle d’obstétrique Ángel<br />
María Estrel<strong>la</strong> 16 fut créée vers <strong>la</strong> même époque. Les premières réactions <strong>de</strong> Wasserman<br />
se réalisèrent au <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca (novembre 1912). Le décret légis<strong>la</strong>tif,<br />
promulgué le 6 novembre, créant l’hôpital <strong>de</strong> bienfaisance dans <strong>la</strong> ville d’Azoguez,<br />
fut émis en octobre 1913 2 .<br />
En 1916, sous le rectorat du Dr Honorato Vázquez, <strong>la</strong> faculté fut améliorée, du bâtiment<br />
jusqu’aux salles <strong>de</strong> cours ; l’aménagement d’un petit local adjacent fut notamment<br />
importante, et l’amphithéâtre où était enseignée l’anatomie disposa d’un toit<br />
semi-couvert. Au cours <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>uxième décennie, le soin hospitalier prit une certaine<br />
importance ; les autopsies étaient réalisées en présence <strong>de</strong>s étudiants, donnant<br />
naissance à <strong>la</strong> véritable anatomie et à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong>s lésions pathologiques. Le véritable<br />
éveil scientifique se fit précisément durant cette décennie, lors <strong>de</strong> l’arrivée à<br />
Cuenca <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins formés en Europe (Allemagne et France) 14 . Il faut distinguer,<br />
outre les professionnels déjà cités, le Dr José Humberto Ochoa Cobos, qui se consacra<br />
à <strong>de</strong>s tâches sanitaires et à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et qui fut envoyé à Lazul (canton Paute)<br />
217<br />
Figure 19.<br />
La P<strong>la</strong>ce d’Armes <strong>de</strong><br />
Cuenca en 1885<br />
Figure 20.<br />
Membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Cuenca en 1911, lors<br />
du rectorat du<br />
Dr Luis Cor<strong>de</strong>ro<br />
Figure 21.<br />
Vue intérieure <strong>de</strong><br />
l’hôpital San Vicente<br />
<strong>de</strong> Paúl, <strong>la</strong> chapelle au<br />
premier p<strong>la</strong>n
Figure 22.<br />
Dr José Mogrovejo,<br />
premier professeur <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong><br />
Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> Cuenca<br />
Figure 23.<br />
Inauguration <strong>de</strong><br />
l’Usine <strong>de</strong> décantation<br />
d’eau potable à<br />
Cuenca, 1928<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
218<br />
combattre une épidémie <strong>de</strong> typhus ; <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die le contamina et l’emporta. L’une <strong>de</strong>s<br />
salles infecto-contagieuses <strong>de</strong> l’ancien hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paúl reçut son nom en<br />
son honneur 16 .<br />
En mars 1919, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Cuenca disposait déjà <strong>de</strong>s chaires suivantes,<br />
avec les enseignants respectifs: anatomie: premier cours, Dr Ignacio Malo; <strong>de</strong>uxième<br />
cours, Dr Sebastián Moscoso; philosophie: Dr Luis Loyo<strong>la</strong>; pathologie: Dr Luis Carlos Jaramillo;<br />
thérapeutique: Dr Bernardo Yépez; clinique: Dr Nicolás Sojos; chirurgie:<br />
Dr José Mogrovejo; obstétrique: Dr Manuel Pa<strong>la</strong>cios; chimie: Dr Carlos Cueva; pharmacie:<br />
Dr Nicanor Corral 14 .<br />
Autre fait important à signaler, une discussion passionnée qui eut lieu en 1920 dans<br />
les cercles scientifiques sur l’existence du typhus exanthématique dans l’Azuay, déjà suspecté<br />
quelques années auparavant par le Dr Nicolás Sojos (doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> Cuenca<br />
en 1904) et le Dr Manuel Farfán; ce <strong>de</strong>rnier semble être décédé <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die qu’il<br />
étudia dans sa pratique hospitalière et privée. Des mé<strong>de</strong>cins sanitaires et <strong>de</strong>s bactériologistes<br />
<strong>de</strong> Quito, Guayaquil et Cuenca (dont le Dr Nicanor Merchán) en effectuèrent une<br />
étu<strong>de</strong> bactériologique sans aboutir à une solution définitive.<br />
Ce fut justement cette année-là (1920) que <strong>la</strong> « variole pâteuse » (septicémie éruptive)<br />
fut i<strong>de</strong>ntifiée <strong>de</strong> façon bactériologique et décrite en tant qu’entité clinique à Guayaquil<br />
(Drs Wences<strong>la</strong>o Pareja et J.T. Larrea), ce qui serait démontré plus tard à <strong>la</strong> commission<br />
technique nord-<strong>américaine</strong> intégrée par Long et Eskey. Un autre fait remarquable fut <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce en 1925 du premier cabinet <strong>de</strong> rayons X à Cuenca 2 .<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que telle débuta à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Cuenca en 1929. Pendant <strong>la</strong> séance du 12 septembre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, l’assemblée<br />
universitaire désigna l’équipe <strong>de</strong> professeurs pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1929-1933,<br />
groupe en vigueur jusqu’en 1936; son premier professeur officiel fut le Dr José Mogrovejo<br />
Carrión, qui eut aussi à sa charge <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> chirurgie 14 ; quelques années<br />
plus tard (1967), il fut nommé professeur honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université 17 (figure 22).<br />
Notons aussi qu’à l’époque fut inaugurée <strong>la</strong> première usine <strong>de</strong> décantation<br />
d’eau potable (figure 23).<br />
Ultérieurement, <strong>de</strong> 1938 à 1949, <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie intégra <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> pathologie externe, à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s Drs Luis A. Sojos, Víctor Barrera et José<br />
Alvear (qui breveta sa fameuse « pomma<strong>de</strong> <strong>de</strong> Alvear ») 14 .<br />
En 1936, un décret universitaire créa <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> pathologie tropicale. Suite<br />
à une réorganisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (mai 1944), le Dr Luis A. Sojos<br />
prit en charge <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> pathologie externe (qui comportait <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie) et <strong>de</strong> nouveaux<br />
professeurs, dignes d’être mentionnés, y furent admis: les Drs Juan Idrovo A. (chirurgie),<br />
Leoncio Cor<strong>de</strong>ro J. (histologie) — qui al<strong>la</strong>it contribuer en gran<strong>de</strong> partie au<br />
développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, non seulement à l’Azuay mais aussi au niveau national<br />
—, et Alberto Alvarado C. (anatomie), entre autres 14 .<br />
Dès 1950, le p<strong>la</strong>n d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté comprenait <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans le<br />
cursus <strong>de</strong> cinquième année, sous le nom <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique, vénérienne et syphiligraphie,<br />
à <strong>la</strong>quelle s’ajoutaient celles <strong>de</strong> clinique thérapeutique, clinique pédiatrique<br />
et puériculture, technique chirurgicale et hygiène et santé publique.<br />
Le p<strong>la</strong>n d’étu<strong>de</strong> en vigueur <strong>de</strong>puis 1950 conserva ces caractéristiques fondamentales,<br />
avec quelques changements dans certaines matières, jusqu’à <strong>la</strong> réalisation du premier<br />
séminaire d’éducation médicale national, qui eut lieu à Guayaquil en septembre 1967.<br />
On y traita encore une fois avec passion <strong>de</strong> l’« unification <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns d’étu<strong>de</strong> », obtenue<br />
après <strong>de</strong> longues discussions; <strong>de</strong> petites modifications furent effectuées, mais les aspects<br />
fondamentaux se maintinrent jusqu’en 1970. Il faut remarquer que ces réformes n’affectèrent<br />
point <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, toujours comprise dans le cursus correspondant<br />
à <strong>la</strong> cinquième année (qui fut é<strong>la</strong>rgi) 14 .
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
En mai 1960, pendant le décanat du Dr<br />
Leoncio Cor<strong>de</strong>ro J. (1958-1964), le conseil <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> faculté, pour récompenser les mérites <strong>de</strong>s<br />
Drs Luis C. Jaramillo et José Mogrovejo Carrión,<br />
anciens professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté — qui<br />
n’avaient pas reçu les honneurs qui leur revenaient<br />
<strong>de</strong> droit —, décida <strong>de</strong> les nommer professeurs<br />
honoraires <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca 14 .<br />
En octobre 1961, l’offre <strong>de</strong> l’Assistance sociale <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux hectares <strong>de</strong> terrain dans le<br />
secteur <strong>de</strong> El Vergel, à côté <strong>de</strong> l’hôpital, <strong>de</strong>vint officielle ; cependant, ce n’est qu’en<br />
mars 1964 qu’on sut que le conseil universitaire avait <strong>de</strong>stiné une partie du budget à<br />
<strong>la</strong> construction du pavillon <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté, à côté du nouvel hôpital. Les actes <strong>de</strong> don <strong>de</strong>s<br />
terrains <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> l’Assistance sociale furent signés à cette même époque 14 .<br />
En mai 1967, au cours du décanat du Dr Timoleón Carrera Cobos (1966-1967), <strong>la</strong><br />
première pierre <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle et actuelle faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut posée 14 (figures<br />
24 et 25).<br />
Plusieurs professeurs (généralistes) <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté travaillèrent à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca suite à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du conseil <strong>de</strong> direction, tels Nicolás<br />
Sojos (figure 26), Leoncio Cor<strong>de</strong>ro (figure 27) et Jaime Vintimil<strong>la</strong> 14, 32 .<br />
Le Dr Jaime Vintimil<strong>la</strong> fut chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en<br />
1960, date à <strong>la</strong>quelle il se rendit en Colombie pour poursuivre<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> psychiatrie; à ce moment-là,<br />
le Dr C<strong>la</strong>udio Arias Argudo (figure 28) fut admis à <strong>la</strong> faculté<br />
en tant que professeur suppléant et prit en charge <strong>la</strong> chaire étant<br />
donné son expérience pour avoir été élève du célèbre Pr. Enrique<br />
Uraga Peña (figure 29) dans <strong>la</strong> salle Santa Luisa <strong>de</strong> l’hôpital Vernaza <strong>de</strong><br />
Guayaquil. Plus tard, le 28 février 1962 le Dr Arias Argudo obtint par<br />
concours <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> pharmacologie; il fut alors désigné professeur<br />
agrégé <strong>de</strong> pharmacologie et titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En<br />
novembre 1975, il fut nommé professeur principal <strong>de</strong> clinique interne<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à temps complet 18 . À partir <strong>de</strong> l’admission du Dr C<strong>la</strong>udio Arias Argudo<br />
— qui suivit un cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1964 dans <strong>la</strong> République d’Uruguay, sponsorisé<br />
par l’université <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o et plus tard (1976) un cours supérieur avancé en<br />
<strong>de</strong>rmatologie à Vienne 19 —, <strong>la</strong> faculté compta un professeur spécialisé, <strong>la</strong> formation<br />
scientifique dans cette discipline se voyant donc bénéficiée. À partir <strong>de</strong> 1966, une <strong>de</strong>rmatologie<br />
pratique commença à être enseignée, avec <strong>la</strong> consultation au cabinet externe<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital San Vicente <strong>de</strong> Paúl; après l’inauguration du<br />
nouvel hôpital Vicente Corral Moscoso (1977) (figure 30), le Dr Arias prit en<br />
charge pendant un an le cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 19 . Rappelons que<br />
le Dr Arias Argudo occupa, avant <strong>de</strong> s’absenter du pays, le décanat <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine entre 1976 et 1978 14 . Un autre fait important <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie du<br />
Dr Arias: en 1991, durant <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr José Andino Vélez, le collège<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Azuay lui octroya judicieusement <strong>la</strong> mention Timoleón Carrera<br />
Cobos, en vertu <strong>de</strong> ses mérites académiques, corporatifs et sociaux 18 . Il<br />
fut aussi le premier prési<strong>de</strong>nt du Noyau <strong>de</strong> l’Azuay <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>puis sa fondation en 1971 jusqu’à octobre 1985, ainsi que le prési<strong>de</strong>nt<br />
du III e Congrès <strong>de</strong> Dermatologie. Finalement, il présida le VI e Congrès équatorien<br />
qui eut lieu à Cuenca en avril 1993 24, 32 .<br />
Pendant le décanat du Dr Vicente Ruilova S., une gran<strong>de</strong> crise se produisit dans <strong>la</strong> faculté<br />
en 1977: cinquante-trois professeurs principaux présentèrent leur démission en<br />
raison <strong>de</strong> désaccords politico-administratifs avec les nouvelles autorités. Désormais, le<br />
219<br />
Figure 24.<br />
Ancienne faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, adjacente à<br />
l’hôpital San Vicente<br />
<strong>de</strong> Paúl<br />
Figure 25.<br />
Faça<strong>de</strong> frontale <strong>de</strong><br />
l’actuelle faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’université <strong>de</strong> Cuenca<br />
Figure 26.<br />
Dr Nicolás Sojos<br />
Figure 27.<br />
Dr Leoncio Cor<strong>de</strong>ro<br />
Figure 28.<br />
Dr C<strong>la</strong>udio Arias<br />
Figure 29.<br />
Pr. Enrique Uraga<br />
Peña
Figura 30.<br />
Photographie frontale<br />
<strong>de</strong> l’hôpital régional<br />
et didactique Vicente<br />
Corral Moscoso<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
220<br />
Dr Alberto Quezada R. prit en charge <strong>la</strong> chaire jusqu’en 1979, où lui succéda<br />
le Dr Franklin Enca<strong>la</strong>da Córdova, qui après avoir été admis à <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong>s sciences médicales en 1973 fit sa spécialisation <strong>de</strong>rmatologique<br />
à Guayaquil sous <strong>la</strong> tutelle <strong>de</strong>s Prs Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue et Servio Peñaherrera,<br />
pendant <strong>de</strong>ux ans. Il se rendit ensuite en Argentine afin <strong>de</strong> poursuivre<br />
sa spécialisation à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques José <strong>de</strong> San Martín. Il<br />
occupa <strong>la</strong> chaire jusqu’en 1991, où il mourut prématurément, <strong>la</strong>issant un<br />
vi<strong>de</strong> dans <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, dans <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qu’il<br />
avait contribué à former, et dans tout le pays. Le Dr Enca<strong>la</strong>da Córdova<br />
rendit service au département <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie vénérienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction provinciale <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’Azuay, et au cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que mé<strong>de</strong>cin associé<br />
entre 1978 et 1983; à partir <strong>de</strong> cette année-là, il fut chef et mé<strong>de</strong>cin traitant en <strong>de</strong>rmatologie<br />
à l’hôpital Regional y Docente Vicente Corral Moscoso <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. Le Dr Franklin<br />
Enca<strong>la</strong>da fut élu prési<strong>de</strong>nt du noyau en 1990, et il présida le VI e Congrès équatorien <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie à Cuenca en avril 1993. Par ailleurs, le Dr Enca<strong>la</strong>da occupa <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
du collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Azuay pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1988-1990. Après sa mort prématurée<br />
en août 1991, le noyau <strong>de</strong> l’Azuay ratifia les résolutions prises par le noyau organisateur<br />
du Congrès national au cours <strong>de</strong>s journées nationales effectuées à Guayaquil<br />
le 30 août <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, et le Dr Mauricio Coello Uriguen — qui occupait jusque-là<br />
<strong>la</strong> vice-prési<strong>de</strong>nce — assuma <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce nationale et celle du noyau. Il choisit le Dr<br />
Iván Zéas Domínguez en tant que vice-prési<strong>de</strong>nt national et le Dr C<strong>la</strong>udio Arias Argudo<br />
comme prési<strong>de</strong>nt du VI e Congrès équatorien; ledit congrès fut réalisé en hommage au<br />
Dr Franklin Enca<strong>la</strong>da Córdova 24, 32 . Le conseil <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté choisit un <strong>de</strong> ses<br />
disciples, le Dr Iván Zéas Domínguez, pour prendre en charge <strong>la</strong> chaire, fonction qu’il<br />
exerce toujours.<br />
En 1991, <strong>la</strong> Direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’Azuay décida <strong>de</strong> combler le poste vacant <strong>la</strong>issé<br />
par le Dr Enca<strong>la</strong>da. Le Dr Marcelo Merchán M. gagna le concours et exerça <strong>la</strong> fonction<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin traitant au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vicente Corral Moscoso jusqu’à<br />
aujourd’hui.<br />
Signalons que Cuenca est une ville universitaire; ce travail ne serait par complet si<br />
nous ne mentionnions pas que dans notre ville fonctionnent, outre l’université <strong>de</strong><br />
Cuenca, l’université Católica, l’université <strong>de</strong> l’Azuay (1990) — appelée auparavant Pontificia<br />
Universidad Católica <strong>de</strong>l Ecuador 20 —, l’université Técnica Salesiana, l’UNITA,<br />
l’université <strong>de</strong>l Pacífico, entre autres, chacune ayant sa propre histoire et contribuant en<br />
gran<strong>de</strong> partie au développement et au progrès <strong>de</strong> Cuenca dans le domaine national et international.<br />
Deux d’entre elles disposent d’une faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine: <strong>de</strong>puis 1977, l’université<br />
Católica — où le Dr C<strong>la</strong>udio Arias fut titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie;<br />
actuellement le titu<strong>la</strong>ire en est le Dr Teodoro Espinosa —, et l’université <strong>de</strong> l’Azuay, qui<br />
vient <strong>de</strong> créer sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 2004 et qui fait ses premiers pas dans <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle.<br />
Compte rendu historique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–Noyau <strong>de</strong> l’Azuay<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–Noyau <strong>de</strong> l’Azuay mériterait un<br />
développement plus long. Nous nous limiterons à dire que le noyau <strong>de</strong> l’Azuay fut créé<br />
le 5 février 1971 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne, le Pr.<br />
Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue Loayza. Pour sa création, il compta sur le soutien et <strong>la</strong> participation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> pathologie <strong>de</strong> l’Azuay 21, 23 (figure 31).<br />
Dès le début, le noyau reçut l’aval <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nationale, créée le 15 mai 1963 à<br />
Guayaquil, son premier prési<strong>de</strong>nt étant le maître Pr. Enrique Uraga Peña. Remarquons
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
que lors <strong>de</strong> sa constitution, quelques membres fondateurs<br />
représentèrent <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Azuay, tels les<br />
Drs Arias Argudo et Eudoro Moscoso Serrano, le promoteur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> léprologie à Cuenca 22 . Les premiers statuts furent<br />
officialisés le 14 juin 1978 par l’accord ministériel<br />
nº 9958; plus tard, le 26 mai 1986, pendant le mandat<br />
du Dr Jorge Bracho Oña au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique,<br />
les statuts réformés <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (accord ministériel nº 687) furent définitivement<br />
approuvés 23, 32 . Le Dr C<strong>la</strong>udio Arias fut élu<br />
premier prési<strong>de</strong>nt du noyau; il exerça cette fonction jusqu’en<br />
1985, quand il fut admis comme prési<strong>de</strong>nt du<br />
noyau et prési<strong>de</strong>nt du lll e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
à Cuenca en octobre 1985 21 (figures 32 et 33).<br />
Selon les premiers statuts, le siège national se trouvait<br />
à Guayaquil; suite à l’approbation <strong>de</strong>s nouveaux statuts (1986), le siège tourna, coïncidant<br />
avec le noyau siège du Congrès national 23, 32 .<br />
À partir <strong>de</strong> 1986, les dirigeants du noyau <strong>de</strong> l’Azuay furent renouvelés tous les <strong>de</strong>ux<br />
ans; <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce fut occupée jusqu’à présent par les Drs Franklin Enca<strong>la</strong>da C., Mauricio<br />
Coello U., Marcelo Merchán M., Iván Zéas D., Edgar Reinoso M., Teodoro Espinosa<br />
P. et Víctor León Ch. 24<br />
Le noyau <strong>de</strong> l’Azuay participa à toutes les activités programmées et sponsorisées par<br />
<strong>la</strong> Société nationale, par exemple les I res Journées régionales (Triangu<strong>la</strong>ires) à Guayaquil<br />
(25 au 25 juillet 1973), les II es Journées régionales (Guayaquil, avril 1976), les III es Journées<br />
régionales (Cuenca, 17 au 17 mai 1979), coïncidant avec le IX e Congrès médical national<br />
31 (figure 34) et <strong>la</strong> IV e Journée régionale (Loja, 25 au 25 mai 1983) 21, 22, 24 . À partir<br />
<strong>de</strong> 1980 32 , les Triangu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie prirent le nom <strong>de</strong> Journées nationales, qui<br />
ont lieu avec succès tous les trois ou quatre mois, en alternance et <strong>de</strong> façon réglementée<br />
dans les villes <strong>de</strong> Quito, Guayaquil, Cuenca, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Loja (pré-noyau <strong>de</strong> Loja) s’étant<br />
ajoutée <strong>de</strong>rnièrement 22, 24, 25 .<br />
L’Azuay, et Cuenca en particulier, eurent aussi une participation significative à l’événement<br />
principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nationale: le Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité,<br />
qui reçut l’aval du CILAD. Onze congrès nationaux eurent lieu avec succès jusqu’à présent:<br />
le I er Congrès équatorien (Guayaquil, juillet 1981), présidé par le Dr Wilson Correa<br />
B. 28 ; le II e Congrès équatorien, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce nationale du Dr Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue L.,<br />
qui eut lieu à Quito au mois <strong>de</strong> novembre 1983, présidé par le Dr Holger Garzón V.; le<br />
III e Congrès équatorien, à Cuenca du 9 au 12 octobre 1985, le Dr Luis Chiriboga A. ayant<br />
été le prési<strong>de</strong>nt national tandis que le Dr C<strong>la</strong>udio Arias A. présidait le congrès; le sujet<br />
principal fut « Tumeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau ». Le IV e Congrès équatorien eut lieu à Guayaquil en<br />
juillet 1987, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr José Ol<strong>la</strong>gue. Quito fut le siège du V e Congrès équatorien<br />
et du lX e Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en octobre 1990; le Dr Carlos Carvajal<br />
H. était le prési<strong>de</strong>nt du congrès. Le VI e Congrès équatorien fut organisé à Cuenca<br />
du 12 au 16 avril 1993, le prési<strong>de</strong>nt national étant au début le Dr Franklin Enca<strong>la</strong>da<br />
(1991) et ensuite le Dr Mauricio Coello. Les thèmes officiels furent abrogés à partir <strong>de</strong> ce<br />
congrès présidé par le Dr C<strong>la</strong>udio Arias. Le VII e Congrès équatorien eut lieu à Guayaquil,<br />
du 20 au 25 juillet 1995, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Gonzalo Calero H.; le VIII ème Congrès<br />
équatorien s’effectua à Quito entre le 20 et le 25 juillet 1997, présidé par le Dr Osvaldo<br />
Reyes. Du 29 avril au 3 mai 1999 eut lieu à Cuenca le IX e Congrès équatorien, le prési<strong>de</strong>nt<br />
du congrès étant le Dr Marcelo Merchán M. À Guayaquil, du 19 au 22 juillet 2001<br />
fut réalisé le X e Congrès équatorien et le XVI e Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, tous<br />
<strong>de</strong>ux présidés par le Dr Franklin Ma<strong>de</strong>ro 24, 32 ; finalement, le XI e Congrès équatorien eut<br />
lieu à Quito du 24 au 26 juillet 2003, présidé par le Dr Santiago Pa<strong>la</strong>cios 24 . Cuenca a<br />
221<br />
Figure 31.<br />
Reportage sur <strong>la</strong><br />
constitution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie –<br />
Noyau <strong>de</strong> l’Azuay.<br />
Journal El Mercurio<br />
Figure 32.<br />
Assistants au lll e<br />
Congrès équatorien<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
Cuenca, 1985<br />
Figure 33.<br />
Organisateurs <strong>de</strong><br />
l’événement :<br />
Dr C<strong>la</strong>udio Arias,<br />
prési<strong>de</strong>nt du congrès ;<br />
Dr Rolendio Pa<strong>la</strong>cios,<br />
Dr Iván Zéas,<br />
Dr Franklin Enca<strong>la</strong>da,<br />
Dr Mauricio Coello et<br />
les Prs Raúl Vignale<br />
(Uruguay) et Miguel<br />
Armijo (Espagne)
Figure 34.<br />
Affiche<br />
promotionnelle <strong>de</strong>s<br />
lll es Journées<br />
équatoriennes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie à<br />
Cuenca en mai 1979<br />
Figure 35.<br />
Prix Franklin Enca<strong>la</strong>da<br />
Córdova, octroyé à <strong>la</strong><br />
Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–<br />
Noyau <strong>de</strong> l’Azuay.<br />
Cuenca, 1992<br />
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
222<br />
organisée d’une part le II e Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> photobiologie et <strong>de</strong> photomé<strong>de</strong>cine,<br />
qui a eu lieu dans notre ville les 26 et 27 novembre 2004 avec <strong>la</strong> participation<br />
<strong>de</strong>s plus grands lea<strong>de</strong>rs mondiaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité 24, 27 et <strong>de</strong> l’autre, le XII e Congrès<br />
équatorien <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, en mars 2006, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce nationale du Dr Víctor<br />
León Ch. 24<br />
Le noyau <strong>de</strong> l’Azuay, chargé d’organiser les III e , VI e et IX e Congrès équatoriens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
eut le privilège <strong>de</strong> compter parmi ses invités <strong>de</strong>s professeurs étrangers <strong>de</strong> renommée<br />
internationale tels que Raúl Vignale (Uruguay), Miguel Armijo (Espagne) et<br />
Enrique Hernán<strong>de</strong>z P. (El Salvador), en 1985; Hugo Néstor Cabrera (Argentine), Lour<strong>de</strong>s<br />
Tamayo et Ramón Ruiz Maldonado (Mexique), Sandra García (Argentine) et Eduardo Civi<strong>la</strong><br />
(Uruguay) en 1993; Donald V. Belsito (USA), Alejandro Guinzburg (Israël), Fernando Stengel<br />
et Juliana Forster (Argentine), Roberto Arenas et Alejandro Bonifaz (Mexique), Héctor<br />
Cáceres (Pérou), Marcelo Nacucchio (Argentine) et Jorge Peniche (Mexique) en 1999. La<br />
présence et <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> ces professionnels donnèrent <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>t aux événements organisés<br />
par notre noyau, et tous les assistants bénéficièrent <strong>de</strong> leurs connaissances et <strong>de</strong><br />
leur enseignement 24, 28, 29, 30 . Le noyau <strong>de</strong> l’Azuay, à l’origine <strong>de</strong>s événements mentionnés<br />
ce-<strong>de</strong>ssus, accorda en son nom et et sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s directives nationales, et en accord avec<br />
ses statuts juridiques, <strong>la</strong> distinction <strong>de</strong> « Membres correspondants » <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à chacun <strong>de</strong>s illustres invités, en vertu <strong>de</strong> leurs mérites et <strong>de</strong>s services<br />
rendus 24 .<br />
Dans le domaine local et provincial, le noyau <strong>de</strong> l’Azuay est un groupe <strong>de</strong> travail fraternel<br />
et très actif, qui <strong>de</strong>puis ses débuts organisa <strong>de</strong>s activités scientifiques, sociales et<br />
culturelles; <strong>de</strong>s réunions hebdomadaires ont lieu le jeudi pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> patients et <strong>de</strong><br />
cas cliniques: à l’origine, elles s’effectuèrent à l’hôpital du IESS (Institut équatorien <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sécurité sociale), dans l’après-midi; le matin ensuite à l’hôpital régional Vicente Corral<br />
Moscoso. Les séances du noyau ont lieu le soir. Par ailleurs, le cours annuel <strong>de</strong> formation<br />
<strong>de</strong>rmatologique continue, qui eut lieu à un moment donné grâce à l’application<br />
et au dévouement <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> l’époque, fut institutionnalisé 24 . Plusieurs séminaires<br />
furent organisés, ainsi que <strong>de</strong>s tables ron<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s cycles <strong>de</strong> conférences, <strong>de</strong>s séminaires<br />
itinérants dans diverses zones du sud, comprenant <strong>de</strong>s allocutions et le soin <strong>de</strong> patients<br />
entre autres. Ces faits poussèrent le collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Azuay à accor<strong>de</strong>r l’honneur<br />
d’octroyer à notre société <strong>la</strong> mention Franklin Enca<strong>la</strong>da Córdova (auparavant collège <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Azuay) pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1992, en récompense du travail scientifique, corporatif<br />
et social <strong>de</strong>s différentes sociétés affiliées à ce collège médical provincial 24 (figure<br />
35).<br />
Certains faits méritent d’être soulignés dans ce bref résumé <strong>de</strong> notre société,<br />
comme <strong>la</strong> présentation et <strong>la</strong> publication du Premier cas <strong>de</strong> lobomycose en Équateur en<br />
1985 par les Drs Iván Zéas D., Franklin Enca<strong>la</strong>da C. et Mauricio Coello U., membres <strong>de</strong><br />
notre noyau 29, 33 . Dès 1968, le noyau <strong>de</strong> l’Azuay, à <strong>la</strong> tête duquel se trouvent les Drs<br />
C<strong>la</strong>udio Arias et Franklin Enca<strong>la</strong>da, participe à <strong>la</strong> <strong>de</strong>scription d’une variété <strong>de</strong> leishmaniose<br />
qui, par ses caractéristiques — âge (<strong>de</strong>s enfants pour <strong>la</strong> plupart), localisation<br />
(zones exposées : le visage), type <strong>de</strong> lésions (petites, arrondies) et <strong>la</strong> zone géographique<br />
(provinces Azuay et Cañar, entre 2 400 et 2 500 mètres au-<strong>de</strong>ssus du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer)<br />
—, serait plus tard appelée leishmaniose urbaine d’altitu<strong>de</strong>. Cette ma<strong>la</strong>die atteignit sa<br />
fréquence maximale vers les années 78-80, coïncidant avec une époque <strong>de</strong> sécheresse ;<br />
le travail fut présenté au II e Congrès équatorien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui eut lieu à Quito en<br />
1982 19 .<br />
Autre événement important, <strong>la</strong> 1 re Rencontre internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui eut<br />
lieu à Cuenca le 13 février 1999, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Marcelo Merchán, compta sur<br />
<strong>la</strong> présence et <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s Prs Luis Díaz (Medical College of Wisconsin), Thomas<br />
Lewley (At<strong>la</strong>nta, Georgie), Richard E<strong>de</strong>lson (université <strong>de</strong> Yale) et Evandro Rivitii (Sao<br />
Paulo, Brésil) et connut une participation locale et nationale massive 24, 32 .
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne<br />
De même, le noyau <strong>de</strong> l’Azuay, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Edgar Reinoso, organisa à<br />
Cuenca (5 au 7 avril 2001) le cours international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’adolescent, qui fut<br />
très bien accueilli et compta sur une gran<strong>de</strong> participation, aussi bien <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins généralistes<br />
que <strong>de</strong> spécialistes nationaux 24 .<br />
Les membres du noyau <strong>de</strong> l’Azuay, notamment les Drs Marcelo Merchán et Víctor<br />
León, visant à contribuer au développement scientifique et à <strong>la</strong> formation du corps médical<br />
en général, participèrent à l’é<strong>la</strong>boration et à <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s Cahiers <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
un programme d’éducation médicale continue en <strong>de</strong>rmatologie générale et en<br />
pédiatrie; ces publications sont en circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>puis 2001. Suivant cette initiative, Osvaldo<br />
Muñoz, Marcelo Merchán, Mauricio Coello, Víctor León et Teodoro Espinosa publièrent<br />
en 2002, avec l’aval <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le soutien du<br />
département <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Cuenca, un livre intitulé Prevención <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Piel [Prévention <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau],<br />
<strong>de</strong>stiné à l’éducation et à <strong>la</strong> formation non seulement du corps<br />
médical mais aussi du public en général, en vertu <strong>de</strong> son <strong>la</strong>ngage<br />
facile et compréhensible 34 .<br />
Pour finir, nous <strong>de</strong>vons remarquer que dans le domaine corporatif,<br />
le noyau <strong>de</strong> l’Azuay apporta à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nationale,<br />
entre autres aspects, l’é<strong>la</strong>boration, <strong>la</strong> discussion et l’approbation<br />
définitive du règlement <strong>de</strong>s Journées nationales 24, 32 ; <strong>la</strong> discussion<br />
et l’approbation du règlement <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Dermatología;<br />
l’é<strong>la</strong>boration et <strong>la</strong> discussion <strong>de</strong>s règlements pour les<br />
statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne qui, une fois approuvés, vont contribuer à réglementer<br />
et organiser l’activité aussi bien au niveau local qu’au niveau national 24 . Le noyau <strong>de</strong><br />
l’Azuay dispose d’un bureau propre, acquis en 1993, où fonctionne le siège et où sont<br />
installées <strong>la</strong> bibliothèque et <strong>la</strong> diapothèque, qui se développent chaque année 24 .<br />
Les faits synthétisés dans les paragraphes précé<strong>de</strong>nts parlent <strong>de</strong> l’unité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mystique<br />
professionnelles qui nous caractérise, nous qui sommes fiers <strong>de</strong> faire partie du<br />
noyau <strong>de</strong> l’Azuay <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie considérée comme « l’une<br />
<strong>de</strong>s sociétés les plus soudées du pays. Ses divergences créent <strong>de</strong>s liens car elles peaufinent<br />
les idées; ses tensions — personnelles peut-être à certains moments (surtout au niveau<br />
national) — furent atténuées; on parvint à gommer les aspérités. L’époque est à<br />
présent propice au commencement d’un nouveau travail, sous l’inspiration et le regard<br />
attentif <strong>de</strong>s grands maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie équatorienne 27 .»<br />
À <strong>la</strong> date <strong>de</strong> finalisation <strong>de</strong> ce travail, <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–Noyau<br />
<strong>de</strong> l’Azuay compte au total vingt-trois membres actifs: C<strong>la</strong>udio Arias A., Iván Zéas D., Víctor<br />
León Ch., Mauricio Coello U., Marcelo Merchán M., Edgar Reinoso M., Hernán Vil<strong>la</strong>cís<br />
O., Juan Ambrosi O., Teodoro Espinosa P., Norma Sigüenza C., Patricia Bermeo M.,<br />
José Ver<strong>de</strong>soto G., Mauro Manzano, Bolívar Granizo H., Jaime Abad (<strong>de</strong>rmatologues); Osvaldo<br />
Muñoz A. (épidémiologue), Plínio Padil<strong>la</strong> G. (infectiologue mycologue), Rolendio Pa<strong>la</strong>cios<br />
P., José Tobar C., Hernán Urgilés (immunologues), Gustavo Moreno A. (chirurgien<br />
oncologue), C<strong>la</strong>udio Ga<strong>la</strong>rza M. (rhumatologue) et Xavier Ochoa M. (infectiologue) 24 (figure<br />
36). ■<br />
Mai 2005<br />
223<br />
Figure 36.<br />
Membres actifs <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société équatorienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie–<br />
Noyau <strong>de</strong> l’Azuay.<br />
Cuenca, 2003. De<br />
gauche à droite : Drs<br />
Mauro Manzano, José<br />
Ver<strong>de</strong>soto, Plinio<br />
Padil<strong>la</strong>, Osvaldo<br />
Muñoz, Marcelo<br />
Merchán, Juan<br />
Ambrosi, Teodoro<br />
Espinosa, José Tobar,<br />
Mauricio Coello,<br />
C<strong>la</strong>udio Arias, Iván<br />
Zéas, Edgar Reinoso et<br />
Xavier Enca<strong>la</strong>da.<br />
Derrière, dans le<br />
même ordre : Drs<br />
Bolívar Granizo et<br />
Víctor León, actuel<br />
prési<strong>de</strong>nt national <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Société<br />
équatorienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie (2004)
M. MADERO, F. MADERO, G. MONTENEGRO, M. COELLO, C. ARIAS<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Arias C. « Época prehispánica y<br />
republicana. » Dermatología.<br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología. 2004; 12(1):11.<br />
2. Samaniego J.J. Cronología<br />
médica ecuatoriana. Quito:<br />
Casa <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cultura<br />
Ecuatoriana; 1957.<br />
3. López Monsalve R. Cuenca.<br />
Orígenes <strong>de</strong> su patrimonio<br />
cultural. Cuenca (Ecuador):<br />
Imp. Monsalve Moreno;<br />
2001: 15.<br />
4. Cor<strong>de</strong>ro Pa<strong>la</strong>cios O. El Azuay<br />
Histórico. Los Cañaris y los<br />
Inco-Cañaris. Cuenca:<br />
Amazonas; 1981.<br />
5. Hermida Piedra C. Resumen <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina<br />
ecuatoriana. 2 e éd. Cuenca:<br />
Talleres Gráficos <strong>de</strong><br />
Publicaciones y Papeles;<br />
1979.<br />
6. Quezada A. et al. La práctica<br />
médica tradicional. 2 e éd.<br />
Universidad <strong>de</strong> Cuenca.<br />
IDICSA; 1992:4.<br />
7. OMS. Informe <strong>de</strong> una reunión<br />
<strong>de</strong> expertos. Ginebra; 1977.<br />
8. Estrel<strong>la</strong> E. Medicina aborigen.<br />
La práctica médica aborigen<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra ecuatoriana.<br />
Quito: Época; 1977.<br />
9. Lloret Bastidas A. Fiestas<br />
Cívicas <strong>de</strong> Cuenca. El Libro <strong>de</strong><br />
Cuenca. Tomo 1. Cuenca:<br />
Editores y Publicistas; 1988.<br />
10. Borrero Vintimil<strong>la</strong> A. La<br />
toponimia <strong>de</strong> <strong>la</strong> región <strong>de</strong><br />
Cuenca. El Libro <strong>de</strong> Cuenca.<br />
Tomo 1. Cuenca: Editores y<br />
Publicistas; 1988.<br />
11. Landívar M.A. « La mortalidad<br />
en Cuenca <strong>de</strong> 1679 a 1785:<br />
epi<strong>de</strong>mias y rogativas. » Arch.<br />
<strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina.<br />
Universidad <strong>de</strong> Cuenca;<br />
1984.<br />
12. Oña Vil<strong>la</strong>real H. Fechas<br />
históricas y hombres notables<br />
<strong>de</strong>l Ecuador. 6 e éd. Guayaquil:<br />
Editorial <strong>de</strong>l Pacífico; 1988.<br />
13. Ospina R.A. Historia <strong>de</strong><br />
América. Quito: Minerva;<br />
1957.<br />
14. Hermida Piedra C., Landívar<br />
Heredia J. Crónicas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong><br />
Ciencias Médicas; 125 años<br />
(1968-1993). Cuenca: Offset<br />
Facultad <strong>de</strong> Ciencias<br />
Médicas; 1979 : 10-15.<br />
15. Cueva Tamariz A.<br />
« Protomédicos <strong>de</strong> Cuenca. »<br />
Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong><br />
Ciencias Médicas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad <strong>de</strong> Cuenca. Nov.<br />
1965; 7(1–2) : 184-185.<br />
16. Cor<strong>de</strong>ro J.L. « Nuestro Viejo<br />
Hospital: <strong>la</strong>s Sa<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l<br />
Hospital San Vicente <strong>de</strong><br />
Paúl. » Serie Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina. Cuenca; 1993:<br />
(10): 10-12.<br />
17. Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong><br />
Ciencias Médicas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad <strong>de</strong> Cuenca. Jul.<br />
1967; 8(2).<br />
18. Arias C. [Communication<br />
personnelle]. 1996.<br />
19. Arias C. [Communication<br />
personnelle]. 1996.<br />
20. La Universidad <strong>de</strong>l Azuay. El<br />
Libro <strong>de</strong> Cuenca. Tomo 2.<br />
Cuenca: Editores y<br />
Publicistas; 1989.<br />
21. « Formóse el Núcleo Azuayo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad <strong>de</strong><br />
Dermatología. » Diario El<br />
Mercurio. 5 febr. 1971: 8C.<br />
22. Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Secret. Nac. Permanente.<br />
Guayaquil. [courtoisie au Dr.<br />
Servio Peñaherrera].<br />
23. Estatutos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología;<br />
May 1986.<br />
24. Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Núcleo <strong>de</strong>l Azuay. Oct. 1985,<br />
Sept. 1991, Abr. 1993.<br />
25. Montenegro G. « Historia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dermatología en Quito. »<br />
Dermatología. Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Jun. 1992; 1(2) : 27-29.<br />
26. Chiriboga Vil<strong>la</strong>quirán M. Los<br />
falsos médicos <strong>de</strong> Eugenio <strong>de</strong><br />
Santa Cruz y Espejo. Quito:<br />
Panorama; 1995.<br />
27. « Entrevista al Dr C<strong>la</strong>udio<br />
Arias. » Dermatología.<br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología 2004; 12(1) :<br />
10.<br />
28. Dermatología. Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
En.–Jun. 1983; 5(1) : 65.<br />
29. Dermatología. Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
1999; 8(1) : 35.<br />
30. Ma<strong>de</strong>ro M., Ma<strong>de</strong>ro F.<br />
Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Ecuatoriana <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Guayaquil; 2001.<br />
31. Actas y Memorias <strong>de</strong>l 3º<br />
Congreso Médico Nacional,<br />
Cuenca: Offsetcolor Cuenca.<br />
14–19 may 1979.<br />
32. Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre M., Ma<strong>de</strong>ro<br />
Izaguirre F. Memorias <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Sociedad Ecuatoriana <strong>de</strong><br />
Dermatología. Guayaquil;<br />
2001.<br />
33. Zeas Domínguez I., Enca<strong>la</strong>da<br />
Córdova F., Coello Uriguen M.<br />
« Presentación <strong>de</strong>l primer<br />
caso <strong>de</strong> lobomicosis en el<br />
Ecuador. » Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad <strong>de</strong> Ciencias Médicas<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong> Cuenca.<br />
1985; 16(2) : 125-129.<br />
34. Muñoz Avilés O., Merchán<br />
Manzano M., Coello Uriguen<br />
M., León Chérrez V., Espinosa<br />
Piedra T. Prevención <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> piel.<br />
Cuenca: U. Ediciones; 2002.
LA DERMATOLOGIE<br />
AU SALVADOR<br />
JULIO EDUARDO BAÑOS, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ,<br />
LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ<br />
À l’instar <strong>de</strong>s autres pays, les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Salvador sont difficiles<br />
à définir, les mé<strong>de</strong>cins se consacrant à une pratique intégrale <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine sans suivre<br />
<strong>de</strong> spécialité particulière 1 .<br />
À l’époque du Salvador préhispanique — région appelée Cuscatlán en <strong>la</strong>ngue aborigène<br />
— le guérisseur (tepahtiani) utilisait <strong>de</strong>s médicaments, habituellement <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
(tepahtelizte), pour guérir les ma<strong>la</strong>dies cutanées 2 .<br />
En étudiant <strong>de</strong>s statuettes <strong>de</strong> boue <strong>de</strong> l’époque précolombienne, le Dr Oswaldo Ramírez<br />
3 détermina l’existence <strong>de</strong> plusieurs pathologies <strong>de</strong>rmatologiques, telles que <strong>la</strong> syphilis<br />
congénitale, les scléromes nasaux, les onychomycoses et les neurofibromatoses, et<br />
mena une recherche sur les métho<strong>de</strong>s thérapeutiques utilisées. Parmi les p<strong>la</strong>ntes les plus<br />
employées nous pouvons citer : le buisson au colibri (Hamelia patents Jacq), ayant un<br />
effet astringent et siccatif, <strong>la</strong> quinquina (Cinchona succirubra Pav.), servant à cicatriser<br />
les p<strong>la</strong>ies, et le margousier (Melia azedarach L.). Le Dr Ramírez observa qu’un bon<br />
nombre <strong>de</strong> ces médicaments archaïques étaient toujours utilisés dans les popu<strong>la</strong>tions rurales.<br />
En 1930, Salomón Melén<strong>de</strong>z, mé<strong>de</strong>cin généraliste, fut nommé chef du <strong>la</strong>zaret, le service<br />
chargé <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées du centre médical national <strong>de</strong> l’hôpital Rosales 4 .<br />
Les premiers mé<strong>de</strong>cins spécialisés dans le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
syphilis, ma<strong>la</strong>die courante à l’époque, arrivèrent au pays à partir <strong>de</strong> 1933. Esteban Reyes,<br />
qui avait poursuivi ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en Californie, donna initialement <strong>de</strong>s conférences<br />
à l’hôpital Rosales; en novembre 1935 il fonda le cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie,<br />
l’un <strong>de</strong>s premiers en Amérique centrale. On lui doit également <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société <strong>de</strong>rmatologique du Salvador en 1951, sa fondation n’étant officialisée qu’en 1957.<br />
Il fut à l’origine du 1 er Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu à San Salvador<br />
du 5 au 8 décembre 1957 et qui accueillit comme invités spéciaux les Prs Pardo Castelló<br />
(Cuba) et Fernando Latapí (Mexique); cependant Reyes, prési<strong>de</strong>nt du congrès, ne put<br />
pas voir son œuvre terminée car il mourut au cours du mois <strong>de</strong> juin <strong>de</strong> cette même année.<br />
Lors <strong>de</strong> ce congrès — réunissant un grand nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues centre-américains —<br />
fut décidée <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, conclue à travers <strong>la</strong><br />
« Déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> Coatepeque » (<strong>la</strong> réunion eut lieu au bord du <strong>la</strong>c du même nom).<br />
Le Dr Reyes se consacra notamment à l’étu<strong>de</strong> du rhinosclérome, ma<strong>la</strong>die sur <strong>la</strong>quelle<br />
il effectua plusieurs recherches. Il <strong>la</strong>issa aussi d’importants apports sur le Xero<strong>de</strong>rma<br />
pigmentosum, <strong>la</strong> scar<strong>la</strong>tine, le psoriasis et <strong>la</strong> tuberculose cutanée.<br />
En 1936 le Dr Arturo Romero revint au pays après avoir fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation<br />
en France. Il présenta <strong>de</strong>s travaux intéressants sur <strong>la</strong> syphilis lors du 5 e Congrès<br />
225
JULIO E. BAÑOS, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ, LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ<br />
226<br />
médical qui eut lieu à San Salvador en 1938. Idéaliste à l’extrême, il participa activement<br />
à <strong>la</strong> politique nationale contre le général Maximiliano Hernán<strong>de</strong>z Martínez, ce qui le<br />
conduisit à quitter le pays en 1944. Il mourut, tout comme son épouse, dans un acci<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> voiture au Honduras.<br />
En 1938, Eduardo Barrientos rentra au pays après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en Suisse; il se mit immédiatement à travailler avec Esteban Reyes 5 et décrivit<br />
les premiers cas <strong>de</strong> pian. Un an plus tard il fut nommé directeur <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’Assistance<br />
sociale et chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> nuit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 6 . Par <strong>la</strong><br />
suite, il fut nommé chef du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Rosales et <strong>de</strong> l’institut<br />
salvadorien <strong>de</strong> l’Assurance sociale, jusqu’à sa retraite en 1978.<br />
Juan José Rodríguez reçut son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1941 ; il fut nommé chef du<br />
cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital San Rafael <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santa Tec<strong>la</strong> (situé à 12 kilomètres<br />
à l’ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale). En 1942 il fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Columbia,<br />
New York 7 . À son retour en 1947, il fut chargé <strong>de</strong> faire construire les unités <strong>de</strong> radiothérapie<br />
cutanée — sa spécialité — et <strong>de</strong> bactériologie, <strong>de</strong> mycologie et <strong>de</strong> chirurgie mineure,<br />
étendant ainsi le service 7 . Il publia <strong>de</strong>s travaux sur le prurigo nodu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> Hy<strong>de</strong>,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatite due aux herbici<strong>de</strong>s, le pemphigus au Salvador, <strong>la</strong> sporotrichose fixe et l’inci<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong>s tumeurs malignes, à l’hôpital Rosales 8 . En 1951, il fut nommé professeur titu<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du<br />
Salvador. Il fut chef du cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital pédiatrique Benjamín<br />
Bloom. Il fut également membre actif <strong>de</strong> l’Académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(dont il fut membre honoraire) et membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique.<br />
Antonio Carranza Amaya obtint son diplôme en 1947 avec une thèse sur La lèpre au<br />
Salvador 9 et travail<strong>la</strong> <strong>de</strong>puis dans le cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; plus tard il s’occupa<br />
<strong>de</strong>s patients hanséniens <strong>de</strong> l’hôpital Rosales et continua <strong>de</strong> s’intéresser à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Il suivit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation à l’institut Skin and Cancer <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
New York ; à son retour, il fut chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre. Parmi ses<br />
travaux publiés nous citerons : Épidémiologie et morbidité <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans <strong>la</strong> République<br />
du Salvador, La lèpre comme cause d’incapacité au Salvador, Lymphomes malins et<br />
Myiase furonculeuse au Salvador.<br />
Le Dr Oswaldo Ramírez Cienfuegos effectua <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
à Paris et à Madrid, où il se lia d’amitié avec <strong>de</strong> grands <strong>de</strong>rmatologues ; il revint au<br />
Salvador en 1950. Il se consacra à <strong>la</strong> recherche avec enthousiasme ; il publia un grand<br />
nombre d’articles sur <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong>rmatologiques, <strong>de</strong>venant ainsi un <strong>de</strong>rmatologue salvadorien<br />
réputé à l’étranger.<br />
En décembre 1957, au cours du 1 er Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, il présenta<br />
les résultats <strong>de</strong> ses étu<strong>de</strong>s sur une entité nosologique qu’il nomma « <strong>de</strong>rmatite cendrée<br />
», appelée également « ma<strong>la</strong>die d’Oswaldo Ramírez » et connue dans <strong>la</strong> littérature<br />
anglo-saxonne sous le nom <strong>de</strong> erythema dyschromicum perstans. Sa présentation expliquant<br />
l’étiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die fut remarquable. Il fut l’un <strong>de</strong>s organisateurs <strong>de</strong> ce<br />
congrès et l’un <strong>de</strong>s promoteurs les plus enthousiastes <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fondée comme nous l’avons déjà dit pendant cette<br />
réunion. Il s’intéressa particulièrement aux ma<strong>la</strong>dies cutanées dont souffraient les habitants<br />
du pays à l’époque préhispanique, et il présenta un travail intitulé Dermatologie en<br />
boue au Salvador 3 au cours du 5 e Congrès du CILAD (1963).<br />
Il fut vice-prési<strong>de</strong>nt du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) et<br />
prési<strong>de</strong>nt du 8 e Congrès à San Salvador en 1975. Il occupa <strong>de</strong>s postes dans l’administration<br />
et fut vice-ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et <strong>de</strong> l’Assistance sociale.<br />
Le Dr José Llerena Gamboa réalisa ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation à l’université <strong>de</strong> Stanford,<br />
en Californie, et plus tard au centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua <strong>de</strong> Mexico DF, dirigé<br />
par le Dr Fernando Latapí. La mycologie l’intéressa beaucoup et à son retour, en 1956,
La <strong>de</strong>rmatologie au Salvador<br />
il s’efforça <strong>de</strong> bien équiper le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie <strong>de</strong> l’hôpital Rosales et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nifier<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>s champignons dans le pays 10 . Ses travaux dans ce domaine<br />
ont pour titres : Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mycoses profon<strong>de</strong>s au Salvador 11 , Quatre cas<br />
<strong>de</strong> mycétome causés par divers champignons, Traitement par <strong>la</strong> chaleur <strong>de</strong> <strong>la</strong> sporotrichose<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chromob<strong>la</strong>stomycose et La sporotrichose au Salvador 12 . Il fut chargé du<br />
cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Rosales et fut professeur auxiliaire <strong>de</strong> mycologie<br />
à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine 4 .<br />
Ayant réalisé <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, et suivi <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong><br />
chirurgie <strong>de</strong>rmatologique et cosmétique, le Dr Enrique Hernán<strong>de</strong>z Pérez regagna son pays<br />
en 1970. Il débuta ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation à l’institut <strong>de</strong>rmatologique Pascua, avec le<br />
Pr. Fernando Latapí, qui lui proposa <strong>de</strong> faire une rotation complète au service <strong>de</strong> chirurgie<br />
esthétique <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico, dirigé par le Pr. Fernando Ortiz Monasterio.<br />
À Sao Paulo (Brésil), son supérieur — le Pr. Sebastiao Sampaio — l’incita à suivre une<br />
formation en chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Pendant les <strong>de</strong>ux années qu’il passa dans <strong>la</strong><br />
ville, il s’intéressa à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie ; encore rési<strong>de</strong>nt, il fut chargé <strong>de</strong> réaliser<br />
toutes les biopsies du service. Il présentait les cas une fois par semaine à ses chefs, les<br />
Drs Thales <strong>de</strong> Brito et Cecy Barros.<br />
À Buenos Aires, il eut comme enseignant le Dr Aarón Kaminsky, un maître extraordinaire<br />
dans les domaines du diagnostic et <strong>de</strong> <strong>la</strong> thérapeutique, avec qui il débuta ses<br />
étu<strong>de</strong>s en cosmétique médicale ; il apprit <strong>de</strong> lui <strong>la</strong> pratique appropriée <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmétologie.<br />
Le Pr. Julio Martín Borda le forma notamment en clinique ; pendant cette même pério<strong>de</strong>,<br />
il approfondit ses étu<strong>de</strong>s en <strong>de</strong>rmato-pathologie sous <strong>la</strong> direction du Dr Jorge<br />
Abu<strong>la</strong>fia.<br />
Plus tard, il poursuivit ses étu<strong>de</strong>s aux États-Unis: en <strong>de</strong>rmato-pathologie, sous <strong>la</strong> direction<br />
<strong>de</strong> Walter Lever à Boston et <strong>de</strong> Bernard Ackerman à New York; en chirurgie cosmétique<br />
avec les Drs Richard Webster (à Brooklyn), Gerry Fenno (à Houston), Howar<br />
Tobin (à Abilene), Julius Newman (à Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie) et Sam Stegman (en Californie).<br />
De retour au Salvador il <strong>de</strong>vint professeur titu<strong>la</strong>ire et chef <strong>de</strong> l’unité d’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université du Salvador et chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie du département <strong>de</strong> pathologie <strong>de</strong> l’hôpital Rosales, dirigé alors<br />
par le Dr Francisco Velásquez. Il occupa ces fonctions jusqu’à sa retraite, en 1987, après<br />
quoi il se consacra uniquement à <strong>la</strong> pratique libérale 13 .<br />
Dès le début <strong>de</strong> son travail dans le pays, il transmit à ses collègues son intérêt pour <strong>la</strong><br />
chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, discipline qui comptait peu à l’époque. Les premières opérations<br />
furent pratiquées dans <strong>la</strong> salle <strong>de</strong> chirurgie mineure du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’hôpital Rosales; malgré l’impertinence <strong>de</strong> l’endroit, on y pratiquait tout genre <strong>de</strong> chirurgies<br />
<strong>de</strong> cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, et même <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs. Le Dr Hernán<strong>de</strong>z Pérez dirigea<br />
les résidanats en <strong>de</strong>rmatologie; les sept <strong>de</strong>rmatologues ayant étudié avec lui reçurent une<br />
formation très spéciale, non seulement en clinique mais aussi en chirurgie et en pathologie.<br />
Quelques années plus tard, il travail<strong>la</strong> à l’hôpital Santa Teresa <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Zacatecoluca,<br />
un vil<strong>la</strong>ge situé à 50 km à l’est <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale, dans le département <strong>de</strong> La Paz, où<br />
il passait même les samedis en compagnie <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts étrangers, pratiquant notamment<br />
<strong>de</strong>s chirurgies cosmétiques, telles que <strong>de</strong>s liposuccions, <strong>de</strong>s rhyti<strong>de</strong>ctomies, <strong>de</strong>s<br />
blépharop<strong>la</strong>sties et <strong>de</strong>s imp<strong>la</strong>nts capil<strong>la</strong>ires.<br />
Ses apports les plus importants en chirurgie cosmétique sont <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> plus <strong>de</strong><br />
8000 liposuccions à partir <strong>de</strong> 1981, <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong> <strong>la</strong> liposuccion en plusieurs volumes,<br />
<strong>la</strong> définition <strong>de</strong> liposculpture et <strong>la</strong> façon <strong>de</strong> calculer le volume <strong>de</strong> solution <strong>de</strong> Klein<br />
<strong>de</strong>vant être infiltré pour réaliser une liposuccion.<br />
Le parcours du Dr Hernán<strong>de</strong>z Pérez au sein du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut remarquable : il débuta comme délégué national représentant le Salvador<br />
en 1970, occupa entre 1984 et 1992 (<strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s consécutives) le poste <strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nt<br />
et fut ultérieurement nommé prési<strong>de</strong>nt du CILAD, <strong>de</strong> 1992 à 1996.<br />
227
JULIO E. BAÑOS, ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ, LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ<br />
228<br />
Il publia jusqu’à présent plus <strong>de</strong> 200 travaux scientifiques en espagnol et en ang<strong>la</strong>is;<br />
ses <strong>de</strong>ux livres Clínica <strong>de</strong>rmatológica [Clinique <strong>de</strong>rmatologique] et Cirugía <strong>de</strong>rmatológica<br />
práctica [Chirurgie <strong>de</strong>rmatologique pratique] furent édités plusieurs fois. Il écrivit aussi<br />
plusieurs chapitres <strong>de</strong> livres internationaux et édita <strong>de</strong> nombreuses revues scientifiques<br />
internationales. Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années, son intérêt se tourna vers <strong>la</strong> chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique.<br />
Il est actuellement directeur du centre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie cosmétique <strong>de</strong><br />
San Salvador, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie cosmétique <strong>de</strong> l’hôpital national<br />
Santa Teresa, certificateur et examinateur pour l’American Board of Cosmetic Surgery,<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Meso-American Aca<strong>de</strong>my of Cosmetic Surgery, membre du Groupe<br />
international <strong>de</strong> thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique et directeur du programme <strong>de</strong> chirurgie<br />
cosmétique approuvé par le CILAD et par l’American Aca<strong>de</strong>my of Cosmetic Surgery. Il<br />
donne fréquemment <strong>de</strong>s conférences en Amérique Latine et en Europe.<br />
Les Drs Enrique Flores Díaz et Fernando Adolfo Cruz Argumedo arrivèrent au pays<br />
vers 1970, après avoir étudié <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua. Le premier<br />
étudia à l’université <strong>de</strong> Stanford; il occupa le poste <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et travail<strong>la</strong> comme <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital<br />
pédiatrique Benjamín Bloom. Juan José Rodríguez et lui-même promurent <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique dans le pays.<br />
Pour sa part, le Dr Cruz poursuivit ses étu<strong>de</strong>s à l’hôpital Saint-Louis, à Paris, et <strong>de</strong>vint<br />
à son retour professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université du Salvador.<br />
Parmi les <strong>de</strong>rmatologues formés par le Dr Hernán<strong>de</strong>z Pérez, nous distinguerons Julio<br />
Eduardo Baños : après trois ans <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie, il s’instal<strong>la</strong> à Mexico<br />
DF en 1979, où il se spécialisa en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique sous <strong>la</strong> tutelle du Dr Ramón<br />
Ruiz-Maldonado, chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie DIF<br />
(anciennement IMAN). De retour au Salvador, il compléta ses étu<strong>de</strong>s en cryochirurgie<br />
avec le Dr Gilberto Castro Ron à l’institut oncologique Luis Razzeti <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Caracas.<br />
Il fut professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université<br />
du Salvador, et col<strong>la</strong>bora avec les Drs Hernán<strong>de</strong>z Pérez (chef), Enrique Flores<br />
Díaz et Adolfo Cruz pour les cours d’étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, ainsi<br />
que les cours <strong>de</strong> spécialisation du résidanat en <strong>de</strong>rmatologie. Il débuta <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cryochirurgie à l’hôpital Rosales et à l’hôpital pédiatrique Benjamín Bloom, où il exerça<br />
<strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine dans le cabinet externe et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que consultant dans tout<br />
l’hôpital. Parmi les postes occupés, il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’institut salvadorien<br />
<strong>de</strong> l’Assurance sociale, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>rmatologique du Salvador (<strong>de</strong>venue<br />
Association <strong>de</strong>rmatologique) à plusieurs reprises, délégué national auprès du<br />
CILAD et vice-prési<strong>de</strong>nt du CILAD comme représentant <strong>de</strong> l’Amérique centrale pendant<br />
<strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s (<strong>de</strong> 1996 à 2003).<br />
Actuellement, on dénombre quarante <strong>de</strong>rmatologues diplômés dans différents pays<br />
d’Amérique Latine travail<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> manière active au Salvador. ■<br />
Octobre 2005
■ Références<br />
bibliographique<br />
s<br />
1. Hernán<strong>de</strong>z Pérez E. « La<br />
Dermatología en El<br />
Salvador. » Dermatol. Rev.<br />
Mexic. 1967; 11(1) : 39-48.<br />
2. Ramírez O. « Paleomedicina<br />
americana. Tratamiento<br />
cuzcatleco <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tiñas. »<br />
Derm. Ibero. Lat. Am. 1964;<br />
6 : 211-218.<br />
3. Ramírez O. « Dermatología en<br />
barro en El Salvador. » Actas<br />
finales <strong>de</strong>l 5º Congreso Ibero-<br />
Latino-Americano <strong>de</strong><br />
Dermatología. Buenos Aires.<br />
1963; 1137-1143.<br />
4. Llerena J. [communication<br />
personnelle]. 1966.<br />
5. Barrientos E. [communication<br />
personnelle].<br />
6. Rodríguez J.J. Contribución al<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong>s afecciones<br />
cutáneas en El Salvador<br />
[thèse <strong>de</strong> doctorat].<br />
Universidad <strong>de</strong> El Salvador;<br />
1941.<br />
7. Rodríguez J.J. [communication<br />
personnelle]. 1966.<br />
8. Rodríguez J.J. Esporotricosis<br />
fija. Presentación <strong>de</strong> tres<br />
casos en niños <strong>de</strong>l Hospital<br />
<strong>de</strong> Niños Benjamín Bloom.<br />
Trabajo presentado en el 5º<br />
Congreso Centro Americano<br />
<strong>de</strong> Dermatología. San José<br />
(Costa Rica); 1965.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie au Salvador<br />
9. Carranza Amaya. Lepra en El<br />
Salvador. 1965; 243 : 6-25.<br />
10. Llerena J., Godoy G.A.<br />
« Dermatofitos responsables<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Tinea Capitis en El<br />
Salvador. » Arch. Col. Med. El<br />
Salvador. 1961; 14 : 183-<br />
186.<br />
11. Llerena J. Micosis profundas<br />
observadas en El Salvador.<br />
Presentado en <strong>la</strong> 1ª Reunión<br />
México-Centroamérica <strong>de</strong><br />
Dermatología. México; 1964.<br />
12. Llerena J. Esporotricosis en El<br />
Salvador [communication<br />
personnelle].<br />
13. Hernán<strong>de</strong>z Pérez E.<br />
[communication personnelle].<br />
Nov. 2004.
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE AU<br />
GUATEMALA<br />
EDUARDO SILVA-LIZAMA, PABLO HUMBERTO URQUIZU DÁVILA,<br />
PETER GREENBERG CORDERO, SUZZETTE DE LEÓN G.<br />
Carlos Martínez Durán, bril<strong>la</strong>nt mé<strong>de</strong>cin et historien, écrit dans le prologue <strong>de</strong> Las<br />
Ciencias Médicas en Guatema<strong>la</strong> [Les sciences médicales au Guatema<strong>la</strong>] :<br />
L’<strong>Histoire</strong> n’est pas le corps fané du passé ni <strong>la</strong> surabondance méthodique <strong>de</strong> recherches<br />
minutieuses menées dans les archives. Ce n’est pas le texte mort du livre ni<br />
l’interprétation <strong>de</strong> ce que d’agréables ou <strong>de</strong> sévères chroniqueurs nous transmirent.<br />
L’<strong>Histoire</strong> est <strong>la</strong> vie même, toujours variable et capricieuse, étrangère au moule d’un<br />
système froid et au calcul <strong>de</strong> <strong>la</strong> science exacte. Clio ne sera jamais <strong>la</strong> même Muse.<br />
Chaque temps lui impose <strong>de</strong>s yeux nouveaux et <strong>de</strong> nouveaux habits ; chaque époque<br />
lui insuffle une vitalité nouvelle, et c’est justement à cause <strong>de</strong> son étroite liaison avec<br />
<strong>la</strong> vie que l’<strong>Histoire</strong> est une science si profondément humaine et sociale.<br />
Dans son livre Historia <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> [<strong>Histoire</strong> du Guatema<strong>la</strong>], Francis Polo Sifontes<br />
définit l’<strong>Histoire</strong> comme « un rapport écrit <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie humaine <strong>de</strong>puis le passé<br />
jusqu’au présent, et encore l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> signification <strong>de</strong> ces faits pour l’homme lui-même ».<br />
Il fait aussi référence à <strong>la</strong> culture comme « <strong>la</strong> conduite ou le comportement appris et manifesté<br />
ultérieurement par les membres d’une société ». En <strong>de</strong>rmatologie, ces <strong>de</strong>ux<br />
concepts sont liés car ils font partie intégrante <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture médicale <strong>de</strong> notre pays. C’est<br />
pourquoi, en tant que <strong>de</strong>rmatologues, nous sommes obligés d’être non seulement <strong>de</strong>s experts<br />
en ma<strong>la</strong>dies cutanées mais aussi d’étudier leur histoire, notamment dans notre<br />
pays : nos connaissances sur les caractéristiques particulières <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées au<br />
Guatema<strong>la</strong> nous permettront d’enrichir ainsi <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mondiale.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
Les Mayas<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
Pablo Humberto Urquizu Dávi<strong>la</strong><br />
Les Mayas possédaient <strong>la</strong> culture <strong>la</strong> plus avancée du mon<strong>de</strong> découvert par Colomb ;<br />
ils méritent d’être appelés « les Grecs <strong>de</strong> l’Amérique ». L’admiration provoquée par les<br />
constructions qui témoignent <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ce peuple suscita <strong>la</strong> venue dès le début<br />
231
Figures:<br />
1. Vieille dame avec<br />
enfant<br />
2. Calvitie<br />
3. Difformité du nez<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
232<br />
du XIX e siècle, <strong>de</strong> voyageurs et <strong>de</strong> spécialistes du mon<strong>de</strong> entier vers ces régions forestières<br />
pour en connaître les sites sacrés. La sous-région maya eut une extension d’environ<br />
325 000 km 2 , c’est-à-dire un territoire équiva<strong>la</strong>nt au triple <strong>de</strong> celui que <strong>la</strong><br />
République du Guatema<strong>la</strong> occupe actuellement. Les Mayas occupèrent les terres actuelles<br />
<strong>de</strong>s États mexicains Chiapas, Tabasco, Yucatán et Quintana Roo, ainsi que <strong>la</strong><br />
République du Guatema<strong>la</strong>, Belize et l’ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> République du Honduras. Leurs origines<br />
sont très lointaines : certains historiens croient qu’il s’agit d’une culture qui se<br />
développa in situ ; bien que l’existence <strong>de</strong>s Mayas remonte à l’an 3113 av. J.-C., les experts<br />
ne trouvèrent aucune preuve <strong>de</strong> leur culture avant l’an 2000 av. J.-C.<br />
La vie <strong>de</strong> ce peuple tournait autour <strong>de</strong> sur <strong>la</strong> culture du maïs, leur principale nourriture.<br />
Ils fondèrent leurs principaux lieux <strong>de</strong> cérémonie dans <strong>de</strong>s endroits secs et éloignés<br />
d’un fleuve ou d’un <strong>la</strong>c, comme le Tikal et l’Uaxactun ; mais dans certains cas ils les édifièrent<br />
à côté d’un cours d’eau, comme le Copan ou le Yaxhá.<br />
PÉRIODE CLASSIQUE (2000 AV. J.-C. - 300 APRÈS J.-C.)<br />
On l’appe<strong>la</strong> également « pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> formation » car les bases <strong>de</strong> cette culture furent<br />
établies au cours <strong>de</strong> cette époque. Sa durée considérable — <strong>de</strong>ux mille trois cents ans —<br />
fut suffisante pour atteindre <strong>la</strong> splen<strong>de</strong>ur pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> suivante qui constitua le<br />
point culminant <strong>de</strong> cette civilisation extraordinaire. Durant cette pério<strong>de</strong> les Mayas<br />
étaient organisés en noyaux agricoles sous forme <strong>de</strong> hameaux. L’agriculture constituait<br />
<strong>la</strong> base <strong>de</strong> l’économie ; <strong>la</strong> religion était représentée par le culte <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et les phénomènes<br />
naturels, tandis que l’architecture était cérémonielle et religieuse.<br />
PÉRIODE CLASSIQUE (300 - 900 APRÈS J.-C.)<br />
C’est au cours <strong>de</strong> ces six cents ans que les Mayas atteignirent leur plein développement<br />
culturel et leur splen<strong>de</strong>ur. Le gouvernement était théocratique, c’est-à-dire<br />
exercé par <strong>de</strong>s prêtres, qui détenaient aussi le mandat militaire et une succession<br />
héréditaire. Le gouvernant s’appe<strong>la</strong>it Ha<strong>la</strong>c Uinic et il était aidé par les caciques<br />
mineurs, le sacerdoce, <strong>la</strong> noblesse, le peuple et les esc<strong>la</strong>ves. Pendant cette époque<br />
l’agriculture s’intensifia : on vendait l’excé<strong>de</strong>nt ou on l’échangeait contre d’autres produits,<br />
ce qui provoqua un essor du commerce <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Le développement <strong>de</strong>s<br />
sciences fut lié à <strong>la</strong> religion. Les Mayas se distinguèrent en astronomie : ils étudiaient<br />
les mouvements du soleil dans leurs observatoires ; encore <strong>de</strong> nos jours on reconnaît<br />
l’exactitu<strong>de</strong> du calendrier maya.<br />
Ils démontrèrent leurs connaissances en mathématiques et en ingénierie par <strong>la</strong><br />
construction <strong>de</strong> leurs grands monuments, <strong>de</strong> canaux d’irrigation, <strong>de</strong> chenaux pour<br />
conduire les eaux <strong>de</strong> pluie, et par le dép<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> pierres énormes et <strong>de</strong> matériaux<br />
utiles à <strong>la</strong> construction. La mé<strong>de</strong>cine connut son apogée en ce qui concerne l’usage
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
d’herbes et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales ; ils pratiquaient l’odontologie et réalisaient <strong>de</strong><br />
véritables prothèses <strong>de</strong>ntaires. L’architecture, surtout religieuse, fut remarquable<br />
au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, avec <strong>la</strong> construction d’un nombre pléthorique <strong>de</strong> lieux <strong>de</strong><br />
cérémonie, <strong>de</strong> chaussées et <strong>de</strong> jeux <strong>de</strong> balle.<br />
PÉRIODE POST-CLASSIQUE (900 - 1500 APRÈS J.-C.)<br />
Le passage à cette pério<strong>de</strong> fut traumatisant. On estime que vers l’an 900 après J.-C. il<br />
y eut une sécheresse prolongée qui affecta pendant plusieurs années le territoire mésoaméricain,<br />
selon les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> paléobotanique. Le peuple maya s’en remit à ses<br />
prêtres, surtout à ceux qui se dédiaient au culte <strong>de</strong> Chac, seigneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> pluie, mais les<br />
efforts <strong>de</strong> ceux-ci furent vains ; le peuple se rebel<strong>la</strong> et les prêtres disparurent après <strong>de</strong>s<br />
révoltes sang<strong>la</strong>ntes. La c<strong>la</strong>sse sacerdotale était <strong>la</strong> seule à savoir lire et écrire, et elle<br />
conservait jalousement ses connaissances en astronomie et en agriculture, raison pour<br />
<strong>la</strong>quelle les sociétés mayas déclinèrent. Une invasion <strong>de</strong>puis le nord-ouest <strong>de</strong>s Toltèques<br />
eut lieu simultanément ; ces conquérants provenaient <strong>de</strong> Tu<strong>la</strong>, une ville située sur le haut<br />
p<strong>la</strong>teau central du Mexique, et leur <strong>la</strong>ngue était le nahuatl. Les Toltèques al<strong>la</strong>ient s’emparer<br />
<strong>de</strong>s lieux mayas. Des chroniques indigènes comme le Memorial <strong>de</strong> Tecpán ou le<br />
Popol Vuh dévoilent comment les Cakchiquels et les Quichés, venus <strong>de</strong> Tu<strong>la</strong> par <strong>la</strong> mer,<br />
emportant leurs dieux toltèques comme Tohil, Avilix et Jacavitz, écrivirent en <strong>la</strong>ngue<br />
maya et utilisèrent l’ancien calendrier maya avec leur système vigésimal. La pério<strong>de</strong><br />
post-c<strong>la</strong>ssique se caractérisa par <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong> guerre et <strong>de</strong> rivalités continuelles : cellesci<br />
provoquèrent l’apparition <strong>de</strong>s autorités indigènes que découvriraient les Espagnols à<br />
leur arrivée et dont les haines mutuelles profiteraient à Dom Pedro <strong>de</strong> Alvarado à ses fins<br />
<strong>de</strong> conquête 1, 9 .<br />
LA MÉDECINE MAYA<br />
Trois sources importent pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine maya :<br />
1) les supports artistiques très riches où sont représentées les ma<strong>la</strong>dies les plus importantes<br />
;<br />
2) les co<strong>de</strong>x mayas, le Popol Vuh et les écrits indigènes ;<br />
3) les anciens chroniqueurs qui furent témoins <strong>de</strong>s us et coutumes.<br />
Les ma<strong>la</strong>dies peuvent également expliquer d’une certaine façon le déclin <strong>de</strong> cette<br />
civilisation, qui n’avait rien à envier à celle <strong>de</strong> l’Égypte ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mésopotamie.<br />
LA MYTHOLOGIE MAYA<br />
Les Mayas sacralisèrent <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, et <strong>la</strong> liturgie que connaissait <strong>la</strong> caste sacerdotale<br />
était une science mystérieuse transmise <strong>de</strong> père en fils. Les indigènes actuels<br />
connaissent très peu <strong>de</strong> choses à propos <strong>de</strong> ces secrets. Il reste encore au Yucatán <strong>de</strong>s<br />
233<br />
Figures :<br />
4. Difformité du<br />
visage<br />
5. Difformité faciale<br />
6. Difformités faciales
Figures :<br />
7. Destruction nasale<br />
8. Rage <strong>de</strong> <strong>de</strong>nts<br />
9. Œdème <strong>de</strong>s<br />
membres inférieurs<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
234<br />
herboristes, tandis qu’au Guatema<strong>la</strong> les sorciers<br />
ou guérisseurs sont les <strong>de</strong>rniers représentants<br />
<strong>de</strong> cette caste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
indigènes. Les divinités médicales étaient<br />
nombreuses et variées, et se concurrençaient<br />
en pouvoir et en gran<strong>de</strong>ur.<br />
On croyait que les ma<strong>la</strong>dies pouvaient<br />
être causées par <strong>de</strong>s esprits ou <strong>de</strong>s êtres aux<br />
pouvoirs surnaturels, et qu’elles pouvaient<br />
résulter <strong>de</strong> causes naturelles comme <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts,<br />
<strong>de</strong>s déficiences ou <strong>de</strong>s excès. On pouvait<br />
prescrire un traitement si on en<br />
découvrait <strong>la</strong> cause. La ma<strong>la</strong>die que causait<br />
l’offense envers les dieux exigeait, par<br />
exemple, <strong>la</strong> confession du péché et <strong>la</strong> pénitence;<br />
si elle était due à une sorcellerie, on agissait contre, mais si elle était due à<br />
<strong>de</strong>s causes naturelles, on prescrivait les médicaments appropriés. S’il s’agissait<br />
d’une ma<strong>la</strong>die habituelle, le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> était soigné chez lui, mais si <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die était<br />
chronique, on <strong>la</strong> considérait comme un châtiment <strong>de</strong>s dieux.<br />
Les anciens Mésoaméricains reconnaissaient une inégalité entres les personnes<br />
: les hommes étaient considérés k´an (agressifs, sûrs d’eux, irascibles) et<br />
les femmes nakanik (paisibles, dociles, soumises). L’âge était un autre facteur <strong>de</strong><br />
distinction : les anciens étaient considérés comme plus sages et plus forts que les<br />
jeunes ; ce<strong>la</strong> est mentionné dans le Memorial <strong>de</strong> Sololá, dans le Popol Vuh et dans<br />
le Título <strong>de</strong> los Señores <strong>de</strong> Totonicapán [Titre <strong>de</strong>s Seigneurs <strong>de</strong> Totonicapán], où<br />
les divinités étaient vieilles.<br />
Ils croyaient aussi que <strong>la</strong> faiblesse temporaire provenait du fait <strong>de</strong> commettre<br />
un péché, d’éprouver <strong>de</strong>s émotions bouleversantes ou d’être envieux ; on pensait<br />
que le travail excessif, l’exposition au froid ou à <strong>la</strong> chaleur et l’ingestion <strong>de</strong> certains<br />
aliments troub<strong>la</strong>it l’équilibre.<br />
On trouve dans ces textes une expression <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie <strong>de</strong> l’équilibre et son rapport à<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Sur les terres élevées du Guatema<strong>la</strong> on croyait qu’un corps fort est davantage<br />
protégé contre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die qu’un corps faible : cette force se rapportait à <strong>la</strong> nature<br />
du sang, qui peut être fort ou faible, froid ou chaud, on croyait que le sang ne pouvait<br />
pas se régénérer et que toute perte entraînait une déficience. Les enfants, les femmes et<br />
certains anciens étaient considérés plus faibles. On pensait que les anciens étaient plus<br />
forts et plus puissants que les jeunes, notamment s’ils étaient sorciers, guérisseurs ou<br />
chefs. Pour conserver l’équilibre corporel, il fal<strong>la</strong>it être en harmonie avec <strong>la</strong> nature, avec<br />
<strong>la</strong> société et avec les dieux. La confession et le sacrifice étaient les moyens les plus sûrs<br />
pour y parvenir 2, 5 .<br />
La déesse Ixchel et les dieux Citobolontun et Itzamná formaient <strong>la</strong> trinité <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
maya ; Citobolontun et Itzamná travaillèrent pour découvrir les vertus médicinales<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes. Ils léguèrent ces connaissances en héritage aux H-Menes, une famille hippocratique<br />
initiée à l’art <strong>de</strong> guérir.<br />
Itzamná : à <strong>la</strong> fois Dieu et homme, il était le père <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine ; sa fête était célébrée<br />
au mois <strong>de</strong> Zip, c’est-à-dire le mois du péché. Le 8 était le jour capital : on versait<br />
face au dieu les herbes médicinales qui recevaient le souffle <strong>de</strong> <strong>la</strong> divinité. On dansait et<br />
on utilisait <strong>de</strong> l’encens pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à Ahau Chamahez d’être sain. Le peuple défi<strong>la</strong>it<br />
et attendait <strong>la</strong> bénédiction.<br />
Ixchel : <strong>la</strong> femme arc-en-ciel, gardienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> maternité, elle recevait <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s<br />
florales <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s femmes désirant être fertiles.<br />
Citobolontun : le compagnon masculin, il offrait ses dons salutaires.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Zuhuykak et Ixtliton : ils<br />
garantissaient <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s<br />
petites filles et <strong>de</strong>s petits<br />
garçons.<br />
Kinich-ahau : le visage<br />
du soleil, il brû<strong>la</strong>it le<br />
démon <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et représentait<br />
le dieu <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
photothérapie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> thermothérapie.<br />
Kukulcan : dieu omnipotent<br />
qui soignait les fièvres.<br />
Tzapot<strong>la</strong>-tenan : c’était<br />
<strong>la</strong> grand-mère <strong>de</strong> <strong>la</strong> thérapeutique topique du fait d’avoir découvert l’oxitl (térébenthine),<br />
<strong>la</strong> résine qui soignait <strong>la</strong> bouba et les p<strong>la</strong>ies cutanées.<br />
Temazcaltec : <strong>la</strong> grand-mère <strong>de</strong>s bains, elle conseil<strong>la</strong>it les bains <strong>de</strong> vapeur.<br />
Yun-cimil : le seigneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort, il se promenait en compagnie <strong>de</strong> sa chouette autour<br />
<strong>de</strong> celui qui agonisait ; parfois il partait sans emporter l’âme du patient.<br />
Il n’y a pas <strong>de</strong> doute que <strong>la</strong> mythologie médicale fut inspirées par les ma<strong>la</strong>dies subies<br />
par les Mayas 4, 5 (figures 1-17).<br />
LA MÉDECINE DANS LE POPOL VUH<br />
Le Popol Vuh contient les histoires <strong>de</strong>s Indiens Quichés sur <strong>la</strong> formation du mon<strong>de</strong>, ses<br />
dieux, ses héros et ses hommes; il traite donc <strong>de</strong> mythologie, <strong>de</strong> religion et <strong>de</strong> généalogie.<br />
Le frère Francisco Ximénez naquit en 1666 à Ecija, dans <strong>la</strong> province d’Andalousie, et arriva<br />
au Guatema<strong>la</strong> en 1688; il était frère <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> Saint-Domingue et eut comme mission<br />
<strong>de</strong> rédiger <strong>la</strong> chronique <strong>de</strong> sa province. Lors <strong>de</strong> son séjour à Chichicastenango, les Indiens<br />
lui montrèrent le manuscrit <strong>de</strong>s Quichés, dont il copia l’original en <strong>la</strong>ngue quiché pour le<br />
traduire ensuite en espagnol. Cette copie se trouve à <strong>la</strong> Newberry Library <strong>de</strong> Chicago 4, 10 .<br />
Le Popol Vuh mentionne quelques divinités mayas responsables <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies. Les seigneurs<br />
<strong>de</strong> Xibalba (l’inframon<strong>de</strong>) pouvaient causer <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies. Xik´iri (nez vo<strong>la</strong>nt) et<br />
Kuchuna Kiq´ (chef sang) étaient <strong>de</strong>s seigneurs dont le travail consistait à produire « du<br />
sang pour que les gens soient ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ». Le sang était perçu par beaucoup comme un<br />
moyen <strong>de</strong> subir un préjudice extérieur. Les seigneurs <strong>de</strong> Xibalbá parvenaient à rendre<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s les personnes en affectant leur sang. Le Popol Vuh mentionne le seigneur Ahal<br />
puh (faiseur <strong>de</strong> pus), qui provoquait <strong>de</strong>s infections. L’Ahal gana Q´ama (faiseur <strong>de</strong> fureur)<br />
avait le pouvoir <strong>de</strong> « faire gonfler les individus ». La bile au visage provoquait <strong>la</strong> jaunisse.<br />
Les seigneurs Chamiabaq (bâton os) et Chamiaholom (bâton tête <strong>de</strong> mort) transformaient<br />
les êtres en os et en têtes <strong>de</strong> mort. Les seigneurs Ahalmez (faiseur <strong>de</strong> saleté) et<br />
Ahaltokob (faiseur <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ies) étaient dangereux dans les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> pauvreté.<br />
L’Ahalxic (seigneur épervier) et le Patan (seigneur piège) causaient <strong>la</strong> mort sur les chemins.<br />
Les Cakchiquels avaient un dieu appelé Ahal Xic qui provoquait une mort subite.<br />
Itzamná, dieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, et Ixchel, <strong>la</strong> déesse lune, étaient invoqués lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> fête<br />
<strong>de</strong>s guérisseurs et <strong>de</strong>s sorciers, pendant le mois <strong>de</strong> Zip. Itzamná était connu pour guérir<br />
les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et ressusciter les morts. Ixchel était <strong>la</strong> déesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> procréation, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mise au mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies à l’origine <strong>de</strong>s pustules. La syphilis<br />
était une <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies assignées à Ixchel à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> symbolique érotique <strong>de</strong> cette<br />
divinité 10 .<br />
CONNAISSANCES ANATOMIQUES ET CHIRURGICALES DES MAYAS<br />
Les instruments chirurgicaux étaient en obsidienne ; ces couteaux leur servaient à<br />
ouvrir <strong>de</strong>s abcès et à effectuer d’autres chirurgies mineures. Les connaissances<br />
235<br />
Figures:<br />
10. Champignons<br />
cérémoniaux<br />
11. Ri<strong>de</strong>s
Figures:<br />
12. Bec <strong>de</strong> lièvre<br />
13. rynophima<br />
14. Tumeur<br />
abdominale<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
236<br />
anatomiques résultaient <strong>de</strong>s sacrifices humains et animaux. Ils connaissaient bien le<br />
cœur. Au début les Mayas ne pratiquaient pas <strong>de</strong> sacrifice humain ; cette terrible coutume<br />
dériva <strong>de</strong> leur contact avec les Aztèques et correspond à une époque très tardive<br />
<strong>de</strong> leur histoire, comme le prouvent certaines étu<strong>de</strong>s réalisées dans les villes indigènes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> post-c<strong>la</strong>ssique (par exemple, Iximché).<br />
Les Mayas-Quichés considérèrent l’étiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die comme différente <strong>de</strong> son<br />
aspect sacré, et leur observation leur octroya une connaissance plus exacte <strong>de</strong> celle-ci.<br />
Le froid et l’humidité furent reconnus comme <strong>de</strong>s agents provoquant les rhumatismes ;<br />
le vent engendrait certaines ma<strong>la</strong>dies ; le régime alimentaire <strong>de</strong>s Indiens était sage et<br />
sain, et les habitu<strong>de</strong>s sexuelles étaient modérées.<br />
Ils connaissaient le rôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> contagion dans les épidémies ; ils pratiquaient <strong>la</strong> sorcellerie<br />
pour savoir si une ma<strong>la</strong>die pouvait être guérie ou pas. Ils connaissaient <strong>la</strong> blennorragie,<br />
<strong>la</strong> bouba, l’impuissance sexuelle et les ma<strong>la</strong>dies éruptives. Ils décrivirent le<br />
typhus exanthématique en employant <strong>de</strong>s mots composés tels que zahualt (éruption) ; ils<br />
connaissaient également <strong>la</strong> leishmaniose, le rynophima et l’ulcus ro<strong>de</strong>ns.<br />
Leur vie guerrière leur fournit une connaissance particulière <strong>de</strong>s blessures ; ils les<br />
c<strong>la</strong>ssifièrent <strong>de</strong> manière topographique, en considérant leur profon<strong>de</strong>ur, leur cause et<br />
leurs complications. Chaque ma<strong>la</strong>die était traitée avec <strong>de</strong>s herbes, et <strong>de</strong>s spécialistes se<br />
chargeaient du traitement. Il existait <strong>de</strong>s spécialistes en morsures du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong><br />
quantité <strong>de</strong> serpents et d’insectes. Ils connaissaient les articu<strong>la</strong>tions du corps, parfois représentées<br />
sur <strong>de</strong> petites figures (le Popol Vuh fait notamment référence à <strong>la</strong> réparation<br />
<strong>de</strong>s os). Le frère Bartolomé <strong>de</strong> Las Casas mentionna les herboristes, appelés quamanel,<br />
dont <strong>la</strong> signification est « celui qui guérit ». Les mé<strong>de</strong>cins effectuaient probablement un<br />
certain type <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> base appuyée sur <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> essai/erreur, en observant<br />
l’effet <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes sur différentes pathologies.<br />
Lors <strong>de</strong> l’accouchement, <strong>la</strong> femme enceinte confessait ses péchés, tandis que <strong>la</strong> sagefemme<br />
se prélevait du sang avec lequel elle aspergeait <strong>la</strong> future mère en faisant <strong>de</strong>s invocations<br />
afin <strong>de</strong> rendre l’accouchement plus facile.<br />
La chirurgie n’était pas aussi développée que <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à base d’herbes ; cependant<br />
les chirurgiens étaient capables d’arracher <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts, <strong>de</strong> fabriquer <strong>de</strong>s prothèses, d’extraire<br />
<strong>de</strong>s corps étrangers, <strong>de</strong> drainer <strong>de</strong>s abcès, <strong>de</strong> soigner <strong>de</strong>s blessures, tout comme<br />
ils pouvaient effectuer <strong>de</strong>s saignées, <strong>de</strong>s circoncisions, <strong>de</strong>s trépanations crâniennes et<br />
prodiguer <strong>de</strong>s soins ocu<strong>la</strong>ires.<br />
D’après les chroniqueurs, l’éventail thérapeutique <strong>de</strong>s Indiens était efficace et supérieur<br />
à celui <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s chirurgiens qui arrivèrent au XVI e siècle. Il existait à<br />
l’époque <strong>de</strong>s purgatifs, <strong>de</strong>s diurétiques, <strong>de</strong>s coagu<strong>la</strong>nts, <strong>de</strong>s émétiques, <strong>de</strong>s sédatifs,<br />
entre autres.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Le régime et les bains constituaient les principales habitu<strong>de</strong>s hygiéniques. L’alimentation<br />
était équilibrée, le maïs étant l’aliment <strong>de</strong> base, et ils cuisinaient aussi les légumes<br />
et <strong>la</strong> vian<strong>de</strong> <strong>de</strong> cerf, ainsi que le poisson. Ils préparaient <strong>de</strong>s boissons fermentées à base<br />
<strong>de</strong> fruits tels que le jocote.<br />
Les Mayas pratiquaient le bain <strong>de</strong> vapeur. Les bains <strong>de</strong> temazcal formaient <strong>de</strong>s rites<br />
spéciaux : les couples prenaient le bain ensemble, les femmes enceintes pendant les <strong>de</strong>rniers<br />
mois <strong>de</strong> <strong>la</strong> grossesse, tandis que les célibataires les prenaient seuls. Ces bains mesuraient<br />
un peu plus <strong>de</strong> 1 mètre et avaient <strong>de</strong>s murs <strong>de</strong> pierre, avec le sol en bois couvert<br />
<strong>de</strong> boue. Il y avait à l’intérieur <strong>de</strong>s pierres chauffées et arrosées ensuite pour produire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vapeur. La déesse Temazcalteci en était <strong>la</strong> protectrice.<br />
Ils employaient aussi <strong>de</strong>s eaux médicinales, par exemple sulfureuses pour les<br />
crampes, les douleurs corporelles, les infections intestinales et les rhumatismes ; ils<br />
croyaient que les eaux thermales avaient le pouvoir <strong>de</strong> guérir. Les Européens du<br />
XVIe siècle n’étaient pas habitués à se <strong>la</strong>ver fréquemment. Le capitaine Juan <strong>de</strong> Estrada<br />
(1579) mentionne dans un récit qu’« ils avaient l’habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> se <strong>la</strong>ver dans les rivières,<br />
et ils le font toujours ». Le chroniqueur espagnol Fuentes y Guzmán raconte que les in-<br />
4, 5<br />
digènes se baignaient pour traiter les fièvres, les tumeurs (syphilis) et d’autres maux<br />
(tableau 1).<br />
Tableau 1. Nom anatomique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> ses annexes et <strong>de</strong> quelques ma<strong>la</strong>dies en <strong>la</strong>ngue maya 4<br />
Peau Oth, Othiel<br />
Bouche Chii<br />
Lèvre Boxel chii<br />
Langue Ak<br />
Pa<strong>la</strong>is Mabcaan<br />
Salive Tub<br />
Gencives Chuncó<br />
Cheveu Tzotz<br />
Ongle Ichac<br />
Crâne dégarni et pellicules Thab<br />
Sueur Zackeluc<br />
Urticaire Zob<br />
Vitiligo Zac Ha<strong>la</strong>y<br />
Variole Kak<br />
Ampoules Popol, choo<strong>la</strong>x<br />
Abcès Bocan, chuchum<br />
Bouba Zob<br />
Cancer Cunuz<br />
Douleur Yail<br />
Ma<strong>la</strong>die Kohanil<br />
Fièvre Chacauil<br />
Lèpre Naycan<br />
Ulcère par traumatisme Cuinpaharil<br />
Ulcère suintant Pomactel<br />
Ulcère incurable Taacan<br />
Mal <strong>de</strong> <strong>la</strong> bouche Chacnich<br />
Mort Cimil<br />
Médicament Cac<br />
Perlèche Xaya kohi<br />
Miliaire Uzan<br />
Rougeole Uzankak<br />
Gale Uech<br />
Teigne Zock<br />
Onguent Nabzah<br />
L’ESTHÉTIQUE<br />
Les déformations céphaliques furent pratiquées <strong>de</strong> manière universelle et au cours <strong>de</strong><br />
pério<strong>de</strong>s culturelles données. Elles obéissent à <strong>de</strong>s raisons esthétiques liées à <strong>de</strong>s habitu<strong>de</strong>s<br />
magiques et religieuses. On ne doit pas associer cette pratique à un moindre développement<br />
culturel, car vers <strong>la</strong> fin du XIX e siècle elle était même pratiquée dans le sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> France.<br />
Ces déformations, inoffensives du point <strong>de</strong> vue médical, s’effectuaient en utilisant <strong>de</strong>s<br />
appareils spéciaux.<br />
Les co<strong>de</strong>x mayas montrent Hunahpú et d’autres dieux avec <strong>la</strong> tête allongée, car l’idéal<br />
esthétique consistait à avoir le front ap<strong>la</strong>ti 4, 5 .<br />
LES ÉPIDÉMIES PENDANT LA PÉRIODE PRÉCOLOMBIENNE<br />
L’empire maya fut détruit au VII e siècle <strong>de</strong> l’ère chrétienne. Certaines personnes<br />
croient que ce fut à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre jaune ; cependant, il n’existe pas <strong>de</strong> preuves<br />
convaincantes pour soutenir cette hypothèse car <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s plus récentes ont prouvé que<br />
cette ma<strong>la</strong>die fut importée d’Afrique en 1647. La variole était inconnue en Amérique et<br />
fut apportée par un marin avec Pánfilo <strong>de</strong> Narváez en 1520.<br />
237
Figures:<br />
15. Tumeur <strong>de</strong> l’aile<br />
nasale<br />
16. Tumeur <strong>de</strong> l’œil<br />
17. Difformité nasale<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
238<br />
Les épidémies <strong>de</strong> type exanthématique furent fréquentes en Amérique avant<br />
l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols ; elles étaient endémiques au Mexique et passèrent au<br />
Guatema<strong>la</strong>. On les nommait mat<strong>la</strong>tza hualt en <strong>la</strong>ngue aztèque.<br />
Le paludisme exista dans le Yucatan et dans certaines régions du Guatema<strong>la</strong><br />
sous <strong>de</strong>s formes bénignes.<br />
Le Memorial <strong>de</strong> Sololá, un manuscrit du XVI e siècle connu comme Anales <strong>de</strong><br />
los Cakchiquels ou Memorial <strong>de</strong> Tecpán Atitlán, décrit l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation cakchiquel<br />
qui se développa dans <strong>la</strong> ville Iximché.<br />
Ce Mémorial décrit une épidémie qui provoqua plusieurs morts parmi <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
indigène en 1523, un an avant l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols. Le nom indigène<br />
donné à cette épidémie fut chaac, qui veut dire « peste avec éruption cutanée ou<br />
avec <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies » ; suivant certains auteurs, ce<strong>la</strong> aurait pu être <strong>la</strong> rougeole, mais<br />
d’autres pensent que ce fut le typhus exanthématique. Selon les symptômes décrits<br />
dans le Mémorial, nous ne pouvons pas établir un diagnostic exact, mais<br />
nous pouvons conclure que les Cakchiquels acquirent <strong>de</strong>s connaissances en <strong>de</strong>rmatologie<br />
à cause <strong>de</strong> ces épidémies ; ils avaient aussi <strong>de</strong> l’expérience en chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique mineure et dans le traitement <strong>de</strong>s blessures.<br />
Le Mémorial dit :<br />
Plus tard commença l’attaque <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville au bout du pont, endroit choisi par Chucuybatzin<br />
pour faire <strong>la</strong> guerre et pour pousser les Tucuchés à <strong>la</strong> révolte. Quatre<br />
femmes étaient armées <strong>de</strong> cottes <strong>de</strong> coton et d’arcs, se déguisant pour <strong>la</strong> guerre en<br />
quatre jeunes guerriers. Les flèches <strong>la</strong>ncées par ces combattants pénétrèrent <strong>la</strong> natte<br />
<strong>de</strong> Chucuybatzin, <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> révolution <strong>de</strong>s anciens seigneurs fut épouvantable.<br />
Iximché, <strong>la</strong> capitale du royaume cakchiquel, eut une histoire brève et orageuse.<br />
Les Cakchiquels étaient les alliés <strong>de</strong>s Quichés, <strong>la</strong> cour se trouvait à Chiavar et le<br />
roi était Quikab. Mais le roi quiché fut renversé par ses enfants et il conseil<strong>la</strong> luimême<br />
aux Cakchiquels <strong>de</strong> fuir et <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r Iximché au sommet <strong>de</strong> <strong>la</strong> colline Ratzamut.<br />
Les rois Juntoh et Vukubatzm construisirent <strong>la</strong> ville en 1470. Dès lors<br />
ils furent les ennemis <strong>de</strong>s Quichés, ce qui fut profitable au conquistador Pedro<br />
<strong>de</strong> Alvarado, qui imita <strong>la</strong> tactique d’Hernán Cortés pour <strong>la</strong> conquête du<br />
Mexique.<br />
Bernal Díaz Del Castillo et Francisco Antonio <strong>de</strong> Fuentes y Guzmán furent<br />
les premiers historiens espagnols arrivés à Iximché. Bernal Díaz passa à<br />
Iximché en août 1526 ; il dut se frayer un chemin vers <strong>la</strong> ville par les armes,<br />
car les escadrons guatémaltèques cachés dans les ravins tendaient aux Espagnols<br />
une embusca<strong>de</strong>. Bernal passa <strong>la</strong> nuit à Guatema<strong>la</strong> <strong>la</strong> Vieja, qu’il décrivit<br />
ainsi : « Et il y avait <strong>de</strong>s logis et <strong>de</strong>s bâtisses si beaux et si aisés comme<br />
pour <strong>de</strong>s caciques qui commandaient toutes les provinces <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. » Cette<br />
<strong>de</strong>scription est un véritable éloge car le soldat chroniqueur avait été témoin<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> magnificence <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour aztèque 6 .<br />
La <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> Don Antonio <strong>de</strong> Fuentes y Guzmán dans <strong>la</strong> Recordación<br />
Florida, livre XV, chapitre V, est vivante et détaillée. Il y a un passage qu’il<br />
faut rapporter :<br />
Vers <strong>la</strong> partie nord du pa<strong>la</strong>is, dans un bel endroit orné, se trouvait un oracle du<br />
démon, une pierre <strong>de</strong> couleur noire cristalline comme du verre (plus belle et plus<br />
précieuse que <strong>la</strong> pierre <strong>de</strong> Chay) dont <strong>la</strong> transparence venait confirmer le verdict ;<br />
l’inculpé était exécuté par <strong>la</strong> suite dans ce tribunal, sur le socle où on l’avait châtié,<br />
et si dans le cas contraire aucune forme ne se représentait ou n’apparaissait dans<br />
<strong>la</strong> transparence <strong>de</strong> <strong>la</strong> pierre, il était libéré. En ce qui concerne les campagnes mili-
taires, <strong>la</strong> guerre était déc<strong>la</strong>rée ou non en fonction également <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme et du<br />
contenu <strong>de</strong> l’oracle.<br />
Ceci <strong>la</strong>isse supposer que cet oracle aurait également pu être consulté si quelque gouvernant<br />
ou supérieur avait souffert d’une ma<strong>la</strong>die ou <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatoses n’ayant pas pu être<br />
guéries par les mé<strong>de</strong>cins ou les prêtres.<br />
Il faut faire ici une brève analyse du nom Guatema<strong>la</strong> 4 . Les lettres que Pedro <strong>de</strong> Alvarado<br />
envoya à Hernán Cortés en 1524 sont les premiers documents historiques dans lesquels<br />
apparaît ce nom par écrit ; Alvarado raconte son voyage <strong>de</strong>puis Soconusco, et le<br />
mot Guatema<strong>la</strong> y apparaît trois fois.<br />
Dans sa <strong>de</strong>uxième lettre, Alvarado dit qu’il sortit d’Utatlán, <strong>la</strong> capitale du royaume<br />
quiché, et qu’il arriva à Guatema<strong>la</strong> <strong>de</strong>ux jours plus tard, c’est-à-dire à Iximché. Hernán<br />
Cortés nomme <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> dans sa lettre au roi Charles Quint, écrite le 15 octobre<br />
1524 au Mexique.<br />
Le nom Guatema<strong>la</strong> est écrit dans les trois lettres mentionnées ci-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> <strong>la</strong> même<br />
façon qu’il est écrit actuellement, et il correspond sûrement à <strong>la</strong> version hispanique du<br />
vocable Quauthtema<strong>la</strong>n (d’origine nahualt), le nom sous lequel les Indiens mexicains<br />
connaissaient <strong>la</strong> ville cakchiquel.<br />
Certains actes du conseil <strong>de</strong> Santiago font mention du mot Guatema<strong>la</strong> pour i<strong>de</strong>ntifier<br />
à l’origine <strong>la</strong> ville cakchiquel Iximché. Mais dès le 27 juillet 1525, il désigna <strong>la</strong> province<br />
<strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>, et plus tard le territoire appartenant à l’audience et le royaume qui<br />
s’étendait du Chiapas au Costa Rica 7 .<br />
À partir <strong>de</strong> 1847, Guatema<strong>la</strong> désigna uniquement <strong>la</strong> République, le département et <strong>la</strong><br />
capitale. Si les noms d’origine mexicaine donnés à plusieurs vil<strong>la</strong>ges ne sont que <strong>de</strong>s traductions<br />
libres <strong>de</strong>s noms originaux quichés, tzutujiles ou cakchiquels, et si on sait à partir<br />
<strong>de</strong>s déc<strong>la</strong>rations <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> Santiago Atitlán (1583) que <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue <strong>de</strong>s natifs<br />
désignait <strong>la</strong> ville sous le nom <strong>de</strong> Cakchiquil — qui se traduit en mexicain par Cuautema<strong>la</strong><br />
—, on peut conclure que <strong>la</strong> signification étymologique du mot Guatema<strong>la</strong> est <strong>la</strong> même que<br />
celle du terme cakchiquel.<br />
Le Memorial <strong>de</strong> Sololá énonce : « Lors <strong>de</strong> notre arrivée aux portes <strong>de</strong> Tulán, nous reçûmes<br />
un bâton rouge qui était notre oracle, c’est pourquoi on nous appe<strong>la</strong> Cakchiquels,<br />
ce qui veut dire les hommes au bâton rouge. »<br />
Le Popol Vuh dit <strong>la</strong> chose suivante : « Ils donnèrent tout <strong>de</strong> suite leur nom aux Cakchiquels,<br />
Gagcheque<strong>la</strong>b fut leur nom. » Ce<strong>la</strong> signifie ceux à l’arbre rouge ou aux feux. En<br />
conséquence, le mot Cakchiquel fut traduit en mexicain par Cuauhtemal<strong>la</strong>n et <strong>de</strong>vint le<br />
vocable hispanique Guatema<strong>la</strong>, qui pourrait signifier l’endroit <strong>de</strong>s hommes à l’arbre ou<br />
au bâton rouge ou encore à feu.<br />
La Dermatologie pendant <strong>la</strong> Conquête<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie pendant <strong>la</strong> Conquête<br />
Pedro <strong>de</strong> Alvarado quitta Tenochtitlán, <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> l’empire aztèque récemment<br />
conquise par Hernán Cortés, le 6 décembre 1523. Il avait pour mission <strong>de</strong> soumettre<br />
Utatlàn et Cuauthemal<strong>la</strong>n à <strong>la</strong> couronne espagnole. 120 hommes à cheval, 300 hommes<br />
à pied, 130 soldats armés d’arbalètes et <strong>de</strong> fusils, quatre corps d’artillerie possédant<br />
beaucoup <strong>de</strong> poudre, <strong>de</strong>s munitions et une force auxiliaire <strong>de</strong> guerriers mexicains<br />
culhúas et t<strong>la</strong>xcaltecas l’accompagnèrent.<br />
Des ma<strong>la</strong>dies innombrables assaillirent les conquistadors. Certaines étaient caractéristiques<br />
<strong>de</strong>s endroits qu’ils dominaient, d’autres furent véhiculées <strong>de</strong>puis le vieux continent<br />
par eux-mêmes, et elles s’ajoutaient telles <strong>de</strong>s armes biologiques aux chevaux, aux<br />
épées, aux canons, aux <strong>la</strong>nces, aux mousquets et aux arbalètes pour terrifier les indigènes<br />
et les tenir sous leur joug.<br />
239
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
Curieusement, ils employaient, outre les p<strong>la</strong>ntes médicinales dont ils apprirent<br />
l’usage en Amérique, <strong>la</strong> graisse d’un Indien mort pour guérir les blessures <strong>de</strong> guerre, car<br />
les Européens ne disposaient pas <strong>de</strong>s connaissances qu’avaient les mé<strong>de</strong>cins indigènes.<br />
Bernal Díaz <strong>de</strong>l Castillo, le fameux chroniqueur, nous re<strong>la</strong>te les ma<strong>la</strong>dies dont souffraient<br />
les conquistadors : « Ce<strong>la</strong> faisait trois ou quatre mois que nous nous trouvions là,<br />
il y eut une o<strong>de</strong>ur pestilentielle, plusieurs soldats moururent. Nous, nous souffrions et<br />
nous avions <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies infectes sur les jambes. » Nous pouvons en déduire qu’ils souffrirent<br />
d’une épidémie, et les p<strong>la</strong>ies <strong>de</strong>s jambes <strong>de</strong>vaient probablement être un ecthyma. Ils<br />
souffrirent certainement <strong>de</strong> plusieurs piqûres d’insectes comme les moustiques, les<br />
mouches, les taons, les tiques, et peut-être même les poux. Les chroniqueurs Bernal Díaz<br />
<strong>de</strong>l Castillo, Francisco Antonio <strong>de</strong> Fuentes y Guzmán et frère Francisco Ximénez mentionnent<br />
aussi les invasions <strong>de</strong> moustiques.<br />
Parmi les <strong>de</strong>rmatoses dont les conquistadors souffraient fréquemment, notons les ulcères<br />
simples ou les p<strong>la</strong>ies, conséquence <strong>de</strong>s piqûres surinfectées, ainsi que <strong>la</strong> bouba ; ce<br />
<strong>de</strong>rnier terme englobe plusieurs ma<strong>la</strong>dies comme <strong>la</strong> syphilis, le pian, les adénites simples<br />
et les petits abcès <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />
Le récit <strong>de</strong> Bernal Díaz semblerait décrire <strong>de</strong>s abcès multiples et <strong>de</strong>s adénites secondaires<br />
dues aux démangeaisons que provoquaient les piqûres et les lésions plutôt qu’une<br />
syphilis ou un pian. Le peuple disait que les gens « étaient <strong>de</strong> mauvaise humeur » si une<br />
blessure s’infectait, ou qu’ils étaient « casse-pieds » ou encore avaient <strong>de</strong>s « bubons » si<br />
une adénite apparaissait. Bernal Díaz fait référence par là à <strong>la</strong> pyo<strong>de</strong>rmite.<br />
Il existait une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitement curieuse employée par les mé<strong>de</strong>cins espagnols<br />
<strong>de</strong> l’époque; d’après les récits, « les mé<strong>de</strong>cins l’envoyèrent téter une femme <strong>de</strong> Castille ».<br />
On sait que le <strong>la</strong>it <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s anticorps, et ce<strong>la</strong> pouvait ai<strong>de</strong>r le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>.<br />
Les conquistadors souffrirent aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> gale, <strong>de</strong> <strong>la</strong> myiase, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pédiculose et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fi<strong>la</strong>riose. La Recordación Florida fait référence à ces fléaux et surtout à <strong>la</strong> myiase nasale<br />
et cutanée, ainsi qu’à l’onchocercose pouvant être causée par l’Oncocerca valvulus var.<br />
acutiens et une espèce <strong>de</strong> fi<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> Medina 3, 7 .<br />
■ La La <strong>de</strong>rmatologie Dermatologie <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> Colonie <strong>de</strong>puis jusqu’à <strong>la</strong> nos jours Colonie jusqu’à nos jours<br />
240<br />
Eduardo Silva-Lizama<br />
La <strong>de</strong>rmatologie aux XVI e , XVII e , XVIII e siècles<br />
Les <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau sont rares au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, c’est<br />
pourquoi nous citerons quelques aspects importants <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et leur<br />
rapport avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Au cours <strong>de</strong>s XVI e et XVII e siècles, <strong>la</strong> science médicale et <strong>la</strong> culture se développèrent<br />
sous l’influence <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s thérapeutiques basées sur les herbes, <strong>la</strong> musique, l’eau, les<br />
batailles, les rites spirituels symboliques et le soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> collectivité envers le ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. Au<br />
Guatema<strong>la</strong>, les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau étaient connues, et l’intérêt <strong>de</strong>s autorités médicales<br />
et gouvernementales pour <strong>la</strong> création d’hôpitaux en fut <strong>la</strong> preuve ; ces bâtiments furent<br />
construits pendant les années 1527, 1543 et 1776. Ils étaient pour <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>stinés à<br />
soigner tout type <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies ; les asiles et les hospices consacrés au traitement <strong>de</strong>s épidémies<br />
qui attaquaient régulièrement le pays, comme l’hôpital San Lázaro fondé en 1638<br />
par le marquis Lorenzana pour soigner les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, étaient en<br />
nombre plus réduit.<br />
Généralement, tous les historiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture affirment que les<br />
XV e , XVI e et XVII e siècles furent une véritable renaissance scientifique pour l’Espagne, et<br />
que <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>la</strong> chirurgie atteignirent à cette époque leur apogée pour décliner <strong>de</strong>
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
façon notable au XVIII e siècle, pauvre en véritables hommes <strong>de</strong><br />
science. Cette apogée et cet épanouissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine espagnole<br />
arrivèrent très tard au Guatema<strong>la</strong>, car notre ville manquait<br />
aussi bien au XVI e siècle qu’au XVII e siècle d’un contexte<br />
approprié, les préoccupations tournant plus autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<br />
<strong>de</strong> colonisation — violente —, <strong>de</strong> <strong>la</strong> pacification et <strong>la</strong> christianisation<br />
<strong>de</strong>s gentils. La mé<strong>de</strong>cine était vulgairement exercée<br />
<strong>de</strong> manière empirique, il n’existait pas <strong>de</strong> lieux où l’enseigner et<br />
les hôpitaux étaient <strong>de</strong> simples asiles pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s, plus<br />
consolés par <strong>la</strong> religion que par <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine curative. On ignorait<br />
<strong>la</strong> science espagnole, qui commença à se concevoir vers <strong>la</strong> fin du<br />
XVII e siècle.<br />
La culture médicale espagnole s’étendit avec beaucoup <strong>de</strong> retard<br />
au Guatema<strong>la</strong> vers le XVIII e siècle, lorsque <strong>la</strong> péninsule Ibérique entamait déjà son déclin.<br />
Les gran<strong>de</strong>s idées physiologiques, les progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie scientifique, l’essor <strong>de</strong><br />
l’anatomie, caractéristiques du XVI e siècle et <strong>de</strong>s débuts du XVII e siècle, parvinrent au<br />
Guatema<strong>la</strong> à <strong>la</strong> fin du XVIII e siècle.<br />
Au XVI e siècle, les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s du corps et <strong>de</strong> l’âme déambu<strong>la</strong>ient dans <strong>la</strong> ville, les mé<strong>de</strong>cins<br />
n’existaient pas et seuls les prêtres et <strong>la</strong> religion pouvaient guérir, en implorant les faveurs<br />
et <strong>la</strong> miséricor<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dieu. Frère Matías <strong>de</strong> Paz, un ange d’espoir et <strong>de</strong> salut, promenait ses<br />
habits b<strong>la</strong>ncs parmi ces souffrances interminables, faisait <strong>de</strong>s allers-retours en apportant<br />
<strong>de</strong>s herbes miraculeuses et <strong>de</strong>s potions cordiales; frère Matías fonda l’hôpital <strong>de</strong> San Alejo<br />
ou <strong>de</strong> los Indios (figure 18). Pour sa part, l’évêque Francisco Marroquín fut le fondateur non<br />
seulement <strong>de</strong> l’église et l’école guatémaltèques mais aussi <strong>de</strong> l’hôpital Real <strong>de</strong> Santiago (figures<br />
19, 20), représentant ainsi <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine charitable et conso<strong>la</strong>trice.<br />
Pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie du XVI e siècle, Don Juan <strong>de</strong> los Reyes, l’un <strong>de</strong> nos premiers<br />
chirurgiens qualifiés, prit <strong>la</strong> plume pour obliger le tranquille gouverneur à reprendre<br />
<strong>la</strong> juridiction <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique. On ne sait rien <strong>de</strong>s techniques chirurgicales<br />
<strong>de</strong> Dom Juan, encore moins du nombre <strong>de</strong> personnes qu’il sauva avec son bistouri ; néanmoins,<br />
on connaît très bien ses démarches énergiques pour lutter<br />
contre l’empirisme. Son action dans ce domaine fait <strong>de</strong> lui le premier<br />
défenseur du mé<strong>de</strong>cin guatémaltèque, le premier chirurgien qui,<br />
conscient <strong>de</strong> son importante mission sociale, défendit le trésor <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
santé, et ouvrit les yeux aux gouverneurs indifférents à ces problèmes<br />
vitaux. Il <strong>de</strong>manda au maire Dom Diego <strong>de</strong> Paz Quiñónez que<br />
les barbiers pratiquant <strong>la</strong> chirurgie montrent immédiatement leurs<br />
diplômes ; dans le cas contraire, ils doivent être gravement condamnés<br />
car les habitants risquent leur vie entre leurs mains ; les barbiers<br />
ne sont pas les seuls à exercer c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stinement <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine : les<br />
enfants et les domestiques aussi. »<br />
Le Memorial <strong>de</strong> Tecpán Atitlán nous fournit <strong>la</strong> meilleure <strong>de</strong>scription<br />
<strong>de</strong>s pestes qui dévastèrent <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion au cours du XVI e siècle:<br />
En réalité, ce fut terrible quand le Grand Seigneur <strong>de</strong> Dieu nous envoya cette<br />
mort. Plusieurs familles plièrent sous elle. Les gens étaient saisis par le froid,<br />
vint ensuite <strong>la</strong> fièvre, le nez saignait, elles toussaient et <strong>la</strong> gorge s’enf<strong>la</strong>mmait,<br />
aussi bien dans <strong>la</strong> peste majeure que dans <strong>la</strong> peste mineure. Tout le mon<strong>de</strong> en<br />
fut attaqué. Sept jours après Pâques <strong>la</strong> peste augmenta, le nombre <strong>de</strong> morts<br />
étant incroyable, hommes, femmes et enfants.<br />
Cette épidémie fut appelée chaac en <strong>la</strong>ngue cakchiquel, ce qui veut dire ma<strong>la</strong>die ou<br />
peste avec éruption cutanée, exanthème ou p<strong>la</strong>ies. Les dérivés <strong>de</strong> ce même mot font tous<br />
241<br />
Figure 18.<br />
Hôpital <strong>de</strong> Indios San<br />
Alejo<br />
Figures 19, 20.<br />
Hôpital <strong>de</strong> Santiago
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
242<br />
référence aux manifestations galeuses, aux brûlures, aux animosités <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies (le mot<br />
chac existe en <strong>la</strong>ngue maya, et signifie rouge); cette peste avec <strong>de</strong>s exanthèmes ou <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ies pourrait bien correspondre à <strong>la</strong> rougeole et au typhus exanthématique.<br />
Au cours du XVII e siècle <strong>de</strong> nombreux mé<strong>de</strong>cins et chirurgiens venus <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle Espagne<br />
et <strong>de</strong>s cités éloignées <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule hispanique arrivèrent en ville. L’épanouissement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> métropole coloniale d’Amérique centrale éveil<strong>la</strong>it les ambitions, et c’est pour<br />
ce<strong>la</strong> que plusieurs mé<strong>de</strong>cins entreprirent le voyage dans l’espoir d’assurer leur avenir.<br />
Leur ordre chronologique d’arrivée au Guatema<strong>la</strong> est le suivant: Juan <strong>de</strong> León (1600), Joseph<br />
Adalid Bohórquez (?), Cristóbal Tartajo (1624), Pedro Ramírez Delgado (1627), Enrique<br />
<strong>de</strong> Sosa (1630), Alonso Aragón (1633), Mauricio López <strong>de</strong> Lozada (1640), Juan <strong>de</strong><br />
Cabrera (1640), Andrés Sánchez <strong>de</strong> Miranda (1648) et Bartolomé Sánchez Parejo (1649).<br />
Une épidémie <strong>de</strong> rougeole maligne s’abattit sur <strong>la</strong> ville en avril 1769, causant <strong>de</strong>s dégâts<br />
principalement chez les Indiens. Le professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> Prime (qui se<br />
récitait au lever du jour) <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, le Dr Ávalos y Porres, et le mé<strong>de</strong>cin français Desp<strong>la</strong>nquez<br />
furent chargés d’appliquer <strong>de</strong>s soins, un régime et d’autres mesures contre<br />
cette épidémie. En juin 1773 un violent tremblement <strong>de</strong> terre détruisit <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santiago<br />
<strong>de</strong> los Caballeros <strong>de</strong> Goathema<strong>la</strong>. La ville ne fut pas entièrement détruite, mais le capitaine<br />
général Dom Martín Mayorga et quelques habitants terrifiés quittèrent <strong>la</strong> ville rapi<strong>de</strong>ment<br />
et impru<strong>de</strong>mment. La ville ruinée était chaotique, et pour couronner le tout, une<br />
peste <strong>de</strong> tabardillo ou typhus exanthématique qui dura environ un an tua 4000 personnes,<br />
causant plus <strong>de</strong> dégâts que les tremblements <strong>de</strong> terre. Elle se déclencha vers <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> 1773, s’accentua en mars 1774 et finit au mois <strong>de</strong> juin <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année. L’épidémie<br />
provint <strong>de</strong> l’exo<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Indiens et <strong>de</strong>s ouvriers vers les vil<strong>la</strong>ges en hauteur, <strong>de</strong>s zones<br />
géographiques où le typhus était endémique. Leur fuite précipitée les obligea à retourner<br />
rapi<strong>de</strong>ment vers <strong>la</strong> ville démolie, où ils arrivèrent à <strong>de</strong>mi nus et affamés, portant en eux<br />
les germes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. La mauvaise alimentation et <strong>la</strong> promiscuité contribuèrent à propager<br />
rapi<strong>de</strong>ment <strong>la</strong> peste pétéchiale. Les pauvres et les Indiens furent, comme d’habitu<strong>de</strong>,<br />
les principales victimes. On peut affirmer que ces épidémies furent les premières à<br />
être étudiées scientifiquement, et on en fit <strong>de</strong> magnifiques <strong>de</strong>scriptions cliniques; <strong>la</strong> Santé<br />
publique fut fondée au cours <strong>de</strong> ces années tragiques, nées <strong>de</strong>s circonstances d’alors.<br />
Le Guatema<strong>la</strong> subit l’une <strong>de</strong>s plus terribles épidémies <strong>de</strong> variole en 1780 ; les circonstances<br />
étaient propices au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> peste : on construisait les hôpitaux<br />
et il manquait <strong>de</strong> lieux pour l’isolement. À ces difficultés matérielles s’ajoutaient les misères<br />
spirituelles d’un peuple fatigué et accablé par toute sorte <strong>de</strong> peines. On fonda l’hôpital<br />
spécialisé dans les varioles (Hôpital San José). L’épidémie <strong>de</strong> 1780 permit au Dr José<br />
Felipe Flores <strong>de</strong> montrer ses qualités d’innovateur. Le conseiller fiscal <strong>de</strong> <strong>la</strong> municipalité<br />
octroya au Dr Flores une liberté absolue dans l’emploi <strong>de</strong> l’inocu<strong>la</strong>tion, après que le ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
en eût été informé et ait donné son accord. La technique était <strong>la</strong> suivante : le docteur<br />
déposait sur chaque bras <strong>de</strong>ux emplâtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille d’une pièce d’un real et il<br />
attendait que se forment <strong>de</strong>s bulles ; il p<strong>la</strong>çait ensuite sur <strong>la</strong> peau ulcérée un coton imbibé<br />
dans <strong>la</strong> sérosité d’une variole mûre, maintenant ce traitement pendant vingt-quatre<br />
heures. D’après les historiens, l’inocu<strong>la</strong>tion eut <strong>de</strong>s résultats prodigieux, comme le<br />
prouva <strong>la</strong> statistique comparée. Parmi les individus inoculés, presque aucun ne présenta<br />
<strong>de</strong> formes malignes, et le contrôle rigoureux ne recensa qu’un seul mort, une fille <strong>de</strong> 13<br />
ans. Dans les quartiers où l’inocu<strong>la</strong>tion ne fut pas pratiquée, <strong>la</strong> mortalité atteignit <strong>de</strong>s<br />
chiffres très élevés. Les preuves furent concluantes, et le bénéfice <strong>de</strong> l’inocu<strong>la</strong>tion fut démontré.<br />
Cette métho<strong>de</strong> fut employée par les Turcs, les Perses et les Chinois, qui observèrent<br />
que <strong>la</strong> variole inoculée était toujours moins grave que celle qui se développait par<br />
contagion. Cette observation induisit <strong>la</strong> découverte du vaccin, précédant d’un siècle les<br />
idées <strong>de</strong> Pasteur sur les virus atténués.<br />
Les principaux hôpitaux du pays commencèrent à être construits au XVIII e siècle; à partir<br />
<strong>de</strong> ce moment-là le concept <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine changea <strong>de</strong> façon progressive 11, 12, 13 .
LA DERMATOLOGIE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL SAN JUAN DE DIOS<br />
L’hôpital général San Juan <strong>de</strong> Dios fut inauguré en 1778. Une clinique spécialisée en<br />
ma<strong>la</strong>dies urogénitales et en syphilis fut aménagée pendant cette pério<strong>de</strong> au département<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s hommes. Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Dom Rafael Angulo y Urrue<strong>la</strong>, on accueillit<br />
entre 1778 et 1875 <strong>de</strong>s patients lépreux et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />
En 1810 le Dr Narciso Esparragoza y Gal<strong>la</strong>rdo écrivit son livre sur <strong>de</strong>s sujets tels que<br />
le prurit, les exanthèmes et les ulcères <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Le Dr Mariano Padil<strong>la</strong> publia pour sa<br />
part, en 1861, un essai sur l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die vénérienne. En 1863, les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong><br />
l’hôpital général entreprirent <strong>la</strong> confection d’un rapport ou mémoire <strong>de</strong>s activités réalisées<br />
dans chaque service ; le Dr Francisco Abel<strong>la</strong> mentionna dans ce rapport plusieurs<br />
cas <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>s ongles et <strong>de</strong>s scrofuleuses diagnostiqués. Le<br />
Dr Eligio Baca présenta son rapport en 1864 et fit référence à l’ecthyma, l’impétigo, l’eczéma,<br />
<strong>la</strong> gale et l’éléphantiasis <strong>de</strong>s Grecs, entre autres constats. L’imp<strong>la</strong>ntation d’une<br />
greffe cutanée postérieure à l’extirpation d’un épithéliome basocellu<strong>la</strong>ire nasal, l’opération<br />
d’un ongle incarné et d’un rhinosclérome sont mentionnées dans <strong>la</strong> liste re<strong>la</strong>tivement<br />
abondante <strong>de</strong>s interventions chirurgicales pratiquées par le Dr Juan José Ortega et<br />
citées dans le mémoire hospitalier <strong>de</strong> 1900 24, 25, 26 .<br />
Les premiers spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie furent admis à l’hôpital général, marquant<br />
une nouvelle étape dans <strong>la</strong> spécialité. Le Dr Fernando Cor<strong>de</strong>ro fut nommé chef <strong>de</strong>s services<br />
internes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1945; le Dr Luis Gálvez Molina occupa le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consultation externe en 1946; le Dr Arturo García Val<strong>de</strong>z fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
masculine en 1956. Les Drs Jorge Close <strong>de</strong> León (1958), Eduardo Silva Martínez (1963),<br />
Leonel Linares (1972), Carlos Cor<strong>de</strong>ro (1978), Salvador Porres (1986) et Edgar Pérez Chavarría<br />
avec une sous-spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique en 1988 furent admis plus tardivement<br />
dans le service. Le Dr Leones Linares est le chef du service <strong>de</strong>puis 1980.<br />
L’hôpital général San Juan <strong>de</strong> Dios, l’un <strong>de</strong>s plus anciens du pays, est l’hôpital école<br />
où sont formés les étudiants <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, qui effectuent <strong>de</strong>s roulements<br />
dans les différents services. La consultation au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est importante et<br />
inclut <strong>de</strong>s patients à faibles ressources provenant <strong>de</strong>s divers endroits du pays.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie débuta comme spécialité dans cet hôpital et fut reconnue comme<br />
telle dans les années 1940 12,13 .<br />
LA DERMATOLOGIE AU CENTRE MÉDICAL MILITAIRE<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Le 9 octobre 1880, le général Justo Rufino Barrios décida <strong>de</strong> créer l’hôpital militaire<br />
« considérant qu’il est un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du gouvernement d’assister efficacement le<br />
personnel <strong>de</strong> l’armée lorsque celui-ci tombe ma<strong>la</strong><strong>de</strong> suite à son service; suivant les bons<br />
préceptes administratifs, <strong>la</strong> création d’un établissement où les militaires peuvent être soignés<br />
professionnellement sous une inspection médicale appropriée est nécessaire ». La<br />
nouvelle fut publiée le jeudi 14 octobre dans le numéro 310 du journal officiel <strong>de</strong> l’époque,<br />
El Guatemalteco. L’inauguration officielle eut lieu le 16 mars 1881 14 .<br />
Le premier règlement <strong>de</strong> l’hôpital militaire, é<strong>la</strong>boré par le Dr Joaquín Ye<strong>la</strong>, inspecteur médical,<br />
et le Dr Francisco Abel<strong>la</strong>, chirurgien <strong>de</strong> l’établissement, fut approuvé le 31 janvier 1882,<br />
dix mois et <strong>de</strong>mi après son ouverture. Ce règlement stipu<strong>la</strong>it: « Il y aura un mé<strong>de</strong>cin et un<br />
chirurgien qui <strong>de</strong>vront appartenir à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, nommés par le<br />
gouvernement sur proposition du directeur. Le mé<strong>de</strong>cin nommé sera chargé <strong>de</strong> soigner les<br />
patients, en col<strong>la</strong>boration avec les personnes qui exercent <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>la</strong> chirurgie après<br />
avoir achevé au moins <strong>la</strong> quatrième année <strong>de</strong> leurs étu<strong>de</strong>s. » À l’époque il n’existait pas <strong>de</strong><br />
spécialistes en mé<strong>de</strong>cine; le mé<strong>de</strong>cin chirurgien soignait tous les patients en général, même<br />
ceux qui souffraient <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Les patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
payaient 50 centimes le séjour et les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong> leur sa<strong>la</strong>ire en cas <strong>de</strong> récidive.<br />
243
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
244<br />
Deux pavillons furent construits en 1913 pour les patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées<br />
et vénériennes ; le mé<strong>de</strong>cin commandant Antonio Macal dirigea en 1914 les services<br />
<strong>de</strong> chirurgie, <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées et vénériennes. En 1915, on déc<strong>la</strong>ra qu’il était<br />
urgent d’améliorer les conditions hygiéniques et sanitaires <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong>s patients atteints<br />
<strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées car ils fuyaient fréquemment l’hôpital.<br />
Le 25 décembre 1917, le bâtiment <strong>de</strong> l’hôpital militaire subit <strong>de</strong> grands dommages suite<br />
au tremblement <strong>de</strong> terre qui dévasta <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>. La tour <strong>de</strong> l’immeuble s’effondra<br />
le jour suivant. La situation précaire <strong>de</strong> l’hôpital se prolongea toute l’année 1919, il était<br />
pratiquement impossible d’assister les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s appartenant au corps militaire.<br />
Vers <strong>la</strong> mi-novembre 1920, le gouvernement ordonna le transfert <strong>de</strong> l’hôpital militaire<br />
dans le bâtiment occupé par l’asile Maternidad Joaquina. Les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s y furent transférés<br />
dès le 6 décembre.<br />
En 1924, le Dr Carlos Padil<strong>la</strong> y Padil<strong>la</strong>, directeur technique, prit en charge les services<br />
<strong>de</strong> chirurgie et <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées et <strong>la</strong> salle <strong>de</strong>s urgences. Un décret du prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> République, le général José María Orel<strong>la</strong>na, exigea que soit établie à partir du<br />
5 décembre une salle <strong>de</strong> consultation gratuite pour soigner les habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> localité.<br />
Les Drs Ramiro Gálvez Asteguieta et Enrique Echeverría prirent en charge le 21 juillet<br />
1929 le service <strong>de</strong>s chefs et officiels, le service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et celui <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées<br />
et vénériennes; <strong>la</strong> bibliothèque <strong>de</strong> l’établissement fut inaugurée le 14 février 1935.<br />
Des cycles mensuels <strong>de</strong> conférences furent organisés <strong>la</strong> même année: le Dr Guillermo<br />
Sánchez présenta en juillet <strong>la</strong> conférence Pian et, en décembre, le Pr. E. Jacobsthal, présenta<br />
Métho<strong>de</strong>s sérologiques pour <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis.<br />
Le message prési<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong>stiné à l’Assemblée nationale légis<strong>la</strong>tive, donné par le général<br />
Jorge Ubico le 1 er mars 1939, déc<strong>la</strong>ra : « L’hôpital militaire accomplit son objectif<br />
<strong>de</strong> façon satisfaisante, nous obligeant à reconnaître l’activité et l’efficacité du personnel<br />
qui y travaille. » Le bâtiment fut amélioré, grâce à l’achat <strong>de</strong> matériel, <strong>de</strong> meubles et<br />
d’instruments ; l’hôpital était considéré comme l’un <strong>de</strong>s meilleurs du pays.<br />
La blennorragie fut en 1943 l’une <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies soignées en priorité. Le Dr Fernando<br />
Cor<strong>de</strong>ro prit en charge le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie <strong>de</strong> l’hôpital en 1945,<br />
suivi par le Dr Luis Gálvez Molina en 1946. Le service comptait un praticien, <strong>de</strong>ux infirmiers<br />
et une ou <strong>de</strong>ux personnes <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>.<br />
En 1968, le Dr Eduardo Silva Martínez prit <strong>la</strong> relève au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et<br />
reçut le Dr Neftalí Vil<strong>la</strong>nueva (disciple du Dr Silva Martínez) comme mé<strong>de</strong>cin assistant<br />
en 1970. Le service fut réorganisé, comptant désormais un chef, un sous-chef, <strong>de</strong>s services<br />
d’hospitalisation et un cabinet externe.<br />
Le 16 juin 1975, le recteur <strong>de</strong> l’université publique, le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense nationale,<br />
le doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales et le directeur <strong>de</strong> l’hôpital militaire signèrent<br />
une convention pour que ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>vienne un hôpital école, académiquement<br />
reconnu par le conseil <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté. Le programme était <strong>de</strong>stiné aux praticiens<br />
externes et internes. Les activités furent organisées <strong>de</strong> février à juillet et divisées<br />
en six modules scientifiques et académiques mensuels. Chaque module se développa autour<br />
d’un sujet principal et comportait <strong>de</strong>s sous-parties tournées vers les spécialités médicales<br />
liées. Le module <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut développé en juillet, avec <strong>de</strong>s objectifs<br />
principaux tels que <strong>la</strong> meilleure formation <strong>de</strong> l’étudiant <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>la</strong> couverture du<br />
curriculum <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Carlos<br />
<strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>, tout comme l’éveil <strong>de</strong> l’intérêt <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie pour les<br />
activités d’enseignement 11 .<br />
En 1977, les <strong>de</strong>rmatologues Antonio Wong Galdamez et Miguel Eduardo Robles Soto,<br />
tous <strong>de</strong>ux ayant suivi <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation au Mexique, furent admis au service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. À l’époque, le service regroupait <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins qualifiés et reconnus par<br />
les universités nationales et étrangères, marquant une nouvelle étape <strong>de</strong> progrès dans <strong>la</strong><br />
spécialité.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Des journées départementales dont le but était <strong>de</strong> visiter les zones endémiques <strong>de</strong><br />
leishmaniose cutanée furent organisées.<br />
Arturo García Val<strong>de</strong>z, éminent <strong>de</strong>rmatologue qui travail<strong>la</strong> entre 1970 et 1989, fut l’un<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins à col<strong>la</strong>borer fortement avec le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. À l’époque, le service<br />
regroupait un chef, un sous-chef, trois <strong>de</strong>rmatologues pour le cabinet externe et un<br />
<strong>de</strong>rmatologue pour les services internes.<br />
La clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique fut créée en 1978. Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense,<br />
souhaitant compter sur un personnel médical spécialisé, octroya <strong>la</strong> même année <strong>de</strong>s<br />
bourses <strong>de</strong> formation à l’étranger aux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’hôpital militaire. En conséquence,<br />
le Dr Eduardo Silva-Lizama se rendit en mars 1981 à l’institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara<br />
; il fut admis dans le service en 1983 13 .<br />
En 1986 le Dr Thomas Navin — <strong>de</strong> <strong>la</strong> division <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies parasitaires au Center for<br />
Disease Control, à At<strong>la</strong>nta, aux États-Unis — et le Dr Byron Arana — du centre <strong>de</strong> recherche<br />
sur les ma<strong>la</strong>dies tropicales <strong>de</strong> l’université Del Valle <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> — col<strong>la</strong>borèrent<br />
avec le service pour étudier <strong>la</strong> leishmaniose cutanée. Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>vint alors l’un <strong>de</strong>s centres les plus importants dans le c<strong>la</strong>ssement et l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s parasitoses<br />
cutanées au Guatema<strong>la</strong>, notamment <strong>la</strong> leishmaniose cutanée 12 .<br />
Le Dr Neftalí Vil<strong>la</strong>nueva Val<strong>de</strong>z occupa le poste <strong>de</strong> chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
entre 1989 et 1990 ; en 1989, les <strong>de</strong>rmatologues Edgar Cifre Recinos et Carlos Vil<strong>la</strong>nueva<br />
Ochoa furent admis dans le service, ce <strong>de</strong>rnier étant chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
Le Dr Antonio Wong Galdamez dirige le service <strong>de</strong>puis 1990, tandis que les Drs Ricardo<br />
Garzona Baril<strong>la</strong>s et Manolo Gutiérrez y furent admis en 1991.<br />
Les locaux <strong>de</strong> l’hôpital militaire étaient fonctionnels <strong>de</strong>puis 1920, l’essentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
construction étant en bajareque. Néanmoins, les investissements constants permirent <strong>de</strong><br />
le maintenir en bon état. Le souci <strong>de</strong> construire un nouvel hôpital remonta à 1945, mais<br />
<strong>de</strong>s circonstances diverses, surtout économiques, empêchèrent <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong>s projets<br />
jusqu’en 1991. C’est alors que l’hôpital fut transféré dans un bâtiment neuf et mo<strong>de</strong>rne,<br />
pour <strong>de</strong>venir le Centre médical militaire 11 .<br />
L’état-major <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense nationale délivra <strong>de</strong>s bourses aux Drs Manolo Val<strong>la</strong>dares<br />
et Horacio Antulio Pare<strong>de</strong>s pour qu’ils partent se former à l’étranger. Le premier se rendit<br />
à l’hôpital militaire <strong>de</strong> Mexico D.F. et y retourna en 1994. Pare<strong>de</strong>s se rendit quant lui<br />
à l’institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara (au Mexique) et fut admis dans le service en<br />
1996, dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique. Le Dr Pare<strong>de</strong>s fut nommé plus<br />
tard directeur général du Centre médical militaire (en 2004).<br />
Le 30 juin 2004, le Dr Eduardo Silva-Lizama <strong>de</strong>vint chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
; les Drs Ricardo Garzona Baril<strong>la</strong>s, Edgar Manolo Val<strong>la</strong>dares et Isabel <strong>de</strong> Orel<strong>la</strong>na intégrèrent<br />
l’équipe <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie médico-chirurgicale.<br />
Le Centre médical militaire proposa une assistance médicale principalement <strong>de</strong>stinée<br />
au personnel <strong>de</strong> l’armée ; cependant il vient récemment d’étendre ses services à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
civile.<br />
LA DERMATOLOGIE À L’INSTITUT GUATÉMALTÈQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (IGSS)<br />
Les idéaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolution du mois d’octobre 1944 inspirèrent <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s réalisations<br />
à caractère social : le Co<strong>de</strong> du travail et <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’Institut guatémaltèque <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sécurité sociale (IGSS).<br />
La Constitution <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, promulguée en 1945, favorisa l’émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité<br />
sociale au sein <strong>de</strong>s structures guatémaltèques, résultat immédiat du mouvement<br />
popu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> 1944 ; elle <strong>de</strong>vint une réalité à travers le décret nº 295 du Congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
le 30 octobre 1946 14-22 .<br />
La polyclinique fut inaugurée le 26 janvier 1963. Trois ans après, les Drs Aparicio<br />
González et Guillermo Fortín Gu<strong>la</strong>rte prirent en charge les patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
245
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
246<br />
cutanées et vénériennes, suivis par Eduardo Silva Martínez et Francisco Ro<strong>la</strong>ndo Vásquez<br />
B<strong>la</strong>nco (1972) qui fut admis ultérieurement à l’hôpital général <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die commune<br />
22 . Jorge Close <strong>de</strong> León rejoignit le service en 1975, tout comme Romeo Augusto<br />
Moraga Miranda en 1976. La même année, Rubén Mayorga Peralta prit en charge le <strong>la</strong>boratoire<br />
<strong>de</strong> mycologie, suivi par Heidi Logemann. Le service compta ensuite sur <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins suivants : Concha Marina Mén<strong>de</strong>z (née González) et Miguel<br />
Eduardo Robles Soto (1977) ; Ramiro Paz y Paz (1978) ; Haroldo Soto Sandoval (1980) ;<br />
Álvaro Castel<strong>la</strong>nos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Roca (1983) ; Eduardo Silva-Lizama (1986) ; Ricardo Augusto<br />
Garzona Baril<strong>la</strong>s, Marco Vinicio Solórzano <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cerda et José Higueros (1992) ; Lorena<br />
Bay et Guillermo Letona (1997).<br />
Cette unité regroupe le plus grand nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues : cinq le matin et cinq le<br />
soir ; elle reçoit en moyenne 150 à 200 patients par jour.<br />
L’hôpital général <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die commune fut inauguré le 7 août 1967. Destiné à dispenser<br />
<strong>de</strong>s soins intégraux, il dispose <strong>de</strong> 333 lits et 110 berceaux, répartis en trois départements<br />
cliniques <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, <strong>de</strong> chirurgie et <strong>de</strong> pédiatrie. Chacun <strong>de</strong>s<br />
départements comporte un chef, <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> service, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins spécialistes, un chef<br />
<strong>de</strong>s internes et <strong>de</strong>s internes. En 1962, cinq ans avant son inauguration officielle, le Dr<br />
Luis Gálvez Molina dirigea le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, suivi en 1972 par le Dr Francisco<br />
Ro<strong>la</strong>ndo Vásquez B<strong>la</strong>nco. Durant cette pério<strong>de</strong>, le Dr Víctor Fernán<strong>de</strong>z, chef du <strong>la</strong>boratoire<br />
<strong>de</strong>s pathologies, s’intéressa à l’étu<strong>de</strong> et à l’analyse histopathologiques <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Les <strong>de</strong>rmatologues Patricia Chang et Eduardo Silva-Lizama (transféré plus<br />
tard à <strong>la</strong> polyclinique) y furent admis en 1983. Le Dr María <strong>de</strong>l Socorro León (née<br />
Obregón) y fut nommée en 1990 ; le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique est p<strong>la</strong>cé sous<br />
<strong>la</strong> responsabilité du Dr Olga Marina Martínez (née Rosales) <strong>de</strong>puis 1978.<br />
Dans cet hôpital, les départements <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne et <strong>de</strong> pédiatrie comprennent<br />
celui <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; on y soigne les patients <strong>de</strong>s cabinets externes et ceux qui sont hospitalisés<br />
14, 23 .<br />
La direction <strong>de</strong> l’IGSS créa les unités périphériques dans le but d’é<strong>la</strong>rgir son programme<br />
d’assistance aux secteurs <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tion plus nombreuse situés dans les environs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. L’unité périphérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone 6 commença avec huit cliniques, <strong>de</strong>s<br />
services d’urgence et un petit bloc opératoire; les locaux pour soigner les nombreux patients<br />
étaient insuffisants. L’hôpital général Dr Juan José Arévalo fut inauguré à sa p<strong>la</strong>ce<br />
en 1984 : le Dr Noemí Quiñónez y était responsable du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en<br />
1996 ; le Dr Gerardo Bran Quintana occupe le poste <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue à partir <strong>de</strong> 1989.<br />
Les locaux mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> l’unité périphérique <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone 5 furent inaugurés en 1994 ; le<br />
Dr Sergio Iván Cobar prit en charge le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 14 .<br />
Le Dr Mi<strong>la</strong>gros Santos supervise <strong>de</strong>puis 1995 les soins administrés dans le Centre<br />
d’assistance médicale intégrale pour pensionnés (CAMIP) aux patients souffrant <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées ; le centre soigne également les patients <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> réhabilitation.<br />
L’IGSS est l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s institutions du pays ; ses programmes d’assistance<br />
furent diffusés dans les provinces <strong>de</strong> <strong>la</strong> République où se trouvaient les patients qui<br />
avaient besoin d’un soin <strong>de</strong>rmatologique spécialisé, selon le critère du mé<strong>de</strong>cin 19-25 .<br />
LA DERMATOLOGIE À L’HÔPITAL ROOSEVELT<br />
La 3 e Réunion <strong>de</strong>s ministres <strong>de</strong>s Affaires étrangères <strong>de</strong>s Républiques <strong>américaine</strong>s se<br />
tint à Rio <strong>de</strong> Janeiro en janvier 1942. La résolution nº 30 approuvée au cours <strong>de</strong> cette réunion<br />
créa l’Agence du gouvernement <strong>de</strong>s États-Unis d’Amérique, appelée Institut <strong>de</strong>s<br />
affaires inter<strong>américaine</strong>s : les principaux objectifs étaient d’encourager <strong>la</strong> santé collective<br />
et <strong>de</strong> renforcer les rapports d’amitié entre les pays américains.<br />
Le 14 août 1942, l’Institut <strong>de</strong>s affaires inter<strong>américaine</strong>s, représenté par le Service<br />
coopératif interaméricain <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique (SCISP), signa un contrat avec le
gouvernement du Guatema<strong>la</strong>, s’engageant à construire un hôpital, parmi d’autres travaux<br />
liés au secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
L’hôpital Roosevelt fut officiellement inauguré le 15 décembre 1955 avec l’ouverture du<br />
département <strong>de</strong> maternité. Le département <strong>de</strong> pédiatrie (1957) et le département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
et chirurgie (1959) furent inaugurés ultérieurement. Les consultations <strong>de</strong>rmatologiques<br />
étaient à <strong>la</strong> charge du Dr Eduardo Tschen; leur nombre augmenta progressivement<br />
jusqu’à <strong>la</strong> création en 1960 <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong>s allergies. Les Drs Francisco<br />
Saravia (1969), Ro<strong>la</strong>ndo Vásquez (1970) — qui en fut le chef en 1985 —, Edwin García<br />
(1981) et María <strong>de</strong>l Socorro Obregón (1990) y furent admis ultérieurement. Le Dr Neftalí<br />
Vil<strong>la</strong>nueva dirigea l’unité entre 1988 et 1995, suivi par le Dr Pablo Urquizu en 1996. L’unité<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Roosevelt s’appelle Dr Eduardo Tschen en hommage à son travail<br />
tenace et méritoire. Carlos Vil<strong>la</strong>nueva (section <strong>de</strong> chirurgie) et Manuel Antonio Samayoa<br />
(histopathologie) col<strong>la</strong>borent à cette unité <strong>de</strong>puis 1990.<br />
L’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong>s allergies Dr Eduardo Tschen dispose actuellement <strong>de</strong><br />
services <strong>de</strong> consultation externe, d’hospitalisation, <strong>de</strong> chirurgie et d’histopathologie ; on<br />
y soigne un grand nombre <strong>de</strong> patients provenant <strong>de</strong> l’ensemble du territoire, dont <strong>la</strong> plupart<br />
sont sans ressources 17, 18 .<br />
LA DERMATOLOGIE DANS LES HÔPITAUX DÉPARTEMENTAUX<br />
La <strong>de</strong>rmatologie est une spécialité re<strong>la</strong>tivement jeune qui se répand toutefois à travers<br />
les différents départements <strong>de</strong> <strong>la</strong> République 30 . Nous allons citer quelques professionnels<br />
:<br />
— Le Dr Arsenio Champet travaille à l’hôpital général <strong>de</strong> Quetzaltenango <strong>de</strong>puis<br />
1977.<br />
— Le Dr Luis Mont est <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital militaire <strong>de</strong> Huehuetenango <strong>de</strong>puis<br />
1978.<br />
— Le Dr Álvaro Castel<strong>la</strong>nos <strong>de</strong> La Roca est <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital national <strong>de</strong> Escuint<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>puis 1983.<br />
— Le Dr Marlene Rosado participe au traitement <strong>de</strong>s patients atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées<br />
à l’hôpital Santa Elena, Petén, <strong>de</strong>puis 1989.<br />
— Le Dr Manuel Antonio Samayoa occupe le poste <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital général<br />
<strong>de</strong> Antigua Guatema<strong>la</strong>, département <strong>de</strong> Sacatepequez, <strong>de</strong>puis 1990.<br />
— Le Dr Guillermo Letona s’occupe <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du département <strong>de</strong><br />
Jutiapa <strong>de</strong>puis 1990.<br />
Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
■ Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques<br />
Il existe <strong>de</strong>puis 1962 dans le pays <strong>de</strong>ux associations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues ; toutes <strong>de</strong>ux<br />
possè<strong>de</strong>nt le statut juridique et sont reconnues par le collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et chirurgiens<br />
du Guatema<strong>la</strong> :<br />
• L’Association guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fondée en 1957 par les Drs Jorge<br />
Close <strong>de</strong> León, Arturo García Val<strong>de</strong>z, Aparicio González, Eduardo Tschen et Fernando<br />
Cor<strong>de</strong>ro (tableau 2).<br />
• L’Académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, syphiligraphie et léprologie, fondée en<br />
1962 par les Drs Fernando Cor<strong>de</strong>ro, Mariano Castillo, Juan M. Funes et Guillermo Reyes<br />
Durán (tableau 3).<br />
L’Association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, dont le sonseil <strong>de</strong> direction était composé<br />
d’Edgar Pérez Chavarría (prési<strong>de</strong>nt), d’Aída Pacheco (secrétaire), <strong>de</strong> Lorena García (née<br />
Bay) (trésorière), d’Olga Marina Martínez (née Rosales) et d’Armando León (membres),<br />
fut fondée en 2000.<br />
247
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
1957 Dr Jorge Close <strong>de</strong> León<br />
1959 Dr Arturo García Val<strong>de</strong>z<br />
1961 Dr Jorge Close <strong>de</strong> León<br />
1964 Dr Arturo García Val<strong>de</strong>z<br />
1968 Dr Aparicio González<br />
1970 Dr Eduardo Tschen<br />
1972 Dr Arturo García Val<strong>de</strong>z<br />
1976 Dr Ro<strong>la</strong>ndo Vásquez B<strong>la</strong>nco<br />
1979 Dr Neftalí Gonzalo Vil<strong>la</strong>nueva<br />
1981 Dr Jorge Close <strong>de</strong> León<br />
1983 Dr. Eduardo Tschen<br />
248<br />
Tableau 3. Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> l’Académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, syphiligraphie et léprologie<br />
1962 Dr Mariano Castillo<br />
1966 Dr Marco A. Cabrera<br />
1969 Dr Carlos G. Quezada<br />
1972 Dr Guillermo Fortin Gu<strong>la</strong>rte<br />
1974 Dr Lionel Linares<br />
1979 Dr Carmen C. <strong>de</strong> Mansil<strong>la</strong><br />
1984 Dr Carlos Cor<strong>de</strong>ro<br />
Tableau 2. Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> l’Association guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
1985 Dr Miguel Eduardo Robles Soto<br />
1987 Dr Antonio Wong Galdamez<br />
1989 Dr Eduardo Silva-Lizama<br />
1991 Dr Patricia Chang <strong>de</strong> Chang<br />
1993 Dr Olga Marina Rosales <strong>de</strong> Martínez<br />
1995 Dr Carlos Vil<strong>la</strong>nueva Ochoa<br />
1997 Dr Pablo Humberto Urquizu Dávi<strong>la</strong><br />
1999 Dr Gerardo Bran Quintana<br />
2001 Dr Manuel Antonio Samayoa<br />
2003 Dr María <strong>de</strong>l Socorro Obregón<br />
1988 Dr Lionel Linares<br />
1992 Dr Edgar Pérez Chavarría<br />
1994 Dr Juan José Mansil<strong>la</strong> Arévalo<br />
1997 Dr Guillermo Letona<br />
1999 Dr Lorena Bay<br />
2002 Dr Mi<strong>la</strong>gros Santos<br />
Le collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et chirurgiens du Guatema<strong>la</strong> inclut 35 spécialités comportant<br />
1861 professionnels, dont 51 sont <strong>de</strong>rmatologues (2.74 % <strong>de</strong>s spécialistes).<br />
Le 6 octobre 1994 fut fondé le Comité <strong>de</strong> coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie guatémaltèque,<br />
composé <strong>de</strong> trois représentants <strong>de</strong> chaque association <strong>de</strong>rmatologique du pays juridiquement<br />
reconnue (Académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et Association guatémaltèque <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie); son but était <strong>de</strong> fusionner les idées et d’établir les positions face aux situations<br />
liées aux intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie guatémaltèque. Les objectifs dudit comité sont: a)<br />
travailler pour le progrès et <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité; b) coordonner les activités<br />
scientifiques; c) veiller à <strong>la</strong> défense du syndicat; d) encourager l’esprit d’unité et <strong>de</strong> solidarité<br />
entre les membres; e) respecter et défendre les statuts et <strong>la</strong> personnalité (<strong>de</strong>s sociétés);<br />
f) veiller au respect <strong>de</strong>s normes qui régissent l’éthique professionnelle.<br />
Eduardo Silva-Lizama (prési<strong>de</strong>nt), Leonel Linares (secrétaire et trésorier), Juan José<br />
Mansil<strong>la</strong> (prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie), Carlos Vil<strong>la</strong>nueva<br />
Ochoa (prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie), Anabel<strong>la</strong> <strong>de</strong> Chang et<br />
Manuel Antonio Samayoa (membres) intégrèrent le premier conseil <strong>de</strong> direction (1994-<br />
1997). Juan José Mansil<strong>la</strong> (prési<strong>de</strong>nt), Carlos Vil<strong>la</strong>nueva Ochoa (secrétaire et trésorier),<br />
Edgar Pérez, Salvador Porres, Anabel<strong>la</strong> <strong>de</strong> Chang et Manuel Antonio Samayoa<br />
(membres) en firent partie au cours <strong>de</strong>s années 1997-1999.<br />
Le comité réalise plusieurs activités : citons par exemple l’organisation d’un congrès<br />
tous les <strong>de</strong>ux ans, dont le premier eut lieu en juillet 1997 dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> sous<br />
le nom <strong>de</strong> Dermatologie 97 30 .<br />
Le 3 octobre 2004, à l’initiative du Dr Pablo Urquizu, eut lieu dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong><br />
une journée « Détecter le cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau » ; au total, 2 800 consultations eurent<br />
lieu dans plusieurs endroits <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale dans le cadre <strong>de</strong> cette journée, qui compta sur<br />
<strong>la</strong> participation d’organismes du gouvernement — comme <strong>la</strong> municipalité <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong><br />
— et privés, ainsi que sur <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Drs Jorge Palmieri, Carlos David, Romeo<br />
Moraga, Álvaro Castel<strong>la</strong>nos, Eduardo Silva-Lizama, María <strong>de</strong>l Socorro Obregón, Telma<br />
Meda, Concha Marina <strong>de</strong> Mén<strong>de</strong>z, Vilma García, Beatriz <strong>de</strong> Silva, Patricia Chang, Miguel<br />
Eduardo Robles Soto, Carol Durán, Azucena Hernán<strong>de</strong>z, Gerardo Bran, Antonio Wong,<br />
Marco Vinicio Solórzano, Neftalí Vil<strong>la</strong>nueva, Arturo García Val<strong>de</strong>z, Sergio Cobar, Edith<br />
Tobías et Carlos Vil<strong>la</strong>nueva.
Enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
■ Enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
La formation médicale est divisée en <strong>de</strong>ux parties : le cours théorique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>la</strong> pratique.<br />
D’une part, le cours est <strong>de</strong>stiné aux étudiants <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> San Carlos <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> et <strong>de</strong>s universités privées Francisco Marroquín et Mariano<br />
Gálvez. Les hôpitaux enseignants sont l’hôpital général San Juan <strong>de</strong> Dios, l’hôpital Roosevelt,<br />
le Centre médical militaire, l’Institut guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale et l’Institut<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (INDERMA).<br />
D’autre part, <strong>la</strong> pratique a lieu à l’Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (IN-<br />
DERMA) ; le cours <strong>de</strong> spécialisation a une durée <strong>de</strong> trois ans et le <strong>de</strong>rmatologue est académiquement<br />
formé aux ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles, à l’histopathologie, à<br />
l’immunologie, à <strong>la</strong> mycologie, à <strong>la</strong> chirurgie, à <strong>la</strong> phlébologie, à <strong>la</strong> pédiatrie, aux tests<br />
diagnostiques et thérapeutiques.<br />
Les Drs Patricia Chang et María <strong>de</strong>l Socorro Obregón enseignent tous les lundis à l’hôpital<br />
général <strong>de</strong> l’Institut guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale ; on y discute, en col<strong>la</strong>boration<br />
avec le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> pathologie, <strong>de</strong> sujets <strong>de</strong>rmatologiques, en mettant l’accent<br />
sur l’histopathologie. Ro<strong>la</strong>ndo Vásquez (<strong>de</strong>rmatologue) et Víctor Fernán<strong>de</strong>z (pathologiste)<br />
entreprirent cette activité en 1981.<br />
Quant au Centre médical militaire, l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
interne effectuent une fois par mois leur activité académique appelée « clinique<br />
<strong>de</strong>rmatologique ». Cette activité établit un programme annuel comportant <strong>de</strong>s sujets sur<br />
l’anatomie et <strong>la</strong> physiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, <strong>la</strong> vénéréologie, les manifestations cutanées <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies systémiques, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie infectieuse (viroses, bactéries, micro-bactéries,<br />
champignons), l’oncologie, les <strong>de</strong>rmatoses réactionnelles et <strong>de</strong>rmatoses bulleuses. Ces sujets<br />
sont présentés par le rési<strong>de</strong>nt en mé<strong>de</strong>cine interne et contrôlés par un <strong>de</strong>rmatologue,<br />
avec <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s étudiants en mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université Mariano Gálvez, <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts<br />
en mé<strong>de</strong>cine interne, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins internistes et <strong>de</strong>s spécialistes<br />
en mé<strong>de</strong>cine interne. Une évaluation a lieu à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> chaque<br />
module. Ces réunions sont une projection <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et complètent <strong>la</strong> formation du mé<strong>de</strong>cin interniste et <strong>de</strong> l’étudiant en<br />
mé<strong>de</strong>cine. Depuis 2000, le bulletin Clínica Dermatológica, comportant<br />
divers sujets et cas cliniques, est publié tous les six mois.<br />
A) ENSEIGNEMENT AU SERVICE DERMATOLOGIE DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL<br />
DE MALADIES IGSS<br />
Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Université <strong>de</strong> San Carlos <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong><br />
(figures 21-22)<br />
Spécialisation en mé<strong>de</strong>cine interne :<br />
1. Corré<strong>la</strong>tion clinico-pathologique tous les mardis.<br />
2. Cours <strong>de</strong> spécialisation en mé<strong>de</strong>cine interne <strong>de</strong>ux fois par mois<br />
(<strong>de</strong>uxième et quatrième mardi).<br />
3. Supervision <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie donnés par les rési<strong>de</strong>nts en mé<strong>de</strong>cine<br />
interne.<br />
4. Révision <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts en mé<strong>de</strong>cine interne à publier.<br />
5. Étudiants sélectionnés en cinquième année <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (<strong>de</strong>ux mois).<br />
6. Présentation lors <strong>de</strong> chaque séance <strong>de</strong>s cas intéressants du mois.<br />
7. É<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> dix questions écrites mensuelles pour l’examen <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts.<br />
8. Présentation <strong>de</strong> cinq à dix photos cliniques mensuelles pour l’examen <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts.<br />
249<br />
Figures 21, 22.<br />
Université <strong>de</strong> San Carlos
Figures 23, 24.<br />
Hôpital Belén<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
250<br />
Unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 2004. Hôpital général <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies IGSS.<br />
Département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
Unité d’urgences<br />
Anatomie, physiologie, et manière d’examiner une ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> peau.<br />
Réactions cutanées aux médicaments: urticaire, érythème fixe<br />
aux drogues, érythème multiforme, syndrome <strong>de</strong> Steven-Johnson,<br />
syndrome <strong>de</strong> Lyell, réactions <strong>de</strong> photosensibilité.<br />
Dermatoses réactionnelles: <strong>de</strong>rmatite atopique <strong>de</strong>s enfants et <strong>de</strong>s<br />
adultes (névro<strong>de</strong>rmite), lichen simple chronique, lichen simple <strong>de</strong><br />
Vidal.<br />
Dermatite <strong>de</strong> contact (comprend aussi <strong>la</strong> phototoxicité).<br />
Dermatite microbienne ou nummu<strong>la</strong>ire.<br />
Dermatite séborrhéique, érythro<strong>de</strong>rmie.<br />
Unité <strong>de</strong> cardiologie<br />
Ma<strong>la</strong>dies bulleuses: <strong>de</strong>rmatite herpétiforme, dishydrose, herpès gestationis, pemphigus<br />
et ses variétés, pemphigoï<strong>de</strong> et ses variétés.<br />
Dyschromies ou altérations <strong>de</strong> <strong>la</strong> pigmentation: vitiligo, albinisme, <strong>de</strong>rmatite so<strong>la</strong>ire<br />
hypochromatique, mé<strong>la</strong>sme, <strong>de</strong>rmatose cendrée, argyrie, lentigo <strong>de</strong>s vieil<strong>la</strong>rds.<br />
Acné, rosacée et réaction acnéiforme.<br />
Unité d’oncologie<br />
Tumeurs bénignes :<br />
Fibromes : dur et mou.<br />
Hémangiomes : taches rubis, hémangiome p<strong>la</strong>n, hémangiomes capil<strong>la</strong>ires immatures,<br />
hémangiomes caverneux.<br />
Tache mongoloï<strong>de</strong>, naevus bleu, naevus <strong>de</strong> Ota.<br />
Nævus nevocellu<strong>la</strong>ire: nævus <strong>de</strong> <strong>la</strong> jonction, composé, intra<strong>de</strong>rmique, géant congénital,<br />
<strong>de</strong> Becker.<br />
Kératose séborrhéique.<br />
Tumeurs malignes :<br />
Lésions précancereuses : kératoses actiniques, arsenicales, ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Bowen, leucop<strong>la</strong>sie,<br />
corne cutanée, radio<strong>de</strong>rmite, ulcères chroniques.<br />
Cancer : basocellu<strong>la</strong>ire, spinocellu<strong>la</strong>ire, mé<strong>la</strong>nome, ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Paget, sarcome <strong>de</strong> Kaposi,<br />
<strong>de</strong>rmatofibrosarcome.<br />
Unité <strong>de</strong> neurologie<br />
Phacomatose :<br />
Ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Von Recklinghausen, E. Pringle, S. Sturge-Weber.<br />
Ma<strong>la</strong>dies psychocutanées :<br />
Excoriations névrotiques, prurigo nodu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> Hy<strong>de</strong>, <strong>de</strong>rmatite factice, phobies, délire<br />
<strong>de</strong> parasites, trichotillomanie, prurit psychogène, alopecia areata, onychophagie.<br />
Unité d’hématologie<br />
Manifestations cutanées <strong>de</strong> leucémie et <strong>de</strong> lymphomes.<br />
Dermatoses inf<strong>la</strong>mmatoires.<br />
Psoriasis, parapsoriasis en p<strong>la</strong>ques, prurigo so<strong>la</strong>ire, pityriasis rosé <strong>de</strong> Gibert.<br />
Unité <strong>de</strong> gastro-entérologie<br />
Manifestations cutanées <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die hépatobiliaire, amyloïdose cutanée, porphyries.<br />
Histiocytose.
Unité d’endocrinologie<br />
Acanthosis nigricans, xanthomes, pel<strong>la</strong>gre et manifestations cutanées dues au<br />
diabète mellitus, goutte.<br />
Unité <strong>de</strong> rhumatologie<br />
LED, LES, LE subaigu, <strong>de</strong>rmatomyosite, scléro<strong>de</strong>rmie localisée et systémique.<br />
Cortico<strong>de</strong>rmies.<br />
Unité <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies infectieuses<br />
Infections bactériennes par staphylocoque et streptocoque : impétigo vulgaire,<br />
ecthyma, érysipèle, folliculite, furonculose, granulome infectieux, hidrosadénites,<br />
ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Ritter.<br />
Autres infections bactériennes : érythrasma, kératolye p<strong>la</strong>ntaire, lèpre, tuberculose<br />
cutanée, myco-bactéries atypiques.<br />
Parasitoses cutanées: leishmaniose, onchocercose, <strong>la</strong>rva migrans, gale, gale norvégienne,<br />
amibiases cutanées.<br />
Infections virales: infection par papillomavirus humain, herpes simple, zoster, molluscum<br />
contagiosum.<br />
Infection par champignons :<br />
Mycoses superficielles : pityriasis versicolore, candidoses et teignes.<br />
Mycoses profon<strong>de</strong>s: actinomycoses, chromob<strong>la</strong>stomycoses, sporotrichoses, mycétomes.<br />
Mycoses systémiques : coccidioïdomycoses, histop<strong>la</strong>smoses, paracoccidioïdomycoses<br />
et b<strong>la</strong>stomycoses.<br />
Mycoses opportunistes : candidoses, cryptococoses, zygomycoses et aspergilloses.<br />
B) PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT. SPÉCIALISATION EN MÉDECINE INTERNE<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, Département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne. Centre médical militaire.<br />
Faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, université Mariano Gálvez<br />
Sujets : 1. Anatomie, histologie et physiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. 2. Sémiologie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
3. Manifestations cutanées <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies systémiques. 4. Ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles. 5 Dermatologie infectieuse. 6. Oncologie <strong>de</strong>rmatologique. 7. Dermatoses<br />
érythémato-squameuses. 8. Dermatoses bulleuses. 9. Dermatoses réactionnelles. 10<br />
Acné, <strong>de</strong>rmatite séborrhéique.<br />
Institut <strong>de</strong> Dermatologie et Chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Peau (INDERMA)<br />
■ Institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (INDERMA)<br />
Peter Greenberg Cor<strong>de</strong>ro, Suzzette <strong>de</strong> León G.<br />
Brève histoire <strong>de</strong> l’asile La Piedad à <strong>la</strong> nouvelle Guatema<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Asunción: l’hôpital national Ramiro Gálvez et ses directeurs<br />
Le tremblement <strong>de</strong> terre <strong>de</strong> Santa Marta se produisit le 29 juillet 1773, détruisant <strong>la</strong> ville<br />
<strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> los Caballeros et plusieurs vil<strong>la</strong>ges voisins. L’action <strong>de</strong> l’archevêque<br />
Dom Pedro Cortés y Larraz fut remarquable: il aida les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s convalescents <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
(figures 23, 24, 25) et se préoccupa <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s lépreux isolés à l’hôpital <strong>de</strong> San Lázaro.<br />
En 1875, Dom Rafael Angulo y Urrue<strong>la</strong> établit un petit <strong>la</strong>zaret situé dans l’ancien couvent<br />
<strong>de</strong> Santo Domingo, mais comme <strong>la</strong> lèpre était considérée à l’époque comme une ma<strong>la</strong>die<br />
très contagieuse, les voisins protestèrent et <strong>de</strong>mandèrent au gouvernement que les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s fussent transférés à un autre endroit. Le 23 décembre 1881, <strong>la</strong> direction<br />
251<br />
Figure 25.<br />
Hôpital San Pedro
Figures 26, 27, 28.<br />
Vues <strong>de</strong> l’hôpital<br />
national Ramiro<br />
Gálvez<br />
Figure 29.<br />
Dr Fernando<br />
A. Cor<strong>de</strong>ro C.<br />
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
252<br />
politique du département <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> décida<br />
que <strong>la</strong> zone appelée « Jocotales ou <strong>la</strong>s<br />
Piedrecitas », située à 7 kilomètres du centre-ville et d’une extension équivalente à<br />
100 pâtés <strong>de</strong> maisons, était l’endroit adéquat pour construire un <strong>la</strong>zaret (il reçut le nom<br />
<strong>de</strong> « Lazaret <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Piedrecitas » ou « Lazaret <strong>de</strong> Elefancíacos »). Rafael Angulo y Urrue<strong>la</strong><br />
fonda et dirigea le premier ce <strong>la</strong>zaret ; il mena un important travail administratif,<br />
finança les dépenses et édifia une petite chapelle.<br />
Ce centre d’assistance atteignit son objectif même pendant <strong>de</strong>s époques et <strong>de</strong>s circonstances<br />
difficiles, comme lors <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>struction complète en 1917-1918. Il fut reconstruit<br />
en 1920 par Rafael Mauricio et José Ruiz Angulo, qui dirigeaient l’hôpital général.<br />
Tableau 4. Directeurs <strong>de</strong> l’hôpital national Ramiro Gálvez Asteguieta<br />
Nom du directeur Date d’entrée en fonction<br />
Dr José Manuel Valdés 26–9–1877<br />
Dr. José Urrutia 23–2–1884<br />
Dr Domingo Álvarez 30–4–1887<br />
Dr Rafael Mauricio 14–12–1895<br />
Dr Salvador Ortiz 23–11–1901<br />
Dr Ramiro Gálvez 20–11–1925<br />
Nom du directeur Date d’entrée en fonction<br />
Dr Fernando A. Cor<strong>de</strong>ro C. 18–3–1941<br />
Dr Mariano Castillo 29–5–1948<br />
Dr Eduardo Silva Martínez 25–11–1955<br />
Dr Carlos N. Cor<strong>de</strong>ro A. 12–12–1984<br />
Dr Peter A. Greenberg Cor<strong>de</strong>ro 27–3–2003<br />
Un accord gouvernemental du 8 novembre 1960 stipu<strong>la</strong> <strong>la</strong> modification du nom <strong>de</strong><br />
l’institution asile La Piedad en hôpital national Ramiro Gálvez, en hommage au travail<br />
effectué pendant plus <strong>de</strong> quinze ans par son défunt directeur, le Dr Ramiro Gálvez<br />
Azteguieta (tableau 4) (figures 26, 27, 28).<br />
En 1972, le prési<strong>de</strong>nt confia au Dr Fernando A. Cor<strong>de</strong>ro C. (figure 29)<br />
<strong>la</strong> réorganisation <strong>de</strong> l’hôpital Ramiro Gálvez (léproserie) car celui-ci se<br />
trouvait en piteux état et les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s y recevaient un très mauvais traitement.<br />
Quatre-vingts ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s étaient soignés à l’hôpital : quinze patients<br />
mutilés par <strong>la</strong> lèpre, huit en bonne condition physique traités<br />
comme <strong>de</strong>s hanséniens ambu<strong>la</strong>toires, cinquante-<strong>de</strong>ux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s chroniques<br />
non lépreux souffrant <strong>de</strong> plusieurs douleurs ; en outre, il y avait<br />
<strong>de</strong>ux mendiants, un patient atteint <strong>de</strong> déficience mentale et <strong>de</strong>ux alcooliques<br />
qui aidaient à soigner les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et <strong>de</strong>mandaient l’aumône pour<br />
financer leurs dépenses.<br />
Le 9 mars 1973 naquit le Patronat d’action contre <strong>la</strong> lèpre, une association<br />
<strong>la</strong>ïque non lucrative, apolitique et <strong>de</strong> bienfaisance, qui avait pour but principal<br />
<strong>de</strong> lutter contre <strong>la</strong> lèpre et les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques aux alentours du<br />
Guatema<strong>la</strong>.<br />
En 1975, ce patronat créa au sein <strong>de</strong> l’INDERMA un cours <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>stiné à<br />
étudier et à diffuser <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le Dr Fernando A. Cor<strong>de</strong>ro C, qui fut fondateur et<br />
directeur <strong>de</strong> plusieurs institutions liées à <strong>la</strong> léprologie parmi les jeunes mé<strong>de</strong>cins du Guatema<strong>la</strong>,<br />
dirigea ce cours.
Les bases <strong>de</strong> cette activité académique furent programmées et accordées à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Académie<br />
guatémaltèque <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, syphiligraphie et léprologie; l’assistance <strong>de</strong>s étudiants<br />
à l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et à son hôpital (le matin et pendant quatre heures par jour) pour<br />
suivre le programme d’étu<strong>de</strong>s préa<strong>la</strong>blement conçu fut remarquée (figures 30, 31, 32).<br />
Le programme <strong>de</strong> spécialisation Pr. Carlos N. Cor<strong>de</strong>ro A. permit à soixante-sept <strong>de</strong>rmatologues,<br />
dont vingt-sept étaient originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du<br />
Sud, <strong>de</strong> réussir leur spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (tableau 5).<br />
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT (figures 33, 34, 35)<br />
Notre vision: être à <strong>la</strong> première p<strong>la</strong>ce au niveau national et international dans <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle.<br />
Objectifs : encourager <strong>la</strong> recherche et l’actualisation <strong>de</strong>s connaissances en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Contribuer au perfectionnement médical et scientifique du professionnel.<br />
Spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
1. Nom exact du diplôme : maîtrise.<br />
2. Nom du directeur du programme: Dr Peter A. Greenberg Cor<strong>de</strong>ro, Dr Suzzette <strong>de</strong> León.<br />
3. Ressources : Soin <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 000 patients ; hôpital à disposition pour hospitalisation<br />
et consultation externe ; <strong>la</strong>boratoire multidisciplinaire comportant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie<br />
; soli<strong>de</strong> formation dans le domaine médico-chirurgical en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
4. Destinataires : mé<strong>de</strong>cins et chirurgiens nationaux et étrangers.<br />
5. Pourquoi un élève doit-il choisir cette maîtrise et pas une autre? C´est <strong>la</strong> seule école<br />
centre-<strong>américaine</strong> avec vingt-cinq ans d’expérience à former <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie<br />
; soin <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 000 patients par an ; hôpital disposant <strong>de</strong> cinquante lits ;<br />
consultation externe à <strong>la</strong> capitale ; consultation externe à Zacapa (programme rural).<br />
6. Programme académique : unités longitudinales (durée trois ans) ; unités transversales<br />
(trois à quatre mois).<br />
7. a) Durée <strong>de</strong> <strong>la</strong> maîtrise : trois ans, quinze unités longitudinales, douze unités transversales.<br />
b) Organisation <strong>de</strong>s cours. Examen mensuel <strong>de</strong>s unités longitudinales à <strong>la</strong> fin<br />
<strong>de</strong>s unités transversales. Dix jours ouvrables <strong>de</strong> vacances par an.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> litterature. La <strong>de</strong>rmatologie popu<strong>la</strong>ire, les guérisseurs, <strong>la</strong> magie<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> littérature. La <strong>de</strong>rmatologie<br />
popu<strong>la</strong>ire, les guérisseurs, <strong>la</strong> magie<br />
Eduardo Silva-Lizama<br />
LE LIT BRODÉ DE DOM MANUEL FERNÁNDEZ<br />
Dom Juan Vásquez <strong>de</strong> Molina était un noble seigneur <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong>s conquistadors et<br />
un chirurgien habile. Sa célébrité remonte à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie du XVI e siècle car son nom<br />
253<br />
Figures 30, 31, 32.<br />
Institut <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et<br />
chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
peau: vue frontale;<br />
unité<br />
d’informatique et<br />
bibliothèque; unité<br />
d’enseignement et<br />
<strong>de</strong> spécialisation en<br />
<strong>de</strong>rmatologie
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
254<br />
Tableau 5. Liste <strong>de</strong>s spécialistes diplômés à l’INDERMA<br />
Co<strong>de</strong> Nom Année diplôme Nationalité<br />
n1 Dr Carmen C. <strong>de</strong> Mansil<strong>la</strong> 1976 Guatémaltèque<br />
n2 Dr Carlos N. Cor<strong>de</strong>ro A. Guatémaltèque<br />
n3 Dr Guillermo Asencio 1977 Guatémaltèque<br />
n4 Dr Miriam Quiñónez 1980 Guatémaltèque<br />
n5 Dr Marco Tulio González Guatémaltèque<br />
n6 Dr Efraín Pérez Alvisurez Guatémaltèque<br />
n7 Dr Augusto E. Perera Costaricaine<br />
n8 Dr Jorge Ramírez 1981 Guatémaltèque<br />
n9 Dr Este<strong>la</strong> <strong>de</strong> Jeni 1982 Équatorienne<br />
10 Dr Ro<strong>la</strong>ndo Fal<strong>la</strong> Sántizo 1983 Guatémaltèque<br />
11 Dr Juan José Mansil<strong>la</strong> A. 1984 Guatémaltèque<br />
12 Dr Edgar L. Pérez Ch. Guatémaltèque<br />
13 Dr Narciso A. Vargas Nicaraguayenne<br />
14 Dr Carlos Cruz Pa<strong>la</strong>cios Guatémaltèque<br />
15 Dr José Guillermo Higueros 1985 Guatémaltèque<br />
16 Dr Anabel<strong>la</strong> Ch. <strong>de</strong> Chang 1987 Guatémaltèque<br />
17 Dr César A. Navarro Guatémaltèque<br />
18 Dr Pura A. Martínez 1989 Guatémaltèque<br />
19 Dr Walter E. Morales F. 1990 Guatémaltèque<br />
20 Dr Guillermo Letona Guatémaltèque<br />
21 Dr Anabel<strong>la</strong> Orel<strong>la</strong>na 1991 Guatémaltèque<br />
22 Dr Mi<strong>la</strong>gros Santos 1992 Guatémaltèque<br />
23 Dr Gustavo A. Coronado Guatémaltèque<br />
24 Dr Edgar E. Chen Lau 1993 Guatémaltèque<br />
25 Dr Sol Beatriz Jiménez Colombienne<br />
26 Dr Alejandro Enríquez Salvadorienne<br />
27 Dr Edith Lorena Bay 1994 Guatémaltèque<br />
28 Dr Edgardo Sandoval Salvadorienne<br />
29 Dr Manuel F. García N. 1995 Guatémaltèque<br />
30 Dr C<strong>la</strong>udia Cifuentes Hondurienne<br />
31 Dr Fredy Baril<strong>la</strong>s Guatémaltèque<br />
32 Dr Byron Vil<strong>la</strong>grán 1996 Guatémaltèque<br />
33 Dr Wilmar Polo Vega Colombienne<br />
34 Dr Telma Meda Álvarez Guatémaltèque<br />
35 Dr María <strong>de</strong>l Pi<strong>la</strong>r Manrique 1997 Guatémaltèque<br />
36 Dr Julitta Bradley 1997 Belize<br />
37 Dr Ana Cristina Guzmán Colombienne<br />
38 Dr Rita María Restrepo Colombienne<br />
39 Dr Maritza <strong>de</strong> Kummerfedt 1998 Guatémaltèque<br />
40 Dr Sonia Maritza Cardona Hondurienne<br />
41 Dr Lubeth H. Hernán<strong>de</strong>z Guatémaltèque<br />
42 Dr Raquel Meneses Colombienne<br />
43 Dr Carmen Y. Choc M. 1999 Guatémaltèque<br />
44 Dr Peter A. Greenberg Cor<strong>de</strong>ro Guatémaltèque<br />
45 Dr Marleny O. Vargas T. Hondurienne<br />
46 Dr Regina Echeverría 2000 Guatémaltèque<br />
47 Dr C<strong>la</strong>ra Lucía Espinal Colombienne<br />
48 Dr Jorge L. Ortiz Guatémaltèque<br />
49 Dr Leticia Ovando Z. Hondurienne<br />
50 Dr Herman Schaffer 2001 Nicaraguayenne<br />
51 Dr Eli Yo<strong>la</strong>ni Santos V. Hondurienne<br />
52 Dr Juan Carlos Argüello Salvadorienne<br />
53 Dr Juan José Rejopachí Guatémaltèque<br />
54 Dr Elmer Saturnino Guatémaltèque<br />
55 Dr Car<strong>la</strong> P. Agui<strong>la</strong>r 2002 Hondurienne<br />
56 Dr Jeannie M. Sánchez Salvadorienne<br />
57 Dr José Antonio Tabush Costaricaine<br />
58 Dr Kar<strong>la</strong> Santacruz 2003 Salvadorienne<br />
59 Dr Carolina Rivas A. Hondurienne<br />
60 Dr Edith Tobías Achtmann Guatémaltèque<br />
61 Dr C<strong>la</strong>udia Lissette Guerrero 2004 Salvadorienne<br />
62 Dr David E. Zepeda Salvadorienne<br />
63 Dr Elizabeth Chu Chang Hondurienne<br />
64 Dr Deify Rodríguez Guatémaltèque<br />
65 Dr Carolina Durán Guatémaltèque<br />
66 Dr Miriam Hernán<strong>de</strong>z Guatémaltèque
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
apparaît dans <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> 1597. Nous nous référerons à l’un d’entre eux.<br />
Dans son lit brodé, Dom Manuel Fernán<strong>de</strong>z se tordait, victime d’une intense colique<br />
au bas-ventre. Vite notre mé<strong>de</strong>cin a recours aux médicaments carminatifs et aux topiques<br />
adoucissants appliqués sur <strong>la</strong> peau abdominale endolorie. Le malheureux ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
n’est pas sou<strong>la</strong>gé, et le sablier compte les heures qui lui restent. Vásquez <strong>de</strong> Molina comprend<br />
<strong>la</strong> situation en tâtant le ventre, et il sent un apostème avec un abcès. En une secon<strong>de</strong><br />
il prépare ses instruments et ouvre <strong>la</strong> peau tuméfiée à l’ai<strong>de</strong> d’une <strong>la</strong>me aiguisée,<br />
ainsi que l’apostème qui gonf<strong>la</strong>it le f<strong>la</strong>nc droit. Des matières pestilentes sortent <strong>de</strong>s entrailles<br />
et l’apostème est évacué. Un sou<strong>la</strong>gement rapi<strong>de</strong> transforme le visage agonisant<br />
du ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et une gran<strong>de</strong> admiration se manifeste <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> tous les assistants.<br />
Avec une gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>xtérité et <strong>de</strong> l’intuition, le chirurgien Vásquez <strong>de</strong> Molina sauva le<br />
patient qui vécut pendant treize mois avec une fistule ne l’empêchant point <strong>de</strong> vivre activement<br />
au quotidien. Pourquoi cette observation resta-t-elle dans les archives ? Don<br />
Manuel Fernán<strong>de</strong>z mourut d’infections ultérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> fistule et sa famille refusa <strong>de</strong><br />
payer à Vásquez <strong>de</strong> Molina ses honoraires. Dom Juan <strong>de</strong>mandait 500 pesos pour son intervention<br />
urgente et les héritiers du défunt portugais ne vou<strong>la</strong>ient rien payer, entraînant<br />
un procès et une action en justice 31, 32, 33 .<br />
SAINT FRÈRE PEDRO DE SAN JOSÉ DE BETHENCOURT<br />
Les écrits sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sont rares dans <strong>la</strong> littérature guatémaltèque ; cependant,<br />
nous ne pouvons pas passer sous silence <strong>la</strong> vie, les œuvres et les miracles du saint<br />
frère Pedro <strong>de</strong> Bethencourt, qui éc<strong>la</strong>ira <strong>de</strong> ses vertus <strong>la</strong> pauvreté scientifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
guatémaltèque du XVII e siècle.<br />
Il est impossible <strong>de</strong> ne pas voir cité le frère Pedro dans un livre sur l’histoire médicale<br />
du Guatema<strong>la</strong> et sur l’histoire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, car <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine est une<br />
science passionnée et un art caritatif, elle est profondément humaine et sociale, et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
hospitalière ne finit pas avec le soin mais elle se prolonge avec <strong>la</strong> convalescence.<br />
Les vertus du vénérable saint frère furent florissantes pendant quinze ans dans <strong>la</strong><br />
noble et très loyale ville <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> los Caballeros <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> ; il arriva <strong>de</strong>s îles<br />
Fortunées en y apportant <strong>la</strong> fortune d’un esprit héroïque et le printemps <strong>de</strong> cent miracles.<br />
Son départ dépendit d’un <strong>de</strong>ssein divin, et notre ville <strong>de</strong> Santiago lui apparut <strong>de</strong>puis<br />
<strong>la</strong> mer telle une étoile qui gui<strong>de</strong> et éc<strong>la</strong>ire le chemin. L’étoile-gui<strong>de</strong> l’amena dans <strong>la</strong><br />
Bethléem <strong>de</strong> ses rêves, pour y brûler <strong>la</strong> myrrhe <strong>de</strong> ses vertus et l’encens <strong>de</strong> son âme dévote<br />
et humble. Roi mage <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté et du sacrifice, il arriva à « Goathema<strong>la</strong> » tel un<br />
présent <strong>de</strong> Dieu. C’était en 1650 et Pedro s’approchait <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> sa vie, lorsque dans<br />
<strong>la</strong> douceur du soir il entendit <strong>la</strong> voix <strong>de</strong> saint Augustin lui dire: « Aime et fais ce que tu<br />
veux. » Les petites fleurs et les agneaux étaient <strong>de</strong>s dons vivants <strong>de</strong> l’humilité, et au loin<br />
<strong>la</strong> mer offrait une leçon <strong>de</strong> constance et invitait les hommes aux dangers <strong>de</strong>s longs<br />
voyages. Pedro écouta <strong>la</strong> voix <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, qui était <strong>la</strong> voix <strong>de</strong> Dieu, et, acceptant les<br />
conseils d’une tante qui habitait outre-mer, il entreprit son voyage vers les In<strong>de</strong>s. À l’île<br />
<strong>de</strong> Cuba, fin heureuse <strong>de</strong> son voyage, il écouta le nom <strong>de</strong> Goathema<strong>la</strong> pour <strong>la</strong> première<br />
fois, et dès qu’il l’eut entendu, il <strong>de</strong>vina que cette ville serait <strong>la</strong> terre promise <strong>de</strong> ses<br />
255<br />
Figures 33, 34, 35.<br />
Institut <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et<br />
chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau :<br />
couloir du service<br />
d’hospitalisation pour<br />
hommes; unité<br />
d’Informatique et<br />
bibliothèque; service<br />
<strong>de</strong> cabinets externes
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
256<br />
vertus et <strong>de</strong> ses sacrifices. Ce nom signifia à l’instant même magie et secret, et sa décision<br />
immédiate amena Pedro sur le chemin <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> Goathema<strong>la</strong>, où il<br />
entra le 18 février 1651, heureux et animé par <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong>s cieux. Ce jour fut heureux<br />
et funeste à <strong>la</strong> fois. La terre tremb<strong>la</strong> violemment au milieu d’une kyrielle <strong>de</strong> dégâts et <strong>de</strong><br />
châtiments, et tandis que les habitants revenaient apeurés et contrits, ils virent Pedro <strong>de</strong><br />
Bethencourt embrasser cette terre qui l’avait accueilli le jour même, entonnant les mots<br />
prophétiques : « C’est là que je vivrai et mourrai. » Sur <strong>la</strong> terre trépidante s’éleva <strong>la</strong> douceur<br />
d’une prière formée <strong>de</strong> vers emplis d’Amour et <strong>de</strong> Dieu, et <strong>la</strong> minute tragique <strong>de</strong>vint<br />
une heure spirituelle. L’étranger <strong>de</strong>s îles Fortunées fut désormais le frère Pedro, qui,<br />
au moment d’entrer dans <strong>la</strong> ville, portait dans ses mains immortelles un faisceau <strong>de</strong> miracles<br />
et une cloche sonore les invitant tous à <strong>la</strong> perfection spirituelle. Les vigiles <strong>de</strong><br />
l’étu<strong>de</strong> commencèrent à le tourmenter. La mémoire est dure et résistante. Toute <strong>la</strong><br />
constance et <strong>la</strong> patience <strong>de</strong> l’élève exemp<strong>la</strong>ire sont inutiles. Les moqueries <strong>de</strong> ses camara<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse triomphent, et quand il déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> monter en chaire, sûr <strong>de</strong> ce qu’il apprit,<br />
le silence scelle ses lèvres, tandis que <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse entière déchaîne injures et satires.<br />
Pedro <strong>de</strong> Bethencourt subit <strong>la</strong> première épreuve et, lorsque <strong>la</strong> voix matérielle est muette,<br />
une voix très pure parle à son âme et lui indique le miracle <strong>de</strong> son <strong>de</strong>stin. Le professeur<br />
ne comprend pas, l’école ne sait rien, mais Pedro, illuminé par une lumière céleste, est<br />
déjà « professeur <strong>de</strong> renom dans les universités <strong>de</strong>s vertus », maître inimitable à l’école<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> charité, élève <strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s disciplines matérielles et spirituelles les plus sévères, bachelier<br />
nemine discrepante dans les sciences difficiles <strong>de</strong> l’humilité et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté, génial<br />
docteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> rare et très spéciale science <strong>de</strong> l’amour envers autrui. Pedro <strong>de</strong><br />
Bethencourt quitta le costume sombre d’étudiant et revêtit <strong>la</strong> tunique bénie <strong>de</strong> tertiaire,<br />
dont lui fit don le pieux Esteban <strong>de</strong> Sa<strong>la</strong>zar, une journée inoubliable <strong>de</strong> 1655. Portant<br />
déjà l’habit <strong>de</strong> troisième, Pedro débuta sa vie merveilleuse et exemp<strong>la</strong>ire. De son vêtement<br />
grossier sail<strong>la</strong>ient <strong>de</strong>s fils d’or, et les roses poussaient là où il marchait. Sur sa tête<br />
découverte le ciel écrivait son meilleur poème ; mille pardons et d’innombrables indulgences<br />
glissaient <strong>de</strong>s grains <strong>de</strong> son grossier chapelet. La main gauche était un verre <strong>de</strong><br />
conso<strong>la</strong>tion et une caresse toute-puissante, et <strong>de</strong> sa main droite pendait <strong>la</strong> clochette immortelle,<br />
dont les touches argentées annonçaient le ciel pour les hommes pacifiques et<br />
bons et le salut pour tous ceux qui chercheraient les chemins du repentir. Lorsque <strong>la</strong> pénombre<br />
estompe les contours dans <strong>la</strong> ville aux roses perpétuelles, on entend quotidiennement<br />
<strong>la</strong> voix du saint frère Pedro qui dit à tous : « Rappelez-vous, mes frères, que nous<br />
n’avons qu’une âme, et que si nous <strong>la</strong> perdons, nous ne <strong>la</strong> récupérerons pas. » Pedro <strong>de</strong><br />
Bethencourt commença déjà ses miracles, et le printemps éternel couvrit <strong>la</strong> très noble et<br />
loyale ville <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong> los Caballeros <strong>de</strong> Goathema<strong>la</strong>, et toute <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong>vint une roseraie<br />
d’amour. Dans l’échelle <strong>de</strong>s vertus, le saint frère Pedro fit son premier pas en imitant<br />
le Christ et, suivant les enseignements <strong>de</strong> François d’Assise, il dit avec eux: « Laissez<br />
approcher les enfants. » Un matin il parcourut vingt-sept églises accompagné du pauvre<br />
invali<strong>de</strong> Marquitos et, arrivé finalement à l’église <strong>de</strong> Santa Cruz, il contemp<strong>la</strong> l’endroit<br />
qu’occuperaient désormais l’hôpital, l’église et l’école. Dans une petite maison pauvre<br />
entourée <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s orties et p<strong>la</strong>cée à mi-chemin entre le calvaire et l’église <strong>de</strong> Santa<br />
Cruz, frère Pedro réunit les enfants nécessiteux qui avaient besoin <strong>de</strong> conso<strong>la</strong>tion et<br />
d’enseignement chrétien. La beauté <strong>de</strong> ses leçons et <strong>la</strong> tendresse avec <strong>la</strong>quelle il traitait<br />
ces enfants se propagèrent au-<strong>de</strong>là du voisinage, et c’est ainsi qu’affluaient <strong>de</strong>s endroits<br />
plus lointains <strong>de</strong>s milliers d’enfants attirés par l’amour du disciple du Christ, du frère<br />
François d’Assise. L’humble petite maison <strong>de</strong>vint école et se réjouit <strong>de</strong>s rires enfantins.<br />
Une vieille ma<strong>la</strong><strong>de</strong> appelée María Esquivel l’habitait, « vénérable par <strong>la</strong> vertu, exemp<strong>la</strong>ire<br />
par <strong>la</strong> pénitence, prodigieuse par <strong>la</strong> souffrance ». La longue et pénible ma<strong>la</strong>die<br />
avait atteint tout son corps et tout mouvement était un martyre. Une fois l’enseignement<br />
fini, le frère Pedro venait <strong>la</strong> consoler <strong>de</strong> sa conversation très pieuse, et il léchait soigneusement<br />
ses p<strong>la</strong>ies pour en enlever toute <strong>la</strong> pourriture et ne pas lui faire mal en les
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
soignant. Il répéta plusieurs fois cet acte héroïque dans les hôpitaux où il se rendait quotidiennement.<br />
Il y avait à l’hôpital <strong>de</strong> San Alejo un Indien dont <strong>la</strong> jambe était pourrie, et<br />
le chirurgien qui le soignait, <strong>de</strong> peur <strong>de</strong> le toucher, <strong>de</strong>manda à ce qu’on apporte un petit<br />
chien pour nettoyer <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ie pestilente. Le frère Pedro était présent et, écoutant le chirurgien,<br />
il se mit à genoux et commença à lécher <strong>la</strong> pourriture, <strong>la</strong>issant <strong>la</strong> jambe ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
propre et décharnée. Lors <strong>de</strong> ses visites quotidiennes à l’hôpital Real <strong>de</strong> Santiago, il répétait<br />
souvent cette guérison héroïque, acte que Don Melchor <strong>de</strong> Mencos et Dom Joseph<br />
<strong>de</strong> Estrada se p<strong>la</strong>isaient à raconter avec stupéfaction. Une atmosphère <strong>de</strong> miracle auréo<strong>la</strong><br />
Pedro <strong>de</strong> Bethencourt pendant les quinze années qu’il vécut à Goathema<strong>la</strong>, et personne<br />
ne mit en doute sa sainteté. Le 25 avril 1667, à <strong>de</strong>ux heures <strong>de</strong> l’après-midi, le<br />
frère Pedro mourut à l’âge <strong>de</strong> 48 ans pour les misères <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et naquit pour <strong>la</strong> gloire<br />
éternelle <strong>de</strong> Dieu.<br />
En 2002, Sa Sainteté Jean-Paul II visita le Guatema<strong>la</strong> à l’occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> canonisation<br />
du saint frère Pedro <strong>de</strong> Bethencourt, actuellement vénéré sur les autels <strong>de</strong>s églises guatémaltèques<br />
31, 32, 33 .<br />
LA CURIEUSE MALADIE DU MINISTRE DOYEN<br />
La ma<strong>la</strong>die chirurgicale dont souffrit le ministre Dom Tomás <strong>de</strong> Arana, un homme<br />
couvert <strong>de</strong> plusieurs titres et <strong>de</strong> bontés, constitua un fait très intéressant <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
coloniale <strong>de</strong> <strong>la</strong> première moitié du XVIII e siècle. La ma<strong>la</strong>die dura longtemps, entre 1729<br />
et 1744. Il fut soumis durant cette pério<strong>de</strong> aux soins les plus divers et tous les bacheliers<br />
en mé<strong>de</strong>cine participèrent aux traitements. Comme il s’agissait d’un homme aimé et respecté,<br />
les rapports abondèrent, nous permettant <strong>de</strong> connaître plusieurs détails sur les<br />
connaissances, les diagnostics, les pronostics et les soins thérapeutiques <strong>de</strong> nos mé<strong>de</strong>cins<br />
coloniaux.<br />
Dom Tomás <strong>de</strong> Arana conquit le peuple grâce à son attitu<strong>de</strong> bonne et conso<strong>la</strong>trice lors<br />
<strong>de</strong>s tremblements <strong>de</strong> terre <strong>de</strong> 1717.<br />
Dom Cristóbal <strong>de</strong> Hincapié vanta dans ses vers <strong>la</strong> conduite altruiste du ministre, qui<br />
visitait chaque jour les foyers détruits et accomplissait toutes sortes <strong>de</strong> charités.<br />
En 1729, le ministre commença à souffrir d’un grave mal <strong>de</strong> bouche, modifiant complètement<br />
sa vie et son caractère. L’homme affable, à l’esprit ouvert et généreux, fut<br />
transformé ; plusieurs formes d’aigreur et <strong>de</strong> susceptibilité dérivèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die douloureuse<br />
et maligne.<br />
La paix intérieure du ministre était malheureusement brisée ; les fistules buccales lui<br />
faisaient plus mal que toutes les querelles <strong>de</strong>s affaires publiques.<br />
Dom Manuel <strong>de</strong> Arteaga y Carranza, protochirurgien <strong>de</strong>s hôpitaux et disséqueur à <strong>la</strong><br />
Real Université <strong>de</strong> San Carlos, était alors le chirurgien le plus notable <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong><br />
Santiago; en conséquence, il fut le premier à intervenir auprès du ministre doyen.<br />
L’observation minutieuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die apparaît dans un rapport que ce chirurgien<br />
<strong>de</strong>stina à l’audience royale :<br />
Depuis 1729, je soignais le ministre D. Tomás Ignacio <strong>de</strong> Arana d’un lupus chancreux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèvre inférieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> bouche, du côté gauche, avec une grave douleur et érysipèle<br />
sur toute <strong>la</strong> circonférence. Je ne pus éviter l’ulcération et aucun médicament ne<br />
permit <strong>de</strong> le guérir. C’est pourquoi le Dr José Medina fut appelé : il prescrivit <strong>de</strong>s<br />
purges et <strong>de</strong>s saignées qui ne l’améliorèrent point. Les soins durèrent jusqu’en 1732,<br />
année pendant <strong>la</strong>quelle il contracta un tabardillo qui faillit le tuer, et duquel le guérit<br />
le Dr Medina. Les évacuations et <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> chaleur <strong>de</strong>s fièvres disséquèrent l’ulcère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> bouche et il resta à sa merci souffrant d’autres ma<strong>la</strong>dies guéries par le Dr<br />
Ávalos y Porres. Ce fut ainsi jusqu’en 1738. Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> cette année, il souffrit d’une<br />
distil<strong>la</strong>tion rhumatisante qui formait plusieurs petites tumeurs cirrhosées et dégénérèrent<br />
en ulcères si malins qu’ils le mortifièrent beaucoup : l’un lui perfora <strong>la</strong> lèvre<br />
257
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
258<br />
inférieure <strong>de</strong> l’extérieur vers l’intérieur et s’étendit aux mo<strong>la</strong>ires, détruisant une partie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mandibule, au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>nt <strong>de</strong> sagesse ; le masséter s’enf<strong>la</strong>mma ensuite<br />
et il ne pouvait plus ouvrir <strong>la</strong> bouche. Lorsque celle-ci commença à cicatriser,<br />
d’autres petites tumeurs s’ulcérèrent atteignant l’oreille et l’œil situés du même côté.<br />
Les traitements ne servirent à rien ; le Dr Santiago Estebanson vint alors lui prescrire<br />
du mercure, décup<strong>la</strong>nt tellement le mal qu’il fut sur le point <strong>de</strong> mourir, ce qui n’advint<br />
pas par l’œuvre miraculeuse <strong>de</strong> Notre Seigneur <strong>de</strong>s Douleurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Colline. Il ne<br />
guérit pas entièrement et les foyers ulcéreux se multiplièrent par <strong>la</strong> suite. Cinq ulcères<br />
très enf<strong>la</strong>mmés avec <strong>de</strong>s érysipèles, semb<strong>la</strong>bles à ceux du visage apparurent<br />
alors sur le bras droit. Les maîtres Justo González et Pedro Zúñiga vinrent tous les<br />
jours, et le cas fut si grave que les tumeurs s’enf<strong>la</strong>mmèrent considérablement le jour<br />
où il assista à une séance à <strong>la</strong> chapelle royale. La tumeur majeure peut <strong>de</strong>venir si<br />
gran<strong>de</strong> qu’elle lui détruira le visage. L’ulcère <strong>de</strong>s Noli Me Tángere est incurable<br />
(26 juin 1744).<br />
Dom Manuel <strong>de</strong> Ávalos y Porres fit également un compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die du ministre,<br />
diagnostiquant une tumeur chancreuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> joue, ulcérée à l’intérieur et à l’extérieur.<br />
Il diagnostiqua d’autres ma<strong>la</strong>dies comme <strong>de</strong>s hémorragies, <strong>de</strong>s affections<br />
asthmatiques et <strong>de</strong>s coliques. La tumeur est incurable, ajouta le rapport, et seuls les<br />
bains fréquents, <strong>la</strong> diététique et le repos pourront l’améliorer. On pense qu’une tumeur<br />
maligne, un lupus ou l’osteomyelitis pouvaient être à l’origine <strong>de</strong> cette souffrance.<br />
Le ministre doyen Dom Tomás <strong>de</strong> Arana, résigné à ne pas guérir physiquement, voulut<br />
guérir son âme et <strong>de</strong>manda au capitaine général Rivera y Santa Cruz <strong>la</strong> permission<br />
<strong>de</strong> se retirer au couvent <strong>de</strong> San Francisco, où il vou<strong>la</strong>it finir ses jours. Il purifia son âme<br />
dans une cellule, tandis que les ulcères malins « s’amusaient à se loger dans <strong>de</strong> nouveaux<br />
endroits du corps ».<br />
Ainsi mourut le ministre Dom Tomás <strong>de</strong> Arana, un homme respectable, digne et charitable,<br />
aimé <strong>de</strong> tous 28, 29, 30 .<br />
LE LAID DR DESPLANQUEZ<br />
Don Francisco Desp<strong>la</strong>nquez avait 32 ans ; il était diplômé <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> Montpellier et possédait un corps désagréable si l’on en juge les <strong>de</strong>scriptions faites <strong>de</strong><br />
lui au Real Protomedicato <strong>de</strong> Mexico. Natif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Normandie, cet homme très petit, blond<br />
aux yeux bleus, avait le visage « caressé par <strong>la</strong> variole » et orné <strong>de</strong> trois grains <strong>de</strong> beauté<br />
en forme <strong>de</strong> triangle, du côté gauche, et trois en ligne droite, du côté droit. Doté <strong>de</strong> ces<br />
belles qualités faciales, il fuit sa patrie en pleine jeunesse et parcourut les Antilles, le<br />
Mexique, le Guatema<strong>la</strong> et Sonsonate. Cette ville fut <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> son voyage terrestre.<br />
Desp<strong>la</strong>nquez passa une nuit à Guatema<strong>la</strong>, poursuivant ensuite son voyage vers Sonsonate,<br />
où il arriva un matin <strong>de</strong> juin 1768. Comme c’était un dimanche, le peuple est en joie sur <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>za Mayor. Desp<strong>la</strong>nquez <strong>de</strong>ssinait très bien, et il fit un brouillon <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce et <strong>de</strong> l’église.<br />
Dom Il<strong>de</strong>fonso Ignacio <strong>de</strong> Domezin, maire <strong>de</strong> Sonsonate, le vit en train <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiner: les gens,<br />
curieux, intrigués par le physique horrible <strong>de</strong> l’étranger, portaient <strong>de</strong>s jugements hâtifs et suspects,<br />
et une vague d’indignation se leva bientôt contre l’innocent mé<strong>de</strong>cin en voyage. En<br />
moins d’une heure, Desp<strong>la</strong>nquez fut dépouillé <strong>de</strong> ses papiers, terriblement maltraité et enchaîné.<br />
Ses papiers et ses lettres, écrits en <strong>la</strong>ngue étrangère, furent immédiatement étudiés<br />
et nul ne douta que cet étranger « marqué par <strong>la</strong> variole » puisse être un espion ang<strong>la</strong>is payé<br />
pour dresser <strong>de</strong>s cartes <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte. Le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce était un brouillon pour dresser une<br />
fortification. Ce cas étant très grave, <strong>la</strong> peine <strong>de</strong> mort serait peut-être nécessaire; en tout cas,<br />
le maire <strong>de</strong> Sonsonate ne pouvant pas le juger, il était nécessaire <strong>de</strong> transférer l’inculpé au<br />
Guatema<strong>la</strong>, où il pourrait être condamné.<br />
Les protestations <strong>de</strong> Desp<strong>la</strong>nquez furent inutiles ; il jurait être français et assurait que<br />
ses papiers étaient <strong>de</strong>s récits <strong>de</strong> voyages. À Sonsonete, personne ne connaissait les
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngues étrangères. Par conséquent, il <strong>de</strong>vait obligatoirement retourner au Guatema<strong>la</strong> et<br />
abandonner l’idée <strong>de</strong> partir à bord d’une frégate pour le Pérou. Adieu aux rêves <strong>de</strong> richesse<br />
et aux désirs <strong>de</strong> pèlerin, songeait Dom Francisco Desp<strong>la</strong>nquez, au moment où il<br />
prit humblement le chemin du retour, dûment gardé.<br />
Le 5 septembre 1768, Dom Pedro Sa<strong>la</strong>zar Natera y Mendoza, capitaine général du<br />
Guatema<strong>la</strong> ordonna <strong>la</strong> capture du suspect Desp<strong>la</strong>nquez et <strong>de</strong> son compagnon, le chirurgien<br />
Thomas. Le maire Felipe Rubio Morales exécuta l’ordre, emprisonnant les inculpés<br />
accompagnés <strong>de</strong> huit dragons et p<strong>la</strong>cés à l’endroit le plus sûr <strong>de</strong> <strong>la</strong> prison appelé chapelle.<br />
Le maire Rubio Morales, l’administrateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> poste, Joseph <strong>de</strong> Garayales, et<br />
toutes les autorités jugèrent les papiers innocents <strong>de</strong> Desp<strong>la</strong>nquez hermétiques et suspects.<br />
Les fantômes <strong>de</strong>s corsaires ang<strong>la</strong>is et l’intrusion d’espions pesaient dans l’accusation<br />
du mé<strong>de</strong>cin français. Les traductions et les interrogatoires étaient urgents. Les<br />
autorités simples et inoccupées virent dans ce voyage un redoutable p<strong>la</strong>n d’invasion, souhaitant<br />
trouver dans ces papiers mystérieux toutes les clés <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ns stupéfiants. La déception<br />
fut gran<strong>de</strong> quand ils apprirent le contenu <strong>de</strong>s papiers. Comme personne ne<br />
connaissait <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue française dans <strong>la</strong> ville, Desp<strong>la</strong>nquez dut lui-même les traduire, sous<br />
serment.<br />
Les papiers mystérieux (actuellement conservés dans les archives du gouvernement)<br />
comportaient divers sujets. L’un traitait avec précision <strong>de</strong> <strong>la</strong> géographie et <strong>de</strong> l’histoire<br />
du Pérou ; ces <strong>de</strong>scriptions, retranscrites à partir d’un carnet <strong>de</strong> voyages, étaient très<br />
utiles au Dr Desp<strong>la</strong>nquez qui partait dans ce pays pour y faire fortune. Un autre contenait<br />
une <strong>de</strong>scription du diamant et d’autres pierres précieuses, étu<strong>de</strong> suivie d’une curieuse<br />
technique pour b<strong>la</strong>nchir les culottes en soie. D’autres papiers évoquaient <strong>de</strong>s<br />
animaux et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes en lien avec <strong>la</strong> thérapeutique. Il y racontait <strong>de</strong>s soins tels que l’infaillible<br />
remè<strong>de</strong> contre <strong>la</strong> rage qui consistait à prendre quelques grammes <strong>de</strong> fumier<br />
d’oie dans du vin b<strong>la</strong>nc. Suivait une liste complète <strong>de</strong> remè<strong>de</strong>s : le jus <strong>de</strong> chiridono permettait<br />
d’extraire les <strong>de</strong>nts sans douleur, en une fois ; le t<strong>la</strong>nchinoli soignait le mal vénérien<br />
en peu <strong>de</strong> jours et privait <strong>de</strong> raison les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s durant vingt-quatre heures. Le<br />
jagua rendait le visage si noir qu’il était possible <strong>de</strong> prendre les B<strong>la</strong>ncs pour <strong>de</strong>s Noirs.<br />
Ces remè<strong>de</strong>s magnifiques et efficaces faisaient le succès du mé<strong>de</strong>cin Desp<strong>la</strong>nquez, qui<br />
dut malheureusement <strong>la</strong>isser au tribunal les recettes infaillibles.<br />
Le château imaginaire s’écrou<strong>la</strong>, car les autorités honteuses durent présenter leurs<br />
excuses à l’innocent Desp<strong>la</strong>nquez. En décembre 1768, le juré dénommé Romaña ordonna<br />
<strong>la</strong> libération du mé<strong>de</strong>cin français, à qui il fut néanmoins interdit <strong>de</strong> s’enfoncer<br />
dans les provinces ou d’errer en Amérique. Une fois libre et désemparé, Desp<strong>la</strong>nquez<br />
participa à <strong>la</strong> lutte contre les épidémies en prescrivant <strong>de</strong> bonnes recettes contre <strong>la</strong> rougeole<br />
<strong>de</strong> 1769 et contre le typhus <strong>de</strong> 1774. Lors du transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville vers <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Ermita, notre mé<strong>de</strong>cin au visage horrible vécut quelques années à Nueva Guatema<strong>la</strong>,<br />
d’où il disparut sans <strong>la</strong>isser <strong>de</strong> traces. C’est ainsi que s’achève l’histoire du mé<strong>de</strong>cin Desp<strong>la</strong>nquez,<br />
célibataire au visage répugnant, qui trouva <strong>la</strong> fortune et le profit dans <strong>la</strong> ville<br />
qui l’avait condamné à une prison redoutable 29 .<br />
LE SCANDALE DU DR IMERY<br />
En 1795, le Dr Marcos Imeria ou Imery, mé<strong>de</strong>cin ir<strong>la</strong>ndais, fut mis en prison pour<br />
« fautes graves ». Marcos Imeria habitait à San Miguel, et y fut emprisonné par ordre du<br />
capitaine général Domás y Valle. Le maire du vil<strong>la</strong>ge respecta tout <strong>de</strong> suite l’ordre et incrimina<br />
le professeur <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine Imery, qui déc<strong>la</strong>ra être catholique, originaire d’Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong>,<br />
et ignorer complètement les causes <strong>de</strong> son emprisonnement. Il sut qu’il avait été<br />
victime <strong>de</strong> calomnie, d’infidélité inventée par un <strong>de</strong> ses clients, ce qui était très fréquent<br />
dans <strong>la</strong> profession.<br />
Il était très ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et ne pouvait pas abandonner ses clients ; <strong>la</strong> liberté sous caution<br />
ou l’assignation à rési<strong>de</strong>nce étant donc nécessaires.<br />
259
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
260<br />
Le maire Becerril sollicita un rapport médical, préparé par le mé<strong>de</strong>cin Juan Santos<br />
Antequera, qui reconnut <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die d’Imery. En mai 1796, Imery fut transféré chez lui.<br />
La nouvelle <strong>de</strong> son emprisonnement se répandit rapi<strong>de</strong>ment dans toute <strong>la</strong> province : elle<br />
fut accueillie avec un mécontentement général car tout le peuple bénéficiait <strong>de</strong> ses services<br />
médicaux et encourrait <strong>la</strong> mort si le secours <strong>de</strong> l’éminent professeur ir<strong>la</strong>ndais venait<br />
à faire défaut. La municipalité reprocha vigoureusement l’emprisonnement d’Imery et<br />
<strong>de</strong>manda qu’il ne fût pas envoyé au Guatema<strong>la</strong> ; sa présence était indispensable dans une<br />
ville où personne n’exerçait l’humble métier <strong>de</strong> saigneur. Le prêtre García Ramos s’unit<br />
aux protestations et annonça qu’il suivrait Imery n’importe où, car il souffrait d’une<br />
grave affection considérablement améliorée grâce aux remarquables soins du mé<strong>de</strong>cin.<br />
La municipalité considéra le cas extrêmement grave pour <strong>la</strong> santé publique. Toute <strong>la</strong><br />
province <strong>de</strong> San Miguel était infestée du mal vénérien, qui évoluait vers <strong>de</strong>s formes malignes<br />
à cause du climat. Le mal fut si grave qu’on ne voyait que <strong>de</strong>s « hommes à p<strong>la</strong>ies »<br />
dans les rues. La maison du mé<strong>de</strong>cin Imery était un véritable hôpital <strong>de</strong> vénériens. Le<br />
malheur et <strong>la</strong> mort se rueraient sur le peuple si on le <strong>la</strong>issait sans assistance médicale.<br />
La peste luétique avantagea Dom Marcos Imery, dans tous les sens : elle lui procura liberté<br />
et grands bénéfices. Les voisins souffrant <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ies eurent plus d’influence que <strong>la</strong><br />
justice accusatrice ; les rapports erronés du voisin Lorenzo Moreno adressés à Domás y<br />
Valle ne servirent à rien. Ce voisin rendait compte dans une note accusatrice <strong>de</strong>s fautes<br />
d’Imery, un empiriste sans conscience, qui ne guérissait personne et exploitait tout le<br />
mon<strong>de</strong>. Malgré tout, le chirurgien et mé<strong>de</strong>cin ir<strong>la</strong>ndais Marcos Imery continua <strong>de</strong> soigner<br />
les syphilitiques. Le gouvernement du Guatema<strong>la</strong> oublia toutes les circonstances du procès.<br />
Imery, riche, estimé, libre <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis, entreprit alors son voyage à León dans l’espoir<br />
d’y trouver une nouvelle clientèle, <strong>de</strong> nouvelles lues (autre dénomination <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
syphilis) et <strong>de</strong> nouvelles monnaies 29, 30 .<br />
La <strong>de</strong>rmatologie popu<strong>la</strong>ire<br />
MÉDICAMENTS À EMPLOI LOCAL<br />
Le très ancien « onguent du soldat » également connu comme « onguent napolitain »,<br />
à base <strong>de</strong> mercure simple (1 once), <strong>de</strong> graisse <strong>de</strong> porc (15 onces) et <strong>de</strong> noir <strong>de</strong> fumée pour<br />
colorer, était prescrit pour le traitement local <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis ou mal gaulois. L’« huile grise »<br />
à base <strong>de</strong> mercure purifié (40 g), <strong>de</strong> graisse <strong>de</strong> <strong>la</strong>ine (26 g) et d’huile <strong>de</strong> vaseline (60 g)<br />
à usage intramuscu<strong>la</strong>ire — formule qui fut plus tard remp<strong>la</strong>cée par le biyodure <strong>de</strong> mercure<br />
à 1 % administré par voie orale —, <strong>la</strong> « solution <strong>de</strong> Van Swieten » ou les pilules <strong>de</strong><br />
Ricord étaient <strong>de</strong>s médicaments antiluétiques.<br />
Des pomma<strong>de</strong>s antiseptiques étaient employées contre <strong>la</strong> pyo<strong>de</strong>rmite :<br />
- <strong>la</strong> « pomma<strong>de</strong> jaune », à base d’oxy<strong>de</strong> jaune <strong>de</strong> mercure (2 g), d’oxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> zinc (5 g),<br />
<strong>de</strong> résorcine et d’aci<strong>de</strong> salicylique (5 g), <strong>de</strong> baume du Pérou (6 g) et <strong>de</strong> beurre (35 g),<br />
- <strong>la</strong> « pomma<strong>de</strong> <strong>de</strong> Reclus » avec <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> phénique et salicylique (1 g), <strong>de</strong> <strong>la</strong> résorcine<br />
(2 g), du camphre pilé et <strong>de</strong> l’antipirine (5 g), du baume du Pérou (6 g) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vaseline<br />
<strong>de</strong> Chesebrough (81 g),<br />
- <strong>la</strong> « pomma<strong>de</strong> <strong>de</strong> Whitfield », préparée avec <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong> salicylique (2 g), <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong><br />
benzoïque (4 g) et du beurre (24 g), formule également employée pour les mycoses superficielles.<br />
La pomma<strong>de</strong> à précipité b<strong>la</strong>nc, composée <strong>de</strong> protochlorure <strong>de</strong> mercure, et <strong>la</strong> « pomma<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> régent », avec <strong>de</strong> l’oxy<strong>de</strong> rouge <strong>de</strong> mercure, <strong>de</strong> l’acétate <strong>de</strong> plomb (10 g) et <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> graisse <strong>de</strong> porc (120 g), étaient également employées pour le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> gale et<br />
d’autres parasitoses.<br />
La « pomma<strong>de</strong> rouge », vulgairement appelée colorada, fabriquée avec du tartare<br />
émétique (3 g), <strong>de</strong> l’oxy<strong>de</strong> rouge <strong>de</strong> mercure (1 g) et du beurre (30 g), fut employée pour<br />
traiter l’oreille du chiclero ou leishmaniose <strong>américaine</strong> avec <strong>de</strong>s résultats probants.
La « pomma<strong>de</strong> Chaulmoogra », conçue avec <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> chaulmoogra (85 g), du<br />
soufre <strong>la</strong>vé (5 g), du camphre (5 g) et du brai <strong>de</strong> Norvège (5 g), était utilisée pour le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et comme antiprurigineux ; plus tard, une nouvelle formule <strong>de</strong> cette<br />
pomma<strong>de</strong> contenant du menthol (1 g), du camphre et <strong>de</strong> l’hydrate <strong>de</strong> chloral (5 g), <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>noline (35 g), <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> coco (50 g), un excipient ayant subi <strong>de</strong>s modifications favorables<br />
au cours <strong>de</strong>s années, servit d’antiprurigineux.<br />
Les bains d’immersion, les eaux, les solutions et les compresses humi<strong>de</strong>s, les savons,<br />
les emplâtres et les crèmes étaient les traitements re<strong>la</strong>tivement inoffensifs les plus employés.<br />
Les plus popu<strong>la</strong>ires au cours <strong>de</strong>s diverses époques étaient : les solutions ou eaux<br />
<strong>de</strong> fleurs <strong>de</strong> tilleul, <strong>de</strong> camomille, <strong>de</strong> feuilles <strong>de</strong> palo jiote, <strong>de</strong> pito et <strong>de</strong> chipilin, pour traiter<br />
les eczémas ; <strong>de</strong> ca<strong>la</strong>gua<strong>la</strong> pour guérir le psoriasis et <strong>la</strong> syphilis ; <strong>de</strong> comméline pour<br />
les morsures <strong>de</strong> serpent et les blessures provoquées par <strong>de</strong>s flèches ou <strong>de</strong>s épées ; <strong>la</strong> cuisson<br />
<strong>de</strong> l’herbe cancer, pour le suintement ; le jus du fruit <strong>de</strong> l’anone tout seul ou mé<strong>la</strong>ngé<br />
à <strong>de</strong> <strong>la</strong> banane, pour traiter <strong>la</strong> blennorragie ; du vinaigre c<strong>la</strong>ir, du camphre et <strong>de</strong> l’eau <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>urier cerisier (10 g) plus <strong>de</strong> l’huile d’olive (50 g) comme antiprurigineux ; l’eau d’Alibour,<br />
avec du sulfate <strong>de</strong> cuivre et <strong>de</strong> zinc dans 300 ml d’eau <strong>de</strong> camphre pour son action<br />
antiseptique et microbici<strong>de</strong> ; <strong>la</strong> liqueur <strong>de</strong> <strong>la</strong>barraque avec <strong>de</strong> l’hypochlorite <strong>de</strong> sou<strong>de</strong> ;<br />
l’eau b<strong>la</strong>nche avec du subacétate <strong>de</strong> plomb ; et l’eau <strong>de</strong> cuisson <strong>de</strong> <strong>la</strong> quinquina, connue<br />
aussi comme solution astringente ; le « baume du comman<strong>de</strong>ur » comme cicatrisant <strong>de</strong>s<br />
blessures <strong>de</strong> guerre; le baume du Pérou en onguent, pour décongestionner, et le « baume<br />
tranquille » comme calmant et émollient. L’emplâtre <strong>de</strong> moutar<strong>de</strong> noire <strong>de</strong> Zacapa, toute<br />
seule ou mé<strong>la</strong>ngée à du poivre rouge <strong>de</strong> Palín, était d’un usage popu<strong>la</strong>ire pour son action<br />
thérapeutique rubéfiante et excitante.<br />
Avec le temps, ces médicaments furent progressivement remp<strong>la</strong>cés par d’autres produits<br />
moins agressifs et présentant <strong>de</strong>s réactions col<strong>la</strong>térales rares: <strong>la</strong> solution citophylique et cicatrisante,<br />
constituée <strong>de</strong> chlorure <strong>de</strong> magnésium sec (12, 10 g), <strong>de</strong> chlorure <strong>de</strong> magnésium<br />
cristallisé (25, 85 g) dans 1000 cm 3 d’eau ou d’« eau ictiolée » à 10 %, qui possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s propriétés<br />
décongestives dans le traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatites schématisées et <strong>de</strong> <strong>la</strong> lymphangite;<br />
les « solutions <strong>de</strong> Dakin » avec du carbonate <strong>de</strong> sodium (15 g), une solution alcaline d’hypochlorite<br />
<strong>de</strong> sodium (750 cm 3 ) et <strong>de</strong> l’eau distillée (csp 1000 cm 3 ); <strong>la</strong> « solution <strong>de</strong> Burrows<br />
», avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> pierre d’alun <strong>de</strong> 1 g, du subacétate <strong>de</strong> plomb (5 g) et <strong>de</strong> l’eau (100 cm 3 ),<br />
ainsi que <strong>la</strong> solution <strong>de</strong> nitrate d’argent à 1 au 10 % ou <strong>de</strong> Co<strong>la</strong>rgol (argent colloïdal) à 10 %;<br />
certaines solutions s’emploient toujours. Le glycérolé d’amidon, seul ou comme excipient<br />
pour d’autres médicaments, comme le glycérolé tartrique ou « cadique », <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> genévrier<br />
(15 g), <strong>de</strong> l’extrait <strong>de</strong> Panamá csp. glycérolé d’amidon (85 g) et essence <strong>de</strong> clous csp.<br />
prescrite pour traiter le psoriasis; le glycérolé <strong>de</strong> stéarates ou dia<strong>de</strong>rmie pour <strong>la</strong> xérose disséminée<br />
<strong>de</strong>s vieil<strong>la</strong>rds ou pour les blessures atoniques; <strong>la</strong> « poudre grasse » avec du talc<br />
(80 g), du stéarate <strong>de</strong> magnésie et <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> coco (10 g); <strong>la</strong> pomma<strong>de</strong> <strong>de</strong> Co<strong>la</strong>rgol à 10 %<br />
et l’huile sans aldéhy<strong>de</strong>s à 15 % comme cicatrisant. La « pomma<strong>de</strong> savonneuse », fabriquée<br />
avec du savon amygdalin et <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse <strong>de</strong> porc (110 g), du soufre sublimée (4 g), <strong>de</strong> l’aci<strong>de</strong><br />
salicylique (1 g), <strong>de</strong> l’huile d’aman<strong>de</strong>s (20 g) et <strong>de</strong> l’essence <strong>de</strong> géranium (4 gouttes), était<br />
employée pour ses propriétés kératolitiques et antiseptiques.<br />
Dans les cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatomycoses, on conseil<strong>la</strong>it <strong>la</strong> teinture d’io<strong>de</strong> pure ou mé<strong>la</strong>ngée<br />
avec <strong>de</strong> l’acétone à 2 %, du chloroforme à 6 %, du thymol camphré à 5 % ou avec du<br />
gaïacol cristallisé (50 g), dans <strong>de</strong> l’huile d’olive et du beurre (25 g) 32, 33 .<br />
La magie en <strong>de</strong>rmatologie. Les guérisseurs<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Un chamán est le sorcier <strong>de</strong>s sorciers. Il travaille les sept puissances qui vont <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
magie b<strong>la</strong>nche à <strong>la</strong> magie noire. La magie noire s’exerce sur une personne qui a été blessée<br />
et que les mé<strong>de</strong>cins ne peuvent plus rien faire pour elle. Le chaman est le <strong>de</strong>rnier recours.<br />
Les cérémonies ont lieu <strong>la</strong> nuit dans <strong>de</strong>s cimetières, <strong>de</strong>s grottes ou sous <strong>de</strong>s ponts,<br />
261
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
262<br />
là où, selon les chamans, il est habituel <strong>de</strong> voir <strong>la</strong> mort et Satan. L’existence <strong>de</strong> chamans,<br />
<strong>de</strong> sorciers, <strong>de</strong> zajorines et <strong>de</strong> guérisseurs fait partie <strong>de</strong> l’histoire et <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture du Guatema<strong>la</strong>.<br />
Certains pensent que ces personnages ne sont que <strong>de</strong>s char<strong>la</strong>tans qui profitent<br />
<strong>de</strong>s crédules, tandis que d’autres croient qu’ils représentent une chance <strong>de</strong> trouver une<br />
solution à leurs problèmes quotidiens. Les religieux sont les plus radicaux : ils condamnent<br />
ces pratiques qu’ils considèrent sataniques. Les sorciers ou chamans sont sept au<br />
total, répartis dans tout le pays à Samayac, San Lucas Toliman, Zunil, Quetzaltenango,<br />
San Jorge, La Laguna et San Andrés Itzapa.<br />
Il était possible d’affronter <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> diverses manières. Voici les particu<strong>la</strong>rités<br />
<strong>de</strong>s principaux acteurs :<br />
• Naturopathes. Appelés N.D., ils possè<strong>de</strong>nt un niveau intermédiaire, technique ou<br />
supérieur, trois années d’étu<strong>de</strong>s systématisées ou plus.<br />
• Allopathes empiriques. Ayant fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s académiques systématisées mais<br />
n’ayant pas obtenu un diplôme.<br />
• Naturalistes. Sans niveau académique, avec un <strong>de</strong>gré d’étu<strong>de</strong>s primaires.<br />
• Guérisseurs <strong>de</strong> famille. Parfois sans niveau <strong>de</strong> sco<strong>la</strong>rité ; apprentissage obtenu simplement<br />
par communication traditionnelle.<br />
• Guérisseurs ambu<strong>la</strong>nts sporadiques, avec ou sans étu<strong>de</strong>s. Ils vont et ils viennent<br />
dans les rues, les parcs et les autobus, annonçant <strong>de</strong>s miracles et <strong>de</strong>s onguents magiques.<br />
• Mé<strong>de</strong>cins traditionnels communautaires. Médiums, sorciers, chamans, sans niveau<br />
académique. Leur formation est le résultat d’une transmission orale. Malgré le<br />
grand nombre <strong>de</strong> char<strong>la</strong>tans, il existe <strong>de</strong>s personnages dont les aptitu<strong>de</strong>s sont exceptionnelles.<br />
• Autopopu<strong>la</strong>tion. Étu<strong>de</strong>s variables avec formes d’automédication multiples.<br />
Les « actions occultes » sont variées et dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du patient. Premièrement,<br />
il faut choisir l’endroit où <strong>la</strong> cérémonie aura lieu ; on cherche ensuite les instruments<br />
utilisés pendant le rituel : <strong>de</strong>s herbes, <strong>de</strong>s chan<strong>de</strong>lles, <strong>de</strong> l’encens ou <strong>de</strong>s animaux<br />
(crapauds, couleuvres, poules et chats).<br />
Si une personne fait par exemple du mal à quelqu’un par une action occulte, il faut<br />
alors trouver dans <strong>la</strong> boule <strong>de</strong> cristal ou dans les cartes <strong>de</strong> tarot ce qui fut entrepris afin<br />
<strong>de</strong> pouvoir accomplir un travail supérieur et parvenir à <strong>la</strong> guérison. Si le mal fut commis<br />
avec un crapaud, il faut se servir d’un animal supérieur, comme le serpent, car celui-ci<br />
mange le crapaud. Selon le chaman, les crapauds servent à guérir ou à faire du mal. On<br />
raconte que plusieurs personnes dont le visage, les paupières et <strong>la</strong> bouche gonf<strong>la</strong>ient,<br />
souffraient d’une action occulte commise avec un crapaud. On coud pour ce<strong>la</strong> à l’ai<strong>de</strong><br />
d’un fil certaines parties <strong>de</strong> l’animal, comme <strong>la</strong> bouche, les mains, le foie ou les pattes ;<br />
on appelle ce<strong>la</strong> amarres. Chaque animal a une fonction spécifique, et il faut d’abord <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
<strong>la</strong> permission à son esprit pour les utiliser.<br />
Le chaman, ou sorcier, est très respecté dans les communautés indigènes car on<br />
considère qu’il a le pouvoir non seulement <strong>de</strong> guérir les ma<strong>la</strong>dies mais aussi <strong>de</strong> les provoquer<br />
; on appelle ce<strong>la</strong> vulgairement ensorceler, chimancar ou faire du mal. Lorsqu’une<br />
personne est ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, on appelle le chaman pour qu’il examine un patient et pratique <strong>la</strong><br />
première opération, appelée copaleada. La copaleada se développe comme suit : le chaman<br />
jette dans un pot un peu <strong>de</strong> capatl (gomme-résine extraite d’un arbre, <strong>de</strong> couleur<br />
noire et à l’o<strong>de</strong>ur agréable) ; il choisit au préa<strong>la</strong>ble le paon le plus gros qui appartient au<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et lui perce ensuite une veine située sous les ailes ; il recueille le sang et le verse<br />
dans le pot, en le mé<strong>la</strong>ngeant au capatl; lorsque celui-ci est bien mé<strong>la</strong>ngé au sang, le<br />
chaman le jette au feu, ce qui provoque une colonne <strong>de</strong> fumée s’élevant jusqu’au p<strong>la</strong>fond<br />
<strong>de</strong> l’habitation, avec une gran<strong>de</strong> régu<strong>la</strong>rité, et produisant un remarquable effet visuel.<br />
Selon les croyances, cette colonne <strong>de</strong> fumée est une forme <strong>de</strong> correspondance privée<br />
entre le chaman et le ciel : elle atteint le ciel pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à Dieu <strong>de</strong> rendre <strong>la</strong> santé<br />
au ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. Mais comme saint Pierre n’a pas le temps <strong>de</strong> s’en occuper, voyons comment
le chaman prépare sa réponse, et comment il trompe sa clientèle. Une fois le capatl<br />
consumé, le chaman se retire sur <strong>la</strong> colline pour attendre <strong>la</strong> réponse ; c’est là qu’a lieu<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième opération, celle <strong>de</strong>s pilolles. Il s’agit <strong>de</strong> petits fruits qui tombent <strong>de</strong> certains<br />
arbres au début <strong>de</strong> l’hiver, et dont <strong>la</strong> forme ressemble à celle <strong>de</strong>s haricots noirs<br />
mais ap<strong>la</strong>tie aux extrémités et d’une très belle couleur rouge. Une fois sur <strong>la</strong> colline, il<br />
étend un morceau <strong>de</strong> toile ou <strong>de</strong> tissu par terre, retire plusieurs poignées <strong>de</strong> pilolles<br />
d’une casserole, en les espaçant à intervalles réguliers, et se met à les compter : si le<br />
résultat est impair dans toutes les poignées, ou bien dans <strong>la</strong> plupart d’entre elles, le<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong> meurt ; par contre, si le résultat est un nombre pair, le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> guérit 29, 30, 31 . ■<br />
Remerciements<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Guatema<strong>la</strong><br />
Septembre 2005<br />
M. Enrique Matheu Recinos, vice-ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture du gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
du Guatema<strong>la</strong>.<br />
M. Fernando Moscoso, directeur du musée national d’archéologie et d’ethnologie du<br />
Guatema<strong>la</strong>.<br />
M. Rodolfo Yaquian, restaurateur <strong>de</strong> biens immobiliers au musée national d’archéologie<br />
et d’ethnologie du Guatema<strong>la</strong>.<br />
Dr Jorge Prado, ville <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>.<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Blom F. La vida <strong>de</strong> los mayas.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Ministerio <strong>de</strong><br />
Educación; 1951.<br />
2. Carmack R. Historia social <strong>de</strong> los<br />
quichés. Guatema<strong>la</strong>: José <strong>de</strong><br />
Pineda Ibarra; 1979.<br />
3. Figueroa Marroquín H.<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
conquistadores. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Editorial Universitaria, 1983.<br />
4. Martínez Durán C. Las ciencias<br />
médicas en Guatema<strong>la</strong>, 3 e éd.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Editorial<br />
Universitaria; 1964.<br />
5. Orel<strong>la</strong>na S. « Medicina<br />
prehispánica. » Dans: AAVV,<br />
Historia general <strong>de</strong><br />
Guatema<strong>la</strong>. Tomo I. Época<br />
precolombina. Asociación <strong>de</strong><br />
Amigos <strong>de</strong>l País; 1999.<br />
6. Recinos A. traductor. Memorial<br />
<strong>de</strong> Sololá. Anales <strong>de</strong> los<br />
cakchikeles, título <strong>de</strong> los<br />
señores <strong>de</strong> Totonicapán. Piedra<br />
Santa; 1950.<br />
7. Recinos A. Pedro <strong>de</strong> Alvarado.<br />
Conquistador <strong>de</strong> México y<br />
Guatema<strong>la</strong>. 2 e éd. Guatema<strong>la</strong>:<br />
José <strong>de</strong> Pineda Ibarra; 1986.<br />
8. Sifontes F.P. Los cakchiqueles en<br />
<strong>la</strong> conquista <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>.<br />
Guatema<strong>la</strong>: José <strong>de</strong> Pineda<br />
Ibarra; 1986.<br />
9. Sifontes F.P. Historia <strong>de</strong><br />
Guatema<strong>la</strong>. 2 e éd. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Ever Gráficas; 1991.<br />
10. Ximénez F.F. Popol Vuh.<br />
Antiguas historias <strong>de</strong> los indios<br />
quichés <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong>. 12 e éd.<br />
México: Porma; 1978.<br />
11. Asturias F. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en Guatema<strong>la</strong>.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Editorial<br />
Universitaria; 1959.<br />
12. Martínez Durán C. Las ciencias<br />
médicas en Guatema<strong>la</strong>, origen<br />
y evolución. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Editorial Universitaria; 1941.<br />
13. F<strong>la</strong>menco J. La beneficencia en<br />
Guatema<strong>la</strong>, reseña histórica.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Tipografía<br />
Nacional; 1915.<br />
14. Bernhard C. Apuntes para <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong>l Hospital Militar<br />
Central en su centenario<br />
1880-1980. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Editorial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong>l<br />
Ejército; 1980 : 1-138.<br />
15. Cor<strong>de</strong>ro F.A. Manual <strong>de</strong><br />
Dermatología. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Unión Tipográfica; 1961.<br />
16. Cor<strong>de</strong>ro F., Mansil<strong>la</strong> C. La<br />
Dermatología en Guatema<strong>la</strong>.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Editorial Cultural<br />
Centroamericana; 1980.<br />
263
E. SILVA-LIZAMA, P.H. URQUIZU, P. GREENBERG, S. DE LEÓN<br />
17. Vásquez R. « Eduardo Tschen<br />
(1913-1994). » Int. J.<br />
Dermatol. 1994; (33)10:748.<br />
18. Tschen E. « Cómo nació <strong>la</strong><br />
Unidad <strong>de</strong> Dermatología <strong>de</strong>l<br />
Hospital Roosevelt. » Gac.<br />
Guat. Dermat. 1991; 2 : 1.<br />
19. Muñoz R. « Seguridad Social:<br />
historia <strong>de</strong> Guatema<strong>la</strong> en el<br />
segundo cuarto siglo hacia <strong>la</strong><br />
revolución <strong>de</strong>l 20 <strong>de</strong> octubre<br />
<strong>de</strong> 1944. » Rev. Polimédica.<br />
1995; 4 : 3-10.<br />
20. Muñoz R. « Seguridad Social.<br />
Enfoque histórico. » Rev.<br />
Polimédica. 1995; 1 : 3-7.<br />
21. Muñoz R. « Seguridad Social.<br />
Enfoque histórico. » Rev.<br />
Polimédica. 1996; 5 : 3-12.<br />
22. Muñoz R. « Seguridad Social.<br />
Enfoque histórico. » Rev.<br />
Polimédica. 1995; 2 : 3-7.<br />
23. Muñoz R. « Seguridad Social.<br />
Enfoque histórico. » Rev.<br />
Polimédica. 1994; 1 : 2-6.<br />
24. Muñoz R. « Seguridad Social.<br />
Enfoque histórico. » Rev.<br />
Polimédica. 1996; 2 : 3-7.<br />
25. Fortín G. « Toke<strong>la</strong>u, su historia.<br />
Rev. Polimédica. 1995; 2 : 7-8.<br />
26. Silva Martínez E. « Estado<br />
actual <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en<br />
Guatema<strong>la</strong>. » Acta Leprol.<br />
Revue éditée par l’ordre<br />
souverain et militaire <strong>de</strong><br />
Malte. France. 1966; 26 : 22-<br />
30.<br />
27. Silva-Lizama E. « History of<br />
Dermatology in Guatema<strong>la</strong>. »<br />
Int. J. Dermatol. 2000; 39(4) :<br />
305-311.<br />
28. Asturias F. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en Guatema<strong>la</strong>.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Editorial<br />
Universitaria; 1959.<br />
29. Martínez Durán C. Las ciencias<br />
médicas en Guatema<strong>la</strong>, origen<br />
y evolución. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Editorial Universitaria; 1941.<br />
30. F<strong>la</strong>menco J. La beneficencia en<br />
Guatema<strong>la</strong>. Reseña histórica.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Tipografía<br />
Nacional; 1915.<br />
31. Bernhard C. Apuntes para <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong>l Hospital Militar<br />
Central en su centenario<br />
1880-1980. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Editorial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Escue<strong>la</strong> <strong>de</strong>l<br />
Ejército. 1980 : 1-138.<br />
32. Cor<strong>de</strong>ro F.A. Manual <strong>de</strong><br />
Dermatología. Guatema<strong>la</strong>:<br />
Unión Tipográfica; 1961.<br />
33. Cor<strong>de</strong>ro F., Mansil<strong>la</strong> C. La<br />
Dermatología en Guatema<strong>la</strong>.<br />
Guatema<strong>la</strong>: Editorial Cultural<br />
Centroamericana; 1980.
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
AU MEXIQUE<br />
Le Mexique occupe <strong>la</strong> partie centrale<br />
du continent américain ; du point <strong>de</strong> vue<br />
géographique, le pays fait partie <strong>de</strong><br />
l’Amérique du Nord, et du point <strong>de</strong> vue<br />
historique et social, il appartient à l’Amérique<br />
<strong>la</strong>tine. La civilisation méso<strong>américaine</strong><br />
surgit et se développa sur le<br />
territoire actuel du Mexique. À leur arrivée<br />
au début du XVI e siècle, les Espagnols<br />
furent surpris par <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> peuples<br />
indigènes qui possédaient une civilisation<br />
forte, une structure politico-sociale bien définie et un patrimoine important <strong>de</strong> connaissances<br />
en différents domaines, y compris <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine (figure 1).<br />
Époque préhispanique ou précolombienne<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
GILBERTO ADAME MIRANDA, MARÍA ISABEL ARIAS GÓMEZ,<br />
ROBERTO ARENAS, PABLO CAMPOS MACÍAS, LEÓN NEUMANN SCHEFFER,<br />
YOLANDA ORTIZ, RAMÓN RUIZ MALDONADO, AMADO SAÚL<br />
■ Époque préhispanique ou précolombienne<br />
Comme pour tous les peuples primitifs, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène se confondait avec <strong>la</strong><br />
magie et <strong>la</strong> connaissance avec <strong>la</strong> superstition. Le prêtre et le sorcier étaient les seuls à<br />
lutter contre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, le premier calmant <strong>la</strong> colère <strong>de</strong>s dieux et le <strong>de</strong>uxième conjurant<br />
l’action <strong>de</strong>s astres et <strong>de</strong>s esprits malins 1 . Les peuples mésoaméricains avaient appris à<br />
différencier les ma<strong>la</strong>dies, les i<strong>de</strong>ntifiant par <strong>de</strong>s noms spécifiques, et ils connaissaient différentes<br />
procédures thérapeutiques. La botanique était un domaine très développé ;<br />
l’herboristerie apporta énormément à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine européenne (figure 2). Ignacio Chávez<br />
signale : « Jamais <strong>la</strong> pharmacologie ne bénéficia — ni ne bénéficiera à l’avenir —<br />
d’une contribution aussi gran<strong>de</strong>, aussi riche et aussi irremp<strong>la</strong>çable que celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> flore<br />
265<br />
Figure 1.<br />
Mé<strong>de</strong>cin indigène<br />
pratiquant<br />
l’herboristerie.<br />
Mural <strong>de</strong> l’Institut<br />
national <strong>de</strong><br />
cardiologie
Figure 2.<br />
Application <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ntes<br />
médicinales au<br />
moyen <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>vements<br />
Figure 3.<br />
Co<strong>de</strong>x<br />
Magliabechiano.<br />
Ingestion <strong>de</strong><br />
champignons<br />
enthéogènes.<br />
Derrière l’indigène<br />
qui les ingère<br />
apparaît le dieu<br />
Mict<strong>la</strong>ntecuhtli<br />
ADAME, ARIAS, ARENAS, CAMPOS, NEUMANN, ORTIZ, RUIZ MALDONADO, SAÚL<br />
266<br />
<strong>américaine</strong> à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine européenne du XVI e siècle. Il faudrait<br />
découvrir un nouveau mon<strong>de</strong> pour que le mon<strong>de</strong> actuel<br />
puisse recevoir un apport aussi grand qu’à cette<br />
époque 1 .»<br />
Dans <strong>la</strong> pratique médicale, certains personnages étaient<br />
<strong>de</strong>s spécialistes en saignées ; d’autres s’occupaient <strong>de</strong>s interventions<br />
chirurgicales, comme recoudre <strong>de</strong>s blessures,<br />
drainer <strong>de</strong>s abcès, réduire <strong>de</strong>s luxations, se servir <strong>de</strong> coapteurs<br />
pour soigner <strong>de</strong>s fractures, é<strong>la</strong>borer <strong>de</strong>s férules et<br />
<strong>de</strong>s bandages, effectuer <strong>de</strong>s trépanations crâniennes ; ces<br />
procédures étaient fréquemment réalisées sous l’action <strong>de</strong><br />
drogues hallucinogènes (figure 3), bien i<strong>de</strong>ntifiées par les<br />
indigènes, afin d’atténuer <strong>la</strong> douleur. Dans le domaine <strong>de</strong><br />
l’obstétrique, on faisait un suivi adéquat <strong>de</strong> <strong>la</strong> grossesse,<br />
pratiquant <strong>de</strong>s versions par manœuvres externes (VME) et<br />
<strong>de</strong>s embryotomies si nécessaire 1, 2 .<br />
Pour les différentes cultures méso<strong>américaine</strong>s, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
était <strong>la</strong> conséquence du châtiment ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> vengeance<br />
<strong>de</strong>s dieux ; ou alors elle était causée par certains phénomènes<br />
naturels (comètes, éclipses). En conséquence, le<br />
traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s incluait <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s aux dieux,<br />
<strong>de</strong>s sacrifices humains et <strong>de</strong>s invocations <strong>de</strong>s astres 3 .<br />
Dermatologie<br />
À cette époque, les ma<strong>la</strong>dies cutanées étaient déjà connues et traitées. Parmi les<br />
dieux mexicas ou aztèques, Xipe-Totec, « notre seigneur écorché », était <strong>la</strong> divinité tuté<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine ; il <strong>de</strong>scendait <strong>de</strong> Tzapotlán, le dieu du printemps, <strong>de</strong>s fleurs et <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies cutanées, dont <strong>la</strong> vengeance consistait à envoyer sur les hommes <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
comme le mauvais œil, <strong>la</strong> gale et l’apostème 4 .<br />
En <strong>la</strong>ngue nahuatl, <strong>la</strong> peau s’appe<strong>la</strong>it euatl ou ehuatl, <strong>de</strong> <strong>la</strong> racine yotl signifiant<br />
« vie » (co<strong>de</strong>x Cruz-Badiano). En maya, <strong>la</strong> peau s’appelle box, kukultik, k’ewel et sol. Box<br />
est l’écorce ou <strong>la</strong> peau dure <strong>de</strong> certains fruits comme <strong>la</strong> jícara; kukultik est <strong>la</strong> peau humaine<br />
; k´ewel est le cuir ou <strong>la</strong> peau écorchée, tanné ou à tanner, <strong>de</strong>s animaux ; sol est <strong>la</strong><br />
croûte <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ie ou <strong>la</strong> gale, le cuir <strong>de</strong> <strong>la</strong> couleuvre ou du petit lézard, l’écaille du poisson<br />
et l’écorce <strong>de</strong> l’arbre 5 .<br />
L’érudit Alfredo López Austin trouve dans les co<strong>de</strong>x Matritense et Florentino les dénominations<br />
assignées aux différentes régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau en <strong>la</strong>ngue nahuatl (tableau 1).<br />
Tableau 1. Dénomination <strong>de</strong>s différentes régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau en nahuatl selon les co<strong>de</strong>x Matritense et Florentino<br />
Tehuayo Notre peau<br />
Topanehuayo Notre peau superficielle<br />
Itic paniehuayo Tissu sous-cutané situé<br />
immédiatement sous <strong>la</strong> peau<br />
Cuaehuatl Peau chevelue<br />
Ixehuatl Peau du visage<br />
Quechehuayo Peau du cou<br />
Maehuatl Peau du bras et <strong>de</strong> <strong>la</strong> main<br />
Cemixtli Mapilli Peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> face palmaire <strong>de</strong>s<br />
doigts<br />
Cuit<strong>la</strong>panehuayo Peau du dos<br />
Itiehuatl Peau <strong>de</strong> l’abdomen<br />
Quezehuatl Peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> hanche<br />
Tzintamalehuayo Peau <strong>de</strong>s fesses<br />
Tepulehuayotl Peau du pénis<br />
Xipinehuatl Cuticule du prépuce<br />
T<strong>la</strong>ncuaehuatl Peau du genou<br />
Metzehuatl Peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> jambe<br />
Cotzehuatl Peau du mollet<br />
Xocpalehuatl Peau du pied<br />
Tezcatlipoca, le dieu créateur du ciel et <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre, adversaire <strong>de</strong> Quetzalcóatl, <strong>la</strong> divinité<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à qui on vouait un culte à Texcoco, châtiait les <strong>la</strong>scifs en leur envoyant<br />
les ma<strong>la</strong>dies vénériennes. Parmi les dieux mineurs liés à <strong>la</strong> peau se trouvait
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique<br />
Nanahuatl, le dieu <strong>de</strong>s lépreux. Les Aztèques, en raison <strong>de</strong> leur besoin impérieux <strong>de</strong> soigner<br />
les blessés <strong>de</strong> guerre et avec leurs nombreuses herbes médicinales, avaient développé<br />
un art médico-chirurgical ; ils appliquaient <strong>de</strong>s remè<strong>de</strong>s chauds ou effectuaient <strong>de</strong>s<br />
saignées dans les régions infectées et enf<strong>la</strong>mmées. À l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> bistouris en obsidienne, ils<br />
ouvraient les abcès et les phlegmons pour évacuer le pus ; ils soignaient les ulcères et les<br />
brûlures et recousaient les blessures en utilisant <strong>de</strong>s cheveux en guise <strong>de</strong> fil. Ils faisaient<br />
<strong>de</strong>s sutures à points séparés sur le nez et les lèvres, en se servant <strong>de</strong> cheveux très<br />
propres et en leur appliquant <strong>de</strong>s substances spéciales.<br />
Les indigènes utilisaient les médicaments par voie orale ou appliqués sur <strong>la</strong> peau, et<br />
ils se servaient <strong>de</strong>s bains, <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur ou <strong>de</strong> l’humidité pour leur propriétés thérapeutiques.<br />
Parmi leurs médicaments <strong>de</strong>stinés à soigner les blessures infectées, signalons les<br />
emplâtres à base <strong>de</strong> tortil<strong>la</strong> <strong>de</strong> maïs attaquée par <strong>de</strong>s champignons, dont ils profitaient<br />
<strong>de</strong>s propriétés curatives 4 . Les Aztèques connurent les ma<strong>la</strong>dies vénériennes, qu’ils appelèrent<br />
cihuat<strong>la</strong>ueliloc, « résultant <strong>de</strong>s rapports avec <strong>de</strong>s femmes » ; ils décrivirent aussi<br />
<strong>la</strong> blennorragie, les chancres et les bubons. La syphilis était <strong>la</strong>rgement connue ; elle était<br />
traitée au moment <strong>de</strong> son étape tertiaire avec <strong>de</strong>s bains <strong>de</strong> vapeur (temazcalli). Ils utilisèrent<br />
aussi <strong>la</strong> pyrothérapie et les sels mercuriels (inha<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> vapeurs sulfureuses et<br />
mercurielles), ainsi qu’une bouillie <strong>de</strong> maïs, michihuautli, ou une infusion <strong>de</strong> racines <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>urier-rose, quautepatli 6 .<br />
La <strong>de</strong>rmatose se nommait probablement zahuatl, l’urticaire chincual et le psoriasis xiotl.<br />
Le Popol Vuh <strong>de</strong>s Mayas évoquait <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine magique, les divinités et le concept <strong>de</strong><br />
ma<strong>la</strong>die vue comme un châtiment <strong>de</strong>s dieux, tout comme il citait <strong>de</strong>s guérisons <strong>de</strong>rmatologiques<br />
et quelques chirurgies rituelles 7 . On ne trouva pas parmi ce peuple d’os mettant<br />
en évi<strong>de</strong>nce <strong>la</strong> syphilis. Les femmes p<strong>la</strong>çaient une pierre d’ambre dans un trou fait<br />
dans le nez, dans <strong>la</strong> cloison séparant les fosses nasales, elles se perforaient les oreilles<br />
pour y mettre <strong>de</strong>s boucles d’oreilles et se peignaient le torse <strong>de</strong> <strong>la</strong> ceinture jusqu’au front,<br />
excepté les seins. Les dieux mayas <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine étaient Ixchel, Citboltún et Zamná. Les<br />
<strong>de</strong>ux premiers fondèrent <strong>la</strong> profession <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins ou ahmen, qui signifie « celui qui<br />
comprend ».<br />
Dans l’herboristerie préhispanique, le cacao, grâce à ses propriétés énergétiques,<br />
était très important du point <strong>de</strong> vue médicinal. Dans le rituel maya, l’épi et <strong>la</strong> boisson <strong>de</strong><br />
cacao symbolisaient le cœur et le sang, éléments nécessaires pour conserver l’équilibre<br />
cosmique. Selon <strong>la</strong> mythologie maya, le cacao avait une origine divine : Xmucane, l’un<br />
<strong>de</strong>s dieux créateurs, inventa neuf boissons qui ont alimenté et formé les hommes ; trois<br />
<strong>de</strong> ces boissons étaient é<strong>la</strong>borées à partir du maïs et du cacao. Les Mexicas attribuaient<br />
l’origine mythique du cacao au dieu Quetzalcóatl, qui l’avait apporté sur terre pour le<br />
cultiver dans son jardin divin <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Tu<strong>la</strong> 8 .<br />
Du point <strong>de</strong> vue médicinal, le cacao était employé pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s souffrant du foie,<br />
les phtisiques et les personnes souffrant d’épuisement. En <strong>de</strong>rmatologie on utilisait<br />
l’huile <strong>de</strong> cacao sur les gerçures et les blessures <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Le beurre <strong>de</strong> cacao avait <strong>de</strong>s<br />
applications médicinales et cosmétiques pour le soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Les indigènes centreaméricains<br />
étaient habitués à le mé<strong>la</strong>nger avec du rocou et s’enduisaient le visage afin<br />
d’obtenir une couleur rouge très vive pour leurs fêtes, en pensant que « celui qui s’en<br />
enduit le plus est le plus bel homme » ; en même temps, ce<strong>la</strong> les protégeait du soleil 8 .<br />
L’assimi<strong>la</strong>tion dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine européenne <strong>de</strong> moyens curatifs américains fut extraordinaire.<br />
Parmi les médicaments importés d’Amérique nous trouvons le guayaco, l’ipecacuana,<br />
<strong>la</strong> coca, <strong>la</strong> quinquina, le barbasco, <strong>la</strong> salsepareille, le curare, le mate et le tabac.<br />
Les vaisseaux <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s arrivaient à Séville chargés <strong>de</strong> racines, d’herbes et <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes;<br />
on y créa <strong>de</strong>s jardins botaniques particuliers. Nicolás Monar<strong>de</strong>s se consacra à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
apports médicaux américains, obtenant un succès universel. Dans son ouvrage, Sahagún<br />
consacre une section à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène du Mexique ; le travail <strong>de</strong> Francisco Hernán<strong>de</strong>z,<br />
le premier mé<strong>de</strong>cin à explorer les mé<strong>de</strong>cines d’Amérique, est également notable.<br />
267
ADAME, ARIAS, ARENAS, CAMPOS, NEUMANN, ORTIZ, RUIZ MALDONADO, SAÚL<br />
Thierry <strong>de</strong> Héry écrivit en 1552 un traité — La Métho<strong>de</strong> curative <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die vénérienne<br />
— et fit fortune en traitant <strong>de</strong>s patients syphilitiques à travers l’application topique<br />
<strong>de</strong> l’onguent mercuriel et en leur faisant boire du thé <strong>de</strong> guayaco provenant<br />
d’Amérique 9 .<br />
■ Époque coloniale coloniale<br />
268<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
La Nouvelle Espagne naquit en 1521 avec <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> Tenochtit<strong>la</strong>n, <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> l’empire<br />
aztèque, et finit officiellement en 1821 lorsque Dom Agustín <strong>de</strong> Iturbi<strong>de</strong> déc<strong>la</strong>ra le<br />
pays indépendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> couronne espagnole 10 . Avant l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong><br />
pays n’existait pas ; <strong>la</strong> région qu’occupe actuellement le Mexique était habitée par divers<br />
groupes ethniques répartis sur un vaste territoire (<strong>de</strong>puis les États-Unis jusqu’à l’Amérique<br />
du Sud) et possédant <strong>de</strong>s cultures et <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngues différentes ; ils se faisaient <strong>de</strong>s<br />
guerres continuelles pour affirmer leur suprématie. Le 13 août 1521, Hernán Cortés et<br />
un groupe <strong>de</strong> soldats répartis sur treize brigantins assiégèrent <strong>la</strong> ville <strong>la</strong>custre <strong>de</strong> Tenochtit<strong>la</strong>n<br />
et <strong>la</strong> détruisirent pierre par pierre, remplissant les canaux avec <strong>de</strong>s centaines<br />
<strong>de</strong> cadavres qui <strong>la</strong> rendirent inhabitable pendant longtemps. Les Espagnols furent alors<br />
obligés <strong>de</strong> se réfugier à Coyoacán, une ville voisine. Vingt ans plus tard, <strong>la</strong> nouvelle ville<br />
commença à être tracée selon les p<strong>la</strong>ns <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes européennes et en utilisant les<br />
pierres <strong>de</strong>s temples aztèques. La ville <strong>de</strong>viendrait <strong>la</strong> capitale du royaume <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle<br />
Espagne, tandis que les Espagnols poursuivaient leur aventure vers le nord jusqu’à <strong>la</strong><br />
Californie et le Texas. Ils y apportèrent leur culture, leur <strong>la</strong>ngue et leur religion, mais<br />
aussi <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies comme <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> rougeole ou <strong>la</strong> syphilis 10 . C’est ainsi qu’en moins<br />
<strong>de</strong> cinquante ans après l’arrivée <strong>de</strong>s conquistadors, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène passa <strong>de</strong> 25<br />
à 3 millions d’Indiens, à cause <strong>de</strong> ces épidémies, <strong>de</strong>s guerres et <strong>de</strong>s mauvais traitements.<br />
Lorsqu’ils observaient l’étrange rituel <strong>de</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s traitements médicaux,<br />
une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s Espagnols n’y voyaient que magie et superstition, mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
peuple primitif exempte <strong>de</strong> toute connaissance positive. Ils ne furent pas capables <strong>de</strong> percevoir<br />
<strong>la</strong> valeur <strong>de</strong> leur expérience, <strong>la</strong> richesse <strong>de</strong> leur pharmacologie et <strong>de</strong> leurs tentatives<br />
<strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssification, l’intuition merveilleuse <strong>de</strong>s peuples qui n’ont reçu aucune<br />
influence d’autres races ou civilisations et qui ont dû é<strong>la</strong>borer <strong>la</strong> leur, <strong>de</strong> manière isolée<br />
et lente, se fiant seulement à l’observation ancestrale et à <strong>la</strong> confirmation <strong>de</strong> leurs idées.<br />
Pour imposer <strong>la</strong> religion chrétienne et éradiquer l’hérésie <strong>de</strong>s natifs, le conquistador détruisit<br />
leurs temples, abattit leurs idoles et brû<strong>la</strong> même leurs co<strong>de</strong>x, muti<strong>la</strong>nt leur histoire.<br />
Ainsi fut perdue une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> ce que <strong>la</strong> race indigène avait cumulé<br />
patiemment pendant <strong>de</strong>s siècles 1 .<br />
À peine établis en Nouvelle Espagne, les Espagnols établirent le protomedicato, une<br />
institution <strong>de</strong>stinée à veiller sur <strong>la</strong> bonne pratique médicale et le bon fonctionnement <strong>de</strong>s<br />
apothicaires. Le besoin <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s centres éducatifs pour préparer les habitants <strong>de</strong>s<br />
terres conquises entraîna <strong>la</strong> fondation par ordonnance royale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Real y Pontificia Universidad<br />
<strong>de</strong> México le 21 septembre 1551, qui entra en fonction <strong>de</strong>ux ans plus tard. La<br />
même année (1553), on commença à admettre les premiers mé<strong>de</strong>cins venus dans le pays,<br />
dont le Dr Pedro López. Le manque <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins conduisit simultanément à inclure <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine dans les programmes académiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle université. Les<br />
programmes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, tout comme ceux <strong>de</strong>s universités européennes, comportaient<br />
quatre matières : « prime <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine », « vêpres <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine », « anatomie et chirurgie<br />
» et « métho<strong>de</strong> et pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine », prenant comme principes <strong>de</strong> base les<br />
concepts énoncés par Hippocrate et Galien. Tel que l’affirme Ignacio Chávez, on doit<br />
reconnaître que les sept universités les plus anciennes et les meilleures au mon<strong>de</strong> furent
créées au cours <strong>de</strong>s XV e et XVI e siècles — les siècles dorés <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine espagnole<br />
—, sous l’influence arabe d’Avicenne. Ce fut à <strong>la</strong> même époque que naquit l’université<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle Espagne.<br />
En 1535, les franciscains fondèrent à T<strong>la</strong>telolco le couvent <strong>de</strong> Santiago Apóstol<br />
et le collège <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>de</strong> T<strong>la</strong>telolco ; le co<strong>de</strong>x <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cruz-Badiano, le co<strong>de</strong> médical<br />
le plus ancien d’Amérique, qui reprend les principaux schémas thérapeutiques<br />
<strong>de</strong> l’herboristerie indigène (figure 4), fut écrit à cet endroit vers 1552. Le<br />
savant indien Martín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cruz, originaire <strong>de</strong> Xochimilco, composa le Libellus <strong>de</strong><br />
Medicinalibus Indorum Herbis, un traité très vaste sur les herbes médicinales employées<br />
par les Indiens au XVI e siècle, avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> Juan Badiano qui le<br />
traduisit en <strong>la</strong>tin. La transmission <strong>de</strong> ses connaissances thérapeutiques fut très importante<br />
quatre siècles plus tard. Son livre, probablement rédigé en nahuatl, fut le<br />
premier écrit connu sur <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène mexicaine ; le manuscrit contient <strong>de</strong>s informations<br />
sur 215 p<strong>la</strong>ntes, dont 185 sont illustrées.<br />
En 1558, frère Bernardino <strong>de</strong> Sahagún rédigea son Historia General <strong>de</strong> <strong>la</strong>s cosas <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Nueva España [<strong>Histoire</strong> générale <strong>de</strong>s choses <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nouvelle Espagne], où il décrivait<br />
les us et coutumes <strong>de</strong>s peuples mésoaméricains avant <strong>la</strong> Conquête, et même certaines<br />
formes <strong>de</strong> leur pratique médicale 14 .<br />
Le premier livre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine édité en Amérique fut publié en 1570 : Opera Medicinales,<br />
du Dr Francisco Bravo. En 1577 furent publiés les volumes <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Francisco<br />
Hernán<strong>de</strong>z De Historia P<strong>la</strong>ntorum Novae Hispania.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, commencé à <strong>la</strong> Real y Pontificia Universidad <strong>de</strong> México,<br />
connut beaucoup d’avatars et fut pratiqué dans plusieurs sièges jusqu’à ce qu’il soit finalement<br />
pratiqué dans l’ancien bâtiment <strong>de</strong> l’Inquisition pendant cent ans (<strong>de</strong>puis 1854).<br />
La première académie <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut établie en 1825, tandis qu’en 1862, naquit<br />
celle qui existe actuellement. Son organe <strong>de</strong> diffusion, La Gaceta Médica, publia <strong>de</strong> nombreux<br />
articles sur <strong>la</strong> peau : « Étu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> lèpre », <strong>de</strong> Reyes ; « Psoriasis guéri par le vaccin<br />
», <strong>de</strong> Ban<strong>de</strong>ra ; « Niguas, <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong> ; « Leucopatie achronique », <strong>de</strong> Gayón ; « Corne<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau », <strong>de</strong> Ortega, entre autres.<br />
Dermatologie<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique<br />
Dans le co<strong>de</strong>x Badiano sont mentionnés <strong>de</strong>s mots comme xiotl (urticaire), cou-<strong>de</strong> pied<br />
et autres. On y parle <strong>de</strong> l’achiote, ou piment <strong>de</strong> Tabasco ou bixa orel<strong>la</strong>na pour traiter <strong>la</strong><br />
lèpre 12 . Cet ouvrage, comme nous l’avons déjà signalé, est considéré comme le premier<br />
livre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonie consacré à <strong>la</strong> thérapeutique herboriste ; le texte fait référence<br />
à plusieurs ma<strong>la</strong>dies cutanées et à leurs remè<strong>de</strong>s, présentant <strong>de</strong> magnifiques<br />
illustrations couleur.<br />
Après <strong>la</strong> Conquête, les co<strong>de</strong>x citent <strong>la</strong> variole ou hueyzahuatl, <strong>la</strong> rougeole (tepitonzahuatl)<br />
et le typhus ou tabardillo (mat<strong>la</strong>tzahuatl). Ils mentionnent aussi le nævus ou grain<br />
<strong>de</strong> beauté (t<strong>la</strong>ciuztli) et le prurit (cuecuetzoquiliztli), les papules prurigineuses (tatapaliuiztli),<br />
les taches <strong>de</strong> rousseur (ixticeuac) et <strong>la</strong> pityriasis (quatequizquitl), tout comme <strong>la</strong><br />
tunga ou nigua (qualocatl), <strong>la</strong> gale (ezcazahuatl), <strong>la</strong> teigne (quiayincayotl) et <strong>la</strong> pédiculose<br />
(ixocuili).<br />
Les Mexicas connaissaient <strong>la</strong> pinta. Hernán Cortés écrivit à Charles Quint dans une <strong>de</strong> ses<br />
lettres, avec une gran<strong>de</strong> admiration: « Dans ce pays surprenant, il y a <strong>de</strong>s raretés dans <strong>la</strong><br />
couleur <strong>de</strong>s habitants, un même individu pouvant présenter <strong>de</strong>s différences 4, 13 .»<br />
On débat du fait <strong>de</strong> savoir si <strong>la</strong> lèpre existait en Amérique avant l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols<br />
; <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> petites figures qui semblent représenter un faciès léonin et <strong>de</strong><br />
quelques chroniques par<strong>la</strong>nt d’un hôpital où les Aztèques enfermaient les patients atteints<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre semblent soutenir l’hypothèse <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die aux temps<br />
préhispaniques 16 . Cependant, d’un autre côté, ni Cortés (dans ses lettres à Charles<br />
269<br />
Figure 4.<br />
Co<strong>de</strong>x <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cruz-<br />
Badiano.<br />
T<strong>la</strong>lquequetzal, p<strong>la</strong>nte<br />
utilisée pour <strong>la</strong><br />
« démangeaison ou<br />
tache du visage »
Figure 5.<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’église<br />
annexée au <strong>de</strong>uxième<br />
hôpital <strong>de</strong> San Lázaro<br />
Figure 6.<br />
État <strong>de</strong>s patients<br />
lépreux à l’hôpital <strong>de</strong><br />
San Lázaro<br />
Figure 7.<br />
Dr Ladis<strong>la</strong>o <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Pascua (1815-1891)<br />
ADAME, ARIAS, ARENAS, CAMPOS, NEUMANN, ORTIZ, RUIZ MALDONADO, SAÚL<br />
270<br />
Quint) ni Bernal Díaz <strong>de</strong>l Castillo n’en parlent, même s’il s’agissait d’une ma<strong>la</strong>die<br />
connue <strong>de</strong> beaucoup d’Espagnols venant d’Andalousie, où elle était très endémique ;<br />
en revanche, on parle effectivement <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> pinta et <strong>de</strong> l’albinisme. Reconnaissant<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die parmi ses propres soldats, Cortés établit <strong>la</strong> première léproserie<br />
d’Amérique (hôpital <strong>de</strong> San Lázaro), dans une zone appelée T<strong>la</strong>xpana. Bien que<br />
petit, le bâtiment reçut un bon nombre <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s espagnols ; cependant, <strong>la</strong> léproserie<br />
dura peu (<strong>de</strong> 1521 à 1528), étant donné qu’elle fut fermée à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> Nuño<br />
<strong>de</strong> Guzmán, qui allégua que l’eau venant <strong>de</strong> l’aqueduc <strong>de</strong> Chapultepec passait par là,<br />
risquant <strong>de</strong> contaminer <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Notons que Guzmán s’appropria ces terrains<br />
magnifiques16 .<br />
Les premiers hôpitaux créés par les Espagnols accueillirent certainement <strong>de</strong>s patients<br />
présentant <strong>de</strong>s affections cutanées : les boubas, <strong>la</strong> gale, <strong>la</strong> lèpre, le « feu sacré » (zoster),<br />
le psoriasis, <strong>la</strong> teigne, <strong>la</strong> tuberculose, <strong>la</strong> pinta, étaient <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies qui frappaient <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
indigène. Il est évi<strong>de</strong>nt que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que telle n’existait pas, car<br />
on sait bien qu’elle naquit en Angleterre et en France vers <strong>la</strong> fin du XVIIIe siècle15 .<br />
Deux protomedicos arrivèrent avec<br />
Cortés : Pedro López (1527-1597), dit « le<br />
Vieux », et Cristóbal <strong>de</strong> Ojeda, qui soignèrent<br />
les nombreuses victimes <strong>de</strong>s épidémies<br />
<strong>de</strong> variole et <strong>de</strong> typhus. Le premier<br />
était né à Due<strong>la</strong>s, en Castille, et il arriva<br />
dans <strong>la</strong> très noble et loyale cité <strong>de</strong> Mexico<br />
à l’âge <strong>de</strong> 30 ans. Il fut un <strong>de</strong>s premiers<br />
mé<strong>de</strong>cins à obtenir le doctorat à <strong>la</strong> Real y<br />
Pontificia Universidad <strong>de</strong> México ; il fut un<br />
grand bienfaiteur et fonda <strong>de</strong>ux hôpitaux,<br />
celui <strong>de</strong>s désemparés — qui <strong>de</strong>viendrait avec le temps l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme — et<br />
le <strong>de</strong>uxième hôpital <strong>de</strong> San Lázaro pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. López<br />
entretint <strong>de</strong> ses propres <strong>de</strong>niers ces hôpitaux et après sa mort, en 1597, ses <strong>de</strong>scendants<br />
poursuivirent son œuvre.<br />
Ce <strong>de</strong>uxième hôpital <strong>de</strong> San Lázaro dura trois siècles (1572-1862). Il fut construit au<br />
bord du <strong>la</strong>c <strong>de</strong> Texcoco, à un endroit connu sous le nom <strong>de</strong> Las Atarazanas, l’arsenal où<br />
Cortés garda ses treize brigantins après avoir conquis <strong>la</strong> ville. On ne sait pas exactement<br />
si cet endroit se trouvait rue <strong>de</strong> Ixtapa<strong>la</strong>pa — aujourd’hui Pino Suárez — ou bien en direction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Merced, à l’est <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, dans le quartier baptisé alors San Lázaro. Cet<br />
hôpital dura longtemps et fut démoli alors qu’il tombait déjà en ruines ; seule son église,<br />
15, 16<br />
dédiée à San Roque et démolie plus tard au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité, resta <strong>de</strong>bout<br />
(figure 5). Les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s furent transférés à l’hôpital <strong>de</strong> San Pablo, appelé hôpital Juárez<br />
<strong>de</strong>puis 1872. Cette institution connut une existence hasar<strong>de</strong>use ; gérée par l’ordre <strong>de</strong>s<br />
juaninos, elle manqua toujours <strong>de</strong> médicaments et <strong>de</strong> matériel pour les guérisons, et les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s qui y étaient envoyés végétaient dans <strong>de</strong>s conditions déplorables (figure 6). Les<br />
autorités ne s’intéressèrent jamais à cet hôpital, qui périclita lentement, tout comme les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s qui y séjournaient. Ses directeurs furent <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins importants comme le Dr<br />
Ladis<strong>la</strong>o <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pascua (figure 7) (1833 - 1842) ; au cours <strong>de</strong> sa gestion, 205 ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s furent<br />
admis. De <strong>la</strong> Pascua fut le premier à attirer l’attention sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die appelée<br />
« forme tachée », connue aujourd’hui sous le nom <strong>de</strong> lèpre lépromateuse diffuse <strong>de</strong><br />
Lucio et Latapí ; il publia également le premier article sur <strong>la</strong> lèpre dans le journal <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Sociedad Filoiátrica. De 1843 et jusqu’à sa démolition en 1862, l’hôpital fut dirigé par<br />
le Dr Rafael Lucio, qui compléta les observations du Dr <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pascua sur <strong>la</strong> forme<br />
tachée.
Les premiers hôpitaux<br />
L’Espagne qui conquit l’Amérique était encore imprégnée d’un esprit médiéval, avec<br />
un projet social fondé sur l’esprit <strong>de</strong>s croisa<strong>de</strong>s et un développement pauvre dans le domaine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé. Les gran<strong>de</strong>s épidémies qui secouaient le Vieux Continent imposaient<br />
<strong>la</strong> construction <strong>de</strong> centres hospitaliers dont le fonctionnement correspondait à celui d’auberges<br />
pour les pauvres et les démunis plutôt qu’à celui <strong>de</strong> cliniques médicales ; l’hôpital<br />
était une œuvre <strong>de</strong> piété, plus voué à accompagner spirituellement le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> qu’à<br />
essayer <strong>de</strong> sou<strong>la</strong>ger ses maux 11 .<br />
L’évangélisation se fit parallèlement à <strong>la</strong> conquête militaire; <strong>de</strong>s monastères furent<br />
construits, faisant également office <strong>de</strong> dispensaires et d’infirmeries, selon <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> médiévale<br />
; on peut donc affirmer que le nombre <strong>de</strong> ces centres était important à <strong>la</strong> fin du<br />
XVI e siècle, époque à <strong>la</strong>quelle les gran<strong>de</strong>s épidémies se propagèrent en Mésoamérique,<br />
provoquant beaucoup <strong>de</strong> morts<br />
parmi les peuples indigènes.<br />
Cette mé<strong>de</strong>cine arriva <strong>de</strong><br />
l’Ancien au Nouveau Mon<strong>de</strong>,<br />
dans l’esprit <strong>de</strong> ces centres<br />
hospitaliers. Hernán Cortés et<br />
les religieux venus avec lui<br />
s’appliquèrent à soigner les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et les nécessiteux. En<br />
1524, Cortés fit construire l’hôpital<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Inmacu<strong>la</strong>da Concepción<br />
<strong>de</strong> Nuestra Señora, au lieu dit Huitzil<strong>la</strong>n (endroit <strong>de</strong>s colibris) — où il avait<br />
rencontré Moctezuma à son arrivée à <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> Tenochtitlán en 1519 —. L’hôpital, connu<br />
plus tard comme hôpital <strong>de</strong> Jesús, fonctionne toujours et constitue l’institution hospitalière<br />
<strong>la</strong> plus ancienne d’Amérique (figure 8).<br />
L’hôpital <strong>de</strong> Santa Fe (1531), l’hôpital <strong>de</strong>l Amor <strong>de</strong> Dios ou hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Bubas (syphilis)<br />
en 1540, l’hôpital <strong>de</strong> los Indios, celui <strong>de</strong> San Cosme y San Damián et l’hôpital <strong>de</strong><br />
San Hipólito pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s mentaux 15 furent fondés à <strong>la</strong> même époque.<br />
L’hôpital <strong>de</strong> San Andrés, le premier à soigner tous types <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies, même les ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées, fut fondé en 1779 (figure 9). Ce fut un hôpital dédié à l’enseignement ;<br />
d’éminents mé<strong>de</strong>cins y eurent leur chaire, tels Jiménez, Carpio, Del Río et bien d’autres.<br />
Il exista jusqu’en 1905, date d’ouverture <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico.<br />
Époque <strong>de</strong> l’indépendance<br />
Mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique<br />
■ Époque <strong>de</strong> l’indépendance<br />
Trois événements vont marquer pour toujours le pays et ses habitants au cours du<br />
XIX e siècle. Tout d’abord, <strong>la</strong> guerre d’indépendance (1810-1821). Ensuite, <strong>la</strong> guerre injuste<br />
avec les États-Unis en 1847, qui finit par retrancher au pays plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong><br />
son territoire. Finalement, l’invasion française <strong>de</strong> 1862, imposant un prince autrichien<br />
sur le trône du Mexique. Ces événements ont opéré <strong>de</strong>s changements profonds dans <strong>la</strong><br />
vie <strong>de</strong>s habitants du Mexique naissant, y compris dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et son enseignement.<br />
La Real Universidad fut fermée en 1833 et on créa l’Établissement <strong>de</strong>s sciences médicales,<br />
à l’origine <strong>de</strong> ce qui <strong>de</strong>viendrait plus tard l’École nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, dont le<br />
siège se trouvait dès 1854 au pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> Santo Domingo (l’ancienne rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sainte<br />
Inquisition à l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonie). En Europe, le XIX e siècle fut une époque <strong>de</strong> grands<br />
progrès dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine ; ces progrès arrivèrent rapi<strong>de</strong>ment au Mexique,<br />
271<br />
Figure 8.<br />
Hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Inmacu<strong>la</strong>da<br />
Concepción <strong>de</strong><br />
Nuestra Señora<br />
fondé par Hernán<br />
Cortés,<br />
actuellement<br />
hôpital <strong>de</strong> Jesús<br />
Figure 9. Hôpital<br />
<strong>de</strong> San Andrés <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Mexico
Figure 10.<br />
Dr Rafael Lucio<br />
(1819-1886)<br />
Figure 11.<br />
Dr Ricardo E. Cicero<br />
(1869-1935)<br />
Figure 12.<br />
Dr Jesús González<br />
Urueña (1868-1957)<br />
Figure 13.<br />
Forme clinique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre décrite<br />
par Lucio<br />
ADAME, ARIAS, ARENAS, CAMPOS, NEUMANN, ORTIZ, RUIZ MALDONADO, SAÚL<br />
obligeant à restructurer les programmes académiques et <strong>la</strong> pratique médicale. Des<br />
écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine furent fondés dans tout le pays (on en comptait huit à <strong>la</strong> fin du<br />
XIX e siècle) et <strong>de</strong>s centres hospitaliers, <strong>de</strong>stinés au soin médical, à l’enseignement et à <strong>la</strong><br />
recherche, commencèrent à être construits.<br />
Le Conseil supérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé fut fondé en 1841. Cet organisme était chargé <strong>de</strong><br />
veiller sur <strong>la</strong> bonne pratique médicale, <strong>la</strong> santé et l’hygiène publiques, ainsi que sur les<br />
campagnes <strong>de</strong> vaccination ; l’institution, tout comme <strong>la</strong> Bienfaisance publique (fondée en<br />
1861), constituera <strong>la</strong> base du Secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé en 1983.<br />
L’Académie mexicaine <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, désignée à partir <strong>de</strong> 1912 comme l’organe <strong>de</strong> consultation<br />
du gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, fut constituée en 1873. En 1891, suite à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
du prési<strong>de</strong>nt Porfirio Díaz, le Dr Eduardo Liceaga é<strong>la</strong>bora le premier co<strong>de</strong> sanitaire.<br />
Dermatologie<br />
Les prémices d’une véritable <strong>de</strong>rmatologie<br />
furent ébauchés au début <strong>de</strong> l’indépendance du<br />
Mexique, après 1821, et les premières publications<br />
spécialisées parurent également. Des<br />
noms tels que Ladis<strong>la</strong>o <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pascua, Rafael<br />
Lucio, Ricardo Cicero, Eugenio Latapí, et plus<br />
tard, au XXe siècle, Jesús González Urueña et<br />
Salvador González Herrejón sont liés à l’enseignement<br />
<strong>de</strong> certains sujets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(figures 10, 11 et 12).<br />
Lucio, par exemple, qui dispensait <strong>de</strong>s cours à l’hôpital <strong>de</strong> San Andrés,<br />
incluait <strong>de</strong>s sujets tels que le lupus érythémateux, <strong>la</strong> lèpre, <strong>la</strong> syphilis, <strong>la</strong><br />
gale, <strong>la</strong> chique (figure 13). Il présenta au cours <strong>de</strong>s séances <strong>de</strong> l’Académie<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> décembre 1851 à janvier 1852 son Opúsculo sobre el Mal<br />
<strong>de</strong> San Lázaro o Elefantiasis <strong>de</strong> los Griegos [Opuscule sur le mal <strong>de</strong> Saint-<br />
Lazare ou l’elephantiasis <strong>de</strong>s Grecs], dans lequel il résumait toutes les observations<br />
qu’il avait faites pendant ses dix-neuf ans à <strong>la</strong> tête du <strong>de</strong>uxième<br />
hôpital <strong>de</strong> San Lázaro, sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die qui porte aujourd’hui son nom. Cependant,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie n’était pas très attirante pendant cette première<br />
époque <strong>de</strong> l’indépendance du Mexique ; Soriano signale qu’en 1888, seuls<br />
<strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins parmi les 232 diplômés les six années précé<strong>de</strong>ntes soignaient <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées17, 18 .<br />
Les mé<strong>de</strong>cins préa<strong>la</strong>blement cités nés au XIXe siècle et d’autres qui travaillèrent jusqu’au<br />
début du XXe siècle sont à l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique ; cette spécialité<br />
se vit consolidée le 5 février 1905 avec l’inauguration <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico, incluant<br />
un pavillon pour les ma<strong>la</strong>dies cutanées.<br />
■ Époque contemporaine<br />
272<br />
González Herrejón et Fernando Latapí posèrent les bases <strong>de</strong> l’École mexicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie commença vers le début du XX e siècle à<br />
l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico et au centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua. L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité naquit ultérieurement au sein <strong>de</strong> ces institutions et à l’Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies tropicales; plus tard, à l’Institut mexicain <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, à l’hôpital général<br />
Dr Manuel Gea González et — dans les provinces — à l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
Jalisco, à l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Monterrey, à l’université <strong>de</strong> San Luis Potosí et enfin<br />
dans d’autres institutions publiques. Il existe aujourd’hui <strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong>rmatologiques:
<strong>la</strong> Société mexicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fondée en 1936, et l’Académie mexicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(1952) ; tous <strong>de</strong>ux appartiennent à <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques<br />
et furent chargés <strong>de</strong> l’organisation du XI e Congrès international <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie qui eut lieu au Mexique en 1977.<br />
Dermatología. Revista Mexicana est née en 1956 ; en 1987, une nouvelle époque débuta,<br />
<strong>la</strong> revue étant <strong>de</strong>venue l’organe officiel <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux groupes.<br />
Un Conseil mexicain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie existe <strong>de</strong>puis 1975 ; <strong>de</strong> nos jours l’attestation<br />
qu’il délivre est indispensable.<br />
La spécialité existe au Mexique <strong>de</strong>puis près d’un siècle ; quelques-uns <strong>de</strong>s premiers<br />
<strong>de</strong>rmatologues d’Amérique Latine se formèrent au Mexique, bien que l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité ait été européenne à l’origine. Les nouvelles générations, par contre, s’inspirent<br />
beaucoup <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nord-<strong>américaine</strong>.<br />
Actuellement, le pays compte environ 2 000 <strong>de</strong>rmatologues. Le Mexique est considéré<br />
comme un pays où on observe beaucoup <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies appelées « tropicales ». Les problèmes<br />
<strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> base sont les mycoses (mycétome, sporotrichose, chromob<strong>la</strong>stomycose,<br />
coccidioïdomycose, histop<strong>la</strong>smose), les parasitoses, <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
l’ulcère <strong>de</strong>s chicleros, les onchocercoses, les mycobactérioses (lèpre, tuberculose), les<br />
tréponématoses et les pyo<strong>de</strong>rmies, mais on observe aussi <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies liées à <strong>la</strong> nutrition<br />
(pel<strong>la</strong>gre) ou à l’environnement (prurigo so<strong>la</strong>ire).<br />
Chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique<br />
Il est difficile <strong>de</strong> déterminer le moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
au Mexique. Ce fut peut-être le Dr Julio César Liparoli (<strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara, Jalisco) le premier<br />
<strong>de</strong>rmatologue à se spécialiser en chirurgie <strong>de</strong>rmatologique en cabinet médical. À<br />
l’hôpital général <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Mexico, le pionnier dans ce domaine fut le Dr Jorge Peniche,<br />
qui organisa <strong>la</strong> première clinique <strong>de</strong> tumeurs cutanées vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 50,<br />
avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’un chirurgien esthétique et d’un radiothérapeute. C’est ainsi que<br />
naquit l’unité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-oncologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dudit hôpital. Le premier cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-oncologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique,<br />
d’une durée d’un an, eut lieu en 1976. Actuellement, cette sous-spécialité<br />
compte sur l’aval <strong>de</strong> l’université nationale autonome <strong>de</strong> Mexico et elle est enseignée dans<br />
trois institutions : l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico, l’hôpital Dr Manuel Gea González et le<br />
centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua. Le Dr Yo<strong>la</strong>nda Ortiz prit en charge dans ce <strong>de</strong>rnier centre<br />
<strong>de</strong>s procédures chirurgicales, encore limitées, pendant les années 60. La préconsultation<br />
<strong>de</strong> tumeurs et leur traitement chirurgical, réalisés à l’origine par un chirurgien esthétique<br />
et ensuite par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues, furent établies en 1967. En 1978, le centre changea<br />
d’adresse et on y établit le service <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique ; finalement, en 1982<br />
fut établie <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>s tumeurs malignes. Le résidanat dans <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>s tumeurs<br />
et dans le service <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique débuta en 1988. Désormais, plus <strong>de</strong><br />
trente <strong>de</strong>rmatologues complétèrent leur formation.<br />
Au centre médical national 20 <strong>de</strong> Noviembre, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut établi en<br />
1961 par le Dr Aquiles Calles; le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie y débuta en 1986, comportant<br />
un programme <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique et un roulement en chirurgie esthétique.<br />
L’hôpital général du centre médical national <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale exista entre 1963<br />
et 1985, lorsqu’il fut détruit par le grand tremblement <strong>de</strong> terre. La chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
y était réalisée par le Dr José Luis Jiménez Castil<strong>la</strong> ; en 1968, elle comptait sur <strong>la</strong><br />
participation d’un chirurgien esthétique et sur <strong>de</strong>s roulements en chirurgie esthétique.<br />
Les cas plus avancés étaient envoyés à l’hôpital d’oncologie pour <strong>de</strong>s interconsultations<br />
avec le Dr Charles Meurehg ; <strong>de</strong> nos jours, le service est à <strong>la</strong> charge d’un <strong>de</strong>rmatologue.<br />
Le Dr Léon Neumann se forma dans l’ancien Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> salubrité et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
tropicales (1966-1967), où on ne pratiquait quasiment aucune chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
273
ADAME, ARIAS, ARENAS, CAMPOS, NEUMANN, ORTIZ, RUIZ MALDONADO, SAÚL<br />
Il fut assistant plusieurs mois (1967) dans une clinique privée <strong>de</strong> La Nouvelle-Orléans<br />
pour y apprendre les techniques <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmabrasion et <strong>de</strong> greffe <strong>de</strong> cheveux ; il fut probablement<br />
chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> première greffe <strong>de</strong> cheveux réalisée au Mexique.<br />
L’hôpital général Dr Manuel Gea González admit <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues formées en<br />
Espagne, le Dr Judith Domínguez Cherit (1987) et le Dr Josefina Carbajosa (1991). Le Dr<br />
Leticia Boeta, formée à <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs au États-Unis, y arriva en 1996. La chirurgie<br />
<strong>de</strong>rmatologique débuta à l’Institut <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> nutrition en 1982 avec l’admission<br />
du Dr Rocío Orozco Topete, chargé <strong>de</strong>s procédures chirurgicales élémentaires; en<br />
1997, le Dr Josefina Carbajosa fut admise dans le service, introduisant <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong><br />
Mohs, l’anesthésie tumescente, <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>s ongles et <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique génitale,<br />
entre autres. Cette sous-spécialité s’effectue également à l’hôpital central militaire,<br />
sous le conseil du Dr Clemente Moreno Col<strong>la</strong>do ; à l’institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong><br />
Jalisco sous <strong>la</strong> direction du chirurgien esthétique Julio Barba Gómez et à l’hôpital Juárez<br />
avec les Drs Ortiz et Boeta.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Monterrey (Nuevo León) est<br />
dirigé par le Dr Jorge Ocampo Candiani, formé comme chirurgien <strong>de</strong>rmatologue dans les<br />
universités <strong>de</strong> Barcelone et d’A<strong>la</strong>bama. L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique dans ce<br />
service débuta avec le Dr Oliverio Welsh, qui introduisit <strong>la</strong> cryochirurgie lorsqu’il en était<br />
le directeur. En 1983, le Dr Sergio Ramos Arizpe, qui avait étudié <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
en Allemagne et encouragé <strong>la</strong> chirurgie oncologique, fut admis dans le service.<br />
Il existe un diplôme <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique pour les <strong>de</strong>rmatologues certifiés, d’une<br />
durée d’un an, qui doit recevoir l’aval <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous-direction <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université autonome <strong>de</strong> Nuevo León. En 1983, León Neumann organisa<br />
en col<strong>la</strong>boration avec Oliverio Welsh et avec <strong>la</strong> sponsorisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société internationale<br />
<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique le premier cours théorique pratique <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique,<br />
dont <strong>la</strong> pratique se faisait sur <strong>de</strong>s pattes <strong>de</strong> cochons.<br />
En 1994 naquit <strong>la</strong> Société mexicaine <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique et oncologique,<br />
affiliée à <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques. Les congrès ont lieu tous<br />
les <strong>de</strong>ux ans ; <strong>la</strong> société dispose d’un organe <strong>de</strong> diffusion officiel appelé Cosmética,<br />
Médica y Quirúrgica, actuellement dirigé par les Drs Jorge Ocampo Candiani et José<br />
Gerardo Silva Siwady.<br />
■ Conclusion<br />
274<br />
La mondialisation atteint tous les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie humaine, y compris <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Où qu’elle soit générée dans le mon<strong>de</strong>, l’information médicale est connue le jour même ;<br />
les progrès technologiques, chirurgicaux et pharmacologiques sont diffusés rapi<strong>de</strong>ment<br />
par les gran<strong>de</strong>s multinationales. Le Mexique entre dans le XXI e siècle en comptant sur <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s institutions privées et publiques et sur l’exercice médical qui répond<br />
aux grands progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine contemporaine, mais doit relever également <strong>de</strong><br />
grands défis, surtout dans le domaine social. ■<br />
Octobre 2004
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Chávez I. México en <strong>la</strong> cultura<br />
médica. México: Fondo <strong>de</strong><br />
Cultura Económica; 1987.<br />
2. Ocaranza F. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en México. México:<br />
Cien <strong>de</strong> México; 1995.<br />
3. Pérez Tamayo R. De <strong>la</strong><br />
Medicina primitiva a <strong>la</strong><br />
Medicina mo<strong>de</strong>rna. México:<br />
Fondo <strong>de</strong> Cultura Económica;<br />
1997.<br />
4. Arias-Gómez M.I., « Adame-<br />
Miranda G. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología mexicana y sus<br />
aportaciones al mundo. »<br />
Dermatología Rev. Mex.<br />
2003; XLVII Supl 1 : 52-64.<br />
5. Cariño-Preciado L., « Del Olmo<br />
Linares G. EUATL. » La<br />
Dermatología en el Códice <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Cruz-Badiano. México:<br />
Grupo Roche; 1998.<br />
6. Latapí F., Ortiz Y. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en México.<br />
Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong><br />
Medicina Primer Centenario<br />
1864-1964. México:<br />
Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong><br />
Medicina. 1964; II : 565-92.<br />
7. Barquín M. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina. México: UNAM;<br />
1971 : 87-95, 243-44, 259-<br />
73, 331-46.<br />
8. González <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vara M., Sa<strong>la</strong>s<br />
E., A<strong>la</strong>zraki A. « El cacao en<br />
el México prehispánico. Usos<br />
religiosos y medicinales <strong>de</strong>l<br />
cacao. » Dans : Chapa M.,<br />
Choco<strong>la</strong>te, regalo <strong>de</strong>l Edén.<br />
México: Gobierno <strong>de</strong>l Estado<br />
<strong>de</strong> Tabasco; 2003 : 31-34.<br />
9. Flores y Troncoso F.A. Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina en México.<br />
Des<strong>de</strong> <strong>la</strong> época <strong>de</strong> los indios<br />
hasta <strong>la</strong> presente. Tomo I. 2 e<br />
éd. México: IMSS; 1982.<br />
10. Vasconcelos J. Breve historia<br />
<strong>de</strong> México. México:<br />
Fernán<strong>de</strong>z Editor; 1976.<br />
11. Ortiz F. Principia Médica. La<br />
medicina y el hombre.<br />
México: Editores <strong>de</strong> Textos<br />
Mexicanos; 2004 : 137-149.<br />
12. De <strong>la</strong> Cruz M. Libellus <strong>de</strong><br />
Medicinabullus Indorum<br />
Herbis. Manuscrito azteca <strong>de</strong><br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Mexique<br />
1552. Traduction <strong>la</strong>tine <strong>de</strong><br />
Juan Badiano. México: IMSS;<br />
1964.<br />
13. Barquín M. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina. México: UNAM;<br />
1971: 73-85.<br />
14. Ortiz F. Hospitales. México:<br />
McGraw-Hill Interamericana;<br />
2000.<br />
15. Fajardo-Ortiz G. Del Hospital<br />
<strong>de</strong> Jesús a instituciones y<br />
centros médicos. Historia <strong>de</strong><br />
los Hospitales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ciudad <strong>de</strong><br />
México 1521-2003. México:<br />
G<strong>la</strong>xoSmithKline; 2003.<br />
16. Saúl A., Latapí F. La lepra en<br />
México. Libro <strong>de</strong>l Centenario<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Aca<strong>de</strong>mia Nacional <strong>de</strong><br />
Medicina. México: Aca<strong>de</strong>mia<br />
Nacional <strong>de</strong> Medicina. 1964 :<br />
89-99.<br />
17. Rodríguez O. « La<br />
Dermatología en México.<br />
Primera parte. »<br />
Dermatología Rev. Mex.<br />
1961; 5 : 123.<br />
18. Saúl A. Dr. Rafael Lucio. Su<br />
vida y su obra. México; 1991.
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
PÉDIATRIQUE<br />
AU MEXIQUE<br />
RAMÓN RUIZ MALDONADO<br />
Dès le XIX e siècle, les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie mexicains — tout comme ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
plupart <strong>de</strong>s pays — soignaient (et le font toujours) <strong>de</strong>s adultes et <strong>de</strong>s enfants sans aucune<br />
distinction. Les patients <strong>de</strong>rmatologiques qui se rendaient dans les hôpitaux pédiatriques<br />
étaient soignés par les pédiatres qui, en général, étaient insuffisamment préparés à <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie. Pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s hôpitaux pédiatriques<br />
comptaient un <strong>de</strong>rmatologue général comme consultant externe, situation qui<br />
prévaut dans <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s cas.<br />
À partir <strong>de</strong>s années 60, l’hôpital infantile <strong>de</strong> Mexico, une institution emblématique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pédiatrie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, disposa d’un service d’allergie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie que dirigea<br />
le mé<strong>de</strong>cin allergologue Luis Gómez Orozco ; le Dr Roberto Núñez Andra<strong>de</strong> y travail<strong>la</strong>it<br />
<strong>de</strong>ux heures par jour comme <strong>de</strong>rmatologue consultant, mais il ne s’occupait ni<br />
d’enseignement ni <strong>de</strong> recherche.<br />
À <strong>la</strong> même époque, le Dr Mario Magaña Lozano soignait les patients pédiatriques au<br />
service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico et faisait <strong>de</strong>s consultations internes<br />
que le service <strong>de</strong> pédiatrie du même hôpital lui <strong>de</strong>mandait.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1969, après avoir fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et<br />
<strong>de</strong>rmato-pathologie, je revins d’Europe et travail<strong>la</strong>i comme chargé du <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie,<br />
au sein <strong>de</strong> l’institution où j’avais passé <strong>la</strong> spécialité en <strong>de</strong>rmatologie<br />
quelques années auparavant : le centre <strong>de</strong>rmatologique Dr Ladis<strong>la</strong>o <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pascua, dirigé<br />
à l’époque par le Pr. Fernando Latapí, également chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital<br />
général <strong>de</strong> Mexico. La même année je fis connaissance du Dr Rigoberto Agui<strong>la</strong>r Pico,<br />
qui venait d’être nommé directeur <strong>de</strong> l’hôpital infantile <strong>de</strong> Mexico; il m’annonça que le Dr<br />
Núñez Andra<strong>de</strong> était sur le point <strong>de</strong> prendre sa retraite et m’invita à occuper son poste.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Díaz Ordaz (1964-1970), on apprit qu’un nouveau centre<br />
hospitalier était en construction au sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Mexico pour remp<strong>la</strong>cer l’hôpital infantile<br />
<strong>de</strong> Mexico. Le directeur du nouvel hôpital serait le Dr Lázaro Benavi<strong>de</strong>s Vázquez,<br />
qui faisait déjà passer <strong>de</strong>s entretiens aux membres <strong>de</strong> sa future équipe. Lorsque je finis<br />
ma première année <strong>de</strong> travail à l’hôpital infantile, je remis un rapport détail<strong>la</strong>nt mes activités<br />
et, peu après, je fus invité à passer un entretien avec le Dr Benavi<strong>de</strong>s. Il m’offrit<br />
le poste <strong>de</strong> chef du service d’allergie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du nouvel hôpital, inauguré le<br />
277
RAMÓN RUIZ MALDONADO<br />
278<br />
6 novembre 1970 par le prési<strong>de</strong>nt sortant, Gustavo Díaz Ordaz, et son épouse, prési<strong>de</strong>nte<br />
du patronat <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> l’enfance (INPI en espagnol). L’INPI serait<br />
remp<strong>la</strong>cé au cours du nouveau sexennat par l’Institution mexicaine d’assistance à<br />
l’enfance (IMAN, en espagnol), dont <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nte serait Mme María Esther Echeverría<br />
(née Zuno).<br />
Le nom du service d’allergie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie avait été hérité <strong>de</strong> l’hôpital infantile <strong>de</strong><br />
Mexico, dont le chef était un mé<strong>de</strong>cin allergologue. En tant que chef du nouvel hôpital <strong>de</strong><br />
l’IMAN, je crus adéquat <strong>de</strong> séparer les <strong>de</strong>ux services, ce qui se produisit un an plus tard.<br />
En décembre 1971 eut lieu, comme tous les ans, <strong>la</strong> réunion annuelle <strong>de</strong> l’Académie<br />
<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, à Chicago. C’est là-bas que je fis connaissance du Dr Lour<strong>de</strong>s<br />
Tamayo Sánchez, qui avait fait sa thèse <strong>de</strong> doctorat sur L’étiologie <strong>de</strong> l’œdème dans <strong>la</strong> malnutrition<br />
chronique <strong>de</strong> l’enfant à l’hôpital infantile <strong>de</strong> Mexico, sous <strong>la</strong> direction du célèbre<br />
maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> pédiatrie, le Dr Joaquín Cravioto; le Dr Tamayo avait fini peu avant <strong>la</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie à l’Institut national <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies tropicales, sous <strong>la</strong> direction<br />
du Pr. Dr Antonio González Ochoa. La lutte entre le « groupe <strong>de</strong> tropicaux » et le<br />
« groupe du Pascua et <strong>de</strong> l’hôpital général » était durant ces années à son apogée, mais<br />
elle commença bien avant; à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> ces groupes se trouvaient respectivement González<br />
Ochoa et Latapí. Cette rivalité entraîna le manque <strong>de</strong> contact entre les élèves et les anciens<br />
élèves <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux professeurs. Malgré ce<strong>la</strong>, et sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s bonnes références que j’avais<br />
reçues à propos d’elle, j’invitai le Dr Tamayo à travailler comme mé<strong>de</strong>cin rattaché au service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie; elle accepta, heureusement, et notre fructueuse col<strong>la</strong>boration dure<br />
<strong>de</strong>puis avril 1971, soit trente-trois ans. En 1989, après près <strong>de</strong> vingt ans <strong>de</strong> direction du<br />
service, je cédai ma p<strong>la</strong>ce au Dr Tamayo afin d’obtenir un poste <strong>de</strong> recherche pour le service;<br />
elle présenta à son tour sa démission en 2002 pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> santé et fut remp<strong>la</strong>cée<br />
par une <strong>de</strong> nos bril<strong>la</strong>ntes élèves, le Dr Caro<strong>la</strong> Durán Mckinster.<br />
Sans doute influencés par l’optimisme et l’énergie créatrice qui existe chez <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong> ceux qui ont initié le nouvel hôpital <strong>de</strong> l’IMAN — y compris le directeur général <strong>de</strong><br />
l’institution, le Dr Alger León Moreno, et <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nte du patronat, Mme María Esther<br />
Echeverría (née Zuno), épouse du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République <strong>de</strong> l’époque —, nous organisâmes<br />
en octobre 1973 le premier Symposium international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
qui eut lieu dans l’auditorium f<strong>la</strong>mbant neuf <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’IMAN en présence<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> vingt-six pays ; parmi eux se trouvaient les pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique dans leurs pays respectifs : Martín Beare (Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong>), Ferdinando Gianotti (Italie),<br />
Gabrie<strong>la</strong> Lowy (Brésil), José María Mascaró (Espagne), Edmund Moynahan (Angleterre),<br />
Dagoberto Pierini (Argentine), Lawrence Solomon, Sydney Hurwitz, Alvin Jacobs,<br />
Samuel Weinberg et Guinter Kahn (États-Unis), Eva Torok (Hongrie) et Kazuya Yamamoto<br />
(Japon).<br />
Pendant le symposium, au cours d’un dîner offert aux professeurs étrangers, je proposai<br />
<strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, initiative qui<br />
fut acceptée avec enthousiasme. Dix congrès furent réalisés sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette société :<br />
le premier eut lieu à Mexico, en octobre 1976. Les huit premiers congrès furent appelés<br />
internationaux, mais à partir du neuvième congrès, qui se dérou<strong>la</strong> à Cancún en 2001,<br />
ma suggestion <strong>de</strong> les appeler mondiaux fut acceptée.<br />
En 1996, donnant suite à une proposition du Dr Alejandro García Vargas <strong>de</strong> l’institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara (Mexique), le Collège mexicain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique fut fondé, étant moi-même son premier prési<strong>de</strong>nt. Le collège organisa<br />
tous les <strong>de</strong>ux ans le Congrès mexicain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique : le premier eut lieu<br />
à Mexico en 1997, sous ma prési<strong>de</strong>nce ; le <strong>de</strong>uxième à Puerto Val<strong>la</strong>rta (Jalisco), présidé<br />
par le Dr García Vargas ; le troisième dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Chihuahua, présidé par le Dr María<br />
<strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s Moreno (née Trevizo) ; le quatrième fut organisé à Pueb<strong>la</strong>, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce<br />
du Dr Javier Gil Beristain. Le <strong>de</strong>rnier eut lieu à Querétaro en 2006, présidé par le Dr<br />
Margarita Garfias (née Royo).
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique au Mexique<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique attire beaucoup le<br />
mé<strong>de</strong>cin généraliste, le <strong>de</strong>rmatologue et le pédiatre,<br />
et c’est pour cette raison que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s événements<br />
<strong>de</strong>rmatologiques et pédiatriques incluent <strong>de</strong>s<br />
cours ou <strong>de</strong>s symposiums <strong>de</strong> cette spécialité.<br />
En 1973 fut organisé dans le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’actuel Institut national <strong>de</strong> pédiatrie<br />
le résidanat <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
d’une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans pour les pédiatres<br />
et d’une année pour les <strong>de</strong>rmatologues ; je<br />
fus professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> ce résidanat et le Dr<br />
Tamayo le professeur adjoint ; les rési<strong>de</strong>nts doivent<br />
travailler huit heures par jour. Nous comprîmes<br />
très vite que <strong>la</strong> pratique était insuffisant<br />
pour les pédiatres, et c’est ainsi qu’à partir <strong>de</strong><br />
1986 le résidanat s’étendit à trois ans. Depuis<br />
2004, quatre-vingt-trois spécialistes provenant du Mexique et <strong>de</strong> toute l’Amérique <strong>la</strong>tine<br />
reçurent une formation en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique. Le cours <strong>de</strong> spécialisation, reconnu<br />
à l’origine par l’Institut et par le Secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, est également reconnu <strong>de</strong>puis<br />
1989 par l’université nationale autonome du Mexique.<br />
Signalons que notre cours <strong>de</strong> spécialisation fut le premier dans le pays et le seul au niveau<br />
mondial pendant plusieurs années. Les <strong>de</strong>rmatologues pédiatres qui s’y formèrent<br />
occupent plusieurs postes importants au sein <strong>de</strong>s institutions mexicaines et étrangères.<br />
Les mé<strong>de</strong>cins rattachés au service qui contribuèrent à ses succès <strong>de</strong> façon significative<br />
sont : le Dr Amelia M. Laterza, <strong>de</strong> nationalité argentine, mé<strong>de</strong>cin rattaché entre 1979<br />
et 1989 ; le Dr Caro<strong>la</strong> Durán Mckinster, rattaché <strong>de</strong> 1989 à 2002 et actuellement chef du<br />
service ; le Dr María <strong>de</strong> <strong>la</strong> Luz Orozco Covarrubias, qui fait partie du service <strong>de</strong>puis 1992,<br />
et le Dr Marimar Sáez <strong>de</strong> Ocaríz, arrivée dans le service en 2002.<br />
La production scientifique du service comprend 288 articles — dont 190 publiés dans <strong>de</strong>s<br />
revues internationales in<strong>de</strong>xées —, ainsi que 5 livres sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
Nous mentionnerons parmi les <strong>de</strong>rmatologues pédiatres mexicains diplômés du service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie actuellement à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> leurs villes respectives : le Dr Teresa Sánchez Gómez, à l’hôpital<br />
pédiatrique <strong>de</strong> León (Guanajuato) ; le Dr Carolina Pa<strong>la</strong>cios López, au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico ; le Dr Angélica Berrón Ruiz, à l’institut <strong>de</strong> périnatologie<br />
<strong>de</strong> Mexico; le Dr María E. Moreno Agui<strong>la</strong>r, à l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant Pob<strong>la</strong>no; le Dr<br />
Lour<strong>de</strong>s Moreno (née Trevizo), à l’hôpital pédiatrique <strong>de</strong> Chihuahua et le Dr Alejandro<br />
García Vargas, à l’institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Guada<strong>la</strong>jara.<br />
D’autres <strong>de</strong>rmatologues exercent <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique au sein d’importants<br />
hôpitaux du D.F.: le Dr Guadalupe Ibarra, qui me remp<strong>la</strong>ça à l’hôpital infantile <strong>de</strong> Mexico<br />
et qui fut à son tour remp<strong>la</strong>cée par son élève le Dr Carlos Mena Cedillos ; le Dr Mario Magaña<br />
García à l’hôpital pédiatrique <strong>de</strong> l’hôpital général <strong>de</strong> Mexico, auteur du livre Dermatología<br />
pediátrica [Dermatologie pédiatrique], publié en 2000 ; le Dr Gregorio<br />
Podoswa, remp<strong>la</strong>cé par son élève, le Dr Edmundo Velázquez Arel<strong>la</strong>no, à l’hôpital pédiatrique<br />
du Centre médical ; le Dr Norma Vio<strong>la</strong>nte à l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> race, tous <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> l’Institut<br />
mexicain <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale ; les Drs Angélica Beirana et Enriqueta Morales au<br />
centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua.<br />
Nous, mé<strong>de</strong>cins qui nous sommes consacrés dans les premiers temps à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique, provenions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie générale; nous sommes <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>rmatologues<br />
pédiatres <strong>de</strong> façon autodidacte, par le biais du contact quotidien avec <strong>la</strong> pédiatrie<br />
et les enfants. Il n’en est pas moins paradoxal qu’ayant établi les bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et<br />
<strong>de</strong> son enseignement, nous ne possédions pas le diplôme qu’obtinrent tous nos élèves.<br />
279<br />
Dr Ramón Ruiz<br />
Maldonado
RAMÓN RUIZ MALDONADO<br />
J’ai essayé d’être objectif en écrivant ce compte rendu historique ; je suis conscient<br />
qu’il ressemble plutôt à une autobiographie et c’en est une en réalité. J’ai joué pendant<br />
trente-cinq ans sur cette scène où <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique est née. Si j’ai oublié un<br />
nom, un renseignement, c’est dû à une négligence involontaire et je vous prie d’avance<br />
<strong>de</strong> bien vouloir m’en excuser.<br />
Tout ce<strong>la</strong> est sans doute un travail d’équipe entre les mé<strong>de</strong>cins du service, les mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>s autres spécialités et les autorités, mais c’est surtout un acte d’amour pour ce<br />
que nous faisons. Nous ne sommes pas l’exception : au sein <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> pédiatrie,<br />
aimer ce que nous faisons est plutôt <strong>la</strong> règle. ■<br />
■ Référence<br />
bibliographique<br />
Ruiz Maldonado, R. « Pediatric<br />
Dermatology, Accomplishments<br />
and challenges for the 21st<br />
Century. » Arch. Dermatol.<br />
2000; 136 : 84.<br />
Novembre 2004
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
NICARAGUAYENNE<br />
Faire un compte rendu <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Nicaragua est une tâche<br />
complexe car il existe très peu d’informations écrites. Les renseignements que nous<br />
avons recueillis proviennent essentiellement <strong>de</strong>s entretiens avec les rares « acteurs » <strong>de</strong>s<br />
époques passées qui sont encore vivants.<br />
Lors du tremblement <strong>de</strong> terre dévastateur <strong>de</strong> 1972 qui détruisit <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Managua,<br />
<strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s archives contenant <strong>de</strong>s renseignements <strong>de</strong> valeur ont été perdues. Malgré<br />
ce<strong>la</strong>, nous avons pu connaître une partie <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Nicaragua<br />
grâce aux documents <strong>de</strong> l’actuelle Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Historiquement, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie est <strong>la</strong> spécialité médicale qui compte le moins <strong>de</strong><br />
membres et les projections pour l’avenir ne <strong>la</strong>issent pas entrevoir <strong>de</strong> changements. De<br />
nos jours, nous sommes 42 mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues, avec prédominance du sexe féminin<br />
(55 %), pour une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> 5 500 000 habitants, c’est-à-dire 1 <strong>de</strong>rmatologue pour<br />
130 952 habitants. Moins <strong>de</strong> <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s spécialistes (45 %) est basée à Managua, capitale<br />
du pays, tandis que le reste est réparti dans d’autres départements ; cependant, certaines<br />
régions importantes du pays manquent encore <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues, comme par<br />
exemple les départements <strong>de</strong> Nueva Segovia, Madriz, Rivas, Chontales, Jinotega, Matagalpa,<br />
RAAN, RAAS et Río San Juan 1 , où sont concentrés 35 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale du<br />
Nicaragua 2 . La plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues sont établis dans les départements <strong>de</strong> Managua<br />
et <strong>de</strong> León.<br />
Nous n’avons pas trouvé d’antécé<strong>de</strong>nts sérieux concernant <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s guérisseurs, mais nous pouvons affirmer qu’ils traitaient les ulcères variqueux<br />
avec du café moulu et <strong>de</strong>s feuilles <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales connues sous <strong>de</strong>s noms<br />
popu<strong>la</strong>ires, non scientifiques. Le vitiligo, fréquemment lié à <strong>de</strong>s sorcelleries ou <strong>de</strong>s envoûtements<br />
<strong>la</strong>ncés sur ceux qui en souffrent, est traité avec du rocou et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes médicinales.<br />
Les lois nicaraguayennes interdisent aux guérisseurs et aux sorciers l’exercice <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> profession, mais le manque <strong>de</strong> contrôle induit le fait qu’ils exercent <strong>de</strong> manière<br />
habituelle.<br />
Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
■ Développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
Les premières informations que nous possédons sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au<br />
Nicaragua se rapportent à <strong>la</strong> lèpre.<br />
281
Figure 1.<br />
Carlos Irigoyen,<br />
le premier<br />
<strong>de</strong>rmatologue<br />
nicaraguayen<br />
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
282<br />
Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République en 1893, le général José Santos Ze<strong>la</strong>ya, <strong>de</strong> peur <strong>de</strong> voir<br />
le mal se propager dans tout le pays, ordonne que tous les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s lépreux soient isolés<br />
sur l’île Aserra<strong>de</strong>ros (île du Cardón), dans le port <strong>de</strong> Corinto, sur l’océan Pacifique (département<br />
<strong>de</strong> Chinan<strong>de</strong>ga). La première léproserie est fondée à cet endroit en 1902 ; les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s y <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong> véritables prisonniers car il leur est interdit <strong>de</strong> sortir. Ils sont<br />
transportés sur le chemin <strong>de</strong> fer peint en jaune dans <strong>de</strong>s wagons spéciaux portant l’inscription<br />
« 79 » et comportant <strong>de</strong>s écriteaux indiquant le type <strong>de</strong> voyageurs. En 1930, les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s s’échappent <strong>de</strong> l’île Aserra<strong>de</strong>ros pour s’installer dans <strong>la</strong> commune <strong>de</strong> El Viejo<br />
(département <strong>de</strong> Chinan<strong>de</strong>ga), qui <strong>de</strong>vient ainsi à l’époque le principal foyer lépreux du<br />
pays. Un autre groupe s’installe dans le département <strong>de</strong> León.<br />
La première léproserie nationale, appelée San Lázaro, fut créée en 1932 à Managua,<br />
sur le terrain qu’occupe actuellement le centre <strong>de</strong>rmatologique national Dr Francisco<br />
José Gómez Urcuyo (toujours appelé léproserie par les anciens habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville). À<br />
l’origine elle hébergeait trente-huit patients. Alfonso Pérez Alonso et Juan <strong>de</strong> Dios Matus<br />
firent don <strong>de</strong> ces terres; ce <strong>de</strong>rnier, par amour envers les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hanséniens, fut appelé<br />
« Jean <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre ».<br />
En 1934 le Dr Roberto Espinosa Sotomayor fut nommé directeur du <strong>la</strong>zaret ; bien que<br />
n’étant pas <strong>de</strong>rmatologue, il combinait les activités administratives avec le soin <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong>s patients hanséniens 3 .<br />
La Fondation contre <strong>la</strong> lèpre fut créée en 1943, son directeur étant le Dr Carlos Irigoyen<br />
(figure 1), premier mé<strong>de</strong>cin spécialisé en <strong>de</strong>rmatologie, diplômé au Mexique, fondateur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En 1963, en qualité <strong>de</strong> secrétaire général <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, il organisa<br />
le IV e Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 4 .<br />
Ultérieurement, le Dr Armando Morales Ettienne prit en charge <strong>la</strong> direction médicale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie San Lázaro. Ce <strong>de</strong>rmatologue, diplômé en Argentine, fut également<br />
membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> société centre<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 5 .<br />
Les années ultérieures furent marquées par le retour au pays <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues nicaraguayens<br />
suivants :<br />
• Dr Jorge García Esquivel, diplômé au Mexique.<br />
• Dr Alci<strong>de</strong>s Delgadillo, membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
• Dr Ernaldo Ávalos, diplômé en Argentine, membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
• Dr Carlos Delgado, diplômé en France, membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie 6 .<br />
• Dr Oscar Martínez Campos, diplômé en Argentine, chirurgien esthétique et <strong>de</strong>rmatologue<br />
; il fut prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ainsi que secrétaire<br />
adjoint <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il fut également ministre<br />
<strong>de</strong> l’Assurance sociale en 1997 et il est actuellement député pour le Nicaragua auprès du<br />
Parlement centre-américain. Il fut invité à participer à <strong>de</strong> nombreux congrès nationaux.<br />
• Dr Josefa Pineda, diplômée en Argentine.<br />
• Dr Sergio Delgado, diplômé au Porto Rico.<br />
• Dr Leonor Corea, diplômée en France.<br />
• Dr Francisco José Gómez Urcuyo (figure 2), diplômé au Mexique et en Espagne, qui<br />
fut <strong>de</strong> retour au Nicaragua en 1975.<br />
• Dr Ángel Martínez Jiménez, <strong>de</strong> retour en 1977, après avoir obtenu son diplôme au<br />
Brésil. Il occupa le poste <strong>de</strong> directeur et <strong>de</strong> sous-directeur <strong>de</strong> l’enseignement au Centre<br />
national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; il fonda les chaires <strong>de</strong> spécialisation et d’étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université nationale autonome du Nicaragua (León et Managua respectivement).<br />
En 1991, l’université (Managua) organisa une cérémonie en l’honneur <strong>de</strong>
ses dix ans d’enseignement au sein <strong>de</strong> l’institution. Il participa également à plusieurs<br />
congrès nationaux en tant que professeur invité.<br />
• Dr Juan José Guadamuz, diplômé au Mexique, fut professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (étu<strong>de</strong>s supérieures) <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale<br />
autonome du Nicaragua, León.<br />
• Dr Or<strong>la</strong>ndo Sarria Berríos, diplômé au Mexique.<br />
• Dr Aldo Edgar Martínez Campos, qui retourna au Nicaragua en 1977 après avoir<br />
obtenu son diplôme en Argentine.<br />
• Dr Fe<strong>de</strong>rico Prado Rocha, diplômé en France, qui retourna au Nicaragua en 1979.<br />
Il fut cofondateur <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> spécialisation et d’étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
à l’université nationale autonome du Nicaragua (León et Managua respectivement), et<br />
cofondateur également <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>rmatologique national. En 1991, <strong>la</strong>dite université<br />
(Managua) organisa une cérémonie pour ses huit ans d’enseignement au sein <strong>de</strong> l’institution.<br />
Il fut vice-ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé entre 1997 et 1998 et participa comme professeur<br />
invité à plusieurs congrès nationaux.<br />
• Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina, <strong>de</strong> retour en 1980 après ses étu<strong>de</strong>s en Uruguay.<br />
• Dr Marlene Parra García, <strong>de</strong> retour en 1985, obtint son diplôme au Mexique avec<br />
une sous-spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>de</strong>venant ainsi <strong>la</strong> première <strong>de</strong>rmatologue<br />
pédiatrique du Nicaragua. Entre 1996 et 1999 elle a coordonné le cours <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie au centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez<br />
Urcuyo. Depuis 1992 elle est professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire d’étu<strong>de</strong>s supérieures en<br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale autonome du Nicaragua,<br />
Managua. Elle participa à <strong>de</strong> nombreux congrès nationaux.<br />
Tous ces <strong>de</strong>rmatologues, ainsi que bien d’autres qui n’ont pas été mentionnés ici, travaillèrent<br />
<strong>de</strong> manière responsable et passionnée pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne.<br />
Nonobstant, il nous apparaît nécessaire <strong>de</strong> témoigner une reconnaissance spéciale envers<br />
ceux qui se sont distingués tout au long <strong>de</strong> ces années pour leur dévouement mémorable.<br />
Personnalités remarquables<br />
Dr Jorge García Esquivel<br />
Son travail <strong>de</strong> directeur médical <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie (1951-1970) fut notable, et c’est au<br />
cours <strong>de</strong> sa gestion que l’institution changea <strong>de</strong> nom pour celui <strong>de</strong> clinique San Lázaro.<br />
Il introduisit au Nicaragua le premier traitement efficace contre <strong>la</strong> lèpre: les sulfones<br />
(DDS). Il mena <strong>la</strong> campagne pour traiter les patients ambu<strong>la</strong>toires et, soutenu par le<br />
Dr Rodolfo Matus, chirurgien esthétique, il réalisa les premières chirurgies reconstructrices.<br />
Il fut le premier spécialiste nicaraguayen à exposer ses expériences <strong>de</strong>rmatologiques<br />
lors <strong>de</strong> congrès nationaux et internationaux et fut membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et secrétaire général <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie ; en tant que tel, il organisa en 1976 le X e Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il occupa également <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
durant différentes pério<strong>de</strong>s.<br />
Dr Francisco José Gómez Urcuyo (1943-1995)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne<br />
■ Personnalités remarquables<br />
Ce fut l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues les plus remarquables du Nicaragua et sa mort prématurée<br />
représente une perte irrémédiable. Il consacra une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> sa vie médicale<br />
aux lépreux, avec habileté scientifique et mystique, amour et dévouement. Il dirigea<br />
<strong>la</strong> clinique San Lázaro entre 1976 et 1981; il fut le cofondateur et le promoteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> fon-<br />
283<br />
Figure 2.<br />
Dr Francisco José<br />
Gómez Urcuyo
Figure 3.<br />
De gauche<br />
à droite :<br />
Pr. Hermann<br />
Schaffer,<br />
Pr. Dr Aldo Edgar<br />
Martínez<br />
Campos,<br />
Pr. Dr Francisco<br />
José Gómez<br />
Urcuyo, lors<br />
<strong>de</strong> l’hommage<br />
<strong>de</strong> l’Association<br />
nicaraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
au Dr Gómez<br />
Urcuyo<br />
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
284<br />
dation <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>rmatologique national qui porte actuellement son<br />
nom en juste hommage à sa mémoire, étant donné <strong>la</strong> tâche difficile qu’il<br />
commença le 1 er février 1978: une importante transformation <strong>de</strong>s structures<br />
physiques et médicales <strong>de</strong> l’hôpital eut lieu, entraînant une amélioration<br />
<strong>de</strong>s conditions d’hygiène et <strong>de</strong> l’environnement pour les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s<br />
hospitalisés. Pour <strong>la</strong> première fois les patients <strong>de</strong>rmatologiques disposaient<br />
<strong>de</strong> leur propre hôpital, où ils recevaient un traitement médical.<br />
C’est au cours <strong>de</strong> sa gestion que les patients souffrant <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong><br />
Hansen reçurent <strong>de</strong> manière institutionnalisée les traitements <strong>de</strong> rifampicine,<br />
clofazimine et DDS (figure 3).<br />
Il fonda également <strong>la</strong> Société amis <strong>de</strong>s lépreux, grâce à <strong>la</strong>quelle fut bâtie <strong>la</strong> cita<strong>de</strong>lle<br />
Adilia <strong>de</strong> Eva, en l’honneur <strong>de</strong> cette femme qui participa à sa construction et qui éprouvait<br />
une dévotion et un amour tout spéciaux envers les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. Il<br />
faut noter que cette construction ne reçut aucune subvention du gouvernement <strong>de</strong><br />
l’époque.<br />
La cita<strong>de</strong>lle, formée <strong>de</strong> dix-sept maisons hygiéniques indépendantes, vise à offrir aux<br />
patients un toit mo<strong>de</strong>ste mais digne, avec l’avantage <strong>de</strong> l’intimité dont bénéficie chaque<br />
famille. Les hommes célibataires occupent <strong>de</strong>s pavillons séparés <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong>s femmes.<br />
Actuellement, elle héberge dix-sept patients qui sont déjà guéris mais qui continuent<br />
<strong>de</strong> recevoir une assistance médicale, <strong>de</strong>s aliments et tous les éléments nécessaires à leur<br />
soin. Il s’agit <strong>de</strong> personnes âgées qui vivent avec leurs enfants et petits-enfants, constituant<br />
ainsi une communauté <strong>de</strong> quarante et une personnes.<br />
Ces constructions se trouvent à l’emp<strong>la</strong>cement <strong>de</strong> l’hôpital et sont séparées <strong>de</strong> celles<br />
<strong>de</strong>stinées aux patients souffrant d’autres pathologies.<br />
Le Dr Gómez Urcuyo créa le département <strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong> bien-être social qui vise<br />
à traiter les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hanséniens <strong>de</strong> façon multidisciplinaire, et c’est grâce à lui que certains<br />
patients mutilés purent réintégrer <strong>la</strong> vie familiale : <strong>de</strong>s ateliers furent organisés<br />
pour offrir aux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s une formation en menuiserie et ébénisterie. Le succès <strong>de</strong> cette<br />
initiative leur permit d’être productifs et <strong>de</strong> se rendre utiles au sein <strong>de</strong> leur famille malgré<br />
leurs muti<strong>la</strong>tions.<br />
En 1980, Gómez Urcuyo participa à une campagne afin <strong>de</strong> déterminer <strong>de</strong> nouveaux<br />
cas <strong>de</strong> lèpre dans les départements <strong>de</strong> Chinan<strong>de</strong>ga et <strong>de</strong> Managua.<br />
Il fut invité maintes fois à <strong>de</strong>s congrès nationaux et à l’étranger, au cours <strong>de</strong>squels il<br />
exposa ses travaux et ses propres expériences.<br />
En 1980 il fonda <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> l’université nationale<br />
autonome du Nicaragua (Managua) et fut également cofondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> même université (León et Managua). Il occupa <strong>de</strong>ux<br />
fois le poste <strong>de</strong> secrétaire adjoint pour le Nicaragua auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En 1991, il reçut à l’université nationale autonome du Nicaragua<br />
(Managua) un hommage pour ses dix ans d’enseignement. En 1994, <strong>la</strong> Société hondurienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie le désigna membre honoraire en reconnaissance <strong>de</strong> ses mérites.<br />
Parmi les patients hanséniens du Centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, l’un <strong>de</strong>s plus anciens,<br />
Dom Pedro Delgadillo 7 , lui dédia le poème suivant, en témoignage d’affection, <strong>de</strong><br />
respect et <strong>de</strong> remerciement :<br />
Mon docteur est un jeune nica, c’est un aventurier.<br />
De tous les employés, il arrive au bureau le premier.<br />
C’est le chercheur <strong>de</strong> ma moelle et <strong>de</strong> ma peau fanée,<br />
c’est celui qui répare mon sang,<br />
qui, quand je m’énerve, est irrité.<br />
Son nom, comme sa signature,<br />
parmi ses collègues sont respectés.
Lors <strong>de</strong> mes consultations, quand rien ne m’est prescrit<br />
je me tais par respect, parce que je le chéris.<br />
Tel qu’il l’affirme,<br />
mon grand désir est<br />
que sur le chemin qu’Il parcourra<br />
ni chardons ni chaînes il n’y aura<br />
et que son beau et sensible travail<br />
Dieu le bénisse là où il aille.<br />
Le Dr Francisco José Gómez Urcuyo est le mé<strong>de</strong>cin qui aima et se consacra le plus<br />
aux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s hanséniens. Nous pouvons le constater dans un poème qu’il écrivit et que<br />
les autorités du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé firent graver sur une p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> bronze dévoilée<br />
lors d’une cérémonie solennelle au centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui porte actuellement<br />
son nom 8 .<br />
Seigneur,<br />
mes lépreux sont <strong>la</strong> lumière <strong>de</strong> ma vie.<br />
Ils remplissent <strong>de</strong> tendresse<br />
ma profession et ma nicaraguayenneté<br />
Ai<strong>de</strong>-moi à sou<strong>la</strong>ger leurs p<strong>la</strong>ies,<br />
à les rendre forts face à l’humiliation,<br />
à les comprendre dans leur solitu<strong>de</strong>.<br />
Dr Aldo Edgar Martínez Campos (1937)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne<br />
Dermatologue et spécialiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine du travail (figure 4), il fut le cofondateur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université<br />
nationale autonome du Nicaragua en 1980. Au cours <strong>de</strong> cette même année, il participa<br />
à <strong>la</strong> campagne menée dans les départements <strong>de</strong> Chinan<strong>de</strong>ga et Managua afin <strong>de</strong><br />
déterminer <strong>de</strong> nouveaux cas <strong>de</strong> lèpre.<br />
En 1982, l’université nationale autonome du Nicaragua (León et Managua) et <strong>la</strong> direction<br />
supérieure du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé le désignèrent chef national d’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour les cours <strong>de</strong> spécialisation 9 . En tant que fondateur et chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire, il é<strong>la</strong>bora avec le Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina les p<strong>la</strong>ns et les programmes<br />
d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité qui sont toujours en vigueur, les modifications ultérieures ayant<br />
été faites par ces mêmes auteurs. Actuellement, trente-six <strong>de</strong>s quarante-<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues<br />
nicaraguayens obtinrent leur diplôme dans leur pays 10 .<br />
Herman Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina, Francisco José Gómez Urcuyo, Fe<strong>de</strong>rico Prado<br />
Rocha et Ángel Martínez Jiménez l’accompagnèrent dans <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Plus tard, Hugo Argüello Martínez, mé<strong>de</strong>cin pathologiste,<br />
Dalia Torres Flores (figure 5), diplômée en biologie et technologie médicale<br />
— elle suivit <strong>de</strong>s formations <strong>de</strong> spécialisation en mycologie au Costa Rica et en<br />
Argentine —, et Marlene Parra García se sont joints à l’ensemble <strong>de</strong>s professeurs<br />
<strong>de</strong> cette chaire.<br />
Le Dr Martínez Campos présida <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (<strong>de</strong>ux<br />
fois), dont il est actuellement le prési<strong>de</strong>nt honoraire. Il présida également à <strong>de</strong>ux occasions<br />
l’Association médicale nicaraguayenne, dont il est membre perpétuel du comité <strong>de</strong><br />
direction 6, 11 . Il représenta son pays en tant que secrétaire adjoint auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et participa maintes fois à <strong>de</strong>s congrès nationaux et internationaux,<br />
au cours <strong>de</strong>squels il exposa ses travaux ainsi que ses expériences personnelles.<br />
285<br />
Figure 4.<br />
Dr Aldo Edgar<br />
Martínez Campos<br />
Figure 5.<br />
Dr Francisco José<br />
Gómez Urcuyo et<br />
Pr. Dalia Torres<br />
Flores
Figure 6.<br />
Dr Hermann<br />
Al<strong>la</strong>n Schäffer<br />
Urbina<br />
Figure 7.<br />
De gauche à<br />
droite : Erasmo<br />
Agui<strong>la</strong>r, Hermann<br />
Schäffer Urbina,<br />
Berthalina<br />
Cuevas, Fe<strong>de</strong>rico<br />
Prado et Aldo<br />
Edgar Martínez<br />
Campos<br />
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
286<br />
Nous pouvons affirmer qu’il représente l’un <strong>de</strong>s piliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne<br />
actuelle, avec les Drs Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina et Francisco José Gómez<br />
Urcuyo.<br />
En 1985, le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé le nomma membre du groupe national <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
(pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie), par reconnaissance envers son travail d’enseignant. En 1986,<br />
ledit ministère et le Conseil national <strong>de</strong> l’éducation supérieure du Nicaragua l’honorèrent<br />
du titre <strong>de</strong> professeur distingué pour le cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie. Cette<br />
même année <strong>la</strong> direction supérieure du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé proposa <strong>de</strong> décentraliser<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nationale ; le Dr Martínez Campos fut alors choisi pour créer une unité<br />
<strong>de</strong> soin et d’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, basée à <strong>la</strong> polyclinique orientale, là où les<br />
mé<strong>de</strong>cins internes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie effectuaient leurs services six mois par an.<br />
En 1991, il reçut à l’université nationale autonome du Nicaragua (Managua) un hommage<br />
pour ses dix ans d’enseignement.<br />
En 1994, il cofonda <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong> —première faculté<br />
privée <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine au Nicaragua— ; il prépara les programmes d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nouvelle institution et créa les chaires <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du travail et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont<br />
il est actuellement le professeur titu<strong>la</strong>ire. Il fut membre du conseil facultatif ; fondateur<br />
et directeur du département <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong> cette université, il démissionna en<br />
1999.<br />
En 1996, il organisa le XX e Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Managua en<br />
tant que secrétaire général <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
En 1997 il fut nommé directeur général <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche au ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé ; <strong>la</strong> même année l’université nationale autonome du Nicaragua (Managua)<br />
organisa une cérémonie en reconnaissance <strong>de</strong> son travail considérable pour le<br />
développement <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie. Il occupa le poste <strong>de</strong> sousdirecteur<br />
<strong>de</strong> l’enseignement à l’hôpital <strong>de</strong>rmatologique national.<br />
En 2001, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong> lui octroya le diplôme honoris<br />
causa, en reconnaissance <strong>de</strong> son travail dans l’enseignement. Il exerce toujours les<br />
fonctions <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université et <strong>de</strong><br />
conférencier lors <strong>de</strong> congrès <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine ayant lieu au Nicaragua ou à l’étranger.<br />
Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina (1945-1998)<br />
Cofondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université nationale autonome du Nicaragua en 1980, il participa <strong>la</strong> même<br />
année à <strong>la</strong> campagne réalisée dans les départements <strong>de</strong> Chinan<strong>de</strong>ga et <strong>de</strong> Managua pour<br />
déterminer <strong>de</strong> nouveaux cas <strong>de</strong> lèpre (figure 6).<br />
Sa contribution à <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce et au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie fut fondamentale : il participa activement et efficacement à l’é<strong>la</strong>boration<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Il avait l’art <strong>de</strong> savoir transmettre ses<br />
connaissances aux élèves, et <strong>de</strong>vint un professionnel très respecté dans <strong>la</strong><br />
communauté médicale nicaraguayenne.<br />
En tant que sous-directeur <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> l’actuel centre national<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo, il travail<strong>la</strong> <strong>de</strong> manière efficace,<br />
ce qui contribua à améliorer <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s internes 12 (figure 7).<br />
Il participa à maints congrès dans le pays et à l’étranger, exposant son<br />
travail et ses expériences. Il présida <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et fut secrétaire adjoint pour le Nicaragua auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société centre<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>de</strong>ux occasions 6 .<br />
En 1991, l’université nationale autonome du Nicaragua lui rendit hommage<br />
pour ses dix ans d’enseignement au sein <strong>de</strong> l’institution. En 1999, au<br />
cours d’une cérémonie solennelle, le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé découvrit une p<strong>la</strong>que <strong>de</strong>
marbre dans l’auditorium du Centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en hommage à son travail<br />
didactique et à sa vie exemp<strong>la</strong>ire.<br />
Il compte parmi les <strong>de</strong>rmatologues les plus importants du Nicaragua et son absence<br />
est ressentie <strong>de</strong> tous.<br />
L’Association Nicaraguayenne <strong>de</strong> Dermatologie<br />
Les démarches visant à sa fondation furent initiées en 1957, mais ce n’est que le 4 mai<br />
1961, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> Déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> Managua, que <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et syphiligraphie fut fondée. Ultérieurement et pour <strong>de</strong>s raisons d’ordre légal, elle changea<br />
<strong>de</strong> nom et adopta <strong>la</strong> dénomination « Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ».<br />
Ses fondateurs furent les Drs Carlos Irigoyen, Alci<strong>de</strong>s Delgadillo, Armando Morales<br />
Ettienne, Jorge García Esquivel, Ernaldo Ávalos Vega et Carlos Delgado González, tous<br />
décédés 5 .<br />
L’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie regroupe <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
du pays. Elle organisa jusqu’à présent dix-neuf congrès nationaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
6 , comprenant les spécialités suivantes : <strong>de</strong>rmatologie, mé<strong>de</strong>cine interne, pédiatrie,<br />
chirurgie esthétique, mé<strong>de</strong>cine générale. Certains congrès traitèrent <strong>de</strong>s sujets concernant<br />
les soins primaires, <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s internes et <strong>de</strong>s étudiants en mé<strong>de</strong>cine. Grâce<br />
à ses dirigeants, l’institution organisa également trois congrès centre-américains.<br />
Des accords furent passés avec <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong> pour<br />
mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> formation continue pour les <strong>de</strong>rmatologues, ainsi<br />
que <strong>de</strong>s cours d’actualisation en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Lors <strong>de</strong> l’assemblée générale du 6 octobre 1998, l’association créa <strong>la</strong> bourse d’étu<strong>de</strong>s<br />
« Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Urbina », en mémoire <strong>de</strong> cet éminent <strong>de</strong>rmatologue nicaraguayen<br />
; <strong>la</strong>dite bourse, <strong>de</strong> 200 dol<strong>la</strong>rs américains mensuels, est <strong>de</strong>stinée à <strong>de</strong> jeunes<br />
mé<strong>de</strong>cins ayant eu une excellente moyenne pendant toutes leurs étu<strong>de</strong>s et désireux<br />
d’étudier <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Suárez, étudiant <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Marroquín, au Guatema<strong>la</strong>, fut le premier mé<strong>de</strong>cin à obtenir<br />
cette distinction.<br />
L’association propose également à ses membres un fonds d’ai<strong>de</strong> mutuelle et une assurance<br />
collective, en cas <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die ou <strong>de</strong> décès 6 .<br />
Le Centre National <strong>de</strong> Dermatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne<br />
■ L’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
■ Le centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Dr Francisco José Gómez Urcuyo<br />
Le 20 février 1995, vingt-cinq jours après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> l’illustre <strong>de</strong>rmatologue,<br />
le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé baptisa l’institution créée le 1 er février 1978<br />
par le Dr Gómez Urcuyo <strong>de</strong> son propre nom au cours d’une cérémonie solennelle,<br />
respectant ainsi <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Association médicale nicaraguayenne<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (figure 8). Le<br />
centre avait été créé avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration du Dr Ángel Martínez Jiménez,<br />
chargé <strong>de</strong>s patients hanséniens, du Dr Aldo Edgar Martínez Campos, sousdirecteur<br />
<strong>de</strong> l’enseignement, du Dr Fe<strong>de</strong>rico Prado Rocha, chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consultation externe, du Dr C<strong>la</strong>udio Galo Sandino, microbiologiste clinique<br />
et chef et fondateur du <strong>la</strong>boratoire actuel <strong>de</strong> l’hôpital. Le Dr Hermann<br />
Schaffer Urbina occupa ultérieurement le poste <strong>de</strong> chef en charge <strong>de</strong>s patients hospitalisés<br />
et l’institution reçut <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Drs Josefa Pineda, Leonor Corea, Hugo<br />
Argüello (pathologiste, disciple du Pr. Ackerman), Marlene Parra García et Dalia Torres<br />
Flores 12 .<br />
287<br />
Figure 8.<br />
Découverte <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>que <strong>de</strong> bronze<br />
en hommage au Dr<br />
Francisco José<br />
Gómez Urcuyo au<br />
centre national <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie qui<br />
porte son nom. De<br />
gauche à droite :<br />
Mme Inés Hurtado,<br />
veuve <strong>de</strong> Gómez<br />
Urcuyo, Mme Sara<br />
Urcuyo, mère du Dr<br />
Gómez Urcuyo, et<br />
Mme Martha<br />
Pa<strong>la</strong>cios, ministre<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, 1995
Figure 9.<br />
Aldo Edgar<br />
Martínez Campos<br />
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
Actuellement, le centre est un hôpital école, qui reçoit en moyenne 300 patients par jour<br />
et qui est considéré comme le berceau <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne 13 . Quarante-sept<br />
<strong>de</strong>rmatologues nicaraguayens et <strong>de</strong>ux étrangers y obtinrent leur diplôme; le Dr Alfonso Bendaña<br />
Hurtado (25 novembre 1985) est le premier <strong>de</strong>rmatologue diplômé au Nicaragua 10 .<br />
De nos jours le centre accueille quatorze internes en <strong>de</strong>rmatologie ; tous les patients<br />
<strong>de</strong>rmatologiques reçoivent un soin spécialisé et intégral ; l’enseignement est à <strong>la</strong> charge<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues diplômés au Nicaragua ; <strong>de</strong>s internes et <strong>de</strong>s chirurgiens esthétiques<br />
col<strong>la</strong>borent également à l’enseignement.<br />
Le centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo travaille avec<br />
l’hôpital Antonio Lenin Fonseca, un centre qui dispose <strong>de</strong> 300 lits et qui offre son soutien<br />
médical aux patients ayant besoin <strong>de</strong> soins spécialisés. L’institution subit <strong>de</strong>s rénovations<br />
<strong>de</strong>puis l’administration du Dr Gómez Urcuyo : le secteur <strong>de</strong>s cabinets externes fut modifié<br />
en 1983 sous les ordres du Dr Juan José Cabrera, directeur <strong>de</strong> l’époque.<br />
■ L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong>rmatologique au Nicaragua au Nicaragua<br />
288<br />
Nous pouvons affirmer <strong>de</strong> façon catégorique que <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie au Nicaragua (1982) constitua un bond en avant <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, autant<br />
qualitatif que quantitatif. La décision <strong>de</strong> former <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie au<br />
pays fut sage et judicieuse. Les différentes écoles fusionnèrent dans cette chaire, comme<br />
celles d’Argentine, d’Uruguay, du Mexique, d’Espagne, <strong>de</strong> France et du Brésil, aboutissant<br />
à une soli<strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s nouveaux <strong>de</strong>rmatologues nicaraguayens. L’enseignement au<br />
sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire est toujours à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues diplômés du pays.<br />
Il existe actuellement au Nicaragua trois facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine qui enseignent <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
dont <strong>de</strong>ux se trouvent à Managua tandis que <strong>la</strong> troisième est à León. La faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale autonome (Managua) possè<strong>de</strong> une chaire<br />
d’étu<strong>de</strong>s supérieures, dont le professeur titu<strong>la</strong>ire est Marlene Parra García, tandis que<br />
pour l’instant <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> spécialisation n’a pas <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire et fonctionne sous<br />
<strong>la</strong> responsabilité du Dr Erasmo Agui<strong>la</strong>r Díaz, diplômé au Nicaragua. De nos jours quatorze<br />
mé<strong>de</strong>cins internes suiuvent une spécialisation d’une durée <strong>de</strong> trois ans. Ces mé<strong>de</strong>cins<br />
doivent présenter et soutenir un travail <strong>de</strong> recherche pour prétendre au titre <strong>de</strong><br />
spécialiste.<br />
La plupart <strong>de</strong>s internes reçoivent une bourse du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé ; cependant<br />
quelques-uns poursuivent leurs étu<strong>de</strong>s avec leurs propres moyens économiques. Pour<br />
être admis, ils doivent passer un examen : les points obtenus sont additionnés aux points<br />
<strong>de</strong>s qualifications <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures, leur CV est étudié et <strong>de</strong> là résulte <strong>la</strong> sélection<br />
<strong>de</strong>s meilleurs étudiants. Le nombre d’élèves admis est déterminé chaque année par les<br />
autorités du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
À <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie est enseignée<br />
uniquement dans le cadre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures ; le Dr Aldo Edgar Martínez Campos (figure<br />
9) en est le professeur titu<strong>la</strong>ire. Les trois chaires sont dictées au centre national <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo (hôpital école).<br />
Le Dr Nubia Pacheco Solís est le professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale autonome du Nicaragua (León), et les cours<br />
ont lieu à l’hôpital école Oscar Danilo Rosales. Cette faculté ne propose pas d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Parmi les nouvelles générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues (figures 10, 11 et 12) — tous titu<strong>la</strong>ires<br />
d’un diplôme <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie acquis au Nicaragua <strong>de</strong>puis 1982,<br />
excepté pour le Dr Hermann Al<strong>la</strong>n Schaffer Suárez —, nous allons citer :<br />
Dr María Eugenia Medina Zepeda: elle fut <strong>la</strong> coordinatrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
au sein <strong>de</strong> l’unité d’assistance dans l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique orientale
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nicaraguayenne<br />
(1988-1994) ainsi qu’au centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José Gómez Urcuyo<br />
(1996-2002, date <strong>de</strong> sa démission). Elle participa en 1989 à une campagne pour détecter<br />
<strong>de</strong> nouveaux cas <strong>de</strong> lèpre à San Francisco Libre, Managua et Chinan<strong>de</strong>ga. Elle exposa ses<br />
travaux et ses expériences au cours <strong>de</strong> congrès à l’étranger ou dans le pays.<br />
Dr Luz Cantillo : directrice du centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie Dr Francisco José<br />
Gómez Urcuyo entre 1994 et 1997, elle impulsa les rénovations <strong>de</strong>s cabinets <strong>de</strong> consultation<br />
externe et <strong>de</strong> l’auditorium <strong>de</strong> l’hôpital. Elle participa à <strong>la</strong> campagne menée dans<br />
<strong>la</strong> commune <strong>de</strong> San Francisco Libre (département <strong>de</strong> Managua), où un noyau <strong>de</strong> lèpre et<br />
plusieurs cas <strong>de</strong> lèpre nodu<strong>la</strong>ire infantile furent découverts. Elle fit également partie <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> campagne en 1996, à El Zapote, Real <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cruz et Sabana Larga (département <strong>de</strong> Matagalpa),<br />
où on découvrit que les puits ravitail<strong>la</strong>nt l’eau potable étaient pollués à l’arsenic<br />
; 111 cas d’HACRE furent détectés à ce moment-là.<br />
Elle participa à plusieurs congrès — nationaux<br />
et internationaux — en qualité <strong>de</strong> conférencier<br />
ou <strong>de</strong> professeur invité, présentant ses<br />
travaux et ses expériences. Actuellement elle<br />
enseigne à <strong>la</strong> chaire d’étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale<br />
autonome du Nicaragua (Managua).<br />
Dr Alina Gómez: elle a coordonné le travail<br />
réalisé à San Francisco Libre, où un foyer<br />
<strong>de</strong> lèpre fut découvert, et participa avec le Dr<br />
Luz Cantillo à l’étu<strong>de</strong> qui permit <strong>de</strong> détecter<br />
les patients atteints d’HACRE. Elle obtint le<br />
premier prix <strong>de</strong> l’exposition d’affiches sur les<br />
résumés <strong>de</strong> cas d’arsenic au cours du XXII e<br />
Congrès centre-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu à Panamá. Elle exposa ses expériences<br />
au cours <strong>de</strong> maints congrès à l’étranger et dans le pays. Pendant une année elle enseigna<br />
dans les chaires d’étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Dr Leónidas Pacheco Mora : prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
entre 1996 et 1998, il organisa également <strong>de</strong>ux congrès nationaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et fut invité à bien d’autres congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Dr José Miguel Gutiérrez Arostegui : entre 1998 et 2000 il présida l’Association<br />
nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, organisant <strong>de</strong>ux congrès nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Il dirigea également le Centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entre 1997 et 1998.<br />
Dr María Luisa Álvarez Ortiz : elle présida l’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
entre 2000 et 2002, pério<strong>de</strong> pendant <strong>la</strong>quelle se déroulèrent <strong>de</strong>ux congrès nationaux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Elle participa à <strong>de</strong> nombreux congrès, nationaux et internationaux.<br />
289<br />
Figure 10.<br />
De gauche à<br />
droite : Alejandro<br />
Varel, Fe<strong>de</strong>rico<br />
Prado, Sonia Rivas,<br />
María Eugenia<br />
Medina, G<strong>la</strong>dis<br />
Rosales, Aldo Edgar<br />
Martínez Campos,<br />
Hermann Schaffer<br />
Urbina et Ángel<br />
Martínez<br />
Figure 11.<br />
De gauche à<br />
droite : Jorge Isaac<br />
Neira Cuadra,<br />
Hermann Al<strong>la</strong>n<br />
Schaffer Urbina,<br />
Lesbia Altamirano,<br />
Aldo Edgar<br />
Martínez Campos,<br />
Erendira Rizo<br />
et José Miguel<br />
Gutiérrez<br />
Figure 12.<br />
De gauche à<br />
droite : Aldo Edgar<br />
Martínez Campos,<br />
Berthalina Cuevas,<br />
Fe<strong>de</strong>rico Prado,<br />
Alejandro Varel,<br />
Dr María Eugenia<br />
Medina, Erasmo<br />
Agui<strong>la</strong>r, María<br />
Luisa Álvarez,<br />
María Merce<strong>de</strong>s<br />
Palma et Hermann<br />
Schaffer Urbina
ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS, JORGE ISAAC NEIRA CUADRA<br />
Dr Erasmo Agui<strong>la</strong>r Díaz : il coordonne <strong>de</strong>puis 2002 les cours <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
; il fit part <strong>de</strong> ses expériences et <strong>de</strong> ses travaux au cours <strong>de</strong>s congrès nationaux<br />
et participa à <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> Matagalpa (111 cas d’HACRE).<br />
Dr Sonia Rivas Serrano : actuelle prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> l’Association nicaraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(<strong>de</strong>puis l’an 2002), elle organisa quelques congrès nationaux. Elle est invitée<br />
comme professeur à plusieurs congrès réalisés dans le pays.<br />
Dr Herman Al<strong>la</strong>n Schaffer Suárez : il est professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong>.<br />
Dr Jorge Neira Cuadra : il est actuellement le directeur du Centre national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
où il réalisa plusieurs réformes structurelles. Il est professeur auxiliaire <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>américaine</strong> ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale<br />
autonome du Nicaragua (Managua). Grâce à ses aptitu<strong>de</strong>s et son dévouement, il<br />
soutient activement l’enseignement et le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation.<br />
Il participa à <strong>de</strong>s congrès nationaux en qualité <strong>de</strong> professeur invité et en tant que conférencier<br />
au cours <strong>de</strong> congrès internationaux.<br />
Nous pouvons affirmer que, malgré le nombre limité <strong>de</strong> ses membres, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
nicaraguayenne occupe actuellement une p<strong>la</strong>ce honorifique dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine du<br />
pays, eu égard à son prestige et aux avancées scientifiques que ses fondateurs lui ont<br />
<strong>la</strong>issé par le passé. Ceux-ci ont légué une œuvre que les générations actuelles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
continuent <strong>de</strong> renforcer et d’enrichir avec leur travail constant et ardu.<br />
Nous sommes profondément convaincus que le présent <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Nicaragua<br />
est sur <strong>la</strong> bonne voie et que notre avenir est très prometteur. ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Ministerio <strong>de</strong> Salud. Dirección<br />
<strong>de</strong> Docencia e Investigación.<br />
Recursos Humanos. Libro <strong>de</strong><br />
Registros. 1984 - 2004.<br />
2. Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
Estadísticas y Censos.<br />
Dirección <strong>de</strong> Estadísticas<br />
Socio<strong>de</strong>mográficas.<br />
Pob<strong>la</strong>ción total por área <strong>de</strong><br />
resi<strong>de</strong>ncia y sexo. Dpto. <strong>de</strong><br />
Proyección; 2004.<br />
3. Gómez Urcuyo F. Pasado,<br />
presente y futuro <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra<br />
en Nicaragua. Trabajo<br />
presentado en el 11º Congreso<br />
Internacional <strong>de</strong> Lepra.<br />
México. 13-18 nov. 1978.<br />
4. Vázquez B<strong>la</strong>nco R. Historia <strong>de</strong><br />
los Congresos<br />
Centroamericanos <strong>de</strong><br />
Dermatología. 23º Congreso<br />
Centroamericano <strong>de</strong><br />
Dermatología; 2002.<br />
5. Libro <strong>de</strong> Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Nicaragüense <strong>de</strong><br />
Dermatología. Año 1973.<br />
6. Libro <strong>de</strong> Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación<br />
Nicaragüense <strong>de</strong><br />
Dermatología. Año 1990.<br />
7. Delgadillo P. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lepra en Nicaragua.<br />
Managua: Mercurio.<br />
8. Gómez Urcuyo F.J. Libro <strong>de</strong><br />
Poemas (inédit).<br />
9. Ministerio <strong>de</strong> Salud. Dirección<br />
<strong>de</strong> Docencia e Investigación.<br />
Recursos Humanos. Libro <strong>de</strong><br />
Registros. 1984 - 2004.<br />
Octobre 2004<br />
10. Libro <strong>de</strong> Actas <strong>de</strong> Examen <strong>de</strong><br />
Posgrado <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Managua: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina. Universidad<br />
Nacional Autónoma <strong>de</strong><br />
Nicaragua. 1984-2004.<br />
11. Libro <strong>de</strong> Actas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Asociación Médica<br />
Nicaragüense. 1990-2004.<br />
12. Centro Nacional <strong>de</strong><br />
Dermatología Francisco José<br />
Gómez Urcuyo. Libro <strong>de</strong><br />
Archivos <strong>de</strong> Recursos<br />
Humanos. 1982-2004.<br />
13. Centro Nacional <strong>de</strong><br />
Dermatología Francisco José<br />
Gómez Urcuyo. Libro <strong>de</strong>l<br />
Departamento <strong>de</strong><br />
Estadísticas; 2004.
A manera <strong>de</strong> prólogo<br />
NOTES SUR<br />
L’HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
AU PARAGUAY<br />
JULIO CORREA<br />
■ À titre <strong>de</strong> prologue<br />
Notre continent, versatile et mystérieux, observé sous tous ses angles, renferme une<br />
infinité <strong>de</strong> manifestations qui constituent, à travers les races natives qui le peuplèrent et<br />
qui le peuplent encore, le riche héritage du développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine sous toutes<br />
les <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Amériques ; les sculptures, les poteries et les inscriptions montrant,<br />
entre autres, les ma<strong>la</strong>dies liées à <strong>la</strong> peau en sont les témoins. Les apports <strong>de</strong>s auteurs<br />
mexicains, colombiens, péruviens, chiliens, argentins, parmi tant d’autres pays <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
confraternité <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, analyseront ce concept en détail.<br />
Vu <strong>la</strong> dimension du sujet, j’ai préféré nommer le présent travail simplement « Notes<br />
sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay », car il comprend <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> développement<br />
<strong>de</strong> plusieurs civilisations, surtout <strong>de</strong> l’ère précolombienne et notamment <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
race tupi-guarani, habitants d’une gran<strong>de</strong> partie du territoire sud-américain en ces<br />
temps-là, et dont les expressions artisanales <strong>la</strong>issèrent malheureusement <strong>de</strong> rares témoignages<br />
<strong>de</strong> leurs connaissances extraordinaires sur les propriétés curatives <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes.<br />
Heureusement, quelques-uns furent recueillis par <strong>de</strong>s observateurs diligents, à savoir <strong>de</strong>s<br />
conquérants, <strong>de</strong>s jésuites, les natifs sco<strong>la</strong>risés et nombre <strong>de</strong> savants et d’académiciens qui<br />
arrivèrent sur ces terres et qui témoignèrent dans <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche remarquables<br />
<strong>de</strong> l’extraordinaire développement cognitif <strong>de</strong>s autochtones du continent.<br />
Le Paraguay, pays méditerranéen à l’histoire richissime et surprenante, qui occupait<br />
avant <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong>s territoires comprenant une gran<strong>de</strong> partie du Brésil et du territoire<br />
argentin, avec <strong>de</strong>s frontières avec le Pérou et <strong>la</strong> Bolivie, se démembra progressivement,<br />
pendant l’époque coloniale, en raison <strong>de</strong>s affrontements entre les Portugais et les Espagnols;<br />
en premier lieu, essentiellement à cause <strong>de</strong> l’avancée <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>irantes, malocas<br />
paulistes, animés par le désir d’asservir une main-d’œuvre bon marché; et en second lieu,<br />
à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> négligence envers ces vastes territoires. Et à l’époque <strong>de</strong> l’indépendance, <strong>la</strong><br />
guerre sang<strong>la</strong>nte — dite <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alliance (le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay) — que le<br />
Paraguay endura entre les années 1865-1870 muti<strong>la</strong> davantage le territoire et anéantit<br />
291
JULIO CORREA<br />
une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, plongeant les survivants dans <strong>la</strong> déso<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> misère,<br />
à cause <strong>de</strong>s balles, <strong>de</strong> <strong>la</strong> faim et <strong>de</strong>s innombrables pestes sur les champs <strong>de</strong> bataille.<br />
Pendant <strong>la</strong> reconstruction <strong>de</strong> <strong>la</strong> patrie qui suivit le funeste quinquennat, apparaissent<br />
les premiers événements qui marquent les débuts <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>rmatologique au Paraguay.<br />
Les nombreux documents que nous avons consultés sur cette pério<strong>de</strong> constituent<br />
une somme intéressante d’informations re<strong>la</strong>tives à ce qu’il y a <strong>de</strong> plus notable sur les ma<strong>la</strong>dies<br />
cutanées dans notre pays, les mécanismes pour les combattre et leurs résultats,<br />
apportées par <strong>de</strong>s membres illustres <strong>de</strong> ces communautés.<br />
Le but <strong>de</strong> cette introduction est d’éveiller l’intérêt <strong>de</strong> ceux qui viennent d’arriver pour<br />
que leur apport contribue à enrichir davantage l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay.<br />
Ma gratitu<strong>de</strong> et ma reconnaissance vont envers ceux qui col<strong>la</strong>borèrent à ce mo<strong>de</strong>ste<br />
travail.<br />
■ La La popu<strong>la</strong>tion d’Amérique. d’Amérique. L’homme américain L’homme américain<br />
292<br />
En Amérique, <strong>de</strong>s fossiles d’hominidés ne furent pas retrouvés ; l’Amérindien n’est<br />
pas autochtone, mais il arriva d’Asie au Paléolithique supérieur et au début du Néolithique.<br />
Son apparition en Amérique se produisit à une époque re<strong>la</strong>tivement récente, plus<br />
tard qu’en Europe, il n’y a pas plus <strong>de</strong> trente mille ans (trente-cinq à quarante mille<br />
d’après Bates), selon les trouvailles archéologiques et les étu<strong>de</strong>s réalisées.<br />
Les habitants d’Amérique sont venus d’Asie par <strong>la</strong> terre, par vagues successives, à<br />
travers le détroit <strong>de</strong> Behring. C’étaient <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> type mongoloï<strong>de</strong>, encore peu différenciés<br />
(avec les traits pas trop accentués <strong>de</strong>s races mongoles et jaunes), dolichocéphales,<br />
provenant <strong>de</strong> tribus primitives paléo-asiatiques d’Asie du Nord 1 .<br />
Il existe aussi d’autres théories <strong>de</strong> plusieurs auteurs, cités par González Torres, qui<br />
essaient d’expliquer <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> l’homme américain sur le continent. Paul Rivet, du<br />
musée <strong>de</strong> l’homme et du musée d’histoire naturelle <strong>de</strong> Paris, signale quatre courants migratoires<br />
:<br />
1. Mongoloï<strong>de</strong> (<strong>la</strong> théorie principale) : ils arrivèrent d’Asie par le détroit <strong>de</strong> Béring.<br />
2. Ils arrivèrent dans <strong>de</strong>s embarcations <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> Polynésie, <strong>la</strong> Mé<strong>la</strong>nésie, l’Océanie,<br />
les îles du Pacifique, en passant par l’île <strong>de</strong> Pâques ; certains doutes subsistent pour une<br />
telle traversée il y a trente mille ans.<br />
3. Ils traversèrent le Pacifique plus au nord, atteignant différents points <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte<br />
<strong>américaine</strong>.<br />
4. Migration <strong>de</strong> l’homme australien à travers l’Antarctique pour arriver à l’extrême<br />
sud <strong>de</strong> l’Amérique ; prédécesseurs <strong>de</strong>s Patagons et <strong>de</strong>s Fueguinos, avec <strong>de</strong>s éléments culturels<br />
communs aux Australiens.<br />
Il existe également d’autres théories, dont quelques-unes sont fantaisistes. Les monticules<br />
et les sambaquis et <strong>de</strong>s restes retrouvés dans <strong>de</strong>s grottes et <strong>de</strong>s cavernes sont les<br />
principales sources <strong>de</strong> données préhistoriques en Amérique. Les fossiles humains les<br />
plus anciens retrouvés sur notre continent, mesurés par le carbone 14, appartiennent à<br />
(toujours d’après González Torres) :<br />
- l’île <strong>de</strong> Roses, côte <strong>de</strong> Californie, 38 000 ans.<br />
- Lewisville, Texas, 37 000 ans.<br />
- Sandia Cave, 26 000 ans.<br />
- Tule Springs, Nevada, 22 000 ans.<br />
- Chili, 10 000 ans.<br />
- Folsom (bûchers humains à Folsom), 9 889 ans.<br />
- Lagoa Santa, Brésil, 6 000 ans.
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Les caractères anthropologiques <strong>de</strong> l’homme du Paléolithique supérieur sont : dolichocéphale<br />
(crâne allongé, avec <strong>la</strong> voûte crânienne élevée, aux parois fines), visage allongé<br />
et étroit, nez moyen, arca<strong>de</strong>s sourcilières accentuées, cheveux lisses. Ils étaient<br />
appelés australoï<strong>de</strong>s parce qu’il existe encore <strong>de</strong>s individus et <strong>de</strong>s peuples avec <strong>la</strong> même<br />
caractéristique anthropologique en Australie. Ils sont représentés aujourd’hui par les Algonquins<br />
et les Shoshones d’Amérique du Nord; et par les Gé, Kaingu, Siriones, Tobas et<br />
Tehuelches, entre autres, en Amérique du Sud.<br />
Les hommes du Paléolithique supérieur apparurent au Paraguay il y a six mille ans.<br />
D’après Canals Frau, les habitants du Paléolithique supérieur d’Amérique du Sud composent<br />
trois groupes raciaux, tous dolichoï<strong>de</strong>s : les ancêtres <strong>de</strong>s Huárpidos (grands,<br />
maigres, poilus : Huarpes <strong>de</strong> Cuyo, Siriones <strong>de</strong> l’Est bolivien), qui <strong>de</strong>scendirent par le<br />
Mexique, l’Amérique centrale, <strong>la</strong> Colombie, les zones interandines ; les Lágidos (petits,<br />
forts, poilus : Caingua, Gé, entre autres), qui gagnèrent le Venezue<strong>la</strong>, le bassin <strong>de</strong> l’Orénoque<br />
jusqu’au Brésil central et oriental, le Paraguay, le NE argentin ; les Patagónidos<br />
(grands, robustes, peu poilus) ; les Tehuelches <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patagonie, qui habitaient <strong>de</strong>puis <strong>la</strong><br />
Terre <strong>de</strong> Feu jusqu’au centre du Brésil.<br />
Au Néolithique, d’autres vagues migratoires arrivèrent et occupèrent l’A<strong>la</strong>ska, le nord<br />
<strong>de</strong> l’Amérique du Nord jusqu’à l’est (Esquimaux) et migrèrent ensuite vers le sud (5500<br />
à 5000 av. J.-C.); certains affirment qu’elles vinrent également <strong>de</strong> Polynésie. Ils étaient<br />
brachycéphales (crâne plus court et <strong>la</strong>rge), sé<strong>de</strong>ntaires, agriculteurs, bergers et éleveurs<br />
<strong>de</strong> bétail. Ils utilisaient <strong>de</strong>s outils et <strong>de</strong>s armes en pierre polie, <strong>de</strong>s os, <strong>de</strong>s cornes, <strong>de</strong><br />
l’ivoire. Ils connurent et perfectionnèrent <strong>la</strong> céramique, <strong>la</strong> poterie, le fi<strong>la</strong>ge, le tricot; ils<br />
possédaient une organisation sociale et habitaient <strong>de</strong>s hameaux. Ils développèrent les arts<br />
et <strong>la</strong> religion. Ils étaient <strong>de</strong> bons navigateurs et perfectionnèrent leurs embarcations.<br />
Les Muscogui et les Sudástidos sont les représentants actuels <strong>de</strong> ces groupes au sud-est<br />
<strong>de</strong>s États-Unis; les Apaches au nord du Mexique; les Esquimaux: Amazoni<strong>de</strong>s, Arawaks,<br />
Brasili<strong>de</strong>s, Caraïbéens, Guaranis-Tupis. Des tribus <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture néolithique apparurent au<br />
Paraguay il y a environ trois mille ans av. J.-C. Elles habitaient <strong>la</strong> jungle, dans notre région<br />
orientale, occupant <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s maisons communales et se regroupant en hameaux.<br />
Les races amérindiennes furent c<strong>la</strong>ssées suivant différents points <strong>de</strong> vue : par régions<br />
géographiques, par familles linguistiques, par domaines culturels, etc. À l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
découverte <strong>de</strong> l’Amérique, il y avait sur le continent quatre sous-groupes, d’après <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong>s anthropologues :<br />
1. Indiens nord-pacifiques en A<strong>la</strong>ska et à l’ouest <strong>de</strong>s montagnes Rocheuses, le long du<br />
Pacifique Nord jusqu’en Californie, dont les Apaches qui sont <strong>de</strong>scendus jusqu’au<br />
Mexique ;<br />
2. Indiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone sub-pacifique ou du Pacifique Sud, <strong>de</strong>puis le Mexique, l’Amérique<br />
centrale, le long <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s jusqu’en Patagonie ; ce sont les néo-Amérindiens, les<br />
Aztèques, les Mayas, les Incas, les Araucans au Chili, les Pampeanos et les Patagons dans<br />
les prairies <strong>de</strong> l’est <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s, le Chaco austral, <strong>la</strong> Pampa et <strong>la</strong> Patagonie ;<br />
3. Indiens nord-at<strong>la</strong>ntiques, dans les p<strong>la</strong>ines d’Amérique du Nord, à l’ouest <strong>de</strong>s montagnes<br />
Rocheuses, dont les principaux représentants étaient les Peaux-Rouges, assez<br />
éloignés du Mongol : ils mesuraient 1,70 m en moyenne ;<br />
4. Indiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone sub-at<strong>la</strong>ntique ou <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique Sud, dans les jungles d’Amérique<br />
du sud à l’est <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s, jusqu’à <strong>la</strong> côte at<strong>la</strong>ntique; léger aspect mongoloï<strong>de</strong>, mésocéphales,<br />
<strong>de</strong> petite taille (1,55m à 1,60m); divisés en plusieurs nations, collectivités ou tribus.<br />
Les Caraïbes occupaient les Antilles. Il existait également d’autres races, que nous<br />
n’inclurons pas ici, pour nous concentrer davantage sur l’analyse <strong>de</strong>s nations qui composaient<br />
les gran<strong>de</strong>s régions d’Amérique du Sud, où les gran<strong>de</strong>s civilisations dont nous<br />
<strong>de</strong>scendons se firent connaître.<br />
Pour être plus précis, nous citerons le maître obligé <strong>de</strong> l’anthropologie paraguayenne,<br />
Branis<strong>la</strong>va Susnik, qui réalisa une synthèse <strong>de</strong>s caractéristiques raciales et<br />
293
JULIO CORREA<br />
294<br />
socio-culturelles et <strong>de</strong>s migrations <strong>de</strong>s habitants préhistoriques du Paraguay, en les<br />
regroupant sous trois c<strong>la</strong>sses :<br />
1. le Pámpido : il habita le Chaco il y a cinq-six mille ans av. J.-C. ; ses caractéristiques<br />
physiques et culturelles correspondaient au Paléolithique. Ses <strong>de</strong>scendants actuels seraient<br />
les Makã et les Mbajá-guaikurú ;<br />
2. le Lágido (selon les fossiles retrouvés à Lagoa Santa, Minas, au Brésil) habita il y a<br />
cinq-six mille ans av. J.-C. <strong>la</strong> région orientale du Paraguay, dans les États <strong>de</strong> Paraná,<br />
Santa Catarina et Río Gran<strong>de</strong> do Sul du Brésil, et à Misiones, Argentine ;<br />
3. l’Amazonien: il y a trois mille ans av. J.-C., il traversa l’isthme <strong>de</strong> Panama, les p<strong>la</strong>ines<br />
<strong>de</strong> Colombie et du Venezue<strong>la</strong> jusqu’à l’Amazone, il <strong>de</strong>scendit à travers les affluents (Ma<strong>de</strong>ira,<br />
Tapajos, Xingú, Araguaica, Tocantins) et il arriva au Paraguay vers l’an 500 av. J.-C. Ce sont<br />
les Paléo-Amazónidos ou Avá-Amazónidos qui, ayant atteint <strong>la</strong> source <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Paraguay,<br />
se dispersèrent par les affluents jusqu’au fleuve Paraná et <strong>la</strong> côte at<strong>la</strong>ntique. Brachycéphales,<br />
<strong>de</strong> type racial proto-ma<strong>la</strong>is mongoloï<strong>de</strong>, ils étaient petits et possédaient une culture<br />
néolithique. Les Guaranis-Tupis sont amazoniens du point <strong>de</strong> vue racial, tout comme les Jíbaro<br />
Pano, à l’ouest, vers les An<strong>de</strong>s, et les Arawaks, Caraïbéens, entre autres.<br />
Parmi les migrants avá-amazónidos, <strong>de</strong>ux branches importantes peuvent être distinguées<br />
:<br />
1. les Protomby’á, qui entrèrent en contact avec les Kaingangs et leur imposèrent leur<br />
<strong>la</strong>ngue avá ñe’e ; ils peuplèrent <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Paraguay et ses affluents ; ils<br />
étaient organisés dans <strong>de</strong>s groupes à lignage unique dans une maison communale ;<br />
2. les Protocaires, installés plus récemment sur le même territoire (moins <strong>de</strong> cinq<br />
cents ans av. J.-C.), s’imposèrent aux précé<strong>de</strong>nts et fusionnèrent avec eux. Ils avaient une<br />
culture néolithique et étaient agriculteurs. Ils vivaient groupés dans <strong>de</strong>s hameaux (tekoja),<br />
<strong>de</strong> lignages multiples (ñandurá), avec un chef (mburuvichá). Ils pratiquaient <strong>la</strong> polygamie<br />
et l’enlèvement <strong>de</strong> jeunes filles afin d’établir <strong>de</strong>s alliances, <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> parenté politiques<br />
(tovajá) et d’ai<strong>de</strong> réciproque. Les <strong>de</strong>ux groupes, Protomby’á et Protocaires, fusionnèrent<br />
sous <strong>la</strong> domination <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, pour constituer <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> nation guarani.<br />
Plusieurs collectivités intégrant <strong>la</strong> nation guarani entrèrent en contact avec les découvreurs,<br />
les conquérants, les colonisateurs et les missionnaires espagnols et portugais.<br />
Nous en citerons les principales, selon G.T. Bertoni et Branis<strong>la</strong>va Susnik, en insistant sur<br />
<strong>la</strong> province du Paraguay : Kario, Tobat), Guarani, Guarambaré, Iratí, Paranae ou Paranaygua,<br />
Yguazu, Akaray, Monday, Guyrae, Jakui-Tape, Tape, Tarumá. Tous occupaient<br />
<strong>de</strong>s territoires définis, délimités par <strong>de</strong>s rivières, <strong>de</strong>s sierras, <strong>de</strong>s <strong>la</strong>gunes et <strong>de</strong>s bois. Ils<br />
étaient agriculteurs, toujours commandés par <strong>de</strong>s caciques dont les noms <strong>de</strong>vinrent légendaires,<br />
à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> défense soli<strong>de</strong> <strong>de</strong> leurs territoires face aux ambitions étrangères.<br />
D’autres collectivités sont citées, qui incluent les Guaranis-Tupis, éparpillés sur l’actuel<br />
territoire du Brésil, <strong>de</strong> Bolivie, d’Argentine, entre autres.<br />
Sur le territoire paraguayen, dans le Chaco, <strong>la</strong> région occi<strong>de</strong>ntale, citons toutes les<br />
collectivités qui y vivent actuellement : Ayoreos, Chamacoco, Tapieté, Chiriguanos,<br />
Guaná, Toba, Sanapaná, Anguite, Lengua, Choroti, Nivaclé, Makã, Toba-lengua. Dans <strong>la</strong><br />
région orientale, les Pa’i-Tavyterã, Ava-Chiripa, Ache-Guayaki, Mbya-Guarani.<br />
■ Territoire du Paraguay. du Paraguay. Découverte. Colonie. Découverte. Indépendance. Guerre Époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alliance Coloniale. (1865-1870)<br />
Indépendance. Guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alliance (1865-1870)<br />
Au XVI e siècle, le premier gouvernement installé par les Espagnols dans les régions<br />
du fleuve Paraná fut celui d’Asunción du Paraguay, où les habitants <strong>de</strong> Buenos Aires<br />
allèrent vivre en 1541. En raison <strong>de</strong> l’expansion rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête, l’administration<br />
du Paraguay comprenait les immenses territoires qui constituent aujourd’hui les
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Républiques d’Argentine, du Paraguay, d’Uruguay et les provinces déjà citées du Brésil,<br />
alors occupées par les Espagnols. En tenant compte <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> nos anciennes<br />
maisons dans ces pays très vastes, il est facile <strong>de</strong> comprendre que sous le<br />
nom <strong>de</strong> Paraguay étaient désignés, en règle générale, les territoires situés du Pérou<br />
et du centre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bolivie au nord, jusqu’à l’extrême sud <strong>de</strong> l’Amérique du Sud, et <strong>de</strong>s<br />
An<strong>de</strong>s jusqu’à l’océan At<strong>la</strong>ntique. Vu que dans tout ce pays, le principal gouvernement<br />
était alors celui du Paraguay — puisque celui <strong>de</strong> Tucumán était inférieur et<br />
celui <strong>de</strong> Buenos Aires ne fut fondé qu’en 1617 —, au moment <strong>de</strong> constituer une province<br />
religieuse dans ces régions en 1607, les jésuites prirent <strong>la</strong> dénomination civile<br />
qui prédominait alors sur le territoire qu’ils occupaient. La Compagnie fut donc appelée<br />
« Province du Paraguay » (Paraquaria en <strong>la</strong>tin) et ce nom se maintint jusqu’à<br />
son expulsion par Charles III 2 .<br />
Ces affirmations correspon<strong>de</strong>nt à l’ouvrage monumental consacré<br />
à l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Compagnie <strong>de</strong> Jésus du prêtre Antonio Astrain S.J.<br />
L’analyse profon<strong>de</strong> du chercheur Luis T. González sur les causes<br />
et les conséquences <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation méditerranéenne du Paraguay<br />
(figure 1) ( à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> nombreuses erreurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s gouverneurs<br />
<strong>de</strong> l’époque et <strong>de</strong>s éléments étrangers aux autorités espagnoles)<br />
nous fournit ceci :<br />
La province géante <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s entame sa déca<strong>de</strong>nce avec les<br />
premières muti<strong>la</strong>tions territoriales. Le Paraguay a souffert <strong>de</strong><br />
quatre démembrements graves. À cause <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, il n’a pas<br />
seulement perdu <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges zones territoriales, mais <strong>de</strong>s parcelles<br />
vitales pour son existence lui ont été retranchées. La ségrégation<br />
amazonienne et <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> Cuyo, par exemple, tout en étant importantes<br />
par leur étendue et leurs richesses, n’ont pas influencé <strong>la</strong> continuité <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation. En<br />
revanche, le retranchement du littoral at<strong>la</strong>ntique et <strong>de</strong>s provinces du sud a représenté<br />
un véritable bouleversement organique pour <strong>la</strong> province, dont nous ressentons<br />
les effets jusqu’à présent 3 .<br />
Les événements que nous évoquerons par <strong>la</strong> suite expliquent d’une manière incontestable<br />
les causes qui menèrent le Paraguay à son isolement géophysique, pour ainsi dire;<br />
situation qui inspira le bril<strong>la</strong>nt commentaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> figure littéraire du Paraguay, Augusto<br />
Roa Bastos, quand il l’appe<strong>la</strong> « une île entourée <strong>de</strong> terre »; il synthétise ainsi les difficultés<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> marche angoissante <strong>de</strong> son interminable acheminement vers l’horizon <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
consécration définitive, du point <strong>de</strong> vue économique, politique et social.<br />
Dans le vaste travail très illustré <strong>de</strong> l’architecte et historien Jorge Rubiani sur <strong>la</strong><br />
guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alliance, nous trouvons les affirmations suivantes :<br />
L’étendue démesurée <strong>de</strong> <strong>la</strong> province n’a suscité aucun problème, tant que sa popu<strong>la</strong>tion<br />
était concentrée dans le siège marqué par <strong>la</strong> présence solitaire d’Asunción. Mais<br />
dès que <strong>de</strong> nouvelles villes commençèrent à surgir, obligées <strong>de</strong> protéger le territoire<br />
et <strong>de</strong> mettre fin à <strong>la</strong> présence portugaise tenace, les inconvénients se manifestèrent.<br />
Le premier démembrement, celui <strong>de</strong> Santa Cruz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sierra, eut lieu en 1562. C’était<br />
une consommation « rusée » <strong>de</strong> Ñuflo <strong>de</strong> Chávez, favorisé par <strong>la</strong> méconnaissance historique<br />
<strong>de</strong>s autorités concernant les singu<strong>la</strong>rités <strong>de</strong>s territoires à leur charge. Cette<br />
négligence — aux dépens du Paraguay — al<strong>la</strong>it se manifester encore à plusieurs reprises.<br />
Lorsque le roi Philippe III signa le malheureux brevet royal le 16 décembre<br />
1616, <strong>la</strong> <strong>de</strong>stinée du Paraguay resta à <strong>la</strong> merci <strong>de</strong> ses voisins du sud. Au moyen <strong>de</strong><br />
dispositions, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sseins et <strong>de</strong> décrets <strong>de</strong> ceux qui géraient à tâtons <strong>la</strong> <strong>de</strong>stinée <strong>de</strong>s<br />
295<br />
Figure 1.<br />
Carte coloniale <strong>de</strong>s<br />
limites <strong>de</strong> l’ancienne<br />
province du Paraguay
JULIO CORREA<br />
296<br />
Colonies, ce qui restait <strong>de</strong> l’ancienne province géante <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s fut divisé en <strong>de</strong>ux :<br />
celle du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, qui comprenait Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes et<br />
Concepción <strong>de</strong>l Bermejo, et <strong>la</strong> nouvelle province <strong>de</strong>l Guairá, intégrée par Vil<strong>la</strong> Rica,<br />
Ciudad Real, Xerez, auxquelles s’ajouta, presque subrepticement, <strong>la</strong> ville d’Asunción.<br />
Le Paraguay <strong>de</strong>meurait ainsi enveloppé à vie dans l’asphyxiante atmosphère méditerranéenne.<br />
Mais s’il n’existait dans cet édit aucune mention concernant les divisions<br />
géographiques (seulement celles du gouvernement), <strong>de</strong>s limites précises<br />
n’étaient pas non plus exprimées, même s’il restait établi que <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> division<br />
entre les <strong>de</strong>ux provinces étaient « <strong>la</strong> rivière Bermejo et le fleuve Paraná central ».<br />
Celui-ci n’al<strong>la</strong>it pas être pour autant le <strong>de</strong>rnier coup <strong>de</strong>stiné à gêner l’intégralité territoriale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> province. Par le traité <strong>de</strong> Madrid, signé avec le Portugal plus d’un siècle<br />
plus tard, l’Espagne abandonnait les territoires qu’elle avait déjà perdus <strong>de</strong> fait : ceux<br />
qui étaient restés sous l’abri <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarcation établie dans le traité <strong>de</strong> Tor<strong>de</strong>sil<strong>la</strong>s<br />
en 1594. Le nouveau traité remit au Portugal non seulement <strong>de</strong>s territoires du Paraguay<br />
(...), mais aussi sept vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s missions jésuites 4 .<br />
Le traité <strong>de</strong> Saint-Il<strong>de</strong>fonse <strong>de</strong> 1777 est également évoqué par rapport à <strong>la</strong> démarcation<br />
<strong>de</strong>s territoires, toujours favorables à <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> Lisbonne, dû au manque <strong>de</strong> coopération<br />
et aux attitu<strong>de</strong>s envahissantes <strong>de</strong>s Portugais.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> septième amputation territoriale dont pâtit <strong>la</strong> province, et avec <strong>la</strong> promulgation<br />
du décret du 17 janvier 1782, Asunción <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> <strong>la</strong> mairie du Paraguay.<br />
Les limites, coïncidant avec celles du district <strong>de</strong> l’évêché, furent fixées dans ce document.<br />
Ces limites étaient les mêmes que celles accordées dans les traités <strong>de</strong> 1750 et 1777 et qui,<br />
par rapport à <strong>la</strong> frontière entre le Paraguay et les provinces du sud, établissaient <strong>la</strong> ligne<br />
suivante: les fleuves Paraná, Uruguay, les rivières Bermejo, Yberá, Mirinay et Ibycui, jusqu’à<br />
<strong>la</strong> source <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière dans le grand nœud <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra Santa Ana, et une ligne<br />
partant <strong>de</strong> là jusqu’à l’embouchure <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Pepiry Guazu en Uruguay. Mais en 1803,<br />
le roi Charles III éleva à <strong>la</strong> catégorie <strong>de</strong> gouvernement indépendant les trente vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s<br />
anciennes missions du Paraguay. Deux ans plus tard, le même monarque rattacha ces vil<strong>la</strong>ges<br />
à ses territoires et désigna Dom Bernardo <strong>de</strong> Ve<strong>la</strong>zco comme gouverneur militaire<br />
et politique et maire <strong>de</strong> <strong>la</strong> province du Paraguay et <strong>de</strong>s trente vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong>s indiens<br />
Guaranis et tapes du Paraná, <strong>de</strong> l’Uruguay et du Paraguay 4 .<br />
Bernardo <strong>de</strong> Ve<strong>la</strong>zco fut le <strong>de</strong>rnier gouverneur espagnol, et le mouvement <strong>de</strong> libération<br />
du 14 et du 15 mai 1811, date à <strong>la</strong>quelle le Paraguay obtint son indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mère patrie, eut lieu pendant sa gestion.<br />
Pour connaître les événements diplomatiques survenus après <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple<br />
Alliance, qui établirent définitivement les limites actuelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> République du Paraguay,<br />
nous évoquerons les faits les plus marquants qui eurent lieu avec comme terrain<br />
<strong>de</strong> négociation les dispositions du traité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alliance, dans un cadre <strong>de</strong> négociations<br />
difficile, eu égard aux mésententes entre le Brésil et l’Argentine en raison <strong>de</strong><br />
conflits d’intérêts.<br />
Le Brésil accepta le fait <strong>de</strong> ne pas remettre en cause <strong>la</strong> fixation <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Apa<br />
comme limite entre le Paraguay et le Brésil, ce qui signifiait <strong>la</strong> cession du territoire paraguayen.<br />
Cette ambition fut nettement exprimée dans le traité <strong>de</strong> janvier 1872, signé<br />
par le baron <strong>de</strong> Cotegipe et Carlos Loizaga, représentant paraguayen. Le 20 mai 1875 un<br />
traité <strong>de</strong> limites fut signé par le représentant paraguayen, Jaime Sosa, et le représentant<br />
argentin, Carlos Tejedor, dans lequel le Paraguay cédait son territoire jusqu’à <strong>la</strong> rivière<br />
Ver<strong>de</strong>, dans le Chaco occi<strong>de</strong>ntal. Ce traité ne fut pas approuvé par le gouvernement du<br />
prési<strong>de</strong>nt Juan B. Gill. De nouvelles négociations aboutirent à l’accord souscrit par le Paraguayen<br />
Facundo Machain et l’Argentin Bernardo <strong>de</strong> Irigoyen, les Argentins é<strong>la</strong>rgissant<br />
leur territoire jusqu’à <strong>la</strong> rivière Pilcomayo. Un jugement <strong>de</strong> Salomon fut rendu en soumettant<br />
à l’arbitrage <strong>la</strong> ban<strong>de</strong> comprise entre <strong>la</strong> rivière Pilcomayo et <strong>la</strong> rivière Ver<strong>de</strong> ;
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
l’arbitre choisi fut le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s États-Unis, Rutherford B. Hayes, qui se prononça en<br />
faveur du Paraguay 5 .<br />
■ Les Guaranis : <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine : empirique <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et son application empirique aux ma<strong>la</strong>dies générales et son et cutanées application<br />
aux ma<strong>la</strong>dies générales et cutanées<br />
Nous avons vu l’étendue territoriale que les Guaranis-Tupis occupaient, répartis en<br />
plusieurs nations et avec <strong>de</strong>s noms qui évoquent <strong>de</strong> multiples expressions d’organisation<br />
sociale, politique, économique, administrative et <strong>de</strong>s mœurs. Ils durent affronter <strong>de</strong>s situations<br />
difficiles après <strong>la</strong> conquête et <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s Espagnols et notamment <strong>de</strong>s Portugais.<br />
Des peuples entiers qui vivaient i<strong>de</strong>ntifiés à <strong>la</strong> nature farouche qui les entourait,<br />
pacifiquement, qui <strong>la</strong>bouraient <strong>la</strong> terre, chassaient dans les montagnes, dominaient les rivières<br />
et les ruisseaux, apprivoisaient <strong>de</strong>s animaux sauvages, vivaient dans <strong>de</strong>s communautés<br />
nombreuses et petites, avec <strong>de</strong>s croyances religieuses définies, <strong>de</strong>vaient aussi<br />
<strong>de</strong>venir guerriers et défendre avec zèle le territoire qu’ils habitaient.<br />
Le métissage fut inévitable. Les traits <strong>de</strong>s races d’Amérique et d’Europe fusionnèrent<br />
tout en conservant les vertus <strong>de</strong> chaque lignage, qui constituent aujourd’hui les reflets<br />
constants d’une pério<strong>de</strong> rayonnante <strong>de</strong> nos ancêtres. Moisés S. Bertoni, savant suisse,<br />
habitant et écrivant au Paraguay, cite Carlos Cuervo Márquez dans son livre La Civilización<br />
guaraní [La civilisation guarani] pour faire un portrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> race :<br />
Le courage indomptable, l’énergie et <strong>la</strong> ténacité avec lesquels ils défendaient <strong>la</strong> liberté<br />
et leur indépendance ; <strong>la</strong> guerre à mort désespérée qu’ils menèrent pour essayer<br />
<strong>de</strong> résister aux envahisseurs européens lorsqu’ils furent convaincus qu’ils<br />
étaient <strong>de</strong>s conquérants venus les priver <strong>de</strong> leurs propriétés, les arracher à leurs<br />
foyers et les réduire à l’esc<strong>la</strong>vage le plus dur ; <strong>la</strong> férocité avec <strong>la</strong>quelle, par vengeance,<br />
ils répondirent à <strong>la</strong> cruauté imp<strong>la</strong>cable et à <strong>la</strong> perfidie inouïe <strong>de</strong>s Européens,<br />
fit que le nom « caraïbe » <strong>de</strong>vint aussitôt synonyme <strong>de</strong> courageux, <strong>de</strong> sanguinaire et<br />
<strong>de</strong> cruel, et que les individus <strong>de</strong> cette race furent considérés comme <strong>de</strong>s brutes féroces,<br />
dont <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction était permise et l’esc<strong>la</strong>vage décrété 6 .<br />
La détermination et les différentes stratégies employées par chaque peuple définirent<br />
<strong>la</strong> réalité d’alors qu’il fal<strong>la</strong>it savoir gérer pour préserver avec dignité <strong>la</strong> race menacée.<br />
Le plus grand connaisseur mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>la</strong> plus civilisée <strong>de</strong> toute <strong>la</strong> partie occi<strong>de</strong>ntale<br />
<strong>de</strong> notre Amérique n’exagérait pas en disant <strong>de</strong>s Guaranis : « C’était un <strong>de</strong>s<br />
peuples les plus grands et les plus remarquables <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre » (général Couto <strong>de</strong> Magalhaes,<br />
O Selvagem, cité par M.S. Bertoni).<br />
La longévité extraordinaire <strong>de</strong>s Guaranis était due à leur très bonne hygiène. La durée<br />
<strong>de</strong> vie ordinaire <strong>de</strong> nos Karaives était <strong>de</strong> cent cinquante ans ou plus. Faire sa toilette était<br />
une coutume généralisée; ils se baignaient dans les rivières quoiqu’il fasse froid. Les Chiriguanos<br />
nettoyaient leur tête avec <strong>de</strong>s semences écrasées <strong>de</strong> ñandihra. Ils prenaient également<br />
grand soin <strong>de</strong> leurs ongles et pas moins <strong>de</strong> leurs pieds. Aucune collectivité guarani<br />
n’était entièrement nue; mais <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tive nudité fut en revanche très familière. La question<br />
du vêtement nous mène à parler <strong>de</strong> <strong>la</strong> « rocourisation »; cette opération quotidienne<br />
était obligatoire parmi les Karaives et les Guaranis du nord et une partie du nord-est,<br />
leurs <strong>de</strong>scendants directs. Le rocou, ou bixa orel<strong>la</strong>na, est un arbre géotropique ordinaire<br />
cultivé par les Indiens, qui s’étend jusqu’aux régions <strong>de</strong>s sierras; il produit une matière<br />
colorante qui se forme autour <strong>de</strong>s semences. Aux Antilles et partout dans le nord <strong>de</strong> ce<br />
continent, elle est utilisée comme du safran dans <strong>de</strong> nombreux p<strong>la</strong>ts. Chaque matin, après<br />
le premier bain, avant <strong>de</strong> se sécher <strong>de</strong>vant le feu, le Karaive mâle se faisait frotter le corps<br />
avec un onguent <strong>de</strong> cette matière, empâtée généralement d’une huile <strong>de</strong> palme. Par <strong>la</strong><br />
297
JULIO CORREA<br />
298<br />
suite, tout le corps, y compris le visage, présentait un teint rougeâtre c<strong>la</strong>ir spécial, assez<br />
luisant, étrange, mais qui n’était pas désagréable à <strong>la</strong> vue ni au toucher, puisque toute<br />
tache <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau ou toute cicatrice s’effaçait et <strong>la</strong> peau restait très finement satinée, plus<br />
souple et plus résistante à <strong>la</strong> fois. Cette opération leur fournissait les moyens <strong>de</strong> se défendre<br />
<strong>de</strong>s effets nocifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> pluie, <strong>de</strong>s brûlures du soleil et du froid certaines nuits, et elle<br />
les préservait enfin <strong>de</strong>s piqûres <strong>de</strong>s insectes. La « rocourisation » préservait aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
transpiration excessive pouvant être à l’origine d’affaiblissements et, en <strong>la</strong> renouve<strong>la</strong>nt <strong>de</strong><br />
jour en jour, par un <strong>la</strong>vage énergique, elle <strong>de</strong>vait également éliminer toutes les impuretés<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Cette friction huileuse tellement répétée <strong>de</strong>vait aussi endiguer le processus <strong>de</strong><br />
vieillissement, aussi bien superficiel et veineux qu’interne, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s exercices que<br />
leur flexibilité corporelle leur permettait <strong>de</strong> faire jusqu’à un âge avancé.<br />
D’un bout à l’autre du domaine karaive-guarani, <strong>la</strong> scarification était une pratique<br />
générale et caractéristique. Elle <strong>de</strong>meure au moins partiellement conservée dans toutes<br />
les entités libres actuelles. Elle visait à plusieurs objectifs, au moyen <strong>de</strong> plusieurs procédures<br />
et d’un rituel spécial pour chacun <strong>de</strong>s buts qu’elle poursuivait. Ceux-ci furent au<br />
moins six : trois curatifs, <strong>de</strong>ux mystiques, et un d’ordre hygiénique pour combattre <strong>la</strong> fatigue<br />
excessive. La scarification se réalisait au moyen d’une <strong>de</strong>nt d’akutí, <strong>de</strong> silex, <strong>de</strong><br />
côtes <strong>de</strong> tacuarembó ou <strong>de</strong> feuilles coupantes, d’aiguillons <strong>de</strong> palmier, d’arêtes <strong>de</strong> poisson<br />
ou <strong>de</strong> matières semb<strong>la</strong>bles, selon les régions. Suivant leur profon<strong>de</strong>ur, les incisions<br />
se divisaient en tugwihkih et tugwihka ; dans le premier cas, le sang est assez abondant<br />
pour tremper toute <strong>la</strong> zone affectée ; dans le second cas, le sang cou<strong>la</strong>it abondamment<br />
ou à petits jets. La première forme suffisait en général pour remédier à <strong>la</strong> fatigue et elle<br />
pouvait être souvent réitérée. La <strong>de</strong>uxième entraînait <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>ises pendant une ou <strong>de</strong>ux<br />
semaines, et parfois le patient <strong>de</strong>vait rester au lit pendant plusieurs jours, à p<strong>la</strong>t ventre.<br />
La partie postérieure, du dos jusqu’aux fesses, et dans quelque cas les mollets, était <strong>la</strong><br />
partie <strong>la</strong> plus souvent sacrifiée. Seulement en cas <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die, on <strong>la</strong> pratiquait là où se<br />
trouvait le mal, comme on le faisait avec les sangsues et les ventouses scarifiées. Avec <strong>la</strong><br />
scarification, une décongestion locale était évi<strong>de</strong>mment effectuée. Pour expliquer comment<br />
<strong>la</strong> décongestion pouvait éliminer <strong>la</strong> fatigue, il semblerait que <strong>la</strong> seule explication<br />
soit <strong>la</strong> suivante : les toxines et certains résidus qui se fixent progressivement dans les<br />
muscles soumis à un travail excessif sont éliminés avec le sang et <strong>la</strong> lymphe.<br />
Admis quand il <strong>de</strong>venait majeur, l’homme <strong>de</strong>vait se soumettre au préa<strong>la</strong>ble à l’un <strong>de</strong>s<br />
traitements les plus rigoureux, qui <strong>de</strong>vait aussi mettre à l’épreuve sa résistance aux souffrances,<br />
et il était pour ce<strong>la</strong> vite soigné, mais très douloureusement. À <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong><br />
chaque enfant mâle, le père se faisait une autre scarification, plus rigoureuse pour l’aîné.<br />
Dans quelques collectivités — sinon dans toutes —, il fal<strong>la</strong>it recueillir du sang pour faire<br />
une marque au nouveau-né et lui communiquer ainsi une partie <strong>de</strong> l’esprit du père, puisqu’il<br />
était admis que <strong>la</strong> vie se trouvait essentiellement dans le sang, et l’âme dans le<br />
cœur. La scarification expiatoire revêtait différentes formes et présentait différentes intensités,<br />
selon <strong>la</strong> faute à expier, l’erreur à purger, le danger métapsychique à éviter ou<br />
d’autres motifs <strong>de</strong> ce genre. Il faut signaler que les scarifications étaient à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> longs<br />
révulsifs, et comme elles étaient assez fréquentes, elles <strong>de</strong>vaient contribuer à <strong>la</strong> conservation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé générale du corps, même si elles n’étaient pas curatives. Lorsque <strong>la</strong><br />
cicatrisation n’était pas activée par <strong>de</strong>s moyens artificiels, <strong>la</strong> révulsion était plus puissante<br />
encore parce que, dans ce cas, les blessures guérissaient plus lentement et toujours<br />
avec un écoulement <strong>de</strong> pus. Dans quelques régions, celui-ci semble avoir été le cas<br />
le plus fréquent, à en juger par les nombreux signes indélébiles que présentaient les habitants.<br />
Mais on savait, et on le sait encore aujourd’hui, comment soigner <strong>de</strong> telles blessures<br />
<strong>de</strong> sorte que ne subsiste presque aucune cicatrice. Certaines substances étaient<br />
employées comme désinfectants. Par exemple, le jus du fruit du ñandihpa-guazú ou genipapo<br />
(Genipa americana) était fréquemment utilisé comme désinfectant <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
pour certaines ma<strong>la</strong>dies, au point qu’on s’en teignait tout le corps, coutume conservée
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
jusqu’à présent. La décoction <strong>de</strong> Paraih, dite aussi « bois amer » (Picrasma paloamargo),<br />
et d’autres espèces simarubacées (Simaruba, Quassia, Simaba) était très utilisée<br />
pour désinfecter <strong>la</strong> peau et <strong>la</strong> protéger contre les piqûres <strong>de</strong>s insectes et <strong>de</strong>s<br />
moustiques. L’usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> première est encore fréquent, elle semble être <strong>la</strong> plus active et<br />
elle s’étend jusqu’au sud-est du Paraguay. Les Guaranis considéraient l’eau bouillie également<br />
appropriée pour favoriser l’asepsie et désinfecter les zones ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ; le baron<br />
Nor<strong>de</strong>nskiold louait beaucoup son utilisation parmi les Guaranis.<br />
Signalons que l’art <strong>de</strong> guérir était pratiqué parmi les Guaranis par le payé, un indigène<br />
reconnu dans <strong>la</strong> communauté, observateur, intelligent, qui disposait d’un arsenal<br />
thérapeutique formé d’innombrables p<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong> jungle, dont les vertus étaient bien<br />
connues.<br />
D’après Moisés Bertoni, le mot payé fit p<strong>la</strong>ce à une certaine confusion. Son acception<br />
n’est pas i<strong>de</strong>ntique dans tous les pays, et elle ne semble pas l’avoir été non plus autrefois.<br />
Il ne peut pas être considéré comme synonyme d’« enchanteur », parce qu’aucun<br />
peuple guarani ne fut fétichiste ni n’utilisa <strong>de</strong> fétiches. Le payé est toujours un mé<strong>de</strong>cin,<br />
mais pas essentiellement ; il se sert surtout <strong>de</strong> <strong>la</strong> suggestion et du magnétisme (qui ne signifie<br />
pas « guérir par <strong>la</strong> parole » comme quelques-uns le croient, et qui est une coutume<br />
superstitieuse d’origine européenne). « Le tuvichava, dit erronément « cacique »,<br />
est aussi mé<strong>de</strong>cin en général ; le kurupaih-voñanga l’est aussi, mais il est plutôt penché<br />
vers le spiritisme et l’évocation <strong>de</strong>s esprits 6 .»<br />
En ce qui concerne les ma<strong>la</strong>dies, certains abcès méritent notre attention. En particulier,<br />
le furoncle ou miã a parfois un caractère épidémique et il atteint tout le mon<strong>de</strong>, tandis<br />
que les nacidos ordinaires poursuivent davantage les B<strong>la</strong>ncs et les gens non<br />
acclimatés. Personne ne constata un seul cas <strong>de</strong> scrofule, que je sache, parmi les Indiens<br />
<strong>de</strong> race guarani, vivant sans être en contact avec <strong>de</strong>s chrétiens (tekokatu).<br />
Il est étonnant que les anciens écrivains se soient si peu occupés <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
parasitaires. La leishmaniose était mal interprétée, et elle était appelée syphilis en<br />
Espagne, c’est-à-dire bouba, et comme quelques nations guaranis l’appe<strong>la</strong>ient piã (nom<br />
que d’autres donnaient à une ma<strong>la</strong>die qui fut confondue avec <strong>la</strong> syphilis), <strong>la</strong> confusion fut<br />
générale.<br />
Ils connaissaient parfaitement le paludisme, avec ses manifestations générales et <strong>la</strong><br />
périodicité <strong>de</strong>s crises, selon <strong>la</strong> variété <strong>de</strong>s parasites.<br />
En ce qui concerne <strong>la</strong> lèpre, Bertoni parle en détail <strong>de</strong> son traitement empirique, mais<br />
il ne décrit pas les lésions c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong> ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. Les Guaranis combattaient cette affection,<br />
introduite par les Européens en Amérique, par <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> transpiration à jets.<br />
La procédure paraguayenne pour soigner <strong>la</strong> lèpre semble être i<strong>de</strong>ntique à ce que Rochefort<br />
vit aux Antilles. Il faut construire un four d’une capacité telle que <strong>la</strong> personne<br />
puisse tenir <strong>de</strong>dans confortablement assise. Le four est fabriqué en boue ordinaire.<br />
Immédiatement après l’avoir construit et pendant que <strong>la</strong> boue est mouillée (il ne faut<br />
pas <strong>la</strong> <strong>la</strong>isser sécher), on y fait un feu léger, non pas pour le brûler mais pour le<br />
chauffer ; ce<strong>la</strong> peut se faire avec du feuil<strong>la</strong>ge mort ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> paille. Une fois le feu opportunément<br />
éteint et <strong>la</strong> chaleur intérieure vérifiée, le patient est totalement enfermé<br />
dans le four pour voir s’il pourra supporter <strong>la</strong> chaleur ; le four est recouvert avec <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> boue pétrie, <strong>la</strong>issant <strong>de</strong>ux trous ou une ouverture, pour que le patient puisse regar<strong>de</strong>r<br />
et respirer. L’énorme tension <strong>de</strong> <strong>la</strong> vapeur, déterminée par <strong>la</strong> saturation d’humidité<br />
et <strong>la</strong> haute température, ne tar<strong>de</strong> pas à produire une transpiration si<br />
abondante qu’elle ne peut pas être réitérée. La sueur coule partout sur le corps et<br />
ensuite par le fond du four. Je crois que l’opération ne dépasse pas trente minutes ou<br />
une heure maximum. À ce moment-là, le four est ouvert et le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> en ressort. C’est<br />
un moment critique et dangereux. Les infirmiers doivent recouvrir aussitôt le ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
avec <strong>de</strong>s ponchos et <strong>de</strong>s couvertures en <strong>la</strong>ine et essuyer en même temps tout son<br />
299
JULIO CORREA<br />
300<br />
corps. Il est indispensable d’agir vite, et que <strong>la</strong> sueur soit séchée sans que le corps<br />
refroidisse ni ne reçoive <strong>de</strong> courant d’air. Le séchage se fait en frottant énergiquement<br />
le patient avec <strong>de</strong>s tissus en coton. Après ce<strong>la</strong>, le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> est complètement enveloppé,<br />
si possible avec <strong>de</strong>s vêtements en <strong>la</strong>ine, il est bien couvert et il va se coucher<br />
dans une chambre fermée, où il doit passer le reste <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée. Le len<strong>de</strong>main il<br />
peut se lever, mais il ne peut pas sortir s’il ne fait pas chaud et s’il y a du vent. Il est<br />
essentiel que le retour à <strong>la</strong> température normale, et enfin à <strong>la</strong> vie libre, se produise<br />
lentement et graduellement. Il est impossible d’affirmer actuellement que cette métho<strong>de</strong><br />
soit efficace et définitive. J’ajoute que l’idée que <strong>la</strong> lèpre soit une altération du<br />
sang est très générale 6 .<br />
La syphilis, cette ma<strong>la</strong>die universelle aux signes très versatiles, fait aussi l’objet <strong>de</strong><br />
l’analyse <strong>de</strong>s auteurs paraguayens <strong>de</strong> l’époque, et surtout <strong>de</strong> Moisés S. Bertoni, qui<br />
nous conduit dans ce chapitre. Dans l’excellent ouvrage Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
en el Perú [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou], <strong>de</strong>s Drs Luis et Elbio Flores Cevallos,<br />
l’origine <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis est réaffirmée, étayée par <strong>de</strong>s poteries précolombiennes.<br />
Bertoni, en revanche, garantit l’absence <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die avant l’arrivée <strong>de</strong>s<br />
Espagnols, et il signale qu’il est contradictoire et étrange <strong>de</strong> prendre pour <strong>américaine</strong><br />
une ma<strong>la</strong>die dont les peuples américains ne souffraient pas, et dont <strong>la</strong> propagation se<br />
fit très rapi<strong>de</strong>ment en Europe alors qu’elle ne se développa pas en Amérique pendant<br />
<strong>de</strong>s milliers d’années. Il souligne également le fait que les indigènes américains<br />
n’avaient pas <strong>de</strong> nom pour désigner cette ma<strong>la</strong>die, et que jusqu’alors, les indigènes<br />
<strong>de</strong>s tribus n’ayant pas eu <strong>de</strong> rapports sexuels avec les Européens ne l’avaient pas<br />
contractée.<br />
Tous les auteurs cités par Bertoni (Juan <strong>de</strong> Léry, Thevet, Guillermo Piso) signalent <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die dénominée piã ou pian, caractérisée par <strong>de</strong>s bubons généralisés, retrouvés parfois<br />
même chez <strong>de</strong>s enfants. D’après Rochefort, on se sert <strong>de</strong> l’écorce amère <strong>de</strong> l’arbre<br />
Chipihú, avec <strong>la</strong> nacre râpée d’un nambí (coquil<strong>la</strong>ge), le jus <strong>de</strong> certains ihsipós rampants<br />
ou Yhvihmbi, comme remè<strong>de</strong> ; certains onguents et liniments avaient le pouvoir remarquable<br />
<strong>de</strong> nettoyer les pustules présentes le plus souvent sur le corps <strong>de</strong> ceux qui étaient<br />
atteints <strong>de</strong> pian. Et il ajoute :<br />
Ils composent ces remè<strong>de</strong>s avec <strong>de</strong>s cendres <strong>de</strong> joncs ou <strong>de</strong>s pirí brûlés, avec lesquels<br />
ils mé<strong>la</strong>ngent l’eau qu’ils recueillent <strong>de</strong>s feuilles <strong>de</strong>s caulinaires ; ils emploient aussi<br />
dans le même but le jus du fruit du genipa et ils appliquent <strong>la</strong> pulpe écrasée <strong>de</strong> ce<br />
fruit sur les boutons, qui a le pouvoir d’attirer tout le pus <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ies et <strong>de</strong> fermer les<br />
lèvres <strong>de</strong>s ulcères 6 .<br />
Les Guaranis connaissaient plusieurs procédures applicables aux différentes affections<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. La succion, qui en guarani se dit suvá, était très connue :<br />
Pour ce qui est du reste, les Guaranis connaissaient <strong>de</strong>puis longue date <strong>la</strong> véritable<br />
ventouse. La ventouse guarani n’était pas en verre, substance ignorée en Amérique,<br />
mais elle était fabriquée en coupant convenablement une courge calebasse ou porongo<br />
(Lagenaria vulgaris) <strong>de</strong> manière à former un entonnoir ou un cornet, qui s’appliquait<br />
comme nos ventouses, sauf qu’il fal<strong>la</strong>it extraire l’air par aspiration par <strong>la</strong><br />
partie étroite dûment trouée. Un bon suvandára (c’est ainsi qu’ils nomment l’opérateur)<br />
produit <strong>de</strong>s rubéfactions et <strong>de</strong>s soulèvements qui ont tout <strong>de</strong> même un effet sur<br />
certaines souffrances 6 .<br />
Le mé<strong>de</strong>cin ou payé tire profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaleur du feu et <strong>de</strong>s rayons so<strong>la</strong>ires. Selon Bertoni,<br />
qui cite Couto <strong>de</strong> Magalhaes :
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Ils utilisent aussi le feu comme agent thérapeutique en cas <strong>de</strong> morsures d’animaux<br />
venimeux, comme les vipères ou les raies. Ils ne cautérisent pas les blessures et les<br />
p<strong>la</strong>ies comme nous, mais ils approchent du feu le membre blessé et ils résistent jusqu’à<br />
ce qu’ils ne soient plus capables <strong>de</strong> supporter <strong>la</strong> chaleur ; alors ils l’éloignent et<br />
l’approchent bientôt une autre fois, et ainsi <strong>de</strong> suite jusqu’à ce qu’une sorte <strong>de</strong> torpeur<br />
vienne après <strong>la</strong> chaleur, <strong>la</strong>issant <strong>la</strong> douleur endormie 6 .<br />
Signalons que grâce à l’attention qu’ils portaient à leur toilette et à leur régime alimentaire<br />
strict, les indigènes présentaient très peu <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatoses. Guillermo Piso, cité par<br />
Bertoni, en indique seulement <strong>de</strong>ux: <strong>la</strong> dartre et l’éruption cutanée. Pour <strong>la</strong> dartre (en guarani<br />
uñé, dénomination qui persiste jusqu’à nos jours et qui est utilisée par nos compatriotes<br />
<strong>de</strong>s hôpitaux <strong>de</strong> l’État pour désigner <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatophytie), on se sert d’une herbe à<br />
l’aspect graminacé et mo<strong>de</strong>ste, dite yupikaih, qui est écrasée. On emploie également <strong>la</strong><br />
cosse d’une légumineuse, le Phaseolus caracal<strong>la</strong>, et dans <strong>de</strong>s cas très virulents, l’écorce <strong>de</strong><br />
sevipira, arbre brésilien à l’action très intense.<br />
La sudamine, une éruption cutanée, peut être arrêtée par <strong>la</strong> décoction <strong>de</strong> racines <strong>de</strong><br />
yuripe (luripeva) avec <strong>de</strong>s citrons. Une <strong>de</strong>s espèces très semb<strong>la</strong>ble au So<strong>la</strong>num robustum<br />
(yaguarete-pó), à un effet remarquable sur les p<strong>la</strong>ies et les ulcères en général.<br />
Certains auteurs anciens mentionnent <strong>la</strong> leishmaniose parmi les ulcères et <strong>la</strong> bouba.<br />
Pour soigner les ulcères, on utilisait les ka’ã-tai, Polygonum acre et <strong>de</strong>s espèces semb<strong>la</strong>bles<br />
et le <strong>la</strong>it du guapoih (Picus).<br />
Un <strong>de</strong>s maux les plus fréquents dans les <strong>de</strong>ux Amériques est sans doute l’ura (Dermatobia<br />
hominis) du nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve <strong>de</strong> cette mouche, distinguée <strong>de</strong> l’animal adulte par<br />
le nom <strong>de</strong> mberuasó, les <strong>de</strong>ux termes étant guaranis. Pour protéger <strong>de</strong> l’ura, les insectifuges<br />
ne sont pas toujours efficaces ; cependant, connaissant les conditions atmosphériques<br />
et les heures dangereuses, et se parfumant avec certaines p<strong>la</strong>ntes, les Indiens<br />
l’évitaient généralement, en utilisant <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> chupad et <strong>la</strong> décoction du paraih, et<br />
dans le nord-est, <strong>de</strong>s baumes divers et <strong>la</strong> connaissance du tarokih, une Cassia aux propriétés<br />
remarquables (p<strong>la</strong>ntes <strong>américaine</strong>s). En cas d’attaques (fréquentes), ils ne pratiquaient<br />
jamais d’entaille ; plus <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve était petite, plus ils l’extrayaient après une<br />
narcotisation avec du tabac, ou ils l’asphyxiaient au moyen <strong>de</strong> l’écorce contuse d’ihvaika<br />
(Ocotea), ou d’une autre substance à effet analogue, tirant ensuite <strong>la</strong> <strong>la</strong>rve par pression.<br />
Des insectifuges sont mentionnés, comme le paraih (Picrasma palo-amargo), le paraihva<br />
du nord-est (Simaruba versicolor) et ceux du nord (Simaruba, Simaba, Quassia).<br />
Le gwembé, <strong>de</strong>signant par ce nom <strong>de</strong>ux ou trois espèces très semb<strong>la</strong>bles aux grands philo<strong>de</strong>ndrons,<br />
appelées aussi embe, aimbe, guembepi (Ph. bipinnatifidum, Ph. lundii, Ph. lubium<br />
et peut-être une autre), les meilleurs moyens <strong>de</strong> défense contre les chiques ou les<br />
niguas (les puces chiques ou Tunga penetrans), est un autre insectifuge puissant.<br />
Les remè<strong>de</strong>s utilisés par les Guaranis contre les morsures <strong>de</strong>s ophidiens correspondaient<br />
à quatre catégories différentes, bien que quelques-uns puissent entrer dans <strong>de</strong>ux<br />
ou trois catégories en même temps. La première visait à l’élimination du venin, <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième à le neutraliser, <strong>la</strong> troisième à maintenir <strong>la</strong> vitalité et <strong>la</strong> quatrième à prévenir<br />
les effets secondaires et l’infection générale. Sont citées : l’application <strong>de</strong> boue sur les<br />
morsures venimeuses, les ventouses scarifiées, <strong>la</strong> cautérisation, mais pas l’échaudage.<br />
Le processus sudorifique était le plus répandu. La neutralisation était tentée <strong>de</strong> plusieurs<br />
manières, au moyen du yahape (Kullinga adorata), <strong>la</strong> cypéracée qui porte <strong>la</strong> désignation<br />
au Paraguay <strong>de</strong> kaapi-kati-payé; son action était peut-être plus carminative. Le tabac,<br />
le caapiã (Dorstenia), le jus en application externe, ou l’infusion à froid <strong>de</strong> <strong>la</strong> racine<br />
contuse en application interne, les catap<strong>la</strong>smes avec du manioc (<strong>la</strong> racine crue et râpée),<br />
étaient <strong>de</strong>s neutralisants plus efficaces.<br />
Il faut mentionner également <strong>la</strong> salive d’une personne à jeun appliquée sur <strong>la</strong> blessure,<br />
<strong>la</strong> maintenant humi<strong>de</strong>. Comme désinfectant, on utilisait l’essence <strong>de</strong> l’encens<br />
301
JULIO CORREA<br />
302<br />
(Myrocarpus frondosus); sur <strong>la</strong> peau, le fruit du guavira (Campomanesia guavira et <strong>de</strong>s<br />
espèces semb<strong>la</strong>bles) ; parmi les meilleurs, citons le ihsihpo kat ou milhombres (Aristolochia<br />
brasiliensis, Ar. Triangu<strong>la</strong>ris), qui maintient les forces, combattant <strong>la</strong> paralysie. Le<br />
véritable yahape (Kyllinga), fort carminatif, s’utilise <strong>de</strong> manière i<strong>de</strong>ntique.<br />
Les Guaranis avaient <strong>de</strong>s connaissances sur l’immunisation par l’inocu<strong>la</strong>tion préa<strong>la</strong>ble.<br />
Ils se faisaient mordre par <strong>de</strong>s espèces portant un faible venin, par exemple <strong>la</strong> couleuvre<br />
ñakanina, <strong>de</strong> sorte que les éventuelles morsures <strong>de</strong>s vipères les plus dangereuses<br />
ne leur soient pas mortelles 6 .<br />
Le traitement <strong>de</strong>s blessures; gangrène, désinfection<br />
Les Guaranis, qui vivaient intégrés à <strong>la</strong> nature et qui, dans <strong>de</strong>s circonstances spécifiques,<br />
al<strong>la</strong>ient à <strong>la</strong> guerre, souffraient <strong>de</strong> toutes sortes <strong>de</strong> lésions cutanées. Le pansement<br />
se faisait avec <strong>de</strong>s tissus en coton. Le <strong>la</strong>vage <strong>de</strong>s blessures fraîches était rarement<br />
pratiqué, avec <strong>de</strong> l’eau bouillie selon le pays ou <strong>la</strong> région. Parfois, ce<strong>la</strong> s’effectuait avec<br />
certaines huiles comme celle <strong>de</strong> karaiva, distillée à partir d’un arbre du nord-est, qui<br />
sert en même temps contre les tumeurs en général.<br />
La médication <strong>la</strong> plus employée était l’essence du Myrocarpus, c’est-à-dire <strong>la</strong> résine<br />
d’encens, obtenue par <strong>la</strong> cuisson ou l’infusion du Myrocarpus frondosus — ou les espèces<br />
semb<strong>la</strong>bles dites kavureih ou kavureihva — dans <strong>de</strong> l’eau chau<strong>de</strong> ou froi<strong>de</strong>. Parmi les plus<br />
utilisées, on trouvait également le mboichini-ka’a, très souvent appelé yerba santa (Baccharis<br />
vulneraria Backer), dont les feuilles vertes s’appliquent sur les blessures.<br />
Ils possédaient assez <strong>de</strong> connaissances sur l’application <strong>de</strong> <strong>la</strong> médication topique selon<br />
les régions anatomiques où les lésions étaient situées. Pour <strong>la</strong> tête, en cas <strong>de</strong> contusion ou<br />
<strong>de</strong> blessure ouverte, ils se servaient <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong> chupad comme remè<strong>de</strong> imparable. Le<br />
blessé était mis en position <strong>de</strong> hamac <strong>de</strong> manière à ce que sa tête reste plus haute que<br />
son corps. Pour les yeux, ils utilisaient le jus <strong>de</strong> kupaihra, obtenu par décoction en le mé<strong>la</strong>ngeant<br />
avec <strong>de</strong> l’albumine contenue dans du b<strong>la</strong>nc d’œuf. Pour les lésions <strong>de</strong>s pieds, le<br />
chupad ajouté au baume ou à <strong>la</strong> résine d’encens. Les résines oléo-essentielles <strong>de</strong> plusieurs<br />
espèces d’Icica, Myrocarpus, Myroxylon, Protium, et d’autres espèces semb<strong>la</strong>bles se substituaient<br />
à l’encens et au chupad, là où ces arbres se faisaient plus rares. Ils employaient<br />
ces oléo-résines pour que les blessures ne <strong>la</strong>issent pas <strong>de</strong> cicatrices. Cette procédure était<br />
aussi utilisée pour effacer les traces <strong>de</strong>s scarifications.<br />
D’autres p<strong>la</strong>ntes étaient également capables d’effacer les cicatrices. En par<strong>la</strong>nt du kurupaih<br />
du nord-est, un observateur note : « Les Indiens se servent du <strong>la</strong>it <strong>de</strong> cet arbre<br />
pour soigner les blessures nouvelles et vieilles... et ils disent que les blessures sur lesquelles<br />
est appliqué ce <strong>la</strong>it ne <strong>la</strong>issent aucune cicatrice. »<br />
Pour les blessures contuses, avec formation d’hématomes, ils utilisaient, à part les<br />
huiles <strong>de</strong> kupaih, le jus <strong>de</strong> cuisson <strong>de</strong> <strong>la</strong> racine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Boehmeria caudata, une urticacée<br />
très courante.<br />
Pour les blessures gangréneuses, le tabac était très fréquent, même si les aristoloches<br />
déjà citées étaient plus puissantes. Le ka’átai (Poligonum acre) était employé par les Indiens<br />
du Nord. D’après Mello Moraes, on utilisait également pour les ulcérations, outre<br />
<strong>la</strong> médication spécifique comme les akapus, un groupe d’espèces d’andira, l’avaramo, <strong>la</strong><br />
momosa unguiscati, le sihpakarihó (Davil<strong>la</strong> rugueuse et D. brasilian), <strong>la</strong> manipuera, une<br />
pâte <strong>de</strong> manioc râpé avec son jus, les guapoih (Picus), le penaihva, une espèce <strong>de</strong> mancenillier<br />
<strong>de</strong>s Antilles et <strong>de</strong> l’Amazone (Hippomane) et beaucoup d’autres p<strong>la</strong>ntes. Les Indigènes<br />
soignaient l’ulcération cancéreuse au moyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> sève <strong>de</strong> l’arbre penaihva.<br />
Après l’avoir séchée, ils l’entouraient d’une pâte faite <strong>de</strong> rocou avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> boue, pour que<br />
le <strong>la</strong>it versé sur l’ulcère ne se répan<strong>de</strong> pas. Les tissus mortifiés noircissaient, se séparaient<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> partie saine, et <strong>la</strong> blessure déjà nettoyée était soignée avec <strong>de</strong> l’huile <strong>de</strong><br />
kupaih et <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes émollientes.
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Ils connaissaient les métho<strong>de</strong>s d’asepsie et <strong>de</strong> désinfection. Mello Moraes parle d’une<br />
p<strong>la</strong>nte aromatique appelée tarerokih, avec <strong>la</strong>quelle les Indiens se parfumaient, lorsqu’ils<br />
tombaient ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s, parce qu’ils croyaient qu’elle possédait <strong>de</strong>s propriétés antiputri<strong>de</strong>s.<br />
Ils employaient dans le même but les fleurs <strong>de</strong> guavira (Campomanesia) et <strong>de</strong>s cuissons<br />
<strong>de</strong> feuilles <strong>de</strong> taperihua (Cassia), <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> kavureih (Myrocarpus), du <strong>de</strong>rma <strong>de</strong> l’ihsihpo-kati-paye<br />
(Aristoloche).<br />
Pour finir, nous <strong>de</strong>vons signaler que les Guaranis peignaient leur corps pour <strong>de</strong>s raisons<br />
variées : i<strong>de</strong>ntification tribale, ornementation, caractère guerrier, religion, signification<br />
magique, rappel mythique, initiation, cérémonie, fête, danses ou jeux, protection<br />
ou attraction, pour épouvanter <strong>de</strong> mauvais esprits, faire peur, arrivée <strong>de</strong> <strong>la</strong> puberté (du<br />
rouge ou du bleu), pendant les menstruations (du noir ou du bleu), chez <strong>de</strong>s mourants,<br />
pendant le <strong>de</strong>uil (mais pas toujours), pour le mariage. Le <strong>de</strong>uil fini (pério<strong>de</strong> d’abstinence<br />
sexuelle), <strong>la</strong> veuve peignait son visage en rouge.<br />
Les tatouages, bien qu’ils ne soient pas fréquents chez les Guaranis, se réalisaient avec<br />
les mêmes peintures, en se servant <strong>de</strong> matériaux tels que <strong>de</strong>s épines <strong>de</strong> nopal ou <strong>de</strong>s os<br />
pointus. Le tatouage était pratiqué progressivement; il commençait en général en bas âge,<br />
il <strong>de</strong>venait plus diffus pendant <strong>la</strong> puberté et les tatouages définitifs était faits à l’âge adulte.<br />
En ce qui concerne les ornements, quelques-uns étaient portés toute <strong>la</strong> vie et d’autres<br />
selon les occasions à caractère religieux, suivant les ethnies, le sexe et l’âge, entre autres<br />
facteurs. Actuellement, parmi les Mby’á, Pañ et Chiripá, les hommes aiment mettre <strong>de</strong>rrière<br />
leurs oreilles, jusqu’au jour <strong>de</strong> leur mariage, <strong>de</strong>s fleurs <strong>de</strong> belles couleurs vives ou<br />
<strong>la</strong> feuille <strong>de</strong> caraguatá moroty, fortement parfumée. Les Mby’á portent le tembetá, qui<br />
fut sans doute autrefois une pierre et qui est aujourd’hui le plus souvent un bâtonnet <strong>de</strong><br />
tacuarembó, sur <strong>la</strong> lèvre inférieure, <strong>de</strong>s os <strong>de</strong> tibia d’oiseaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> taille d’une poule, avec<br />
ou sans incrustations. La résine du hyary, mbary ou tembetary est utilisée aussi pour<br />
confectionner ces objets. La technique consiste à mettre une petite tige <strong>de</strong> bambou<br />
contre le tronc blessé d’un <strong>de</strong> ces arbres afin <strong>de</strong> recueillir <strong>la</strong> résine. Après quelques<br />
jours, le petit tuyau est plein et <strong>la</strong> résine a durci, <strong>de</strong> sorte qu’elle peut être libérée <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
forme qui l’enveloppe.<br />
Seules les femmes portaient <strong>de</strong>s ornements aux oreilles 7 .<br />
■ Aspects historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine au Paraguay.<br />
Re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Aspects historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine au Paraguay. Re<strong>la</strong>tion avec <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Après l’arrivée <strong>de</strong>s premiers conquérants, plusieurs événements se succédèrent : le<br />
choc <strong>de</strong>s cultures — pour ainsi dire —, <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> légen<strong>de</strong> d’un Eldorado qui<br />
éveil<strong>la</strong> <strong>la</strong> convoitise <strong>de</strong> beaucoup <strong>de</strong> navigants accompagnant ceux qui venaient s’emparer<br />
<strong>de</strong>s terres au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> Couronne, les traités entre les cours espagnole et portugaise<br />
sur <strong>de</strong>s définitions territoriales, <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s jésuites dans les réserves du Paraguay,<br />
d’Argentine et du Brésil, qui dura <strong>de</strong>ux cents ans, jusqu’à leur expulsion par le roi<br />
Charles III, au milieu du XVIII e siècle.<br />
Tous ces événements composèrent un cadre social où se produisit progressivement<br />
l’instal<strong>la</strong>tion d’institutions sanitaires, improvisées et rudimentaires au début, avec <strong>de</strong>s acteurs<br />
occasionnels qui agissaient en mé<strong>de</strong>cins, sans formation académique mais qui constituaient<br />
un ultime refuge pour contenir en quelque sorte les ma<strong>la</strong>dies légères ou sévères.<br />
Du travail du Dr Guillermo Vidal, retrouvé dans les annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences<br />
médicales, nous retenons cet extrait :<br />
Les premiers mé<strong>de</strong>cins européens arrivent au Paraguay avec les conquérants. Ce<strong>la</strong><br />
se produisit au XVI e siècle. Au cours <strong>de</strong>s capitu<strong>la</strong>tions que les a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntados fixaient<br />
avec le roi, il y avait souvent une c<strong>la</strong>use fixant l’obligation d’amener avec eux <strong>de</strong>s<br />
303
JULIO CORREA<br />
304<br />
mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s chirurgiens, <strong>de</strong>s apothicaires et <strong>de</strong>s médicaments, grâce auxquels les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s seraient soignés gratuitement pendant <strong>la</strong> traversée ou sur les terres<br />
conquises. Au début, ce furent les chirurgiens. Et pas <strong>de</strong>s diplômés, mais <strong>de</strong> simples<br />
barbiers qui savaient aussi bien faire saigner que raser, autant arracher <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts<br />
que mettre <strong>de</strong>s ventouses. Plus tard, vers <strong>la</strong> fin du XVI e siècle, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins chirurgiens<br />
diplômés commencèrent à exercer, mais ils étaient les moins nombreux. Le Rio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, qui en dépit <strong>de</strong> son nom ne possédait ni argent ni rien <strong>de</strong> semb<strong>la</strong>ble, offrait<br />
peu d’attrait aux docteurs en mé<strong>de</strong>cine et en chirurgie. Ce que nous appelons<br />
aujourd’hui <strong>la</strong> dysenterie, <strong>la</strong> variole, le paludisme et l’avitaminose, qui furent probablement<br />
les affections médicales les plus courantes à l’époque, étaient surtout traités<br />
avec <strong>de</strong>s purgatifs, <strong>de</strong>s saignées et <strong>de</strong>s ventouses. Leurs tâches habituelles consistaient<br />
à éclisser <strong>de</strong>s os fracturés, réduire <strong>de</strong>s dislocations, drainer <strong>de</strong>s abcès, cautériser<br />
<strong>de</strong>s blessures et amputer <strong>de</strong>s membres gangrenés. Leurs remè<strong>de</strong>s préférés<br />
étaient <strong>la</strong> purge et <strong>la</strong> saignée, <strong>de</strong> véritables panacées. Ils avaient aussi quelquefois<br />
recours à <strong>la</strong> poudre <strong>de</strong> licorne, au bézoard miraculeux ou aux mille et un breuvages<br />
dans lesquels ne manquaient jamais le vin ni l’huile, en vogue dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Renaissance. (...) Avec ces artisans, beaucoup <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vinrent également aux<br />
Amériques. Le Paraguay subit aux XVI e , XVII e et XVIII e siècles <strong>de</strong>s épidémies <strong>de</strong> variole<br />
et <strong>de</strong> rougeole dévastatrices, et d’autres infections importées qui ravagèrent <strong>de</strong>s<br />
peuples entiers. Les indigènes, moins immunisés que les Européens, mouraient par<br />
milliers. Après l’é<strong>la</strong>n créateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête, le Paraguay tomba dans une léthargie<br />
sécu<strong>la</strong>ire. Les mauvais gouvernants, les migrations colonisatrices successives et ininterrompues<br />
et le hasard géographique firent avorter l’ascension prometteuse <strong>de</strong><br />
ses premières années.<br />
Il faut signaler <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> guérisseurs qui administraient <strong>de</strong>s produits végétaux.<br />
L’exaltation religieuse régnante pendant <strong>la</strong> Colonie fit aussi que <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine fut<br />
un peu dépréciée 8 .<br />
González Torres et Guillermo Vidal s’accor<strong>de</strong>nt à situer <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’hôpital d’Espagnols<br />
et <strong>de</strong> Naturels en 1541, puisqu’à cette date-là Asunción <strong>de</strong>vint une ville. Un Brevet<br />
royal obligeait les vice-rois, l’audience et les gouverneurs à fon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s hôpitaux dans<br />
les vil<strong>la</strong>ges d’Espagnols et d’Indiens. À l’époque coloniale, <strong>de</strong>ux hôpitaux furent<br />
construits à Asunción. Le premier, l’hôpital <strong>de</strong> San Bartolomé, fut dressé vers 1603 par<br />
l’évêque franciscain frère Martín Ignacio <strong>de</strong> Loyo<strong>la</strong>. Le second fut fondé et organisé par<br />
le mé<strong>de</strong>cin paraguayen José Dávalos y Peralta, qui avait étudié <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’université<br />
<strong>de</strong> San Marcos, à Lima. Vers 1695, il fonda l’hôpital où il travail<strong>la</strong> jusqu’à sa mort en<br />
1731 9 .<br />
Vers 1760, un autre hôpital fut construit sur les terrains appelés plus tard Potrero,<br />
sur les rives du ruisseau Jardín, par décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour, qui s’opposa obstinément aux<br />
prétentions <strong>de</strong> l’hôtel <strong>de</strong> ville et <strong>de</strong> l’évêque à investir <strong>de</strong>s rentes <strong>de</strong> l’hôpital dans <strong>la</strong> création<br />
d’une université ou d’un pensionnat dirigé par les jésuites 8 .<br />
Les <strong>de</strong>rnières années coloniales furent, en revanche, très profitables au pays dans le<br />
domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique. La prospérité économique attira plusieurs mé<strong>de</strong>cins européens<br />
; d’autres arrivèrent avec les missions restrictives <strong>de</strong>s limites hispano-portugaises.<br />
Des chirurgiens possédant un diplôme universitaire introduisirent au Paraguay<br />
les idées les plus mo<strong>de</strong>rnes sur l’anatomie, <strong>la</strong> pathologie et le diagnostic clinique ; ils<br />
i<strong>de</strong>ntifièrent le tétanos infantile, les exanthèmes aigus, les fièvres intermittentes, <strong>la</strong> syphilis,<br />
<strong>la</strong> tuberculose pulmonaire, <strong>la</strong> conjonctivite épidémique, les dysenteries et <strong>la</strong> fièvre<br />
typhoï<strong>de</strong>. Ils furent aussi les premiers à se servir du forceps et à faire <strong>de</strong>s interventions<br />
chirurgicales audacieuses. Pendant ces années, l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine fut réglementé.<br />
Le congrès <strong>de</strong> 1844 décida <strong>de</strong> l’embauche <strong>de</strong> professeurs d’autres pays et <strong>de</strong> l’envoi <strong>de</strong><br />
jeunes Paraguayens à l’étranger pour y étudier <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, <strong>la</strong> chirurgie et l’obstétrique.
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Ces mé<strong>de</strong>cins engagés par l’État, <strong>de</strong>s Ang<strong>la</strong>is pour <strong>la</strong> plupart, formèrent <strong>la</strong> santé militaire,<br />
et ils fondèrent en 1858 une école <strong>de</strong> chirurgie qui fonctionnait à l’hôpital Potrero.<br />
La guerre <strong>de</strong> 1865-1870 mit un terme à cette institution qui fut notre première école médicale<br />
officielle ; tous ses membres réintégrèrent l’armée 8 .<br />
À partir <strong>de</strong> 1870, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine se renforça grâce aux contributions <strong>de</strong> nombreux mé<strong>de</strong>cins<br />
européens qui vinrent dans le Paraguay héroïque plus en quête d’aventures que<br />
<strong>de</strong> fortune. L‘État, dépourvu <strong>de</strong> ressources, ne pouvait pas réaliser d’œuvres sociales, et<br />
se limitait à l’ébauche d’une nouvelle organisation sanitaire. Le Conseil <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et<br />
d’hygiène publique, le Conservatoire <strong>de</strong>s vaccins, l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité et d’autres institutions<br />
analogues furent fondés à l’époque, plus à partir d’intentions louables que <strong>de</strong><br />
moyens.<br />
L’année 1890 marqua une nouvelle étape, à travers <strong>de</strong>ux événements: l’apparition <strong>de</strong>s<br />
premiers mé<strong>de</strong>cins paraguayens et <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’université nationale d’Asunción. Les<br />
premiers mé<strong>de</strong>cins paraguayens obtinrent leur diplôme à Buenos Aires et à Montevi<strong>de</strong>o ;<br />
à leur retour dans leur patrie, grâce au soutien offert par plusieurs professeurs espagnols,<br />
ils rendirent possible l’ouverture d’une faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Cette première faculté<br />
connut une existence éphémère, car elle fut dissoute au milieu <strong>de</strong> 1891, faute<br />
d’élèves ; elle rouvrit ses portes en 1898 pour donner quelques années plus tard <strong>la</strong> première<br />
promotion <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins nationaux.<br />
Au cours du XX e siècle, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine progressa rapi<strong>de</strong>ment. L’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité,<br />
inauguré en 1894, fut nationalisé en 1925 et <strong>de</strong>vint une dépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s<br />
sciences médicales en 1927. Celle-ci, fermée en 1912 et rouverte pour <strong>la</strong> troisième fois<br />
en 1918, se réorganisa et se perfectionna avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’illustres professeurs engagés<br />
en Europe. L’année 1927 peut être considérée comme le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
phase académique <strong>de</strong> notre mé<strong>de</strong>cine. À cette époque, l’embauche <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong> l’hôpital fut à l’origine d’une pério<strong>de</strong> fructueuse qui se poursuit jusqu’à nos<br />
jours 8 .<br />
■ Compte rendu rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> Paraguayenne <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> Dermatologie paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Nous allons à présent faire référence aux événements qui posèrent les bases <strong>de</strong>s premières<br />
structures d’organisation et du fonctionnement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société paraguayenne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie (figure 2).<br />
Il ne faut pas oublier, en revenant très loin en arrière, les pères fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> syphiligraphie et <strong>de</strong> léprologie du Paraguay, selon sa dénomination<br />
originale. Dans cet extrait, nous reproduisons l’acte fondamental <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> syphiligraphie et <strong>de</strong> léprologie du Paraguay (figure 3),<br />
et nous rappelons <strong>la</strong> liste <strong>de</strong> ceux qui souscrivirent à ce document, sous réserve <strong>de</strong><br />
quelques éventuelles omissions involontaires, faute <strong>de</strong> documents. Ses associés fondateurs<br />
furent les Drs Amelia Aguirre, Roque Ávi<strong>la</strong>, Atilio Báez Giangreco, Francisco<br />
Benza, Guillermo Brañas, Virgilio Caballero Garay, Arquíme<strong>de</strong>s Canese, José Esculies,<br />
Manuel Jiménez, Tomás González, Miguel González Oddone, Domingo Masi, Desi<strong>de</strong>rio<br />
Meza, Francisco Mil<strong>la</strong>res, Alberto Miquel, Domingo Pesso<strong>la</strong>ni, Fe<strong>de</strong>rico Ríos,<br />
Eduardo Rodríguez, Juan Servín, Ricardo Ugarriza, David Zai<strong>de</strong>stein. C’était en<br />
1946.<br />
Le statut régissant aujourd’hui <strong>la</strong> Société paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut définitivement<br />
fixé au cours <strong>de</strong> l’assemblée du 10 novembre 1947, remp<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> dénomination<br />
précé<strong>de</strong>nte et déterminant les objectifs, les obligations sociétaires, les rangs <strong>de</strong> ses<br />
membres, les assemblées et les commissions <strong>de</strong> direction, entre autres, et définissant les<br />
lignes définitives qui donnent sa vigueur et sa dynamique à l’institution regroupant les<br />
<strong>de</strong>rmatologues du Paraguay 10 .<br />
305<br />
Figure 2.<br />
Logotype <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société paraguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Figure 3.<br />
Acte fondateur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
<strong>de</strong> syphiligraphie<br />
et <strong>de</strong> léprologie<br />
du Paraguay
JULIO CORREA<br />
306<br />
La Société paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut refondée en 1986 sous <strong>la</strong> direction du<br />
Pr. Dr Hermelinda Bordón (née Pa<strong>la</strong>cios).<br />
Grâce à <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> plusieurs jeunes mé<strong>de</strong>cins paraguayens partis se spécialiser<br />
dans <strong>de</strong>s écoles prestigieuses aussi bien en Amérique que dans le Vieux Mon<strong>de</strong>, <strong>la</strong><br />
Société Paraguayenne <strong>de</strong> Dermatologie réussit, mo<strong>de</strong>stement mais avec constance et fermeté,<br />
à intégrer <strong>de</strong> célèbres sociétés scientifiques (RADLA, CILAD, ATD, entre autres) en<br />
communiquant ses activités scientifiques comme <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong>s cas cliniques<br />
importants, en participant à <strong>de</strong>s commissions auxiliaires et en organisant également<br />
<strong>de</strong>s congrès.<br />
Tenant compte <strong>de</strong>s documents que nous avons examinés, nous avons trouvé très peu<br />
d’informations concernant les commissions <strong>de</strong> direction antérieures à 1986 ; il est fort<br />
probable que ces documents se soient égarés faute d’un secrétariat permanent, situation<br />
corrigée en 1998 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Gloria Valdovinos (née Galeano).<br />
Malgré ces manques, il est possible d’affirmer qu’à partir <strong>de</strong> 1986 se succédèrent <strong>de</strong>s<br />
autorités dynamiques et <strong>la</strong>borieuses qui donnèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> solidité aux activités scientifiques,<br />
comptant sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s innombrables associés <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Des calendriers<br />
<strong>de</strong> rencontres mensuelles furent é<strong>la</strong>borés : <strong>de</strong>s cours, <strong>de</strong>s conférences, <strong>de</strong>s<br />
présentations <strong>de</strong> cas, <strong>de</strong>s tables ron<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s présentations <strong>de</strong> travaux pour l’intégration<br />
d’associés et <strong>de</strong>s journées avec d’importants invités étrangers — <strong>de</strong> grands maîtres tels<br />
que les Drs Adrián M. Pierini, León Jaimovich, Rita García Díaz, Alejandro Cor<strong>de</strong>ro, Alberto<br />
Woscoff, Jorge Abu<strong>la</strong>fia, José A. Massimo, Evandro Rivitti, Joel Bomfard, Walter<br />
Balda, Hugo Cabrera, Sebastiao Sampaio, María A. Vitale, Galo Montenegro, Raúl Vignale,<br />
Mario Marini.<br />
Après <strong>de</strong>s heures <strong>de</strong> travail et grâce à un dévouement acharné, le I er Congrès paraguayen<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu du 13 au 16 octobre 1995, compta d’illustres représentants<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, tels que les Prs Drs Ramón Ruiz<br />
Maldonado, Roberto Arenas (Mexique), Jorge Abu<strong>la</strong>fia, Alberto Woscoff, Hugo Cabrera,<br />
Margarita Larral<strong>de</strong>, David Grinspan, Manuel Jiménez, José A. Mássimo (Argentine),<br />
Juan Honeyman (Chili), C<strong>la</strong>risse Zaits, Silvio Alencar (Brésil). La thérapeutique en <strong>de</strong>rmatologie<br />
et le cancer et le pré-cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau furent les sujets officiels. 413 personnes<br />
y assistèrent, mé<strong>de</strong>cins nationaux et étrangers, dont <strong>la</strong> plupart étaient, comme il<br />
était prévisible, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues qui assistèrent à <strong>de</strong>s cours préa<strong>la</strong>bles au congrès, à<br />
<strong>de</strong>s conférences magistrales, à <strong>de</strong>s symposiums, à <strong>de</strong>s thèmes libres, à <strong>de</strong>s mini-cas et à<br />
une séance d’histopathologie, entre autres sujets <strong>de</strong> l’éventail <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1996, le Dr Oilda Knopfelmacher étant <strong>la</strong> déléguée RADLA pour le Paraguay,<br />
le pays se vit proposer d’être le siège du congrès RADLA suivant — le premier<br />
dans notre pays —, qui eut lieu en 1998.<br />
Le II e Congrès paraguayen <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et les II es Journées paraguyennes-paranaenses<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eurent lieu du 26 au 28 août 2000. Le sujet officiel fut « Thérapeutique<br />
<strong>de</strong>rmatologique : quoi <strong>de</strong> neuf ? », accompagné <strong>de</strong> cours, <strong>de</strong> symposiums et<br />
<strong>de</strong> conférences, en présence d’invités illustres, comme les Prs Drs Amy Nopper (USA),<br />
Roberto Arenas et Yo<strong>la</strong>nda Ortiz (Mexique), Fausto Forim Alonso, Julio C. Empinotti, Sebastiao<br />
Sampaio (Brésil), Manuel Giménez, León Jaimovich, Héctor Lanfranchi et Mario<br />
Marini (Argentine).<br />
Le III e Congrès paraguayen <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eut lieu du 20 au 22 septembre 2002,<br />
avec <strong>la</strong> même disposition et le même enthousiasme que lors <strong>de</strong>s événements précé<strong>de</strong>nts;<br />
ce congrès reprit les sujets déjà évoqués, ajouta quelques nouveautés et compta sur <strong>la</strong><br />
présence d’invités illustres tels que les Prs Drs Guadalupe Chávez, Roberto Arenas, Roberto<br />
Estrada, Josefina Carbajosa (Mexique), Héctor Cáceres (Pérou), Manuel Zamora,<br />
Martín Sangüeza, Juan C. Diez <strong>de</strong> Medina (Bolivie), Margarita Larral<strong>de</strong> (Argentine), Antonio<br />
Rondón (Venezue<strong>la</strong>), Raúl Cabrera (Chili), Marcello Menta (Brésil).
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Paraguay<br />
Les I res Journées d’ATD virent le jour au Paraguay le 25 et le 26 juillet 2003, comptant<br />
sur l’inestimable col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Prs Drs Miguel Allevato, Juan C. Diez <strong>de</strong> Medina,<br />
Jaime Piquero, Martín Sangüeza, Néstor Macedo. Elles furent encouragées par <strong>la</strong> Société<br />
paraguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, avec le soutien d’autres institutions, et comptèrent sur<br />
<strong>la</strong> participation <strong>de</strong> nombreux <strong>de</strong>rmatologues et <strong>de</strong>s personnes intéressées par <strong>la</strong> spécialité,<br />
à travers <strong>de</strong>s conférences, <strong>de</strong>s séances interactives et <strong>de</strong>s réunions.<br />
Le IV e Congrès paraguayen <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le I er Cours CILAD pour <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
généralistes et pédiatres se dérou<strong>la</strong> du 24 au 26 septembre 2004, sous les auspices <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société paraguayenne <strong>de</strong> pédiatrie, du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital national, du<br />
département <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et du bien-être social, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong> l’université nationale<br />
d’Itapúa, du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital central <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> prévision sociale<br />
et du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne <strong>de</strong> l’hôpital central <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> prévision sociale.<br />
On compta sur <strong>la</strong> présence d’invités étrangers comme les Prs Drs Carlos F. Gatti et<br />
Adrián M. Pierini (Argentine), Juan C. Diez <strong>de</strong> Medina et Martín Sangüeza (Bolivie), Roberto<br />
Arenas (Mexique), Ricardo Pérez Alfonso, Elda Giansante (Venezue<strong>la</strong>) ; les sujets<br />
traités inclurent, tout comme lors <strong>de</strong>s événements précé<strong>de</strong>nts, tout l’éventail <strong>de</strong>s affections<br />
<strong>de</strong>rmatologiques.<br />
Tous les événements eurent lieu dans <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, Asunción. Il<br />
convient <strong>de</strong> mentionner <strong>la</strong> participation d’éminents professionnels paraguayens, comme<br />
<strong>de</strong>s professeurs, <strong>de</strong>s enseignants, <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales <strong>de</strong><br />
l’université nationale et à <strong>de</strong> célèbres hôpitaux <strong>de</strong> l’État du Paraguay, ainsi que <strong>de</strong>s spécialistes<br />
d’autres disciplines comme <strong>de</strong>s hématologues, <strong>de</strong>s infectiologues, <strong>de</strong>s internistes,<br />
<strong>de</strong>s pédiatres et d’autres spécialistes <strong>de</strong>s sciences médicales, car sans leur<br />
participation désintéressée, il aurait été impossible <strong>de</strong> réaliser ces événements.<br />
Sans citer <strong>de</strong> noms, par crainte d’oublis injustifiés, nous tenons à exprimer notre gratitu<strong>de</strong><br />
envers tous, sans exception. Pour conclure, nous pouvons affirmer que les activités<br />
réalisées par les <strong>de</strong>rmatologues du Paraguay (dans une nouvelle étape <strong>de</strong><br />
renforcement et d’intégration dans le mon<strong>de</strong> fascinant <strong>de</strong>s sciences), ont pour but ultime<br />
<strong>de</strong> sou<strong>la</strong>ger, en mettant en pratique leurs connaissances, les pathologies cutanées dont<br />
souffrent les patients venus consulter dans le temple du travail, le cabinet du <strong>de</strong>rmatologue.<br />
■<br />
Septembre 2005<br />
307
JULIO CORREA<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. González Torres D. Cultura<br />
guaraní. Asunción: Litocolor.<br />
1993: 61-97.<br />
2. Ruiz Nestoza J. Diario ABC<br />
Color. Asunción. 22 febr.<br />
2004; Suplemento Cultural,<br />
pp. 2-6.<br />
3. González L.J. Paraguay:<br />
prisionero geo-político.<br />
Buenos Aires: Nogal; 1967:<br />
17-18.<br />
4. Rubiani J. La Guerra <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Triple Alianza. Tomo I.<br />
Asunción: Azote-Diario ABC<br />
Color. 2002: 10-16.<br />
5. Ferreira R., Campos Caballero<br />
H. « Escarbando <strong>la</strong> historia. »<br />
Diario Última Hora. 7 jul.<br />
2005; Sección Política, p. 8.<br />
6. Bertoni M.S. La civilización<br />
guaraní. Parte III:<br />
Conocimientos. Puerto<br />
Bertoni, Alto Paraná:<br />
Imprenta y Ed. Ex Sylvis;<br />
1927.<br />
7. Müller F. Etnografía <strong>de</strong> los<br />
Guaraní <strong>de</strong>l Alto Paraná.<br />
Rosario (Argentina): Escue<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> Artes Gráficas <strong>de</strong>l Colegio<br />
Salesiano San José.<br />
Asunción: Museo Etnográfico<br />
Andrés Barbero. 1989: 89-92.<br />
8. Vidal G. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Paraguay. »<br />
Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong><br />
Ciencias Médicas. Asunción.<br />
1945; 5(21): 148-150.<br />
9. González Torres D. « Cap. 1.<br />
Hospitales. » Dans: Historia<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina en Paraguay.<br />
Temas médicos. Asunción:<br />
Imprenta Nacional. 1964: 7-8.<br />
10. Estatuto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Paraguaya <strong>de</strong> Dermatología,<br />
50 e Aniversario 1946-1996.<br />
Bibliographie<br />
complémentaire<br />
Bol<strong>la</strong> <strong>de</strong> Lezcano L. Reseña<br />
histórica <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cátedra <strong>de</strong><br />
Dermatología <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad<br />
<strong>de</strong> Ciencias Médicas.<br />
[Communication<br />
personnelle].<br />
Cadogan L. Apuntes <strong>de</strong> medicina<br />
popu<strong>la</strong>r guaireña. Asunción:<br />
Publicación <strong>de</strong>l Centro <strong>de</strong><br />
Estudios Antropológicos <strong>de</strong>l<br />
Paraguay (CEAP). Imprenta<br />
Nacional; 1957.<br />
Departamento Nacional <strong>de</strong><br />
Higiene y Asistencia Pública.<br />
Informe <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dirección<br />
General correspondiente a los<br />
meses <strong>de</strong> agosto a diciembre<br />
<strong>de</strong> 1917. Asunción: Talleres<br />
Gráficos <strong>de</strong>l Estado. Museo<br />
Etnográfico Andrés Barbero;<br />
1918: 86-95.<br />
Franco V. La sanidad en <strong>la</strong> Guerra<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Triple Alianza. Asunción:<br />
Círculo Paraguayo <strong>de</strong><br />
Médicos; 1976: 78-81.<br />
Furlong G. Historia social y<br />
cultural <strong>de</strong>l Río <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta<br />
1536-1810. El transp<strong>la</strong>nte<br />
social. Buenos Aires:<br />
Tipográfica Editora<br />
Argentina. Asunción: Museo<br />
Etnográfico Andrés Barbero.<br />
González Torres D., Aspectos<br />
sanitarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerra <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Triple Alianza, Capítulo III-Las<br />
Epi<strong>de</strong>mias, Asunción, 1968,<br />
60-93.<br />
Meliá B., Nagel L.M. Guaraníes y<br />
Jesuitas en tiempos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
misiones. Asunción: CEPAG<br />
(Centro <strong>de</strong> Estudios<br />
Paraguayos Antonio Guasch);<br />
1995.<br />
Revista Médica <strong>de</strong>l Paraguay.<br />
Círculo Paraguayo <strong>de</strong><br />
Médicos. En.-may 1964;<br />
VI(1): 30-3.<br />
Sánchez Labrador J. La Medicina<br />
en el Paraguay natural 1771-<br />
1776. Exposición comentada<br />
<strong>de</strong>l texto original por el Dr.<br />
Aníbal Ruiz M., profesor<br />
titu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong><br />
Ciencias Médicas <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires. Tucumán (República<br />
Argentina): Talleres ETA.<br />
Asunción: Museo Etnográfico<br />
Andrés Barbero. 1968: 78-88.<br />
Susnik B. Los aborígenes <strong>de</strong>l<br />
Paraguay. Cultura Material.<br />
Asunción: Museo Etnográfico<br />
Andrés Barbero. 1982; IV:<br />
126-147.
INTRODUCCIÓN<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
AU PÉROU<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
■ Introduction<br />
Luis Flores-Cevallos<br />
Le Pérou est un pays privilégié, possédant une gran<strong>de</strong> richesse naturelle — flore et faune<br />
— qui influe énormément sur <strong>la</strong> pathologie humaine et, par conséquent, sur <strong>la</strong> pathologie<br />
<strong>de</strong>rmatologique. Le pays possè<strong>de</strong> également un passé historique culturel millénaire.<br />
Nous exposerons quelques éléments qui ai<strong>de</strong>ront à connaître l’environnement dans<br />
lequel se développent les événements historiques, ainsi que <strong>la</strong> pathologie <strong>de</strong>rmatologique<br />
tropicale.<br />
Le Pérou occupe <strong>la</strong> zone subtropicale d’Amérique du Sud, traversé par <strong>la</strong> Cordillère<br />
<strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s du nord au sud et bordé par l’océan Pacifique avec le courant maritime froid<br />
<strong>de</strong> Humboldt qui se dép<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>puis le sud vers le nord; grâce à ces conditions, le pays est<br />
un haut lieu <strong>de</strong> richesses naturelles dont <strong>la</strong> biologie présente <strong>de</strong>s manifestations variées.<br />
La côte. Correspondant à <strong>la</strong> partie occi<strong>de</strong>ntale, elle présente un climat désertique assez<br />
stable, fréquemment recouverte d’une brume épaisse et <strong>de</strong> pluies sporadiques. Elle s’étend<br />
<strong>de</strong>puis le littoral jusqu’à 500 m <strong>de</strong> hauteur, sur 2070 km <strong>de</strong> long; ceci ne rend pas propice<br />
l’existence <strong>de</strong> vecteurs transmetteurs <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques tropicales.<br />
La sierra. C’est <strong>la</strong> partie centrale, constituée <strong>de</strong>s vallées interandines, d’une altitu<strong>de</strong><br />
entre 500 et 4 000 m au-<strong>de</strong>ssus du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer. Elle fait 150 km <strong>de</strong> <strong>la</strong>rge au nord et<br />
300 km au sud. Son climat est varié et les températures extrêmes oscillent entre 5 °C et<br />
26 °C. Des neiges éternelles apparaissent à partir <strong>de</strong> 4 500 m. Dans les vallées, les climats<br />
peuvent varier dans une même saison <strong>de</strong> l’année, avec peu d’écart et <strong>de</strong>s variantes<br />
<strong>de</strong> flore, <strong>de</strong> faune et <strong>de</strong> pathologie. L’écosystème propice à l’habitat <strong>de</strong>s vecteurs qui<br />
transmettent <strong>la</strong> leishmaniose cutanée bénigne appelée uta et <strong>la</strong> verrue péruvienne (Bartonellose),<br />
se trouve entre 1200 et 2800 m d’altitu<strong>de</strong>.<br />
La forêt. C’est <strong>la</strong> partie orientale et <strong>la</strong> région <strong>la</strong> plus étendue, dont l’altitu<strong>de</strong> est inférieure<br />
à 1 000 m au-<strong>de</strong>ssus du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer. De nombreuses rivières <strong>la</strong> traversent et<br />
elle possè<strong>de</strong> une végétation tropicale touffue ; <strong>de</strong>s précipitations abondantes influent sur<br />
son climat humi<strong>de</strong> et extrêmement chaud, propice aux vecteurs transmettant <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong>rmatologiques tropicales telles que <strong>la</strong> leishmaniose muco-cutanée, appelée<br />
espundia.<br />
309
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
■ I<br />
310<br />
I partie<br />
Elbio Flores-Cevallos<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque précolombienne<br />
LA DERMATOLOGIE DANS LES CULTURES PRÉ-INCAS: CÉRAMIQUES, HUACO RETRATO<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou débuta à une époque très lointaine. Les cultures<br />
pré-incas qui se développèrent sur <strong>la</strong> côte, <strong>la</strong> sierra et le nord du Pérou, <strong>de</strong>puis le<br />
I er siècle av. J.-C. jusqu’à leur conquête par les Incas, <strong>la</strong>issèrent dans l’iconographie <strong>de</strong><br />
leurs céramiques <strong>de</strong>s illustrations <strong>de</strong> leurs connaissances sur diverses ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
Au début du XII e siècle <strong>de</strong> notre ère, ces cultures furent progressivement<br />
conquises par les Quechuas, qui se situaient aux environs du <strong>la</strong>c Titicaca, le plus élevé<br />
au mon<strong>de</strong>, sur le p<strong>la</strong>teau du Col<strong>la</strong>o, et qui avaient atteint leur développement maximal<br />
cents ans avant l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols. Tout comme les Romains assimilèrent <strong>la</strong> culture<br />
grecque lors <strong>de</strong> leur conquête, les Incas absorbèrent les cultures <strong>de</strong>s civilisations les précédant.<br />
L’empire <strong>de</strong>s Incas formait l’un <strong>de</strong>s peuples les plus développés d’Amérique du<br />
Sud avant l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols.<br />
Nous avons mené une étu<strong>de</strong> minutieuse <strong>de</strong>s différentes céramiques <strong>de</strong>s cultures moche,<br />
chimú, vicús, chancay notamment, qui se trouvent disséminées dans les divers musées <strong>de</strong><br />
Lima et du Pérou. Ces céramiques, <strong>de</strong> véritables livres <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, nous dévoilent,<br />
avec un graphisme très réaliste, le mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture mochica, ainsi que plusieurs ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong>s actes chirurgicaux; elles montrent aussi très c<strong>la</strong>irement <strong>la</strong> verrue<br />
péruvienne, <strong>la</strong> syphilis, <strong>la</strong> leishmaniose (uta), <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies pustuleuses du visage, <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
prurigineuses, <strong>de</strong>s tumeurs, <strong>de</strong>s amputations d’extrémités, entre autres. Nous les appelons<br />
« huaco retrato à pathologie <strong>de</strong>rmatologique clinique », et elles possè<strong>de</strong>nt une<br />
gran<strong>de</strong> valeur historique comparable aux mou<strong>la</strong>ges réalisés mille ans plus tard à l’hôpital<br />
Saint-Louis <strong>de</strong> Paris, où <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie débuta en tant que spécialité.<br />
Pour parler <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou pendant l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conquête, l’époque coloniale et les cent premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, nous nous<br />
sommes appuyés sur l’ouvrage <strong>de</strong> Prescott Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquista <strong>de</strong>l Perú [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> conquête du Pérou] et celui <strong>de</strong> J.B. Lastres, Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina Peruana [<strong>Histoire</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne], entre autres.<br />
Plusieurs années avant <strong>la</strong> conquête du Pérou, les Espagnols avaient déjà introduit en<br />
Amérique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies virales telles que <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> rougeole et <strong>la</strong> grippe. Selon les<br />
chroniqueurs, après avoir conquis le royaume <strong>de</strong> Quito en 1526 avec son armée, l’Inca<br />
Huayna Capac fut atteint <strong>de</strong> variole, ma<strong>la</strong>die à <strong>la</strong>quelle il succomba tout comme plus <strong>de</strong><br />
200 000 Indiens <strong>de</strong> l’empire. Le <strong>de</strong>stin du Pérou aurait été tout autre si cet Inca courageux<br />
et expérimenté n’était pas mort <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die. Nous pouvons dire que <strong>la</strong> variole<br />
changea le <strong>de</strong>stin du Pérou ; l’Inca, avec toute son armée réunie, n’aurait jamais été<br />
vaincu par moins <strong>de</strong> 200 Espagnols.<br />
Selon les étu<strong>de</strong>s archéologiques réalisées pendant le XX e siècle, les premiers habitants<br />
du Pérou arrivèrent par groupes il y a plus <strong>de</strong> dix mille ans, <strong>la</strong>issant leurs traces dans <strong>de</strong>s<br />
cavernes (peintures rupestres <strong>de</strong> Tacna) ou d’autres endroits <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte; leur nourriture<br />
<strong>de</strong> base provenait <strong>de</strong> <strong>la</strong> chasse et <strong>de</strong> <strong>la</strong> récolte; ils apprivoisèrent les camélidés sylvestres,<br />
sélectionnèrent plusieurs p<strong>la</strong>ntes pour leur alimentation (haricots, haricots b<strong>la</strong>ncs, maïs,<br />
pomme <strong>de</strong> terre, etc.) et beaucoup <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales pour soigner leurs ma<strong>la</strong>dies.<br />
L’architecture monumentale apparut sur <strong>la</strong> côte vers l’an 3 000 av. J.-C. : <strong>de</strong>s édifications<br />
publiques en U, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>tes-formes et <strong>de</strong>s puits effondrés. La popu<strong>la</strong>tion habitait<br />
tout autour <strong>de</strong> ces constructions, dans <strong>de</strong>s maisons simples, parfois souterraines.<br />
Plusieurs cultures se développèrent au cours <strong>de</strong>s siècles, aussi bien sur <strong>la</strong> côte que<br />
dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra du Pérou, suivant le schéma établi. La céramique apparut
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
dans les cultures <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte nord vers l’an 1 800 av. J.-C., et dans le nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra vers<br />
l’an 1000 av. J.-C. 1 . Grâce à leurs céramiques anthropomorphes huaco retrato — constituant<br />
<strong>de</strong> véritables idéogrammes —, les cultures pré-incas nous montrent par une iconographie<br />
très fine et réaliste non seulement les manifestations extérieures <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pathologie <strong>de</strong>rmatologique mais aussi d’autres spécialités médicales comme l’obstétrique,<br />
<strong>la</strong> traumatologie, <strong>la</strong> chirurgie, l’oncologie et <strong>la</strong> tératologie ; elles comprennent<br />
également <strong>de</strong>s représentations sur l’activité sexuelle, et sur leurs connaissances en architecture<br />
et en musique, leurs croyances magiques et religieuses, leurs sentiments <strong>de</strong><br />
joie, <strong>de</strong> douleur et leurs préoccupations.<br />
LES MALADIES DERMATOLOGIQUES DANS L’EMPIRE INCA<br />
L’empire <strong>de</strong>s Incas ou Tahuantinsuyo se développa <strong>de</strong>puis le début du XII e siècle jusqu’à<br />
l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols en 1532. Les cultures antiques pré-incas qui avaient prospéré<br />
au cours <strong>de</strong>s années sur <strong>la</strong> côte et dans les vallées andines et interandines avaient<br />
été conquises, selon <strong>la</strong> légen<strong>de</strong>, par les Quechuas, originaires du p<strong>la</strong>teau du Col<strong>la</strong>o aux<br />
abords du <strong>la</strong>c Titicaca.<br />
Au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête, le Tahuantinsuyo occupait au nord une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Colombie<br />
et <strong>de</strong> l’Équateur actuels, tout le territoire du Pérou et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bolivie ; au sud, il arrivait<br />
jusqu’au fleuve Bío Bío, au centre du Chili, et à <strong>la</strong> région du Tucumán argentin<br />
(provinces <strong>de</strong> Santiago <strong>de</strong>l Estero, Salta, Jujuy et La Rioja) ; à l’ouest, <strong>la</strong> limite était<br />
l’océan pacifique et, à l’est, <strong>la</strong> forêt amazonienne habitée par <strong>de</strong>s tribus sauvages.<br />
Lors <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols, l’empire avait atteint son apogée moins <strong>de</strong> cent ans<br />
auparavant. Vers <strong>la</strong> moitié du XV e siècle l’Inca Tupac Yupanqui avait étendu l’empire au<br />
sud jusqu’au fleuve Bío Bío, tandis que son successeur Huayna Capac l’étendit au début<br />
du XVI e siècle jusqu’au royaume <strong>de</strong> Quito, dans le territoire <strong>de</strong> l’Équateur actuel. À sa<br />
mort, l’empire fut partagé entre ses <strong>de</strong>ux fils : le royaume <strong>de</strong> Quito pour Atahualpa et<br />
celui <strong>de</strong> Cuzco pour Huáscar.<br />
Cette division fut fatale ; les <strong>de</strong>ux frères se livrèrent très vite une guerre fratrici<strong>de</strong> féroce<br />
qui inclut <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> toutes les tribus <strong>de</strong> l’empire, d’un camp ou <strong>de</strong> l’autre.<br />
Quelques mois avant <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> Huáscar, Francisco Pizarro avait entrepris <strong>la</strong> conquête<br />
<strong>de</strong> l’empire inca ; facilement, sans batailler, il surprit l’Inca Atahualpa et le fit prisonnier<br />
à Cajamarca le 15 novembre 1532 ; il l’exécuta plus tard et, aidé par les tribus indiennes<br />
qui combattaient à ses côtés, il réussit à conquérir en quelques mois <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Cuzco,<br />
capitale <strong>de</strong> l’empire.<br />
La ville sacrée <strong>de</strong> Cuzco, le nombril du mon<strong>de</strong>, était selon les chroniqueurs une ville<br />
très peuplée et impressionnante, une merveille du mon<strong>de</strong>, construite <strong>de</strong> pierres assemblées<br />
<strong>de</strong> manière fabuleuse, et reliée aux différentes villes <strong>de</strong> l’empire grâce à plusieurs<br />
chemins s’étendant au nord jusqu’à Quito et au sud jusqu’au Chili 2 .<br />
Le gouvernement inca était <strong>de</strong>spotique mais bienveil<strong>la</strong>nt ; les c<strong>la</strong>sses sociales étaient<br />
bien définies. L’Inca était considéré comme un dieu, le fils du Soleil ; les membres <strong>de</strong> sa<br />
famille venaient après dans <strong>la</strong> hiérarchie. Il avait plusieurs concubines et pouvait engendrer<br />
entre 100 et 200 enfants, qui constituaient <strong>la</strong> noblesse. Celle-ci faisait partie <strong>de</strong>s<br />
hauts rangs <strong>de</strong> l’armée, occupait <strong>de</strong> hauts postes dans <strong>la</strong> hiérarchie religieuse et était<br />
composée par les nobles orejones et les savants ou amautas; le peuple, celui qui travail<strong>la</strong>it<br />
véritablement, était bien au-<strong>de</strong>ssous.<br />
La pauvreté n’existait pas au sein <strong>de</strong> l’empire inca, ni les mendiants, ni l’argent, ni <strong>la</strong><br />
faim ; tout le mon<strong>de</strong> travail<strong>la</strong>it et il n’y avait pas <strong>de</strong> propriété privée. Le système médical<br />
était très bien organisé. Les mé<strong>de</strong>cins étaient divisés selon les c<strong>la</strong>sses sociales : les ambicamayos<br />
s’occupaient seulement <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’Inca, <strong>de</strong> sa famille et <strong>de</strong> <strong>la</strong> noblesse ;<br />
les ccamascas ou soncoyoc pratiquaient <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine pour l’homme du peuple ou runa;<br />
le hampi-camayoc était le mé<strong>de</strong>cin au sens strict du mot. Il y avait aussi <strong>de</strong>s magiciens,<br />
<strong>de</strong>s sorciers, <strong>de</strong>s guérisseurs et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>vins.<br />
311
Figure 1.<br />
Céramique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> culture mochica<br />
du musée Víctor<br />
Larco Herrera<br />
<strong>de</strong> Lima : patient<br />
exposant ses fesses,<br />
<strong>la</strong> peau présentant<br />
<strong>de</strong>s lésions<br />
<strong>de</strong> condylomes<br />
p<strong>la</strong>ts <strong>de</strong> syphilis<br />
Figure 2.<br />
Céramique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> culture chimú<br />
du même musée :<br />
patient <strong>de</strong> sexe<br />
masculin, qui <strong>la</strong>isse<br />
voir <strong>de</strong> nombreux<br />
papillomes sur<br />
<strong>la</strong> peau du pénis<br />
et <strong>de</strong> l’abdomen,<br />
sans doute<br />
caractéristiques<br />
d’une syphilis<br />
secondaire<br />
Figure 3.<br />
Céramique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> culture chimú<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> collection du<br />
Dr Hugo Vizcarra :<br />
le ma<strong>la</strong><strong>de</strong> présente<br />
<strong>de</strong> multiples lésions<br />
nodu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong><br />
verrue péruvienne<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
312<br />
Les Hacarícuc ou Cuyricuc étaient les <strong>de</strong>vins qui regardaient les cobayes et les incisaient<br />
avec leur ongle pour établir, d’après l’état <strong>de</strong>s viscères, le diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Les calparicuqui,<br />
qui voyaient l’avenir et <strong>la</strong> chance, établissaient leur diagnostic en examinant le<br />
cadavre <strong>de</strong>s <strong>la</strong>mas et en souff<strong>la</strong>nt sur les bofes. Plusieurs <strong>de</strong>vins utilisaient <strong>de</strong>s feuilles <strong>de</strong><br />
coca: « Ils les prennent entières, les éten<strong>de</strong>nt sur une couverture, murmurent quelques<br />
mots, soufflent leur haleine sur les feuilles et les jettent en l’air. Ils observent <strong>la</strong> façon dont<br />
elles tombent sur <strong>la</strong> couverture et c’est <strong>de</strong> ce<strong>la</strong> que dépendront le diagnostic et le pronostic<br />
»; <strong>de</strong> nos jours, ce rite a encore lieu dans quelques vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra du Pérou 3 .<br />
Plusieurs oracles — dont le plus fameux fut celui <strong>de</strong> Pachacámac, près <strong>de</strong> Lima —<br />
prenaient p<strong>la</strong>ce près <strong>de</strong>s idoles ou <strong>de</strong>s totems. La popu<strong>la</strong>tion y avait recours pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> pour guérir les ma<strong>la</strong>dies, pour prier pour <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’Inca, tout comme<br />
faisaient les Grecs à l’oracle <strong>de</strong> Delphes.<br />
La mé<strong>de</strong>cine inca atteignit son sommet sous le gouvernement <strong>de</strong> l’Inca Pachacútec,<br />
qui mit en p<strong>la</strong>ce une légis<strong>la</strong>tion très avant-gardiste. Les ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques subies<br />
par l’empire inca furent les mêmes que celles <strong>de</strong>s différents peuples qui les conquirent.<br />
LES MALADIES DERMATOLOGIQUES À L’ÉPOQUE PRÉCOLOMBIENNE<br />
Syphilis<br />
La syphilis fut l’une <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques les plus répandues<br />
parmi les différentes civilisations <strong>de</strong> l’ancien Pérou. Les céramiques — notamment<br />
celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture moche-chimú — nous montrent <strong>de</strong>s Huacos présentant<br />
<strong>de</strong>s lésions syphilitiques évi<strong>de</strong>ntes (figures 1-2). L’archéologue péruvien<br />
Julio C. Tello, accompagné <strong>de</strong> Hunter Williams, trouva <strong>de</strong>s lésions typiques <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> syphilis au cours <strong>de</strong> ses étu<strong>de</strong>s d’ostéopathologie réalisées en 1929. Dans<br />
l’empire inca, <strong>la</strong> syphilis atteignait non seulement le peuple mais aussi les<br />
c<strong>la</strong>sses sociales plus aisées.<br />
George E. Eaton, mé<strong>de</strong>cin ostéologue américain, membre <strong>de</strong> l’expédition <strong>de</strong><br />
Hiram Bingham qui découvrit le Machu Picchu en 1911, trouva dans un cimetière<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone, dans un « endroit très spectacu<strong>la</strong>ire », <strong>la</strong> sépulture <strong>de</strong> <strong>la</strong> suprême prêtresse<br />
ou mamacona, prieure du couvent <strong>de</strong>s femmes vierges élues, chargées <strong>de</strong><br />
tisser <strong>de</strong> beaux tissus et <strong>de</strong> préparer les mets pour l’Inca et <strong>la</strong> noblesse. Lors <strong>de</strong><br />
l’examen ostéopathologique il découvrit que « malheureusement, elle souffrait<br />
<strong>de</strong> syphilis ». Cette dame avait été enterrée dans un très bel endroit, avec une<br />
immense richesse qui mettait en évi<strong>de</strong>nce son importance 2 .
Les anciens Péruviens traitaient <strong>la</strong> syphilis (huanthi, terme quechua-aymará signifiant<br />
« ulcère ») en utilisant <strong>de</strong> <strong>la</strong> salsepareille et du bâton <strong>de</strong> guayacán ou bâton <strong>de</strong>s Indiens.<br />
Il est prouvé que le jus <strong>de</strong> salsepareille frais possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vertus thérapeutiques et<br />
réussit une merveilleuse guérison 3 .<br />
Selon les chroniqueurs, <strong>la</strong> syphilis fut amenée en Europe par les conquistadors lors<br />
<strong>de</strong> leur premier voyage <strong>de</strong> retour en Espagne. La ma<strong>la</strong>die apparut pour <strong>la</strong> première fois<br />
en 1494 à Naples, et c’est pourquoi on l’appe<strong>la</strong> le « mal napolitain ». Elle se présenta<br />
comme une épidémie mystérieuse et inconnue, propagée rapi<strong>de</strong>ment, pour <strong>la</strong>quelle on<br />
ne connaissait pas <strong>de</strong> traitement et qui perturba gran<strong>de</strong>ment <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Son nom est<br />
retranscrit dans <strong>la</strong> littérature pour <strong>la</strong> première fois en 1530 ; un mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> Vérone, Giro<strong>la</strong>no<br />
Fracastore, écrivit un poème pastoral et donna à <strong>la</strong> redoutable ma<strong>la</strong>die le nom du<br />
pasteur Syphile.<br />
Pendant longtemps on crut que <strong>la</strong> syphilis était originaire d’Amérique ; cependant, <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s récentes menées par <strong>de</strong>s archéologues ang<strong>la</strong>is dans une abbaye <strong>de</strong> religieux augustiniens<br />
située au port <strong>de</strong> Hull, du nord-ouest <strong>de</strong> l’Angleterre — dans une crypte où<br />
l’on enterrait les prêtres, les nobles et les riches commerçants —, montrèrent que les<br />
<strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong>s squelettes présentaient <strong>de</strong>s lésions typiquement syphilitiques. Ces chercheurs<br />
firent également <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s archéologiques sur <strong>de</strong>s restes osseux <strong>de</strong> différents cimetières<br />
romains du Moyen Âge, où ils trouvèrent <strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> syphilis héréditaire chez<br />
les enfants, avec les c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie d’Hutchinson. Ils conclurent donc que <strong>la</strong> syphilis<br />
existait en Europe avant <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique.<br />
Verrue péruvienne<br />
Les cultures pré-incas moche, chimú, vicús et chancay prospérèrent sur <strong>la</strong> côte nord<br />
du Pérou entre le I er siècle av. J.-C. et le XIII e siècle <strong>de</strong> l’ère chrétienne, dans les départements<br />
actuels <strong>de</strong> Piura, Lambayeque, La Libertad et Lima. Leurs nombreuses céramiques<br />
(huaco retrato) montrent les lésions externes <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau produites par les<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, dont <strong>la</strong> verrue péruvienne.<br />
Cette céramique (figure 3) montre sans doute les lésions typiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> <strong>la</strong> verrue<br />
péruvienne au cours <strong>de</strong> sa phase verruqueuse et constitue un véritable livre sur cette<br />
ma<strong>la</strong>die que nous <strong>la</strong>issèrent les anciennes cultures du Pérou.<br />
Leishmaniose<br />
Les céramiques <strong>de</strong>s cultures moche-chimú prouvent que <strong>la</strong> verrue péruvienne<br />
et <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire étaient associées à <strong>de</strong>s mythes<br />
légendaires du culte <strong>de</strong> <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong> terre. Certains huacos mochicas représentent<br />
<strong>de</strong>s pommes <strong>de</strong> terre; <strong>de</strong>s visages <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints <strong>de</strong> verruga<br />
et <strong>de</strong> uta poussent <strong>de</strong> leurs bourgeons, comme <strong>de</strong>s vulves. D’autres<br />
céramiques représentent <strong>de</strong>s scènes <strong>de</strong>s semailles et <strong>de</strong> récoltes <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pomme <strong>de</strong> terre, dans lesquelles le visage humanisé <strong>de</strong> <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong> terre<br />
présente <strong>de</strong>s muti<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> uta et <strong>de</strong>s nodules verruqueux (figure 4).<br />
La leishmaniose cutanée, variété uta, est endémique dans les gorges <strong>de</strong>s<br />
vallées andines, tout comme <strong>la</strong> verrue péruvienne. Pedro Weiss étudia minutieusement<br />
ces céramiques qui représentent <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong> terre montrant<br />
<strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> uta et <strong>de</strong> verrue, et qui sont liées aux organes sexuels; ceci<br />
prouve que les anciens Péruviens marquaient le rapport entre <strong>la</strong> uta et <strong>la</strong><br />
verrue, <strong>la</strong> fécondité <strong>de</strong>s terres <strong>de</strong>s vallées andines et <strong>la</strong> fertilité <strong>de</strong>s femmes.<br />
Les indigènes utilisaient <strong>de</strong>s résines pour guérir <strong>la</strong> leishmaniose 3 .<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Ma<strong>la</strong>dies pustuleuses du visage<br />
Dans <strong>la</strong> céramique <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture mochica (figure 5) on observe <strong>la</strong> tête<br />
d’un ma<strong>la</strong><strong>de</strong> qui présente <strong>de</strong>s cicatrices lenticu<strong>la</strong>ires profon<strong>de</strong>s sur le visage, le nez,<br />
313<br />
Figure 4.<br />
Céramique mochica<br />
(leishmaniose)
Figure 5.<br />
Céramique mochica<br />
(acné pustuleuse)<br />
Figure 6.<br />
Céramique vicús<br />
(mycétome)<br />
Figure 7.<br />
Mycétome <strong>de</strong> pied<br />
Figure 8.<br />
Céramique mochica<br />
(urticaire ?)<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
314<br />
les joues, le menton et les oreilles ; les cicatrices sont peu nombreuses<br />
sur le front. Le lobule <strong>de</strong> chaque oreille présente <strong>de</strong>ux<br />
gran<strong>de</strong>s perforations, ce qui indique qu’il s’agissait possiblement<br />
d’un Orejón ayant contracté une ma<strong>la</strong>die pustuleuse du visage —<br />
peut-être une acné pustuleuse grave — provoquant ces cicatrices<br />
ponctiformes profon<strong>de</strong>s.<br />
Mycoses profon<strong>de</strong>s<br />
Dans <strong>la</strong> figure 6, céramique <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture vicús (300-800 après<br />
J.-C.) du musée <strong>de</strong> <strong>la</strong> banque <strong>de</strong> réserve du Pérou, on observe un<br />
pied œdémateux, avec <strong>de</strong>s nodu<strong>la</strong>tions circonscrites, situées pour<br />
<strong>la</strong> plupart sur <strong>la</strong> partie postérieure externe <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau du pied et<br />
du talon. Ces lésions sont simi<strong>la</strong>ires à celles <strong>de</strong> <strong>la</strong> figure 7 (patient<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> Lima dont le diagnostic répond<br />
au pied <strong>de</strong> Madura après l’étu<strong>de</strong> mycologique) (courtoisie du<br />
Dr O. Romero).<br />
Ma<strong>la</strong>dies prurigineuses <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
La figure 8, céramique <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture mochica, montre un homme nu, <strong>la</strong> tête recouverte<br />
d’un bonnet et dont le visage exprime l’ennui ; <strong>de</strong> <strong>la</strong> main droite il se gratte le dos.<br />
La peau <strong>de</strong> l’abdomen et <strong>de</strong>s jambes présente <strong>de</strong>s lésions papuleuses p<strong>la</strong>tes ; il s’agit probablement<br />
d’une urticaire.<br />
Pinta ou cara<br />
D’après Lastres, <strong>la</strong> pinta ou cara était connue<br />
par les anciens Péruviens sous le nom <strong>de</strong> ahoberados <strong>de</strong> prieto y b<strong>la</strong>nco. Les chroniques<br />
<strong>de</strong> l’Inca Garci<strong>la</strong>so <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega racontent que les sorciers <strong>de</strong> l’antiquité élevaient <strong>de</strong>s crapauds<br />
à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s offensés, en leur donnant à manger du maïs <strong>de</strong> différentes couleurs<br />
selon les taches que ceux-ci vou<strong>la</strong>ient produire sur <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> leurs ennemis, <strong>de</strong>s<br />
amants infidèles, etc. 3<br />
Tuberculose<br />
Nos étu<strong>de</strong>s menées dans les années 40-60 (avec <strong>de</strong>s patients <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
du pavillon 8–II <strong>de</strong> l’hôpital national Arzobispo Loayza <strong>de</strong> Lima et <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique<br />
ouvrière <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale du Cal<strong>la</strong>o) montrèrent que 0,01 % <strong>de</strong>s patients qui<br />
s’y rendaient pour soigner leurs affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau souffrait <strong>de</strong> tuberculose cutanée.<br />
Nos conclusions furent les suivantes :
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
1. La tuberculose cutanée est une ma<strong>la</strong>die millénaire au Pérou.<br />
2. Son apparition est liée au sous-développement, à l’environnement, et à <strong>la</strong> paupérisation.<br />
3. Elle fut <strong>la</strong>rgement étudiée à travers <strong>de</strong>s recherches menées au Pérou aussi bien<br />
qu’à l’étranger, et dont <strong>la</strong> première réalisée au Pérou revient au Dr Luis Flores-Cevallos.<br />
4. Il existe <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> prévention (vaccin) et <strong>de</strong> traitement favorable.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté<br />
Selon Unanue, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine que les Espagnols introduirent dans le Nouveau Mon<strong>de</strong> fut<br />
dominée par <strong>la</strong> théologie sco<strong>la</strong>stique du Moyen Âge et les concepts philosophiques d’Aristote<br />
4 . Dans l’Espagne du XVI e siècle, les universités étaient soumises à l’intolérance religieuse<br />
<strong>de</strong> l’Inquisition. Les idées <strong>de</strong> <strong>la</strong> Renaissance se heurtèrent en général à une<br />
gran<strong>de</strong> résistance, comme celles <strong>de</strong> Vésale, qui bouleversa l’anatomie avec <strong>la</strong> dissection<br />
<strong>de</strong> cadavres.<br />
La conquête <strong>de</strong> l’empire inca commença aux environs <strong>de</strong> 1526 avec <strong>la</strong> signature du<br />
document entre Francisco Pizarro, Diego <strong>de</strong> Almagro et le prêtre Hernando <strong>de</strong> Luque<br />
pour conquérir un pays fabuleux, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s côtes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer du Sud, qu’ils appe<strong>la</strong>ient<br />
« Biru ». En 1531, au cours du troisième et <strong>de</strong>rnier voyage vers le sud, les conquistadors<br />
durent faire halte dans <strong>la</strong> paisible baie <strong>de</strong> Las Esmeraldas, à Coaque (Équateur). « Une<br />
ma<strong>la</strong>die inconnue et redoutable appelée berrues », attaqua un grand nombre d’entre<br />
eux, provoquant détresse et consternation. L’Inca Garci<strong>la</strong>so raconte qu’une ma<strong>la</strong>die<br />
« étrange, abominable » apparut soudain : elle était caractérisée par <strong>de</strong>s verrues multiples<br />
sur toute <strong>la</strong> peau du corps, dont <strong>la</strong> plupart grandissaient démesurément et <strong>de</strong>venaient<br />
comme <strong>de</strong>s « figues », et saignaient beaucoup, affectant le visage, car beaucoup<br />
« pendaient du front, d’autres <strong>de</strong>s sourcils, d’autres <strong>de</strong> <strong>la</strong> pointe du nez, <strong>de</strong> <strong>la</strong> barbe et<br />
<strong>de</strong>s oreilles ». L’épidémie affecta plusieurs Espagnols, avec <strong>de</strong>s verrues gran<strong>de</strong>s et sang<strong>la</strong>ntes<br />
comme <strong>de</strong>s « œufs », accompagnées d’autres symptômes d’intoxication, <strong>de</strong> délire<br />
et <strong>de</strong> paralysie. Comme il s’agissait d’une ma<strong>la</strong>die nouvelle pour les Espagnols, Gómara<br />
note qu’« ils ne savaient que faire 3-6 .»<br />
Le calvaire <strong>de</strong>s Espagnols dura sept mois. Certains moururent sous l’effet <strong>de</strong> cette<br />
étrange souffrance, qui débutait brusquement « car ils al<strong>la</strong>ient se coucher sains et se réveil<strong>la</strong>ient<br />
très ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ». Il s’agit là d’une <strong>de</strong>s premières ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques systémiques,<br />
dont <strong>la</strong> phase éruptive fut magistralement décrite par le chroniqueur espagnol<br />
Miguel <strong>de</strong> Estete, qui affirme que « le vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> Coaque est <strong>la</strong> côte <strong>la</strong> plus ma<strong>la</strong><strong>de</strong> qu’il<br />
y a sous le ciel 3 .»<br />
Les Espagnols n’accordèrent aucune importance aux connaissances médicales <strong>de</strong>s<br />
Incas. Dans son Historia General <strong>de</strong>l Perú [<strong>Histoire</strong> générale du Pérou], Garci<strong>la</strong>so <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Vega raconte que l’Inca Atahualpa tomba ma<strong>la</strong><strong>de</strong> au cours <strong>de</strong> son emprisonnement; selon<br />
le père B<strong>la</strong>s Valera, « en prison, l’Inca n’eut plus le goût <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et souffrait d’une mé<strong>la</strong>ncolie<br />
si profon<strong>de</strong> d’être enchaîné et seul, qu’on ne <strong>la</strong>issait entrer aucun Indien, sauf un<br />
jeune neveu qui le servait. Alors les Espagnols le libérèrent et appelèrent les principaux<br />
Indiens, qui amenèrent <strong>de</strong> grands herboristes pour le guérir; pour indiquer <strong>la</strong> température,<br />
ils prirent le pouls du nez, entre les sourcils, et lui donnèrent à boire le jus d’herbes<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> vertu. Il en appe<strong>la</strong> quelques-unes payco, et ne nomma pas les autres. Il dit que<br />
<strong>la</strong> boisson lui provoqua une gran<strong>de</strong> sueur et un sommeil profond et long, après quoi <strong>la</strong><br />
température <strong>de</strong>scendit et il se réveil<strong>la</strong> sans fièvre; et qu’on lui fit un autre médicament et<br />
qu’en quelques jours il revint à soi, et qu’on le remit alors en prison 3-6 .»<br />
À peine <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Lima fondée en 1535, on ressentit le besoin <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s centres<br />
hospitaliers pour soigner les nombreux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s, espagnols et indiens. Le premier hôpital<br />
fut inauguré le 16 mars 1538 à <strong>la</strong> Rinconada <strong>de</strong> Santo Domingo et naquit le béguinage<br />
<strong>de</strong> Cami<strong>la</strong>s pour les femmes atteintes du « chancre ». L’Hôpital <strong>de</strong> Santa Ana,<br />
315
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
316<br />
<strong>de</strong>stiné à « guérir les misérables Indiens qui mouraient comme <strong>de</strong>s bêtes dans les<br />
champs et dans les rues », selon Córdova y Urrutia, commença à être édifié vers 1549 ;<br />
ils mouraient surtout à cause <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses. L’hôpital <strong>de</strong> San Andrés fut<br />
fondé en 1556 pour soigner les Espagnols 3 .<br />
La lèpre infecta le sol américain ; en conséquence, et suivant l’initiative d’Antón Sánchez,<br />
il fallut fon<strong>de</strong>r en 1546 un hôpital appelé hôpital <strong>de</strong> San Lázaro, qui accueillit bientôt<br />
plusieurs patients ; les esc<strong>la</strong>ves africains étaient très sujets à <strong>la</strong> lèpre et à <strong>la</strong> variole.<br />
Peu après <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête, d’autres hôpitaux furent fondés à Lima et dans diverses<br />
villes du Pérou comme Cuzco, Trujillo, Huamanga et Arequipa. Dans ces cas-ci,<br />
l’initiative provenait <strong>de</strong>s religieux et <strong>de</strong>s confréries <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité.<br />
Le Real Tribunal <strong>de</strong>l Protomedicato fut créé au Pérou par le roi Philippe II pour contrôler<br />
<strong>la</strong> profession médicale; il fut inauguré en 1570 à l’époque du vice-roi Toledo. Une décision<br />
royale datée <strong>de</strong> 1501 permit l’introduction <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves africains en Amérique;<br />
ceux qui venaient <strong>de</strong> Panamá apportaient beaucoup <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies, comme <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong><br />
lèpre, <strong>la</strong> rougeole et le typhus; ils vivaient au milieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> corruption et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies 3 .<br />
Plusieurs épidémies se produisirent pendant <strong>la</strong> vice-royauté, notamment <strong>de</strong>s épidémies<br />
virales. L’art popu<strong>la</strong>ire remarquait <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> ces hôtes indésirables :<br />
Rougeole frappe à <strong>la</strong> porte<br />
Variole <strong>de</strong>man<strong>de</strong> : « Qui va là ? »<br />
et Scar<strong>la</strong>tine riposte :<br />
« Nous voilà toutes trois. »<br />
Les épidémies <strong>de</strong> variole, <strong>de</strong> rougeole, <strong>de</strong> verrue, <strong>de</strong> typhus exanthématique et <strong>de</strong><br />
grippe étaient très fréquentes, attaquant <strong>de</strong> préférence <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène.<br />
La tuberculose fut une ma<strong>la</strong>die très répandue pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> coloniale et <strong>la</strong> République.<br />
Santa Rosa <strong>de</strong> Lima, patronne <strong>de</strong> l’Amérique hispanique et <strong>de</strong>s Philippines,<br />
mourut <strong>de</strong> tuberculose le 24 août 1617 à l’âge <strong>de</strong> 31 ans. Simón Bolívar, après sa campagne<br />
libératrice du Pérou, partit sur l’île Santa Marta où il mourut du même mal.<br />
La variole produisit encore <strong>de</strong>s épidémies pendant toute l’époque coloniale et les premières<br />
années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République. L’une <strong>de</strong>s pires épidémies a<strong>la</strong>rma tout le Pérou en<br />
avril 1584 ; elle commença à Cuzco comme une souffrance que certains appe<strong>la</strong>ient rougeole,<br />
d’autres typhus ou oreillons. Il était difficile <strong>de</strong> préciser le type <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die en raison<br />
« du retard <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, mais plus tard les symptômes montrèrent qu’il s’agissait<br />
probablement <strong>de</strong> <strong>la</strong> variole ». Cette ma<strong>la</strong>die attaquait « presque exclusivement les Indiens,<br />
qui mouraient par milliers, surtout les jeunes 7 .»<br />
Cette épidémie dura jusqu’en 1590. D’après les histoires qui provenaient <strong>de</strong>s différentes<br />
provinces du Pérou, on l’assimi<strong>la</strong>it à <strong>la</strong> peste <strong>de</strong> Florence — à cause <strong>de</strong>s ravages —<br />
décrite par Alejandro Manzoni. Les cadavres restaient parfois sans sépulture, ou bien on<br />
creusait <strong>de</strong>s tranchées à même les rues pour éviter <strong>de</strong> les dép<strong>la</strong>cer.<br />
La popu<strong>la</strong>tion péruvienne, qui comptait 10 millions d’habitants d’après ce que l’on<br />
sait <strong>de</strong> l’empire inca au moment <strong>de</strong> sa conquête, diminua considérablement. Le recensement<br />
réalisé par le vice-roi Gil <strong>de</strong> Taboada y Lemos entre 1792 et 1795 révé<strong>la</strong> une popu<strong>la</strong>tion<br />
<strong>de</strong> 1,4 million d’habitants dans <strong>la</strong> circonscription <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté péruvienne.<br />
La cause <strong>de</strong> ce terrible dépeuplement s’explique non seulement par les gran<strong>de</strong>s pertes<br />
produites par les ma<strong>la</strong>dies virales que les conquistadors apportèrent, mais aussi par les<br />
mauvaises conditions <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s Indiens 7 .<br />
Pendant toute l’époque coloniale et les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, il n’y eut<br />
aucune tentative <strong>de</strong> représenter graphiquement les différentes ma<strong>la</strong>dies présentant <strong>de</strong>s<br />
lésions visibles <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau, comme l’avaient fait les anciens Péruviens. Les travaux<br />
médicaux furent rares ; ils étaient tous triés par le Tribunal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sainte Inquisition qui<br />
s’était installé à Lima sous le gouvernement du vice-roi Toledo en 1570 et qui dura
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
pratiquement jusqu’en 1821, année <strong>de</strong> l’indépendance du Pérou. Les cercles médicaux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> d’Amérique du Sud ne s’intéressèrent pas beaucoup<br />
aux ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
En 1818, le protomedico Melchor <strong>de</strong> Amusgo (prêtre) publia un « discours sur <strong>la</strong> rougeole<br />
ou à propos <strong>de</strong> <strong>la</strong> rougeole » qui reçut les éloges <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’époque. Comme<br />
le prouva Lastres, il existait à l’époque un rapport soli<strong>de</strong> entre <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>la</strong> religion.<br />
Le protomedico Pedro Gago <strong>de</strong> Vadillo (Espagnol) publia en 1630 le premier livre péruvien<br />
sur <strong>la</strong> chirurgie, Luz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Verda<strong>de</strong>ra Cirugía [Lumière <strong>de</strong> <strong>la</strong> véritable chirurgie], dans lequel<br />
il nomma <strong>la</strong> verrue pour <strong>la</strong> première fois. Rappelons qu’à l’époque, tout comme en Europe,<br />
les chirurgiens se consacraient au soin <strong>de</strong>s troubles externes, superficiels ou cutanés.<br />
En 1693, le protomedico prêtre Vargas Machuca publia un Discurso sobre el sarampión<br />
[Discours sur <strong>la</strong> rougeole], recevant les éloges d’Unanue.<br />
En 1694, Francisco Bermejo y Roldán, professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire Prime <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
(partie <strong>de</strong> l’office divin qui se récitait au lever du jour), publia un livre sur <strong>la</strong> rougeole,<br />
ma<strong>la</strong>die qui apparaissait <strong>de</strong> façon épidémique et présentait <strong>de</strong> graves complications; on<br />
croyait que <strong>la</strong> contagion était provoquée par les miasmes <strong>de</strong> l’air et que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die altérait<br />
les humeurs et le sang. Pour son traitement, Bermejo conseil<strong>la</strong>it <strong>de</strong> rénover l’air avec<br />
du romarin, tandis qu’il prescrivait <strong>de</strong>s saignées et <strong>de</strong>s purges pour améliorer les humeurs.<br />
Il s’agit là <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>la</strong> plus complète sur <strong>la</strong> rougeole.<br />
Entre 1732 et 1743, Pedro Peralta publia un Calendario anual sobre climas y enfermeda<strong>de</strong>s<br />
[Calendrier annuel sur les climats et les ma<strong>la</strong>dies], dans lequel il affirmait que l’automne<br />
était une saison plus propice aux ma<strong>la</strong>dies, avec <strong>de</strong>s menaces <strong>de</strong> variole et <strong>de</strong> rougeole.<br />
L’amphithéâtre anatomique royal fut inauguré le 21 novembre 1792 à l’hôpital San<br />
Andrés, suivant les conseils du protomedico péruvien Hipólito Unanue, dans le but<br />
d’améliorer l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, d’après l’anatomiste Vésale ; il y établit <strong>de</strong>s<br />
conférences cliniques, où il serait le conférencier sur les « fièvres » ; le protomedico José<br />
M. Dávalos aurait à sa charge les conférences sur <strong>la</strong> « variole ». Lors du discours d’inauguration<br />
<strong>de</strong> l’amphithéâtre, Unanue affirma que « les fièvres éruptives sont un astre<br />
malin du Pérou, plein <strong>de</strong> pestilences et d’épidémies, compliqué par <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> char<strong>la</strong>tans<br />
et d’empiristes qui pratiquent <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et provoquent un tableau déso<strong>la</strong>nt.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> l’anatomie, avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> grands mé<strong>de</strong>cins illustres, va libérer le<br />
Pérou, en <strong>la</strong> rétablissant comme science bénéfique 3 .»<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine s’améliora en 1634, à l’époque du vice-roi Con<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Chinchón ; on découvrit les vertus médicinales <strong>de</strong> l’écorce du quinquina pour guérir les<br />
fièvres tierces et quartes ; elle fut apportée en Europe en 1635.<br />
Une grave épidémie <strong>de</strong> variole eut lieu à Lima en 1802. Un bateau espagnol, qui se<br />
dirigeait vers les Philippines, arriva à Cal<strong>la</strong>o avec quelques f<strong>la</strong>cons en verre contenant le<br />
vaccin ; Unanue profita <strong>de</strong> l’occasion pour procé<strong>de</strong>r à <strong>la</strong> vaccination contre cette terrible<br />
ma<strong>la</strong>die au Pérou. Quelques années plus tard, le roi d’Espagne envoya une expédition<br />
phi<strong>la</strong>nthropique apportant le vaccin, qui arriva à Lima en 1806 ; cependant, un an plus<br />
tôt (1805), neuf tubes <strong>de</strong> verre contenant le vaccin étaient arrivés <strong>de</strong> Buenos Aires, ce<br />
qui permit <strong>de</strong> poursuivre <strong>la</strong> vaccination commencée par Unanue, non sans quelque résistance<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. L’arrivée <strong>de</strong> Salvani avec l’expédition phi<strong>la</strong>nthropique<br />
mentionnée permit d’étendre <strong>la</strong> vaccination contre <strong>la</strong> variole dans toute <strong>la</strong> Colonie,<br />
avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration efficace d’Hipólito Unanue.<br />
Suivant l’initiative d’Unanue, le collège royal <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> San Fernando<br />
fut fondé au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté d’Abascal et commença à fonctionner le<br />
13 août 1808. Le programme d’étu<strong>de</strong>s était en accord avec les progrès médicaux <strong>de</strong><br />
l’époque : « La théorie est accompagnée <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique pour que, liées à une morale<br />
saine, elles soient le chemin pour <strong>de</strong>venir un bon mé<strong>de</strong>cin 3 . » Lorsque l’époque coloniale<br />
se termina, ce savant péruvien avait acquis une technique scientifique, une sensibilité<br />
professionnelle et une profon<strong>de</strong>ur philosophique exceptionnelles.<br />
317
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
318<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pendant les cent premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
Suite à <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> l’indépendance, le 28 juillet 1821, <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
ne changea pas sinon qu’elle garda les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine coloniale. Pendant<br />
les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, les guerres civiles continues empêchèrent tout<br />
progrès. Hipólito Unanue, le père <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne qui avait occupé d’importants<br />
postes durant l’époque coloniale, continua <strong>de</strong> travailler et <strong>de</strong> diffuser ses connaissances<br />
après <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> l’indépendance. Son successeur, Cayetano Heredia,<br />
réforma le p<strong>la</strong>n d’étu<strong>de</strong>s médicales et créa <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine actuelle. Le 30 décembre<br />
1848 marqua <strong>la</strong> fin du Protomedicato, qui céda les droits à <strong>la</strong> nouvelle faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, créée le 9 septembre 1856 ; <strong>de</strong>s concours furent mis en p<strong>la</strong>ce pour occuper les<br />
postes <strong>de</strong>s différentes chaires et pour obtenir les meilleurs mé<strong>de</strong>cins afin d’entreprendre<br />
<strong>la</strong> réforme <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne. Plusieurs jeunes se rendirent<br />
ensuite dans les universités européennes (surtout françaises), et ils occuperaient plus<br />
tard les différentes chaires. Le doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, Cayetano Heredia, établit<br />
les nouveaux règlements comportant un programme pédagogique mo<strong>de</strong>rne, créant<br />
<strong>de</strong> nouvelles chaires et donnant plus d’importance à <strong>la</strong> pratique hospitalière; il fonda le<br />
musée d’histoire naturelle et un herbier avec 1 820 p<strong>la</strong>ntes, ainsi qu’une belle collection<br />
<strong>de</strong> minéraux et d’espèces géologiques. Heredia s’entoura <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borateurs prestigieux<br />
<strong>de</strong> l’envergure <strong>de</strong> José Elboli (Italien), précurseur <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> chimie ; Antonio Raimondi<br />
(Italien), grand explorateur qui décrivit physiquement le Pérou ; Rafael Benavi<strong>de</strong>s,<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> physique médicale et d’hygiène.<br />
En 1851, Lima subit une épidémie <strong>de</strong> fièvre jaune, qui motiva <strong>la</strong> création d’un nouvel<br />
établissement mo<strong>de</strong>rne en accord avec le progrès urbain et scientifique pour remp<strong>la</strong>cer<br />
l’hôpital <strong>de</strong> San Andrés vétuste. L’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo fut alors inauguré le 28 février<br />
1875 ; il était l’un <strong>de</strong>s meilleurs d’Amérique du Sud, équipé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières technologies<br />
<strong>de</strong> l’époque.<br />
En 1870, au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction du chemin <strong>de</strong> fer <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sierra centrale, une gran<strong>de</strong><br />
épidémie <strong>de</strong> verrue péruvienne affecta les travailleurs; elle attaquait spécialement ceux<br />
qui venaient d’autres régions du pays et <strong>de</strong> l’étranger. Comme un triste épilogue <strong>de</strong> cette<br />
gran<strong>de</strong> œuvre d’ingénierie, chaque traverse coûta une vie.<br />
En 1879, <strong>la</strong> guerre contre le Chili bloqua totalement le Pérou, dans les domaines économique,<br />
culturel et social. Les bibliothèques furent saccagées par l’armée chilienne,<br />
l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo fut occupé, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et d’autres institutions cessèrent<br />
<strong>de</strong> fonctionner.<br />
À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo fut rouvert ; les pratiques hospitalières y<br />
étaient réalisées et <strong>de</strong> longues discussions eurent lieu sur <strong>la</strong> fièvre d’Oroya et <strong>la</strong> verrue<br />
éruptive comme étant <strong>de</strong>s entités différentes. Un nom mérite d’être mentionné : Daniel<br />
Alci<strong>de</strong>s Carrión, un étudiant en quatrième année <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine qui, imprégné <strong>de</strong>s nouvelles<br />
sciences médicales et philosophiques <strong>de</strong> son époque, décida <strong>de</strong> se sacrifier. Le<br />
27 août 1885, il se fit pratiquer quatre inocu<strong>la</strong>tions — <strong>de</strong>ux à chaque bras — du bouton<br />
verruqueux d’un ma<strong>la</strong><strong>de</strong> déjà convalescent qui était hospitalisé dans une salle <strong>de</strong><br />
l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo. Quelques jours plus tard, il développa les symptômes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
: <strong>de</strong> grands frissons, une forte fièvre, une cépha<strong>la</strong>lgie gravative, <strong>de</strong>s douleurs muscu<strong>la</strong>ires,<br />
<strong>de</strong>s crampes, <strong>de</strong> l’insomnie, ainsi que <strong>de</strong>s altérations <strong>de</strong>s sens, <strong>de</strong> l’inquiétu<strong>de</strong><br />
et du délire. Pendant les premiers jours il fut luci<strong>de</strong> et décrivit les symptômes <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Il consigna sur le dossier clinique : « Mais maintenant je me trouve finalement<br />
convaincu que je suis atteint <strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre qui tua mon ami Orihue<strong>la</strong>. Voici <strong>la</strong> preuve palpable<br />
que <strong>la</strong> fièvre d’Oroya et <strong>la</strong> verrue éruptive ont <strong>la</strong> même origine, tel que je l’ai entendu<br />
dire une fois <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du Dr A<strong>la</strong>rco. » À travers son sacrifice, Carrión aida à <strong>la</strong><br />
résolution définitive du problème nosographique <strong>de</strong> <strong>la</strong> verrue péruvienne. Avant <strong>de</strong><br />
perdre connaissance, il nous <strong>la</strong>issa son message éternel : « Je ne suis pas encore mort,
mes amis, maintenant c’est à vous <strong>de</strong> finir l’œuvre engagée, suivant le chemin que je<br />
vous ai tracé 3 .»<br />
Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Carrión, nos chercheurs entreprirent un travail incessant ; il faut distinguer<br />
parmi eux Alberto Barton, qui découvrit en 1905 le germe causant <strong>la</strong> verrue péruvienne.<br />
En 1887, <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando approuva un nouveau programme<br />
d’étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> nouvelles chaires furent créées dans les années qui suivirent. Un nouvel emp<strong>la</strong>cement<br />
pour <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut créé en 1903, celui qu’elle occupe actuellement.<br />
La littérature médicale fut très pauvre pendant les premières années <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
En 1884, Pablo Patrón publia dans <strong>la</strong> Gaceta Médica <strong>de</strong> Lima un travail dont le titre était<br />
« Bref traité <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die vénérienne ou Morbus gallicus », consacré au mé<strong>de</strong>cin français<br />
<strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> Paris Pablo Petit, le premier à introduire au Pérou les mercuriels pour traiter<br />
cette ma<strong>la</strong>die redoutable. Ce mé<strong>de</strong>cin français installé à Lima critiquait très sévèrement<br />
ses collègues qui utilisaient encore le traitement à base <strong>de</strong> purges, <strong>de</strong> saignées, <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>vements et d’herbes telles que <strong>la</strong> ronce et <strong>de</strong>s onguents mercuriels, qui ne faisaient<br />
qu’accélérer <strong>la</strong> mort du patient et enrichissaient les mé<strong>de</strong>cins.<br />
En 1918, Hermilio Valdizán fonda <strong>la</strong> revue Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong> San<br />
Fernando dans le but <strong>de</strong> publier exclusivement <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche médicale et<br />
d’éviter les articles sur <strong>de</strong>s cérémonies pompeuses qui n’avaient rien à voir avec <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Cette revue publia les travaux <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> Barton — découvreur du germe<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> verrue —, Pedro Weiss, Tello, Monge et bien d’autres.<br />
Dans les années 20, les professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando, suivant<br />
l’exemple <strong>de</strong> Cayetano Heredia, stimulèrent et aidèrent plusieurs jeunes mé<strong>de</strong>cins<br />
à poursuivre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> différentes spécialités dans les universités européennes pour<br />
qu’ils occupent plus tard les nouvelles chaires qui se créaient progressivement. C’est<br />
ainsi qu’Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> se rendit à Paris pour se spécialiser en <strong>de</strong>rmatologie,<br />
chaire qu’il occupa à son retour.<br />
Segunda parte<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Luis Flores-Cevallos<br />
SOCIÉTÉ PÉRUVIENNE DE DERMATOLOGIE<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 30, le Pérou accueillit le Pr. Luis Pierini, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires, et le Pr. Basombrío,<br />
<strong>de</strong>rmatologue péruvien installé en Argentine. Ils se réunirent avec le Pr. Aurelio<br />
Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> afin <strong>de</strong> stimuler <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’objectif ne fut pas atteint à l’époque à cause du nombre réduit <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues 7 , mais<br />
il fut conseillé <strong>de</strong> former davantage <strong>de</strong> spécialistes dans le pays et d’envoyer les plus remarquables<br />
à l’étranger pour qu’ils achèvent leur formation.<br />
Le 15 mai 1964, les <strong>de</strong>rmatologues péruviens se réunirent en assemblée extraordinaire<br />
pour fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et en approuvèrent les<br />
statuts, é<strong>la</strong>borés par une commission intégrée par Aizic Cotlear, Juan Manrique,<br />
Amaro Urrelo, Guillermo Arana, Luis Cavero, José San Martín. Le statut comportait<br />
onze chapitres et trente articles 8 . Parmi les fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie nous citerons Amaro Urrelo, Marcial Ayaipoma, Juan Manrique, Zuño<br />
Burstein et Wences<strong>la</strong>o Castillo. La société s’est formée dans le but <strong>de</strong> regrouper les<br />
<strong>de</strong>rmatologues et les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> spécialités communes, <strong>de</strong> favoriser <strong>la</strong> recherche,<br />
<strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s liens avec les organisations analogues, aussi bien nationales<br />
■ II<br />
319
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
320<br />
qu’étrangères ; <strong>de</strong> nommer spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie les mé<strong>de</strong>cins réunissant les<br />
conditions éthiques et <strong>de</strong> préparation stipulées dans les règlements en vigueur, <strong>de</strong> garantir<br />
les fonctions éthiques et déontologiques propres à <strong>la</strong> spécialité jusqu’à <strong>la</strong> formation<br />
du Collège médical ; et enfin <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borer avec les entités officielles et privées<br />
pour fournir <strong>de</strong>s solutions aux problèmes techniques. La commission directive <strong>de</strong>vait<br />
changer tous les ans.<br />
En 1971, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Luis Flores-Cevallos, une commission fut nommée<br />
pour modifier le statut <strong>de</strong> <strong>la</strong> société en l’adaptant aux exigences du Collège médical du<br />
Pérou. Le statut changea plusieurs fois dans ses aspects secondaires 9 ; <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
réforme (1996), <strong>la</strong> commission directive est élue tous les <strong>de</strong>ux ans. La Société péruvienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie organise <strong>de</strong>s réunions clinico-pathologiques mensuelles, <strong>de</strong>s journées,<br />
<strong>de</strong>s congrès bisannuels et d’autres activités scientifiques, effectuées aussi bien à Lima<br />
que dans les provinces. Le 1 er septembre 2004, <strong>la</strong> SPD célébra ses 40 ans ; lors <strong>de</strong> cette<br />
cérémonie <strong>la</strong> commission directive — présidée par le Dr Nicolás Tapia Dueñas et dont le<br />
Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t était le secrétaire — octroya <strong>la</strong> médaille d’honneur aux fondateurs<br />
et aux anciens prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. À <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> cérémonie centrale, le doyen<br />
du Collège médical du Pérou inaugura le X e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. La Société<br />
péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie publie actuellement un bulletin d’information et une<br />
revue scientifique, Dermatología Peruana.<br />
En 1967, pendant le XIV e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie réalisé à Munich (Allemagne),<br />
le Dr Luis Flores-Cevallos 14 , ami du Pr. Robert Degos, mé<strong>de</strong>cin à l’hôpital Saint-<br />
Louis et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques (LISD), lui<br />
manifesta son désir d’inscrire <strong>la</strong> SPD au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite ligue, objectif atteint après les démarches<br />
nécessaires et le paiement — <strong>de</strong> ses propres <strong>de</strong>niers — <strong>de</strong>s cotisations <strong>de</strong> vingt<br />
et un <strong>de</strong>rmatologues.<br />
En 1969, le Dr Luis Flores-Cevallos fut élu prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD ; il fonda et organisa<br />
alors les sièges <strong>de</strong>s provinces ainsi que leurs propres commissions directives.<br />
Siège central, à Lima: Prési<strong>de</strong>nt, Luis Flores-Cevallos; vice-prési<strong>de</strong>nt, Zuño Burstein;<br />
secrétaire général, Wences<strong>la</strong>o Castillo; secrétaire d’action scientifique, Luis Romero; secrétaire<br />
d’économie, Oscar Romero; secrétaire d’action syndicale et déontologie, Pedro<br />
Navarro; secrétaire à <strong>la</strong> <strong>Bibliothèque</strong> et aux Archives, María Elena Ruiz.<br />
Siège région du sud, à Arequipa : Marcial Ríos, Luis Suárez, Raúl Hurtado, Víctor<br />
Delgado.<br />
Siège région du nord, à Trujillo : Luis Tincopa.<br />
Le Dr Luis Flores-Cevallos organisa également à Arequipa <strong>la</strong> 1 re Journée péruvienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, réalisée du 21 au 24 mai 1970 et qui réunit non seulement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
mais aussi <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> spécialités communes et paramédicales. Les<br />
annales <strong>de</strong> ces journées furent publiées dans un numéro spécial <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD<br />
(vol. 4 nº 1 juin 1970).<br />
Le 1 er septembre 1971 le Dr Luis Flores-Cevallos fut encore élu prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie; <strong>la</strong> commission directive fut complétée par Wences<strong>la</strong>o Castillo,<br />
Raúl Gal<strong>la</strong>rday, Luis Romero, Oscar Romero, Pedro Navarro et María Elena Ruiz.<br />
Divers hôpitaux <strong>de</strong> Lima et <strong>de</strong> Cal<strong>la</strong>o accueil<strong>la</strong>ient <strong>de</strong>puis peu <strong>de</strong>s symposiums, <strong>de</strong>s<br />
tables ron<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s conférences organisés par <strong>la</strong> SPD, ainsi que <strong>de</strong>s cours et <strong>de</strong>s journées<br />
à Lima et dans les provinces (Arequipa et Trujillo) ; tout ce<strong>la</strong> justifiait <strong>la</strong> réalisation du<br />
I er Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’organisation <strong>de</strong> ce premier congrès fut une tâche difficile mais elle était compensée<br />
par le grand intérêt qu’il éveil<strong>la</strong>it et par <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong> prestigieux <strong>de</strong>rmatologues<br />
provenant <strong>de</strong> différents pays. Le I er Cours international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le I er Congrès<br />
péruvien <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eurent lieu à l’hôpital Edgardo Rebagliati<br />
Martins, du 1 er au 7 décembre 1971. L’assistance se composait <strong>de</strong> 30 <strong>de</strong>rmatologues<br />
étrangers, 10 accompagnateurs et 150 <strong>de</strong>rmatologues nationaux.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Les cours, les conférences, les symposiums, les forums et les tables ron<strong>de</strong>s comptèrent<br />
<strong>la</strong> présence et <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> professeurs tels que Jorge Abu<strong>la</strong>fia, Julio Borda,<br />
Raúl Balsa, Juan Fuertes Álvarez, David Grinspan, Ana Kaminsky, Carlos Kaminsky,<br />
Pablo Negroni, Lázaro Sehtman, Juan Serra-Estivell, Sergio Stringa, Domingo Mantel<strong>la</strong><br />
et Miguel Dekmak (Argentine) ; Fernando Cár<strong>de</strong>nas (Bolivie) ; Gise<strong>la</strong> Del Pino (Brésil) ;<br />
Luis Rueda Pinto (Colombie) ; Elfrem So<strong>la</strong>no (Costa Rica) ; Wences<strong>la</strong>o Ol<strong>la</strong>gue (Équateur) ;<br />
José Mercadal Peyri et José M. Mascaró (Espagne) ; Ito Kasuke (Japon) ; Francisco Arel<strong>la</strong>no<br />
et Luciano Domínguez (Mexique) ; Francisco Da Cruz Sobral, María Fernanda Me<strong>la</strong>da<br />
et Aureliano Da Fonseca (Portugal) et Miguel Contreras (République dominicaine).<br />
Les actes du congrès furent publiés dans un numéro spécial <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD :<br />
1971 ; 5 (2) : 1-55.<br />
Au cours <strong>de</strong> ses quarante ans, <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie renouve<strong>la</strong> périodiquement<br />
sa commission directive; pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2003-2004, celle-ci fut présidée par le Dr<br />
Nicolás Tapia, tandis que le Dr Eva Tejada fut élue pour <strong>la</strong> prochaine pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans.<br />
COMITÉ CENTRAL PÉRUVIEN DU COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE<br />
(CCP-CILAD). COMITÉ NATIONAL PÉRUVIEN DU COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN<br />
DE DERMATOLOGIE<br />
En 1979, l’assemblée du CILAD choisit Luis Flores-Cevallos comme délégué péruvien<br />
pour une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> quatre ans; en 1983 il fut réélu. Le prési<strong>de</strong>nt du CILAD, Jorge Abu<strong>la</strong>fia,<br />
souhaitait travailler en coordination avec le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, mais malgré les démarches effectuées aucun accord pour organiser un<br />
p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> travail conjoint ne put avoir lieu. C’est pour cette raison que Luis Flores, pour récupérer<br />
les années perdues, décida <strong>de</strong> former le Comité central péruvien du CILAD (CCP-<br />
CILAD) en 1984, qui al<strong>la</strong>it <strong>de</strong>venir plus tard le Comité national péruvien du Collège<br />
ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie10 . Ses col<strong>la</strong>borateurs furent les Drs Zuño Burstein<br />
et Víctor Meth (secrétaires <strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong> presse), Wences<strong>la</strong>o Castillo (secrétaire général)<br />
et Elda Cana<strong>de</strong>ll (trésorière). Le comité constitua un vivier permettant <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong><br />
l’apathie dans <strong>la</strong>quelle était tombée <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie: <strong>de</strong>s réunions<br />
clinico-pathologiques furent programmées, et le Dr Zuño Burstein, avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />
du Dr Víctor Meth, <strong>la</strong>nça en octobre 1986 l’édition du bulletin Folia Dermatológica Peruana,<br />
organe officiel <strong>de</strong> l’institution, à contenu informatif, scientifique et institutionnel, à<br />
diffusion nationale et internationale.<br />
Le Comité national péruvien du CILAD se préoccupa aussi du respect <strong>de</strong>s obligations<br />
administratives : il paya les cotisations <strong>de</strong>s associés aux institutions tuté<strong>la</strong>ires du CILAD<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> ILDS négligées, celles-ci ayant été sur le point d’expulser le Pérou. On se préoccupa<br />
également d’inviter <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues péruviens aux événements internationaux,<br />
ce qui entraîna <strong>la</strong> participation du pays au XVIIIe Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie réalisé<br />
à Berlin ainsi qu’au XIe Congrès du CILAD (Madrid) en 1987.<br />
COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE DU PÉROU (CILAD-PÉROU)<br />
Lors du XII e Congrès réalisé à Guada<strong>la</strong>jara (Mexique) en 1991, l’assemblée du CILAD<br />
— présidée alors par Enrique Hernán<strong>de</strong>z Pérez — choisit le Dr Zuño Burstein comme<br />
nouveau délégué national péruvien ; celui-ci, respectant ses obligations <strong>de</strong> conformité<br />
avec le nouveau prési<strong>de</strong>nt, reconstitua le Comité national péruvien du Collège ibéro<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui fonctionna en tant que tel jusqu’au 7 septembre<br />
1994, date <strong>de</strong> création du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Pérou<br />
(CILAD-PÉROU). CILAD-PÉROU fut reconnu par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et le<br />
Collège médical du Pérou le 9 mars 1995 comme une nouvelle institution médicale scientifique<br />
<strong>de</strong>rmatologique, et inscrit en tant que tel dans les registres publics <strong>de</strong> Lima 11 .<br />
Cette institution, qui déploya une immense activité scientifique, maintint <strong>la</strong> publication<br />
<strong>de</strong> Folia Dermatológica Peruana.<br />
321
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
322<br />
CERCLE DERMATOLOGIQUE DU PÉROU (CIDERM-PÉROU)<br />
Le 5 mai 1999, CILAD-PÉROU changea sa dénomination pour celle <strong>de</strong> CIDERM-<br />
PÉROU (Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou) 12 — tout en conservant ses statuts — et s’affilia<br />
à <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques (ILDS) sous ce nouveau nom.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou (CI-<br />
DERM-PÉROU) sont les institutions péruviennes en vigueur reconnues et enregistrées<br />
par <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
En tant que CILAD-PÉROU d’abord puis CIDERM-PÉROU ensuite, les commissions directives<br />
<strong>de</strong> l’institution furent présidées successivement par les Drs Zuño Burstein, Francisco<br />
Bravo, Rafael Gamarra (le prési<strong>de</strong>nt actuel).<br />
Le CIDERM-PÉROU encourage constamment les <strong>de</strong>rmatologues péruviens à participer<br />
aux événements scientifiques nationaux et internationaux qui leur permettent d’être<br />
au courant <strong>de</strong>s progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ; l’institution gère et octroie les bourses, <strong>de</strong> préférence<br />
aux jeunes <strong>de</strong>rmatologues, afin d’y favoriser leur participation.<br />
Le CIDERM-PÉROU organise toujours les réunions clinico-pathologiques périodiques,<br />
<strong>de</strong>s cours théoriques et pratiques avec <strong>la</strong> participation d’experts internationaux comme<br />
invités, <strong>de</strong>s vidéoconférences, <strong>de</strong>s symposiums et <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>rmatologique<br />
avec <strong>de</strong>s professeurs nationaux et étrangers.<br />
Il réalise également chaque année <strong>de</strong>puis dix ans une importante action <strong>de</strong>stinée à <strong>la</strong><br />
communauté qui s’appelle « Journée du grain <strong>de</strong> beauté » : une campagne nationale<br />
d’éducation, <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> diagnostic précoce du cancer <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et du mé<strong>la</strong>nome.<br />
Cette activité, officialisée par le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, est soutenue par les services<br />
médicaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sécurité sociale et les services <strong>de</strong> santé <strong>de</strong>s forces armées et<br />
policières, ainsi que par les gouvernements locaux ; elle reçoit aussi <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration économique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoires pharmaceutiques, sensibilisés dans <strong>la</strong> matière.<br />
Le CIDERM-PÉROU participe <strong>de</strong> manière institutionnelle aux congrès et aux activités du<br />
Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) et à <strong>la</strong> Réunion annuelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
<strong>la</strong>tino-américains (RADLA), dont <strong>la</strong> commission directive inclut <strong>de</strong>s délégués du Pérou.<br />
Pour <strong>la</strong> première fois dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> RADLA, <strong>la</strong> XXIII e Réunion se réalisa à Lima<br />
du 1 er au 4 mai 2004 avec grand succès, présidée par le Dr Fernando Magill, dirigeant<br />
du CIDERM-PÉROU et délégué national du CILAD ; le Dr Zuño Burstein fut distingué<br />
comme prési<strong>de</strong>nt honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion.<br />
La revue Folia Dermatológica Peruana constitue l’organe officiel <strong>de</strong> diffusion scientifique<br />
du CIDERM-PÉROU, qui possè<strong>de</strong> également <strong>de</strong>s sous-délégations régionales dans<br />
le nord et le sud du pays.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s publications scientifiques <strong>de</strong>rmatologiques au Pérou<br />
Nous citerons quelques-unes <strong>de</strong>s premières publications <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, en tant que<br />
précurseurs <strong>de</strong>s publications actuelles.<br />
En 1953, le Dr Luis Flores-Cevallos édita le Primer Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cátedra <strong>de</strong> Dermatología<br />
y Sifilografía, qui comprenait <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation mensuelle <strong>de</strong>s cas<br />
clinico-pathologiques <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et d’anatomie pathologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Juan Manrique Ávi<strong>la</strong>, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD, édita le premier numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Sociedad Peruana <strong>de</strong> Dermatología comportant <strong>de</strong>s travaux originaux et <strong>de</strong>s activités<br />
scientifiques diverses <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD ; <strong>la</strong> revue, <strong>de</strong> diffusion nationale et internationale, fut publiée<br />
régulièrement jusqu’au mois <strong>de</strong> décembre 1971.<br />
Le Dr Luis Flores-Cevallos édita aussi les annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> I re Journée <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
réalisée à Arequipa dans un numéro spécial <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD (1970). En 1971, il publia<br />
un autre numéro spécial consacré aux annales du I er Cours international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et du I er Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.
REVISTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERMATOLOGÍA ET DERMATOLOGÍA PERUANA<br />
La Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Peruana <strong>de</strong> Dermatología, organe <strong>de</strong> diffusion officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société, fut fondée en 1965 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Juan Manrique. À l’origine <strong>la</strong> publication<br />
était semestrielle et <strong>la</strong> revue était envoyée gratuitement aux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues<br />
membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> SPD, aux institutions nationales et internationales<br />
(bibliothèques).<br />
La revue parut régulièrement jusqu’en 1971 ; vingt-cinq ans après, en 1996, <strong>la</strong> commission<br />
directive étant présidée par le Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t, <strong>la</strong> publication se remit<br />
en route, <strong>la</strong> revue changea son nom et <strong>de</strong>vint Dermatología Peruana, dans le but <strong>de</strong> remettre<br />
à <strong>la</strong> portée <strong>de</strong> tous les <strong>de</strong>rmatologues péruviens et <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté médicale<br />
en général <strong>de</strong>s travaux scientifiques, <strong>de</strong>s expériences professionnelles et l’information<br />
mise à jour sur les <strong>de</strong>rniers progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
De nous jours <strong>la</strong> revue, éditée une fois par an, est divisée en trois numéros ; elle est<br />
enregistrée dans LILACS et LIPECS et son numéro <strong>de</strong> registre est le ISSN1028-7175 ; son<br />
éditeur actuel est le Dr Arturo Saetone.<br />
FOLIA DERMATOLÓGICA PERUANA<br />
La publication <strong>de</strong> Folia Dermatológica Peruana en tant qu’organe <strong>de</strong> diffusion du<br />
Comité central péruvien du CILAD débuta en octobre 1986 ; ultérieurement elle <strong>de</strong>vint<br />
une revue régulièrement publiée jusqu’à nos jours, comportant <strong>de</strong>s travaux originaux<br />
et <strong>de</strong> l’information institutionnelle, à diffusion nationale et internationale. Elle est enregistrée<br />
dans les bases <strong>de</strong> données du pays et <strong>de</strong> l’étranger (LIPECS, LILACS et<br />
SCIELO). Elle constitue actuellement l’organe officiel <strong>de</strong> diffusion scientifique du<br />
Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou (CIDERM-PÉROU). Son numéro <strong>de</strong> registre est le<br />
ISSN1029-1733 ; le Dr Zuño Burstein est son directeur fondateur, tandis que le Dr Rafael<br />
Gamarra, prési<strong>de</strong>nt du CIDERM-PÉROU, en est le directeur exécutif actuel<br />
(année 2005).<br />
REVUE DERMA SUR<br />
Éditée par <strong>la</strong> filiale sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, le premier numéro<br />
parut en septembre 2004, publié par <strong>la</strong> commission directive (présidée par le Dr Lilia Zapata).<br />
REVISTA DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA LATINOAMERICANA<br />
Elle constitue l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
Le premier numéro parut à Lima en octobre 2003 et ses éditeurs principaux sont<br />
les <strong>de</strong>rmatologues péruviens Rosalía Ballona, Héctor Cáceres et José Catacora. Elle reçoit<br />
<strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>rs réputés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et vise à une périodicité <strong>de</strong> quatre<br />
numéros par an pour les distribuer dans toute l’Amérique Latine.<br />
Quelques précurseurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Lorsque <strong>la</strong> spécialité n’était pas encore reconnue, beaucoup <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins — ayant<br />
suivi une formation à l’étranger ou <strong>de</strong> façon autodidacte — se consacraient plus ou moins<br />
au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos à l’étu<strong>de</strong> et à <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie au Pérou. Nos prédécesseurs furent méritoires, nous les considérons<br />
comme <strong>de</strong>s « précurseurs » ; les « pionniers » sont tous ceux qui firent plus tard preuve<br />
d’intérêt et <strong>de</strong> dévouement envers <strong>la</strong> pratique et l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie ;<br />
enfin les « continuateurs » sont les spécialistes qui suivirent leur exemple.<br />
Parmi les précurseurs, il faut rappeler les noms <strong>de</strong> quelques mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong> groupes<br />
professionnels dont l’activité fut notable dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne.<br />
323
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
324<br />
FELIPE MERKEL (1873-1941) 13<br />
Mé<strong>de</strong>cin né à Kronstad (Autriche) en 1873, il poursuivit sa sco<strong>la</strong>rité au sein du prestigieux<br />
collège Nuestra Señora <strong>de</strong> Guadalupe <strong>de</strong> Lima et obtint le diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin à<br />
l’UNMSM (1903) avec un travail académique sur La tuberculose dans l’armée nationale,<br />
qui reçut un prix <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences médicales. Il fit ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation<br />
à Paris, à Berlin et à Vienne, obtenant le diplôme <strong>de</strong> docteur en mé<strong>de</strong>cine en 1908 avec<br />
une thèse sur La réglementation <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution à Lima. Il consacra prioritairement sa<br />
vie professionnelle à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et à <strong>la</strong> syphiligraphie ; il fut nommé prési<strong>de</strong>nt du<br />
Comité péruvien du X e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il est considéré comme le premier<br />
spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie au Pérou.<br />
Lors du V e Congrès médical <strong>la</strong>tino-américain réalisé à Lima en 1913, Merkel exposa<br />
un important travail sur <strong>la</strong> uta. Il se consacra à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis et diffusa l’emploi<br />
du salvarsan dans <strong>la</strong> thérapie antisyphilitique, présentant <strong>de</strong>s travaux sur Salvarsanothérapie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis: douze ans <strong>de</strong> pratique du salvarsan (1922) et sur le traitement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis (1937).<br />
En 1910, il fut désigné membre titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Lima et reçut plusieurs hommages pour son activité professionnelle et son sens austère<br />
<strong>de</strong> l’éthique hippocratique.<br />
MAXIME KUCZYNSKI-GODARD (1890-1967) 14<br />
Mé<strong>de</strong>cin immigré allemand, né en 1890, il contribua très remarquablement à l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans l’Amazonie péruvienne. Il fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à Berlin, où il occupa<br />
le poste <strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> pathologie; plusieurs missions médicales l’entraînèrent<br />
partout dans le mon<strong>de</strong>. À cause <strong>de</strong>s lois racistes <strong>de</strong>s nazis, il démissionna <strong>de</strong> sa chaire en<br />
1933 et émigra d’abord en France, ensuite au Venezue<strong>la</strong>. Il arriva au Pérou en 1936, où<br />
il travail<strong>la</strong> fébrilement: au début avec Carlos Enrique Paz Soldán à l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
sociale <strong>de</strong> l’UNMSM et plus tard au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé. On lui assigna d’importantes<br />
responsabilités sanitaires dans <strong>la</strong> forêt et dans <strong>la</strong> sierra, où il effectua et publia <strong>de</strong> nombreux<br />
travaux scientifiques, dont l’auto-inocu<strong>la</strong>tion expérimentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> verrue péruvienne,<br />
reproduisant ainsi l’expérience <strong>de</strong> Carrión; ce travail lui valut <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong><br />
membre honoraire <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Le gouvernement du Pérou créa<br />
en 1940 <strong>la</strong> Supervision <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> Loreto et San Martín, qui <strong>de</strong>vint rapi<strong>de</strong>ment <strong>la</strong> Supervision<br />
du nord-est à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Maxime Kuczynski. Après avoir fondé en 1940 un<br />
dispensaire anti-lépreux à Iquitos, il reconstruisit l’asile <strong>de</strong> San Pablo en tant que colonie<br />
agricole, où il obtint <strong>de</strong>s progrès notables; il se <strong>la</strong>nça aussi dans l’exploration <strong>de</strong> plusieurs<br />
rivières, notamment l’Ucayali, menant <strong>de</strong>s enquêtes sur <strong>la</strong> lèpre d’une gran<strong>de</strong> valeur.<br />
C’est à lui que revient l’observation <strong>de</strong>s premiers cas <strong>de</strong> lèpre en Amérique du Sud, chez<br />
les tribus camo et cocama, d’authentiques habitants <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt 17 .<br />
GROUPES PROFESSIONNELS<br />
Certains domaines spécialisés <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine qui se rapportent à l’allergie et à l’immunologie<br />
contribuèrent à <strong>la</strong> connaissance et au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au<br />
Pérou. Nous distinguerons certaines personnalités médicales, dont quelques-unes donnèrent<br />
naissance à <strong>de</strong> véritables écoles <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, comme celle du Dr<br />
Emilio Ciuffardi à l’hôpital <strong>de</strong> police ; ce mé<strong>de</strong>cin participa aussi à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne d’immunopathologie et d’allergie. Avec le Dr Pedro Vargas Morales,<br />
fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société d’asthme bronchiale — tous <strong>de</strong>ux décédés —, et leurs successeurs,<br />
ils contribuèrent à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques allergiques.<br />
Dans ce domaine il faut mentionner le service hautement qualifié <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
d’allergie <strong>de</strong> l’hôpital central <strong>de</strong> l’employé, dirigé par le Dr Luis Flores 7 , et l’école allergologique<br />
du Dr Betteta, basée à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, ainsi que l’Institut spécialisé<br />
d’immunologie et d’allergie <strong>de</strong> ses successeurs, groupe lié au Dr José Zegarra Pupi.
Citons aussi <strong>la</strong> contribution du service d’allergie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant, à <strong>la</strong> charge du<br />
Dr Enrique Drassinower. Les successeurs <strong>de</strong> ces personnalités déjà décédées sont actuellement<br />
liés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA DERMATOLOGIE AU PÉROU<br />
L’enseignement universitaire formel <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie débuta au Pérou vers <strong>la</strong> moitié<br />
du XX e siècle. Les Drs Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et Pablo Arana (1930), Arturo Sa<strong>la</strong>s<br />
(1941), Marcial Ayaipoma (1942), Amaro Urello, Víctor Gonzáles (1943) et le Dr Luis<br />
Flores (1947) firent partie du groupe <strong>de</strong> <strong>la</strong> première chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando à l’hôpital Arzobispo Loayza.<br />
LES PIONNIERS<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> (1896-1968) 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, spécialisé en France, pionnier dans l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
clinique au Pérou (figure 9), il naquit à Lima en 1896 et poursuivit <strong>de</strong>s cours<br />
pratiques complets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> vénéréologie avec le professeur Jeanselme à <strong>la</strong><br />
clinique <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées et syphilitiques <strong>de</strong> l’hôpital Saint-Louis. Il étudia également<br />
avec Touraine, Norié, Chevallier, Riccard, Ferrand, Flurin et d’autres maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie française.<br />
De retour au Pérou, il fut l’un <strong>de</strong>s fondateurs <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza, où il occupa<br />
le poste <strong>de</strong> chef du cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong>puis 1927, remp<strong>la</strong>çant<br />
le Dr Eleodoro Camacho. Il fut professeur intérimaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et syphilis à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando, et en 1933 il fut nommé<br />
professeur, pour remp<strong>la</strong>cer le Pr. Pedro Weiss. Ce fut là qu’il obtint le diplôme <strong>de</strong> docteur<br />
en mé<strong>de</strong>cine en 1936, soutenant un important travail <strong>de</strong> recherche sur les Réactions inf<strong>la</strong>mmatoires<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et procédures <strong>de</strong> désensibilisation.<br />
Étant professeur principal titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie (1937), et<br />
plus tard professeur principal titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando (1940), il fut le représentant du Pérou dans plusieurs congrès en Amérique et<br />
en Europe, y apportant <strong>de</strong> remarquables contributions.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création en 1961 <strong>de</strong> l’université péruvienne <strong>de</strong>s sciences médicales et biologiques<br />
Cayetano Heredia, il occupa le poste <strong>de</strong> professeur principal et instaura <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université, où il reçut <strong>la</strong> distinction <strong>de</strong> professeur émérite en 1967.<br />
Le Dr Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> fut nommé membre titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> diverses académies médicales et<br />
<strong>de</strong> multiples collèges et sociétés <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> syphiligraphie, <strong>de</strong> vénéréologie et<br />
<strong>de</strong> léprologie <strong>américaine</strong>s et européennes. Il fut également reconnu et récompensé par<br />
<strong>de</strong>s institutions médicales d’Allemagne, d’Argentine, du Brésil, du Canada, d’Espagne,<br />
<strong>de</strong>s États-Unis, <strong>de</strong> France et du Venezue<strong>la</strong>, entre autres.<br />
Il publia plusieurs articles dans <strong>de</strong>s revues <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine nationales et étrangères,<br />
ainsi que <strong>de</strong> longs et importants travaux <strong>de</strong> recherche en <strong>de</strong>rmatologie tels que Sur le<br />
traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> peste bubonique (1923) ; Contribution au traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> blennorragie<br />
(1928) ; Réactions inf<strong>la</strong>mmatoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et procédures <strong>de</strong> désensibilisation (1936) ;<br />
Mon expérience <strong>de</strong> vingt-cinq ans dans le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis (1953) ; <strong>de</strong> nombreux<br />
articles sur Thérapeutique <strong>de</strong> l’eczéma (entre 1926 et 1940) et différents travaux sur Sujets<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie (entre 1930 et 1960). Il mourut le 17 novembre<br />
1968.<br />
Pedro Weiss (1893-1985) 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin éclectique, spécialisé en France, en Allemagne et en Autriche dans le domaine<br />
<strong>de</strong> l’anatomie pathologique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, pionnier dans le diagnostic étiologique<br />
et dans l’enseignement <strong>de</strong> l’histopathologie et <strong>la</strong> mycologie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
325<br />
Figure. 9<br />
Dr Aurelio Loret<br />
<strong>de</strong> Mo<strong>la</strong><br />
Figure 10.<br />
Dr Pedro Weiss
Figure 11.<br />
Dr Hugo Pesce<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
326<br />
peau au Pérou (figure 10), il naquit à Lima en 1893, fréquenta <strong>la</strong> Universidad Nacional<br />
Mayor <strong>de</strong> San Marcos, où il obtint son doctorat en mé<strong>de</strong>cine en 1927. En 1930, <strong>de</strong> retour<br />
d’Europe, il fut nommé professeur principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université, pour remp<strong>la</strong>cer le Pr. Belisario Sosa Arto<strong>la</strong> qui avait démissionné.<br />
En 1935 il fut nommé professeur principal d’anatomie pathologique,<br />
déployant un travail très fructueux en tant que pathologiste, archéologue, paléo-pathologiste<br />
et <strong>de</strong>rmatologue. En ce qui concerne son travail d’assistance sociale, il fonda et<br />
dirigea les services <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>s hôpitaux Dos <strong>de</strong> Mayo et <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant,<br />
ainsi que celui <strong>de</strong> l’institut d’anatomie pathologique <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos. Il figure<br />
parmi les fondateurs <strong>de</strong> l’université Cayetano Heredia ; il occupa le poste <strong>de</strong> chef du<br />
service <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza, du département d’anthropologie<br />
physique au musée national d’anthropologie et d’archéologie et du séminaire d’anthropologie<br />
physique <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Quant à son travail didactique, il fut professeur principal titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire d’anatomie<br />
pathologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando et professeur principal<br />
titu<strong>la</strong>ire du séminaire d’anthropologie physique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong>s sciences.<br />
Sa contribution scientifique dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche est très vaste, ses publications<br />
nombreuses et importantes aussi bien dans le domaine médical que dans<br />
le domaine anthropologique. Parmi les travaux publiés à propos <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong>rmatologiques<br />
citons : Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> verrue péruvienne (1933) ; Sur un<br />
cas <strong>de</strong> lymphogranulomatose mycotique par Paracoccidioi<strong>de</strong>s brasiliensis (1937) ;<br />
Nouveaux cas <strong>de</strong> lymphogranulomatose mycotique aperçus à Lima (1949) ; Épidémiologie<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies transmises par Phlébotomes dans les An<strong>de</strong>s péruviennes, uta,<br />
verrue péruvienne (1953) et L’association <strong>de</strong> uta et verrue péruvienne dans les<br />
mythes <strong>de</strong> <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong> terre <strong>de</strong>ssinés sur <strong>la</strong> céramique mochica (1961), entre bien<br />
d’autres.<br />
Il intégra quelques institutions scientifiques comme le CILAD (membre honoraire), <strong>la</strong><br />
Société mexicaine d’histoire et philosophie, <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>la</strong> Société brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Sa participation au I er Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut remarquable. Il fut nommé membre honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie le 27 mai 1967.<br />
Durant toute sa carrière professionnelle il reçut maintes distinctions, telles que l’ordre<br />
Hipólito Unanue, avec le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> grand officier, l’ordre Daniel A. Carrión et <strong>la</strong> médaille<br />
d’honneur <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> pathologie <strong>de</strong>s forces armées <strong>de</strong>s États-Unis.<br />
Hugo Pesce (1900-1969) 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin, léprologue tropicaliste, docteur en mé<strong>de</strong>cine, ayant fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> doctorat<br />
en Italie, il fut pionnier <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale au Pérou. Il<br />
naquit dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Tarma-Perú en 1900 (figure 11).<br />
Il obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Gênes (Italie) en 1927.<br />
Il travail<strong>la</strong> comme mé<strong>de</strong>cin généraliste jusqu’en 1931, col<strong>la</strong>borant avec le Dr Carlos<br />
Monge à l’hôpital Arzobispo Loayza et intégrant l’équipe qui effectua les premières<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> biologie andine à Morococha (1927).<br />
Mé<strong>de</strong>cin dans <strong>la</strong> colonie <strong>de</strong> Satipo (forêt du Pérou) il exerça pour <strong>la</strong> première fois en<br />
1931 <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale ; son premier travail dans <strong>la</strong> spécialité fut l’objet <strong>de</strong> son séjour<br />
: Géographie sanitaire dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Satipo.<br />
De retour à Lima, il travail<strong>la</strong> à <strong>la</strong> clinique médicale <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza jusqu’en<br />
1935, quand il fut nommé mandataire sanitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> région ; il fonda au cours <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> même année le Service anti-lépreux d’Apurímac (SALA), entité précédant le Service<br />
national anti-lépreux qu’il créa à Lima en 1944. Ce service <strong>de</strong>vint plus tard le département<br />
et ensuite <strong>la</strong> division <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s normes et supervision du ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
En 1937, il décrivit le premier cas <strong>de</strong> lèpre tuberculoï<strong>de</strong> à Apurímac. En 1945, il fut<br />
admis à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses, tropicales et parasitaires dirigée par le Dr<br />
Oswaldo Hercelles à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando. Il travail<strong>la</strong> sur <strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification<br />
mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, dont il fut coauteur avec les Drs Fernán<strong>de</strong>z et Schujman (Argentine)<br />
et Souza Campos (Brésil). Il créa et resta à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> l’École léprologique<br />
péruvienne.<br />
Il contribua <strong>de</strong> manière décisive à <strong>la</strong> reconstruction académique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> San<br />
Fernando (1961) ; étant professeur principal, il obtint par concours le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses et tropicales, qu’il occupa pendant quatorze ans consécutifs,<br />
jusqu’au 15 mai 1967, date <strong>de</strong> sa nomination comme professeur émérite. Il étudia<br />
<strong>la</strong> lèpre, mais il compi<strong>la</strong> aussi <strong>de</strong> manière exhaustive <strong>de</strong>s informations sur le typhus<br />
exanthématique et le typhus récurrent — dont il avait une vaste expérience grâce à son<br />
séjour dans <strong>la</strong> sierra —, et sur les mycoses profon<strong>de</strong>s, notamment <strong>la</strong> b<strong>la</strong>stomycose sud<strong>américaine</strong><br />
et l’histop<strong>la</strong>smose. Il géra l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos.<br />
L’envergure intellectuelle du Dr Hugo Pesce dépasse <strong>la</strong>rgement l’activité médicale :<br />
il se distingua en tant que grand conférencier, écrivain et philosophe, il déploya un important<br />
patrimoine intellectuel que son esprit encyclopédique avait accumulé en maniant<br />
<strong>la</strong> dialectique avec une habileté extraordinaire, <strong>de</strong>venant ainsi le consultant<br />
attitré <strong>de</strong>s analystes <strong>de</strong> <strong>la</strong> société péruvienne.<br />
Hugo Pesce, maître et chercheur, mourut soudainement le 26 juillet 1969 à l’âge <strong>de</strong><br />
69 ans, en pleine production intellectuelle, après avoir effectué un travail universitaire<br />
gigantesque, persévérant et impeccable.<br />
Marcial Ayaipoma (1908-1998) 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né en 1908 dans le département <strong>de</strong> Huancavelica (figure 12),<br />
partisan <strong>de</strong> l’école française, il fut convoqué en 1942 par le Pr. Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>,<br />
qui était chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos. Ultérieurement et par concours, il fut désigné professeur<br />
associé <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le groupe <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> professeurs se renforça<br />
plus tard avec les Drs Víctor Meth et Elda Cana<strong>de</strong>ll, ainsi que Guillermo Arana et Jaime<br />
Flores en tant qu’auxiliaires.<br />
Un grave problème se posa en 1961 entre <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
San Marcos et le conseil universitaire: <strong>la</strong> faculté refusa l’intervention du tiers d’étudiants<br />
dans son gouvernement. Par conséquent, les professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté présentèrent leur<br />
démission <strong>de</strong> façon collective. Quelques mois plus tard, ces professeurs — parmi lesquels<br />
se trouvait Ayaipoma — fondèrent l’université péruvienne <strong>de</strong>s sciences médicales et biologiques<br />
Cayetano Heredia, dont le local occupé auparavant par le collège Belén, dans le<br />
Jirón <strong>de</strong> <strong>la</strong> Unión, du Cercado <strong>de</strong> Lima était le premier siège.<br />
Le Dr Ayaipoma continua d’enseigner comme professeur associé à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle université, qui fonctionnait à l’hôpital Arzobispo Loayza. En<br />
1970, il présenta sa démission irrévocable <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, tout comme le groupe d’enseignants,<br />
à l’exception du Dr Víctor Gonzáles-Pinillos. Bien qu’éloigné <strong>de</strong> <strong>la</strong> pédagogie, il<br />
rendit toujours d’importants services médicaux à <strong>la</strong> communauté, comme secrétaire à<br />
vie <strong>de</strong> sa promotion.<br />
Le Dr Ayaipoma fut membre actif du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(CILAD) et membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Víctor Gonzáles-Pinillos (1914-1985) 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue d’une vaste expérience, il naquit à Trujillo en 1914 (figure 13),<br />
formé par l’école française et col<strong>la</strong>borateur fidèle du Pr. Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>, il suivit une spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie, à <strong>la</strong>quelle il se consacra jusqu’à sa mort, en 1985.<br />
327<br />
Figure 12.<br />
Dr Marcial<br />
Ayaipoma<br />
Figure 13.<br />
Dr Víctor Gonzáles<br />
Pinillos
Figure 14.<br />
Dr Luis<br />
Flores-Cevallos<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
328<br />
Durant une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> sa carrière professionnelle, il prêta ses services à l’administration<br />
publique car l’une <strong>de</strong> ses priorités était <strong>de</strong> contribuer directement à améliorer<br />
les services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique <strong>de</strong> son pays. Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé l’envoya<br />
dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt, où il travail<strong>la</strong> entre 1942 et 1944 pour résoudre les problèmes<br />
liés aux diverses pathologies <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
En 1945, il commença à travailler dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale, au sein <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> polyclinique nº1 et <strong>de</strong> l’ancien hôpital ouvrier, l’actuel hôpital Guillermo Almenara,<br />
<strong>de</strong>ux centres médicaux où il occupa le poste <strong>de</strong> chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en<br />
1983. Un an plus tard, il regagna l’hôpital Arzobispo Loayza, où il occupa également le<br />
poste <strong>de</strong> chef du cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’en 1961.<br />
Entre le début <strong>de</strong>s années 70 et <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s années quatre-vingt, le Dr Gonzáles-Pinillos<br />
fut chargé du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza, le service le<br />
plus grand et le plus actif du pays, composé <strong>de</strong> quatorze spécialistes qui soignaient chacun<br />
une moyenne <strong>de</strong> quarante patients par jour. En 1977, le Dr Gonzáles-Pinillos obtint<br />
son doctorat <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, où il avait été<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entre 1942 et 1960.<br />
Fondateur <strong>de</strong> l’université péruvienne Cayetano Heredia, il y fut professeur principal<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie jusqu’ à 1979.<br />
Luis Flores-Cevallos 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue spécialisé en France et docteur en mé<strong>de</strong>cine (1973) (figure<br />
14), il naquit à Ayabaca, département <strong>de</strong> Piura, en 1917.<br />
Le Pr. Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> l’incita à partir à l’étranger et lui suggéra l’hôpital Saint-Louis<br />
<strong>de</strong> Paris pour être le meilleur centre d’étu<strong>de</strong>s en <strong>de</strong>rmatologie. En 1950, il s’inscrivit aux<br />
cours d’histopathologie <strong>de</strong>rmatologique, avec le Pr. B. Duperrat ; en <strong>de</strong>rmatologie clinique<br />
avec les Prs L. Gougerot et R. Degos ; en allergie <strong>de</strong>rmatologique et en cytologie<br />
avec le Pr. Ezanc. Remarquons que le Pr. Duperrat lui <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> col<strong>la</strong>borer à <strong>la</strong> rédaction<br />
d’un livre, pour lequel le Dr Flores-Cevallos écrivit le chapitre « Leishmanioses<br />
et verrue péruvienne ».<br />
À son retour au Pérou en 1952, il décida d’appliquer les connaissances acquises en<br />
France à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos et au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique ouvrière du Cal<strong>la</strong>o. Pendant les dix années <strong>de</strong> travail comme<br />
chef instructeur <strong>de</strong> clinique et professeur auxiliaire dans ces institutions, il organisa les<br />
réunions cliniques mensuelles, les symposiums annuels à Lima et dans les provinces et<br />
il prépara le syl<strong>la</strong>bus d’enseignement pour les étu<strong>de</strong>s supérieures ; il travail<strong>la</strong> également<br />
sur <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> travaux et d’annonces sur les réunions cliniques, il instaura <strong>de</strong>s<br />
programmes d’échange culturel avec l’étranger et <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> groupes à <strong>de</strong>s<br />
congrès mondiaux, entre autres tâches, sans <strong>la</strong>isser pour autant <strong>de</strong> côté ses cours pratiques<br />
et théoriques du matin.<br />
À l’hôpital <strong>de</strong> l’employé, il se consacra à l’organisation du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; il<br />
créa plus tard le service d’allergie, établit les réunions cliniques inter-hospitalières et les<br />
échanges culturels avec l’étranger ; il prépara également les manuels d’organisation et<br />
<strong>de</strong> fonctions, normes et procédures du service.<br />
Il assuma par <strong>la</strong> suite <strong>de</strong>s responsabilités administratives d’une gran<strong>de</strong> importance<br />
au sein dudit hôpital ; il en occupa même <strong>la</strong> direction jusqu’en 1986, date <strong>de</strong> sa démission<br />
pour poursuivre son in<strong>la</strong>ssable travail dans d’autres domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Il organisa <strong>la</strong> I re Journée péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital régional <strong>de</strong> l’employé<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d’Arequipa, il entreprit <strong>la</strong> préparation du I er Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et du I er Cours international <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Réélu prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1971, sa première tâche<br />
fut l’inscription <strong>de</strong> <strong>la</strong> société dans le registre national d’institutions médicales du Collège<br />
médical du Pérou. Il mit à jour le statut et le règlement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société et ajouta aux
20 membres fondateurs 30 membres honorifiques étrangers, 145 titu<strong>la</strong>ires, 1 membre<br />
honorifique national, 10 correspondants étrangers, 10 membres associés et 16 membres<br />
adjoints.<br />
Parmi ses principales publications scientifiques, il faut distinguer sa contribution au livre<br />
<strong>de</strong> Duperrat déjà mentionnée, ainsi que les travaux suivants: Distribution <strong>de</strong> certaines <strong>de</strong>rmatoses<br />
selon les différentes zones climatiques du Pérou; Inci<strong>de</strong>nts généraux d’intolérance<br />
aux médicaments; Manifestations cutanées <strong>de</strong> l’avitaminose B; Normes générales <strong>de</strong> thérapeutique<br />
<strong>de</strong>rmatologique; Réticulose cutanée, mycose fongoï<strong>de</strong>, ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hodgkin, ma<strong>la</strong>die<br />
<strong>de</strong> Kaposi, mastocytoses; Concept actuel sur <strong>la</strong> syphilis (1968); Traitement du vitiligo<br />
avec Triso<strong>la</strong>ren; Pemphigus séborrhéique, son traitement avec Murranil; Le soin <strong>de</strong>s aliments<br />
dans <strong>la</strong> prévention <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies.<br />
Il publia également <strong>de</strong>s livres sur <strong>la</strong> tuberculose cutanée et sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
au Pérou. Il est membre honoraire <strong>de</strong> différentes sociétés <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> l’étranger.<br />
En 1971, le Collège médical du Pérou le nomma prési<strong>de</strong>nt du comité <strong>de</strong> qualification<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire.<br />
En 1979, il fut désigné délégué péruvien auprès du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, étant réélu en 1983. Il fonda en 1984 le Comité central péruvien du CILAD,<br />
dont il fut désigné prési<strong>de</strong>nt. Un an plus tard, il fut élu membre honoraire du CILAD, et<br />
prési<strong>de</strong>nt honoraire du CILAD-PÉROU en 1989.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> célébration <strong>de</strong>s 40 ans <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (Noces <strong>de</strong><br />
Rubis), il fut décoré <strong>de</strong> <strong>la</strong> médaille d’honneur en qualité d’ancien prési<strong>de</strong>nt.<br />
À l’occasion du 38 e anniversaire <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> l’employé (actuellement hôpital Edgardo<br />
Rebagliati Martins), il reçut <strong>la</strong> médaille d’honneur pour son travail remarquable<br />
pendant quarante ans. En 1996, le Collège médical du Pérou, au cours d’une cérémonie<br />
centrale, lui octroya une médaille <strong>de</strong> l’Ordre pour ses services remarquables dans le domaine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En 2003, au cours du XV e Congrès du CILAD à Buenos Aires, il<br />
reçut un prix pour sa col<strong>la</strong>boration dans le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou,<br />
en guise <strong>de</strong> reconnaisance <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés<br />
<strong>de</strong>rmatologiques (LISD).<br />
LES CONTINUATEURS<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Juan Manrique 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, diplômé à l’université du Chili (figure 15), il naquit à Ilo, dans<br />
le département <strong>de</strong> Moquegua, en 1914. Il poursuivit sa formation à l’hôpital San Vicente<br />
<strong>de</strong> Santiago du Chili, au sein du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Pr. Arturo Parodi, disciple du<br />
professeur allemand Jadassohn.<br />
En 1944, il rejoignit <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université du Chili. À son retour<br />
au Pérou en 1947, il commença son travail à l’hôpital ouvrier <strong>de</strong> Lima jusqu’en 1984, où<br />
il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et plus tard chef du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine spécialisée<br />
jusqu’à sa retraite. Il occupa aussi le poste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue consultant<br />
dans les hôpitaux militaire et <strong>de</strong> l’aéronautique.<br />
En 1960, il fut admis à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos, comme<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
En 1972, il fut prié d’ouvrir <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie au sein <strong>de</strong> l’université nationale<br />
Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>rreal, dont il fut professeur principal.<br />
En 1990, il fut nommé professeur émérite <strong>de</strong> l’université du Chili et, un an plus tard,<br />
il reçut le titre <strong>de</strong> docteur honoris causa.<br />
Tout au long <strong>de</strong> sa vie professionnelle, ce remarquable spécialiste accomplit un travail<br />
vaste et profitable dans le domaine <strong>de</strong> l’enseignement universitaire: il donna <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong><br />
formation et <strong>de</strong> doctorat, il proposa ses conseils pour <strong>de</strong>s thèses d’étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>de</strong><br />
spécialisation, il fut jury <strong>de</strong> ces thèses et intégra <strong>de</strong> nombreuses commissions académiques.<br />
329<br />
Figure 15.<br />
Dr Juan Manrique
Figura 16.<br />
Dr José Neyra<br />
Figure 17.<br />
Dr Aizic Cotlear<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
330<br />
Il publia <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche, dont <strong>de</strong>ux manuels <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie parmi les plus<br />
importants qui servent <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>s aux élèves <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures <strong>de</strong> l’université nationale<br />
Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>rreal.<br />
Il participa à maints congrès sur <strong>la</strong> spécialité, nationaux et internationaux, en tant<br />
qu’organisateur et conférencier.<br />
Il reçut plusieurs distinctions, telles les reconnaissances du Collège médical du Pérou,<br />
<strong>de</strong> l’ancien hôpital ouvrier (actuellement hôpital Guillermo Almenara), <strong>de</strong> l’hôpital militaire,<br />
<strong>de</strong> l’hôpital aéronautique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société chilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il est membre <strong>de</strong> plusieurs sociétés scientifiques au Pérou et à l’étranger et occupa le<br />
poste <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération<br />
bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
José Neyra 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin, docteur en mé<strong>de</strong>cine, spécialiste en mé<strong>de</strong>cine tropicale, léprologie et mé<strong>de</strong>cine<br />
sanitaire (figure 16), il naquit à Lima en 1920 et poursuivit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> doctorat<br />
en France. Il est l’auteur <strong>de</strong> plusieurs étu<strong>de</strong>s sur l’épidémiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou.<br />
Pendant trente-<strong>de</strong>ux ans, il travail<strong>la</strong> au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, où il atteignit le poste<br />
<strong>de</strong> vice-ministre en 1978.<br />
Il se consacra à l’enseignement pendant quarante ans au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> San Fernando, où il obtint le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> professeur principal dans <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies tropicales.<br />
Ce centre d’étu<strong>de</strong>s lui octroya à l’occasion <strong>de</strong> son départ <strong>la</strong> distinction <strong>de</strong> professeur<br />
émérite, en reconnaissance <strong>de</strong> son travail important et dévoué qui bénéficia aux nouvelles<br />
générations <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins.<br />
Il mena en France, entre 1951 et 1953, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> tuberculose, <strong>la</strong> lèpre et le<br />
BCG. Quelques années plus tard, il y retourna pour poursuivre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s sur <strong>la</strong> tuberculose<br />
et, en 1970, il voyagea en Italie dans le même but.<br />
Il reçut tout au long <strong>de</strong> sa carrière plusieurs distinctions, comme l’ordre Hipólito Unanue<br />
et l’ordre Daniel A. Carrión, au gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> grand officier.<br />
Il occupa à <strong>de</strong>ux occasions le poste <strong>de</strong> secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando;<br />
il fut également secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération médicale péruvienne et du conseil régional<br />
III du Collège médical du Pérou. Il fut nommé membre associé <strong>de</strong> l’Académie nationale<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1991 et membre titu<strong>la</strong>ire en 1994. Il est membre honoraire <strong>de</strong> l’Académie<br />
péruvienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’institution en décembre 1993. En 1994<br />
et 1995, il occupa le poste <strong>de</strong> doyen du Collège médical du Pérou; <strong>de</strong> 1995 à 1998, il représenta<br />
les collèges professionnels du Pérou auprès du Conseil national <strong>de</strong> <strong>la</strong> magistrature.<br />
Le Dr Neyra mena plusieurs travaux <strong>de</strong> recherche : Les corré<strong>la</strong>tions immunologiques<br />
entre <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> tuberculose. Application pratique; La vaccination BCG dans <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, qui constitua sa Thèse <strong>de</strong> bacca<strong>la</strong>uréat en mé<strong>de</strong>cine (1950), et<br />
d’autres travaux tels que Immunologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre ; La vaccination BCG dans <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> travail dans le Nord-Est ; Climat et tuberculose. Aspects historiques<br />
; L’antagonisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans <strong>la</strong> tuberculose. Considérations épidémiologiques<br />
au Pérou ; La tuberculose chez les sujets <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ans, La fièvre jaune au Pérou ; La<br />
peste au Pérou et La verrue péruvienne dans le département <strong>de</strong> Ancash. Son livre Imágenes<br />
históricas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina Peruana [Images historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne]<br />
(1999) est remarquable.<br />
Aizic Cotlear 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue et docteur en mé<strong>de</strong>cine, il naquit à Lima en 1927 (figure 17).<br />
Il effectua son internat en <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> New York University, Bellevue Medical<br />
Center, Skin and Cancer Unit, où il poursuivit ses étu<strong>de</strong>s jusqu’à 1955.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Son activité fut intense dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> léprologie entre 1957 et 1976 ; pendant<br />
ce temps, il travail<strong>la</strong> comme mé<strong>de</strong>cin-chef dans le service national anti-lépreux du ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique.<br />
Entre 1958 et 1970, il fut consultant à l’Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé professionnelle ; en même<br />
temps il accomplit une tâche importante d’assistance en <strong>de</strong>rmatologie, travail<strong>la</strong>nt<br />
comme mé<strong>de</strong>cin-chef du service académique d’assistance en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> San Marcos, au siège <strong>de</strong> l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo (1962-1983).<br />
Il fut nommé chef du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando<br />
en 1968, poste qu’il occupa jusqu’en 1969. Il fut nommé par <strong>la</strong> suite directeur du<br />
programme académique <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> l’UNMSM jusqu’à 1971.<br />
Parmi ses travaux <strong>de</strong> recherche les plus notables citons, dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> léprologie<br />
Préparation du sérum cytotoxique anti-réticu<strong>la</strong>ire et son application pour <strong>la</strong> lèpre, et<br />
en <strong>de</strong>rmatologie professionnelle Arsenic et <strong>de</strong>rmatoses professionnelles. Ses publications<br />
lui apportèrent <strong>de</strong>s distinctions spéciales: il fut nommé consultant sur <strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong>s instituts<br />
nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> New York Aca<strong>de</strong>my of Sciences.<br />
Il est membre <strong>de</strong> plusieurs institutions scientifiques importantes et <strong>de</strong> sociétés professionnelles<br />
au Pérou et à l’étranger, comme par exemple l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology<br />
; il est aussi membre actif <strong>de</strong> <strong>la</strong> New York Aca<strong>de</strong>my of Sciences.<br />
Depuis 1970, il assiste annuellement aux réunions <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology,<br />
dont il est membre à vie.<br />
Zuño Burstein 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin, docteur en mé<strong>de</strong>cine, spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et mé<strong>de</strong>cine tropicale,<br />
ayant fait <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> doctorat en Allemagne et en Israël, il naquit à Chic<strong>la</strong>yo, département<br />
<strong>de</strong> Lambayeque, en 1930. Il obtint le diplôme <strong>de</strong> bachelier en mé<strong>de</strong>cine à <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM et celui <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien (1957) (figure 18).<br />
Entre 1958 et 1960, il fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie et en mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale à l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> Hambourg, en Allemagne, et à<br />
<strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique universitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ville. Il poursuivit ultérieurement<br />
sa spécialisation à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université hébraïque <strong>de</strong> Jérusalem<br />
grâce à une bourse octroyée par le gouvernement allemand, qui avait conclu une<br />
convention avec le gouvernement péruvien afin <strong>de</strong> créer au Pérou un institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale.<br />
En 1962, <strong>de</strong> retour à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Marcos comme chef instructeur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses tropicales et parasitaires, il obtint le poste <strong>de</strong> professeur<br />
auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie. Il fut chargé du déménagement,<br />
<strong>de</strong> l’organisation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> coordination <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire, installée à l’hôpital Dos<br />
<strong>de</strong> Mayo. Plus tard il fut nommé professeur principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong><br />
celle <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale. Il occupa le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> cabinets externes et unités périphériques<br />
et il fut chargé <strong>de</strong>s programmes spéciaux <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
Daniel A. Carrión <strong>de</strong> l’UNMSM qui existait déjà, où il fut directeur intérimaire et plus tard<br />
chef du service <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire en accord avec le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santé.<br />
Quant à son activité administrativo-académique, il fut membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission réorganisatrice<br />
et ensuite directeur universitaire <strong>de</strong>s services académiques et registre central,<br />
plus tard directeur universitaire <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> l’UNMSM. Il fut nommé<br />
professeur émérite <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université en 1976 ; <strong>de</strong> nos jours il poursuit l’enseignement<br />
en doctorat.<br />
Il occupa le poste <strong>de</strong> chef du département <strong>de</strong> lèpre et <strong>de</strong> mycologie médicale et du département<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire <strong>de</strong>s instituts nationaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
Depuis 2001, il est membre honorifique <strong>de</strong> l’académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine; il fait partie<br />
d’importantes institutions scientifiques internationales: le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain<br />
331<br />
Figure 18.<br />
Dr Zuño Burstein
Figure 19.<br />
Dr Dante Mendoza<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
332<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD), dont il fut délégué national pour le Pérou, l’American Aca<strong>de</strong>my<br />
of Dermatology, <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, l’Académie européenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et vénéréologie, l’union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles (ULACETS en espagnol), entre autres. Il est membre honoraire international<br />
<strong>de</strong>s Sociétés argentines <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> léprologie.<br />
Il appartient également à <strong>de</strong>s institutions scientifiques nationales : le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD-PÉROU, actuellement CIDERM-PÉROU), dont il<br />
fut fondateur et prési<strong>de</strong>nt, l’Union péruvienne contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
(UPCETS en espagnol), qu’il prési<strong>de</strong> actuellement, <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong> Société d’immunopathologie et d’allergie, et d’autres.<br />
Il fut premier secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération médicale péruvienne en 1966 ; trois ans plus<br />
tard, il fut nommé membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission qui rédigea les statuts et le règlement du<br />
Collège médical du Pérou, présentant les programmes académiques <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Il est directeur-fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue Folia Dermatológica.<br />
Ses travaux <strong>de</strong> recherche comprennent F<strong>la</strong>gellés dans le <strong>la</strong>tex <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jatropha macranta<br />
(huanarpo femelle) ; communication préliminaire; Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
verrue péruvienne et <strong>de</strong> <strong>la</strong> uta. Recherches dans le Cnidosculos basiacantha et Jatropha<br />
macrantha (huanarpos) comme réservoir possible (thèse <strong>de</strong> bachelier en mé<strong>de</strong>cine, université<br />
<strong>de</strong> San Marcos) ; Contribution à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mycoses profon<strong>de</strong>s au Pérou. À propos<br />
<strong>de</strong> trois cas <strong>de</strong> sporotrichose ; Étu<strong>de</strong> actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose<br />
tégumentaire au Pérou ; Gale norvégienne au Pérou ; Notre expérience clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniose tégumentaire au Pérou. Tentative <strong>de</strong> regrouper les formes cliniques suivant<br />
un critère clinique épidémiologique; Nouvelles contributions à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> sporotrichose<br />
au Pérou. Formes cliniques peu fréquentes; Candidose granulomateuse; Anatomie<br />
pathologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> b<strong>la</strong>stomycose sud-<strong>américaine</strong> au Pérou (aspects<br />
histopathologiques); Une forme clinique peu habituelle d’actinomycose ; À propos d’un<br />
cas <strong>de</strong> mycétome maduro-mycotique par Madurel<strong>la</strong> mycetomi.<br />
D’autres travaux ont été publiés dans <strong>de</strong>s revues scientifiques : Dermatose cendrée<br />
(érythème discromique pertans) au Pérou: à propos d’un cas étudié, Contribution au diagnostic<br />
<strong>de</strong>s mycoses humaines au Pérou (notre contribution après huit ans <strong>de</strong> travail)<br />
(thèse <strong>de</strong> doctorat), B<strong>la</strong>stomycose sud-<strong>américaine</strong> au Pérou, Sporotrichose et mycétomes<br />
au Pérou, Contribution à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong>s mycoses superficielles au Pérou, La lèpre<br />
indifférenciée au Pérou, Faillite du programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou à cause<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> décentralisation et <strong>de</strong> l’incorporation aux programmes généraux <strong>de</strong> santé, Flore<br />
mycotique génitale chez les femmes enceintes <strong>de</strong> notre milieu (Pérou), État actuel du<br />
contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes au Pérou, Verrue du Pérou (Encyclopédie médico-chirurgicale,<br />
Paris), Le besoin d’évaluer les cosmétiques, Traitement du psoriasis sévère<br />
avec ciclosporine A entre autres.<br />
Il fut déc<strong>la</strong>ré prési<strong>de</strong>nt honoraire <strong>de</strong> <strong>la</strong> XXIII e Réunion annuelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
ibéro-<strong>la</strong>tino-américains du Cône Sud (RADLA), qui eut lieu du 1 er au 4 mai 2004 à Lima.<br />
Il reçut les distinctions du Collège médical du Pérou pour ses apports à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne<br />
et son grand prestige professionnel, ainsi que <strong>la</strong> médaille d’honneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> part<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme membre fondateur et ancien prési<strong>de</strong>nt<br />
(en septembre 2004).<br />
Dante Mendoza 15<br />
Dermatologue et <strong>de</strong>rmo-pathologiste, il naquit dans le département <strong>de</strong> Junín,<br />
au Pérou, en 1934 (figure 19). Il fit son doctorat au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie avec le Pr.<br />
Robert Degos et ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie avec le Pr. Jean Civatte, à l’hôpital<br />
Saint-Louis <strong>de</strong> Paris. Le 20 septembre 1974, il obtint le diplôme <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie<br />
à <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos. Il y entama sa carrière d’enseignement<br />
: il fut nommé par concours responsable <strong>de</strong>s stages en juillet 1962 ; il obtint
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
le plus haut titre <strong>de</strong> professeur principal en janvier 1981. En 1993, il fut désigné chef du<br />
cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM.<br />
Ses travaux, très importants, comprennent: Donovanose à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo,<br />
Sarcome <strong>de</strong> Kaposi, <strong>de</strong> 1991 à 1993 à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo et Nécrobiose lipoïdique à<br />
l’hôpital national Dos <strong>de</strong> Mayo, années 1992-1993.<br />
Il fut membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et appartient au<br />
Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il prési<strong>de</strong> actuellement (2005) le comité <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong><br />
doctorat <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Wences<strong>la</strong>o Castillo 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né à Lima en 1929 (figure 20), il obtint le diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin<br />
chirurgien à l’UNMSM en 1956. En 1961, il <strong>de</strong>vint professeur à l’université <strong>de</strong> San<br />
Marcos, où il est actuellement professeur principal <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> San Fernando ; il est aussi chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du complexe hospitalier<br />
Daniel A. Carrión-Cal<strong>la</strong>o.<br />
Tout au long <strong>de</strong> sa carrière professionnelle il se distingua dans <strong>la</strong> recherche ; son travail<br />
Candidose muco-cutanée chronique, étu<strong>de</strong> immunologique et traitement spécifique<br />
avec facteur <strong>de</strong> transfert, réalisé conjointement avec le Dr Raúl Patruco, lui valut le<br />
<strong>de</strong>uxième prix du prestigieux institut Hipólito Unanue en 1979, ainsi qu’une mention honorable<br />
au prix Roussell.<br />
En 1982, le travail Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s paramètres immunologiques en ma<strong>la</strong>dies infectieuses et<br />
tropicales constituant <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> santé au Pérou, également réalisé par les <strong>de</strong>ux<br />
spécialistes, obtint une mention honorable au prix Hipólito Unanue. La découverte <strong>de</strong>s<br />
premiers cas <strong>de</strong> sida au Pérou, qu’il effectua aussi avec le Dr Patruco, fut un autre événement<br />
marquant dans <strong>la</strong> carrière <strong>de</strong> recherche du Dr Castillo. Il consacra également ses<br />
recherches à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Lyme, dont il communiqua les premiers cas.<br />
Ses travaux scientifiques publiés sont, entre autres, Dermatite atopique, Génétique et<br />
<strong>de</strong>rmatologie, Dermatite <strong>de</strong> contact, L’enfance et le sida, C<strong>la</strong>ssification <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles, Herpès I et herpès II, Immunologie du sida et L’éosinophile.<br />
Il est membre <strong>de</strong> plusieurs sociétés médicales : <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(SPD), <strong>la</strong> Société péruvienne d’immunologie et d’allergie, <strong>la</strong> Société équatorienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
<strong>la</strong> Société paraguayenne d’allergie, <strong>la</strong> Société bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
<strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> d’allergologues, <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> génétique médicale,<br />
l’Union péruvienne et l’Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles.<br />
Le Dr Castillo fut nommé plusieurs fois prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne d’immunologie<br />
et d’allergie.<br />
Oscar Romero 16<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né à Lima en 1929, il obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1961<br />
à l’université nationale Mayor <strong>de</strong> San Marcos ainsi que celui <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie<br />
en 1977. Il se spécialisa à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Sao Paulo<br />
entre 1961 et 1962 en microbiologie et en mé<strong>de</strong>cine tropicale ; il fit ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> doctorat<br />
en <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> même université (1963 à 1965).<br />
Il fut admis à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos<br />
en 1955 comme assistant <strong>de</strong>s cours pratiques au <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>s cliniques. Sa carrière<br />
d’enseignement débuta à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses, tropicales et<br />
parasitaires, avec le Pr. Hugo Pesce ; il enseigna plus tard à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
avec le Pr. Aizic Cotlear ; il accéda au poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
(1977) et <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos (1980 à 1993), occupant<br />
le poste <strong>de</strong> professeur principal <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux chaires, au terme <strong>de</strong> quarante-quatre ans<br />
333<br />
Figure 20.<br />
Dr Wences<strong>la</strong>o<br />
Castillo
Figure 21.<br />
Dr Elda Cana<strong>de</strong>ll<br />
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
334<br />
d’enseignement. Il fut chef du service académique d’assistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chef<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> section d’éducation médicale continue <strong>de</strong> <strong>la</strong>dite université. Il fut également professeur<br />
principal et responsable <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> doctorat <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Il fut admis par concours au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique en 1966 pour occuper le<br />
poste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin vénéréologue au centre <strong>de</strong> santé d’Ate Vitarte ; en 1968, il obtint aussi<br />
par concours le poste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital national Dos <strong>de</strong> Mayo, où il<br />
fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (1995-1999), concluant trente-sept ans <strong>de</strong> service<br />
dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique (ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé). Il exposa ses connaissances<br />
lors <strong>de</strong> plusieurs examens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale organisés par les<br />
sociétés médicales, ainsi qu’à <strong>de</strong>s congrès nationaux et internationaux.<br />
Voici les titres <strong>de</strong> ses remarquables travaux publiés: Ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Jorge Lobo, premier<br />
cas diagnostiqué au Pérou ; Leishmaniose cutanée, formes sporotricoï<strong>de</strong>s ; Ma<strong>la</strong>dies vénériennes,<br />
syphilis ; B<strong>la</strong>stomycose sud-<strong>américaine</strong> du Pérou ; Donovanose à l’hôpital Dos<br />
<strong>de</strong> Mayo ; Nécrobiose lipoïdique à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo ; Sarcome <strong>de</strong> Kaposi <strong>de</strong>puis 1991<br />
jusqu’en 1993 à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, ainsi que plusieurs manuels <strong>de</strong> cours théoriques<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Il reçut diverses distinctions, parmi lesquelles <strong>la</strong> médaille pour ses vingt-cinq ans <strong>de</strong><br />
service à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, <strong>la</strong> médaille pour ses quarante ans dans l’enseignement<br />
médical à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, une<br />
distinction honorifique et une médaille du mérite pour sa remarquable tâche scientifique<br />
et professionnelle octroyée par le Collège médical du Pérou en octobre 1999. Il fait partie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui lui accorda en 2004 le titre honorifique<br />
<strong>de</strong> maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie nationale. Il est également membre du Collège ibéro-<strong>la</strong>tinoaméricain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD).<br />
Elda Cana<strong>de</strong>ll 15<br />
Née à Buenos Aires en 1934, elle obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1958 à <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Buenos Aires (figure 21). Elle poursuivit sa formation <strong>de</strong>rmatologique<br />
à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> l’hôpital Ramos Mejía avec le Dr Marcial Quiroga. Après son<br />
mariage, elle obtint <strong>la</strong> nationalité péruvienne et confirma son diplôme professionnel <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cin chirurgien à l’université <strong>de</strong> San Marcos ; elle reçut ultérieurement le diplôme <strong>de</strong><br />
spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong>venant un <strong>de</strong>s premiers mé<strong>de</strong>cins et représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie cosmétologique au Pérou.<br />
Grâce aux certificats expédiés par le Pr. Quiroga, elle fut acceptée à <strong>la</strong> chaire du<br />
Pr. Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et y travail<strong>la</strong> comme chef <strong>de</strong>s cours pratiques, en étant <strong>la</strong> première<br />
femme <strong>de</strong>rmatologue à enseigner.<br />
En 1962, elle fut admise dans le groupe <strong>de</strong> professeurs fondateurs <strong>de</strong> l’université péruvienne<br />
Cayetano Heredia, où elle enseigna à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
En 1972, elle fut invitée à faire partie du groupe <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San<br />
Marcos comme professeur auxiliaire; plus tard, elle <strong>de</strong>vint professeur associé à <strong>la</strong> chaire<br />
du Pr. Aizic Cotlear.<br />
Le Dr Cana<strong>de</strong>ll, dotée d’une gran<strong>de</strong> vocation pour l’enseignement, est tutrice <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts<br />
<strong>de</strong> pédiatrie pour <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie au département <strong>de</strong> pédiatrie <strong>de</strong><br />
l’aire hospitalière nº 6 <strong>de</strong> Cal<strong>la</strong>o et à l’hôpital <strong>de</strong> l’enfant, pour l’université <strong>de</strong> San Marcos<br />
et l’université Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>rreal.<br />
Elle participa à maints cours et congrès nationaux et internationaux : ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Lima et au siège à Arequipa, <strong>de</strong> l’Association médicale<br />
féminine du Pérou et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> pathologistes, ainsi qu’aux<br />
concours médicaux <strong>de</strong> l’Alliance pan<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins femmes, <strong>de</strong> l’Association<br />
péruvienne <strong>de</strong> chimie cosmétique, au I er Congrès médical argentin et à plusieurs symposiums<br />
et séminaires du CILAD-PÉROU.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Elle est membre actif du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) <strong>de</strong>puis<br />
1963. Elle fut également l’une <strong>de</strong>s fondatrices <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Elle est l’auteur <strong>de</strong> plusieurs articles parus dans <strong>la</strong> presse spécialisée et <strong>de</strong> certains<br />
chapitres du livre Actualizaciones en Terapéutica [Actualisations en thérapeutique] et du<br />
Manual <strong>de</strong> Dermatología [Manuel <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie], tous <strong>de</strong>ux publiés par l’université <strong>de</strong><br />
San Marcos.<br />
Alejandro Morales 17<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né à Trujillo (Pérou) en 1933, il obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin<br />
chirurgien à l’université <strong>de</strong> San Marcos en 1959. Il fit ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> doctorat spécialisé<br />
à l’hôpital Henry Ford (Detroit) ; il fit l’internat et le résidanat en mé<strong>de</strong>cine interne<br />
entre 1959 et 1961, ainsi qu’un résidanat en <strong>de</strong>rmatologie au même hôpital entre 1961<br />
et 1964. Il fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie avec le Dr G. Pinkus (Michigan) (1964 à<br />
1965).<br />
Le Dr Morales est membre émérite <strong>de</strong> l’Académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dès<br />
1965 et <strong>de</strong> l’Académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie <strong>de</strong>puis 1976 ; il fut admis à<br />
l’American Board <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et à l’American Board <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie.<br />
Il fut admis à l’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Cotlear <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’UNMSM comme professeur associé <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entre 1965 et 1971; il fut également<br />
membre du comité <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> cette université en 1974. Il fut aussi<br />
professeur associé <strong>de</strong> clinique à l’université <strong>de</strong> Michigan (1978, 1980, 1982 et 1984).<br />
Il fut associé, pour son travail à l’assistance sociale, au département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Henry Ford (Detroit) <strong>de</strong> 1975 à 1980 et vice-prési<strong>de</strong>nt du même département<br />
entre 1981 et 1984.<br />
Il fut secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Michigan Dermatology Society <strong>de</strong> 1978 à 1981 et son prési<strong>de</strong>nt<br />
entre 1981 et 1983.<br />
Il appartint au département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique anglo-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> Lima<br />
(1965-1974) ; il dirige l’institut <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong>puis 1984.<br />
Il est l’auteur <strong>de</strong> quinze publications dans <strong>de</strong>s revues médicales nationales et étrangères,<br />
par exemple JAMA, Archives of Dermatology, Journal of the American Aca<strong>de</strong>my<br />
of Dermatology et autres, sur <strong>de</strong>s sujets tels que Ototoxicité <strong>de</strong> <strong>la</strong> Kanamycine ; Xanthomatose<br />
hypercholestérolémique essentielle et familiale ; Calcifications sous-cutanées<br />
dans les cas d’ulcères <strong>de</strong>s jambes ; Épithéliome <strong>de</strong> Jadassohn ; Kérato-acanthomes multiples<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conjonctive ; Pemphigus bénin familial chronique ; Dysp<strong>la</strong>sie ecto<strong>de</strong>rmique<br />
anhidrotique héréditaire ; Syndrome <strong>de</strong> Reiter avec kérato<strong>de</strong>rmie ; Principes<br />
<strong>de</strong> photobiologie et <strong>de</strong> photosensibilité ; Minocycline et pigmentation cutanée généralisée<br />
; Syndrome <strong>de</strong> Torres : rapport <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cas, entre autres. Il col<strong>la</strong>bora à <strong>la</strong> publication<br />
<strong>de</strong> livres en rédigeant quelques chapitres, comme « Traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> gale » et autres<br />
pour Current Therapy, <strong>de</strong> Conn.<br />
Il donna plusieurs conférences sur <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>de</strong>s institutions<br />
nationales et étrangères.<br />
Il est membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong> l’American Medical Association, <strong>de</strong> l’American Venereal Disease<br />
Association, <strong>de</strong> l’International Society of Tropical Dermatology et <strong>de</strong> l’International<br />
Society of Pediatric Dermatology, entre autres.<br />
Pedro Navarro 18<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, docteur en mé<strong>de</strong>cine, il naquit dans <strong>la</strong> province constitutionnelle<br />
du Cal<strong>la</strong>o en 1931. Après <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando, où il obtint le<br />
diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien en 1958, il fut admis à <strong>la</strong> santé militaire où il travail<strong>la</strong><br />
initialement ; il fut assigné plus tard au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital central <strong>de</strong><br />
l’employé.<br />
335
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
336<br />
Au cours <strong>de</strong>s années qui suivirent (jusqu’en 1963), il fit <strong>de</strong>s formations à l’étranger<br />
pendant <strong>de</strong> courtes pério<strong>de</strong>s : en 1964, il obtint un poste à <strong>la</strong> chaire du Pr. Luis Pierini à<br />
Buenos Aires, et il se forma également en <strong>de</strong>rmato-pathologie avec le Pr. Jorge Abu<strong>la</strong>fia ;<br />
en août et septembre 1967, il intégra le service du Pr. Duperrat à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong><br />
Paris.<br />
Il obtint le diplôme <strong>de</strong> spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie en 1976 à l’UNMSM, ainsi que le<br />
gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> docteur en mé<strong>de</strong>cine en 1978.<br />
Il débuta dans l’enseignement universitaire en 1977 comme professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
activité qu’il exerce toujours en qualité <strong>de</strong> professeur principal et membre du comité<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong> l’UNMSM <strong>de</strong>puis<br />
plusieurs lustres. Il enseigne aussi <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’université Ricardo Palma <strong>de</strong>puis<br />
2001.<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> l’assistance sociale, il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Edgardo Rebagliati (auparavant hôpital central <strong>de</strong> l’employé) jusqu’en 2001.<br />
Grâce à ses étu<strong>de</strong>s multiples et à sa gran<strong>de</strong> formation académique et professionnelle,<br />
il participa à maints congrès et concours <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dès 1963 ; il est l’auteur <strong>de</strong> nombreuses<br />
publications.<br />
Il est membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et appartient à<br />
l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology, au Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
au Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou, à l’International Society of Tropical Dermatology,<br />
à <strong>la</strong> Fédération bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, à l’institut <strong>de</strong> recherches<br />
léprologiques d’Argentine, à <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> pathologie orale et à <strong>la</strong> New York Aca<strong>de</strong>my of<br />
Sciences.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> création du Collège médical du Pérou — en 1970 —, il participa activement<br />
à l’inscription définitive <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans le registre national<br />
<strong>de</strong>s institutions médicales scientifiques.<br />
José San Martín 19<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né à Bel<strong>la</strong>vista (Cal<strong>la</strong>o) en 1931, il eut son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin<br />
à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM en 1958, et celui <strong>de</strong> spécialiste en 1974 à<br />
<strong>la</strong> même université. Il suivit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation au département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’US Naval Hospital Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphia, en Pennsylvanie. En 1964, il débuta dans<br />
l’enseignement universitaire à l’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Cotlear située à l’hôpital<br />
Dos <strong>de</strong> Mayo, et continua d’enseigner jusqu’en 1979. À partir <strong>de</strong> 1974, il fit partie du<br />
comité <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando. Ce<br />
comité était chargé, au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation, <strong>de</strong> qualifier les mé<strong>de</strong>cins accréditant <strong>la</strong> formation<br />
exigée pour aspirer à ce diplôme professionnel (octroyé pour <strong>la</strong> première fois<br />
dans le pays) <strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie. Il fut professeur invité du programme <strong>de</strong><br />
résidanat <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UNMSM jusqu’en 1980 ainsi qu’à l’université péruvienne<br />
Cayetano Heredia pour donner <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> 1991 jusqu’à nos<br />
jours.<br />
Des revues nationales publièrent ses articles sur divers sujets <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité: Notre<br />
expérience en histopathologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire au Pérou, présenté au<br />
cours du I er Congrès <strong>de</strong> microbiologie et parasitologie du Pérou (1964), avec le Dr Burstein<br />
et publié dans les annales dudit congrès.<br />
Il déploya ses qualités <strong>de</strong> conférencier en participant <strong>de</strong> manière permanente à <strong>de</strong>s<br />
cours, <strong>de</strong>s expositions, <strong>de</strong>s tables ron<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s conférences sponsorisés par les différentes<br />
institutions médico-scientifiques du pays.<br />
Il est membre fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont il fut secrétaire<br />
d’action scientifique, secrétaire général, vice-prési<strong>de</strong>nt et prési<strong>de</strong>nt intérimaire. Il<br />
est également membre honoraire <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sud-péruvienne et<br />
membre <strong>de</strong> l’American Aca<strong>de</strong>my of Dermatology.
Hugo Monroy 15<br />
Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né en 1941 dans <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Pisco, département d’Ica (figure<br />
22), à l’âge <strong>de</strong> 15 ans il se rendit à Córdoba, en Argentine, et y obtint en 1965 son<br />
diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien. Les Prs Luis Argüello, Enrique Tello et José María<br />
Fernán<strong>de</strong>z, un fameux léprologue, lui apportèrent ses premières notions <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Suite à un concours, il fut admis très tôt à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Córdoba.<br />
Il dispense actuellement <strong>de</strong>s cours au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme professeur titu<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale <strong>de</strong> San Marcos, pour les élèves<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures aussi bien que pour ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation. Il col<strong>la</strong>bore également<br />
à <strong>la</strong> spécialisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université nationale Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>rreal,<br />
où il est tuteur <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
L’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Aizic Cotlear à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo<br />
Luis Flores-Cevallos et Zuño Burstein<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
L’école <strong>de</strong>rmatologique du Pr. Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando, dont le siège se trouvait à l’hôpital Arzobispo Loayza, fonctionna entre 1933<br />
(date <strong>de</strong> sa création) et 1960, année au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle tous les membres démissionnèrent<br />
<strong>de</strong> leur université d’origine. Un an plus tard, le Dr Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> instaura <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> toute nouvelle université péruvienne Cayetano Heredia,<br />
accompagné <strong>de</strong> ses anciens enseignants. Quelque temps après, il prit sa retraite, <strong>la</strong>issant<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire au Dr Marcial Ayaipoma, qui présenta sa démission en 1970 à<br />
l’université, ainsi que tout le groupe d’enseignants (sauf le Dr Víctor Gonzáles Pinillos,<br />
qui <strong>de</strong>meure chef <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital Loayza).<br />
À l’hôpital du Rimac, siège <strong>de</strong> l’université Cayetano Heredia, le Dr Guillermo Arana<br />
assuma <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong> chef du service hospitalier et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire; c’est ainsi que l’école<br />
<strong>de</strong>rmatologique du Pr. Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> fut définitivement dissoute.<br />
Entre-temps, à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, siège à l’époque <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> <strong>la</strong> UNMSM, sa chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
fut remp<strong>la</strong>cée et reconstituée (en 1961 suivant une disposition <strong>de</strong> l’autorité universitaire),<br />
le Dr Zuño Burstein, professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale <strong>de</strong> l’université, étant chargé <strong>de</strong> sa coordination et <strong>de</strong> son application. Le Dr<br />
Aizic Cotlear assuma en 1962 le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> cette chaire, respectant sa condition <strong>de</strong><br />
professeur associé après concours.<br />
Nous transcrivons ci-<strong>de</strong>ssous une partie du rapport que le Pr. Cotlear présenta à l’autorité<br />
universitaire en tant que coordinateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et chef intérimaire<br />
du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine <strong>de</strong> l’UNMSM (8 octobre 1969) 20 :<br />
Lorsque les professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM présentèrent leur démission<br />
massive en 1961, <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était basée à l’hôpital Loayza.<br />
C’est à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> cette crise qu’il fallut transporter les biens <strong>de</strong> l’université vers un<br />
siège provisoire qui fut aménagé dans plusieurs petites pièces <strong>de</strong> <strong>la</strong> salle San Lázaro<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo. […] Pendant six ans les activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire se développèrent<br />
dans ces endroits inappropriés et étroits, jusqu’à ce que les autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
assignent <strong>de</strong> nouvelles pièces. […] En nous procurant un milieu adéquat, nous<br />
réussîmes à les modifier selon les besoins propres à <strong>la</strong> spécialité avec <strong>de</strong>s salles, <strong>de</strong>s<br />
cabinets et <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires auxiliaires. […] Actuellement, <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
possè<strong>de</strong> une aile où sont aménagés quatre bureaux pour l’enseignement, un cabinet<br />
<strong>de</strong> photographie, un <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> recherche en mycologie et<br />
337<br />
Figure 22.<br />
Dr Hugo Monroy
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
338<br />
parasitologie à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong>rmatologiques et un <strong>la</strong>boratoire d’histopathologie. Elle possè<strong>de</strong><br />
aussi une bibliothèque, un fichier <strong>de</strong> cas, un local pour les séminaires et les projections<br />
avec un chef et un secrétaire pour <strong>la</strong> section. […] L’aile clinique accueille<br />
pendant toute l’année six enseignants qui travaillent sur <strong>la</strong> consultation spécialisée,<br />
constituant les cas qui serviront pour l’enseignement et <strong>la</strong> recherche, tandis que le<br />
<strong>la</strong>boratoire a un chef qui enseigne au département. [...] Le fichier <strong>de</strong> dossiers cliniques,<br />
<strong>de</strong> photographies (couleur et noir et b<strong>la</strong>nc), d’histopathologie et <strong>de</strong> mycologie<br />
abrite <strong>de</strong>s centaines <strong>de</strong> cas, faisant <strong>de</strong> notre centre un établissement scientifique.<br />
Le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie <strong>de</strong>rmatologique qui fournit <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong><br />
haute qualité est le seul centre spécialisé <strong>de</strong> ce genre dans le pays. […] Le service <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie sert aussi <strong>de</strong> centre d’apprentissage, non seulement pour le personnel<br />
<strong>de</strong> notre université mais aussi pour <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong>s autres universités nationales<br />
qui le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt, grâce à <strong>de</strong>s conventions spéciales. […] Le personnel permanent du<br />
service est le suivant : Dr Aizic Cotlear, chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong>rmatologie ; Dr Zuño Burstein,<br />
chef <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> recherches ; Drs Oscar Romero et Abe<strong>la</strong>rdo<br />
Tejada, professeurs auxiliaires ; Drs Dante Mendoza, Julio Bonil<strong>la</strong> et Juan<br />
Meza, chefs instructeurs.<br />
Ce groupe, qui travaille en permanence sur <strong>de</strong>s fonctions spécifiques, constitua le service<br />
académique d’assistance en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UNMSM, base <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong><br />
l’assistance <strong>de</strong>rmatologique ; s’y ajoutèrent <strong>de</strong> manière transitoire ou plus prolongée <strong>de</strong>s<br />
professionnels qualifiés engagés avec l’enseignement, l’assistance et <strong>la</strong> recherche tels<br />
que les Pr. José San Martín, Alejandro Morales, Wences<strong>la</strong>o Castillo, Pedro Navarro, Juan<br />
Manrique, Elda Cana<strong>de</strong>ll et Raúl Gal<strong>la</strong>rday. Il faut reconnaître le travail d’enseignement<br />
et d’assistance digne d’éloges du Dr Humberto Ugaz, mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue, né à Chic<strong>la</strong>ya<br />
en 1929 et disparu prématurément en 1979, qui se distingua comme l’un <strong>de</strong>s promoteurs<br />
<strong>de</strong> ce groupe <strong>de</strong>rmatologique les plus dynamiques grâce à son ingéniosité et à<br />
sa gran<strong>de</strong> capacité ; remarquons également <strong>la</strong> contribution <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins chirurgiens tels<br />
que les Drs Rafael Rabinovich et Elbio Flores, dont le soutien à l’enseignement et à l’assistance<br />
fut important. Notons aussi <strong>la</strong> contribution temporaire <strong>de</strong>s Drs Aníbal Manrique,<br />
César Rojas (<strong>de</strong>rmatologue et pédiatre), Enrique Sifuentes (vénéréologue), David Carrizales,<br />
ainsi que l’i<strong>de</strong>ntification et <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration dans l’enseignement et l’assistance du<br />
Dr Tarci<strong>la</strong> Rey Sánchez, qui intégra longtemps cette école <strong>de</strong>rmatologique.<br />
L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie (au niveau <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et surtout <strong>de</strong><br />
l’entraînement <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts) compta dès le début <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s services hautement<br />
spécialisés <strong>de</strong>s centres hospitaliers les plus importants.<br />
Finalement, il faut remarquer que l’important travail pédagogique, dont <strong>la</strong> responsabilité<br />
quasi absolue fut assumée à un moment donné par l’école <strong>de</strong>rmatologique universitaire<br />
mo<strong>de</strong>rne, basée à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, se décentralisa progressivement, <strong>la</strong>issant<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à un grand travail complémentaire <strong>de</strong> formation développé par les sociétés médico-scientifiques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, représentées par le Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou<br />
(CIDERM-PÉROU) et par <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et jouant un rôle très significatif<br />
dans <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>rmatologique du pays.<br />
Un important noyau <strong>de</strong> développement didactique, <strong>de</strong> formation et <strong>de</strong> recherche surgit<br />
<strong>de</strong> nos jours à l’université péruvienne Cayetano Heredia, à <strong>la</strong> tête duquel se trouvent<br />
<strong>de</strong>ux jeunes valeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne : les Drs Francisco Bravo et Manuel<br />
<strong>de</strong>l So<strong>la</strong>r.
■ Références<br />
bibliographiques<br />
I et II<br />
1. Shady Solís R. Supe, <strong>la</strong><br />
civilización más antigua <strong>de</strong><br />
América. Lima: INC; 2004.<br />
2. Prescott W.H. Conquista <strong>de</strong>l Perú<br />
I y II. New York: The Publishers<br />
P<strong>la</strong>te Renting Company; 1858.<br />
3. Lastres J.B. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina Peruana. Tomos I, II,<br />
III. Lima: Imprenta Santa<br />
María; 1951.<br />
4. Lorenzi R., Rothchild B., Mays S.<br />
« Syphilis-History. » Discovery<br />
Channel. 12 abr; 2004.<br />
Disponible sur:<br />
http://dsc.Discovery.com.<br />
5. García U.C. « Historiografía <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
enfermedad <strong>de</strong> Carrión. I<strong>de</strong>as e<br />
imágenes <strong>de</strong> <strong>la</strong> enfermedad <strong>de</strong><br />
Carrión. » Folia Dermatol. Peru.<br />
1998; 9(4): 45–56.<br />
6. Garci<strong>la</strong>so <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega. Historia<br />
Tercera parte<br />
general <strong>de</strong>l Perú. Primera Parte.<br />
Lima: Librería Internacional <strong>de</strong>l<br />
Perú; 1959.<br />
7. Roel V. Historia social y<br />
económica <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonia. Lima:<br />
Labor; 1970.<br />
8. Estatutos <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Peruana <strong>de</strong> Dermatología<br />
aprobados en <strong>la</strong> Asamblea<br />
Extraordinaria <strong>de</strong>l 15 <strong>de</strong> mayo<br />
<strong>de</strong> 1964 [información <strong>de</strong>l<br />
archivo <strong>de</strong>l Dr. Zuño Burstein].<br />
9. Valdivia L. « Evaluación <strong>de</strong>l<br />
Estatuto <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Peruana <strong>de</strong> Dermatología. »<br />
Dermatología Peruana. 1999;<br />
9(1): 67–68.<br />
10. Nota Editorial. Folia Dermatol.<br />
Peru. 1988; 1(1): 1.<br />
11. Nota Editorial. Folia Dermatol.<br />
Peru. 1994; 5(3): 1.<br />
12. Comunicado. Folia Dermatol.<br />
Peru. 1999; 10(2-3): 8.<br />
13. Paz Soldán C.E. Decanos,<br />
maestros y médicos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong> Lima.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> formalisation légale <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité au Pérou<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Lima: Biblioteca <strong>de</strong> Cultura<br />
Sanitaria. Inst. <strong>de</strong> Medicina<br />
Social; 1957: 269-273.<br />
14. Flores L. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en el Perú. Lima:<br />
Concytec; 1999.<br />
15. Burstein Z. « Maxime<br />
Kuczynski-Godard, un pionero<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Salud Pública. » Revista<br />
Peruana <strong>de</strong> Medicina<br />
Experimental y Salud Pública.<br />
2003; 20(4): 231.<br />
16. Romero O. [Communication<br />
personnelle].<br />
17. Morales A. [Communication<br />
personnelle].<br />
18. Navarro P. [Communication<br />
personnelle].<br />
19. San Martín J. [Communication<br />
personnelle].<br />
20. Cotlear A. Carta dirigida al Dr.<br />
Z. Burstein, Director<br />
Universitario <strong>de</strong> Servicios<br />
Académicos Asistenciales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
UNMSM. 2 oct. 1967.<br />
Zuño Burstein<br />
ANTÉCÉDENTS<br />
Le statut universitaire <strong>de</strong> 1928, délivré par mandat <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi nº 6041, considérait déjà<br />
les étu<strong>de</strong>s pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste pertinentes. Cette prérogative fut concédée<br />
uniquement aux facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong><br />
San Marcos <strong>de</strong> Lima (UNMSM).<br />
Cette disposition se répéta pour les lois suivantes et les statuts universitaires, mais<br />
disparut dans le texte <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi n° 13417 <strong>de</strong> 1963. C’est pour cette raison, et dans le but<br />
<strong>de</strong> pouvoir préparer <strong>de</strong>s spécialistes, que l’UNMSM se hâta <strong>de</strong> constituer son école <strong>de</strong> diplômés,<br />
chargée d’organiser et d’orienter leur éducation continue, en insistant particulièrement<br />
sur les cours d’actualisation et en établissant le système <strong>de</strong> résidanat pour<br />
former <strong>de</strong>s spécialistes dans les différentes branches <strong>de</strong> l’activité médicale ; cependant,<br />
elle n’octroya pas le titre <strong>de</strong> spécialiste mais un diplôme stipu<strong>la</strong>nt qu’un mé<strong>de</strong>cin chirurgien<br />
« avait suivi <strong>de</strong> manière satisfaisante le programme <strong>de</strong> résidanat dans <strong>la</strong> spécialité<br />
<strong>de</strong>… », en indiquant les dates <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation. Ce diplôme était signé par le doyen<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et le directeur <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> diplômés.<br />
PROGRAMMES DE SPÉCIALISATION<br />
Le statut général <strong>de</strong> l’université péruvienne <strong>de</strong> 1972, promulgué par le décret-loi<br />
nº 17437, établit que les programmes <strong>de</strong> spécialisation simples (cours d’actualisation<br />
et/ou <strong>de</strong> remise à niveau) et les programmes <strong>de</strong> résidanat correspon<strong>de</strong>nt au cycle <strong>de</strong><br />
■ III<br />
339
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
340<br />
<strong>de</strong>uxième spécialisation (le cycle <strong>de</strong> première spécialisation culminant avec l’obtention<br />
du titre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien) et qu’ils sont compris dans <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s programmes<br />
académiques <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine.<br />
DIPLÔME DE SPÉCIALISTE<br />
À travers <strong>la</strong> résolution nº 1226-73 du 18 janvier 1973, le Conseil national <strong>de</strong> l’université<br />
péruvienne (CONUP) autorisa l’UNMSM à mettre en p<strong>la</strong>ce son programme <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine et à délivrer le diplôme <strong>de</strong> spécialiste, octroyé<br />
pour <strong>la</strong> première fois au Pérou au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation, suivant <strong>la</strong> modalité sco<strong>la</strong>risée<br />
à <strong>la</strong> fin d’un programme <strong>de</strong> résidanat et <strong>de</strong> formation spécialisée rigoureux.<br />
Avant l’existence <strong>de</strong> ce programme, les professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>venaient spécialistes<br />
par un processus d’autoformation, d’interapprentissage ou d’étu<strong>de</strong>s effectué <strong>de</strong><br />
façon indépendante sous <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>risée.<br />
Considérant :<br />
qu’il convenait <strong>de</strong> délivrer <strong>de</strong>s diplômes par <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire afin <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>riser<br />
<strong>la</strong> situation <strong>de</strong> beaucoup <strong>de</strong> professionnels,<br />
que <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> diplômes était protégée par l’article 62 du décret-loi nº 19326 et que<br />
d’ailleurs aucune autre institution publique ou privée ne pouvait s’arroger cette fonction<br />
propre à l’université péruvienne, c<strong>la</strong>irement autorisée par <strong>la</strong> loi à délivrer les diplômes<br />
<strong>de</strong> spécialisation,<br />
le CONUP a résolu, à travers <strong>la</strong> résolution nº 1556-74 CONUP du 6 février 1974, d’autoriser<br />
le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine <strong>de</strong> l’UNMSM à<br />
délivrer le titre <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien spécialiste en…, au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation péruvienne,<br />
pour <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire 1 .<br />
INTERVENTION DU COLLÈGE MÉDICAL DU PÉROU<br />
Le Collège médical du Pérou (CMP) fut créé en 1969, par <strong>la</strong> loi nº 15173 combinée<br />
avec le décret-loi nº 17239, dans le but <strong>de</strong> veiller, conformément aux principes internationaux<br />
correspondants, au respect <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> profession médicale selon les<br />
normes déontologiques contenues dans le co<strong>de</strong> d’éthique professionnelle promulgué par<br />
le Collège même. Les Drs Elmer Alegría et Zuño Burstein intervinrent comme membres<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> commission rédactrice du statut et du règlement du CMP, en tant que représentants<br />
<strong>de</strong>s programmes académiques <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Selon ce dispositif légal, ses statuts et ses règlements, il fut établi que les mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>vaient, pour exercer <strong>la</strong> profession médicale au Pérou, être inscrits au CMP ; il fal<strong>la</strong>it<br />
pour ce<strong>la</strong> qu’ils présentent leur titre professionnel <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins chirurgiens, délivré par<br />
l’une <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine du pays ou confirmé par l’une <strong>de</strong>s universités nationales.<br />
Pour les titres professionnels délivrés à l’étranger, ils se trouvaient exemptés <strong>de</strong> confirmation<br />
s’il existait une convention internationale <strong>de</strong> réciprocité en vigueur.<br />
Pour aboutir à ces fins, le CMP créa les registres nationaux d’inscription <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
chirurgiens, <strong>de</strong> spécialistes et <strong>de</strong> sociétés médicales scientifiques, mettant en p<strong>la</strong>ce pour<br />
cet enregistrement <strong>de</strong>s comités compétents à l’intérieur <strong>de</strong> sa structure organique. Le<br />
premier comité <strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie fut instauré le 20 décembre 1971, présidé<br />
par le Dr Luis Flores et composé <strong>de</strong>s Drs Aizic Cotlear et Guillermo Arana.<br />
Peu après sa création, le CMP commença à délivrer, au cours <strong>de</strong> cérémonies publiques,<br />
<strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> spécialistes pour <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire à <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins chirurgiens<br />
considérés comme qualifiés.<br />
RÉACTION DE L’UNIVERSITÉ PÉRUVIENNE ET ORDRE LÉGAL<br />
Le 22 novembre 1972, le conseil exécutif <strong>de</strong> l’UNMSM désigna une commission constituée<br />
<strong>de</strong>s Drs Zuño Burstein (directeur universitaire <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification), Andrés Rotta (directeur<br />
du programme académique <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine) et Elmer Alegría
(représentant l’école <strong>de</strong>s diplômés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine). Cette commission fut chargée <strong>de</strong> présenter<br />
auprès du CONUP une modification qui suspendrait, par <strong>la</strong> remise <strong>de</strong> titres <strong>de</strong> spécialisation<br />
au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation, les attributions que le CMP assumait illégalement et <strong>de</strong><br />
proposer par ailleurs <strong>de</strong>s solutions à <strong>de</strong>s problèmes divers du programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine <strong>de</strong> cette université.<br />
L’affaire fut réglée en spécifiant que, dorénavant, seules les universités nationales et privées<br />
habilitées pour cette mission pourraient délivrer les titres professionnels <strong>de</strong> spécialistes,<br />
aussi bien pour <strong>la</strong> modalité sco<strong>la</strong>ire (programmes <strong>de</strong> résidanat avec une programmation exigeante<br />
pour chaque spécialité) que pour <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire (avec une qualification rigoureuse<br />
du curriculum <strong>de</strong>s postu<strong>la</strong>nts), une fois leurs programmes et leurs règlements<br />
approuvés, après une évaluation exhaustive <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du CONUP. Le droit légal d’enregistrer<br />
automatiquement <strong>de</strong>s titres <strong>de</strong> spécialistes délivrés par les universités, d’autoriser aux<br />
non-diplômés l’exercice professionnel à <strong>de</strong>s conditions spéciales et <strong>de</strong> veiller au respect <strong>de</strong>s<br />
aspects concernant l’éthique et <strong>la</strong> déontologie médicales, revint alors au CMP.<br />
SITUATION ACTUELLE DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL DU SPÉCIALISTE EN DERMATOLOGIE<br />
Actuellement, et <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> création du CMP, le mé<strong>de</strong>cin spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie<br />
vou<strong>la</strong>nt exercer au Pérou doit être inscrit comme mé<strong>de</strong>cin chirurgien, et réunir par<br />
ailleurs les conditions requises pour s’inscrire en tant que mé<strong>de</strong>cin chirurgien spécialiste<br />
en <strong>de</strong>rmatologie, démarche qui nécessite <strong>la</strong> présentation du titre universitaire correspondant.<br />
Jusqu’en 1989, les mé<strong>de</strong>cins pouvaient obtenir l’autorisation du comité <strong>de</strong> qualification<br />
<strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie du CMP pour être enregistrés pour <strong>la</strong> modalité<br />
non sco<strong>la</strong>ire dans le registre correspondant à l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité ; cette attribution<br />
fut suspendue définitivement à partir <strong>de</strong> 1990.<br />
PROGRAMME UNIVERSITAIRE DE DEUXIÈME SPÉCIALISATION EN MÉDECINE (DERMATOLOGIE)<br />
Le 30 janvier 1975, <strong>la</strong> résolution directoriale nº 001-75 <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction universitaire<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> l’UNMSM nomma une commission présidée par le Dr Zuño Burstein<br />
(ancien directeur universitaire <strong>de</strong> p<strong>la</strong>nification) et intégrée par les Drs Elmer Alegría et<br />
Vitaliano Manrique, ce <strong>de</strong>rnier en tant que directeur <strong>de</strong>s programmes académiques <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine humaine. La commission visait à évaluer et à contrôler <strong>la</strong> bonne mise en<br />
marche du programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine, à gérer l’attribution<br />
<strong>de</strong>s commodités <strong>de</strong> l’espace physique, les ressources humaines, les normes<br />
d’organisation académico-administratives, le flux <strong>de</strong> documents, les dispositions économiques<br />
et <strong>de</strong> registre, les requêtes <strong>de</strong> coordination académique et d’évaluation pédagogique,<br />
s’ajustant aux normes et aux procédures pour l’obtention du titre <strong>de</strong> spécialiste<br />
<strong>de</strong>s modalités sco<strong>la</strong>risée et non sco<strong>la</strong>risée, publiés par l’UNMSM en 1974 dans les « Dispositions<br />
légales et organisation du programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation », avec les<br />
« Normes et procédures pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste pour les modalités sco<strong>la</strong>risée<br />
et non sco<strong>la</strong>risée » déjà en vigueur (autorisées par une résolution du CONUP nº 1556-74<br />
CONUP du 6 février 1974) 1 .<br />
Dès lors, tous les programmes <strong>de</strong> spécialisation existants, dont celui <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
(1974), furent progressivement régu<strong>la</strong>risés.<br />
Premier programme universitaire <strong>de</strong> spécialisation<br />
<strong>de</strong>rmatologique au Pérou<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES<br />
L’apprentissage et <strong>la</strong> formation <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins pratiquant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou eurent<br />
différents versants.<br />
Les centres <strong>de</strong> soin hospitalier et les services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique (bienfaisances publiques,<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, sécurité sociale, forces armées et policières et gouvernements<br />
341
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
342<br />
locaux) et privés (cliniques particulières) engageaient, au début <strong>de</strong> façon directe et ensuite<br />
par concours, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins qui avaient acquis une expérience en ma<strong>la</strong>dies cutanées<br />
et vénériennes, soit par une formation in situ — aux côtés <strong>de</strong> professionnels chefs<br />
<strong>de</strong> service chargés <strong>de</strong> ces affections et possédant <strong>de</strong>s connaissances pratiques en <strong>la</strong> matière<br />
—, soit grâce à <strong>de</strong>s cours ou <strong>de</strong>s stages sur <strong>la</strong> spécialité à l’étranger.<br />
Rappelons <strong>la</strong> contribution faite par <strong>de</strong>ux grands centres hospitaliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> bienfaisance<br />
publique <strong>de</strong> Lima: l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo (hôpital pour hommes) et l’hôpital Arzobispo<br />
Loayza (hôpital pour femmes); <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> l’UNMSM y<br />
comptait non seulement du personnel hautement qualifié qui s’occupait du soin <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s<br />
— tout en étant à <strong>la</strong> fois professeurs <strong>de</strong> l’université —, mais aussi <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions<br />
pour l’enseignement et <strong>la</strong> recherche, constituant ainsi <strong>de</strong>s centres d’assistance, d’enseignement<br />
et <strong>de</strong> recherche qui jouèrent — et jouent toujours — un rôle très important dans<br />
<strong>la</strong> formation universitaire <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins chirurgiens, <strong>de</strong>s chercheurs mé<strong>de</strong>cins et, ultérieurement,<br />
<strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong> diverses branches <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
À l’hôpital Arzobispo Loayza, le grand centre <strong>de</strong> soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> bienfaisance publique <strong>de</strong><br />
Lima, transféré plus tard au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, le cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
(à <strong>la</strong> charge du Dr Eleodoro Camacho en 1926) fut occupé un an plus tard<br />
par le Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>, qui en assuma <strong>la</strong> direction dans les années 30 tout en<br />
étant également professeur principal <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie à<br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> <strong>la</strong> UNMSM. Le Dr Pablo Arana, qui eut un<br />
rôle très important dans l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et dans <strong>la</strong> formation spécialisée<br />
pour <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> plusieurs mé<strong>de</strong>cins, fut nommé professeur auxiliaire,<br />
marquant le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> première école <strong>de</strong>rmatologique péruvienne au sein dudit hôpital.<br />
Cette structure d’enseignement et <strong>de</strong> soin fut étroitement liée à celle du Dr Pedro<br />
Weiss, qui fut sous-chef <strong>de</strong> l’institut d’anatomie pathologique <strong>de</strong> l’hôpital Loayza vers<br />
1926, dirigé par le Dr Mackehenie ; il fonda ultérieurement, en tant que professeur principal<br />
d’anatomie pathologique <strong>de</strong> l’UNMSM, l’importante école péruvienne <strong>de</strong> pathologistes,<br />
avec un intérêt spécial pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie, <strong>la</strong> mycologie médicale, <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine tropicale et l’anthropologie. Ce lien ouvrit un vaste spectre <strong>de</strong> connaissances<br />
sur le sujet et fut très important pour approcher <strong>de</strong> façon adéquate <strong>la</strong> spécialité et l’enseignement<br />
<strong>de</strong>rmatologiques.<br />
Ces <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine — l’école <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et<br />
l’école pathologique <strong>de</strong> Pedro Weiss — fut longuement liées. Pour preuve les activités du<br />
<strong>de</strong>rmatologue Víctor Meth, qui appartint aux <strong>de</strong>ux groupes : il enseignait à l’ancienne<br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dirigeait le service hospitalier <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et travail<strong>la</strong>it<br />
comme <strong>de</strong>rmo-pathologiste au Département <strong>de</strong> pathologie <strong>de</strong> l’Hôpital Loayza.<br />
Tel que nous l’avons déjà signalé, <strong>la</strong> démission massive <strong>de</strong>s professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando eut lieu en 1961. Face à cette crise, le gouvernement universitaire<br />
décida le transfert <strong>de</strong> tous les biens physiques et <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> cette<br />
chaire vers l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> Lima, et il décréta sa réorganisation, en <strong>de</strong>mandant<br />
au Dr Zuño Burstein, professeur auxiliaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong><br />
l’UNMSM, qui venait d’arriver après sa formation en Allemagne et en Israël, d’accomplir<br />
cette mission délicate.<br />
La chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM<br />
s’instal<strong>la</strong> à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> Lima et commença une nouvelle vie institutionnelle<br />
à partir <strong>de</strong> sa réorganisation.<br />
L’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo <strong>de</strong> Lima, l’un <strong>de</strong>s centres hospitaliers les plus grands et les plus<br />
mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> l’époque, et comptant un groupe <strong>de</strong> professionnels qui soignaient les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s<br />
tout en étant professeurs à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM, fut inauguré le<br />
28 février 1875.<br />
Ce grand centre hospitalier joua un rôle important dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine pé-
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
ruvienne, non seulement parce qu’il accueil<strong>la</strong>it les pathologies <strong>de</strong> toutes les régions du<br />
Pérou (car c’était un centre <strong>de</strong> référence et qu’il concentrait les soins au niveau national),<br />
mais aussi parce que tous les mé<strong>de</strong>cins péruviens s’y formaient. Le centre recevait<br />
plusieurs équipes d’enseignants et <strong>de</strong> chercheurs universitaires, venant uniquement <strong>de</strong><br />
l’UNMSM au début et ensuite <strong>de</strong>s autres universités.<br />
Le Dr Zuño Burstein travail<strong>la</strong> dans cet hôpital à partir <strong>de</strong> 1950, tout d’abord comme praticien,<br />
ensuite comme assistant au département <strong>de</strong> pathologie et finalement, à partir <strong>de</strong><br />
1957, comme assistant au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> salle San Lázaro, dont le chef<br />
était le Dr Arturo Sa<strong>la</strong>s (professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Dr Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et chef<br />
du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> police, entre autres). Les Drs Oscar Romero et<br />
Abe<strong>la</strong>rdo Tejada travail<strong>la</strong>ient également dans ce service comme auxiliaires libres; ce <strong>de</strong>rnier<br />
fut ensuite muté à l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> l’UNMSM, où il occupe actuellement<br />
le poste <strong>de</strong> directeur. Les Drs Marcial Ríos et Luis Romero, membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie du Dr Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>, y assistaient également.<br />
À l’époque, le Dr Félix Castillo était le chef du <strong>la</strong>boratoire central <strong>de</strong> l’hôpital, le <strong>la</strong>boratoire<br />
<strong>de</strong> microbiologie était dirigé par le Dr Julio Morales Saravia, tandis que le<br />
Dr Rafael Acosta était chargé <strong>de</strong>s diagnostics et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche mycologique. Le département<br />
<strong>de</strong> pathologie, unité d’enseignement et d’assistance universitaire créée par le<br />
Dr Pedro Weiss, avait pour chef le Dr Oscar Urteaga, et accueil<strong>la</strong>it <strong>de</strong>s professionnels notables<br />
comme le Dr Hugo Lumbreras (tropicaliste, plus tard fondateur <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale Alexan<strong>de</strong>r Von Humboldt), entre autres ; on y étudiait intensément <strong>la</strong><br />
pathologie <strong>de</strong>rmatologique tropicale (verrue péruvienne, leishmaniose, lèpre, mycoses<br />
profon<strong>de</strong>s et autres). L’enseignement s’appuyait sur le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong>s cliniques, universitaires,<br />
dont le Dr Vitaliano Manrique assumait <strong>la</strong> responsabilité. Ainsi, l’hôpital Dos <strong>de</strong><br />
Mayo, une structure d’appui venait compléter l’équipe <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> recherche intégrale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pathologie nationale.<br />
Le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> protozoologie et mycologie, à <strong>la</strong> charge du Dr Zuño<br />
Burstein, professeur auxiliaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UNMSM, se<br />
greffa sur l’hôpital à partir du 1 er janvier 1962, comme une dépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> l’UNMSM.<br />
Ce <strong>la</strong>boratoire situé dans l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, dont le Dr Zuño Burstein établit le lien<br />
avec <strong>la</strong> nouvelle chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine San<br />
Fernando <strong>de</strong> l’UNMSM, permit vers 1962 <strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce et d’initier l’activité universitaire<br />
pour les étudiants <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine; le Dr Clement Counter (<strong>de</strong>rmatologue américain)<br />
fut embauché comme professeur, tandis que les Drs Abe<strong>la</strong>rdo Indacochea, Zuño Burstein,<br />
Raúl Gal<strong>la</strong>rday, César Rojas, Juan Manrique et Humberto Benavi<strong>de</strong>s intégrèrent le groupe<br />
<strong>de</strong> professeurs auxiliaires. Enrique Sifuentes, Wences<strong>la</strong>o Castillo, Pedro Ortiz, Carlos Rega<strong>la</strong>do<br />
et Juan Meza <strong>de</strong>vinrent pour leur part chefs éducateurs, assistés par Julio Bonil<strong>la</strong>,<br />
Humberto Ugaz et Dante Mendoza.<br />
Les Drs Luis Castro Mendívil, Hugo Pesce, Julio Bedoya, Wilfredo Gardini, Oscar Romero<br />
et Félix Castillo y travail<strong>la</strong>ient en tant que professeurs invités. Une nouvelle étape,<br />
marquée par <strong>la</strong> multidisciplinarité, commença alors : le <strong>la</strong>boratoire intégra <strong>la</strong> vénéréologie,<br />
l’allergie, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, l’anatomie pathologique, <strong>la</strong> mycologie, <strong>la</strong> thérapeutique<br />
physique, <strong>la</strong> radiothérapie et d’autres procédures physiques, suivant<br />
l’orientation spécialisée <strong>de</strong>s enseignants, contribuant à mo<strong>de</strong>rniser l’enseignement et<br />
l’exercice professionnel.<br />
Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année (1962), le Dr Aizic Cotlear fut élu par concours professeur<br />
associé ; il constitua et dirigea pendant plusieurs années l’école <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> l’UNMSM mo<strong>de</strong>rne, à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo;<br />
cette école délivra les premiers titres <strong>de</strong> spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie pour <strong>la</strong> modalité<br />
non sco<strong>la</strong>ire et initia le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation pour <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues pour <strong>la</strong> modalité sco<strong>la</strong>ire. On intégra pour ce<strong>la</strong> <strong>la</strong> zone<br />
343
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
344<br />
<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique (à <strong>la</strong> charge du Dr Rafael Rabinovich et du Dr Elbio Flores<br />
ultérieurement), et intégra <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues réputés pour y enseigner tels que les<br />
Drs José San Martín, Alejandro Morales, Tarci<strong>la</strong> Rey Sánchez et Elda Cana<strong>de</strong>ll, entre<br />
autres ; on engagea aussi les hôpitaux rattachés au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, à <strong>la</strong> sécurité<br />
sociale et aux forces armées et à <strong>la</strong> police pour dispenser l’enseignement.<br />
Le 8 octobre 1969, le Dr Aizic Cotlear, coordinateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
chef intérimaire du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine <strong>de</strong> l’UNMSM, adressa une communication<br />
au directeur universitaire <strong>de</strong>s services académiques et du registre central <strong>de</strong><br />
cette université sur <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> cette structure d’enseignement et d’assistance située<br />
dans l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo : il lui fit part du haut <strong>de</strong>gré d’organisation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> valeur <strong>de</strong>s<br />
prestations <strong>de</strong>s services communautaires, <strong>la</strong> formation du personnel spécialisé, les recherches<br />
mises en route entre 1961 et 1969, <strong>de</strong>mandant le soutien <strong>de</strong>s autorités universitaires<br />
pour continuer d’exercer ses fonctions 2 .<br />
En conséquence, les services académiques d’assistance dans différentes zones furent<br />
créés et notamment le service académique d’assistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont le siège<br />
central se trouvait à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, qui a été et qui est toujours le centre <strong>de</strong> formation<br />
universitaire le plus important du Pérou dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Le service académique d’assistance <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’UNMSM fut reconnu par les organismes<br />
du gouvernement <strong>de</strong> l’université par <strong>la</strong> résolution directoriale nº 303/DSA/70, le 2 février<br />
1970. La liste <strong>de</strong> professionnels <strong>de</strong> ce service fut établie comme suit: chef du service,<br />
Dr Aizic Cotlear, professeur principal; chef du <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> diagnostic, Dr Zuño Burstein, professeur<br />
associé; les Drs Oscar Romero et Abe<strong>la</strong>rdo Tejada, professeurs auxiliaires; Dante<br />
Mendoza, Julio Bonil<strong>la</strong>, Juan Meza et David Carrizales, assistants du service.<br />
HISTOIRE DE L’ORGANISATION DU PROGRAMME UNIVERSITAIRE DE DEUXIÈME<br />
SPÉCIALISATION EN DERMATOLOGIE<br />
Depuis sa création en 1973 (résolution rectorale nº 38145-UNMSM et res. CONUP<br />
nº 1226-73), le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation comprend l’enseignement et les<br />
activités <strong>de</strong>s sciences médicales basiques et cliniques. Son p<strong>la</strong>n d’étu<strong>de</strong>s comprend essentiellement<br />
<strong>de</strong>s stages professionnels intensifs, <strong>de</strong>s cours d’actualisation <strong>de</strong> haut niveau,<br />
<strong>de</strong>s activités non cognitives et <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> conseil et d’orientation. La durée ne<br />
doit pas être inférieure à six semestres, avec un total <strong>de</strong> 120 crédits. Pour s’y inscrire il<br />
faut possé<strong>de</strong>r le titre professionnel <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien, et l’admission se fait uniquement<br />
sur concours. Actuellement, les postes vacants pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, spécialité très<br />
sollicitée, sont restreints ; il y en a treize à l’UNMSM, <strong>la</strong> première à établir ce programme<br />
<strong>de</strong> spécialisation, et un poste vacant par an à l’université Particu<strong>la</strong>r Cayetano Heredia,<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière à en recevoir l’autorisation.<br />
Le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation <strong>de</strong> l’UNMSM utilise <strong>de</strong>s locaux et <strong>de</strong>s équipements<br />
cédés par les centres d’assistance du secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et du travail, suivant le décret<br />
suprême 0055-71SA du 13 avril 1971, car ils doivent faciliter l’enseignement médical<br />
universitaire. Il fut établi que le résidanat <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation aurait lieu dans les centres<br />
d’assistance accrédités, après une évaluation préa<strong>la</strong>ble. L’UNMSM conclut <strong>de</strong>s conventions<br />
avec tous les hôpitaux et les centres <strong>de</strong> santé <strong>de</strong> Lima pour aboutir au respect <strong>de</strong> ce décret.<br />
L’université possè<strong>de</strong> aussi, même aujourd’hui, ses propres locaux, comme l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale Daniel A. Carrión, et d’autres situés dans différents hôpitaux <strong>de</strong> Lima <strong>de</strong>puis<br />
longtemps. Les services académiques d’assistance <strong>de</strong> l’UNMSM, constitués dès 1970 à l’initiative<br />
du Dr Zuño Burstein (au cours <strong>de</strong> sa gestion comme membre du conseil du gouvernement<br />
<strong>de</strong> réorganisation <strong>de</strong> l’UNMSM et plus tard comme directeur universitaire), sont <strong>de</strong>s<br />
centres académiques <strong>de</strong>stinés à l’enseignement, à <strong>la</strong> recherche, à <strong>la</strong> pratique professionnelle<br />
<strong>de</strong>s étudiants et au service d’assistance envers <strong>la</strong> communauté, fournissant donc <strong>de</strong>s biens<br />
et <strong>de</strong>s services.<br />
Les services académiques d’assistance <strong>de</strong> l’UNMSM sont au nombre <strong>de</strong> dix, situés
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
dans les hôpitaux Dos <strong>de</strong> Mayo, Arzobispo Loayza, Víctor Larco Herrera (hôpital pour<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s mentaux), materno-infantile <strong>de</strong> San Bartolomé, complexe hospitalier Daniel<br />
A. Carrión <strong>de</strong>l Cal<strong>la</strong>o, entre autres. Parmi eux, celui <strong>de</strong> l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo, dirigé par<br />
le Dr Aizic Cotlear, est remarquable dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne. Il <strong>de</strong>vint<br />
le foyer <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, d’enseignement et <strong>de</strong> soin le plus important du pays, et<br />
sa reconnaissance fut <strong>la</strong>rgement justifiée lorsque l’autorité universitaire compétente lui<br />
octroya l’accréditation pour <strong>de</strong>venir le siège central du premier programme <strong>de</strong> spécialisation<br />
pour <strong>la</strong> modalité sco<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du Pérou.<br />
Les institutions <strong>de</strong> santé étatiques et paraétatiques qui sollicitent <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins spécialistes dont elles ont besoin doivent créer les postes, prenant en charge<br />
les frais et coordonnant avec l’université l’appel à concours, selon le règlement universitaire<br />
du programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine.<br />
PREMIERS COMITÉS DE SPÉCIALISATION EN DERMATOLOGIE ET EN MÉDECINE TROPICALE<br />
La direction <strong>de</strong>s programmes académiques <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine <strong>de</strong> l’UNMSM approuva<br />
le 15 mars 1974 vingt-sept comités <strong>de</strong> spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine, dont<br />
le comité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, présidé à l’origine par le Pr. Dr Aizic Cotlear et intégré par les<br />
Drs Dante Mendoza, José San Martín et Alejandro Morales et celui <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale,<br />
présidé par le Pr. Dr Zuño Burstein ; ces <strong>de</strong>ux comités établirent un rapport étroit<br />
d’enseignement et <strong>de</strong> services. Actuellement, le comité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est présidé par<br />
le Pr. Dr Dante Mendoza, tandis que le Pr. Dr Abe<strong>la</strong>rdo Tejada a en charge celui <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine tropicale.<br />
À travers son programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine humaine,<br />
l’UNMSM publia dans les journaux nationaux (le 3 mars 1974 et le 16 avril 1975) les dispositions,<br />
les démarches et les conditions requises pour obtenir le titre <strong>de</strong> spécialiste en<br />
mé<strong>de</strong>cine humaine pour vingt-huit spécialités pour <strong>la</strong> modalité non sco<strong>la</strong>ire, dont celle<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien spécialiste en <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien spécialiste<br />
en mé<strong>de</strong>cine tropicale.<br />
Le 22 avril 1974, l’UNMSM remit les titres <strong>de</strong> spécialistes dans les différentes<br />
branches <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine pour <strong>la</strong> modalité sco<strong>la</strong>ire, grâce à ses programmes académiques<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine humaine et <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation, assumant ainsi publiquement<br />
ses <strong>de</strong>voirs et ses obligations établis par <strong>la</strong> loi et en voie <strong>de</strong> régu<strong>la</strong>risation.<br />
Cette remise <strong>de</strong> titres aux étudiants ayant fini leur cursus à l’ancienne école <strong>de</strong> diplômés<br />
eut lieu au cours d’une séance publique solennelle au pa<strong>la</strong>is municipal <strong>de</strong> Lima,<br />
en <strong>la</strong> présence du ministre <strong>de</strong> l’éducation et du maire du conseil provincial <strong>de</strong> Lima, sur<br />
une invitation du recteur <strong>de</strong> l’UNMSM et du prési<strong>de</strong>nt du CONUP. Cette cérémonie réaffirma<br />
que l’université péruvienne est le seul organisme du Pérou autorisé à remettre <strong>de</strong>s<br />
titres professionnels <strong>de</strong> spécialistes au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation.<br />
Aspects historiques <strong>de</strong>s instituts <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
recherche scientifique <strong>de</strong>rmatologique au Pérou<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou fut étroitement liée au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine tropicale en tant que spécialité, aussi bien aux niveaux <strong>de</strong> l’enseignement et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche sur <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine péruvienne qu’au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> pratique professionnelle.<br />
Le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire tropicale, qui comprend l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pathologies<br />
partagées entre ces <strong>de</strong>ux spécialités telles que <strong>la</strong> verrue péruvienne, <strong>la</strong> leishmaniose, les<br />
mycoses profon<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> lèpre, les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles, le sida, entre<br />
autres, nous oblige à faire un compte rendu, quoique succinct, <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s centres<br />
<strong>de</strong> recherche du Pérou liés à l’activité <strong>de</strong>rmatologique.<br />
345
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
346<br />
INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE DANIEL A. CARRIÓN, DE LA UNIVERSIDAD<br />
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (UNMSM)<br />
Vers <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s années 50 un groupe <strong>de</strong> jeunes professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando <strong>de</strong> l’UNMSM (dirigée par le<br />
Pr. Dr Hugo Pesce) et d’autres institutions académiques et scientifiques furent accueillis<br />
par le professeur Dr Enrique Encinas au sein <strong>de</strong> son <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> recherche neuropathologique<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Víctor Larco Herrera, autorisés par son directeur, le Dr Juan<br />
Francisco Valega. Le Dr Hugo Lumbreras, qui s’était rendu à l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
<strong>de</strong> Hambourg grâce à <strong>la</strong> bourse « Alexan<strong>de</strong>r Von Humboldt » sur les conseils du<br />
Pr. Encinas, se trouvait parmi eux. Comptant sur <strong>la</strong> coordination du Dr Zuño Burstein à<br />
Lima, il y organisa <strong>la</strong> visite du Pr. Dr Ernst Georg Nauck, directeur dudit institut, dans le<br />
but d’étudier <strong>la</strong> création d’un institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale à Lima, sur le campus <strong>de</strong><br />
l’UNMSM, par une convention entre les gouvernements <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux pays.<br />
Ce groupe promoteur (qui fut à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
Daniel A. Carrión en 1963) était intégré, entre autres figures remarquables, par le<br />
Dr Olga Pa<strong>la</strong>cios, mé<strong>de</strong>cin virologue, qui occupa plus tard <strong>la</strong> direction dudit centre; le Dr<br />
Zuño Burstein, mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue tropicaliste (désigné plus tard professeur émérite<br />
<strong>de</strong> l’UNMSM) ; le Dr Hugo Lumbreras, mé<strong>de</strong>cin tropicaliste, qui créa et dirigea jusqu’à sa<br />
mort l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Alexan<strong>de</strong>r von Humboldt, <strong>de</strong> l’université privée<br />
Cayetano Heredia ; le Dr Abe<strong>la</strong>rdo Tejada, mé<strong>de</strong>cin tropicaliste, qui fut désigné en 2003<br />
directeur <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> l’UNMSM ; le Dr Oscar Romero, mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue tropicaliste,<br />
qui fut ensuite professeur principal et chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong><br />
l’UNMSM ; le Dr César Náquira, mé<strong>de</strong>cin microbiologiste, qui fut nommée directeur <strong>de</strong><br />
l’institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé du Pérou en 2004.<br />
De nos jours l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión est un centre <strong>de</strong> recherche,<br />
d’enseignement et <strong>de</strong> formation du personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé qui propose <strong>de</strong>s services<br />
spécialisés à <strong>la</strong> communauté et qui possè<strong>de</strong> aussi <strong>de</strong>s <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> diagnostic en<br />
bactériologie, parasitologie, entomologie, mycologie, virologie et histopathologie, tout<br />
comme <strong>de</strong>s unités spécialisées pour <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong> <strong>la</strong> toxop<strong>la</strong>smose, <strong>la</strong> bartonellose, <strong>la</strong><br />
leishmaniose et <strong>la</strong> lèpre, entre autres. Il dispose également d’un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
sanitaire à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> cinq mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues.<br />
L’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión est une référence nationale et jouit<br />
d’un prestige international. Des professionnels <strong>de</strong> l’étranger s’y ren<strong>de</strong>nt afin <strong>de</strong> se former<br />
en mé<strong>de</strong>cine tropicale, tout comme <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nts en infectiologie, en mé<strong>de</strong>cine tropicale,<br />
en mé<strong>de</strong>cine interne, en <strong>de</strong>rmatologie et en pathologie clinique, <strong>de</strong> l’UNMSM et<br />
d’autres universités.<br />
Il est en rapport avec diverses universités nationales et étrangères, avec le bureau sanitaire<br />
panaméricain <strong>de</strong> l’OMS et avec l’Institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> l’armée <strong>américaine</strong><br />
(NAMRED) ; il conclut <strong>de</strong>s conventions avec le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé afin <strong>de</strong><br />
développer <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>ria, <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies méta-xéniques, <strong>de</strong><br />
l’hydatidose, <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et d’autres affections <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire.<br />
Il dispose d’un bâtiment mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> quatre étages situé dans <strong>la</strong> ville universitaire <strong>de</strong><br />
San Marcos, qui comprend quarante <strong>la</strong>boratoires, vingt bureaux, <strong>de</strong>s cabinets externes,<br />
<strong>de</strong>s salles <strong>de</strong> cours pratiques pour les élèves effectuant <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures et <strong>la</strong> spécialisation,<br />
un auditorium, <strong>la</strong> bibliothèque spécialisée Hugo Pesce et un local pour gar<strong>de</strong>r<br />
les animaux servant aux expérimentations (figure 23).<br />
L’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión édite une publication, <strong>la</strong> Revista<br />
Peruana <strong>de</strong> Medicina Tropical, son organe officiel pour <strong>la</strong> diffusion scientifique.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE ALEXANDER VON<br />
HUMBOLDT, DE L’UNIVERSITÉ PÉRUVIENNE<br />
CAYETANO HEREDIA (UPCH)<br />
L’UPCH (université privée) approuva en 1968 <strong>la</strong><br />
création d’un nouvel institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale à<br />
Lima — appelé institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Alexan<strong>de</strong>r<br />
Von Humboldt —, et désigna le Dr Hugo Lumbreras<br />
pour s’occuper <strong>de</strong> son organisation.<br />
Ce nouveau centre, qui acquit vite un prestige national<br />
et international, s’occupa <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche, <strong>de</strong><br />
l’enseignement et du soin communautaire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
infectieuses et tropicales. Ses activités plus notables se rapportent à <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Chagas, les ma<strong>la</strong>dies entériques, les parasitoses intestinales, <strong>la</strong> mycologie<br />
médicale, le VIH/sida, les infections par HTLV-1, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen et d’autres ma<strong>la</strong>dies<br />
d’origine virale et bactérienne.<br />
Des mé<strong>de</strong>cins infectiologues prestigieux font partie <strong>de</strong> cet institut : le Dr Eduardo Gotuzzo<br />
(son directeur actuel, expert en MST/sida), le Dr Alejandro L<strong>la</strong>nos (chercheur en<br />
leishmaniose), le Dr Pedro Legua (spécialiste en ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen), le Dr Humberto<br />
Guerra (ancien directeur et microbiologiste réputé), et le Dr Humberto Álvarez (parasitologue<br />
renommé).<br />
AUTRES CENTRES DE RECHERCHE<br />
Un troisième institut <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies infectieuses et tropicales fut récemment créé à Trujillo<br />
(au nord du pays) par le Dr Hernán Miranda, mé<strong>de</strong>cin microbiologiste, tropicaliste.<br />
Cet institut se consacre à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire et <strong>de</strong>s mycoses, ainsi<br />
qu’à d’autres affections du domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie tropicale.<br />
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ<br />
Ce centre constitue le bras scientifique du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé. Il fut créé en 1896<br />
et joua historiquement, dans le vaste domaine qui est le sien, un rôle très important dans<br />
le diagnostic et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire, telles <strong>la</strong> verrue<br />
péruvienne, <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire, <strong>la</strong> lèpre et les mycoses, entre autres. Il eut un<br />
rôle moteur dans l’éradication <strong>de</strong> <strong>la</strong> variole au Pérou par <strong>la</strong> production <strong>de</strong> sérums biologiques<br />
et <strong>de</strong> vaccins (figure 24).<br />
Certains chercheurs, parmi d’autres, contribuèrent <strong>de</strong> façon remarquable au développement<br />
<strong>de</strong> l’institution : Telémaco Batisttini, en verrue péruvienne ; Arísti<strong>de</strong>s Herrer,<br />
en leishmaniose et ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrión ; Carlos Carrillo, en variole ; Oscar<br />
Miró Quesada, en néop<strong>la</strong>sies ; Oswaldo Meneses, en animaux venimeux<br />
(serpents, araignées) ; René Solis, en MST ; José Gonzales Mugaburu, en<br />
parasitologie ; Zuño Burstein en lèpre et mycologie.<br />
Depuis 1942, l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé édite une <strong>de</strong>s publications<br />
scientifiques les plus importantes du Pérou, <strong>la</strong> Revista Peruana <strong>de</strong> Medicina<br />
Experimental y Salud Pública, qui constitue son organe <strong>de</strong> diffusion<br />
scientifique. Les Drs Telémaco Batisttini et Carlos Gutiérrez Noriega furent<br />
ses premiers éditeurs, tandis que <strong>de</strong> nos jours (2005) c’est le Dr Zuño Burstein<br />
qui en est à <strong>la</strong> charge. Elle est inscrite à <strong>la</strong> LIPECS, à <strong>la</strong> LILACS et à<br />
<strong>la</strong> SCIELO et compte un comité éditorial et un conseil <strong>de</strong> consultation <strong>de</strong><br />
très haute qualité scientifique.<br />
L’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, et par là le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, signèrent<br />
il y a vingt ans une convention avec l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión<br />
<strong>de</strong> l’UNMSM dans le but d’encourager l’étu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> formation du personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
et le soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté liés à <strong>la</strong> lèpre et à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire.<br />
347<br />
Figure 23.<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Institut<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale Daniel<br />
A. Carrión<br />
Figure 24.<br />
Vue du local central<br />
<strong>de</strong> l’Institut<br />
national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
348<br />
<strong>Histoire</strong> succincte <strong>de</strong> quelques ma<strong>la</strong>dies au Pérou<br />
LA LEISHMANIOSE TÉGUMENTAIRE AU PÉROU. CONTRIBUTION PÉRUVIENNE<br />
À SA CONNAISSANCE ET À SA LÉGISLATION<br />
Le Pérou jouit d’un privilège sur le p<strong>la</strong>n scientifique qui correspond à un inconvénient<br />
sérieux sur le p<strong>la</strong>n sanitaire: les modalités cliniques les plus diverses du processus s’appliquent<br />
sur son vaste territoire, qui compte <strong>de</strong>s zones endémiques <strong>de</strong> leishmaniose tégumentaire.<br />
Cette particu<strong>la</strong>rité ne se retrouve pas dans d’autres régions au mon<strong>de</strong>, où<br />
prédomine habituellement une modalité clinique donnée pour <strong>de</strong>s régions territoriales<br />
assez étendues, comme c’est le cas dans le Vieux Mon<strong>de</strong> avec le bouton d’Orient (leishmaniose<br />
cutanée pure).<br />
Par contre, les conditions écologiques si variées <strong>de</strong> notre pays entraînent <strong>de</strong>s manifestations<br />
cliniques apparemment liées à ces conditions, que nous associons étroitement<br />
à leur origine territoriale. C’est ainsi qu’on parle d’uta pour faire référence à <strong>la</strong> leishmaniose<br />
andine et d’espundia pour <strong>la</strong> leishmaniose provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt, en leur attribuant<br />
<strong>de</strong>s caractères cliniques plus ou moins spécifiques.<br />
On observe <strong>de</strong>puis très longtemps au Pérou l’existence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux types ou formes cliniques<br />
<strong>de</strong> leishmaniose tégumentaire. Palma en 1908 3 , Escomel 4 , Arce 5 et Monge 6 en<br />
1914, Weiss en 1924 7 et d’autres chercheurs péruviens admettaient <strong>la</strong> différence entre<br />
uta et espundia, sans même connaître l’étiologie <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux tableaux cliniques. Mais ce<br />
furent essentiellement Escomel en 1942 8 et Weiss en 1943 9 qui établirent <strong>de</strong>ux formes<br />
cliniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose parfaitement i<strong>de</strong>ntifiables au Pérou, une fois connue l’étiologie<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux processus. Un premier type bénin, comparable au bouton d’Orient, affectant<br />
prioritairement les enfants et qui guérit <strong>de</strong> façon spontanée, <strong>la</strong> personne en restant<br />
vaccinée à jamais ; cette forme <strong>de</strong> pathologie propre aux régions andines présente rarement<br />
<strong>de</strong>s lésions muqueuses prolongées, on l’appelle uta ou leishmaniose andine péruvienne.<br />
Le <strong>de</strong>uxième type, une forme grave, affecte <strong>de</strong> préférence les hommes adultes,<br />
présentant un compromis constant et métastatique <strong>de</strong>s muqueuses respiratoires ; sa localisation<br />
territoriale correspond à <strong>la</strong> forêt, on l’appelle espundia ou leishmaniose <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
forêt <strong>américaine</strong>. Ce critère fut accepté par <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> nomenc<strong>la</strong>ture <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
brésilienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie et par <strong>la</strong> Société ibéro-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie au cours <strong>de</strong> sa réunion à Rio <strong>de</strong> Janeiro en 1950.<br />
Toutefois, l’analyse <strong>de</strong>s cas, effectuée par plusieurs chercheurs péruviens comme<br />
Cornejo Ubillus 10 , prouva <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> certaines formes cliniques <strong>de</strong> leishmaniose dans<br />
d’autres régions. Contrairement à ce qu’il croyait au début, Weiss douta en 1953 11 du fait<br />
que l’uta se contractait uniquement dans les An<strong>de</strong>s, après avoir vérifié l’existence, même<br />
rare, <strong>de</strong> quelques foyers d’espundia andins et <strong>de</strong>s foyers d’uta dans <strong>la</strong> forêt. Weiss dit<br />
que ces faits semb<strong>la</strong>ient effacer <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> différences essentielles entre les <strong>de</strong>ux<br />
formes c<strong>la</strong>ssiques. Nonobstant, les différences statistiques régionales et même locales<br />
sont si accentuées qu’elles ne peuvent pas être ignorées.<br />
Burstein 12 <strong>la</strong>issa <strong>de</strong> côté les considérations visant à expliquer les différentes modalités<br />
cliniques qui tournent autour <strong>de</strong>s facteurs parasitologiques (comme <strong>la</strong> différenciation<br />
sérologique <strong>de</strong> différentes souches productrices <strong>de</strong> leishmaniose tégumentaire, les conditions<br />
immunoallergiques <strong>de</strong> l’hôte, le rôle joué par les réservoirs et même les vecteurs,<br />
entre autres). Il présenta au cours du VII e Congrès international <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
et ma<strong>la</strong>ria qui eut lieu à Rio <strong>de</strong> Janeiro en 1963 (et à partir <strong>de</strong> son expérience à l’hôpital<br />
Dos <strong>de</strong> Mayo et <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> 158 cas <strong>de</strong> leishmaniose tégumentaire dans tout le pays),<br />
<strong>la</strong> c<strong>la</strong>ssification suivante <strong>de</strong>s leishmanioses tégumentaires au Pérou :<br />
1. leishmaniose andine cutanée (équiva<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> uta c<strong>la</strong>ssique) ;<br />
2. leishmaniose andine cutanée muqueuse ;<br />
3. leishmaniose cutanée forestière;
4. leishmaniose cutanée muqueuse forestière (équiva<strong>la</strong>nt à<br />
<strong>la</strong> espundia c<strong>la</strong>ssique).<br />
Ce critère fut accepté au cours du I er Congrès péruvien <strong>de</strong><br />
microbiologie et parasitologie <strong>de</strong> 1964 13 et il est basé sur <strong>de</strong>s<br />
concepts clinico-épidémiologiques évolutifs 14, 15 (figures 25, 26,<br />
27).<br />
Il est indispensable que ces dénominations soient accompagnées<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> qualification évolutive du processus afin que <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>ssification ait un sens dynamique ; nous adoptâmes pour<br />
ce<strong>la</strong> le critère que Dostrowsky 16 appliqua à <strong>la</strong> leishmaniose cutanée<br />
(bouton d’Orient), <strong>la</strong> jugeant récente (ou précoce) si le<br />
processus prend moins d’un an, et tardive s’il prend plus d’un<br />
an pour évoluer.<br />
Selon L<strong>la</strong>nos 17 , le nom uta dérive du mot quechua hutu, qui<br />
signifie « ronger, concasser, pourrir ». Les Espagnols l’appe<strong>la</strong>ient<br />
« p<strong>la</strong>ie » sur le versant du Hual<strong>la</strong>ga, ainsi que « mal <strong>de</strong>s<br />
An<strong>de</strong>s ». D’autres expressions idiomatiques quechuas ou aymaras<br />
faisaient référence à cette pathologie : quecpo, en raison<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> croyance dans <strong>la</strong> ville d’Abancay que <strong>la</strong> brûlure du visage<br />
par le soleil ou le froid provoquait <strong>de</strong>s lésions favorisant l’apparition<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die ; le mot tiac-araña vient <strong>de</strong> <strong>la</strong> supposition<br />
que ces arthropo<strong>de</strong>s domestiques léchaient pendant <strong>la</strong> nuit<br />
<strong>la</strong> peau du visage et <strong>de</strong>s mains comportant <strong>de</strong>s restes <strong>de</strong> miel,<br />
et que <strong>la</strong> leishmaniose débutait <strong>de</strong> cette manière; jucuya, kjapa<br />
et anti-honcoy 18 sont d’autres termes utilisés régionalement.<br />
Plus tard, <strong>la</strong> tendance s’accentua : on appe<strong>la</strong> uta <strong>la</strong> leishmaniose<br />
du nord du pays et espundia celle du sud du Pérou.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Ancienneté <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire au Pérou<br />
Les chercheurs étudiant actuellement <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire<br />
au Pérou considèrent qu’il s’agit d’une affection qui<br />
précéda l’arrivée <strong>de</strong>s Espagnols. Pour <strong>la</strong> plupart d’entre eux,<br />
les lésions muti<strong>la</strong>ntes représentées sur certains huacos anthropomorphes<br />
péruviens <strong>de</strong> l’ère précolombienne en sont <strong>la</strong><br />
preuve évi<strong>de</strong>nte. L’i<strong>de</strong>ntification étiologique <strong>de</strong> ces représentations<br />
entraîna <strong>de</strong> nombreuses discussions ; l’historien naturaliste<br />
espagnol Marcos Jiménez <strong>de</strong> <strong>la</strong> Espada, cité par Tamayo<br />
en 1905 19 , qui recueillit et fit sienne cette approche, associa le<br />
premier ces représentations à l’uta. Dans son analyse historique<br />
<strong>de</strong> l’uta, Urcia 20 soutint en 1913 son ancienneté précolombienne<br />
en se basant sur les représentations <strong>de</strong>s huacos et<br />
sur les notes, très précoces, que les Espagnols firent <strong>de</strong> cette<br />
ma<strong>la</strong>die ; il cita Pedro Pizarro, qui fit référence au « mal incurable<br />
<strong>de</strong>s nez » en 1571, et le Dr Cosme Bueno, par<strong>la</strong>nt d’une<br />
« p<strong>la</strong>ie corrosive notamment du visage très difficile à soigner,<br />
causée par un insecte, qui s’appelle uta ».<br />
Weiss soutint en 1943 9 l’ancienneté <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire<br />
sur notre territoire en se basant, outre les arguments précé<strong>de</strong>nts, sur le caractère<br />
bénin <strong>de</strong> l’uta (tendance à <strong>la</strong> guérison spontanée en un an environ). Herrer<br />
affirma en 1956 21 : « Sans nier <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> ancienneté <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die en Amérique, nous<br />
croyons qu’il est difficile <strong>de</strong> <strong>la</strong> prouver, et le principal argument invoqué jusqu’à présent<br />
en sa faveur, soit les huacos anthropomorphes représentant <strong>de</strong>s muti<strong>la</strong>tions sur les<br />
349<br />
Figure 25.<br />
Leishmaniose andine<br />
Figure 26.<br />
Leishmaniose <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt<br />
Figure 27.<br />
Leishmaniose<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt cutanéomuqueuse<br />
tardive
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
350<br />
lèvres et le nez, renferme <strong>de</strong>s objections assez sérieuses. » Parmi ces objections, on ne<br />
peut pas affirmer que les huacos proviennent d’endroits proches <strong>de</strong>s foyers d’uta; certains<br />
d’entre eux présentent <strong>de</strong>s muti<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s extrémités sous une forme et un aspect<br />
différents <strong>de</strong>s lésions provoquées par l’uta; les figures montrent une cloison nasale entière<br />
et parfois augmentée, contrairement à ce qui arrive dans les cas <strong>de</strong> leishmaniose ;<br />
les figures ne représentent pas <strong>de</strong> lésions sur les pavillons auricu<strong>la</strong>ires, p<strong>la</strong>ie propre à <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die qui ne serait pas passée inaperçue aux yeux <strong>de</strong>s potiers précolombiens. Au<br />
contraire, ce chercheur fournit <strong>de</strong>s considérations basées sur <strong>la</strong> répartition géographique<br />
<strong>de</strong> l’uta, qui pourraient indiquer son ancienneté notable.<br />
Comme nous le voyons, les arguments utilisés peuvent être discutables, mais il est évi<strong>de</strong>nt<br />
que tout le mon<strong>de</strong> est d’accord pour admettre l’ancienneté <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose au<br />
Pérou.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification étiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire au Pérou<br />
Le Dr José Julián Bravo peut être mentionné comme précurseur <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification<br />
étiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire dans notre milieu ; cité par Weiss 9 , il i<strong>de</strong>ntifia<br />
en 1852 l’uta au bouton d’Alep. Toutefois, en accord avec Urcia 20 , ces lésions furent<br />
cataloguées comme étant <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> tuberculose cutanée en raison <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong><br />
Smith Archibald. Cette théorie sur l’origine lupique, Palma 22 démontrant que <strong>la</strong> tuberculose<br />
n’intervenait pas dans sa détermination, fut en vigueur jusqu’en 1908. Cependant,<br />
Escomel 23 communiqua en 1911 <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme f<strong>la</strong>gellée <strong>de</strong> Leishmanies dans<br />
un cas d’espundia. Laveran et Nattan Larrere trouvèrent <strong>de</strong>s Leishmanies se rapportant<br />
à <strong>de</strong>s cas d’espundia dans du matériel fourni par Escomel. En 1912, Wenyon 24 fit <strong>de</strong>s découvertes<br />
simi<strong>la</strong>ires qui l’amenèrent à penser que l’espundia était une leishmaniose. En<br />
1913, Vélez et Monge 25 prouvèrent l’étiologie leishmaniosique <strong>de</strong> processus ulcéreux<br />
dans <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> Convención (Cuzco). Simultanément Gastiaburú et Rebagliati 26 trouvèrent<br />
<strong>de</strong>s Leishmanies dans <strong>de</strong>s cas d’uta. Finalement, suite à l’obtention <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme f<strong>la</strong>gellée<br />
et aux résultats positifs constatés après <strong>de</strong>s inocu<strong>la</strong>tions chez <strong>de</strong>s animaux, <strong>la</strong><br />
commission <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Harvard conclut dans un rapport publié par Strong en<br />
1914 que l’uta était une leishmaniose 27 .<br />
Le problème <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification étiologique <strong>de</strong>s leishmanioses tégumentaires au Pérou<br />
fut ainsi résolu, aussi bien pour sa variété cutanée pure (uta) que pour <strong>la</strong> forme cutanéomuqueuse<br />
(espundia).<br />
Quelques considérations autour <strong>de</strong> l’écologie, l’épidémiologie et l’histoire <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
vecteurs, <strong>de</strong>s réservoirs et du traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire au Pérou<br />
Plusieurs chercheurs contribuèrent à <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition géographique<br />
<strong>de</strong> cette affection au Pérou ; nous distinguerons parmi eux, par ordre chronologique : Raimondi<br />
en 1885 28 , Pagaza en 1904 29 , Escomel en 1911 30 , Urcia en 1913 20 , Weiss, Rojas et<br />
Guzmán-Barrón en 1924 31 , Kuczynski-Godard en 1945 34 , Marroquín en 1950 32 , Cornejo<br />
Ubillus en 1951 10 , plusieurs communications <strong>de</strong> Herrer, <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé,<br />
<strong>de</strong>puis 1951 33 , Acurio et Valdieso en 1964 35 , Burstein en 1964 13 , plusieurs travaux <strong>de</strong> Tejada<br />
publiés à partir <strong>de</strong> 1970 36 et bien d’autres étu<strong>de</strong>s plus récentes <strong>de</strong> divers chercheurs.<br />
Quant aux espèces vecteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire au Pérou, les étu<strong>de</strong>s ne<br />
furent pas encore complétées <strong>de</strong> preuves expérimentales décisives permettant d’affirmer<br />
quelles espèces <strong>de</strong> Phlebotomus (Lutzomyias) servaient <strong>de</strong> vecteurs à <strong>la</strong> Leishmanie. En<br />
1943, Pesce et Pardo 37 trouvèrent dans <strong>la</strong> province d’Andahuay<strong>la</strong>s (<strong>la</strong> zone endémique <strong>de</strong><br />
l’uta) <strong>de</strong>ux espèces <strong>de</strong> Plebotomus c<strong>la</strong>ssifiés par Hertig comme Ph. battistini (Hertig, 1943).<br />
Étudiant le rapport entre <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire et le Phlebotomus, Herrer 38<br />
considéra en 1951 que, sur le versant occi<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s, le Ph. verrucorum et le Ph.<br />
peruensis avaient un lien très étroit avec <strong>la</strong> répartition géographique <strong>de</strong> l’uta. Ce
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
chercheur nous informa personnellement qu’« en ce qui concerne <strong>la</strong> transmission naturelle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire il existe une confusion notable. Par exemple, on<br />
indique fréquemment les espèces <strong>de</strong> Lutzomyia comme en étant les vecteurs, uniquement<br />
parce qu’elles manifestent <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> promastigotes (leptomonas), sans i<strong>de</strong>ntifier<br />
dûment le f<strong>la</strong>gellé en question ». En accord avec cette opinion, Laison et Show 39<br />
signalèrent qu’une gran<strong>de</strong> quantité d’infections naturelles dues au f<strong>la</strong>gellé furent observées<br />
parmi <strong>de</strong>s phlébotomes capturés dans <strong>la</strong> nature; cependant les parasites i<strong>de</strong>ntifiés<br />
positivement comme Leishmanies ne furent rencontrés que dans un petit nombre <strong>de</strong> ces<br />
f<strong>la</strong>gellés. Une analyse critique rigoureuse et très minutieuse du problème <strong>de</strong> ces auteurs<br />
indiqua également que les Lutzomyias infectées ne sont pas anthropophiles, et donc ne<br />
se transmettent pas à l’homme ; <strong>la</strong> chaîne épidémiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose humaine<br />
nécessite l’intervention d’espèces <strong>de</strong> Phlebotomus anthropophiles.<br />
Herrer fut l’un <strong>de</strong>s premiers à préparer et à publier, au Pérou et à l’étranger, l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> présence et <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition du Lutzomyia en général et notamment <strong>de</strong> ceux qui<br />
jouent un rôle <strong>de</strong> vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire; il fut suivi par les biologistes<br />
Drs Bertha L<strong>la</strong>nos et Abraham Cáceres, <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et <strong>de</strong> l’institut<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión <strong>de</strong> l’UNMSM. Abe<strong>la</strong>rdo Tejada, son directeur actuel,<br />
fit aussi <strong>de</strong> nombreuses recherches sur le sujet.<br />
Pour l’heure, il était impossible <strong>de</strong> détecter précisément les réservoirs du parasite<br />
pouvant expliquer <strong>de</strong> manière satisfaisante l’endémie qui se maintenait <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s<br />
époques lointaines.<br />
Lors <strong>de</strong> son étu<strong>de</strong> sur l’uta (alors appelée lupus) au Pérou en 1886 40 , Ugaz mit en évi<strong>de</strong>nce<br />
une <strong>de</strong>s idées les plus répandues chez les habitants <strong>de</strong>s zones infectées par l’uta<br />
les vil<strong>la</strong>ges <strong>de</strong> Cajamarca, Huamachuco, Ancash, Cerro <strong>de</strong> Pasco, Valle <strong>de</strong>l Rimac et Ayacucho<br />
: les moustiques qui les piquaient le soir jouaient pour eux un rôle important dans<br />
<strong>la</strong> formation du mal ulcéreux ; ces insectes s’étaient nourris <strong>de</strong> « jus d’animaux en putréfaction,<br />
notamment <strong>de</strong>s serpents », et l’inocu<strong>la</strong>ient ensuite à leurs victimes ; ils pensaient<br />
aussi aux petites mouches à ailes b<strong>la</strong>nches vivant à l’ombre du huarango (Acacia<br />
punctata) à Cajamarca, dont elles inocu<strong>la</strong>ient le jus résineux.<br />
À Cuzco, une croyance assurait que le « lèchement d’une araignée » provoquait <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die. À Cajamarca, on attribuait un rôle important à « l’antimoine qui se soulève du<br />
sol sec et chaud <strong>de</strong>s torrents par les premières pluies <strong>de</strong> Carême ». On attribua également<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die aux eaux <strong>de</strong> mauvaise qualité (La Libertad). En 1913 20 Urcia reprit les<br />
conclusions du Dr Barranca dans lesquelles il rapportait <strong>la</strong> croyance que « l’Indien<br />
contracte <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die lorsqu’il boit et qu’il mouille le bout <strong>de</strong> son nez ». Urcia par<strong>la</strong> aussi<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> croyance en l’existence d’animaux ou <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes qui <strong>de</strong> manière directe ou indirecte,<br />
par les piqûres ou <strong>la</strong> contagion, inocu<strong>la</strong>ient le germe <strong>de</strong> l’uta; il se penchait sur<br />
l’idée que l’eau stagnante pouvait contenir soit les germes producteurs, soit les œufs ou<br />
les <strong>la</strong>rves <strong>de</strong>s insectes. Il décrivit en détail un insecte qu’il estima être le vecteur <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die en faisant référence bien évi<strong>de</strong>mment au Phlebotomus, « qu’on prétend nommer<br />
titira lorsque son nom est uta ».<br />
En 1914, Antúnez 41 signa<strong>la</strong> <strong>la</strong> présence constante d’un arbuste appelé mith à l’endroit<br />
où les infections d’uta étaient connues et dangereuses : « L’uta provoque une épidémie<br />
uniquement pendant les mois <strong>de</strong> février, mars et avril, justement pendant l’époque <strong>de</strong><br />
fructification du mith, et elle disparaît lorsque les fruits sont gâtés. L’uta s’acharne sur<br />
l’individu qui aime manger le fruit au pied <strong>de</strong>s arbustes ou sur celui qui habite les environs.<br />
Il suffit, non pas <strong>de</strong> s’approcher pour manger le fruit, mais seulement <strong>de</strong> rester à<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> dangereuse dans un rayon d’environ <strong>de</strong>ux kilomètres <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone où se trouvent<br />
les miths » ; il attribua <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die à un « moustique à <strong>la</strong> tête b<strong>la</strong>nche qui aime le<br />
fruit du mith ».<br />
351
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
352<br />
En 1930, Maldonado 42 dit textuellement :<br />
À Surco, un foyer important <strong>de</strong> verrue et d’uta, j’eus l’occasion <strong>de</strong> constater un élément<br />
caractéristique dans <strong>la</strong> flore spontanée : <strong>la</strong> Jatropha macrantha Müll. Arg., une<br />
p<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille <strong>de</strong>s euphorbiacées connue sous le nom vulgaire <strong>de</strong> huanarpo femelle<br />
[…] L’existence <strong>de</strong> cette p<strong>la</strong>nte permet <strong>de</strong> soupçonner qu’elle joue un rôle dans<br />
l’étiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose du <strong>de</strong>rme, connue sous le nom vulgaire d’uta, car on<br />
trouva dans le <strong>la</strong>tex d’une gran<strong>de</strong> quantité d’euphorbiacées <strong>de</strong>s protozoaires parasites<br />
qui, peut-être, peuvent être considérés comme <strong>de</strong>s états évolutifs <strong>de</strong> l’agent <strong>de</strong><br />
ce type d’ulcère. Puisque <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> Surco est un foyer <strong>de</strong> verrue, on peut affirmer<br />
qu’il y existe <strong>de</strong>s Phlebotomus, connus sous le nom vulgaire <strong>de</strong> titiras, dont une espèce<br />
peut être vecteur <strong>de</strong> l’uta, le huanarpo femelle étant éventuellement le réservoir<br />
<strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die si désagréable.<br />
En 1934, Sal y Rosas 43 reprit l’approche phytogénétique <strong>de</strong> l’uta, montrant encore<br />
une fois que le mith (Carica candicans), une p<strong>la</strong>nte <strong>la</strong>ctescente <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille <strong>de</strong>s euphorbiacées,<br />
était un élément récurrent dans toute <strong>la</strong> région endémique, n’apparaissant plus<br />
à l’endroit où finissait le périmètre pathologique <strong>de</strong> l’uta. Il affirma même que <strong>la</strong> concomitance<br />
du mith et <strong>de</strong> l’uta était tellement constante que son absence « marque c<strong>la</strong>irement<br />
<strong>la</strong> limite <strong>de</strong> <strong>la</strong> ceinture <strong>de</strong> l’uta, un signe très précis pour délimiter dans les endroits<br />
non peuplés <strong>la</strong> zone endémique <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone in<strong>de</strong>mne ». Selon l’expérience popu<strong>la</strong>ire, le<br />
mith est accompagné du huanarpo (Jatropha macrantha), car là où il y a du mith se<br />
trouve l’uta. Sal y Rosas supposa qu’une partie du cycle évolutif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Leishmanie se produisait<br />
dans <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nte et il soutint <strong>la</strong> « formule <strong>de</strong> l’utogénèse » suivante : 1. flore xérophile<br />
et <strong>la</strong>ctescente qui sert <strong>de</strong> réservoir au virus ; 2. un vecteur ailé et hématophage, le<br />
Phlebotomus ; 3. l’homme. Il concluait en proposant <strong>la</strong> <strong>de</strong>struction systématique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
flore xérophile <strong>la</strong>ctescente.<br />
Cette approche fut remise en question par Burstein, qui communiqua en 1956 et en<br />
1957 <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> phythormones dans le <strong>la</strong>tex <strong>de</strong> <strong>la</strong> Jatropha macrantha Müll. Arg.,<br />
une p<strong>la</strong>nte euphorbiacée dont <strong>la</strong> répartition géographique coïnci<strong>de</strong> avec <strong>la</strong> distribution<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire andine cutanée pure (uta), dans <strong>la</strong> vallée du Rimac. Ces<br />
phythormones furent isolées du <strong>la</strong>tex dans leur phase f<strong>la</strong>gellée (leptomonas) et cultivées<br />
dans <strong>de</strong>s milieux qui contenaient du sang humain, reproduisant ainsi <strong>la</strong> phase <strong>de</strong> Leishmanie.<br />
Burstein démontra encore <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> récupérer pendant un temps re<strong>la</strong>tivement<br />
long <strong>de</strong>s Leishmanies pathogènes pour l’homme et d’autres germes incorporés in<br />
vitro au <strong>la</strong>tex <strong>de</strong> ces p<strong>la</strong>ntes euphorbiacées, connues dans <strong>la</strong> région sous le nom <strong>de</strong> huanarpos,<br />
prouvant ainsi que ces p<strong>la</strong>ntes pouvaient être <strong>de</strong>s réservoirs <strong>de</strong> Leishmanies pathogènes<br />
et d’autres microorganismes dans les zones endémiques.<br />
La recherche sur les animaux naturellement infectés et susceptibles d’être <strong>de</strong>s réservoirs<br />
semble avoir débuté en 1924, à travers les travaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission désignée par<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> salubrité du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé afin d’étudier <strong>la</strong> région Madre <strong>de</strong><br />
Dios. Les Drs Pedro Weiss, H. Rojas et Alberto Guzmán Barrón 31 faisaient partie <strong>de</strong> cette<br />
commission qui étudia 750 animaux (<strong>de</strong>s singes, <strong>de</strong>s rongeurs, entre autres) sans trouver<br />
<strong>de</strong> traces d’infection. Herrer fut le premier à parler <strong>de</strong> l’infection naturelle chez <strong>de</strong>s<br />
animaux dans notre environnement; lors <strong>de</strong> ses communications dans les années 1948 46<br />
et 1951 47 , il exposa ses recherches, réalisées <strong>de</strong>puis 1941 dans les localités <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée<br />
du Rimac infectées par l’uta. Il examina <strong>de</strong>s chiens, <strong>de</strong>s chats, <strong>de</strong>s ânes, <strong>de</strong>s chevaux,<br />
<strong>de</strong>s rongeurs du genre Phyllotis et Orysomis, <strong>de</strong>s renards et une sorte <strong>de</strong> marsupial<br />
connu sous le nom <strong>de</strong> muca, et il obtint une preuve parasitologique d’infection <strong>de</strong> leishmaniose<br />
sur 46 <strong>de</strong>s 513 chiens étudiés. Il remarqua que l’inci<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> l’infection conservait<br />
un parallélisme fort avec celle <strong>de</strong> l’uta chez l’homme, observant une coexistence <strong>de</strong><br />
lésions chez les chiens et chez les hommes. Les animaux infectés (sauf un seul cas)
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
étaient restés un temps assez court dans les localités propices à <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> l’uta.<br />
Cet auteur soupçonna le renard d’être un réservoir probable étant donné sa sensibilité à<br />
l’infection expérimentale <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose, même si l’infection naturelle ne fut pas<br />
prouvée, ni chez les autres animaux examinés à l’époque.<br />
En 1950 32 , Marroquín considéra que l’homme pouvait être un réservoir <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
soit dans le cas d’une infection active ou d’une convalescence, soit qu’il s’agisse d’un porteur<br />
sain, en prenant comme base <strong>la</strong> conception <strong>de</strong> Weiss 9 : le germe peut subsister longtemps<br />
dans <strong>la</strong> peau, <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die se manifestant à l’occasion d’un traumatisme.<br />
La possibilité que l’homme soit le réceptacle décisif pour expliquer l’endémie est<br />
discutable. La possibilité que le chien qui accompagne toujours l’homme, en soit un<br />
autre l’est tout autant. En étudiant l’épidémiologie <strong>de</strong> l’uta, Herrer dit en 1951 33 : « Il<br />
existe <strong>de</strong>s endroits inhabités et exempts <strong>de</strong> toute culture où <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die peut toutefois<br />
être contractée. Ce phénomène est si fréquent que les éleveurs le connaissent bien ; ils<br />
appellent même ces endroits par <strong>de</strong>s noms très expressifs tels que l<strong>la</strong>gay-puquio, l<strong>la</strong>gay-cueva,<br />
l<strong>la</strong>gay-pampa, c’est-à-dire sources, grottes et p<strong>la</strong>ines où l’on peut attraper<br />
<strong>la</strong> leishmaniose. Cette caractéristique est sans doute liée à <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> quelque animal<br />
sauvage agissant comme réservoir. »<br />
Certains chercheurs <strong>de</strong> divers pays constatèrent <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> Leishmanies chez plusieurs<br />
mammifères sauvages. Au début, on considéra que <strong>la</strong> leishmaniose était une zoonose,<br />
mais ensuite il fut prouvé que dans plusieurs cas les foyers <strong>de</strong> leishmaniose animale<br />
n’avaient aucun rapport avec l’homme si les vecteurs n’étaient pas anthropophiles. La<br />
transmission est souvent occasionnelle si l’homme fait irruption par acci<strong>de</strong>nt dans un foyer<br />
<strong>de</strong> leishmaniose animale; ceci mena Laison et Show 39 à affirmer que « l’homme <strong>de</strong>vrait être<br />
perçu comme un hôte acci<strong>de</strong>ntel qui ne joue aucun rôle important dans le maintien <strong>de</strong>s parasites<br />
dans <strong>la</strong> nature ».<br />
Le bi<strong>la</strong>n du traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion souffrant <strong>de</strong> leishmaniose au Pérou est décourageant,<br />
surtout pour les formes malignes cutanéo-muqueuses ; les agents thérapeutiques<br />
dont on dispose sont insuffisants, et <strong>la</strong> situation sociale et économique <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s est précaire. Cette pathologie touche les secteurs les plus démunis <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion,<br />
et les lésions muti<strong>la</strong>ntes et déformantes provoquent leur marginalisation sociale.<br />
Le tartare émétique, introduit au Brésil par Viana en 1912 et employé par Julián Arce<br />
pour <strong>la</strong> première fois au Pérou en 1915, fut l’un <strong>de</strong>s premiers recours thérapeutiques<br />
pharmacologiques utilisés pour le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose tégumentaire. En 1916,<br />
Escomel 48 publia ses expériences avec ce traitement. Pour les cas cutanés, il avait <strong>de</strong>s résultats<br />
favorables, mais l’action était uniquement palliative ou complètement inefficace<br />
pour les formes cutanéo-muqueuses.<br />
À cause <strong>de</strong> sa forte toxicité, le tartare émétique fut remp<strong>la</strong>cé par d’autres antimoniaux<br />
trivalents à l’origine (intramuscu<strong>la</strong>ires comme le neo-antimosan « Repodral »,<br />
« Fuadina ») et pentavalents par <strong>la</strong> suite (« Neoestibosan » et « Solustibosan », retirés<br />
du marché par les fabricants car ils ne convenaient pas à leurs intérêts) ; il ne resta que<br />
le « Glucantime », utilisé <strong>de</strong> façon intramuscu<strong>la</strong>ire ou endoveineuse avec <strong>de</strong>s résultats<br />
curatifs dans les phases initiales ou dans les formes pures <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, mais dont <strong>la</strong> réponse<br />
était irrégulière pour les formes cutanéo-muqueuses.<br />
L’amphotéricine B (« Fungisone ») endoveineuse, employé à l’origine (1966) au Pérou<br />
par Zegarra Araujo 49 , procura <strong>de</strong>s avantages thérapeutiques pour les formes cutanéomuqueuses<br />
(espundia) <strong>de</strong> leishmaniose péruvienne, malgré sa néphrotoxicité prononcée.<br />
On étudie actuellement les p<strong>la</strong>ntes médicinales dont faisaient usage les Péruviens pour<br />
soigner cette ma<strong>la</strong>die tenter d’en extraire, les principes actifs susceptibles d’être utiles du<br />
point <strong>de</strong> vue thérapeutique. Ces recherches ont lieu <strong>de</strong>puis 2003 grâce à une convention<br />
conclue entre le Pérou et le Japon. Le groupe <strong>de</strong> chercheurs, intégré par <strong>de</strong>s Péruviens et<br />
<strong>de</strong>s Japonais, est dirigé pour <strong>la</strong> partie péruvienne par les Drs Fernando Cabieses (recteur<br />
<strong>de</strong> l’université scientifique du sud, Lima) et Zuño Burstein (UNMSM), et compte sur <strong>la</strong><br />
353
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
354<br />
col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión <strong>de</strong> l’UNMSM (à travers<br />
son directeur, le Dr Abe<strong>la</strong>rdo Tejada, et le Dr Olga Pa<strong>la</strong>cios) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> pharmacie<br />
et <strong>de</strong> biochimie <strong>de</strong> l’UNMSM (Drs Bertha Pareja et Diana Flores).<br />
La légis<strong>la</strong>tion péruvienne se rapportant à <strong>la</strong> santé (décret suprême nº 007-75-TR,<br />
26 août 1975) mentionne que <strong>la</strong> leishmaniose muco-cutanée sud-<strong>américaine</strong> (uta et espundia)<br />
est une ma<strong>la</strong>die professionnelle chez les travailleurs migrant vers les zones endémiques.<br />
La résolution suprême nº 063-75-TR (11 septembre 1975) nomma une<br />
commission chargée d’é<strong>la</strong>borer le règlement <strong>de</strong>s conditions d’hygiène et <strong>de</strong> sécurité pour<br />
les milieux professionnels proches <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> leishmaniose endémiques, afin <strong>de</strong> protéger<br />
les travailleurs. Cette commission était intégrée, entre autres, par les Drs Arísti<strong>de</strong>s<br />
Herrer et Zuño Burstein, représentant l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
La résolution suprême nº 026-76-TR (21 octobre <strong>de</strong> 1976) 50 approuva le règlement<br />
<strong>de</strong>s conditions d’hygiène et <strong>de</strong> sécurité, qui comporte cinq titres et cinquante-<strong>de</strong>ux articles.<br />
La résolution, signée par le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République et ratifiée par les ministres<br />
du Travail et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, comprend <strong>de</strong>s généralités, <strong>de</strong>s objectifs, <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s entreprises,<br />
<strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s travailleurs, <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> protection collectives et individuelles<br />
(sans négliger les campements permanents et provisionnels installés dans les<br />
zones endémiques), <strong>de</strong>s examens médicaux, le diagnostic <strong>de</strong>s cas suspects, <strong>la</strong> notification,<br />
le registre et le traitement ; ce chapitre signale d’une part que, dans tous les cas diagnostiqués<br />
<strong>de</strong> leishmaniose, <strong>la</strong> notification obligatoire sera établie dans son registre, en<br />
accord avec les dispositions du système national <strong>de</strong> notifications <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies transmissibles<br />
et, d’autre part, que les cas <strong>de</strong> leishmaniose contractée sur les lieux <strong>de</strong> travail seront<br />
pris en charge (traitement et autres) par <strong>la</strong> sécurité sociale du Pérou, selon les<br />
normes légales en vigueur. Finalement, <strong>de</strong>s sanctions furent établies pour les entreprises<br />
ou les employés qui ne respecteraient pas ce règlement.<br />
LA MALADIE DE CARRIÓN (VERRUE PÉRUVIENNE)<br />
Généralités<br />
Daniel A. Carrión était un étudiant en mé<strong>de</strong>cine qui se sacrifia héroïquement en s’inocu<strong>la</strong>nt<br />
volontairement le spécimen du bouton verruqueux et mourut à cause du processus<br />
systémique en 1885. Il aida <strong>de</strong> cette manière à consoli<strong>de</strong>r le concept d’unité entre <strong>la</strong><br />
phase fébrile anémique (« fièvre d’Oroya ») et <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> éruptive (« verrue péruvienne »)<br />
<strong>de</strong> cette affection, considérée par les dualistes comme <strong>de</strong>ux ma<strong>la</strong>dies différentes.<br />
La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrión, ou verrue péruvienne, est une bartonellose humaine, un processus<br />
infectieux général, bactérien, non contagieux, produit par <strong>la</strong> Bartonel<strong>la</strong> bacilliformis,<br />
qui est transmise par un vecteur ailé (Phlebotomus verrucarum). Il s’agit d’une<br />
ma<strong>la</strong>die endémique, propre aux zones bien circonscrites <strong>de</strong> certaines régions andines du<br />
Pérou et constatée dans quelques foyers en Équateur et en Colombie. Du point <strong>de</strong> vue clinique,<br />
elle présente un premier sta<strong>de</strong> qui peut passer inaperçu, sans aucun symptôme,<br />
pour <strong>de</strong>s causes diverses, mais fait habituellement p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> phase fébrile anémique, très<br />
grave, entraînant <strong>la</strong> mort par anémie sévère et un tableau toxique et infectieux, anciennement<br />
appelé « fièvre d’Oroya ». Si le patient survit à cette phase, après une pério<strong>de</strong><br />
d’une durée variable, le <strong>de</strong>uxième processus éruptif apparaît alors, caractérisé par une<br />
poussée verruqueuse (angiomateuse) d’ampleur variée, qui provoque <strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> taille<br />
et <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur différentes et dont <strong>la</strong> localisation peut compromettre, outre <strong>la</strong> peau, les<br />
organes internes. L’involution spontanée conduit à un état d’immunité permanente.<br />
Le pronostic est mauvais si on respecte l’évolution spontanée <strong>de</strong> <strong>la</strong> forme sévère <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> fébrile anémique, mais il est habituellement bon, même au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong><br />
poussée, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> éruptive. La mort pendant le premier sta<strong>de</strong> se produit soit par<br />
anémie sévère, soit par complication <strong>de</strong> salmonellose fréquente au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
intermédiaire. La ma<strong>la</strong>die répond favorablement aux antibiotiques antibactériens ;
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
il n’existe pas <strong>de</strong> vaccin contre cette ma<strong>la</strong>die. Elle représente un risque épidémique<br />
lorsque <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion non immunisée est transférée vers <strong>de</strong>s régions endémiques ; en <strong>de</strong>hors<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone endémique le processus n’est pas propagé (figures 28, 29, 30).<br />
<strong>Histoire</strong><br />
La verrue péruvienne est une ma<strong>la</strong>die autochtone <strong>américaine</strong>, proprement péruvienne,<br />
dont l’ancienneté précolombienne est discutable. Les représentations <strong>de</strong> <strong>la</strong> céramique mochica<br />
51 , les récits <strong>de</strong>s chroniqueurs <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s et d’autres preuves font penser à Lastres 52<br />
que <strong>la</strong> verrue exista toujours aux mêmes endroits où elle se présente aujourd’hui (géographiquement<br />
par<strong>la</strong>nt), notamment dans les torrents; l’indigène utilisait le mot quechua sirki<br />
pour <strong>la</strong> nommer. L’intérêt scientifique <strong>de</strong> son étu<strong>de</strong> fut principalement éveillé à partir <strong>de</strong><br />
1870, à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> <strong>la</strong> construction du chemin <strong>de</strong> fer reliant Lima à La Oroya à travers les<br />
An<strong>de</strong>s. Une grave épidémie se produisit au niveau du tronçon qui traverse <strong>la</strong> zone infestée<br />
<strong>de</strong> verrues <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée du Rimac; selon quelques affirmations, l’épidémie tua 7000 ouvriers<br />
et les 100 ingénieurs britanniques et américains qui participaient à <strong>la</strong> construction.<br />
Tous furent contaminés et <strong>la</strong> moitié mourut. Le rapport nosographique <strong>de</strong>s manifestations<br />
graves <strong>de</strong> cette épidémie, appelée « fièvre d’Oroya » avec <strong>la</strong> poussée cutanée que présentaient<br />
les survivants (connue comme « verrue péruvienne ») fut établi progressivement; le<br />
sacrifice héroïque <strong>de</strong> Daniel A. Carrión aida à le prouver.<br />
La communauté scientifique mondiale s’intéressa à cette affection mystérieuse et bizarre,<br />
qui fut étudiée exhaustivement dans ses aspects cliniques, épidémiologiques, éthiopathogéniques,<br />
expérimentaux et thérapeutiques par plusieurs chercheurs péruviens et<br />
étrangers. C’est ainsi qu’en 1898, Odriozo<strong>la</strong> 53 publia une monographie considérée comme<br />
l’une <strong>de</strong>s meilleures contributions à l’étu<strong>de</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Barton 54 découvrit en<br />
1905 le microorganisme causal. Strong 55 , qui présidait <strong>la</strong> commission <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong><br />
Harvard venue au Pérou afin d’étudier l’affection, créa en 1913 le genre bartonel<strong>la</strong>, utilisant<br />
le nom Bartonel<strong>la</strong> bacilliformis pour désigner le microorganisme causal découvert<br />
par Barton. En 1913, Ch Townsend 56 découvrit le Phlebotomus verrucarum et établit qu’il<br />
transmettait <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Plusieurs chercheurs comme Maldonado A., Hertig M., Herrer A.,<br />
Rebagliati R. et Gorbitz G. entre autres, étudièrent le panorama épidémiologique et les<br />
mesures <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Carrión.<br />
Hors du Pérou, il faut mentionner Patiño Camargo, qui étudia en 1939 57 un foyer endémique<br />
dans le département <strong>de</strong> Marino, à <strong>la</strong> frontière avec l’Équateur. Pour leur part,<br />
Montalbán et Moral, en coordination avec Hertig, étudièrent en 1940 le foyer endémique<br />
équatorien <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Loja, près <strong>de</strong> <strong>la</strong> frontière péruvienne. Après Odriozo<strong>la</strong>,<br />
d’autres chercheurs apportèrent leurs connaissances à l’étiopathogénie <strong>de</strong>s manifestations<br />
cliniques et pathologiques <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die, à son évolution et à sa thérapeutique.<br />
355<br />
Figure 28.<br />
Verrue péruvienne –<br />
partie I<br />
Figure 29.<br />
Verrue péruvienne –<br />
partie II<br />
Figure 30.<br />
Verrue péruvienne :<br />
pério<strong>de</strong> éruptive
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
356<br />
Notons les travaux d’Arce, d’Escomel, <strong>de</strong> Strong, d’Hurtado, <strong>de</strong> Monge, <strong>de</strong> Mackehenie,<br />
<strong>de</strong> Weiss, d’Urteaga, <strong>de</strong> Gastiaburú, <strong>de</strong> Reynafarje et <strong>de</strong> tant d’autres. Après Barton et<br />
Strong, l’étu<strong>de</strong> bactériologique fut développée dans ses aspects morphologiques et culturels<br />
par Battistini, Hercelles, Aldana et Colichón. En ce qui concerne l’ultrastructure<br />
avec microscope électronique, citons Peters et Wiegand, Pérez Alva, Cuadra et Takano.<br />
Les étu<strong>de</strong>s immunologiques, comme celles menées par Cal<strong>de</strong>rón Howe, furent poursuivies<br />
même <strong>de</strong> manière très sporadique (sur les aspects <strong>de</strong> l’immunité humorale et cellu<strong>la</strong>ire)<br />
à l’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo (Larrea et Contreras) et à l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
Daniel A. Carrión (A. Colichón).<br />
Malgré les nombreuses recherches qui dévoilèrent en gran<strong>de</strong> partie les aspects pratiques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die liés à <strong>la</strong> santé publique (<strong>la</strong> rendant contrô<strong>la</strong>ble du point <strong>de</strong> vue épidémiologique<br />
et thérapeutique grâce à <strong>la</strong> connaissance plus ou moins précise <strong>de</strong> son<br />
écologie, sa distribution géographique, ses caractéristiques cliniques, son diagnostic et<br />
son traitement étiologique, ainsi que du vecteur qui <strong>la</strong> transmet), plusieurs <strong>la</strong>cunes persistent<br />
sur le p<strong>la</strong>n scientifique ; elles ne pourront être élucidées que grâce à une recherche<br />
persévérante. On ignore, par exemple, quel est le réservoir exact ; savoir si son<br />
existence ou son cycle normal dans <strong>la</strong> nature nécessite <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> l’homme dans les<br />
zones endémiques, c’est-à-dire s’il s’agit d’une ma<strong>la</strong>die humaine ou si c’est, comme dans<br />
le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose (avec <strong>la</strong>quelle elle partage plusieurs aspects comme <strong>la</strong> répartition<br />
géographique et les mêmes vecteurs), une zoonose ou une phytoparasitose qui passe<br />
acci<strong>de</strong>ntellement à l’homme lorsque celui-ci fait irruption dans sa niche écologique, brisant<br />
les écosystèmes et créant un effet vicariant, est un mystère.<br />
Il n’y a pas d’animal reproduisant en <strong>la</strong>boratoire l’histoire naturelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
comme chez l’homme, ce qui permettrait son étu<strong>de</strong> intégrale sur un modèle expérimental.<br />
On ignore pourquoi, comme infection bactérienne générale, elle ne peut pas être inoculée<br />
à l’homme ou aux animaux <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire par du sang infecté au moment le plus<br />
virulent du germe afin d’obtenir, comme on pourrait l’espérer, <strong>la</strong> même manifestation<br />
pathologique. On étudie encore à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie actuelle le comportement immunologique<br />
<strong>de</strong> l’hôte, mais on ne dispose pas <strong>de</strong> procédure d’immunisation active qui<br />
protégerait <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> contagion.<br />
LA LÈPRE ET SON CONTRÔLE<br />
Introduction<br />
La lèpre n’existait pas en Amérique avant l’arrivée <strong>de</strong>s conquistadors européens. Les<br />
Espagnols apportèrent cette ma<strong>la</strong>die en Amérique centrale, en Amérique du Sud et au<br />
Mexique, ainsi que dans une partie <strong>de</strong>s États-Unis. Le premier <strong>la</strong>zaret fut fondé à Saint-<br />
Domingue en 1520 et d’autres léproseries furent établies par <strong>la</strong> suite dans toute l’Amérique<br />
coloniale. Au Brésil, les Portugais introduisirent <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die en 1496 ; les grands<br />
contingents d’esc<strong>la</strong>ves africains constituèrent un facteur déclenchant très important<br />
dans l’Amérique portugaise, les Caraïbes et l’Amérique centrale. En Amérique du Nord,<br />
outre les foyers apportés par les Espagnols, vinrent s’ajouter les foyers provenant principalement<br />
<strong>de</strong> France, <strong>de</strong> Norvège et <strong>de</strong> Chine.<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou<br />
Le Dr Hugo Pesce étudia exhaustivement l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou, sujet <strong>de</strong> sa thèse<br />
<strong>de</strong> doctorat en 1961, sous le nom <strong>de</strong> L’épidémiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou 58 . Dans ce travail<br />
monumental qui <strong>de</strong>vrait servir <strong>de</strong> source précieuse d’information pour les mé<strong>de</strong>cins et les<br />
personnels sanitaires péruviens, il affirme que <strong>la</strong> lèpre se développa indépendamment dans<br />
les trois gran<strong>de</strong>s régions <strong>de</strong> notre pays (<strong>la</strong> côte, <strong>la</strong> sierra et l’Amazonie). La présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
sur <strong>la</strong> côte est lointaine et rare, en Amazonie elle est récente et explosive, tandis que<br />
dans <strong>la</strong> sierra elle connut un développement diffus.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Les colons espagnols amenèrent <strong>la</strong> lèpre par <strong>la</strong> côte péruvienne, car leur pays<br />
connaissait une endémie considérable (environ 3 000 lépreux et <strong>de</strong>s douzaines <strong>de</strong> léproseries).<br />
Il fallut donc créer une léproserie à Lima, vingt-huit ans après sa fondation ; l’hôpital<br />
<strong>de</strong> San Lázaro fut inauguré en 1563, dans le quartier <strong>de</strong> Pescadores, sur <strong>la</strong> rive<br />
droite du fleuve Rímac, pour soigner les lépreux pendant l’époque coloniale.<br />
Selon Pesce, <strong>la</strong> lèpre apparut manifestement dans notre Amazonie au XX e siècle. Quant<br />
à sa provenance, <strong>la</strong> thèse <strong>la</strong> plus ancienne associe son origine au Brésil, tandis qu’une<br />
autre thèse revendique son origine équatorienne. La recherche <strong>de</strong> Ponce <strong>de</strong> León eut le<br />
mérite <strong>de</strong> prouver que l’infection lépreuse <strong>de</strong> certains secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt haute eut lieu<br />
avant celle <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt basse, et qu’elle eut très probablement une origine<br />
équatorienne pas très lointaine sans présenter <strong>de</strong> cas très nombreux. Pesce dit qu’« on ne<br />
peut pas comparer le danger d’un très petit foyer <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt haute avec le foyer brésilien,<br />
très effervescent en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> migration massive <strong>de</strong> 15 à 20000 Péruviens et <strong>de</strong><br />
quelques centaines <strong>de</strong> Brésiliens suite à l’essor du caoutchouc, qui dura vingt ans. »<br />
La popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt basse succomba à partir <strong>de</strong> 1910, lors <strong>de</strong> l’impact évi<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong>s foyers brésiliens massifs. Ceci fut probablement provoqué par les conditions environnementales<br />
diverses, et parce que l’habitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt haute était moins exposé à <strong>la</strong><br />
malnutrition, à l’hypoprotéinémie et aux helminthiases intestinales agressives, occasionnant<br />
un état anémique et une baisse du niveau <strong>de</strong> l’immunité physiologique générale.<br />
Les premiers cas <strong>de</strong> lèpre en Amazonie furent diagnostiqués entre 1901 et 1905 ; le<br />
17 mars 1905, une résolution suprême autorisa <strong>la</strong> construction à Iquitos d’un <strong>la</strong>zaret<br />
pour les lépreux du département <strong>de</strong> Loreto. Entre 1906 et 1907, <strong>la</strong> préfecture fit<br />
construire un hôpital d’urgences pour les lépreux à Is<strong>la</strong> Padre, en face <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d’Iquitos.<br />
Le <strong>de</strong>uxième <strong>la</strong>zaret y fut inauguré à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1917, tandis que <strong>la</strong> loi n° 5020 (28 janvier<br />
1925) créa une léproserie à San Pablo, sur les bords <strong>de</strong> l’Amazone vers <strong>la</strong> frontière<br />
brésilienne, qui entra en fonction le 15 mai 1926. En 1940, le gouvernement créa <strong>la</strong> supervision<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> Loreto et San Martín, qui changea vite <strong>de</strong> statut et <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> supervision<br />
du Nord-Est, à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> Maxime Kuczynski. Celui-ci fonda en 1941 un<br />
dispensaire antilépreux à Iquitos et reconstruisit ensuite l’asile <strong>de</strong> San Pablo comme une<br />
colonie agricole, parvenant à faire progresser <strong>de</strong> façon notable l’exploration <strong>de</strong>s rivières<br />
(notamment l’Ucayali) et réalisant plusieurs enquêtes léprologiques. La création du Service<br />
national antilépreux entraîna en 1944 <strong>la</strong> fondation, quelques mois après, du service<br />
antilépreux du Nord-Est, chargé d’inspecter <strong>la</strong> zone.<br />
Hugo Pesce affirma que le foyer <strong>de</strong> lèpre infantile <strong>de</strong> Loreto faisait partie <strong>de</strong>s foyers<br />
les plus sévères du mon<strong>de</strong>. Tous les renseignements correspondant aux formes cliniques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre infantile dans cette zone révélèrent un processus caractérisé par l’absence <strong>de</strong><br />
signes immunitaires chez <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion : l’endémie était assez récente, sévère et en développement.<br />
Selon Pesce, les premiers cas <strong>de</strong> lèpre observés en Amérique du Sud parmi<br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion originelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt furent rapportés par Maxime Kuczynski (tribus cambo<br />
et cocama) et par lui-même (tribu piro). Les cas successifs furent étudiés par H. Pesce et<br />
R. Montoya en 1953. Tous les cas constituaient <strong>de</strong>s formes extrêmement malignes révé<strong>la</strong>trices<br />
du risque grave et durable auquel s’exposerait toute <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion du Nord-Est<br />
si <strong>la</strong> lèpre pénétrait les tribus <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt. Ses habitants, estimés à 141 000, étaient éloignés<br />
<strong>de</strong> toute possibilité <strong>de</strong> contrôle sanitaire.<br />
<strong>Histoire</strong> du contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou<br />
Hugo Pesce détecta les premiers cas <strong>de</strong> lèpre andine à Andahuay<strong>la</strong>s et fonda en<br />
1937 le service antilépreux <strong>de</strong> Apurímac. Le 1 er janvier 1944, il créa <strong>la</strong> Campagne<br />
nationale antilépreuse (organisme sanitaire officiellement chargé <strong>de</strong> lutter contre<br />
cette ma<strong>la</strong>die dans le pays) ; ce fut ainsi que naquit, autour <strong>de</strong> ce maître, l’école léprologique<br />
péruvienne, <strong>la</strong> même année <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation du service antilépreux du<br />
Nord-Est.<br />
357
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
358<br />
Cette campagne antilépreuse (appelée Service national antilépreux en 1954) avait <strong>la</strong><br />
structure d’un organisme unitaire, avec <strong>de</strong>s directions et différents services périphériques.<br />
La direction, appelée département <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, était chargée <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> direction,<br />
<strong>de</strong> normalisation et <strong>de</strong> contrôle, divisée en sections spécialisées. Pour leur part,<br />
les services périphériques étaient chargés <strong>de</strong> l’exécution <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne dans leur juridiction.<br />
Chaque région posséda donc son propre service antilépreux régional, qui formait<br />
une unité fonctionnelle et avait sa propre organisation.<br />
Cette organisation, méthodiquement p<strong>la</strong>nifiée et mise en route, permit un diagnostic<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> réalité léprologique péruvienne dans <strong>de</strong> courts dé<strong>la</strong>is, avec un bénéfice effectif pour<br />
les patients et le pays. La division <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (ancien département <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre) fut malheureusement<br />
dissoute par le gouvernement le 14 janvier 1963 ; <strong>la</strong> structure si méticuleusement<br />
mise en p<strong>la</strong>ce fut démantelée et ses différents éléments intégrèrent d’autres<br />
organismes ; à partir <strong>de</strong> 1965, les niveaux périphériques furent incorporés à d’autres<br />
services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s zones concernées.<br />
La désarticu<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> détérioration <strong>de</strong>s actions sanitaires contre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen<br />
à divers niveaux – équipes techniques et administratives centrales, équipes dirigeantes<br />
externes, équipes <strong>de</strong> recherche et <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> personnels entre autres –<br />
firent que le ministre lieutenant-général FAP, M. Campódonico (à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />
Publique en 1977), sensibilisé par ce problème, actualisa le Programme <strong>de</strong> Contrôle <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen en considérant que le diagnostic, le traitement et <strong>la</strong> recherche en<br />
<strong>de</strong>rmato-léprologie étaient une responsabilité pluri-institutionnelle au niveau national,<br />
suivant les conseils prodigués au cours du Séminaire Régional <strong>de</strong> Léprologie qui eut lieu<br />
en septembre 1971 à Pucallpa. Malheureusement, les changements d’autorités et<br />
d’autres facteurs repoussèrent longtemps l’exécution <strong>de</strong>s mesures adoptées.<br />
Entre-temps, par un effort personnel et pionnier, le Dr Víctor Noria, chargé <strong>de</strong> l’unité<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre (un organisme technique et normatif dépendant du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé),<br />
était le seul à poursuivre <strong>de</strong> manière responsable le respect d’un programme, en accord<br />
avec ses projets, ses idées et son expérience d’épidémiologiste et <strong>de</strong> léprologue clinique.<br />
En 1980, Zuño Burstein publia un travail sur L’effondrement du programme <strong>de</strong> contrôle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou causé par <strong>la</strong> décentralisation et son intégration aux programmes généraux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé 59 ; il y faisait une analyse détaillée <strong>de</strong> l’organisation sanitaire du<br />
contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et concluait à l’échec <strong>de</strong>s actions sanitaires <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> cette affection<br />
au Pérou. Cet échec était provoqué en gran<strong>de</strong> partie par une politique <strong>de</strong> décentralisation<br />
inadéquate, inopportune et prématurée, avec une intégration résultant <strong>de</strong><br />
programmes sanitaires généraux qui méconnaissaient <strong>la</strong> réalité nationale. Il y signa<strong>la</strong>it<br />
également qu’il fal<strong>la</strong>it mettre en p<strong>la</strong>ce un programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen<br />
bien articulé, adéquatement financé, car il s’agissait là d’un problème sanitaire d’une<br />
gravité particulière dans les régions endémiques, à répercussion nationale.<br />
Suite à <strong>la</strong> disparition du Service national antilépreux en 1963 (ainsi que son département<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre), le diagnostic spécialisé du <strong>la</strong>boratoire, <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> <strong>la</strong> lépromine, les recherches<br />
spéciales et <strong>la</strong> formation du personnel professionnel passèrent entre les mains du<br />
département <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et <strong>de</strong> mycologie médicale, intégré à <strong>la</strong> structure <strong>de</strong>s Instituts nationaux<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, <strong>de</strong>s organismes décentralisés du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé. Ce département<br />
provenait du Laboratoire central <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> léprologie du département<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre disparu (organisme commandé par le Service national antilépreux qui<br />
dépendait du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé). Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> disparition du service et <strong>de</strong> son département,<br />
le <strong>la</strong>boratoire fut intégré à l’Institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique et conserva en théorie ses fonctions<br />
et sa structure établies <strong>de</strong>puis 1944. Sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong> cette structure, le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />
signa une convention en 1975 successivement ratifiée avec <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor<br />
<strong>de</strong> San Marcos (à travers son institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale Daniel A. Carrión), pour travailler<br />
ensemble sur <strong>la</strong> recherche, le service communautaire et <strong>la</strong> formation du personnel<br />
associés à <strong>la</strong> léprologie et d’autres affections qui font l’objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Burstein affirma, dans une communication publiée en 1972 sous le titre Notre apport<br />
au diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou 60 , que parmi les 2 366 biopsies envoyées entre 1944<br />
et 1971 pour le diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au département <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et mycologie médicale<br />
<strong>de</strong> l’institut dont il était chargé, les résultas furent répartis comme suit : 1 119 cas<br />
(47,3 %) <strong>de</strong> lèpre lépromateuse, 619 cas (26,2 %) <strong>de</strong> lèpre indifférenciée, 233 cas (9,4 %)<br />
<strong>de</strong> lèpre tuberculoï<strong>de</strong> et 18 cas (0,8 %) <strong>de</strong> lèpre dimorphe. Les changements histopathologiques<br />
<strong>de</strong>s patients furent étudiés à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s biopsies pratiquées en série, et <strong>la</strong> concordance<br />
entre le diagnostic clinique et <strong>la</strong> vérification histopathologique fut établie. Il<br />
n’existe pas d’étu<strong>de</strong>s ultérieures simi<strong>la</strong>ires.<br />
En 1980, le Dr Samsaricq, chef du programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong> l’Organisation mondiale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (OMS), visita le Pérou et conseil<strong>la</strong> <strong>la</strong> formation d’une commission permanente<br />
pour le programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen. Il promut, évalua et conseil<strong>la</strong><br />
<strong>de</strong> nouvelles actions et <strong>la</strong> création d’un comité scientifique national pour <strong>la</strong> promotion et<br />
l’évaluation <strong>de</strong>s recherches sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Jusqu’en 1985, <strong>la</strong> direction d’épidémiologie intégra dans son programme le contrôle<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose et <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre comme faisant partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction technique <strong>de</strong> coordination<br />
<strong>de</strong>s programmes spéciaux, même si l’OMS le considéra indépendamment. En<br />
1987, le DS n° 017-87-SA approuva seulement le programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose,<br />
celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre restant donc détaché.<br />
En janvier 1988, le programme national <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen fut incorporé<br />
aux programmes spéciaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé; le Dr Augusto Reátegui en fut désigné le<br />
directeur général 61 . Le décret suprême n° 003-88SA (22 janvier 1988) établit: « En tant<br />
que pays membre <strong>de</strong> l’Organisation mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, pendant <strong>la</strong> 40 e Assemblée mondiale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> santé (15/05/1987), le Pérou s’engagea à organiser <strong>de</strong>s programmes actifs visant<br />
à éliminer <strong>la</strong> lèpre qui faisaient partie <strong>de</strong> son objectif <strong>de</strong> santé pour tous en 2000. »<br />
Les normes et les procédures pour le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen au Pérou furent<br />
approuvées en octobre 1988 ; leur application aux composantes techniques, administratives,<br />
éducatives, sociales et <strong>de</strong> recherche était obligatoire sur tout le territoire<br />
national. Le document « Doctrines, normes et procédures pour le contrôle et l’élimination<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou » fut approuvé en 1992.<br />
Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé comptait jusqu’à l’an 2000 une structure technique et administrative<br />
appelée direction du programme national <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies transmissibles,<br />
qui comportait le programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose et <strong>la</strong> lèpre, et qui<br />
comptait sur <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration éventuelle d’un comité <strong>de</strong> conseil formé par <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
tropicalistes, <strong>de</strong>s léprologues et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues.<br />
Actuellement, <strong>la</strong> restructuration administrative du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé fit disparaître<br />
les programmes nationaux spécifiques du contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies, y compris celui<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. Six structures administratives appelées stratégies <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé existent à sa<br />
p<strong>la</strong>ce, qui intègrent <strong>la</strong> direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s personnes, dont l’une s’occupe<br />
du contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> tuberculose et <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre.<br />
Politique du programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre. Perspectives pour l’avenir<br />
Le cadre dogmatique adopté par le Programme National <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au<br />
Pérou 62 en l’an 2000 est basé sur le principe que « les ma<strong>la</strong>dies transmissibles, dont <strong>la</strong><br />
lèpre, sont liées à <strong>de</strong>s facteurs culturels, sociaux et économiques, à solution complexe »<br />
et que « les programmes <strong>de</strong> contrôle sont nationaux, permanents et continus; ces programmes<br />
tiennent compte <strong>de</strong>s technologies appropriées, ils nourrissent et ren<strong>de</strong>nt plus<br />
efficace leur opération à travers le monitoring et l’évaluation, et leur version actuelle intègre<br />
leurs activités au soin général <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé; les programmes verticaux et inefficaces,<br />
dont l’exécution spécialisée ignorait les services <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, disparurent donc ».<br />
Avec ce cadre dogmatique, le programme actuel considère que « <strong>la</strong> lutte pour le<br />
contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre s’inscrit et s’articule autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> dignité <strong>de</strong>s<br />
359
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
personnes, <strong>de</strong> leurs droits universels et <strong>la</strong> quête <strong>de</strong> l’exaltation <strong>de</strong> leurs facultés, leur permettant<br />
<strong>de</strong> se réaliser pleinement »; en conclusion, cette nouvelle doctrine est basée sur<br />
une conception mo<strong>de</strong>rne qui encourage « le développement <strong>de</strong>s principes d’équité, <strong>de</strong><br />
subsidiarité, d’universalité, <strong>de</strong> solidarité et d’autonomie, grâce à une intéraction dans les<br />
domaines médical, éducatif et social ». Le programme s’appuie sur le fait que <strong>la</strong> lèpre au<br />
Pérou peut être contrôlée et éradiquée à l’ai<strong>de</strong> d’axes <strong>de</strong> gestion donnés.<br />
La définition <strong>de</strong> l’OMS indique que <strong>la</strong> lèpre ne constitue plus un problème <strong>de</strong> santé<br />
lorsque le taux <strong>de</strong> prévalence est inférieur à 1 cas pour 10000 habitants; toutefois cette<br />
situation ne se présente pas dans <strong>de</strong>s régions données, i<strong>de</strong>ntifiées et stratifiées. Pour<br />
contrôler et éradiquer cette ma<strong>la</strong>die, il faudra donc renforcer le développement d’une<br />
série d’activités basées sur <strong>la</strong> diffusion <strong>de</strong>s principes suivants: <strong>la</strong> lèpre peut être guérie,<br />
le patient peut être traité chez lui et il n’a pas besoin d’être isolé ni enfermé dans <strong>de</strong>s léproseries;<br />
si elle est diagnostiquée <strong>de</strong> façon précoce, <strong>la</strong> lèpre n’entraîne pas forcément<br />
<strong>de</strong>s difformités ni <strong>de</strong>s handicaps; après avoir commencé <strong>la</strong> polichimiothérapie (PCT), le<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong> lépreux n’est pas contagieux; si le patient n’est pas traité, il subira malgré un traitement<br />
ultérieur <strong>de</strong>s difformités <strong>de</strong>s mains et <strong>de</strong>s pieds, qui <strong>la</strong>isseront <strong>de</strong>s séquelles à vie.<br />
Épidémiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou<br />
Le comportement épidémiologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre au Pérou se réduit aux zones endémiques,<br />
peuplées <strong>de</strong> 3 218 109 personnes, dont 1 255 062 ont moins <strong>de</strong> 15 ans. Selon les<br />
taux <strong>de</strong> prévalence <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en l’an 2000, et tenant compte <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong> l’OMS,<br />
nous pouvons conclure que <strong>la</strong> lèpre au Pérou constitue un problème <strong>de</strong> santé publique,<br />
notamment dans le département d’Ucayali, où <strong>la</strong> prévalence <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die dépasse le<br />
taux <strong>de</strong> 1 pour 10 000 habitants. Cette information nous permet <strong>de</strong> donner <strong>la</strong> priorité<br />
aux activités <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, tentant d’engager les autorités locales et l’ensemble<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté, à mener <strong>de</strong>s actions coordonnées qui permettront le diagnostic<br />
et le traitement <strong>de</strong> nouveaux cas <strong>de</strong> lèpre <strong>de</strong> manière précoce, tout en prévenant<br />
les handicaps et en diminuant effectivement l’impact social <strong>de</strong> cette ma<strong>la</strong>die (figures 31,<br />
32, 33).<br />
Légis<strong>la</strong>tion péruvienne pour le contrôle <strong>de</strong>s MST. <strong>Histoire</strong><br />
<strong>de</strong>s dispositions légales en vigueur<br />
Departamentos Pob<strong>la</strong>ción Total <strong>de</strong> casos Tasa <strong>de</strong> prevalencia Casos nuevos Tasa <strong>de</strong> <strong>de</strong>tección<br />
Figure 31.<br />
Taux <strong>de</strong> prévalence<br />
et détection<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre<br />
au Pérou, 2000<br />
360<br />
LÉGISLATION POUR LE CONTRÔLE DES MALADIES VÉ-<br />
NÉRIENNES63, 64<br />
La première référence officielle se trouve<br />
dans <strong>la</strong> résolution suprême du 1er juillet 1910.<br />
Considérant: qu’« il est un <strong>de</strong>voir pour l’État <strong>de</strong><br />
s’occuper <strong>de</strong> <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
qui, outre les dommages provoqués<br />
chez les individus contaminés, attaquent<br />
également les intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et ceux <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
race », que « l’expérience universelle prouva<br />
l’inefficacité <strong>de</strong> <strong>la</strong> réglementation policière <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
prostitution pour <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie <strong>de</strong> ces ma<strong>la</strong>dies<br />
», que « l’expérience prouva également que<br />
les mesures les plus efficaces sont dans ce sens celles concernant l’inspection et <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce<br />
sanitaire <strong>de</strong>s femmes publiques et <strong>de</strong>s maisons <strong>de</strong> tolérance, ainsi que le traitement<br />
médical gratuit <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints d’affections vénériennes dans les<br />
dispensaires », elle résout <strong>de</strong> charger <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> salubrité publique d’organiser et<br />
<strong>de</strong> mettre en p<strong>la</strong>ce le service sanitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution, ouvrant <strong>de</strong>s dispensaires <strong>de</strong> salubrité<br />
<strong>de</strong>stinés aux ma<strong>la</strong>dies vénériennes à Lima et à Cal<strong>la</strong>o, puis dans toute <strong>la</strong><br />
endémicos 1989 x 10.000 hab. x 10.000 hab.<br />
1. Loreto 889.471 83 0.9 29 0.3<br />
2. Ucayali 424.410 60 1.4 14 0.3<br />
3. Amazonas 143.981 0 0 0 0<br />
4. Apurímac 243.852 1 0.04 0 0<br />
5. Huánuco 776.727 2 0.02 0 0<br />
6. San Martín 743.668 3 0.04 0 0<br />
Lima Norte<br />
(Hospital Nacional<br />
Cayetano Heredia) - 15* - 0 0<br />
Lima Sur<br />
(Hospital <strong>de</strong> Apoyo<br />
María Auxiliadora) - 1* - - -<br />
Total <strong>de</strong> casos 3.218.109 165 0.5 43 0.1<br />
* Casos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> <strong>la</strong>s zonas endémicas<br />
Fuente: Programa Nacional <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s Transmisibles - Control <strong>de</strong> Lepra - MINSA
République; déc<strong>la</strong>rer <strong>la</strong> gratuité <strong>de</strong> l’examen<br />
médical et du traitement effectués dans les<br />
dispensaires; obliger <strong>la</strong> police à faire respecter<br />
les dispositions sanitaires pour le fonctionnement<br />
<strong>de</strong> ce service et tout ce qui concerne<br />
le maintien <strong>de</strong> <strong>la</strong> morale et <strong>de</strong> l’ordre public.<br />
Suivant cette disposition légale, le règlement<br />
interne <strong>de</strong> l’assistance publique <strong>de</strong><br />
Lima (approuvé par <strong>la</strong> résolution suprême du<br />
30 juin 1923) établit <strong>la</strong> section <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie<br />
antivénérienne, obligeant à <strong>la</strong> surveil<strong>la</strong>nce<br />
<strong>de</strong>s femmes exposées à ce contrôle, à l’ouver-<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
Años 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total<br />
Multi-baci<strong>la</strong>r 1.205 672 220 245 202 195 227 237 221 151 126 3.701<br />
Pauci-baci<strong>la</strong>r 649 362 57 59 39 45 37 25 45 29 39 1.386<br />
Total 1.854 1.034 27 304 241 240 264 262 266 180 165 5.087<br />
C.N* - - - - 79 90 90 63 107 63 43 535<br />
D-OMS** - - - - 17 12 10 4 6 7 6 62<br />
** Casos nuevos.<br />
Discapacitados según grado 1 y 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> OMS.<br />
Fuente: Programa Nacional <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s Transmisibles - Control <strong>de</strong> Lepra - MINSA.<br />
ture d’un « registre <strong>de</strong> péripatéticiennes » et à <strong>la</strong> remise d’un « carnet sanitaire », les<br />
autorisant à exercer légalement <strong>la</strong> prostitution. Y sont mentionnés le contrôle policier et<br />
les sanctions pour <strong>la</strong> prostitution c<strong>la</strong>n<strong>de</strong>stine et pour les omissions au contrôle sanitaire<br />
périodique.<br />
Pour leur part, les forces armées établirent à travers <strong>de</strong>s décrets suprêmes les<br />
normes <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes pour ses membres ; les<br />
dispositions propres à <strong>la</strong> police et à <strong>la</strong> gendarmerie <strong>de</strong> <strong>la</strong> République furent décrétées en<br />
avril 1923, et celles <strong>de</strong> propres à l’Armée Nationale, en novembre 1928.<br />
Un décret suprême créa en septembre 1926 <strong>la</strong> Ligue nationale antivénérienne, une<br />
institution <strong>de</strong> santé et <strong>de</strong> bienfaisance consacrée<br />
à l’action et à <strong>la</strong> propagan<strong>de</strong> antivénériennes.<br />
Cette création respecta les conseils<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> I re Conférence nationale antivénérienne,<br />
qui eut lieu du 30 août au 5 septembre 1926<br />
à Lima. Il était conseillé au cours <strong>de</strong> cette<br />
conférence <strong>de</strong> commencer l’éducation<br />
sexuelle à partir <strong>de</strong> l’enseignement secondaire,<br />
d’unifier les métho<strong>de</strong>s et les procédures<br />
curatives, <strong>de</strong> stimuler le développement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité vénéréologique et d’introduire<br />
le certificat médical prénuptial. Elle<br />
déc<strong>la</strong>ra aussi que, tant que les conditions sociales<br />
qui règnent subsisteront, <strong>la</strong> réglementation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution sera nécessaire; elle<br />
conseil<strong>la</strong> une série <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> protection<br />
pour les enfants mineurs et pour les jeunes filles abandonnées, en suggérant d’établir un<br />
âge minimum <strong>de</strong> 18 ans pour exercer <strong>la</strong> prostitution et elle sollicita également le décompte<br />
légal du nombre <strong>de</strong> personnes porteuses <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vénériennes.<br />
La résolution suprême du 6 mars 1927 approuva les statuts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue nationale<br />
Antivénérienne, dont le but était <strong>de</strong> recevoir et d’acheminer les orientations tracées par<br />
<strong>la</strong> I re Conférence Nationale Antivénérienne. Cependant, elle ne fonctionnera jamais car<br />
sa constitution fut compliquée à cause du nombre excessif <strong>de</strong> ses membres (le prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> République, <strong>de</strong>s Ministres d’Etat, les Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cour Suprême <strong>de</strong> Justice et<br />
<strong>de</strong>s Chambres Légis<strong>la</strong>tives, <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> plusieurs institutions).<br />
Le gouvernement intervint à nouveau en janvier 1941, en créant, à travers un décret<br />
suprême, le Service national antivénérien qui dépendait <strong>de</strong> <strong>la</strong> Direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> salubrité;<br />
il est chargé d’exécuter les travaux <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> soin médical et social liés<br />
aux ma<strong>la</strong>dies vénériennes; il constitue également un organisme d’orientation et d’étu<strong>de</strong><br />
technique <strong>de</strong>s problèmes inhérents à ces ma<strong>la</strong>dies, étant obligé <strong>de</strong> centraliser <strong>la</strong> statistique<br />
générale <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes et d’exercer <strong>la</strong> supervision ainsi que le contrôle tech-<br />
361<br />
Figure 32.<br />
Cas <strong>de</strong> lèpre<br />
notifiés au Pérou,<br />
1990-2000<br />
Figure 33.<br />
Taux <strong>de</strong> prévalence<br />
<strong>de</strong> lèpre pour<br />
10.000 habitants au<br />
Pérou, 1990-2000
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
362<br />
nique <strong>de</strong>s services vénéréologiques d’autres entités. La même année un autre décret suprême<br />
déc<strong>la</strong>ra l’obligation <strong>de</strong> soigner pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> contagion toute personne souffrant<br />
<strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies suivantes : syphilis, blennorrhagie, chancre mou et<br />
lymphogranulome vénérien. Les personnes ignorant ces normes seraient sévèrement sanctionnées,<br />
et même l’intervention policière était prévue en cas <strong>de</strong> besoin; on interdit également<br />
<strong>la</strong> vente libre <strong>de</strong> drogues, <strong>de</strong> spécialités et <strong>de</strong> médicaments <strong>de</strong>stinés au traitement<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes. Les obligations médicales étaient également établies.<br />
Le contrôle actuel <strong>de</strong> l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution au Pérou est signalé dans le règlement<br />
en vigueur <strong>de</strong>s licences spéciales <strong>de</strong> police, approuvé à travers un décret suprême<br />
en décembre 1946 ; on y établit les conditions requises pour le fonctionnement<br />
<strong>de</strong>s maisons <strong>de</strong> tolérance, <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>z-vous et <strong>de</strong>s maisons closes, ainsi que<br />
l’obligation pour les femmes exerçant <strong>la</strong> prostitution d’acquérir le certificat <strong>de</strong> bonne<br />
santé délivré par le Service antivénérien et <strong>la</strong> licence personnelle expédiée tous les<br />
mois par <strong>la</strong> perception. Les dirigeants <strong>de</strong> ces établissements sont obligés <strong>de</strong> faire visiter<br />
les locaux au Service National Antivénérien une fois par semaine. La police est<br />
chargée <strong>de</strong> faire respecter les normes et d’envoyer à l’hôpital les femmes souffrant<br />
d’une ma<strong>la</strong>die contagieuse. Des amen<strong>de</strong>s prévues dans le règlement sanctionneront<br />
les infractions à ces dispositions.<br />
Eu égard à <strong>la</strong> réorganisation ministérielle, le Service national antivénérien disparut,<br />
remp<strong>la</strong>cé par le Département <strong>de</strong> vénéréologie qui adapte son fonctionnement pour respecter<br />
<strong>la</strong> résolution suprême du 19 mai 1952, afin <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniser les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte<br />
antivénérienne dans le pays ; en accord avec le principe <strong>de</strong> décentralisation administrative<br />
<strong>de</strong>s services sanitaires exécutifs périphériques, il prend essentiellement en charge <strong>la</strong><br />
programmation <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne antivénérienne. Il é<strong>la</strong>bore ainsi un p<strong>la</strong>n général <strong>de</strong> travail,<br />
dont les fonctions sont les suivantes : concevoir le p<strong>la</strong>n national <strong>de</strong> lutte antivénérienne<br />
; promulguer <strong>de</strong>s normes techniques pour l’exécution <strong>de</strong>s campagnes<br />
antivénériennes <strong>de</strong>vant être menées par les services sanitaires locaux ; inspecter ou<br />
contrôler le respect <strong>de</strong>s programmes locaux ; constituer l’organisme <strong>de</strong> consultation pour<br />
tous les programmes antivénériens du ministère et coordonner leur action avec les<br />
autres départements, entités ou secteurs concernés ; é<strong>la</strong>borer un p<strong>la</strong>n détaillé <strong>de</strong> campagne<br />
nationale antivénérienne.<br />
Le Département <strong>de</strong> vénéréologie disparut ultérieurement en tant que structure pour<br />
être intégré comme programme à <strong>la</strong> division d’épidémiologie du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé,<br />
incorporé à son tour à <strong>la</strong> direction d’éradication et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies transmissibles.<br />
C’est là que furent centralisées les fonctions <strong>de</strong> surveil<strong>la</strong>nce épidémiologique, <strong>de</strong><br />
programmation et <strong>de</strong> normalisation technique, <strong>de</strong> contrôle général et spécifique au niveau<br />
national. Les ma<strong>la</strong>dies vénériennes, prises en compte dans le groupe <strong>de</strong>s « ma<strong>la</strong>dies<br />
d’action sanitaire », leur notification étant obligatoire dans les sept jours suivant<br />
le diagnostic, sont soumises au système national <strong>de</strong> notification <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies transmissibles.<br />
Les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s atteints du sida sont soignés dans le pays <strong>de</strong>puis 1983. Les premiers patients<br />
positifs étaient généralement <strong>de</strong>s homosexuels originaires <strong>de</strong>s États-Unis. Grâce à<br />
leur condition d’Américano-péruviens, ils venaient se soigner au Pérou, où <strong>la</strong> plupart<br />
cherchaient un meilleur traitement car ils se sentaient exclus ou discriminés aux USA.<br />
Les spécialistes qui les soignaient les envoyèrent immédiatement chez le Dr Raúl Patrucco<br />
Puig pour leur contrôle immunologique. Ce mé<strong>de</strong>cin, mort prématurément en<br />
1987, entama les étu<strong>de</strong>s et <strong>la</strong> compi<strong>la</strong>tion complète <strong>de</strong>s cas.<br />
Plus tard, les patients furent également <strong>de</strong>s homosexuels péruviens qui n’avaient pas<br />
voyagé à l’étranger mais qui avaient eu <strong>de</strong>s rapports sexuels avec <strong>de</strong>s touristes. Il exista<br />
aussi <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> contagion par transfusion sanguine. À cette époque, aucun cas ne fut<br />
rapporté dans les provinces. Au tout début <strong>de</strong> l’épidémie, ils étaient peu nombreux à<br />
prendre au sérieux le problème du sida au Pérou.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
La première commission désignée pour étudier l’inci<strong>de</strong>nce du sida dans le pays fut<br />
nommée le 25 novembre 1985 par une résolution vice-ministérielle (005-85-SA/DVM).<br />
Elle fut intégrée par les Drs Gottardo Agüero (coordinateur) et Raúl Patrucco, tandis que<br />
les Drs César Delgado Sayán et Aníbal Esca<strong>la</strong>nte étaient les délégués du Collège médical<br />
du Pérou.<br />
Quelque temps après, cette commission prit contact avec le NAMRID (Institut <strong>de</strong> recherche<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> Marine <strong>de</strong>s États-Unis), qui avait manifesté son intention <strong>de</strong><br />
mener une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> séroprévalence d’anticorps contre le VIH sur 40 000 personnes sur<br />
le territoire péruvien.<br />
Le 19 février 1987, <strong>la</strong> résolution vice-ministérielle 020-87SA/DVM é<strong>la</strong>rgit <strong>la</strong> commission<br />
grâce à <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s Drs Santos Hinostroza, Eduardo Gotuzzo, Enrique<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Alejandro Padrón et Oscar Frisancho.<br />
Le 2 avril 1987, <strong>la</strong> RS 011-87-SA créa le Programme national multisectoriel pour <strong>la</strong><br />
prévention et le contrôle du sida, tandis que <strong>la</strong> RS 013-87SA créa <strong>la</strong> Commission technique<br />
<strong>de</strong> certification, qualification et registre <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> sida (CTCCR). La résolution ministérielle<br />
du 7 avril (238-87-SA/DM) désigna <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s professionnels qui l’intégraient :<br />
les Drs Raúl Patrucco (prési<strong>de</strong>nt), Eduardo Gotuzzo, Alejandro Padrón, Santos Hinostroza,<br />
José Gálvez Brandon, Oscar Misad, Aníbal Esca<strong>la</strong>nte, Guillermo Contreras et Miguel<br />
Campos.<br />
Le 1 er juin 1987, le Dr Gottardo Agüero fut nommé directeur du programme national<br />
multisectoriel pour <strong>la</strong> prévention et le contrôle du sida (RM 373-87-SA/DM), et le 9 juin <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> même année, il fut nommé directeur général dudit programme (RM 196-SA7P).<br />
Eu égard à <strong>la</strong> disparition prématurée du Dr Raúl Patrucco, une résolution ministérielle<br />
du 21 août 1987 désigna le Dr Aníbal Esca<strong>la</strong>nte pour le remp<strong>la</strong>cer comme prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> CTCCR ; le 10 juillet <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, le Dr Alberto Yuén fut désigné nouveau<br />
membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission (RVM 428-87-SA/DM).<br />
Un avant-projet <strong>de</strong> banques du sang fut publié en décembre 1987 ; le 21 novembre<br />
1988, le décret suprême 031-88-SA obligea à effectuer <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> dépistage du sida,<br />
d’hépatite B et <strong>de</strong> syphilis avant les transfusions sanguines.<br />
Le 1 er décembre 1988 fut créé (DS 033-88-SA) le Programme spécial <strong>de</strong> contrôle du<br />
sida (PECOS), résultat <strong>de</strong> <strong>la</strong> fusion entre le Programme national multisectoriel pour <strong>la</strong><br />
prévention et le contrôle du sida et <strong>la</strong> Commission technique <strong>de</strong> certification, qualification<br />
et registre. Les directeurs dudit programme ainsi que les membres du comité technique<br />
<strong>de</strong> consultation furent désignés par <strong>la</strong> RM 483-88-SA/DM du 27 décembre 1988.<br />
Le PECOS a pour objectifs, entre autres, <strong>la</strong> prévention et le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> transmission<br />
du VIH et <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> morbi-mortalité associée. Il est financé par le budget<br />
national <strong>de</strong> <strong>la</strong> République et le P<strong>la</strong>n d’urgence, comptant sur le soutien <strong>de</strong> l’OMS et <strong>de</strong>s<br />
Agences internationales du développement (AID, John Hopkins University, Popu<strong>la</strong>tion<br />
Council), ainsi que sur celui <strong>de</strong> quelques ONG telles que Generación y Germinal, AID-<br />
SCOM, entre autres. La responsabilité politique du PECOS revient au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Santé ; il est intégré à l’Institut national <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé.<br />
Le 23 juillet 1990 fut promulguée <strong>la</strong> loi nº 25275, le dispositif <strong>de</strong> plus haut niveau associé<br />
au sida au Pérou.<br />
Le Programme national <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s MST/sida, intégré à l’organisme central du<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé, fut créé ultérieurement ; ce programme se rangea en 2004 sous <strong>la</strong><br />
tutelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction générale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s personnes et constitua l’une <strong>de</strong>s six stratégies<br />
sanitaires <strong>de</strong> cette direction.<br />
L’Union péruvienne contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles (UPCETS en espagnol),<br />
fondée à Lima le 14 juin 1982, filiale <strong>de</strong> l’Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les Ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles (ULACETS), présidée à l’origine par le Dr Gottardo<br />
Agüero et ensuite par le Dr Zuño Burstein, eut un rôle important <strong>de</strong> catalyseur et<br />
d’orientation pendant les premières étapes <strong>de</strong> <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> l’importance du<br />
363
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
364<br />
contrôle <strong>de</strong>s MST/sida; parmi ses multiples activités, elle organisa le premier atelier sur<br />
le sida au Pérou, comptant sur une participation multisectorielle 64 .<br />
L’UPCETS mena ses activités en étroite col<strong>la</strong>boration avec le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, filiale Pérou (CILAD-PÉROU). ■<br />
Le Dr Tarci<strong>la</strong> Rey Sánchez s’est chargée <strong>de</strong> <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> ce texte.<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
III<br />
1. Universidad Nacional Mayor<br />
<strong>de</strong> San Marcos. Dirección <strong>de</strong><br />
Programas Académicos <strong>de</strong><br />
Medicina Humana.<br />
Disposiciones legales y<br />
organización <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong><br />
Segunda Especialización.<br />
Normas y procedimientos<br />
para <strong>la</strong> obtención <strong>de</strong>l título<br />
<strong>de</strong> Especialista por <strong>la</strong>s<br />
modalida<strong>de</strong>s esco<strong>la</strong>rizada y<br />
no esco<strong>la</strong>rizada. Lima:<br />
Imprenta UNMSM, 1974.<br />
2. Cotlear A. Coordinador <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Sección Dermatología y Jefe<br />
interino <strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong><br />
Medicina Humana, UNMSM.<br />
Carta <strong>de</strong>l 8 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong><br />
1969 dirigida al Dr. Zuño<br />
Burstein, Director<br />
Universitario <strong>de</strong> Servicios<br />
Académicos y Registro<br />
Central <strong>de</strong> <strong>la</strong> UNMSM.<br />
Archivo personal <strong>de</strong>l Dr. Z.<br />
Burstein.<br />
3. Palma R. « La uta en el Perú. »<br />
Boletín <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong><br />
Fomento. Dirección <strong>de</strong><br />
Salubridad. Lima. Nov. 1908;<br />
10: 1-98.<br />
4. Escomel E. « Informe <strong>de</strong>l 5º<br />
Congreso Latinoamericano. »<br />
Crónica Médica. Lima. 1913;<br />
30: 102-3.<br />
5. Arce J. « Las leishmaniasis<br />
dérmicas en el Perú. » Actas y<br />
trabajos <strong>de</strong>l 5º Congreso<br />
Médico Latinoamericano.<br />
Lima; 1913: 208-247.<br />
6. Monge C. La leishmaniasis <strong>de</strong>l<br />
<strong>de</strong>rmis en el Perú [tesis<br />
doctoral UNMSM]. Lima:<br />
Imp. San Martín; 1914.<br />
7. Weiss P. « Casos <strong>de</strong> espundia<br />
en que se han encontrado<br />
leishmanias. » Crónica<br />
Médica. 1924; 41: 120-2.<br />
8. Escomel E. « Leishmaniasis<br />
americana y <strong>la</strong>s leishmaniasis<br />
<strong>de</strong> América. » Gac. Med. Mex.<br />
1942: 502-516<br />
9. Weiss P. « Epi<strong>de</strong>miología y<br />
clínica <strong>de</strong> <strong>la</strong>s leishmaniasis<br />
tegumentarias en el Perú. »<br />
Rev. Med.Exp. 1943; 2: 209-<br />
248.<br />
10. Cornejo Ubillus J.<br />
Contribución al estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en nuestro medio [tesis <strong>de</strong><br />
Bachiller en Medicina<br />
UNMSM]. Lima, 1951.<br />
11. Weiss P. « Las zonas andinas<br />
<strong>de</strong> patología <strong>de</strong><br />
Phlebotomus. » Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina UNSM.<br />
1953; 36: 1-11.<br />
12. Burstein Z., Cornejo J., Pesce<br />
H. « Estado actual <strong>de</strong>l<br />
conocimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en el Perú. » Proceedings of<br />
the 7th International<br />
Congress on Tropical<br />
Medicine and Ma<strong>la</strong>ria 1963.<br />
Río <strong>de</strong> Janeiro 1963: 385-<br />
387.<br />
13. Burstein Z. « Nuestra<br />
experiencia clínica en<br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en el Perú. Intento <strong>de</strong><br />
Septembre, 2005<br />
agrupar <strong>la</strong>s formas dérmicas<br />
con un criterio clínico<br />
epi<strong>de</strong>miológico. » Resúmenes<br />
<strong>de</strong> trabajos <strong>de</strong>l 1º Congreso<br />
Nacional <strong>de</strong> Microbiología y<br />
Parasitología. Arequipa (Perú)<br />
8-12 oct. 1964; pp. 62-66.<br />
14. Burstein Z. « Leishmaniasis<br />
andina (galería fotográfica). »<br />
Folia Dermatol. Peru. 1995;<br />
6(1): 45-6.<br />
15. Burstein Z. « Leishmaniasis<br />
tegumentaria en el Perú<br />
(continuación). Leishmaniasis<br />
selvática. » Folia Dermatol.<br />
Peru. 1995; 6(2): 46-8.<br />
16. Dostrowsky A. « Inmunidad y<br />
alergia en <strong>la</strong> leishmaniasis<br />
cutánea (Botón <strong>de</strong> Oriente). »<br />
El Día Médico. Buenos Aires.<br />
Ag. 1951: 1555-1560.<br />
17. L<strong>la</strong>nos R. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en el Perú [ponencia]. »<br />
1º Congreso Americano <strong>de</strong><br />
Estudiantes <strong>de</strong> Medicina.<br />
Lima; 1958.<br />
18. Tejada A. Leishmaniasis<br />
tegumentaria en el Perú.<br />
Investigación epi<strong>de</strong>miológica.<br />
Clínica <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniasis<br />
tegumentaria en los<br />
<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> Cuzco y<br />
Madre <strong>de</strong> Dios [tesis <strong>de</strong><br />
doctorado UNMSM]. Lima;<br />
1973.<br />
19. Tamayo M. « La uta en el<br />
Perú » [comunicación].<br />
4º Congreso Científico Latino<br />
Americano. Lima: Imp. F.<br />
Barrionuevo; 1905.<br />
20. Urcia J. « Algo sobre <strong>la</strong><br />
epi<strong>de</strong>miología y <strong>la</strong> profi<strong>la</strong>xis
<strong>de</strong> <strong>la</strong> uta. » Actas <strong>de</strong>l 5º<br />
Congreso Médico Latino<br />
Americano; 1913: 465-525.<br />
21. Herrer A. « Antigüedad <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en América. » Rev. Bras.<br />
Ma<strong>la</strong>riol Doenças Trop. 1956;<br />
8(1): 187-195.<br />
22. Palma R. « La uta en el Perú »<br />
[tesis <strong>de</strong> Bachiller UNMSM].<br />
Boletín <strong>de</strong>l Ministerio <strong>de</strong><br />
Fomento. Lima; 1909: 1-98.<br />
23. Escomel E. Gaceta Médica.<br />
Arequipa (Perú); 1911.<br />
24. Wenyon Ch. « La espundia es<br />
una leishmaniasis <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
piel. » Crónica Médica. 1913;<br />
30: 146-8.<br />
25. Vélez L., Monge C.<br />
« Leishmaniasis. » Crónica<br />
Médica. 1913; 30: 225-231.<br />
26. Gastiaburú, Rebagliati.<br />
Crónica Médica. 1913; 30:<br />
225-231.<br />
27. Strong R. « Informe<br />
preliminar <strong>de</strong> <strong>la</strong> primera<br />
expedición <strong>de</strong>l Departamento<br />
<strong>de</strong> Medicina Tropical <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad <strong>de</strong> Harvard a Sud<br />
América. » Crónica Médica.<br />
1914; 31: 2-12.<br />
28. Raimondi A. El Perú. Tomo I.<br />
Lima: Imp. <strong>de</strong>l Estado; 1885:<br />
216.<br />
29. Pagaza M. « Uta peruana. »<br />
Crónica Médica. 1904; 21:<br />
190-192.<br />
30. Escomel E. « La espundia. »<br />
Bull. Soc. Path. Ext. 1911; 7:<br />
489-492.<br />
31. Weiss P., Rojas H., Guzmán<br />
Barrón A. Informe médico<br />
sobre <strong>la</strong> región <strong>de</strong> Madre <strong>de</strong><br />
Dios. Lima: Imp. Americana;<br />
1924.<br />
32. Marroquín J. « Datos sobre<br />
epi<strong>de</strong>miología <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniasis en el Perú. »<br />
El Perú Médico; 1950: 4.<br />
33. Herrer A. « Estudios sobre<br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en el Perú. Observaciones<br />
epi<strong>de</strong>miológicas sobre <strong>la</strong><br />
uta. » Rev. Med. Exp. 1951; 8:<br />
45-86.<br />
34. Kuczynski-Godard M. Iberia<br />
(Madre <strong>de</strong> Dios).<br />
Posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> su<br />
organización en <strong>la</strong><br />
postguerra. Lima: Imp. Gráf.<br />
Scheuch; 1945.<br />
35. Acurio B., Valdieso N. « La<br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
en el Departamento <strong>de</strong>l<br />
Cuzco. Estudio<br />
histopatológico y<br />
epi<strong>de</strong>miológico. Libro <strong>de</strong><br />
resúmenes. » 1º Congreso<br />
Nacional <strong>de</strong> Microbiología y<br />
Parasitología. Arequipa<br />
(Perú). 1964: 76-77.<br />
36. Tejada A. « Observaciones<br />
sobre leishmaniasis<br />
tegumentaria en el<br />
Departamento <strong>de</strong> Madre <strong>de</strong><br />
Dios. » 3º Congreso Peruano<br />
<strong>de</strong> Microbiología y<br />
Parasitología. Trujillo (Perú);<br />
1970: 44.<br />
37. Pesce H., Pardo L. « Notes on<br />
cutaneous leishmaniasis and<br />
Phlebotomus in the province<br />
of Andahuay<strong>la</strong>s. Peru. » The<br />
Amer. Journ. of Hyg. 1943;<br />
37: 255-258.<br />
38. Herrer A. « Re<strong>la</strong>ción entre<br />
leishmaniasis tegumentaria y<br />
Phlebotomus. » Rev. Med.<br />
Exp. 1951; 8: 119-37.<br />
39. Laison R., Show J. « Las<br />
leishmanias y <strong>la</strong><br />
leishmaniasis en el nuevo<br />
mundo con particu<strong>la</strong>r<br />
referencia al Brasil. » Bol. of<br />
San Panam. 1974; 76: 93-114.<br />
40. Ugaz J. « Etiología, topografía<br />
y tratamiento <strong>de</strong> <strong>la</strong> uta<br />
(lupus) en el Perú. » Crónica<br />
Médica. 1886; 3: 211-222,<br />
260-268.<br />
41. Antúnez D. « Uta peruana. »<br />
Actas <strong>de</strong>l 5º Congreso Latino<br />
Americano. Lima; 1914: 278-<br />
282.<br />
42. Maldonado A. Probable rol <strong>de</strong><br />
algunas p<strong>la</strong>ntas <strong>la</strong>ctescentes<br />
características <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
quebradas verrucógenas y<br />
utógenas (nota preliminar).<br />
Lima: Imp. San Martín; 1930.<br />
43. Sal y Rosas F. La Uta,<br />
ambiente telúrico,<br />
<strong>de</strong>rmatológico y social [tesis<br />
<strong>de</strong> Bachiller en Medicina].<br />
Lima: UNMSM; 1934.<br />
44. Burstein Z., Romero O.<br />
« F<strong>la</strong>ge<strong>la</strong>dos en el látex <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Jatropha macrantha (huanarpo<br />
hembra) » [comunicación<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Pérou<br />
preliminar]. Arch. <strong>de</strong> Pat. y Clín.<br />
1956; X: 1-11.<br />
45. Burstein Z. Contribución al<br />
estudio <strong>de</strong> <strong>la</strong> verruga peruana<br />
y <strong>de</strong> <strong>la</strong> uta. Investigaciones en<br />
el Cnidosculos basiacantha y<br />
Jatropha Macrantha<br />
(huanarpos) como posibles<br />
reservorios [tesis <strong>de</strong> Bachiller<br />
en Medicina]. Lima: UNMSM;<br />
1957.<br />
46. Herrer A. « Nota preliminar<br />
sobre leishmaniasis natural<br />
en perros. » Rev. Med. Exp.<br />
1948; 8: 62-64.<br />
47. Herrer A. « Leishmaniasis<br />
natural en perros<br />
proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> localida<strong>de</strong>s<br />
utógenas. » Rev. Med. Exp.<br />
1951; 8: 87-118.<br />
48. Escomel E. « La leishmaniasis<br />
cutánea curada por el tártaro<br />
emético. » Crónica Médica.<br />
1916; 3: 207.<br />
49. Zegarra Araujo N. « La<br />
leishmaniasis tegumentaria<br />
americana y su terapéutica<br />
con Anfotericina B. » Revista<br />
Médica. Lima. 1966; 2(2): 3.<br />
50. « Reg<strong>la</strong>mento <strong>de</strong> condiciones<br />
<strong>de</strong> higiene y seguridad para<br />
centros <strong>de</strong> trabajo en zonas<br />
endémicas <strong>de</strong> leishmaniasis. »<br />
Diario Oficial El Peruano.<br />
Lima; 25 oct 1976.<br />
51. Weiss P. « Verruga peruana. »<br />
Rev. Soc. Per. Dermat. 1967;<br />
1: 9-27.<br />
52. Lastres J.B. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
medicina peruana. La<br />
medicina incaica. Lima:<br />
UNMSM; 1951.<br />
53. Odriozo<strong>la</strong> E. La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong><br />
Carrion ou <strong>la</strong> verruga<br />
péruvienne. París: G. Carré et<br />
C. Naut; 1898.<br />
54. Barton A. Gaceta <strong>de</strong> los<br />
Hospitales A-2. Lima. 1905;<br />
(42).<br />
55. Strong R. « Informe<br />
preliminar <strong>de</strong> <strong>la</strong> expedición<br />
<strong>de</strong>l Dpto. <strong>de</strong> Medicina<br />
Tropical <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad <strong>de</strong><br />
Harvard a Sudamérica. »<br />
Lima. Crónica Médica. 1914;<br />
31: 2-12.<br />
56. Townsend Ch. « La titira es<br />
transmisora <strong>de</strong> <strong>la</strong> verruga<br />
peruana. » Lima. Crónica<br />
Médica. 1913; 30: 210-211.<br />
365
ELBIO FLORES-CEVALLOS, LUIS FLORES-CEVALLOS, ZUÑO BURSTEIN<br />
57. Patiño Camargo L.<br />
« Bartonellosis en Colombia. »<br />
Rev. Hig. 1939; 20: 4.<br />
58. Pesce H. La epi<strong>de</strong>miología <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> lepra en el Perú [tesis <strong>de</strong><br />
doctorado]. Lima: UNMSM,<br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina; 1961.<br />
59. Burstein Z. « Quiebra <strong>de</strong>l<br />
Programa <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Lepra en el Perú por <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>scentralización e integración<br />
a los programas generales <strong>de</strong><br />
salud. » Arch. Arg. Dermatol.<br />
1980; 30: 173-80.<br />
60. Burstein Z. « Nuestro aporte al<br />
diagnóstico <strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en el<br />
Perú. » Actas <strong>de</strong>l 1º Congreso<br />
Argentino <strong>de</strong> Dermatología.<br />
Buenos Aires; 1972.<br />
61. Ministerio <strong>de</strong> Salud. Manual<br />
<strong>de</strong> normas y procedimientos<br />
<strong>de</strong>l Programa Nacional <strong>de</strong><br />
Control <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hanseniasis.<br />
Lima: MINSA; 1988.<br />
62. Ministerio <strong>de</strong> Salud. Situación<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lepra en el Perú, año<br />
2000. Programa Nacional <strong>de</strong><br />
Control <strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s<br />
Transmisibles: Control <strong>de</strong><br />
Lepra. Lima: MINSA; 2000.<br />
63. Burstein, Z. editor.<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transmisión<br />
sexual-SIDA. Lima: Colegio<br />
Médico <strong>de</strong>l Perú. Unión<br />
Peruana contra <strong>la</strong>s<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Transmisión<br />
Sexual (UPCETS); 1991.<br />
64. Unión Peruana contra <strong>la</strong>s<br />
Enfermeda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Transmisión<br />
Sexual. Memoria <strong>de</strong>l Taller<br />
SIDA en el Perú (HIV). Lima:<br />
Talleres IMPARES; 1988.
Époque précolombienne<br />
NOTES SUR<br />
L’HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
PÉRUVIENNE<br />
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
■ Époque précolombienne<br />
Rien ne prouve que les civilisations pré-incas et incas aient connu l’écriture.<br />
Toutefois, certaines ma<strong>la</strong>dies qui attaquèrent les popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> l’époque<br />
furent représentées sur <strong>de</strong>s huacos anthropomorphes appartenant aux cultures<br />
moche, huari, <strong>la</strong>mbayeque, chimú et mochica (toutes pré-incas). Ceci<br />
mène à penser que <strong>de</strong>s pathologies telles que l’uta (figure 1), <strong>la</strong> verrue péruvienne<br />
(figure 2), l’albinisme (figure 3), <strong>la</strong> paralysie faciale (figure 4), l’éléphantiasis<br />
(figure 5), l’hyperthyroïdisme avec leishmaniose (figure 6), <strong>la</strong><br />
syphilis congénitale « nez en lorgnette » (figure 7) et le bec-<strong>de</strong>-lièvre (figure 8),<br />
entre autres, existaient déjà. Plusieurs mots quechuas (incas) sont toujours utilisés<br />
pour nommer les différentes pathologies ; par exemple, sirki et ticti pour<br />
<strong>la</strong> verrue péruvienne et ccara pour <strong>la</strong> pinta.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s lésions osseuses <strong>de</strong>s momies <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture paracas <strong>la</strong>isse supposer<br />
que l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis est <strong>américaine</strong> ; elle montre également que<br />
cette culture pratiquait <strong>de</strong>s trépanations et <strong>de</strong>s greffes osseuses (figure 9).<br />
Les croyances <strong>de</strong> ces peuples incluaient <strong>de</strong>s concepts magico-religieux qui ne<br />
différaient pas beaucoup <strong>de</strong>s concepts européens <strong>de</strong> l’époque; ils supposaient que<br />
<strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die était due à un châtiment divin pour leurs péchés, et ils s’en protégeaient<br />
à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> magie ou <strong>de</strong> l’occultisme et avec un arsenal thérapeutique<br />
bien plus vaste que celui d’Europe, au point que Philippe II, roi d’Espagne, envoya<br />
Francisco Hernán<strong>de</strong>z étudier les médicaments américains. Pour sa part, Hernán<br />
Cortés — conquistador du Mexique — avait une telle confiance dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
et les guérisseurs américains qu’il écrivit à Charles Quint pour lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r d’éviter<br />
<strong>la</strong> présence <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins européens en Amérique car il les jugeait inutiles.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin indigène qui traitait l’Inca et <strong>la</strong> noblesse était le hampi camayoc<br />
(hampi: mé<strong>de</strong>cine; camayoc: celui qui pratique), tandis que le camasca était le mé<strong>de</strong>cin<br />
soignant le peuple.<br />
La plupart <strong>de</strong>s médicaments provenaient du règne végétal, et certains sont toujours<br />
employés : <strong>la</strong> quinine ou cascarille (pour <strong>la</strong> fièvre et les tierces), le palissandre (pour<br />
367<br />
Figure 1.<br />
Culture moche.<br />
Huaco représentant<br />
l’uta<br />
Figure 2.<br />
Culture moche.<br />
Représentation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> verrue péruvienne
Figure 3.<br />
Culture moche.<br />
Représentation d’un<br />
albinos<br />
Figure 4.<br />
Culture mochica.<br />
Représentation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> paralyse faciale<br />
Figure 5.<br />
Culture <strong>la</strong>mbayeque.<br />
Poterie représentant<br />
l’éléphantiasis<br />
Figure 6.<br />
Culture mochica.<br />
Représentation<br />
d’hyperthyroïdisme<br />
avec leishmaniose<br />
(uta)<br />
Figure 7.<br />
Culture moche.<br />
Syphilis congénitale :<br />
nez en lorgnette<br />
Figure 8.<br />
Culture moche.<br />
Bec-<strong>de</strong>-lièvre<br />
Figure 9.<br />
Culture paracas.<br />
Trépanations et<br />
greffes osseuses<br />
Figure 10.<br />
B<strong>la</strong>son <strong>de</strong><br />
l’Universidad<br />
Nacional Mayor<br />
<strong>de</strong> San Marcos<br />
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
enlever les taches du visage), le faux poivrier (pour les maux <strong>de</strong> tête), <strong>la</strong> pomme <strong>de</strong> pin<br />
et le tamarinier (purgatifs), le guayacan (anti-diarrhéique), <strong>la</strong> uchangana (abortif), le<br />
guayruro (pour les maux <strong>de</strong> cœur), le vanargo (aphrodisiaque), l’isaña (pour réprimer<br />
l’appétit sexuel), entre autres.<br />
■ La La Conquête, <strong>la</strong> Vice-royauté <strong>la</strong> vice-royauté et les premières années <strong>de</strong> et <strong>la</strong> République les premières années<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
368<br />
Nous connaissons les pathologies <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête espagnole grâce aux<br />
textes <strong>de</strong>s chroniqueurs plutôt qu’aux personnes qui soignaient. L’éducation médicale au<br />
cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> vice-royauté correspondait à celle <strong>de</strong>s universités médiévales ; jusqu’au<br />
XVII e siècle, ni les sciences naturelles naissantes ni <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine ne furent enseignées.<br />
C’est ainsi qu’au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> Real y Pontificia Universidad <strong>de</strong> San Marcos, créée le 12 mai<br />
1551 (figure 10), on étudia seulement <strong>la</strong> théologie, les arts et le droit jusqu’en 1638. Au<br />
cours <strong>de</strong> cette année, une ordonnance royale <strong>de</strong> Philippe IV inclut l’enseignement formel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, à travers les chaires <strong>de</strong> prime et <strong>de</strong> vêpres ; plus tard, l’enseignement fut<br />
é<strong>la</strong>rgit par <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> Galien ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> (1691) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire d’anatomie (1711),<br />
qui fonctionna <strong>de</strong> façon irrégulière jusqu’en 1752, lorsque le roi confirma sa création.<br />
La pratique médicale était très limitée et s’exerçait chez les particuliers; les hôpitaux<br />
étaient plutôt <strong>de</strong>s « maisons <strong>de</strong> miséricor<strong>de</strong> ». La fonction <strong>de</strong> l’hôpital était d’ai<strong>de</strong>r « à <strong>la</strong><br />
bonne mort » chrétienne. Le soin médical était secondaire; les mé<strong>de</strong>cins et les chirurgiens<br />
percevaient <strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>ires symboliques. Certaines restrictions s’appliquaient aux personnes<br />
vou<strong>la</strong>nt faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine: il n’y avait que les « natifs sans signe d’infamie » qui pouvaient<br />
étudier, c’est-à-dire que les métis, les mulâtres et les enfants nés d’Indiens et <strong>de</strong><br />
Noirs ainsi que <strong>de</strong> métis et d’Espagnols étaient exclus. À ce<strong>la</strong> s’ajoutait le peu d’estime<br />
que l’élite créole éprouvait envers les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. C’est pour ces raisons que durant<br />
cette pério<strong>de</strong>, les rares mé<strong>de</strong>cins durent s’occuper un peu <strong>de</strong> tout. Vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
l’époque coloniale et le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> République oligarchique, <strong>la</strong> situation était i<strong>de</strong>ntique,<br />
car les idées religieuses et les obstacles sociaux freinaient le développement du corps médical;<br />
par exemple, en 1830 à Lima, il n’y avait que vingt-quatre mé<strong>de</strong>cins qui exerçaient<br />
<strong>la</strong> pratique médicale et, dix ans plus tard, il n’y en avait que <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> plus.
Jusqu’à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle, l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine était fondamentalement<br />
concentré à <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos et dans sa faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando.<br />
L’éducation <strong>de</strong>rmatologique dans <strong>la</strong> République <strong>de</strong>puis 1856 jusqu´au présent<br />
Les étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
■ L’enseignement <strong>de</strong>rmatologique sous <strong>la</strong> République<br />
<strong>de</strong> 1856 jusqu´à nos jours<br />
Pendant <strong>la</strong> République oligarchique<br />
(1856-1933), <strong>la</strong> Universidad Nacional<br />
Mayor <strong>de</strong> San Marcos réorienta l’éducation<br />
médicale sous l’influence <strong>de</strong> l’école<br />
clinique <strong>de</strong> Paris. En 1856, le Dr Cayetano<br />
Heredia créa <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine dans<br />
un local situé p<strong>la</strong>ce Santa Ana. Le collège<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando, fondé par<br />
Hipólito Unanue Pavón (1755-1833) et<br />
dont le nom fut choisi en l’honneur du vice-roi Fernando <strong>de</strong><br />
Abascal, qui soutenait son fonctionnement, existait avant <strong>la</strong><br />
création <strong>de</strong> cette faculté. Le Real Colegio <strong>de</strong> Medicina y Cirugía<br />
<strong>de</strong> San Fernando fut fondé le 18 juillet 1808 et fonctionna à côté du Real Hospital San<br />
Andrés jusqu’à 1821 ; entre 1821 et 1856, il fut appelé Colegio In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia. Depuis<br />
1856, on l’appelle faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando (figure 11). Son emp<strong>la</strong>cement<br />
actuel fut inauguré le 6 septembre 1903 dans le périmètre du Jardin botanique, avenue<br />
Grau (figure 12).<br />
La faculté <strong>de</strong>s sciences naturelles et <strong>de</strong> mathématiques <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos<br />
fut créée le 5 janvier 1855, son premier doyen étant le savant Antonio Raymondi. La faculté<br />
commença ses activités en 1866 en préparant les professeurs au cycle secondaire,<br />
étape obligatoire avant d’intégrer <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Fernando. Ceci est à<br />
l’origine <strong>de</strong> l’incorporation d’étu<strong>de</strong>s prémédicales au cursus <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures du<br />
mé<strong>de</strong>cin péruvien.<br />
Les registres <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos montrent qu’en 1887, le cursus médical<br />
comportait un cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie, à <strong>la</strong> charge du Dr Julián Arce<br />
(jusqu’en 1911), auquel succéda le Dr Belisario Sosa, remp<strong>la</strong>cé à son tour par le Dr Pedro<br />
Weiss Harvey en 1926. Le Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> — diplômé en France — occupa <strong>la</strong><br />
chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à partir <strong>de</strong> 1937, choisit le Dr Pablo Arana comme professeur<br />
auxiliaire et entama <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie selon les concepts <strong>de</strong> l’époque.<br />
En 1950, <strong>la</strong> chaire était intégrée par les Drs Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> (professeur principal),<br />
Arturo Sa<strong>la</strong>s (professeur associé) et Marcial Ayaipoma, Amaro Urrelo, Víctor Gonzáles et<br />
Luis Flores (professeurs auxiliaires).<br />
En 1961, suite à l’approbation <strong>de</strong> l’autonomie universitaire (l’article 34 <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi universitaire<br />
n° 13417 du 8 avril 1960 octroyait à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s privilèges spéciaux<br />
par rapport à <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s étudiants à <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté), 497<br />
enseignants présentèrent collectivement leur démission car ils n’étaient pas d’accord<br />
avec <strong>la</strong> direction conjointe (enseignants et étudiants). Quelques-uns regagnèrent plus<br />
tard <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine ; d’autres — dont le <strong>de</strong>rmatologue Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>,<br />
alors chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie — s’éloignèrent définitivement <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Certains <strong>de</strong>rmatologues qui travail<strong>la</strong>ient avec lui le suivirent. Cet épiso<strong>de</strong>, connu sous le<br />
nom <strong>de</strong> « schisme », détermina <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> sciences<br />
biologiques Cayetano Heredia, marquant le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> prolifération d’universités et <strong>de</strong><br />
369<br />
Figure 11.<br />
B<strong>la</strong>son <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad<br />
Nacional Mayor <strong>de</strong><br />
San Marcos<br />
Figure 12.<br />
Faça<strong>de</strong> principale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
370<br />
facultés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine dans le pays. Il n’existait jusqu’alors que <strong>de</strong>ux universités possédant<br />
une faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine : San Marcos et l’université nationale <strong>de</strong> Trujillo ; les cours<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s prémédicales étaient dispensés uniquement dans cette <strong>de</strong>rnière, les élèves<br />
<strong>de</strong>vant continuer le cursus à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Le recteur <strong>de</strong> l’UNMSM désigna un conseil transitoire du gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, et le Dr Alberto Cuba Caparó en fut désigné le doyen. Le Dr Clement Countar,<br />
<strong>de</strong>rmatologue nord-américain, fut embauché pour réorganiser le service d’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Le Dr Aizic Cotlear occupa <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> 1962 à 1980, remp<strong>la</strong>cé<br />
par le Dr Oscar Romero Rivas jusqu’en 1993, lorsque <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>vint<br />
une partie du cours <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne ; le Dr Dante Mendoza Rodríguez occupe actuellement<br />
le poste <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> service.<br />
Jusqu’à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e siècle, le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie se<br />
concentra à l’université <strong>de</strong> San Marcos. De nouvelles universités furent créées à partir <strong>de</strong><br />
1960, à Lima et dans le reste du pays, plusieurs d’entre elles possédant <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. En 1966, elles étaient au nombre <strong>de</strong> cinq: Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San<br />
Marcos, université péruvienne Cayetano Heredia, université nationale <strong>de</strong> Trujillo, université<br />
nationale San Agustín <strong>de</strong> Arequipa et université nationale San Luis Gonzaga <strong>de</strong> Ica.<br />
Actuellement, huit universités à Lima comprennent <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine :<br />
Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos, université péruvienne Cayetano Heredia,<br />
université Particu<strong>la</strong>r San Martín Porras, université nationale Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>real, université<br />
Ricardo Palma, université scientifique du Sud, université San Juan Bautista, université<br />
Norbert Wiener.<br />
L’université péruvienne <strong>de</strong> sciences médicales et biologiques Cayetano Heredia fut<br />
créée par les Drs Alberto Hurtado et Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> en 1962. Le premier en était<br />
le recteur tandis que le second dirigeait <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’université Particu<strong>la</strong>r San Martín <strong>de</strong> Porras fut fondée le 17 mai <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année,<br />
son premier recteur étant Víctor Sánchez Valer ; <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et d’odontologie<br />
débuta le 6 juillet 1983. En 1984 <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>vint indépendante, et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
fut enseignée à l’intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine interne ; toutefois, elle <strong>de</strong>vint un<br />
cours indépendant en 2002, à <strong>la</strong> charge du Dr Julio Bonil<strong>la</strong> Espinoza.<br />
L’université nationale Fe<strong>de</strong>rico Vil<strong>la</strong>rreal fut fondée le 18 septembre 1965 ; sa faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut créée par résolution du recteur (nº 1348) le 12 avril 1966, et par loi<br />
(nº14692) le 18 octobre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année. L’Hôpital universitaire est l’hôpital Hipólito<br />
Unanue (auparavant hôpital du thorax <strong>de</strong> Bravo Chico). Son premier doyen fut le Dr<br />
César Reynafarje Hurtado et le premier chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie le Dr Juan<br />
Manrique Ávi<strong>la</strong>.<br />
Dans le sud du pays, l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine débuta en 1827 à Arequipa, au<br />
Colegio <strong>de</strong> <strong>la</strong> In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, en coordination avec l’université <strong>de</strong> San Agustín. Le premier<br />
recteur en fut le Dr José Fernán<strong>de</strong>z Dávi<strong>la</strong>. La faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fonctionna avec<br />
<strong>de</strong>s hauts et <strong>de</strong>s bas jusqu’à sa fermeture en 1876 ; elle fut rouverte en 1958, l’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie y débutant en 1960, dispensé par le Dr Marcial Ríos Flores<br />
à l’hôpital Honorio Delgado (auparavant hôpital général). Parmi les enseignants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité, nous citerons les Drs Víctor Delgado Fernán<strong>de</strong>z et Luis Suárez Eliot ; le chef<br />
du service est actuellement le Dr Raúl Hurtado Pare<strong>de</strong>s, qui mit en p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’université catholique Santa María fut fondée en 1967 ; elle disposait d’une faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. À l’origine, le professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était le Dr Marcial Ríos Flores ; ensuite<br />
le Dr René Portugal Gallegos, le Dr Lilia Zapata Cárcamo et actuellement le Dr<br />
Fredy Mostajo Quiroz.<br />
Les élèves <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux universités font leur formation pratique dans les hôpitaux<br />
Goyeneche et Honorio Delgado, tous <strong>de</strong>ux appartenant à <strong>la</strong> Santé publique, ainsi qu’à<br />
l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale.
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
L’université San Antonio Abad <strong>de</strong>l Cuzco fut créée par le pape Innocent XII le 1 er mars<br />
1692. La faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut créée à son tour par le conseil exécutif le 25 août 1977<br />
et approuvée par le conseil régional <strong>de</strong> l’université péruvienne à Arequipa le 30 août<br />
1977. Finalement, le 2 décembre 1977, le conseil national <strong>de</strong> l’université péruvienne autorisa<br />
son fonctionnement à partir <strong>de</strong> 1980. La <strong>de</strong>rmatologie est actuellement enseignée<br />
par le Dr Roy García Cuadros au niveau <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures.<br />
L’université nationale <strong>de</strong> Trujillo, fondée le 10 mai 1824 par Simón Bolívar et Faustino<br />
Sánchez Carrión, fonctionne dans le nord du pays. C’est <strong>la</strong> quatrième université <strong>la</strong><br />
plus ancienne du Pérou, après San Marcos, San Cristóbal <strong>de</strong> Huamanga et San Antonio<br />
Abad <strong>de</strong>l Cuzco. Sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut inaugurée le 29 décembre 1957. L’enseignement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie débuta en 1964, l’hôpital <strong>de</strong> Belén étant le siège <strong>de</strong> <strong>la</strong> consultation<br />
externe. Le cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital régional d’enseignement fut ouvert<br />
en 1969. Les Drs Ángel Morgan Zavaleta à l’hôpital Belén et Luis Tincopa Montoya à l’hôpital<br />
régional furent les premiers professeurs <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures en <strong>de</strong>rmatologie.<br />
La spécialisation est à <strong>la</strong> charge du Dr Luis Tincopa Montoya, qui fut nommé professeur<br />
émérite au moment <strong>de</strong> sa retraite en janvier 2000 ; actuellement, il est chargé <strong>de</strong> coordonner<br />
le résidanat avec les mé<strong>de</strong>cins tuteurs Jenny Valver<strong>de</strong> López et Percy Rojas P<strong>la</strong>sencia.<br />
L’hôpital Víctor Lazarte Echegaray <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale <strong>de</strong>vint centre d’enseignement<br />
en 1974. Le Dr Víctor Che León et ensuite le Dr Oscar Tincopa Wong (1982) occupèrent<br />
le poste <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue assistant jusqu’en 2003. Actuellement, le Dr Hernán<br />
Padil<strong>la</strong> Corcuera s’occupe <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
Quant à l’université nationale <strong>de</strong> Trujillo, <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie débuta le<br />
1 er juin 1991, ayant comme siège l’hôpital régional d’enseignement <strong>de</strong> Trujillo. Le résidanat,<br />
interrompu en 2000, fut à <strong>la</strong> charge du Dr Luis Tincopa Montoya.<br />
L’université privée Antenor Orrego fut créée le 26 juillet 1988, sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
démarra ses activités en 1996. La <strong>de</strong>rmatologie commença à être enseignée en 2000 par<br />
les professeurs suivants : Oscar Tincopa Wong à l’hôpital Víctor Lazarte Echegaray <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sécurité sociale ; Ángel Morgan Zavaleta à l’hôpital <strong>de</strong> Belén ; Hernán Padil<strong>la</strong> Corcuera à<br />
<strong>la</strong> polyclinique Albretch <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale. À partir <strong>de</strong> 2003, les Drs José Azcurra<br />
Valle (polyclinique Albretch), Hernán Padil<strong>la</strong> Corcuera (hôpital Víctor Lazarte Echegaray)<br />
et Ángel Morgan Zavaleta (hôpital <strong>de</strong> Belén) sont les responsables <strong>de</strong> l’enseignement.<br />
L’université César Vallejo fut fondée en 1991 ; sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine entama ses activités<br />
en 2000.<br />
Chic<strong>la</strong>yo, <strong>la</strong> capitale du département <strong>de</strong> Lambayeque, inaugura l’université Pedro<br />
Ruiz Gallo le 17 mars 1970 ; <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine ouvrit en 1982 et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
commença à être enseignée en 1988. Le Dr José Ruiz Agüero, à l’hôpital national Almanzor<br />
Aguinaga <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale du Pérou, fut le premier professeur du cours. Actuellement<br />
le Dr Rosa Rodríguez Barboza est <strong>la</strong> coordinatrice du cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
tandis que le Dr Enrique Arias Pare<strong>de</strong>s en est le professeur auxiliaire.<br />
L’université Particu<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Chic<strong>la</strong>yo fut fondée le 31 mai 1993 et sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
en 1998 ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie y est enseignée <strong>de</strong>puis le mois <strong>de</strong> juillet 2003. Le Dr Aurora<br />
Cár<strong>de</strong>nas Silva fut le premier professeur du cours ; actuellement, c’est le Dr Hernán<br />
Agip Díaz qui en a <strong>la</strong> charge.<br />
À Piura, capitale du département homonyme, fonctionne l’université nationale <strong>de</strong><br />
Piura, fondée le 18 août 1961. Sa faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut inaugurée le 28 février 1979;<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie intègre le cours <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne ; son enseignement, dispensé par<br />
les Drs Rubén Torres Correa et Asterio Albines Bernal, se fait à l’hôpital régional <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
sécurité sociale.<br />
371
Figure 13.<br />
Couverture du<br />
premier programme<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’image montre<br />
<strong>la</strong> cour principale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando<br />
Figure 14.<br />
Faça<strong>de</strong> principale<br />
<strong>de</strong> l’hôpital<br />
Arzobispo Loayza<br />
Figure 15.<br />
Faça<strong>de</strong> principale<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Dos<br />
<strong>de</strong> Mayo<br />
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
372<br />
La spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie<br />
Dans les années 60 et 70, face au développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, le résidanat <strong>de</strong>vint<br />
nécessaire, contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, où <strong>la</strong> formation obtenue<br />
après <strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong> travail dans <strong>de</strong>s services hospitaliers qualifiés <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité était suffisante.<br />
C’est ainsi que se formèrent quelques-uns <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne,<br />
sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> professeurs nationaux ou dans <strong>de</strong>s centres étrangers<br />
(Argentine, Brésil, Espagne, France, Allemagne <strong>de</strong> l’Est et États-Unis).<br />
Le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos fut créé le 4 février 1981.<br />
Le premier comité <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité fut élu le 7 avril 1981 à l’unité <strong>de</strong> spécialisation, présidé<br />
par le Dr David Carrizales Ulloa, professeur principal. Le prési<strong>de</strong>nt actuel en est le<br />
professeur Dr Dante Mendoza Rodríguez. D’autres programmes <strong>de</strong> résidanat en <strong>de</strong>rmatologie<br />
furent créés ultérieurement dans d’autres universités déjà mentionnées.<br />
Le premier programme <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, toujours en vigueur (figure 13), fut établi à<br />
l’UNMSM en 1996, constituant un grand progrès dans <strong>la</strong> structuration du p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> formation<br />
du <strong>de</strong>rmatologue dans le pays.<br />
Les sièges hospitaliers pour l’enseignement<br />
La vocation pédagogique <strong>de</strong>s hôpitaux fut établie à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’UNMSM à Lima, en 1856; en conséquence, ils ajoutèrent l’enseignement<br />
universitaire à leurs objectifs. C’est ainsi que naquirent les sièges hospitaliers pour l’enseignement:<br />
il s’agit d’hôpitaux qui dispensent une instruction adéquate, aussi bien pour<br />
les étu<strong>de</strong>s supérieures que pour <strong>la</strong> spécialisation.<br />
Nous mentionnerons quelques-uns <strong>de</strong>s hôpitaux <strong>de</strong> Lima et <strong>de</strong> Cal<strong>la</strong>o, à cause <strong>de</strong> leur<br />
histoire.<br />
L’hôpital Arzobispo Loayza actuel (av. Alfonso Ugarte) fut inauguré le 10 décembre<br />
1924 pour remp<strong>la</strong>cer l’ancien hôpital Santa Ana, p<strong>la</strong>ce Italia <strong>de</strong> Lima,<br />
tout en gardant sa mission : soigner les pathologies féminines. Il fut rebaptisé hôpital<br />
Arzobispo Loayza le 27 mars 1954 (figure 14). Son premier directeur fut le<br />
Dr Juvenal Denegri. Les sœurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité <strong>de</strong> <strong>la</strong> congrégation Saint-Vincent<strong>de</strong>-Paul<br />
étaient chargées <strong>de</strong> l’administration <strong>de</strong> l’hôpital ; grâce à son travail dévoué,<br />
<strong>la</strong> mère supérieure Larrabure y Correa occupa <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’école<br />
d’infirmières <strong>de</strong> l’hôpital en 1939. Le mé<strong>de</strong>cin savant et grand archéologue Julio<br />
C. Tello, décédé le 3 juin 1947, fut soigné dans cet hôpital jusqu’à ses <strong>de</strong>rniers jours. Son<br />
cœur est conservé au musée <strong>de</strong> l’hôpital, où les professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé peuvent<br />
contempler <strong>la</strong> relique en signe <strong>de</strong> respect.<br />
Le Dr Guillermo Fernán<strong>de</strong>z Dávi<strong>la</strong> M. prit en charge le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans<br />
le pavillon <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infecto-contagieuses et cutanées, le Dr Víctor<br />
Gonzáles Pinillo le rejoignant jusqu’en 1937 ; le Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> occupa<br />
ensuite le poste <strong>de</strong> chef, remp<strong>la</strong>cé par Marcial Ayaipoma Vidalón, Víctor<br />
Meth Tuesta et Aldo Ayaipoma Nicolini jusqu’à maintenant. Ce service accueille<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues éminents, parmi lesquels on distingue Aurelio Loret<br />
<strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et Luis Flores Cevallos, tous <strong>de</strong>ux appartenant à l’école française<br />
ayant mo<strong>de</strong>rnisé <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne.<br />
L’hôpital Dos <strong>de</strong> Mayo — inauguré le 28 février 1875 pour remp<strong>la</strong>cer l’hôpital<br />
San Andrés (1557-1875), <strong>de</strong>stiné au soin <strong>de</strong>s pathologies masculines —<br />
possédait à une époque donnée <strong>la</strong> meilleure infrastructure <strong>de</strong> tous les hôpitaux<br />
d’Amérique du sud (figure 15). Son premier directeur fut Juan José Moreyra ; les<br />
sœurs <strong>de</strong> Saint-Vincent-<strong>de</strong>-Paul étaient chargées <strong>de</strong>s fonctions administratives. La supérieure<br />
sœur Elena Regnier rédigea <strong>de</strong>s notes <strong>de</strong>stinées au directeur où elle retraça<br />
une partie <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’occupation <strong>de</strong> l’hôpital par les troupes chiliennes et son
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
abandon ultérieur ; elle donna aussi son opinion sur le sacrifice <strong>de</strong> Daniel Alci<strong>de</strong>s Carrión<br />
(figure 16).<br />
Cet hôpital abrita les faits principaux <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
du Pérou pendant le XIX e siècle et <strong>la</strong> première moitié du XX e siècle ; citons comme<br />
exemple Daniel Alci<strong>de</strong>s Carrión. C’est également à cet endroit que fut instaurée <strong>la</strong> fête<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine (5 octobre 1930), ainsi que l’Association médicale péruvienne Daniel Alci<strong>de</strong>s<br />
Carrión.<br />
Rénové en 1967 avec l’appui <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation Kayser, il <strong>de</strong>vint un hôpital général, c’està-dire<br />
<strong>de</strong>stiné aux hommes, aux femmes et aux enfants.<br />
Le service <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau entra en fonction en 1935 au pavillon <strong>de</strong> San Lázaro,<br />
dirigé par le <strong>de</strong>rmatologue italo-péruvien Alfieri Val<strong>de</strong>ttaro et par le Dr Pablo Nagaro.<br />
Le service fut transféré en 1942 dans un local construit pour abriter un <strong>la</strong>boratoire<br />
clinique, situé entre <strong>la</strong> morgue et le pavillon pour enfants ; finalement (1945), le service<br />
prit p<strong>la</strong>ce dans ce <strong>de</strong>rnier pavillon, le Dr Alfredo Parodi Bacigalupo <strong>de</strong>venant chef <strong>de</strong> service<br />
<strong>de</strong> San Lázaro et San Camilo.<br />
Le premier chef du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut le Dr Arturo Sa<strong>la</strong>s Brousset, à<br />
qui succédèrent les Drs Enrique Franciscolo Castagnino, Julio Bonil<strong>la</strong> Espinoza, Oscar<br />
Romero Rivas, Victoria Morante Sotelo et Carlos Ga<strong>la</strong>rza Manyari.<br />
L’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> police fut inauguré le 30 octobre 1942 et comptait 250 lits; le cabinet <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie, à <strong>la</strong> charge du Dr Luis García Arrese, se trouvait à l’intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique<br />
<strong>de</strong>s officiers. Le Dr García Arrese fut remp<strong>la</strong>cé par les <strong>de</strong>rmatologues suivants: Arturo<br />
Sa<strong>la</strong>s Brousset, Carlos Rizo Patrón Tassara, Oswaldo Pare<strong>de</strong>s Reynoso, Emilio Carranza<br />
Cordivio<strong>la</strong>, Alberto Torero, Manuel Ba<strong>la</strong>guer Rosas et Guido Pare<strong>de</strong>s Llerena. Le premier<br />
directeur <strong>de</strong> l’hôpital fut le lieutenant-colonel <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé Juan José Mostajo Vargas.<br />
L’hôpital ouvrier (appelé aujourd’hui hôpital Guillermo Almenara) fut inauguré le<br />
12 août 1936, mais les activités n’y débutèrent que le 10 février 1941. Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
disposait <strong>de</strong> quatorze lits ; son premier chef fut le Dr Pablo Arana Iturri, auquel<br />
succédèrent Juan Manrique Ávi<strong>la</strong>, Adrián Casafranca Lovatón, Luis Rioja Ugaz et<br />
José Catacora Cama.<br />
L’hôpital militaire central, inauguré le 31 décembre 1957, reçut le personnel <strong>de</strong> l’ancien<br />
hôpital militaire San Bartolomé, où fonctionnait le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, syphiligraphie<br />
et ma<strong>la</strong>dies infecto-contagieuses <strong>de</strong>puis 1952. Son premier chef fut le<br />
lieutenant-colonel <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé Luis Castro Mendivil (jusqu’en 1962). Le premier mé<strong>de</strong>cin<br />
<strong>de</strong>rmatologue qui y travail<strong>la</strong> fut le lieutenant-colonel <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé Raúl Gal<strong>la</strong>rday Vásquez,<br />
formé en Argentine, qui fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entre 1962 et 1977. Il fut<br />
remp<strong>la</strong>cé par les Drs colonels <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé mé<strong>de</strong>cin Julio Saldaña Patiño, Alejandro Rosé<br />
Gonzáles et Leonardo Sánchez Saldaña. Le Dr David Carrizales Ulloa, <strong>de</strong> l’école<br />
française (Paris), travail<strong>la</strong> comme mé<strong>de</strong>cin conseiller enseignant et il eut une<br />
gran<strong>de</strong> influence sur le développement <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’hôpital<br />
militaire. En 1968, le service prit le nom <strong>de</strong> département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’hôpital central d’aéronautique (force aérienne du Pérou) (figure 17) fut<br />
inauguré le 8 juillet 1969 et comptait un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dirigé par le<br />
colonel FAP mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue Luis Cavero Ortiz ; les Drs Luis Valdivia<br />
Blon<strong>de</strong>t, Manuel Palomino Yamamoto et Rafael Gamarra y furent admis ultérieurement.<br />
Le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie est <strong>de</strong>puis 1984 le siège hospitalier <strong>de</strong><br />
l’enseignement <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos. Ses chefs furent le colonel FAP<br />
mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t (qui atteignit le gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> général),<br />
le colonel FAP mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmatologue Dr Manuel Palomino Yamamoto, le colonel<br />
FAP mé<strong>de</strong>cin Rafael Gamarra Gálvez, les commandants FAP mé<strong>de</strong>cins Bruno Ciriani Anchorena<br />
et Lizandro Obregón Sevil<strong>la</strong>no. Ce service <strong>de</strong>rmatologique fut le premier dans<br />
l’histoire du pays à être reconnu comme médico-chirurgical par l’institution dont il faisait<br />
partie. Il fut le modèle d’organisation mo<strong>de</strong>rne d’un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
373<br />
Figure 16.<br />
Daniel Alci<strong>de</strong>s<br />
Carrión García,<br />
Héros national<br />
Figure 17.<br />
Hôpital Central<br />
d’Aéronautique
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
médico-chirurgical, ses instal<strong>la</strong>tions disposant <strong>de</strong> sections <strong>de</strong> radiothérapie, <strong>de</strong> photothérapie,<br />
d’allergologie, <strong>de</strong> microscopie, d’une salle <strong>de</strong> photographie, d’un bloc opératoire<br />
ambu<strong>la</strong>toire et <strong>de</strong> cabinets externes.<br />
L’hôpital national Daniel Alci<strong>de</strong>s Carrión était composé du « secteur Carrión » et du<br />
« secteur San Juan », construits par <strong>la</strong> bienfaisance publique du Cal<strong>la</strong>o ; le premier fut<br />
inauguré en 1941 et le <strong>de</strong>uxième en 1968. L’unification eut lieu le 15 octobre 1971, <strong>de</strong>venant<br />
le complexe hospitalier Daniel A. Carrión, en hommage au martyr <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
péruvienne, héros national. Le Dr Wences<strong>la</strong>o Castillo Riva<strong>de</strong>neyra fut le premier chef du<br />
Service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; il occupa ce poste jusqu’à sa retraite (1999), le Dr Zaida Gutiérrez<br />
Y<strong>la</strong>ve lui succédant.<br />
L’hôpital central <strong>de</strong> l’Employé, <strong>de</strong> l’institut péruvien <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité sociale — hôpital<br />
Edgardo Rebagliati Martins — fut fondé le 2 novembre 1958 ; le premier chef du service<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut le Dr Luis Flores-Cevallos, remp<strong>la</strong>cé par les Drs Pedro Navarro<br />
Huamán, Enrique Yoshiyama Tanaka et Gadwyn Sánchez Félix.<br />
Le centre médical naval, fondé en 1956, dispose <strong>de</strong>puis le début d’un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
dirigé par José San Martín Razzeto, Humberto Costa Alfaro, Octavio Small<br />
Arana, Hugo Condori Di Burga et Gustavo Beltrán Grados.<br />
L’institut <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> l’enfant — hôpital <strong>de</strong> l’enfant — fut inauguré le 1 er novembre<br />
1929 par Augusto B. Leguía, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, sous le nom d’hôpital d’enfants<br />
Julia Swayne <strong>de</strong> Leguía. Son premier directeur fut le Dr Carlos Krumdieck. Les cabinets<br />
externes commencèrent à fonctionner en janvier 1930, recevant sept patients le premier<br />
jour ; au cours du mois d’avril, les vingt premiers lits furent mis en p<strong>la</strong>ce. Actuellement<br />
c’est le centre <strong>de</strong> référence pour les pathologies infantiles. Son service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique est à <strong>la</strong> charge du Dr Rosalía Ballona Chambergo.<br />
L’hôpital Alberto Sabogal Sologuren fut fondé en 1942 ; il changea <strong>de</strong> nom en 1974 et<br />
<strong>de</strong>vint l’hôpital <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone n° 1 IPSS. Un nouveau centre hospitalier fut inauguré à Bel<strong>la</strong>vista<br />
le 12 février 1982, <strong>de</strong>venant en 1991 l’hôpital régional III.<br />
Le Dr Luis Flores-Cevallos créa en 1950 le cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui fut transféré<br />
quelques années plus tard (1961) au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Edgardo Rebagliati.<br />
Le Dr Juan Meza Balbuena y fut admis au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, l’équipe <strong>de</strong><br />
travail étant intégrée comme suit : Dr Juan Meza Balbuena (mé<strong>de</strong>cin-chef), Dr Emma<br />
Ávi<strong>la</strong> Del Carpio, Dr Gloria Baquerizo et Dr Rogelio Pinto Sa<strong>la</strong>s. En 1984 l’équipe <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
était composée <strong>de</strong>s Drs Humberto Gonzáles Garay (mé<strong>de</strong>cin-chef), Gloria Baquerizo,<br />
Emma Ávi<strong>la</strong> Del Carpio, Rogelio Pinto Sa<strong>la</strong>s, Humberto Costa Alfaro, Herbert<br />
Tirado, Carlos Guerra Carbajal, Daniel Valver<strong>de</strong> Bejarano et José Sa<strong>la</strong>zar Zumarán. Le<br />
Dr Gonzáles Garay occupa le poste <strong>de</strong> chef du service entre 1980 et 1992 (quand il partit<br />
à <strong>la</strong> retraite), remp<strong>la</strong>cé par le Dr Emma Ávi<strong>la</strong> Del Carpio. En 1994, le Dr Rogelio Pinto<br />
Sa<strong>la</strong>s prit en charge le poste, qu’il exerce toujours. Le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie débuta<br />
en juin 2000, avec l’admission du Dr Ferdinando <strong>de</strong> Amat Loza.<br />
L’hôpital María Auxiliadora fut fondé en août 1986, comptant un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dirigé dès le début par le Dr César Pérez <strong>de</strong>l Arca. Cet hôpital constitue <strong>de</strong>puis 1986<br />
le siège d’enseignement <strong>de</strong> l’UNMSM pour les étu<strong>de</strong>s supérieures, et pour <strong>la</strong> formation<br />
<strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nts en <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>puis mai 2000.<br />
■ Les sociétés scientifiques scientifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité<br />
374<br />
Le Collège médical du Pérou, en vertu <strong>de</strong> ses fonctions, c<strong>la</strong>ssifia les sociétés scientifiques<br />
comme suit : principales — représentant <strong>la</strong> spécialité dans tout le pays — et spéciales<br />
— <strong>de</strong>s filiales <strong>de</strong>s sociétés scientifiques internationales — (règlement <strong>de</strong>s sociétés<br />
médico-scientifiques du Collège médical du Pérou 1999, article 7).
La Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
La Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie fut fondée le 15 février<br />
1951, au cours d’une séance solennelle au salon <strong>de</strong>s conférences <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo<br />
Loayza, présidée par le Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> et qui compta <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s Drs Ricardo<br />
Pazos Vare<strong>la</strong> (faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine), Gilberto Morey (prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération<br />
médicale péruvienne), Oswaldo Hercelles (vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> bienfaisance<br />
publique <strong>de</strong> Lima), Guillermo Basombrío (prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>rmatologique d’Argentine),<br />
Juan Machiavello (directeur <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza) et Víctor Eguiguren<br />
(mé<strong>de</strong>cin-chef du service antivénérien). La première commission directive fut intégrée<br />
comme suit : prési<strong>de</strong>nt, Pr. Dr Aurelio Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong> ; secrétaire, Dr Amaro Urrelo ; trésorier,<br />
Dr Marcial Ayaipoma V.; membres, Drs Pedro Weiss, Hugo Pesce, Pablo Arana et<br />
Arturo Sa<strong>la</strong>s Brouset.<br />
La société cessa ses activités pour <strong>de</strong>s raisons inconnues.<br />
Le 1 er septembre 1964, un groupe <strong>de</strong> vingt-<strong>de</strong>ux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues réunis dans<br />
les locaux <strong>de</strong> l’Association médicale Daniel Alci<strong>de</strong>s Carrión décida <strong>de</strong> former une association<br />
qu’ils appelèrent Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; ils en rédigèrent et souscrivirent<br />
l’acte <strong>de</strong> fondation et nommèrent <strong>la</strong> commission organisatrice, présidée par le<br />
Dr Aizic Cotlear.<br />
Les membres fondateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> société furent Guillermo Arana Zapatero, Marcial Ayaipoma<br />
Vidalón, Zuño Burstein Alva, Antonio Caldas Rodríguez, Elda Puertas (née Cana<strong>de</strong>ll),<br />
Wences<strong>la</strong>o Castillo Riva<strong>de</strong>neyra, Luis Cavero Ortiz, Aizic Cotlear Dolberg, Carlos<br />
Echegaray, Enrique Franciscolo Castagnino, Raúl Gal<strong>la</strong>rday Vásquez, Rafael Gonzáles<br />
Will, Juan Manrique Ávi<strong>la</strong>, Oswaldo Pare<strong>de</strong>s Reynoso, Carlos Rega<strong>la</strong>do, César Rojas Miranda,<br />
María Elena Ruiz Soto, José San Martín Razzeto, Enrique Sifuentes, Nicolás Tapia<br />
Dueñas, Amaro Urrelo Novoa et Alfredo Yong Laos.<br />
Deux mois plus tard, les élections désignèrent <strong>la</strong> première commission directive <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société, présidée par le Dr Amaro Urrelo Novoa ; il fut remp<strong>la</strong>cé par quatorze prési<strong>de</strong>nts<br />
et leurs commissions directives respectives, qui dirigèrent <strong>la</strong> société jusqu’en 2004, <strong>la</strong><br />
durée du gouvernement étant à l’origine d’un an et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans à partir <strong>de</strong> 1975.<br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie furent les suivants :<br />
1965-1966 Dr Amaro Urrelo Novoa (réélu)<br />
1967 Dr Juan Manrique Ávi<strong>la</strong><br />
1968-1969 Dr Aizic Cotlear Dolberg (réélu)<br />
1970-1971 Dr Luis Flores-Cevallos (réélu)<br />
1972-1973 Dr Wences<strong>la</strong>o Castillo Riva<strong>de</strong>neyra (réélu)<br />
1974 Dr Zuño Burstein Alva<br />
1975-1976 Dr Raúl Gal<strong>la</strong>rday Vásquez<br />
1977-1978 Dr Antonio Caldas Rodríguez<br />
1979-1980 Dr Humberto Gonzáles Garay<br />
1981-1982 Dr David Carrizales Ulloa<br />
1983-1984 Dr Manuel Palomino Yamamoto<br />
1985-1986 Dr David Carrizales Ulloa<br />
1987-1988 Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t<br />
1989-1990 Dr José Sa<strong>la</strong>zar Zumarán<br />
1991-1992 Dr Julio Saldaña Patiño<br />
1993-1994 Dr David Carrizales Ulloa<br />
1995-1996 Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t<br />
1997-1998 Dr Héctor Cáceres Ríos<br />
1999-2000 Dr Leonardo Sánchez Saldaña<br />
2001-2002 Dr Gadwyn Sánchez Félix<br />
2003-2004 Dr Nicolás Tapia Dueñas<br />
375
Figure 18.<br />
Logo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Figure 19.<br />
Diplôme <strong>de</strong><br />
reconnaissance en<br />
tant que société<br />
scientifique<br />
principale<br />
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
376<br />
D’après certains documents, <strong>la</strong> première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’admission eut lieu le 17 mars<br />
1965, faite par le Dr José Ruiz Agüero. En 2004, <strong>la</strong> société rassemble 245 associés, sans<br />
tenir compte <strong>de</strong>s membres honoraires ni <strong>de</strong>s membres correspondants. Le symbole <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société fut approuvé pendant <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> <strong>la</strong> première commission directive : il s’agit<br />
d’un huaco retrato <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture mochica (figure 18) représentant un noble atteint<br />
d’uta, ma<strong>la</strong>die propre à notre pays et profondément enracinée dans le patrimoine <strong>de</strong>rmatologique<br />
local; le modèle <strong>de</strong> diplôme permettant <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> société<br />
fut approuvé vers <strong>la</strong> même époque.<br />
Le premier statut fut approuvé le 1 er octobre 1964 ; <strong>de</strong>puis, il a subi plusieurs modifications<br />
au cours <strong>de</strong>s assemblés statutaires ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière modification, du 25 novembre<br />
1996, est toujours en vigueur.<br />
Le Collège médical du Pérou n’existait pas dans les premiers temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, et c’était <strong>la</strong> Fédération médicale péruvienne qui contrô<strong>la</strong>it<br />
<strong>la</strong> profession médicale dans le pays, tant pour les aspects syndicaux et que pour<br />
les aspects éthiques. La société fut acceptée comme organe <strong>de</strong> base le 19 septembre<br />
1965, <strong>la</strong> Fédération médicale péruvienne étant toujours en vigueur comme une organisation<br />
syndicale nationale ; c’est <strong>de</strong> là que proviennent les grands lea<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
comme les Drs Max Cár<strong>de</strong>nas, Julio Castro Gómez et l’actuel doyen national<br />
du Collège médical du Pérou, le Dr Isaías Peñaloza Rodríguez.<br />
Les statuts du Collège médical du Pérou furent approuvés le 1 er juillet 1969 ; en janvier<br />
1970, le premier conseil <strong>de</strong> direction entra en fonction. Les objectifs <strong>de</strong> cette institution<br />
au niveau national sont aussi bien scientifiques et éthiques que déontologiques<br />
(non syndicales) ; elle reçoit le soutien <strong>de</strong>s sociétés scientifiques nationales pour exercer<br />
ces fonctions. Grâce au respect <strong>de</strong> toutes les normes et exigences requises par le registre<br />
d’institutions médico-scientifiques, <strong>la</strong> société fut reconnue comme telle par le Conseil national<br />
CMP-CN-146 le 28 décembre <strong>de</strong> 1973.<br />
De nouvelles sous-spécialités surgirent avec le temps, regroupant <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins qui se<br />
consacraient à l’étu<strong>de</strong> d’une partie <strong>de</strong> leur spécialité <strong>de</strong> base. C’est ainsi que proliférèrent<br />
<strong>de</strong> nouvelles sociétés qui cherchaient à avoir un rôle principal, entrant en<br />
concurrence avec les sociétés mères et rendant difficile <strong>la</strong> supervision <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> part du collège. Celui-ci nomma alors un comité pour étudier et réglementer les sociétés<br />
scientifiques ; <strong>la</strong> SPD s’inscrivit comme société scientifique principale dans le<br />
registre national d’institutions médico-scientifiques (folio nº 005 du registre <strong>de</strong>s sociétés<br />
médicales principales, par résolution du Conseil national nº 1680, 12 mai 1999)<br />
(figure 19). Son rapport avec le Collège médical du Pérou fut toujours loyal et mérita<br />
un diplôme d’honneur le 5 octobre 1988.<br />
L’Association <strong>de</strong>rmatologique sud-péruvienne fut fondée le 18 août 1972 à Arequipa<br />
et reconnue comme une filiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> société le 29 décembre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année ;<br />
elle arrêta ultérieurement ses activités jusqu’en 1995, au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> filiale sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dont le siège se trouve à Arequipa.<br />
Cette filiale, coordonnée par les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> région sud (Arequipa,<br />
Cuzco et Tacna), fut à l’origine présidée par le Dr Víctor Delgado Fernán<strong>de</strong>z.<br />
L’idée <strong>de</strong> former <strong>la</strong> filiale nord surgit en 1979 et se concrétisa le 15 août 1987 ; elle<br />
fut présidée par le Dr Luis Tincopa Montoya.<br />
Les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> société qui se consacraient aux sous-spécialités formèrent plusieurs<br />
délégations, en dépit <strong>de</strong> leurs intérêts personnels, comprenant que <strong>la</strong> division affaiblissait<br />
<strong>la</strong> représentativité et <strong>la</strong> force <strong>de</strong> leur société principale. La première fut <strong>la</strong> Délégation <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique (1995), présidée lors <strong>de</strong> sa création par le Dr Héctor Cáceres Ríos<br />
et actuellement par le Dr Rosalía Bayona Chambergo. La Délégation <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
fut formée le 8 mars 1996, son premier prési<strong>de</strong>nt étant le Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t,<br />
tandis que le Dr Lizandro Obregón Sevil<strong>la</strong>no est son prési<strong>de</strong>nt actuel. L’action <strong>de</strong> cette<br />
délégation est méritoire car elle conçut et mit en route pour <strong>la</strong> première fois au Pérou les
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
campagnes <strong>de</strong> prévention, <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> traitement du cancer cutané dans les zones<br />
socialement et économiquement démunies. Son enthousiasme pour mettre en p<strong>la</strong>ce les<br />
cours <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique pendant <strong>la</strong> spécialisation éveil<strong>la</strong> l’intérêt pour <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université Mayor <strong>de</strong> San Marcos.<br />
Le 28 août 2002 fut fondée <strong>la</strong> Délégation <strong>de</strong> photobiologie (premier prési<strong>de</strong>nt : Dr Luis<br />
Valdivia Blon<strong>de</strong>t ; prési<strong>de</strong>nt actuel : Dr Gustavo Beltrán Grados) ; les créations plus récentes<br />
sont les Délégations d’enseignement, présidée par le Dr Manuel Palomino Yamamoto<br />
; d’histopathologie cutanée, présidée par le Dr Gadwyn Sánchez Félix, et <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie gériatrique, présidée par le Dr Arturo Saettone León.<br />
Quant aux publications, <strong>la</strong> société édite <strong>la</strong> revue Dermatología Peruana. Elle succéda<br />
à <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Peruana <strong>de</strong> Dermatología, dont le premier numéro parut en<br />
juin 1967 sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Juan Manrique Ávi<strong>la</strong>, et fut édité par Mme Beatriz <strong>de</strong><br />
Marcenaro. Sa publication s’arrêta en 1972, <strong>la</strong> revue Dermatología Peruana paraissant<br />
en 1996 avec le volume n° 6 (figure 20) (perpétuant ainsi <strong>la</strong> numérotation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Peruana <strong>de</strong> Dermatología), sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t,<br />
qui était également l’éditeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication ; le Dr Arturo Saettone León lui succéda<br />
en 2001.<br />
Le Boletín <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad Peruana <strong>de</strong> Dermatología, à caractère essentiellement syndical<br />
et social, est publié périodiquement. Des livres furent également publiés, tels Infectología<br />
y Piel [Infectiologie et peau] et Actualización en Dermatología [Actualisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie], <strong>de</strong>s Drs Leonardo Sánchez Saldaña et Jorge Candiotti Vera (2000); Dermatosis<br />
profesionales [Dermatoses professionnelles], du Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t ; Temas<br />
<strong>de</strong> Enfermeda<strong>de</strong>s Transmisibles Sexualmente [Sujets <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles],<br />
du Dr Oscar Tincopa Wong.<br />
En tant que société scientifique principale du pays, <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
est autorisée à effectuer <strong>de</strong>s congrès nationaux et internationaux sur <strong>la</strong> spécialité.<br />
Jusqu’à présent, dix congrès nationaux furent organisés: le I er Congrès national (1971), effectué<br />
à l’hôpital <strong>de</strong> l’employé à Lima; le II e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le IV e<br />
Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (23-26 juillet 1979), à l’hôpital militaire central, présidé<br />
par le Dr Juan Manrique Ávi<strong>la</strong>; le III e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, auquel assistèrent<br />
<strong>de</strong>s professeurs invités prestigieux, les Drs Arturo Tapia (Panama), Jorge Abu<strong>la</strong>fia<br />
(Argentine) et Emilio Quintanil<strong>la</strong> (Espagne), réalisé à l’hôpital militaire central (12 au<br />
12 novembre), sous <strong>la</strong> direction du Dr David Carrizales Ulloa; le IV e Congrès péruvien <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie (1988), à l’hôpital militaire central, présidé par le Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t;<br />
le V e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (21-26 octobre 1990), à l’hôpital Alberto Sabogal<br />
et présidé par le Dr José Sa<strong>la</strong>zar Zumarán; le VI e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, au<br />
Círculo Militar <strong>de</strong>l Perú (8-10 novembre 1996), sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Luis Valdivia Blon<strong>de</strong>t<br />
— désormais, les congrès nationaux furent considérés comme <strong>de</strong>s événements <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> envergure; le VII e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Lima (24-27 septembre<br />
1998), dirigé par le Dr Leonardo Sánchez Saldaña; le VIII e Congrès <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (du<br />
30 août au 3 septembre 2000), réalisé à Arequipa et présidé par le Dr Héctor Cáceres Ríos;<br />
le IX e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, le XVII e Congrès bolivarien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et le<br />
I er Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> photobiologie, effectués du 28 août au 1 er septembre 2002<br />
à Lima, dirigés par le Dr Gadwyn Sánchez Félix; le X e Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
réalisé entre le 1 er et le 5 septembre 2004, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Nicolás Tapia Dueñas.<br />
En 2003, <strong>la</strong> société sponsorisa le III e Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
qu’elle organisa avec <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
La première épreuve <strong>de</strong> force eut lieu en juillet 1971, lorsque plusieurs professeurs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> société furent victimes d’un abus <strong>de</strong><br />
pouvoir <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> San Marcos<br />
: ils ne furent pas ratifiés dans leurs postes d’enseignement, sans droit préa<strong>la</strong>ble à<br />
leur défense. À ce moment-là, <strong>la</strong> société ne sut pas défendre ses associés : au cours<br />
377<br />
Figure 20.<br />
Couverture <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie
LUIS VALDIVIA BLONDET<br />
d’une assemblée du conseil <strong>de</strong> direction (1971), elle déc<strong>la</strong>ra qu’elle n’interviendrait pas<br />
car « ce n’était pas du ressort <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ». Actuellement<br />
<strong>la</strong> leçon a été retenue et <strong>la</strong> société peut s’enorgueillir d’avoir défendu plusieurs<br />
fois avec succès ses associés et <strong>la</strong> profession, même au cours <strong>de</strong> crises politiques nationales<br />
où les garanties individuelles étaient suspendues, avec les risques que ce<strong>la</strong> implique.<br />
Quant à l’enseignement, cette société accomplit en permanence son activité éducatrice<br />
à travers l’organisation <strong>de</strong> cours d’actualisation, <strong>de</strong> journées et <strong>de</strong> tables ron<strong>de</strong>s<br />
s’adressant au spécialiste et au mé<strong>de</strong>cin généraliste. Elle s’est toujours battue pour <strong>la</strong><br />
création du résidanat médical sco<strong>la</strong>risé, objectif qui fut atteint le 4 février 1981. Les premiers<br />
comités <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité pour le programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième spécialisation en mé<strong>de</strong>cine<br />
humaine furent désignés par une résolution rectorale nº 63772 du 7 avril 1981 ; le<br />
comité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie était intégré par les Drs David Carrizales Ulloa (prési<strong>de</strong>nt), Víctor<br />
Meth Tuesta, Iram La Torre Tuesta, Wences<strong>la</strong>o Castillo Riva<strong>de</strong>neyra et Oscar Romero<br />
Rivas.<br />
La SPD eut toujours une attitu<strong>de</strong> positive et éthique envers les sociétés scientifiques<br />
nationales et internationales. Elle appartient à <strong>la</strong> Fédération bolivarienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>puis 1965 ; elle est fidèle à <strong>la</strong> doctrine qui émane du Collège médical du Pérou : les<br />
sociétés scientifiques internationales n’ont aucune prééminence sur les sociétés nationales.<br />
Le 1 er septembre 1999, le désir <strong>de</strong> disposer d’un local propre, un endroit où tous les<br />
<strong>de</strong>rmatologues puissent se réunir et travailler dans le but <strong>de</strong> promouvoir <strong>la</strong> spécialité et<br />
non pas <strong>de</strong> <strong>la</strong> fragmenter, <strong>de</strong>vint une réalité.<br />
CILAD-Pérou<br />
Le CILAD-Pérou est une association formée en 1964 par le délégué national du Collège<br />
ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD), appelée <strong>de</strong> nos jours CIDERM<br />
(Cercle <strong>de</strong>rmatologique du Pérou) et qui est inscrite au registre spécial <strong>de</strong>s filiales d’institutions<br />
médicales scientifiques internationales. L’activité scientifique déployée reproduisit<br />
celle développée par <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ; notons également<br />
l’édition <strong>de</strong> <strong>la</strong> revue Folia Dermatológica.<br />
■ Épilogue<br />
378<br />
Malgré les preuves que les pathologies cutanées étaient connues <strong>de</strong>puis l’époque<br />
précolombienne, l’histoire mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne commence au<br />
XIX e siècle — époque à <strong>la</strong>quelle débute <strong>la</strong> spécialité dans le mon<strong>de</strong> entier. Son évolution<br />
historique tourne autour <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux axes fondamentaux : <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> San<br />
Fernando <strong>de</strong> <strong>la</strong> Universidad Nacional Mayor <strong>de</strong> San Marcos et <strong>la</strong> Société péruvienne <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie. ■<br />
Remerciements<br />
Septembre 2005<br />
Nous voulons remercier le Dr Nicolás Tapia Dueñas, qui nous a fourni ses photographies<br />
<strong>de</strong> huacos pour cet ouvrage ; Julio Bonil<strong>la</strong> Espinoza, Oscar Romero Pridat et Carlos<br />
Ga<strong>la</strong>rza Manyari, qui nous procurèrent les renseignements sur l’histoire <strong>de</strong> l’hôpital
Notes sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie péruvienne<br />
Dos <strong>de</strong> Mayo ; le Dr G<strong>la</strong>dys Vidarte Orrego, pour nous avoir aidés à obtenir <strong>de</strong>s informations<br />
sur l’histoire <strong>de</strong> l’hôpital Arzobispo Loayza ; le Dr Oscar Tincopa Wong, qui nous<br />
fournit <strong>de</strong>s renseignements sur l’histoire <strong>de</strong>rmatologique dans le nord du Pérou ; les<br />
Drs Víctor Delgado Fernán<strong>de</strong>z et Marcial Ríos Flores, pour leurs renseignements sur <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie dans le sud du Pérou ; et tous ceux qui rendirent possible <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong><br />
cet ouvrage.<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Arias Schereiber J. La Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina <strong>de</strong> Arequipa en el<br />
siglo XIX. Lima: Editorial<br />
Universitaria; 1973.<br />
Arquio<strong>la</strong> E. La materia médica en<br />
el mundo mo<strong>de</strong>rno. Historia<br />
<strong>de</strong>l medicamento. Madrid:<br />
Dira; 1985.<br />
Bustíos Romaní C. « Notas sobre<br />
<strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> educación<br />
médica en el Perú. Primera<br />
Parte: 1568-1933. »<br />
Acta Médica Peruana. 2003;<br />
XX(2): 94-108.<br />
Cabieses F. Dioses y<br />
enfermeda<strong>de</strong>s. Lima:<br />
Ortegraf; 1974.<br />
Castillo Narváez F. Benemérito<br />
Hospital Dos <strong>de</strong> Mayo. Su<br />
génesis y proyecciones. Lima:<br />
Gráfica Liz Ana; 1993.<br />
Castillo Narváez F. Un pedazo <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> historia <strong>de</strong>l Hospital Dos <strong>de</strong><br />
Mayo. Lima: Monterrico;<br />
1987.<br />
Flores Cevallos L., Flores Cevallos<br />
E. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
en el Perú (200 años a.C.siglo<br />
XX). Lima: Hozlo; 1999.<br />
Guerra García R. Alberto Hurtado:<br />
médico y educador. Lima:<br />
Universidad Peruana<br />
Cayetano Heredia; 2001.<br />
Lastres J.B. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina Peruana. Tomos I, II<br />
y III. Lima: UNMSM; 1951.<br />
Morales Lan<strong>de</strong>o E. Daniel Alci<strong>de</strong>s<br />
Carrión García. Lima: Impreso<br />
<strong>de</strong>l Colegio Médico <strong>de</strong>l Perú;<br />
2000.<br />
Nava Carrión C. Historia <strong>de</strong>l<br />
Hospital Arzobispo Loayza<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> sus orígenes. Lima:<br />
Editora Perú; 1999.<br />
Rabi Chara M. « Del Hospital <strong>de</strong><br />
Santa Ana al Hospital<br />
Nacional Arzobispo Loayza<br />
(1925-1999). 450 años <strong>de</strong><br />
protección <strong>de</strong> <strong>la</strong> salud <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
personas. » Dans: Lastres J.B.<br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina<br />
Peruana. Tomo II. Lima:<br />
UNMSM; 1951.<br />
Tapia Dueñas N. Dermatología y<br />
cosmetología en el Antiguo<br />
Perú. Lima: Schering-Plough;<br />
2000.
La mé<strong>de</strong>cine précolombienne<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
À PORTO RICO<br />
CÉSAR QUIÑONES, PABLO I. ALMODÓVAR<br />
■ La mé<strong>de</strong>cine précolombienne<br />
L’archipel <strong>de</strong>s Antilles forme un arc <strong>de</strong> cercle dans <strong>la</strong> mer <strong>de</strong>s Caraïbes. Il est proche<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> <strong>la</strong> Flori<strong>de</strong> (les îles Lucayes), <strong>de</strong>s côtes du Venezue<strong>la</strong> (les îles <strong>de</strong> Sotavento<br />
et Trinité), et <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule du Yucatan (l’île <strong>de</strong> Cuba). Porto Rico, <strong>la</strong> plus petite<br />
<strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s Antilles, est située au milieu <strong>de</strong> cette chaîne d’îles.<br />
Les scientifiques affirment que l’actuelle mer <strong>de</strong>s Caraïbes était auparavant une<br />
gran<strong>de</strong> extension <strong>de</strong> terre : <strong>la</strong> Terre antil<strong>la</strong>ise. Au cours <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s jurassique et crétacée,<br />
une série <strong>de</strong> mouvements sismiques affectèrent toute <strong>la</strong> terre. Les éruptions volcaniques<br />
firent couler <strong>la</strong> p<strong>la</strong>te-forme antil<strong>la</strong>ise qui fut recouverte par <strong>la</strong> mer. Porto Rico<br />
est située au sommet <strong>de</strong>s hautes montagnes, comme les autres Gran<strong>de</strong>s Antilles, tandis<br />
que les Petites Antilles ont une origine volcanique.<br />
La popu<strong>la</strong>tion originaire <strong>de</strong>s Antilles s’établit initialement dans <strong>la</strong> partie occi<strong>de</strong>ntale<br />
<strong>de</strong> Cuba <strong>de</strong>puis le Yucatan. Son développement culturel était très primitif : les habitants<br />
n’avaient pas <strong>de</strong> maisons et ne faisaient pas <strong>de</strong> céramique ; ils ne connaissaient pas non<br />
plus l’agriculture, mais vivaient <strong>de</strong> ce qu’ils chassaient et pêchaient. Au moment du<br />
<strong>de</strong>uxième voyage <strong>de</strong> Christophe Colomb, les taínos peup<strong>la</strong>ient l’île <strong>de</strong> Porto Rico ;<br />
d’après une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur <strong>la</strong>ngage et <strong>de</strong> leur céramique, ils avaient dép<strong>la</strong>cé les habitants<br />
originaires et venaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> l’Orénoque, au Venezue<strong>la</strong>. Leur arrivée dans les<br />
îles <strong>de</strong> Barlovento aurait pu être favorisée par les courants maritimes qui proviennent<br />
d’Afrique via l’océan At<strong>la</strong>ntique Sud et détournent leur route vers le nord à <strong>la</strong> hauteur<br />
<strong>de</strong>s Guyanes, notamment en été, lors <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong> l’Orénoque. Le versant caribéen<br />
<strong>de</strong>s îles est plus protégé <strong>de</strong>s vents qui proviennent <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique ; par ailleurs,<br />
quelques-unes <strong>de</strong> ces îles sont virtuellement reliées entre elles, ce qui favoriserait <strong>la</strong> navigation<br />
<strong>de</strong>s unes vers les autres. (Rappelons que ces groupes-là ne connaissaient pas les<br />
voiles et qu’ils se dép<strong>la</strong>çaient en canoë.)<br />
Les taínos arrivèrent au Porto Rico vers 400 av. J.-C. Lors du débarquement <strong>de</strong><br />
Colomb, les habitants <strong>de</strong> l’île étaient menacés par les Indiens caraïbes, qui avaient déjà<br />
conquis les Petites Antilles.<br />
Pendant <strong>de</strong>ux millénaires les taínos habitèrent l’île, y instal<strong>la</strong>nt leur culture, pas aussi<br />
avancée que celles du centre et du sud <strong>de</strong> l’Amérique mais éga<strong>la</strong>nt celles du nord du<br />
continent. Ils vivaient en communauté, habitaient <strong>de</strong>s maisons équipées <strong>de</strong> mobilier pour<br />
381
CÉSAR QUIÑONES, PABLO I. ALMODÓVAR<br />
dormir et pour cuisiner, et travail<strong>la</strong>ient <strong>la</strong> céramique, <strong>la</strong> pierre et les tissus qu’ils teignaient<br />
<strong>de</strong> différentes couleurs. Les femmes portaient <strong>de</strong>s boucles d’oreilles et <strong>de</strong>s colliers<br />
faits <strong>de</strong> petites pierres et elles coupaient leurs cheveux.<br />
La société <strong>de</strong>s taínos était divisée en trois c<strong>la</strong>sses : les nitaínos (chefs), les naborias<br />
(ouvriers) et les bohiques, qui étaient mé<strong>de</strong>cins et prêtres. Ils croyaient en un dieu du<br />
bien qu’ils appe<strong>la</strong>ient Yukiyú, un être immortel sans origine, mais qui avait cependant<br />
une mère appelée A<strong>la</strong>bex. Il existait aussi un dieu du mal, Juracán, qui était responsable<br />
<strong>de</strong>s orages, <strong>de</strong>s tremblements <strong>de</strong> terre et <strong>de</strong>s mauvaises récoltes. Ils croyaient à <strong>la</strong> vie<br />
après <strong>la</strong> mort et offraient en conséquence une sépulture soignée pour les morts, accroupis,<br />
les genoux à hauteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> poitrine et <strong>la</strong> tête inclinée. Dans les tombes, ils déposaient<br />
<strong>de</strong>s pots remplis <strong>de</strong> nourriture et d’eau pour le <strong>de</strong>rnier voyage.<br />
Les bohiques étaient chargés <strong>de</strong> préparer les cérémonies religieuses et <strong>de</strong> soigner les<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. Ils connaissaient les propriétés curatives <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes ; ils utilisaient le mancenillier<br />
(Hippomane mancinel<strong>la</strong>) et le tua-tua (Jatrophagossyfolia) comme purgatifs, et <strong>la</strong><br />
noix <strong>de</strong> cajou (Anacardium occi<strong>de</strong>ntale) pour les ma<strong>la</strong>dies respiratoires. Ils connaissaient<br />
l’art <strong>de</strong>s saignées, <strong>la</strong> castration et l’immobilisation <strong>de</strong>s fractures en utilisant <strong>la</strong> yagua humi<strong>de</strong><br />
(le tissu fibreux qui entoure <strong>la</strong> partie supérieure et plus tendre du tronc du palmier).<br />
Ils pratiquaient également <strong>de</strong>s massages pour leurs traitements.<br />
L’Indien <strong>de</strong>s Antilles possédait <strong>de</strong> bonnes habitu<strong>de</strong>s hygiéniques. Le matin, en se levant,<br />
il se <strong>la</strong>vait dans <strong>la</strong> rivière ou le torrent et il peignait ensuite son corps, aidé <strong>de</strong> sa<br />
compagne, avec du rocou (Bixa orel<strong>la</strong>na), afin <strong>de</strong> se protéger <strong>de</strong>s rayons du soleil et <strong>de</strong>s<br />
moustiques.<br />
■ De De l’arrivée <strong>de</strong> Colomb <strong>de</strong> au Colomb changement <strong>de</strong> au souveraineté changement <strong>de</strong> souveraineté<br />
382<br />
Le 19 novembre 1493, au cours <strong>de</strong> son <strong>de</strong>uxième voyage, Dom Christophe Colomb découvrit<br />
Porto Rico ; il y fit une escale pour s’approvisionner et repartit trois jours plus<br />
tard, sans jamais y revenir. En 1508, Dom Juan Ponce <strong>de</strong> León entama <strong>la</strong> colonisation.<br />
Les Espagnols traitèrent sévèrement <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ; ils se servirent <strong>de</strong>s indigènes,<br />
contraints aux travaux forcés pour exploiter les mines, construire les maisons et entreprendre<br />
<strong>de</strong>s travaux agricoles. La popu<strong>la</strong>tion, changeant ainsi ses habitu<strong>de</strong>s, fut décimée.<br />
D’autres indigènes moururent à cause d’une épidémie <strong>de</strong> vérole — ma<strong>la</strong>die qui<br />
n’existait pas en Amérique —, suivie d’une épidémie <strong>de</strong> syphilis (mal français) et d’autres<br />
ma<strong>la</strong>dies provenant d’Afrique et d’Europe. Les taínos utilisèrent le gaïac (Guaiacum officinale)<br />
pour combattre <strong>la</strong> syphilis.<br />
Eu égard à <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène, on commença à importer <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves<br />
africains. Un recensement datant <strong>de</strong> 1530 dénombrait 369 B<strong>la</strong>ncs, 1 148 Indiens<br />
(plus <strong>de</strong> 30 000 à l’origine) et 1 523 Noirs africains esc<strong>la</strong>ves.<br />
Vers 1787 <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion passa à 103 051 personnes, mais il ne restaient que 2 302 Indiens<br />
<strong>de</strong> race pure, tous <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> ceux qui étaient parvenus à se cacher <strong>de</strong>s<br />
conquérants en se réfugiant dans <strong>la</strong> partie <strong>la</strong> plus acci<strong>de</strong>ntée <strong>de</strong> <strong>la</strong> sierra, près du vil<strong>la</strong>ge<br />
Maricao, dans un endroit connu sous le nom <strong>de</strong> La Indiera.<br />
Il existe peu d’informations sur <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> cette époque, mais on sait que vers<br />
1803 <strong>la</strong> variole apparut une nouvelle fois dans le pays ; elle fut traitée par le Dr Francisco<br />
Oller : il réussit à contenir l’épidémie en utilisant <strong>la</strong> vaccinia. Ce ne fut pas le cas<br />
lors <strong>de</strong> l’épidémie <strong>de</strong> choléra <strong>de</strong> 1855 : on estime que près <strong>de</strong> 30 000 personnes — dont<br />
10 000 esc<strong>la</strong>ves — sont mortes <strong>de</strong> ce fléau.<br />
Les mé<strong>de</strong>cins, peu nombreux, étaient affectés aux secteurs militaires. La popu<strong>la</strong>tion<br />
n’accédait pas facilement aux soins hospitaliers et seule <strong>la</strong> bourgeoisie pouvait bénéficier<br />
<strong>de</strong>s soins <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins.
Le 10 décembre 1898 fut signé le traité <strong>de</strong> Paris, mettant fin à <strong>la</strong> guerre hispano-<strong>américaine</strong><br />
et concluant ainsi quatre siècles pendant lesquels ni <strong>la</strong> santé ni l’éducation ne furent<br />
traitées <strong>de</strong> façon appropriée dans l’île.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie académique<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Porto Rico<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie académique<br />
La <strong>de</strong>rmatologie du Porto Rico bénéficia <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> pensée espagnole, nord-<strong>américaine</strong><br />
(avec <strong>de</strong>s influences française, alleman<strong>de</strong> et ang<strong>la</strong>ise), mexicaine, <strong>de</strong> plusieurs pays<br />
sud-américains et bien entendu <strong>de</strong>s autres îles <strong>de</strong>s Caraïbes grâce aux progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
communication, à <strong>la</strong> facilité pour se dép<strong>la</strong>cer et à notre situation géographique.<br />
Le Dr Arturo L. Carrión (figure 1) fut le père <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie portoricaine.<br />
Après ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine (1919) à l’université <strong>de</strong> La Havane, il poursuivit <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s spécialisées en <strong>de</strong>rmatologie au Skin and Cancer Hospital <strong>de</strong> New York, après<br />
quoi il rentra dans son pays. Il dirigea entre 1923 et 1931 le Service <strong>de</strong> prévention<br />
<strong>de</strong>s fléaux. À partir <strong>de</strong> 1926 il se consacra à <strong>la</strong> recherche et à l’enseignement à<br />
l’École <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale, qui était alors sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Columbia<br />
(États-Unis). Le Dr Carrión, mondialement considéré comme une autorité dans<br />
le domaine, consacra sa vie à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s champignons.<br />
En 1936, le Dr Alfredo L. Bou mit en route <strong>la</strong> première consultation privée exclusivement<br />
consacrée aux patients <strong>de</strong>rmatologiques. Par ailleurs, en 1941 le Dr Elí Rojas<br />
retourna à Porto Rico après une spécialisation à l’université <strong>de</strong> Pennsylvanie.<br />
Au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> Deuxième Guerre mondiale, un groupe d’excellents <strong>de</strong>rmatologues arriva<br />
au pays; le Dr Honorato Estel<strong>la</strong> Entralgo, mé<strong>de</strong>cin espagnol qui s’instal<strong>la</strong> à Porto<br />
Rico en 1943 et qui fut chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie insu<strong>la</strong>ire jusqu’à sa mort en 1965, les précéda.<br />
Le Dr Luis Maduro fut le premier à s’établir à Ponce, rompant ainsi avec <strong>la</strong> tendance<br />
qu’avaient d’autres spécialistes à ne s’installer que dans <strong>la</strong> capitale, San Juan. Le<br />
Dr Héctor Torres, qui était maître d’école et pharmacien, fut un <strong>de</strong>rmatologue notable;<br />
il étudia plus tard <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, se spécialisant en <strong>de</strong>rmatologie, pour suivre finalement<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> droit. Les Drs Víctor Montil<strong>la</strong> et Jesús<br />
Quiñones s’établirent pour leur part à Porto Rico après<br />
avoir étudié aux États-Unis.<br />
Pendant l’après-guerre, le Dr Víctor M. Rivera arriva<br />
au pays pour travailler en tant que consultant à l’hôpital<br />
<strong>de</strong>s vétérans; le Dr Rivera était diplômé <strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Loyo<strong>la</strong> (La Nouvelle-Orléans, Louisiane), avec<br />
une spécialité en <strong>de</strong>rmatologie acquise au Skin and Cancer<br />
Hospital. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Porto Rico (figure 2), en 1950, le Dr Rivera<br />
fut nommé directeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne, poste qu’il occupa<br />
jusqu’à 1965. Les Drs José Correa, Jesús Quiñones et<br />
Honorato Estel<strong>la</strong> Entralgo intégrèrent également cette<br />
faculté.<br />
Le Dr Emilio Tril<strong>la</strong> — considéré comme le premier chirurgien<br />
<strong>de</strong>rmatologique — et le Dr Francisco Barnés, tous <strong>de</strong>ux spécialisés en <strong>de</strong>rmatologie,<br />
arrivèrent <strong>de</strong>s États-Unis dans les années 50. Le Dr Lawrence Fleisher arriva quant à<br />
lui à Porto Rico en travail<strong>la</strong>nt pour l’armée nord-<strong>américaine</strong>; son activité au <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong><br />
recherche sur les ma<strong>la</strong>dies tropicales l’incita à étudier <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et il reçut son diplôme<br />
dans notre école en 1956. Il retourna aux États-Unis pour suivre sa spécialisation et, <strong>de</strong><br />
retour à Porto Rico en 1960, il rejoignit le département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie auquel il apporta<br />
beaucoup jusqu’au moment <strong>de</strong> sa retraite (2002).<br />
383<br />
Figure 1.<br />
Dr Arturo L. Carrión<br />
Figure 2.<br />
Ecole<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> l’université<br />
<strong>de</strong> Porto Rico
CÉSAR QUIÑONES, PABLO I. ALMODÓVAR<br />
384<br />
Liste <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues diplômés. Programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Université <strong>de</strong> Porto Rico<br />
1969 Ramón Piñeiro, Eduardo Hernán<strong>de</strong>z, Luis G. Ortiz<br />
1970 Jorge L. Sánchez, Gloria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega, Rafael E. Martín<br />
1971 Hiram Ruiz Arroyo, Juan A. Mújica, Ana L. Colón<br />
1972 Edil González, Francille Escalona, Ernesto González<br />
1973 David Latoni, Neville Pereyo, Rubén Vallejo<br />
1974 Pedro Carranza, Angel L. Rivera, Héctor A. Hernán<strong>de</strong>z Álvarez<br />
1975 Cándido Torres, Juan López Berrios, Nilda Vil<strong>la</strong>vicencio<br />
1976 Ana J. Díaz, Reinaldo Rosario, Jerry C. Charneco<br />
1977 Aníbal Rivera, Félix Grau<strong>la</strong>u, Magaly Peña<br />
1978 María A. Padil<strong>la</strong>, Pablo I. Almodóvar<br />
1979 Miguel Vázquez, José R. González, Armando J. Guardio<strong>la</strong><br />
1980 José Mén<strong>de</strong>z Coll, Roberto E. Alfonso, Roberto Dávi<strong>la</strong> <strong>de</strong> Pedro<br />
1981 Francisco Ramos Caro, José A. Hernán<strong>de</strong>z, Isabel M. Banuchi<br />
1982 María L. Betancourt, María I. Martínez<br />
1983 Luz D. Figueroa, Edgardo Rodríguez, Roberto Pa<strong>la</strong>cio<br />
1984 Maritza Pérez, Julio Hernán<strong>de</strong>z, Antonio Riutort<br />
1985 Héctor Maldonado, Coty Benmaman<br />
1986 María Ibáñez, B<strong>la</strong>s A. Reyes, Félix Rodríguez<br />
1987 Shei<strong>la</strong> M. Torres, Carmen L. Cruz, Oliva Benmaman<br />
1988 Alma Cruz, Francis Caban<br />
1989 Aída Lugo Somolinos, Aída L. Quintero, Jaime Vil<strong>la</strong><br />
1990 Luis J. Ortiz, Scott Ross, David G. Latoni Maldonado<br />
1991 María Pico, Gerardo Lugo<br />
1992 Rafael F. Martín García, Elba Rubianes<br />
1993 Kevin Chun, Rubén Vallejo Rivera, Loyda Torres<br />
1994 Jorge E. Torres, Carmen M. San Miguel<br />
1995 Rocío Mandry, Doris N. Molina<br />
1996 Norma Alonso, Isaac Pérez, Francisco Colón<br />
1997 A<strong>de</strong>lle T. Quintana, Lizette Chabrier<br />
1998 Hiram A. Ruiz Santiago, Ricardo J. Rodríguez, Virnalisis González<br />
1999 Pedro J. Vendrell, Damaris Torres<br />
2000 José A. Rabelo, Nedil Aldarondo<br />
2001 Nydia <strong>de</strong>l R. Camacho, Áurea Delgado<br />
2002 Lymarie I. Águi<strong>la</strong>, Lillian Montalvo<br />
2003 Aivlys Pérez<br />
2004 Christine Muñoz, Alexan<strong>de</strong>r Lugo-Janer, Julio E. Sánchez<br />
Le Dr Víctor M. Torres est une autre figure clé dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie académique.<br />
Il étudia <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’université <strong>de</strong> Columbia (New York), où il fut diplômé<br />
en 1951; il s’y spécialisa en <strong>de</strong>rmatologie entre 1954 et 1957. En 1964 il s’exerça à <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmato-pathologie au Columbia-Presbyterian Medical Center; <strong>de</strong> retour à Porto Rico<br />
une année plus tard, il prit en charge <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong>rmatologique du département<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et il se consacra à établir un programme <strong>de</strong> formation à partir<br />
<strong>de</strong> 1966. Les Drs Ramón Piñeiro, Eduardo Hernán<strong>de</strong>z et Luis Guillermo Ortiz furent les<br />
premiers diplômés (1969); Gloria <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega, membre du <strong>de</strong>uxième groupe <strong>de</strong> diplômés<br />
du programme <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fut <strong>la</strong> première femme <strong>de</strong>rmatologue.<br />
Le nombre <strong>de</strong> Portoricains qui al<strong>la</strong>ient se spécialiser aux États-Unis diminua en raison<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> se former à Porto Rico; environ quatre-vingt-dix <strong>de</strong>rmatologues<br />
firent jusqu’à présent leur formation au sein <strong>de</strong> notre institution.<br />
Les Drs Armando Silva, Pedro Lázaro, Héctor Hernán<strong>de</strong>z López, Héctor Cardona et<br />
César A. Quiñones (qui avait passé une maîtrise en physiologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau), commencèrent<br />
à exercer <strong>la</strong> spécialité dans les années 60; Rafael Pasarell, Raúl Morales, María <strong>de</strong>l<br />
P. Millán, Aurea Ramírez et Fernando Calero, qui avaient poursuivi leur formation à<br />
l’étranger, leur succédèrent au cours <strong>de</strong>s années 70.<br />
Le Dr Jorge L. Sánchez se spécialisa en <strong>de</strong>rmato-pathologie en compagnie du Dr Bernard<br />
Ackerman à l’université <strong>de</strong> New York après avoir effectué son résidanat au sein <strong>de</strong> notre programme<br />
en 1970; en 1973 il fut nommé chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui <strong>de</strong>vint, sept<br />
ans plus tard et grâce à ses efforts, le département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le Dr Sánchez fut également<br />
nommé directeur exécutif <strong>de</strong> l’hôpital universitaire pour adultes, recteur du département<br />
<strong>de</strong>s sciences médicales et prési<strong>de</strong>nt intérimaire <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Porto Rico.
Le Dr Néstor P. Sánchez revint à Porto Rico en 1981 et le Dr Rafael Vélez Torres en<br />
1985; celui-ci fut le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>rmatologue portoricain spécialisé aux États-Unis. Le Dr<br />
Oteyza (Cuba) et le Dr Porres (Espagne) s’installèrent temporairement à Porto Rico, mais<br />
ils partirent plus tard vers les États-Unis.<br />
Au début <strong>de</strong> l’année 2005, le Dr Néstor P. Sánchez, <strong>de</strong>rmatologue et <strong>de</strong>rmato-pathologiste,<br />
fut nommé chef du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Les Drs Néstor P. Sánchez, Jorge<br />
L. Sánchez, Pablo I. Almodóvar, Miguel Vázquez Botet, José R. González, Luz D. Figueroa,<br />
Aida Lugo-Somolinos, Aivlys Pérez, Rafael F. Martín, Francisco Colón, Hiram Ruiz Santiago,<br />
Alma Cruz et Hiram Ruiz Arroyo travaillent actuellement à <strong>la</strong> faculté.<br />
Les postes vacants du résidanat étant très sollicités, nous eûmes <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> choisir<br />
d’excellents candidats, dont beaucoup <strong>de</strong> diplômés dans d’autres spécialités telles que<br />
<strong>la</strong> pédiatrie, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine familiale, <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine interne et l’anesthésie. Nous accueillons<br />
actuellement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues ayant étudié une sous-spécialité telles que <strong>la</strong> photothérapie,<br />
l’immuno<strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, <strong>la</strong> chirurgie<br />
cosmétique, <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs et le traitement au <strong>la</strong>ser. Notre spécialité a ainsi<br />
une p<strong>la</strong>ce éminente dans <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et une p<strong>la</strong>ce d’honneur dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé<br />
à Porto Rico et à l’étranger.<br />
Au total soixante-cinq <strong>de</strong>rmatologues, dont plus d’un tiers sont <strong>de</strong>s femmes, exercent<br />
actuellement <strong>de</strong> manière active <strong>la</strong> spécialité dans l’île. Il existe environ 1 <strong>de</strong>rmatologue<br />
pour 60000 habitants, et les services sont distribués dans toutes les régions <strong>de</strong> l’île.<br />
La recherche scientifique<br />
La recherche scientifique débuta avec le Dr Arturo Carrión qui publia près <strong>de</strong> 200 articles<br />
dans sa vie. Bien d’autres spécialistes auteurs <strong>de</strong> plusieurs travaux <strong>de</strong> recherche<br />
publiés au niveau international le suivirent.<br />
Le département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie stimu<strong>la</strong> <strong>la</strong>rgement <strong>la</strong> recherche et <strong>la</strong> production <strong>de</strong><br />
travaux scientifiques; entre cinq et dix travaux scientifiques sont publiés tous les ans<br />
dans les principales revues <strong>de</strong>rmatologiques du mon<strong>de</strong>.<br />
La lèpre à Porto Rico<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Porto Rico<br />
■ La recherche scientifique<br />
■ La lèpre à Porto Rico<br />
Nous avons très peu d’informations sur les ma<strong>la</strong>dies et les épidémies qui<br />
sévirent durant les quatre siècles <strong>de</strong> <strong>la</strong> domination espagnole. L’envoyé <strong>de</strong><br />
Porto Rico auprès <strong>de</strong>s cours espagnoles lutta en vain afin d’ouvrir une léproserie<br />
pour les nombreux patients insu<strong>la</strong>ires atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die (figure<br />
3). On croit que l’arrivée <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves africains fut à l’origine <strong>de</strong><br />
l’introduction <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre; son existence fut constatée grâce aux documents<br />
d’achat et <strong>de</strong> vente où il était stipulé que l’acheteur récupérerait son argent<br />
si l’esc<strong>la</strong>ve venait à contracter <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die.<br />
Le changement <strong>de</strong> souveraineté eut lieu en 1898, suscitant <strong>la</strong> première tentative d’isoler<br />
les patients atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre dans une auberge construite à l’arrière <strong>de</strong> <strong>la</strong> prison <strong>de</strong><br />
San Juan. La première léproserie fut bâtie en 1902 sur l’île <strong>de</strong> Cabras, un îlot situé en face<br />
du port <strong>de</strong> San Juan; l’endroit, isolé par <strong>la</strong> mer, avait servi pendant plusieurs années <strong>de</strong><br />
lieu <strong>de</strong> quarantaine. En 1926 les patients furent transférés dans un lieu plus proche <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> San Juan afin d’encourager les traitements.<br />
La léproserie insu<strong>la</strong>ire servit à mettre à l’écart les patients au cours <strong>de</strong> leur pré-traitement.<br />
Entre 1943 et 1965, le Dr Honorato Estel<strong>la</strong> dirigea l’institution et réussit à faire<br />
passer une légis<strong>la</strong>tion visant à modérer les lois puisqu’il existait déjà un traitement<br />
effectif.<br />
385<br />
Figure 3.<br />
Ruines <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie
CÉSAR QUIÑONES, PABLO I. ALMODÓVAR<br />
En 1966, <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du département <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
prit en charge <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie, qui changea <strong>de</strong> nom et <strong>de</strong>vint centre<br />
<strong>de</strong>rmatologique; le centre prolongea ses activités jusqu’en 1977, année <strong>de</strong> sa fermeture<br />
(et <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s autres léproseries) : ce type d’établissement <strong>de</strong>venant superflu en raison<br />
<strong>de</strong> l’avènement <strong>de</strong>s nouvelles thérapies multiples. En 1984, <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
tropicale fut construite; <strong>de</strong>puis, les patients atteints <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre sont traités et suivis dans<br />
les cliniques du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Le Dr Pablo I. Almodóvar fut le premier<br />
mé<strong>de</strong>cin et le directeur <strong>de</strong> ce département dépendant du programme <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong><br />
lèpre financé par l’US Public Health Service pendant les vingt <strong>de</strong>rnières années.<br />
■ Associations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
La première association <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues fut constituée avec <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> <strong>la</strong> section<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Association médicale <strong>de</strong> Porto Rico, au début <strong>de</strong>s années 50. Cette section<br />
regroupa pendant <strong>de</strong>ux décennies <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues exerçant leur spécialité<br />
dans l’île. En 1971, une nouvelle organisation fut créée : <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Porto<br />
Rico. Cette entité, indépendante <strong>de</strong> <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>de</strong>vint progressivement le plus<br />
grand groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues. Depuis 1971, <strong>la</strong> société organise chaque été une convention<br />
à <strong>la</strong>quelle assistent presque tous les <strong>de</strong>rmatologues du pays et plusieurs rési<strong>de</strong>nts qui habitent<br />
aux États-Unis; elle organise aussi une mini-convention au mois <strong>de</strong> novembre. C’est ainsi<br />
que les <strong>de</strong>rmatologues en activité obtiennent les qualifications dont ils ont besoin pour mettre<br />
à jour leur certification tous les trois ans. L’excellence scientifique et sociale caractérisent ces<br />
activités; elles accueillent <strong>de</strong>s conférenciers invités provenant <strong>de</strong>s États-Unis, d’Europe,<br />
d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et <strong>de</strong>s Caraïbes. Le succès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong> Porto Rico est dû en gran<strong>de</strong> partie à l’engagement du département <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine dans <strong>la</strong> partie académique et scientifique <strong>de</strong>s conventions.<br />
La plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues sont membres <strong>de</strong> l’Académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et nombre d’entre eux assistent à ses réunions annuelles. Les autres <strong>de</strong>rmatologues<br />
font partie <strong>de</strong>s différentes sociétés professionnelles : le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie (CILAD), l’Association <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et d’autres groupes<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, <strong>de</strong> cosmétologie, <strong>de</strong> chirurgie cosmétique, <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> Mohs<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique.<br />
■ Communication<br />
Dans les années 1977-1979, le Dr César A. Quiñones publia une lettre portant le titre<br />
News from... distribuée aux <strong>de</strong>rmatologues et aux mé<strong>de</strong>cins intéressés par notre spécialité.<br />
La lettre incluait <strong>de</strong>s commentaires sur les <strong>de</strong>rnières nouvelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, <strong>de</strong>s échanges<br />
d’information et <strong>de</strong>s comparatifs du coût <strong>de</strong>s médicaments entre autres. Suivant les progrès<br />
technologiques, le Dr Quiñones créa en août 2000 un site internet () qui dura<br />
jusqu’en 2004, date <strong>de</strong> création du site Internet officiel , <strong>la</strong>ncé par <strong>la</strong><br />
Société <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> Porto Rico sous <strong>la</strong> direction du Dr José Rabelo.<br />
Le 18 e Congrès du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD), qui eut lieu<br />
en août 1995, fut l’événement le plus significatif <strong>de</strong> <strong>la</strong> courte histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
Porto Rico : environ 1000 <strong>de</strong>rmatologues y assistèrent; au cours d’échanges scientifiques et<br />
conviviaux mémorables, ils en profitèrent également pour visiter le pays. La première<br />
convention <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, association formée à<br />
Porto Alegre (Brésil) en 1994, se tint au cours <strong>de</strong> ce congrès du CILAD. ■<br />
Janvier 2005
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE EN<br />
RÉPUBLIQUE<br />
DOMINICAINE<br />
ÎLE DE SAINT-DOMINGUE: LÀ OÙ TOUT COMMENÇA<br />
L’île <strong>de</strong> Saint-Domingue fut le berceau <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Amérique. Les premières<br />
colonies européennes s’installèrent sur <strong>la</strong> terre <strong>la</strong> plus aimée <strong>de</strong> Christophe Colomb. En<br />
conséquence, ce fut là que l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie post-coloniales<br />
commença.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie précolombienne<br />
Au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> Découverte, plusieurs races indigènes habitaient l’île, avec une prédominance<br />
<strong>de</strong>s Arahuacos (taínos) et <strong>de</strong>s Siboneyes, qui vivaient une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> développement<br />
correspondant au néolithique précoce 1 . Les différentes chroniques<br />
européennes décrivent les indigènes comme une popu<strong>la</strong>tion saine et d’une rare beauté;<br />
elles mentionnent <strong>la</strong> qualité et <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong> leur peau et l’éc<strong>la</strong>t <strong>de</strong> leur chevelure 2 .<br />
Les indigènes avaient un rapport animiste avec <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine; ils ne concevaient pas <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die comme quelque chose <strong>de</strong> naturel mais <strong>de</strong> surnaturel, le bohutí 3 exécutant alors<br />
<strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> pratiques magiques. À son tour, il invoquait les zemíes pour qu’ils<br />
col<strong>la</strong>borent avec lui.<br />
Les pathologies dominantes sur l’île étaient caractéristiques <strong>de</strong>s climats tropicaux,<br />
accompagnées d’autres ma<strong>la</strong>dies à distribution universelle. Dans son Historia General <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s Indias [<strong>Histoire</strong> générale <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s], le frère Bartolomé <strong>de</strong> Las Casas parle <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies<br />
inconnues <strong>de</strong>s colons espagnols, qui tombèrent ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s peu après leur arrivée. Il<br />
mentionne <strong>la</strong> bouba, l’ulcère phagédénique ou rámpano ou ulcère tropical 2 ; le paludisme,<br />
qui provoqua <strong>la</strong> première épidémie connue dans le Nouveau Mon<strong>de</strong>; <strong>la</strong> nigua, mal<br />
qui attaquait les Européens <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntations; les mycoses tropicales, <strong>la</strong> gusaro<strong>la</strong>, l’éléphantiasis,<br />
l’ankylostomiase, <strong>la</strong> tuberculose, <strong>la</strong> fièvre jaune et <strong>la</strong> syphilis, l’origine <strong>de</strong> ces<br />
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières étant très discutée 3 . La malnutrition, le rachitisme, l’asthme, <strong>la</strong> fièvre typhoï<strong>de</strong><br />
et <strong>la</strong> dysenterie étaient <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies habituelles 4 . Pour leur part, les Espagnols<br />
387
Figure 1.<br />
Cathédrale<br />
primatiale<br />
d’Amérique et<br />
monument <strong>de</strong>dié à<br />
Christophe Colomb.<br />
Première<br />
cathédrale<br />
construite dans le<br />
Nouveau Mon<strong>de</strong>,<br />
où reposèrent une<br />
fois les dépouilles<br />
mortelles <strong>de</strong><br />
l’amiral Colomb<br />
Figure 2.<br />
Ruines <strong>de</strong> l’hôpital<br />
San Nico<strong>la</strong>s<br />
<strong>de</strong> Bari. Premier<br />
hôpital du Nouveau<br />
Mon<strong>de</strong>, construit<br />
en 1509<br />
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
apportèrent <strong>la</strong> lèpre, <strong>la</strong> variole — qui décima <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
indigène —, <strong>la</strong> blennorragie et les fièvres éruptives.<br />
La mé<strong>de</strong>cine indigène était empirique, traditionnelle, secrète et<br />
transmise oralement. L’information dont on dispose n’est pas abondante<br />
en raison du manque <strong>de</strong> registres écrits par cette civilisation, à<br />
part les documents rédigés par les Européens.<br />
La flore existant sur l’île était rare, mais les habitants savaient <strong>la</strong><br />
mettre à profit. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> cérémonie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cohoba (où ils employaient<br />
le D. stramonium), le bohutí ou sorcier pouvait induire un état <strong>de</strong> torpeur<br />
à son patient. L’encens ou l’aspiration <strong>de</strong> tabac, employée aussi<br />
occasionnellement par les Espagnols pour l’effet <strong>de</strong> stupeur et le sou<strong>la</strong>gement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> douleur causée par <strong>de</strong>s ulcères qu’elle provoquait,<br />
constituaient d’autres pratiques habituelles 5-8 .<br />
Parmi les premières pathologies cutanées enregistrées, outre <strong>la</strong><br />
bouba — une douloureuse lésion ulcérative —, notons les lésions appelées<br />
caracol, qui pourraient bien correspondre, selon les récits, aux<br />
teignes ou aux <strong>de</strong>rmatophytoses du corps 5 . La bouba était traitée<br />
avec une infusion <strong>de</strong> guayacán ou palo santo; les jambes souffrant <strong>de</strong><br />
troubles circu<strong>la</strong>toires étaient immergées dans une infusion <strong>de</strong> fruit <strong>de</strong><br />
jobo qui les rafraîchissait et les raffermissait en même temps; les<br />
fruits <strong>de</strong> <strong>la</strong> camomille étaient utilisés pour les attaques aiguës <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
goutte (Colomb en fit lui-même l’expérience) 7 .<br />
Ils appliquaient du yagrumo ou yoruba sur les blessures sous<br />
forme <strong>de</strong> catap<strong>la</strong>smes; ils suçaient <strong>de</strong>s nodules, <strong>de</strong>s excroissances et <strong>de</strong>s humeurs. Parmi<br />
les autres substances employées: <strong>la</strong> bija (ajiaco ou safran), appliquée comme onguent<br />
huileux, dont ils se servaient pour peindre leurs corps (en guise d’ornementation), pour<br />
faire fuir les moustiques; les feuilles <strong>de</strong> guao, outre le fait <strong>de</strong> constituer un puissant<br />
venin, étaient utilisées pour b<strong>la</strong>nchir <strong>la</strong> peau du visage, tandis que le baume était employé<br />
comme hémostatique pour les blessures et les ulcères. Pour combattre le paludisme,<br />
ils connaissaient l’emploi d’une p<strong>la</strong>nte dérivée <strong>de</strong> <strong>la</strong> quinquina qui s’utilise encore<br />
dans certaines régions <strong>de</strong>s montagnes <strong>de</strong> notre cordillère centrale 8, 9 .<br />
■ La La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> colonie<strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Colonie<br />
388<br />
La popu<strong>la</strong>tion indigène diminua rapi<strong>de</strong>ment à cause <strong>de</strong>s fléaux et <strong>de</strong> l’esc<strong>la</strong>vage; il en<br />
fut <strong>de</strong> même pour les Espagnols, mais en moindre quantité, car ils étaient attaqués <strong>de</strong><br />
maux qui leur étaient inconnus, comme <strong>la</strong> première épidémie <strong>de</strong> paludisme que même<br />
l’amiral Colomb subit, attaqué trois fois par ce mal 2-4 .<br />
La colonie La Isabe<strong>la</strong> fut construite en 1493 dans <strong>la</strong> province actuelle <strong>de</strong> Puerto P<strong>la</strong>ta,<br />
au nord <strong>de</strong> l’île; elle comportait les premières constructions coloniales du Nouveau<br />
Mon<strong>de</strong>: un fort, une église, <strong>de</strong>s chemins, un conseil municipal et un hôpital. Le grand<br />
maître Juan, un chirurgien non mé<strong>de</strong>cin, en avait <strong>la</strong> charge. Le premier mé<strong>de</strong>cin envoyé<br />
par les rois catholiques, le Dr Diego Alvarez Chanca 10 , y travail<strong>la</strong> après son arrivée avec<br />
le <strong>de</strong>uxième voyage <strong>de</strong> Colomb et soigna <strong>la</strong> première épidémie <strong>de</strong> paludisme; il diagnostiqua<br />
aussi <strong>de</strong>s ulcères éventuels chez le cacique Guacanagarix, qui correspondaient à ce<br />
que nous appellerions une <strong>de</strong>rmatose factice 2, 4 .<br />
La première épidémie <strong>de</strong> fièvre jaune fut enregistrée en 1495 11 ; déjà <strong>de</strong>puis 1494, les<br />
épidémies <strong>de</strong> variole attaquaient <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion indigène, c’est pourquoi il ne restait, selon<br />
l’historien Ulloa Cisneros, que 15 000 indigènes sur l’île en 1518 2 .<br />
La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Saint-Domingue eut lieu en 1502, et par là <strong>la</strong> construction<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> première cathédrale (figure 1) et du premier hôpital, San Nicolás <strong>de</strong> Bari, qui
possédait une vingtaine <strong>de</strong> lits et une léproserie et qui<br />
« puait <strong>la</strong> bouba 2, 3 » (figure 2). Ultérieurement fut créé<br />
l’hôpital San Lázaro (1511), <strong>la</strong> première léproserie du<br />
Nouveau Mon<strong>de</strong> (figures 3 et 4).<br />
Le premier chirurgien, le grand maître Alonso, arriva<br />
en 1500; <strong>la</strong> première autopsie du Nouveau Mon<strong>de</strong><br />
eut lieu en 1533 sur <strong>de</strong>s jumelles siamoises, pratiquée<br />
par le chirurgien Juan Camacho, qui mit notamment<br />
l’accent sur <strong>la</strong> peau au cours <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>scription 4 .<br />
Le premier Protomedicato s’instal<strong>la</strong> en Amérique en<br />
1519, régu<strong>la</strong>nt l’exercice <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine; <strong>la</strong> bulle Aposto<strong>la</strong>tus<br />
Culmine <strong>de</strong> 1562 créa <strong>la</strong> première université du<br />
Nouveau Mon<strong>de</strong>, Santo Tomás <strong>de</strong> Aquino, appelée <strong>de</strong> nos jours<br />
université autonome <strong>de</strong> Santo Domingo (UASD). Le premier asile<br />
pour enfants fut inauguré en 1582; selon les récits du Dr Pedro<br />
López, il fut fréquemment attaqué par <strong>de</strong>s épidémies <strong>de</strong> gale et<br />
d’éruptions cutanées 2 .<br />
Les esc<strong>la</strong>ves originaires <strong>de</strong> différents points d’Afrique apportèrent<br />
<strong>de</strong> nouvelles ma<strong>la</strong>dies; d’après les chroniqueurs, on observa<br />
alors à l’époque les affections suivantes sur l’île: fi<strong>la</strong>riose, gusaro<strong>la</strong>s,<br />
variole, lèpre, dysenterie, fièvre jaune, gale, bouba, chancres,<br />
p<strong>la</strong>ies et ulcères variqueux.<br />
Au cours du XVIII e siècle quelques ma<strong>la</strong>dies cutanées comme <strong>la</strong><br />
fi<strong>la</strong>riose, le pian, <strong>la</strong> blennorrhagie, les varioles noires, <strong>la</strong> rougeole,<br />
<strong>la</strong> gusaro<strong>la</strong>, <strong>la</strong> vero<strong>la</strong> (pinta), les niguas, les ulcères et plusieurs types <strong>de</strong> chancres, furent<br />
décrites 9, 11, 12 .<br />
La bouba fut l’une <strong>de</strong>s premières pathologies décrites sur l’île. Damier Chevalier décrivit<br />
en 1730 <strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau qui pourraient correspondre à <strong>la</strong> lèpre, en affirmant:<br />
« Elles sont <strong>la</strong> conséquence <strong>de</strong> <strong>la</strong> variole (syphilis) »; il publia en 1747 un traité sur les<br />
affections <strong>de</strong> l’île dans lequel il signa<strong>la</strong>it que <strong>la</strong> lèpre était une pathologie commune chez<br />
<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion noire et b<strong>la</strong>nche, <strong>la</strong> considérant comme une syphilis modifiée 2, 12 .<br />
La mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves noirs, tout comme celle <strong>de</strong>s indigènes, était animiste et empirique,<br />
basée sur l’utilisation <strong>de</strong> catap<strong>la</strong>smes et <strong>de</strong> jus et accompagnée <strong>de</strong> rites magiques<br />
interprétés par le bokor 12 .<br />
En 1804, Emmanuel Chopitre — un mé<strong>de</strong>cin français installé dans <strong>la</strong> partie française<br />
<strong>de</strong> l’Hispanio<strong>la</strong> — réalisa l’une <strong>de</strong>s premières <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre en Amérique, <strong>la</strong><br />
considérant également comme une forme <strong>de</strong> syphilis. Cet auteur décrivit à Paris ce que<br />
nous connaissons aujourd’hui comme faciès léonin, ainsi que quelques séquelles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die; il décrivit aussi le pian ou bouba sous trois formes cliniques (forme à petits<br />
pians, pians rouges et grands pians) 12, 13 .<br />
Un autre mé<strong>de</strong>cin français, Charlevoix, définit <strong>la</strong> lèpre comme une pathologie non<br />
propre à ces terres mais provenant d’Europe, fréquente dans les villes et rare dans les<br />
campagnes 13 .<br />
La <strong>de</strong>rmatologie au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en République dominicaine<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
Depuis 1845, les patients lépreux <strong>de</strong>vaient être enfermés à l’hôpital San Nicolás <strong>de</strong><br />
Bari. La première association médicale fut fondée en 1881; pendant ce temps, les mé<strong>de</strong>cins<br />
étaient toujours généralistes ou chirurgiens. Les spécialisations n’existaient pas<br />
encore; elles commencèrent à apparaître seulement en 1852, après l’ouverture <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
écoles <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, à Saint-Domingue et à Santiago 14 .<br />
389<br />
Figure 3.<br />
Ancien hôpital<br />
San Lazaro.<br />
Dessin <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
première<br />
léproserie<br />
d’Amérique<br />
Figure 4.<br />
Ancien hôpital<br />
San Lazaro.<br />
Etat actuel<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> première<br />
léproserie du<br />
Nouveau<br />
Mon<strong>de</strong>
Figure 5.<br />
Dr Felipe Pimentel<br />
Imbert. Considéré<br />
comme le premier<br />
<strong>de</strong>rmatologue<br />
dominicain, il fut<br />
également le<br />
premier mycologue<br />
et le premier<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Société<br />
dominicaine <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie,<br />
en 1949<br />
Figure 6.<br />
Le Dr Huberto<br />
Bogaert Díaz<br />
(2000) dirige une<br />
séance clinique <strong>de</strong><br />
l’IDCP (direction<br />
IDCP-DHBD)<br />
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
La <strong>de</strong>rmatologie au XXe ■ La <strong>de</strong>rmatologie siècleau<br />
X X e siècle<br />
390<br />
Vers 1904, l’idée surgit <strong>de</strong> construire un <strong>la</strong>zaret dans <strong>la</strong> petite île <strong>de</strong> Catalina, dans le<br />
sud-est du pays; cependant le projet fut <strong>la</strong>issé <strong>de</strong> côté et les travaux débutèrent à Nigua,<br />
au sud-ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. La construction finit en 1911 15 , le Dr Fernando Arturo Defilló (le<br />
premier léprologue <strong>de</strong> notre pays) occupant le poste <strong>de</strong> directeur entre 1912 et 1926 16 .<br />
Le Dr José Antonio Miniño Bhäer dirigea <strong>la</strong> léproserie en 1928 17 ; le centre est actuellement<br />
dirigé par le Dr Mario Fernán<strong>de</strong>z.<br />
Evangelina Rodríguez, <strong>la</strong> première Dominicaine mé<strong>de</strong>cin, obtint son diplôme en<br />
France et travail<strong>la</strong> à partir <strong>de</strong> 1912 en gynéco-obstétrique et urologie. Elle traita les ma<strong>la</strong>dies<br />
sexuellement transmissibles (MST) chez <strong>de</strong>s prostitués <strong>de</strong> sa ville natale, San<br />
Pedro <strong>de</strong> Macorís, en faisant les premières <strong>de</strong>scriptions systématiques <strong>de</strong> ces pathologies.<br />
Le Dr Guillermo Herrera, bril<strong>la</strong>nt léprologue ayant fait ses étu<strong>de</strong>s en France, occupa<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Nigua <strong>de</strong> 1942 à <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong>s années 1980. Il fut le premier<br />
à utiliser les sulfones chez les lépreux et publia plusieurs articles en République dominicaine<br />
et à l’étranger sur les Lésions lichénoï<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre et le Traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lèpre avec <strong>de</strong>s sulfones 18 .<br />
Les premiers <strong>de</strong>rmatologues et <strong>la</strong> première société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Les premiers <strong>de</strong>rmatologues spécialisés du pays exercèrent <strong>la</strong> spécialité dans les<br />
années 40, après avoir étudié à l’étranger. Parmi eux nous citerons Víctor Manuel Soñé<br />
Uribe, qui étudia à Bruxelles et exerça les professions <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologue et <strong>de</strong> vénéréologue<br />
; Manuel Felipe Pimentel Imbert (figure 5), qui fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> mycologie à Porto Rico, travail<strong>la</strong>nt dans les <strong>de</strong>ux domaines ; il se consacra à l’enseignement<br />
médical <strong>de</strong> <strong>la</strong> mycologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> bactériologie, et ouvrit une consultation<br />
privée en <strong>de</strong>rmatologie. Citons également les Drs Héctor Purcell Peña et Miguel<br />
Ortega 19, 20 .<br />
La Société dominicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie (SDDS) fut fondée le 8 juin<br />
1949; son premier prési<strong>de</strong>nt fut le Dr Pimentel Imbert, Héctor Purcell Peña (vénéréologue)<br />
faisant office <strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nt. Juan Mel<strong>la</strong>, Miguel Ortega, Víctor Soñé Uribe (<strong>de</strong>rmatologues<br />
vénéréologues), Guillermo Herrera (léprologue), Julio Senior, Guillermo <strong>de</strong><br />
los Santos (mé<strong>de</strong>cins généralistes), José <strong>de</strong> Jesús Ravelo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fuente (mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire)<br />
et Fernando Defilló (prési<strong>de</strong>nt honorifique) intégraient cette nouvelle société.<br />
Le régime politique <strong>de</strong> l’époque interdisant<br />
les activités scientifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> corporation<br />
médicale, <strong>la</strong> société fut donc<br />
pratiquement inactive jusqu’en 1962. À<br />
cette date-là, une nouvelle direction fut élue<br />
et <strong>de</strong> nouveaux statuts furent proc<strong>la</strong>més. La<br />
commission, intégrée par Pimentel Imbert,<br />
Herrera, Purcell, Soñé, accompagnés <strong>de</strong> Miguel<br />
Contreras et Huberto Bogaert Díaz (figure<br />
6), comptait aussi Rafael Rodríguez<br />
Castel<strong>la</strong>nos, Félix Benzo, Gilberto Baltasar<br />
Robiou, José Ruso, Rafael Fernán<strong>de</strong>z Báez<br />
et Rafael Díaz.<br />
Il fut établi que <strong>la</strong> société serait intégrée par les spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie, en vénéréologie<br />
et en léprologie; qu’elle possè<strong>de</strong>rait une revue lui étant propre et qu’elle organiserait<br />
<strong>de</strong>s congrès, <strong>de</strong>s symposiums, <strong>de</strong>s cours et d’autres activités scientifiques<br />
appropriées; que ses membres pourraient bénéficier <strong>de</strong> voyages et <strong>de</strong> bourses d’étu<strong>de</strong>s.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en République dominicaine<br />
On autorisa aussi le changement <strong>de</strong> nom <strong>de</strong> l’association pour celui qu’elle porte actuellement:<br />
Société dominicaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (SDD) 20, 21 .<br />
L’origine <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong>rmatologique dominicain. Ses réussites<br />
Le patronat <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre<br />
fut fondé en 1963 afin d’établir une coopération<br />
dans tout le pays pour lutter<br />
contre cette ma<strong>la</strong>die; il serait le précurseur<br />
du futur Institut <strong>de</strong>rmatologique<br />
dominicain. Le patronat mena une intense<br />
campagne d’information dans tous<br />
les médias entre 1963 et 1965, avec <strong>la</strong><br />
col<strong>la</strong>boration active <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDD et obtenant<br />
en 1964 un terrain pour <strong>la</strong> création<br />
d’un centre, dont <strong>la</strong> construction fut entamée<br />
en 1965 22 .<br />
Le 3 février 1966 fut inauguré l’Institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique dominicain (IDD) (figure<br />
7), une entité privée qui comptait le conseil du Pr Fernando Latapí — du centre<br />
<strong>de</strong>rmatologique Pascua du Mexique — et <strong>de</strong> son assistant Amado Saúl. L’institut débuta<br />
dans un très petit local <strong>de</strong>s environs <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville, avec un groupe réduit <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins: Huberto<br />
Bogaert Díaz et Sócrates Parra, diplômés aux États-Unis; Ernesto Benzo et Colón<br />
Kuret, mé<strong>de</strong>cins géneralistes ayant <strong>de</strong>s connaissances en <strong>de</strong>rmatologie; Mario Fernán<strong>de</strong>z,<br />
Antonio Coiscou Weber et E<strong>la</strong>dio <strong>de</strong> los Santos (figures 8 et 9), <strong>de</strong>rmatologues provenant<br />
du centre <strong>de</strong>rmatologique Pascua 23 .<br />
Le Dr Huberto Bogaert, qui lutta avec persévérance pour créer et conserver le centre,<br />
fut le créateur <strong>de</strong> ce projet, qui constitue aujourd’hui un axe central <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en République dominicaine. Avant 1966 il n’existait pas <strong>de</strong> programme organisé à portée<br />
nationale pour contrôler <strong>la</strong> lèpre; il y avait à peine trois cabinets dans les hôpitaux,<br />
qui comptaient six spécialistes dans tout le pays, dont cinq se trouvaient à Saint-Domingue<br />
et le <strong>de</strong>rnier à Santiago. La même année, l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’université autonome<br />
<strong>de</strong> Santo Domingo (UASD) renforça le programme d’enseignement, le rendant<br />
éminemment pratique et intégrant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au programme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne.<br />
Un symposium sur <strong>la</strong> syphilis et un autre sur <strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong>stinés aux mé<strong>de</strong>cins généralistes<br />
furent organisés vers <strong>la</strong> même époque 23, 24 .<br />
L’IDD conclut en 1967 une convention avec l’UASD pour effectuer <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie et pour améliorer l’enseignement en mycologie. L’année<br />
391<br />
Figure 7.<br />
Fondateurs <strong>de</strong><br />
l’Institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique<br />
dominicain (1966).<br />
De droite à gauche :<br />
Antonio Coiscou,<br />
E<strong>la</strong>dio <strong>de</strong> los<br />
Santos, Huberto<br />
Bogaert Díaz,<br />
Sócrates Parra,<br />
Ernesto Benzo,<br />
Mario Fernán<strong>de</strong>z<br />
Figure 8.<br />
Le Dr Antonio<br />
Coiscou pendant<br />
une consultation<br />
(1967)<br />
Figure 9.<br />
Le Dr E<strong>la</strong>dio <strong>de</strong> los<br />
Santos pendant ses<br />
cours à l’université<br />
autonome <strong>de</strong> Santo<br />
Domingo à l´IDD
Figure 10.<br />
Groupe <strong>de</strong><br />
participants au I er<br />
Congrès <strong>de</strong> syphilis<br />
et lèpre qui eut<br />
lieu à l’IDD (1970)<br />
Figure 11.<br />
Margarita<br />
Quiñones (née<br />
Rosado) dans<br />
l’ancien <strong>la</strong>boratoire<br />
<strong>de</strong> l’IDD, préparant<br />
un test pour le<br />
diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
leishmaniose<br />
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
392<br />
suivante, les premiers <strong>de</strong>rmatologues obtinrent leur diplôme au bout d’un an <strong>de</strong> cours à<br />
l’IDD: Idalina Sánchez, Maritza Santiago, Rosa Francia Rojas.<br />
Le premier programme <strong>de</strong> formation pour mé<strong>de</strong>cins auxiliaires <strong>de</strong>rmato-léprologues<br />
débuta en 1969; ceux-ci furent intégrés activement au programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
lèpre et contribuèrent gran<strong>de</strong>ment à <strong>la</strong> lutte contre cette ma<strong>la</strong>die; ils détectèrent aussi<br />
<strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> diverses pathologies telles que les mycoses profon<strong>de</strong>s, <strong>la</strong> leishmaniose, les<br />
cancers cutanés et d’autres affections cutanées à intérêt médico-social 25 .<br />
Ce programme constitue un modèle <strong>de</strong> santé réussi en République dominicaine. Cette<br />
réussite est due, outre à <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’IDD, aux Drs Juan Antonio Bod<strong>de</strong>n, Zino Castel<strong>la</strong>zzi<br />
(Venezue<strong>la</strong>), Dennis Martínez — qui participa remarquablement pendant plusieurs<br />
années à <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’institut — et Miriam Hi<strong>la</strong>rio.<br />
À Santiago, les Drs Rafael Díaz et José Canaán sont les références <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine cutanée,<br />
tandis que Román Brache l’est à San Francisco <strong>de</strong> Macorís.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie à partir <strong>de</strong>s années 70<br />
Un premier congrès national eut lieu du 30 août au 1er septembre<br />
1970, dont les sujets principaux furent <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> syphilis. L’Institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau (IDCP) organisa jusqu’à présent<br />
neuf journées <strong>de</strong>rmatologiques, tandis que <strong>la</strong> SDD en réalisa onze,<br />
en alternance tous les <strong>de</strong>ux ans 26 (figure 10).<br />
Les mycoses superficielles et profon<strong>de</strong>s furent d’abord étudiées par<br />
Pimentel Imbert (consultation privée) et ensuite par Rafael Coiscou, Rafael<br />
Isa et les bio-analystes Ana Cecilia Cruz et Betina Gil à l’IDD, qui<br />
contrôlèrent <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> cas <strong>de</strong> mycoses <strong>de</strong> types différents 23, 27 .<br />
Les gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatoses affectant le peuple dominicain furent étudiées<br />
à l’Institut <strong>de</strong>rmatologique, tout comme les infections cutanées<br />
bactériennes et virales, <strong>la</strong> tuberculose cutanée, les ma<strong>la</strong>dies bulleuses<br />
chroniques, les col<strong>la</strong>génoses et les différentes parasitoses; parmi cellesci,<br />
quarante cas <strong>de</strong> leishmaniose furent découverts pour <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
1974-1998, <strong>de</strong> <strong>la</strong> variété anergique, causés par un parasite du groupe L<br />
mexicaine, qui furent étudiés en profon<strong>de</strong>ur par Margarita Quiñones (figure<br />
11); celle-ci introduisit dans le pays les techniques d’immunofluorescence<br />
pour le diagnostic <strong>de</strong> <strong>la</strong> toxop<strong>la</strong>smose, <strong>la</strong> syphilis et les<br />
col<strong>la</strong>génopathies en 1978 28 .<br />
L’IDD (aujourd’hui IDCP) (figure 12) dispose d’unités <strong>de</strong>rmatologiques<br />
à San Pedro <strong>de</strong> Macorís pour <strong>la</strong> région orientale, à Santiago pour<br />
le Cibao ou région centrale du pays, à Puerto P<strong>la</strong>ta pour <strong>la</strong> région du nord, à San Cristóbal<br />
pour <strong>la</strong> région du sud, à Barahona pour <strong>la</strong> région du sud-ouest et à La Romana et Higuey<br />
à l’est 29 .<br />
Les services spécialisés <strong>de</strong> cosmétologie, <strong>de</strong> cryochirurgie, <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatoses professionnelles et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne furent créés en 1975. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier débuta avec le Dr Alfredo Staffeld; le département se partagea ensuite entre <strong>la</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine interne appliquée à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie — dirigée jusqu’à présent par Juan Pablo<br />
Guzmán — et <strong>la</strong> consultation <strong>de</strong> cardiologie-néphrologie, actuellement à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong><br />
Francisco Bonnet 30 .<br />
En 1984, l’IDD inaugura le Centre <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles (CETS en<br />
espagnol) sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> C<strong>la</strong>udio Vólquez, é<strong>la</strong>rgissant ainsi le domaine du travail<br />
<strong>de</strong>rmatologique; les départements MST au sein <strong>de</strong>s unités <strong>de</strong> Santiago et <strong>de</strong> Puerto P<strong>la</strong>ta<br />
furent mis en route peu après. Les principales MST affectant le peuple dominicain furent<br />
étudiées pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 1984-1998. Actuellement, le centre mène <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préliminaires<br />
du vaccin contre le VIH 31 .
■ Développement <strong>de</strong>s sous-spécialités <strong>de</strong>s <strong>de</strong> sous-spécialités <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Le résidanat <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’IDD débuta formellement<br />
en 1992. Les premiers chirurgiens <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong><br />
notre pays (Luisa González et Emma Guzmán) firent leur formation<br />
au département <strong>de</strong> chirurgie esthétique <strong>de</strong> l’institut existant en<br />
1972-1992. Ultérieurement, les Drs Antonio Giral<strong>de</strong>s, Ana Cruz et<br />
Kirshe Fernán<strong>de</strong>z acquirent leur formation au Mexique et à San<br />
Salvador. De nos jours l’Institut <strong>de</strong>rmatologique compte un résidanat<br />
officiel <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique d’une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans,<br />
qui se développa considérablement 32, 33 .<br />
Le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmétique se développa dans les années 70,<br />
lorsque <strong>de</strong> jeunes spécialistes se rendirent en Argentine pour se<br />
former avec Alejandro Cor<strong>de</strong>ro: Ana Josefa Marte, Margarita<br />
Cotes, Doraida Jones. Ceci permit l’ouverture d’un département <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> sous-spécialité à l’IDD, <strong>de</strong>venant l’un <strong>de</strong>s domaines préférés <strong>de</strong> spécialisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues.<br />
Quant à <strong>la</strong> cryochirurgie, elle débuta à l’IDD dans les années 70 avec Rosa Francia<br />
Rojas, qui exerça <strong>la</strong> spécialité <strong>de</strong> manière privée et institutionnelle. À l’IDD, ce département<br />
est dirigé <strong>de</strong>puis 1986 par Silvia Marte, pédiatre, chirurgien <strong>de</strong>rmatologue et cryochirurgien.<br />
Dans le privé, le travail d’Edgardo Jorge Job, formé au Japon, est<br />
remarquable 32, 34 .<br />
La phlébologie ne fut plus le domaine exclusif <strong>de</strong>s chirurgiens. Eida Espail<strong>la</strong>t, suivie<br />
<strong>de</strong> Carmen Yris Taveras, créa les bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> phlébologie <strong>de</strong>rmatologique, accompagnées<br />
plus tard <strong>de</strong> Chantal Uttendale Belga et Danie<strong>la</strong> Guerrero, Cesarina Liriano, Víctor Pou.<br />
La stomatologie fut à <strong>la</strong> charge du Dr Adolfo Arthur Nouel, odontologue et stomatologue,<br />
qui exerça en Argentine aux côtés du Pr Grinspan et qui inaugura avec le Dr Fernando<br />
Jacobo Armach le département <strong>de</strong> stomatologie <strong>de</strong> l’IDD.<br />
À l’origine, les biopsies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau étaient interprétées par <strong>de</strong>s pathologistes, au<br />
point que <strong>la</strong> SDD admit en 1965 trois <strong>de</strong> ces mé<strong>de</strong>cins : Rafael Alfau Cambiaso, Alci<strong>de</strong>s<br />
Hernán<strong>de</strong>z Guante et Michelle Khoury. Celle-ci étudia en France avec le Pr Civatte et<br />
fut le premier <strong>de</strong>rmato-pathologiste <strong>de</strong> l’IDD, à qui succédèrent Nilda Fernán<strong>de</strong>z et Antonio<br />
Torres, qui travaillent dans <strong>de</strong>s cabinets privés. Ce département est actuellement<br />
dirigé par Fernanda Nanita Estévez, qui se forma en Argentine avec le Pr Abu<strong>la</strong>fia et<br />
qui travaille en étroite col<strong>la</strong>boration avec Raysa Acosta (<strong>de</strong>rmo-pathologiste) et Nerys<br />
Ramírez (pathologiste). La République dominicaine compte actuellement six <strong>de</strong>rmopathologistes.<br />
Les origines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie du travail remontent aux années 80, lorsque Idalina<br />
Sánchez s’entraîna avec le professeur espagnol Con<strong>de</strong> Za<strong>la</strong>zar (1983), créant ensuite le<br />
département correspondant à l’IDD. Elle fut remp<strong>la</strong>cée par Elfida Sánchez, qui s’exerça<br />
également avec Con<strong>de</strong> en 1992.<br />
Autres institutions<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en République dominicaine<br />
En janvier 1988 naquit une <strong>de</strong>uxième institution <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine cutanée, <strong>la</strong> clinique<br />
<strong>de</strong>rmatologique Herrera, fondée par Idalina Sánchez, Eida Espail<strong>la</strong>t, Rosa Francia Rojas<br />
et Mariselda Fernán<strong>de</strong>z. Le centre possè<strong>de</strong> aujourd’hui un vaste local et <strong>de</strong>s départements<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du travail, <strong>de</strong> cosmétologie, <strong>de</strong> chirurgie mineure, <strong>de</strong> cryochirurgie,<br />
<strong>de</strong> pharmacie et un <strong>la</strong>boratoire; tout comme l’IDD, <strong>la</strong> clinique vise à fournir ses<br />
services à une popu<strong>la</strong>tion démunie 34-36 .<br />
Il existe actuellement d’autres cliniques <strong>de</strong>rmatologiques privées, plutôt orientées<br />
vers <strong>la</strong> cosmétologie.<br />
393<br />
Figure 12.<br />
Vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> faça<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique et<br />
<strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
peau Dr Huberto<br />
Bogaert Díaz, le<br />
centre <strong>de</strong> soin le<br />
plus important <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> République<br />
dominicaine
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
■ Publications<br />
PREMIÈRE PUBLICATION DE DERMATOLOGIE<br />
En 1967, l’IDD <strong>la</strong>nça <strong>la</strong> première publication <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> Revista Dominicana<br />
<strong>de</strong> Dermatología (RDD), organe officiel <strong>de</strong> l’institut toujours en vigueur. Sa publication est<br />
semestrielle et reçoit <strong>de</strong>s contributions <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins rési<strong>de</strong>nts aussi bien que <strong>de</strong> spécialistes<br />
nationaux et étrangers.<br />
AUTRES PUBLICATIONS<br />
Le premier texte <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine cutanée dominicaine fut publié en 1978; son éditeur fut<br />
le Dr Bogaert et il constitue le livre officiel <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les<br />
principales universités du pays. Cette publication, toujours en vigueur, a un tirage bisannuel;<br />
elle en est déjà à sa huitième édition.<br />
La <strong>de</strong>uxième publication <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’IDD parut en 1993 : <strong>la</strong> Carta Dermatológica<br />
Clínico-Quirúrgica, éditée tous les quatre mois, adressée essentiellement au<br />
mé<strong>de</strong>cin généraliste et distribuée gratuitement dans les principaux centres <strong>de</strong> soin du<br />
pays.<br />
En 1994 parut le bulletin officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> SDD, Per<strong>la</strong>s Dermatológicas, à tirage trimestriel,<br />
sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Nilda Fernán<strong>de</strong>z. De nos jours, <strong>la</strong> République dominicaine<br />
compte trois publications <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine cutanée 35 .<br />
■ L’enseignement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
394<br />
Le résidanat en <strong>de</strong>rmatologie, initié en 1967 avec une durée d’un an, s’étendit à <strong>de</strong>ux<br />
ans en 1974 et plus tard à trois ans, comprenant une année préa<strong>la</strong>ble <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne<br />
à effectuer dans un hôpital universitaire; en 1987, il fut é<strong>la</strong>rgi à quatre ans.<br />
Pendant ce temps, l’IDD prépara <strong>de</strong> nombreux spécialistes en <strong>de</strong>rmatologie; d’autres furent<br />
formés à l’étranger (au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique) et pratiquèrent<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Saint-Domingue et dans d’autres villes <strong>de</strong> province.<br />
Il existe actuellement dans le pays environ 200 <strong>de</strong>rmatologues accrédités, dont plus<br />
<strong>de</strong> 100 diplômés <strong>de</strong> l’IDCP; ce résidanat connaît une renommée internationale, au point<br />
que plusieurs étrangers s’y ren<strong>de</strong>nt, en provenance <strong>de</strong> pays tels que le Guatema<strong>la</strong>, l’Espagne,<br />
le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Panama, le Mexique, <strong>la</strong> Colombie, le<br />
Chili, l’Iran, les États-Unis et Porto Rico, entre autres.<br />
Le résidanat <strong>de</strong> l’IDCP maintient aussi <strong>de</strong>s échanges avec différentes universités <strong>de</strong>s<br />
États-Unis: Iowa University Hospital, New York Hospital, Washington University STD<br />
Training Center of Washington, University of Miami, Hospital Cleve<strong>la</strong>nd, Hospital Jackson<br />
Memorial, ainsi qu’avec l’hôpital Dr Gea González et l’institut <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Dr Barba Rubio du Mexique 36, 37 .<br />
Une partie du personnel médical <strong>de</strong>s États-Unis visite périodiquement l’IDCP, où ils<br />
reçoivent une formation sur les ma<strong>la</strong>dies tropicales et les MST.<br />
Programmes<br />
Programme <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre<br />
En 1972, l’IDD conclut un accord avec le secrétariat d’État à <strong>la</strong> Santé publique et <strong>la</strong><br />
Sécurité sociale, lui permettant <strong>de</strong> recevoir une mo<strong>de</strong>ste subvention. À travers cet accord,<br />
le secrétariat lui délégua <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> programmer, diriger et mettre en œuvre le<br />
programme <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre, préconisé par le Dr O. Hasselb<strong>la</strong>d <strong>de</strong> l’Association<br />
<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre; le programme fut entrepris en 1973 et il reçoit actuellement<br />
l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> différentes institutions internationales, comme <strong>la</strong> Lutte contre <strong>la</strong>
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en République dominicaine<br />
lèpre du Canada et l’ordre royal <strong>de</strong> Malte. Son développement permit d’éradiquer le problème<br />
<strong>de</strong> santé publique que constitue <strong>la</strong> lèpre, avant <strong>la</strong> date prévue (1999); le taux <strong>de</strong><br />
prévalence actuel se maintient à 0,4 pour 10 000 habitants, ce qui en fait un programme<br />
modèle en Amérique <strong>la</strong>tine.<br />
Projet d’intervention <strong>de</strong>s mycoses subcutanées<br />
Entrepris par Cosicou dans les années 70 et formalisé par Rafael Isa vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années<br />
80, il se concrétisa en 2000 grâce à l’apport du gouvernement espagnol à travers <strong>la</strong><br />
fondation Humanisme et Démocratie, qui permet l’assistance spécialisée, l’intervention et<br />
l’administration gratuite <strong>de</strong> médicaments pour les patients souffrant <strong>de</strong> mycoses subcutanées<br />
handicapantes telles que les chromob<strong>la</strong>stomycoses, les mycétomes, les sporotrichoses,<br />
les rhinoconidiobolomycoses, les phéohiphomycoses et les botriomycoses 38, 39 .<br />
Soins primaires en <strong>de</strong>rmatologie<br />
Ce programme — partie fondamentale <strong>de</strong> l’IDCP, du programme <strong>de</strong> Lutte contre <strong>la</strong><br />
lèpre et du projet pour contrôler les mycoses subcutanées — fut conçu et développé par<br />
le Dr Bogaert vers le début <strong>de</strong>s années 70. Le programme propose un soin médical sur<br />
le lieu <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s patients atteints d’affections cutanées faciles à traiter et sans<br />
complications — zones urbano-marginales et rurales —, envoyant les patients les plus<br />
atteints dans <strong>de</strong>s centres <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième et troisième niveau. Il permet <strong>de</strong>s examens périodiques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion au niveau national, le dépistage <strong>de</strong> certaines ma<strong>la</strong>dies, <strong>la</strong> livraison<br />
gratuite <strong>de</strong> médicaments é<strong>la</strong>borés par l’IDCP, le suivi <strong>de</strong> ces cas et une éducation<br />
communautaire 38 , 40 . Il est essentiellement à <strong>la</strong> charge du personnel non médical — les<br />
mé<strong>de</strong>cins auxiliaires spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre —, accompagnés <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins spécialistes et<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins rési<strong>de</strong>nts en formation.<br />
Autres programmes<br />
L’IDCP-DHBD (Dr Huberto Bogaert Díaz) développa d’autres programmes: celui <strong>de</strong><br />
contrôle, <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s fi<strong>la</strong>rioses et <strong>de</strong> <strong>la</strong> myiase cutanée, celui du<br />
vaccin du VIH, le programme d’intervention en MST pour <strong>la</strong> prévention du VIH, le programme<br />
<strong>de</strong> genre et <strong>de</strong> santé, qui sont financés et dirigés par différentes institutions<br />
étrangères.<br />
Produits <strong>de</strong>rmatologiques é<strong>la</strong>borés en République dominicaine<br />
Dans les premiers temps, les <strong>de</strong>rmatologues dépendaient <strong>de</strong>s produits étrangers; un<br />
<strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> médicaments à médicaments magistraux, qui constituent <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s médicaments<br />
employés dans le programme <strong>de</strong> soins primaires en <strong>de</strong>rmatologie, naquit à<br />
partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’IDD. Les prix <strong>de</strong> ces médicaments sont modiques pour les patients<br />
qui se ren<strong>de</strong>nt à une consultation aux unités <strong>de</strong> l’IDCP et ils sont distribués gratuitement<br />
sur les travaux <strong>de</strong> chantier. Plus tard, avec l’avènement <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmétologie au<br />
début <strong>de</strong>s années 80, s’ajoutèrent <strong>de</strong>s formules et <strong>de</strong>s préparations cosmétologiques.<br />
Actuellement, le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l’IDCP possè<strong>de</strong> <strong>de</strong> nombreux produits qui<br />
comportent <strong>de</strong>s masques, <strong>de</strong>s peelings, du matériel <strong>de</strong> cabinet, <strong>de</strong>s antibiotiques, <strong>de</strong>s<br />
produits cosméceutiques et tout un arsenal dans le domaine 41, 42 .<br />
Le Dr Ana Josefa Díaz et son époux, Ramón Marte, ingénieur en chimie, inaugurèrent<br />
dans les années 80 leur <strong>la</strong>boratoire, ANACEL, l’un <strong>de</strong>s premiers à fabriquer <strong>de</strong>s<br />
produits cosmétiques dans notre pays. Il existe d’autres <strong>la</strong>boratoires comme celui du<br />
centre <strong>de</strong>rmatologique Herrera, qui é<strong>la</strong>bore aussi <strong>de</strong>s formules magistrales et <strong>de</strong>s cosméceutiques.<br />
395
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
■ Vers <strong>la</strong> fin du X X e<br />
Vers <strong>la</strong> fin du XX e siècle et le début du XXI e siècle<br />
Tel que nous l’avons déjà signalé, l’IDD changea <strong>de</strong> nom en 1995 et <strong>de</strong>vint l’Institut<br />
<strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong> peau (IDCP); en 2002, après <strong>la</strong> mort du Dr Bogaert, il<br />
prit <strong>la</strong> dénomination IDCP-Dr Huberto Bogaert Díaz (IDCP-DHBD) 43 .<br />
La <strong>de</strong>rmatologie met l’accent sur les aspects cosmétiques et chirurgicaux, c’est<br />
pourquoi le résidanat <strong>de</strong> cette spécialité est <strong>de</strong>venu l’un <strong>de</strong>s plus prisés ; <strong>de</strong> nouvelles<br />
sous-spécialités surgissent, comme <strong>la</strong> greffe capil<strong>la</strong>ire, <strong>la</strong> thérapie par <strong>la</strong>ser, entre<br />
autres.<br />
■ Dermatologie et art et art<br />
Jusqu’à présent, seuls <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues se distinguèrent dans les arts p<strong>la</strong>stiques:<br />
Thimo Pimentel, le fils <strong>de</strong> Pimentel Imbert, est peintre, sculpteur et graveur, et ses ouvrages<br />
furent exposés dans divers endroits d’Amérique <strong>la</strong>tine. Luisa González <strong>de</strong> Bogaert<br />
est également peintre et sculpteur; elle partage son temps entre ces activités et l’écriture<br />
<strong>de</strong> contes et d’essais. Pour sa part, Martha Miniño est écrivain et journaliste, en plus<br />
d’être critique d’art.<br />
■ Dermatologie et magie et magie<br />
396<br />
La pratique vaudou est très ancrée dans <strong>la</strong> culture dominicaine; au cours <strong>de</strong>s rituels,<br />
les sorciers ou bocós préparent différentes infusions et <strong>de</strong>s bains contre les maléfices ou<br />
enviaciones, en utilisant <strong>de</strong>s potions et <strong>de</strong>s formules transmises oralement <strong>de</strong>puis le<br />
temps <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves noirs qui les précédèrent 44 . Cependant, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Dominicains<br />
préfèrent se rendre chez le mé<strong>de</strong>cin lorsqu’il s’agit <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. ■<br />
Annexe<br />
Hôpitaux et infirmeries <strong>de</strong> Saint-Domingue<br />
Lieu Nom Année<br />
Fort La Navidad Infirmerie 1492<br />
La Isabe<strong>la</strong> La Isabe<strong>la</strong> 1493*<br />
Fort Magdalena Infirmerie 1494<br />
Asunción La Vega Asunción 1495<br />
Región <strong>de</strong>l Cibao La Buenaventura 1496<br />
Saint-Domingue San Nicolás <strong>de</strong> Bari 1502-1509**<br />
Saint-Domingue San Andrés 1503-1511**<br />
Saint-Domingue San Lázaro 1512-1518**<br />
Saint-Domingue Hôpital Los Indios 1511***<br />
Asunción <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega San Sebastián 1562<br />
* Possédait une apothicairerie propre.<br />
** Début et fin <strong>de</strong>s travaux.<br />
*** Commencé mais jamais achevé.<br />
siècle et le début du XXI e<br />
siècle<br />
Septembre 2005<br />
Source : F. Moscoso Puello: Apuntes para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Santo Domingo, vol. 1, Universidad Central <strong>de</strong>l Este, 1982.
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Moya-Pons F. Historia colonial<br />
<strong>de</strong> Santo Domingo. 2 e éd.<br />
España: UCMM; 1976: 20-<br />
25, 33, 34.<br />
2. Casas B <strong>de</strong> Las (Fray). Historia<br />
General <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Indias. Santo<br />
Domingo: Librería<br />
Dominicana; 1976: 321-322.<br />
3. Moscoso Puello F. Apuntes<br />
para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Santo<br />
Domingo. Universidad<br />
Central <strong>de</strong>l Este. 1982; I: 33,<br />
34, 111, 302, 327, 417.<br />
4. Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo G.<br />
Historia general y natural <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s Indias. Madrid; 1851:<br />
195-197.<br />
5. Colón F. Historia <strong>de</strong>l Almirante<br />
Don Cristóbal Colón. Madrid;<br />
1892: 288.<br />
6. Coll y Toste C. « La Medicina<br />
entre los indo-antil<strong>la</strong>nos ».<br />
Boletín Histórico <strong>de</strong> Puerto<br />
Rico; 1915: 11-20.<br />
7. Larrazábal B<strong>la</strong>nco C. « Medicina<br />
y Ciencias Naturales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Is<strong>la</strong> Españo<strong>la</strong> a través <strong>de</strong> los<br />
historiadores clásicos <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
Indias ». Santo Domingo.<br />
Tribuna Médica. 1923, 1924<br />
y 1927.<br />
8. Larrazábal B<strong>la</strong>nco C.<br />
« Farmacopea India. Santo<br />
Domingo ». Tribuna Médica.<br />
1923; 58<br />
9. Moscoso Puello F. Apuntes<br />
para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Santo<br />
Domingo. Santo Domingo:<br />
Librería Dominicana. 1977; II:<br />
29-48, 141-169.<br />
10. Joubert J. « Primeros médicos<br />
dominicanos ». Periódico<br />
HOY. 11 oct. 1998; 1(A): 25.<br />
11. Legère M. Les gran<strong>de</strong>s<br />
endémies tropicales. París;<br />
1934: 74-77.<br />
12. Larrazábal B<strong>la</strong>nco C. « Ciencia<br />
indohaitiana. Santo Domingo ».<br />
Tribuna Médica. 1926; II(2-3).<br />
13. Chopitre E. Aperçu sur le piano<br />
et les ma<strong>la</strong>dies dont il est suivi<br />
[Thesis Nº 385]. Archivos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Nación. República<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en République dominicaine<br />
Dominicana. París; 1804.<br />
14. Moscoso Puello F. Apuntes<br />
para <strong>la</strong> historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina <strong>de</strong> <strong>la</strong> is<strong>la</strong> <strong>de</strong> Santo<br />
Domingo. Santo Domingo:<br />
Librería Dominicana. 1977;<br />
III: 383-392.<br />
15. Ortega M. « Algunos apuntes<br />
sobre <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Salud Pública en <strong>la</strong> República<br />
Dominicana ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1970; 4(1): 60-77.<br />
16. Brache R. « Dr. Fernando Arturo<br />
Defilló. Biografía <strong>de</strong>l primer<br />
leprólogo dominicano ». Per<strong>la</strong>s<br />
Dermat. 1996; 3(4): 3.<br />
17. Miniño F. [interview]. 1998.<br />
18. Bogaert H., Castel<strong>la</strong>zzi Z.<br />
Manual <strong>de</strong> Lepra. Santo<br />
Domingo: Ediciones Amigo<br />
<strong>de</strong>l Hogar; 1993: 60-62.<br />
19. Fernán<strong>de</strong>z N., Mendizábal M.<br />
« Semb<strong>la</strong>nza <strong>de</strong>l doctor<br />
Manuel F. Pimentel Imbert ».<br />
Per<strong>la</strong>s Dermat. 1994; 1(1): 1-2.<br />
20. Soñé V. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Asociación <strong>de</strong> Dermatología<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> República<br />
Dominicana ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1967; 4(1): 62-66.<br />
21. Fernán<strong>de</strong>z N. « Notas<br />
Históricas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Dominicana Dermatológica ».<br />
Per<strong>la</strong>s Dermat. 1996; 3(3): 3.<br />
22. Bogaert H. « El Patronato <strong>de</strong><br />
Lucha Contra <strong>la</strong> Lepra <strong>de</strong><br />
República Dominicana ». Rev.<br />
Dom. Dermatol. 1970; 4(1):<br />
62-66.<br />
23. Bogaert H. « Diez años <strong>de</strong>l<br />
Instituto Dermatológico ».<br />
Rev. Dom. Dermatol. 1982;<br />
16(1-2): 49-55.<br />
24. Bogaert H. « Enseñanza <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en República<br />
Dominicana. Cursos <strong>de</strong><br />
posgrados ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1982; 16(1-2): 61-<br />
65.<br />
25. Bogaert H. « Inauguran curso<br />
<strong>de</strong> adiestramiento <strong>de</strong><br />
auxiliares en <strong>de</strong>rmatoleprología<br />
». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1970; 4(1): 1-4.<br />
26. « Primer Congreso <strong>de</strong> Lepra y<br />
Sífilis. Invitación ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1970; 4(1): 68.<br />
27. Coiscou A. « Panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Micología Médica en <strong>la</strong><br />
República Dominicana ». Rev.<br />
Dom. Dermatol. 1974; 8(2):<br />
104-117.<br />
28. Miniño M. « Principales<br />
pruebas para <strong>la</strong>s<br />
conectivopatías ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 2003; 31(1): 5.<br />
29. Bogaert H., Simonó F.<br />
« Instituto Dermatológico y<br />
Cirugía <strong>de</strong> Piel, Unidad<br />
Cibao: Antece<strong>de</strong>ntes y<br />
diferentes programas <strong>de</strong><br />
salud ». Rev. Dom. Dermatol.<br />
1999; 26(1): 7-12.<br />
30. Bogaert H. « Pa<strong>la</strong>bras<br />
pronunciadas por el Dr.<br />
Huberto Bogaert en el acto<br />
<strong>de</strong> graduación <strong>de</strong> <strong>la</strong> 23ª<br />
promoción <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatovenerólogos<br />
<strong>de</strong>l Instituto<br />
Dermatológico Dominicano, 5<br />
<strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 1993 ». Santo<br />
Domingo. Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1993; 20(1-2): 5-6.<br />
31. Bogaert H. « Pa<strong>la</strong>bras<br />
pronunciadas por el Dr.<br />
Huberto Bogaert en el acto<br />
inaugural <strong>de</strong>l 8º Congreso<br />
Latinoamericano <strong>de</strong> ETS ».<br />
Rev. Dom. Dermatol. 1992;<br />
19(2): 5- 6.<br />
32. Larrache R. Revisión histórica<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>bor realizada por el<br />
Departamento <strong>de</strong> Cirugía<br />
Dermatológica <strong>de</strong>l Instituto<br />
Dermatológico y Cirugía <strong>de</strong><br />
Piel, ag. 1988-dic. 1996. Tesis<br />
IDCP-UASD; 1997: 25-28.<br />
33. González L. « Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
cirugía <strong>de</strong>rmatológica ». Rev.<br />
Dom. Dermatol. 1999; 26(1):<br />
25-26.<br />
34. Miniño M., Isa R. « Historia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Dermatología en República<br />
Dominicana ». Rev. Dom.<br />
Dermatol. 1999; 26(2): 7-11.<br />
35. Fernán<strong>de</strong>z N. « Editorial ».<br />
Per<strong>la</strong>s Dermat. 1994; 1(1): 1.<br />
36. Bogaert H. « La Dermatología<br />
en el nuevo milenio »<br />
[conferencia magistral]. 11º<br />
Congreso <strong>de</strong> Dermatología,<br />
Sociedad Dominicana <strong>de</strong><br />
Dermatología, jun 2001. Rev.<br />
Dom. Dermatol. 2002; 29(1):<br />
45-49.<br />
37. Miniño M. « La resi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong><br />
Dermatología <strong>de</strong>l IDCP ». Rev.<br />
Dom. Dermatol. 2000; 27(2):<br />
7-10.<br />
397
MARTHA MINIÑO, RAFAEL ISA ISA<br />
38. Isa R., Miniño M., Canario S.<br />
« Proyecto <strong>de</strong> intervención <strong>de</strong><br />
micosis subcutáneas »<br />
[conferencia]. 12º Congreso<br />
<strong>de</strong> Dermatología. Sociedad<br />
Dominicana <strong>de</strong> Dermatología;<br />
sept. 2003.<br />
39. Isa R. « Panorama <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
micosis subcutáneas en <strong>la</strong><br />
República Dominicana »<br />
[conferencia]. Aca<strong>de</strong>mia<br />
Dominicana <strong>de</strong> Medicina;<br />
febr. 2004.<br />
40. Bogaert H. « Atención<br />
primaria en Dermatología »<br />
[conferencia magistral]. 21º<br />
Congreso Centroamericano<br />
<strong>de</strong> Dermatología. San José<br />
(Costa Rica): Sociedad<br />
Centroamericana <strong>de</strong><br />
Dermatología; 1998.<br />
41. Miniño M., Hernán<strong>de</strong>z P.<br />
« Exfoliación química<br />
(peelings) ». Dermatol. Cosm.<br />
Med. Quir. 2003; 1(4): 237-<br />
240.<br />
42. Departamento Producción<br />
IDCP. Formu<strong>la</strong>ciones Instituto<br />
Dermatológico y Cirugía <strong>de</strong><br />
Piel; 2003: 1.<br />
43. « Activida<strong>de</strong>s IDCP ». Rev.<br />
Dom. Dermatol. 2002; 29(1):<br />
67.<br />
44. Miniño M. « ¿Es el vudú una<br />
religión? ». Documentos<br />
artísticos <strong>de</strong>l Maestro. Serie<br />
Arte y Sociedad.<br />
Publicaciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad Autónoma <strong>de</strong><br />
Santo Domingo. 1999; (38):<br />
13-22.
Introducción<br />
LES INDIGÈNES DE<br />
L’URUGUAY ET LEUR<br />
RAPPORT À LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
L’Uruguay et le P<strong>la</strong>ta<br />
Vivaient leur printemps sauvage...<br />
... C’est <strong>la</strong> race charrua<br />
Dont le nom<br />
Les on<strong>de</strong>s et les bois conservèrent à peine<br />
Pour qu’elle évoque l’âme d’un poème<br />
Nom qui reproduit encore<br />
La tempête lointaine, qui se rapproche<br />
Formant les fanaux <strong>de</strong> l’éc<strong>la</strong>ir<br />
Avec les nuages lourds <strong>de</strong> cendres.<br />
C’est <strong>la</strong> race indomptable<br />
Qui donna le courage dans ces terres<br />
Patrie <strong>de</strong>s amours et <strong>de</strong>s gloires,<br />
Qui se penche vers l’Uruguay et le P<strong>la</strong>ta;<br />
Patrie, dont le nom<br />
Devient chanson dans <strong>la</strong> harpe du poète,<br />
Cri dans le cœur, lumière dans l’aurore,<br />
Feu dans l’esprit et étoile dans le ciel...<br />
... La fleur tomba dans l’eau.<br />
Les cercles concentriques tremb<strong>la</strong>nts<br />
Firent ba<strong>la</strong>ncer les vertes jacinthes d’eau<br />
Et moururent dans le silence <strong>de</strong> <strong>la</strong> jonchaie...<br />
(J. Zorril<strong>la</strong> <strong>de</strong> San Martín, Tabaré 1 )<br />
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
■ Introduction<br />
Tel les cercles concentriques qui meurent dans les bras <strong>de</strong> <strong>la</strong> jonchaie, on prétendit<br />
anéantir une race; <strong>la</strong> Conquête fut un succès et <strong>la</strong> colonisation totale : politique, culturelle<br />
et religieuse. Nous partageons le concept transmis par INDIA (Intégration nationale<br />
399
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
400<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>scendants d’indigènes américains) : « Ils arrachèrent nos feuilles, enlevèrent nos<br />
branches, coupèrent notre tronc, mais ils ne purent pas toucher notre racine et c’est <strong>de</strong><br />
là que renaît notre force. »<br />
Une fois <strong>la</strong> Découverte achevée, les Espagnols durent déterminer si les Indiens étaient<br />
<strong>de</strong>s êtres humains dans le but <strong>de</strong> les évangéliser. Une bulle du pape Paul III reconnut leur<br />
condition humaine en 1537 2 .<br />
En Amérique, les indigènes subirent <strong>la</strong> cupidité <strong>de</strong>s conquistadors, qui commença<br />
avec Colomb et sa soif d’or : « L’or est excellentissime; avec l’or on fait un trésor, et avec<br />
ce trésor, celui qui le possè<strong>de</strong> fait ce que le mon<strong>de</strong> veut, et il peut même envoyer <strong>de</strong>s<br />
âmes au Paradis 3 .»<br />
En 1495, Colomb dirigea une campagne militaire contre les indigènes <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Saint-<br />
Domingue, dont 500 furent conduits en Espagne comme esc<strong>la</strong>ves; face à <strong>la</strong> protestation<br />
<strong>de</strong>s théologiens, l’esc<strong>la</strong>vage fut interdit. Eduardo Galeano dit qu’il fut plutôt « béni », car<br />
<strong>la</strong> pratique habituelle après chaque soumission consistait à lire face à un notaire une requête<br />
longue et rhétorique exhortant les indigènes à se convertir à <strong>la</strong> « sainte foi »; s’ils<br />
s’y opposaient, ils étaient réduits en esc<strong>la</strong>vage 4 .<br />
Amerigo Vespucci, dont les travaux cartographiques fournirent son nom au continent<br />
américain, annote avec froi<strong>de</strong>ur les cruautés envers les Indiens antil<strong>la</strong>is. Comme auparavant<br />
Colomb, il juge que les indigènes sont « timi<strong>de</strong>s et bêtes et que l’on pouvait en<br />
faire ce qu’on vou<strong>la</strong>it 5 .»<br />
Selon l’analyse <strong>de</strong> Galeano, les civilisations qui débarquaient sur ces terres vivaient<br />
l’explosion créatrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> Renaissance. L’Amérique apparaît comme une invention <strong>de</strong><br />
plus, venant s’ajouter tout comme <strong>la</strong> poudre, l’imprimerie, le papier et <strong>la</strong> boussole au<br />
bouil<strong>la</strong>nt surgissement <strong>de</strong> l’ère mo<strong>de</strong>rne; il existait un grand déséquilibre entre le développement<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s, ce qui explique dans une gran<strong>de</strong> mesure <strong>la</strong> facilité <strong>de</strong>s civilisations<br />
autochtones à succomber 4 .<br />
Depuis <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> notre nation (1830), l’histoire officielle se chargea <strong>de</strong> soutenir<br />
que « l’Uruguay était un pays sans Indiens », ce qui encourageait une forte présence<br />
d’immigrants, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière gran<strong>de</strong> vague d’Européens étant arrivée dans les années 20 du<br />
siècle <strong>de</strong>rnier, en quête <strong>de</strong> paix et <strong>de</strong> bien-être 6, 7 .<br />
L’État oriental <strong>de</strong> 1830 fut un projet libéral, par conséquent antiartiguista (contre le projet<br />
<strong>de</strong> José G. Artigas) à l’origine, contraire au concept <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Patrie fédérale et d’intégration<br />
<strong>américaine</strong> proc<strong>la</strong>mée par notre grand homme José Gervasio Artigas Pasqual.<br />
Artigas lutta pour les droits <strong>de</strong>s Indiens avec lesquels il vécut pendant plusieurs années;<br />
ils furent ses camara<strong>de</strong>s dans <strong>la</strong> lutte armée pour l’indépendance, ils formaient sa<br />
gar<strong>de</strong> du corps personnelle et restèrent <strong>de</strong>s amis fidèles jusqu’aux <strong>de</strong>rniers jours <strong>de</strong> sa<br />
vie en exil au Paraguay.<br />
L’État naissant essaya <strong>de</strong> démontrer que les Charruas étaient peu nombreux et<br />
constamment présentés <strong>de</strong> façon calomnieuse comme étant rustres et incorrigibles.<br />
Abel<strong>la</strong> dit que « c’était l’époque <strong>de</strong>s idées reçues subtilement racistes, avec tellement <strong>de</strong><br />
préjugés inculqués que Zorril<strong>la</strong> <strong>de</strong> San Martín, bril<strong>la</strong>nt auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patrie,<br />
dut créer un personnage métis — Tabaré — pour y mettre <strong>de</strong>s sentiments humains; nous<br />
ne conservons que <strong>la</strong> beauté <strong>de</strong> <strong>la</strong> poésie <strong>de</strong> cet ouvrage, divergeant avec le thème 6 .»<br />
Barran soutient que les c<strong>la</strong>sses dominantes du pays créèrent le mythe <strong>de</strong> l’Uruguay européen<br />
et b<strong>la</strong>nc. L’estuaire du P<strong>la</strong>ta vécut une colonisation tardive car il ne possédait pas <strong>de</strong><br />
trésors et que l’entrée vers les « terres <strong>de</strong>s métaux » ne fut pas trouvée sur le Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta.<br />
Ces régions furent peuplées pour trois raisons fondamentales : <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> leurs prairies,<br />
le port naturel <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o et leur situation frontalière avec l’Espagne et le Portugal.<br />
La persécution et l’ethnoci<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Charruas al<strong>la</strong>ient commencer bien avant 1830,<br />
concrètement avec les hostilités <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>irantes à partir <strong>de</strong> 1610. Désormais le manque<br />
<strong>de</strong> refuges au fin fond <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt al<strong>la</strong>it conditionner <strong>la</strong> forme <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s aborigènes, les<br />
poussant à <strong>de</strong>venir davantage noma<strong>de</strong>s 6 .
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Selon une légen<strong>de</strong> indigène, <strong>la</strong> première jeune fille charrua morte en défendant son<br />
peuple <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>iras fut enterrée dans le versant d’une colline; son compagnon, <strong>de</strong>meuré<br />
à côté <strong>de</strong> sa tombe pendant plusieurs jours, mourut au cours d’un combat ultérieur<br />
et fut enterré à côté <strong>de</strong> sa bien-aimée.<br />
Quelque temps après, le corps <strong>de</strong> <strong>la</strong> jeune fille surgit <strong>de</strong> terre sous <strong>la</strong> forme d’un ceibo<br />
aux fleurs rouges; un oiseau à plumage rouge qui surveil<strong>la</strong>it l’horizon s’était posé sur ses<br />
branches : c’était le cœur du Charrua. Le moucherolle vermillon épris <strong>de</strong> liberté rappelle<br />
au peuple charrua qu’il ne doit jamais accepter l’esc<strong>la</strong>vage; <strong>la</strong> fleur rouge du ceibo<br />
constitue aujourd’hui notre fleur nationale 8 .<br />
Les ban<strong>de</strong>irantes étaient <strong>de</strong>s groupes armés créés à Sao Paulo qui fonctionnaient<br />
comme une entreprise très bien organisée, recrutant <strong>de</strong>s Indiens pour les vendre aux<br />
p<strong>la</strong>ntations <strong>de</strong> sucre et aux haciendas <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Sao Paulo avait été fondée en 1543<br />
sur le bord même <strong>de</strong> <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> démarcation du traité <strong>de</strong> Tor<strong>de</strong>sil<strong>la</strong>s, signé entre l’Espagne<br />
et le Portugal pour délimiter l’étendue territoriale portugaise en Amérique 9 .<br />
Les tueries et les persécutions contre les Charruas se poursuivirent pendant plus <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux siècles. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille du Yí (1703) les forces alliées entre les Tapes et les Espagnols<br />
décimèrent 300 Charruas. En 1751, le gouverneur Joaquín <strong>de</strong> Viana donna l’ordre<br />
<strong>de</strong> les « égorger ». Le « corps <strong>de</strong> B<strong>la</strong>n<strong>de</strong>ngues » fut créé en 1797 pour mener une « lutte<br />
sans merci contre les infidèles »; on pourrait citer davantage d’épiso<strong>de</strong>s du genre 10 .<br />
Le 18 avril 1831, le général Rivera, premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, tua sauvagement<br />
les membres <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières tribus charruas au cours d’une embusca<strong>de</strong> au niveau<br />
du ruisseau Salsipue<strong>de</strong>s. Ses fidèles soldats d’antan y furent réunis sous prétexte <strong>de</strong> promouvoir<br />
un traité <strong>de</strong> paix qui finit en trahison.<br />
Le prési<strong>de</strong>nt Rivera écrivit au général Laguna, à qui on avait <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> rassembler<br />
les Charruas : « lnsufflez-leur <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> confiance et assurez-les <strong>de</strong> <strong>la</strong> bonne disposition<br />
et <strong>de</strong> l’amitié du prési<strong>de</strong>nt envers eux… » La raison invoquée par le gouvernement<br />
était que les Charruas occupaient <strong>de</strong>s terres qui étaient adjugées (alors qu’ils y habitaient<br />
<strong>de</strong>puis trois mille cinq cents ans) et que Rivera vou<strong>la</strong>it « pacifier <strong>la</strong> campagne ».<br />
Le groupe armé <strong>de</strong> Salsipue<strong>de</strong>s était formé par <strong>de</strong>s Guaranis originaires du Paraguay, par<br />
<strong>de</strong>s bataillons d’Argentins et <strong>de</strong> Brésiliens sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s propriétaires <strong>de</strong>s haciendas<br />
et par l’armée nationale, commandée par le prési<strong>de</strong>nt Rivera et son neveu Bernabé Rivera;<br />
celui-ci fut exécuté quelque temps après par un groupe <strong>de</strong> Charruas sous les ordres du chef<br />
cacique Sepé, qui avait promis <strong>de</strong> se venger du « traître Dom Frutos Rivera » 11, 12, 13 .<br />
Lorsque nous parlons <strong>de</strong> l’ethnoci<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Charruas, il ne faut pas oublier qu’il fut longuement<br />
analysé et p<strong>la</strong>nifié. Avant <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r l’« opération Salsipue<strong>de</strong>s », on avait pensé<br />
à les envoyer en Patagonie ou à les expulser vers le Brésil.<br />
En 1831, José El<strong>la</strong>uri, ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Guerre, signait un décret permettant aux Charruas<br />
d’être embarqués « sans leur permettre <strong>de</strong> débarquer au port ». Le Charrua Ramón<br />
Mataojo fut envoyé en France, les archives indiquant une hospitalisation à Toulon du 22<br />
au 29 avril 1832; il mourut sur le bateau du retour le 21 septembre 11 .<br />
Vers <strong>la</strong> même époque plusieurs Charruas étaient exilés dans les îles Malouines. Commandés<br />
par Antonio Rivero, <strong>de</strong> <strong>la</strong> province argentine d’Entre Ríos, ils attaquèrent l’établissement<br />
<strong>de</strong> Luis Vernet, à Puerto Soledad (26 août 1833). Quelques-uns d’entre eux furent<br />
emprisonnés et exilés ensuite à Valparaíso, tandis que d’autres moururent au combat.<br />
Les Malouines abritent les tombes <strong>de</strong>s Charruas qui luttèrent en 1833 pour défendre<br />
<strong>la</strong> souveraineté argentine et <strong>américaine</strong> <strong>de</strong>s îles. En 1982, lorsque celles-ci furent occupées<br />
par l’armée argentine, l’endroit prit le nom <strong>de</strong> Capitán Rivero, en souvenir <strong>de</strong>s actions<br />
<strong>de</strong> cet indigène d’Entre Ríos; il <strong>de</strong>vint ensuite Puerto Argentino et il porte<br />
actuellement le nom <strong>de</strong> Port Stanley 11, 13 .<br />
Quatre survivants <strong>de</strong> Salsipue<strong>de</strong>s furent conduits en France le 25 février 1833 : Vaimaca<br />
Pirú et Tacuabé — qui avaient lutté pour l’indépendance avec Artigas et Rivera —,<br />
Guyunusa et Senaqué (mé<strong>de</strong>cin-chaman).<br />
401
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
L’histoire officielle nous dit qu’il s’agissait <strong>de</strong>s quatre <strong>de</strong>rniers Charruas, mais il n’en<br />
fut pas ainsi : après <strong>la</strong> tuerie, <strong>de</strong>s enfants et <strong>de</strong>s femmes furent répartis entre les familles<br />
<strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o; plusieurs hommes fuirent, d’autres se réfugièrent là où il fut impossible<br />
<strong>de</strong> les retrouver, même <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong> <strong>la</strong> frontière.<br />
L’entrepreneur François <strong>de</strong> Curel les amena en France dans le but <strong>de</strong> les présenter<br />
au roi et aux sociétés scientifiques. Ils furent exhibés dans un cirque inhumain; le célèbre<br />
Chopin se trouvait parmi les spectateurs.<br />
Quelques mois plus tard, Senaqué mourut, ensuite Vaimaca et finalement Guyunusa,<br />
atteinte <strong>de</strong> tuberculose. Cependant, avant <strong>de</strong> mourir, elle mit au mon<strong>de</strong> un fils <strong>de</strong> Tacuabé,<br />
qui fuit avec l’enfant et se perdit en France sans <strong>la</strong>isser aucune trace. On n’en sut<br />
pas davantage 11, 12, 13, 14, 15 .<br />
Contrairement au reste <strong>de</strong> l’Amérique, il n’existe actuellement pas <strong>de</strong> communautés<br />
indigènes en Uruguay. Depuis plus <strong>de</strong> cent ans, il n’y a pas d’Indiens autochtones<br />
sur notre territoire mais uniquement leurs <strong>de</strong>scendants, qui sont actuellement regroupés<br />
en diverses institutions dont les objectifs sont très variés. Depuis presque<br />
vingt ans, ils mènent <strong>de</strong>s recherches sur leurs ancêtres, organisent <strong>de</strong>s conférences et<br />
<strong>de</strong>s événements culturels, récupèrent <strong>de</strong>s symboles et <strong>de</strong>s mots longtemps gardés,<br />
qu’ils chantent même. Jusqu’en 1991, les premiers recensements comptaient 120 familles<br />
(360 individus) <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendants. Des données plus récentes font état <strong>de</strong> 500 000<br />
individus 16 .<br />
Les étu<strong>de</strong>s d’anthropologie biologique, entreprises par les Drs Mañe Garzón et Nora<br />
Sans en 1985, se poursuivent aujourd’hui sur le territoire. Les recherches menées par le<br />
Dr Sans à Tacuarembó montrent que plus <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong>s gènes <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion possè<strong>de</strong><br />
une origine indigène. Parmi cette popu<strong>la</strong>tion, 59 % <strong>de</strong>scend <strong>de</strong>s indigènes par <strong>la</strong> voie maternelle,<br />
ce qui montre qu’en Uruguay, tout comme en Amérique Latine, il y eut <strong>de</strong>s<br />
unions entre les femmes natives et les Européens. Les chiffres se répètent dans d’autres<br />
points du territoire, mais ils sont moindres 11 . Ces étu<strong>de</strong>s certifient qu’une part importante<br />
<strong>de</strong> sang américain est conservée chez nos habitants : nous, membres <strong>de</strong> cette nation,<br />
ne sommes pas alors seulement <strong>de</strong>s immigrants européens ou <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong><br />
ces immigrants 17 .<br />
■ Les voyages dans le Paranaguazú dans le (Rio Paranaguazú <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta) (Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta)<br />
402<br />
Tous les documents écrits sur l’Uruguay indigène proviennent <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conquête et <strong>de</strong>s siècles ultérieurs. Du fait que les peuples aborigènes ne connaissaient<br />
pas l’écriture, il fallut avoir recours aux chroniques <strong>de</strong>s voyageurs et aux recherches archéologiques,<br />
anthropologiques et philologiques pour les étudier. Parfois les récits sont<br />
le fait <strong>de</strong> personnes peu informées qui ne s’intéressent point à l’ethnographie, mais ils<br />
sont quand même très précieux.<br />
Paranaguazú (fleuve <strong>la</strong>rge comme <strong>la</strong> mer) était le nom que les indigènes donnaient<br />
au Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta; ce <strong>de</strong>rnier nom provient d’une interprétation erronée car on pensait<br />
que nos territoires étaient riches en métaux; <strong>la</strong> dénomination se perpétue cependant.<br />
Avant d’être l’effrayante « tombe <strong>de</strong>s navigants », comme le prouvent les multiples<br />
naufrages causés par les redoutables vents pamperos et par les bancs <strong>de</strong> sable <strong>de</strong> son lit,<br />
le Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta fut le sépulcre <strong>de</strong>s illusions. Son entrée <strong>la</strong>rge empêcha l’arrivée dans<br />
les entrailles argentifères d’Amérique où se trouvait <strong>la</strong> légendaire Sierra <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, l’actuel<br />
Potosí 18 .<br />
À son arrivée au Paranaguazú en 1502, Amerigo Vespucci l’appe<strong>la</strong> Rio Jordán 19 . En<br />
1516, l’expédition <strong>de</strong> Juan Díaz <strong>de</strong> Solís entama une série <strong>de</strong> navigations telle une compétition<br />
entre l’Espagne et le Portugal pour chercher le passage vers le Pacifique et découvrir<br />
les chemins vers les terres <strong>de</strong>s trésors. Avant Solís, d’autres navigants y étaient passés,
comme le prouve l’île <strong>de</strong> Flores, sur le Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta, ainsi que <strong>la</strong> carte réalisée par le cartographe<br />
Schöner en 1515, montrant un détroit qui relie en théorie les mers du Sud 20 .<br />
Solís appe<strong>la</strong> le fleuve Mar Dulce (mer douce). Des indigènes, qui habitaient les côtes<br />
du territoire actuel <strong>de</strong> Colonia, le tuèrent et le mangèrent. Ces Indiens n’étaient pas <strong>de</strong>s<br />
Charruas mais <strong>de</strong>s Guaranis ; ils pratiquaient l’anthropophagie comme pratique rituelle<br />
car les sources <strong>de</strong> protéines étaient très abondantes sur ces terres, comme le signalent<br />
les récits <strong>de</strong>s voyageurs qui décrivaient <strong>la</strong> faune et <strong>la</strong> flore <strong>de</strong> <strong>la</strong> région.<br />
L’anthropophagie rituelle était pratiquée par les groupes amazoniens mais pas par les<br />
Patagons 20, 21 .<br />
Les chroniques racontant le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie et les habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Charruas nous parviennent<br />
à partir <strong>de</strong> l’arrivée <strong>de</strong> Solís; nous en citerons les plus importantes.<br />
En 1520, Fernand <strong>de</strong> Magel<strong>la</strong>n navigua sur le Rio <strong>de</strong> Solís, appel<strong>la</strong>tion donnée en<br />
l’honneur du marin décédé. On connaît, grâce à ce voyage, le nom Monte Vidi, qui désignerait<br />
plus tard notre capitale Montevi<strong>de</strong>o, en allusion à <strong>la</strong> colline située dans <strong>la</strong> baie<br />
(en 1502, Vespucci l’avait appelée Pinnaculum Detentio, c’est-à-dire « <strong>de</strong> l’arrêt » ou « <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> tentation », selon <strong>la</strong> traduction). Magel<strong>la</strong>n navigua sur le fleuve Uruguay, où les indigènes<br />
l’approvisionnèrent en vivres. Sans trouver <strong>la</strong> route <strong>de</strong>s trésors, il poursuivit son<br />
voyage vers le sud et atteignit le Pacifique à travers le détroit qui porte aujourd’hui son<br />
nom 18 .<br />
L’an 1527 marqua l’arrivée <strong>de</strong> Sebastián Gaboto, qui fonda le premier peuplement en<br />
Uruguay au bord <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière San Salvador et qui, selon les récits, entra en contact avec<br />
les indigènes.<br />
Les mémoires <strong>de</strong> Diego García (1526-1530) constituent l’un <strong>de</strong>s documents les plus<br />
précieux pour i<strong>de</strong>ntifier <strong>la</strong> nation charrua.<br />
Pour sa part, le cahier <strong>de</strong> navigation <strong>de</strong> Lope <strong>de</strong> Souza (1530) offre <strong>de</strong>s témoignages<br />
très intéressants concernant son contact avec les Charruas, décrivant aussi les recoins,<br />
<strong>la</strong> faune et <strong>la</strong> flore <strong>de</strong> <strong>la</strong> région.<br />
En 1536, Pedro <strong>de</strong> Mendoza étudia l’embouchure <strong>de</strong>s fleuves Uruguay et Paraná. Sur<br />
<strong>la</strong> côte sud-ouest, à côté du Riachuelo, il fonda un vil<strong>la</strong>ge qu’il appe<strong>la</strong> Santa María <strong>de</strong> los<br />
Buenos Aires. Un soldat <strong>de</strong> son expédition, Ulrico Schmi<strong>de</strong>l, nous <strong>la</strong>issa un long récit qu’il<br />
rédigea après environ vingt ans <strong>de</strong> vie sur ces terres.<br />
Martín <strong>de</strong>l Barco Centenera, venu avec le a<strong>de</strong><strong>la</strong>ntado Ortiz <strong>de</strong> Zárate (1573), écrivit<br />
un poème — connu <strong>de</strong> manière posthume — qu’il appe<strong>la</strong> Argentine et <strong>la</strong> conquête du Rio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta... Le mot Argentine fait ici allusion aux territoires <strong>de</strong> toute <strong>la</strong> région du P<strong>la</strong>ta,<br />
réputée, abusivement, receler <strong>de</strong> l’argent (argentum).<br />
L’étymologie du mot « argentine » vient <strong>de</strong> argentum (argent). L’influence <strong>de</strong> cette appel<strong>la</strong>tion<br />
fut si puissante que non seulement elle changea le nom du Rio <strong>de</strong> Solís par Rio<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta (p<strong>la</strong>ta : argent en espagnol), mais elle perdura aussi en donnant son nom à <strong>la</strong><br />
nation voisine, <strong>la</strong> République argentine 18, 22 .<br />
L’Uruguay indigène<br />
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
■ L’Uruguay indigène<br />
Il fut impossible <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s fossiles d’hominidés en Amérique car l’Amérindien<br />
n’est pas un autochtone, il n’est pas originaire du continent américain. Différents chercheurs<br />
soutiennent qu’il vint d’Asie, en plusieurs étapes <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> Sibérie via le détroit<br />
<strong>de</strong> Behring.<br />
Selon Bates, et d’après les découvertes archéologiques d’éléments datant <strong>de</strong> trentecinq<br />
mille à quarante mille ans, son apparition en Amérique eut lieu avant son apparition<br />
en Europe. Il s’agissait <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong> type mongoloï<strong>de</strong>, qui acquirent plus tard <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques différenciées suivant les facteurs environnementaux. D’autres théories<br />
soutiennent qu’ils purent arriver plus tard par l’océan Pacifique et l’Antarctique.<br />
403
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
404<br />
L’existence <strong>de</strong> l’homme sur notre territoire remonte à environ dix mille ans. L’archéologue<br />
Ta<strong>de</strong>i fit cette découverte, trouvant en 1955 <strong>de</strong> vastes sites-ateliers au nord <strong>de</strong><br />
notre territoire. Daniel Vidart l’appe<strong>la</strong> « culture cata<strong>la</strong>nense ». Ils occupèrent <strong>la</strong> région,<br />
sans se dép<strong>la</strong>cer beaucoup car <strong>la</strong> zone était riche en flore et en faune. Ces groupes, qui<br />
constituent notre préhistoire, étaient <strong>de</strong>s cueilleurs et <strong>de</strong>s chasseurs inférieurs.<br />
Ultérieurement se produisirent <strong>de</strong>s incursions <strong>de</strong> différentes cultures jusqu’à l’arrivée<br />
<strong>de</strong>s Charruas en provenance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patagonie il y a environ trois mille cinq cents ans12, 21,<br />
23, 24, 25 .<br />
D’après les recherches, pendant les années <strong>de</strong> <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> l’Amérique, l’Uruguay<br />
était peuplé par quelques milliers d’indigènes — Charruas, Chanaes, Guenoas, Minuans,<br />
Yaros, Bohanes, Guaranis et Arachans — et son territoire s’étendait jusqu’au Brésil et en<br />
Argentine. Nous allons décrire brièvement leur provenance et les différences entre les<br />
tribus diverses.<br />
Charruas, Guenoas, Chanaes et Minuans constituaient <strong>la</strong> macro-ethnie charrua aux<br />
origines et aux racines linguistiques simi<strong>la</strong>ires. Ils occupaient les territoires <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte du<br />
P<strong>la</strong>ta, le centre et le nord <strong>de</strong> l’Uruguay. Les Minuans arrivaient jusqu’à Río Gran<strong>de</strong>, tandis<br />
que les Charruas et les Chanaes s’étendaient jusqu’à <strong>la</strong> Mésopotamie argentine. Du<br />
point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> race, les Charruas étaient patagoniques (Chonick), une branche <strong>américaine</strong><br />
caractéristique <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ines présentant <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s analogies avec plusieurs coutumes<br />
<strong>de</strong>s Tehuelches, y compris <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue. D’après Serafín Cor<strong>de</strong>ro, l’arrivée <strong>de</strong>s<br />
Charruas serait déterminée par un élément d’individualisation du Néolithique : l’arc et <strong>la</strong><br />
flèche.<br />
Outre l’hypothèse qui révèle que l’homme américain est arrivé sur le continent par le<br />
détroit <strong>de</strong> Béring (Mongols), il existe une autre théorie très acceptée, développée par<br />
Rivet11 , selon <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> race patagonique aurait une origine australienne; quelque<br />
soixante-dix mots <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngues tehuelches et australiennes se ressemblent. Goebner et<br />
Schmidt trouvèrent quelques similitu<strong>de</strong>s ethnographiques entre les Indiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> Terre<br />
<strong>de</strong> Feu et ceux d’Australie : <strong>la</strong> stature et <strong>la</strong> couleur <strong>de</strong> peau <strong>de</strong>s Patagons sont semb<strong>la</strong>bles<br />
à celles <strong>de</strong>s Australiens mais pas à celles <strong>de</strong>s Mongols. Rivet ne peut pourtant pas<br />
expliquer c<strong>la</strong>irement comment ils arrivèrent sur ces terres, étant donné l’océan qui les<br />
sépare26 .<br />
Les Yaros et les Bohanes étaient <strong>de</strong>s tribus qui arrivèrent sur notre territoire avant<br />
les Charruas il y a environ six mille ans, se glissant le long du bassin <strong>de</strong> l’Amazone grâce<br />
aux torrents, <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> cordillère <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s. Ils vinrent par les fleuves Parana et<br />
Uruguay et s’établirent sur notre territoire et en Mésopotamie argentine. Les témoignages<br />
<strong>de</strong> Sepp (1691) décrivent leurs traits anthropologiques et leurs coutumes; Félix<br />
<strong>de</strong> Azara constate que leur <strong>la</strong>ngue est tout à fait différente <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s autres indigènes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région25, 26, 27 .<br />
Après l’établissement <strong>de</strong>s Charruas provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Patagonie, une incursion <strong>de</strong> races<br />
tropicales — les Guaranis et les Tupi-Guaranis — se produisit il y a environ <strong>de</strong>ux mille<br />
ans; ceux-ci appartenaient à <strong>la</strong> famille caraïbe, mot étymologiquement lié à « cannibale ».<br />
Elles occupèrent <strong>de</strong> vastes territoires <strong>de</strong>puis les Guyanes jusqu’au Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta. Dans<br />
notre région, les Guaranis s’installèrent sur <strong>la</strong> côte du fleuve Uruguay et sur ses <strong>de</strong>ux îles.<br />
Les Tupi-Guaranis s’établirent pour leur part au nord-ouest du fleuve (Arachans).<br />
Avant <strong>la</strong> Conquête, les Guaranis s’étendirent autour du territoire occupé par les Charruas;<br />
le troc <strong>de</strong> marchandises et les communications étaient habituelles entre les <strong>de</strong>ux<br />
groupes. L’influence <strong>de</strong> leur <strong>la</strong>ngue et <strong>de</strong> leur culture pénétra lentement les tribus charruas<br />
établies aux frontières tribales. C’est pour ce<strong>la</strong> que plusieurs noms <strong>de</strong> caciques<br />
charruas compris dans les récits <strong>de</strong>s chroniqueurs et <strong>de</strong>s voyageurs étaient déjà « guarinisés<br />
» avant <strong>la</strong> conquête. Cette situation s’accentua après <strong>la</strong> Découverte et les tribus<br />
furent repoussées vers l’intérieur <strong>de</strong>s territoires, les liens avec les Guaranis et les Tapes<br />
<strong>de</strong>venant plus étroits.
Après <strong>la</strong> Découverte, les Tupi-Guaranis envahirent complètement notre territoire.<br />
Leur influence culturelle, qui dura <strong>de</strong>ux cents ans, entraîna <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
charrua; les missionnaires jésuites, qui employaient <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue guarani pour imposer leur<br />
religion, contribuèrent à consoli<strong>de</strong>r cette prédominance. Les chercheurs sauvèrent <strong>de</strong><br />
l’oubli un peu plus <strong>de</strong> soixante-dix mots <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue charrua.<br />
En 1831, après le piège <strong>de</strong> Salsipue<strong>de</strong>s, les survivants charruas <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves; le<br />
nouveau gouvernement leur interdisait, entre autres, <strong>de</strong> parler leur propre <strong>la</strong>ngue 28 , ce qui<br />
était très loin <strong>de</strong> l’idéologie d’Artigas. Celui-ci avait vécu plusieurs années (dès 1779) parmi les<br />
Charruas, et tout le long <strong>de</strong> son intervention il se battit pour les droits <strong>de</strong>s Indiens et <strong>de</strong>s plus<br />
humbles, obtenant les qualifications <strong>de</strong> « protecteur <strong>de</strong>s peuples libres » et « père <strong>de</strong>s<br />
pauvres » 29 . On relève <strong>de</strong> sa pensée <strong>de</strong> chef <strong>de</strong>s Orientaux (les orientaux sont les habitants <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> République orientale <strong>de</strong> l’Uruguay), exprimée dans plusieurs documents (Règlement <strong>de</strong><br />
terres, Congrès d’avril, Instruction <strong>de</strong> l’an XIII 30 ), les nobles principes <strong>de</strong> solidarité, d’égalité et<br />
<strong>de</strong> liberté, si nécessaires dans les sociétés anciennes autant que dans les sociétés globalisées.<br />
Après l’an 1500, les incursions <strong>de</strong>s Guaranis <strong>de</strong> Misiones pendant plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux siècles <strong>la</strong>issèrent<br />
<strong>de</strong>s traces notoires dans notre culture et nos coutumes; <strong>la</strong> toponymie <strong>de</strong> <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong><br />
nos fleuves, les acci<strong>de</strong>nts géographiques en général, <strong>la</strong> flore et <strong>la</strong> faune en constituent <strong>la</strong><br />
preuve. Il est probable que les Charruas les aient appelés différemment, mais le manque <strong>de</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion fixe, soutien fondamental <strong>de</strong> l’enracinement, entraîna l’oubli <strong>de</strong> ces noms d’origine.<br />
Les incursions <strong>de</strong> Guaranis postérieures à <strong>la</strong> Conquête commencèrent en 1612, pour<br />
fuir les attaques <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>irantes.<br />
Lors <strong>de</strong>s vaquerías, on dirigeait le bétail <strong>de</strong>puis l’Uruguay vers <strong>la</strong> Province argentine <strong>de</strong><br />
Misiones, mais certains Indiens ne continuaient pas leur chemin et préféraient rester sur<br />
notre territoire.<br />
Des milliers d’individus s’installèrent sur nos terres suite aux campagnes militaires<br />
espagnoles qui comptaient <strong>de</strong>s soldats guaranis, à <strong>la</strong> lutte contre les Portugais à Colonia<br />
<strong>de</strong> Sacramento (1680) ou à <strong>la</strong> bataille du Yi plus tard.<br />
L’expulsion <strong>de</strong>s jésuites <strong>de</strong>s missions (1767) provoqua l’émigration <strong>de</strong> 15 000 Guaranis<br />
vers le sud, processus qui se poursuivit dans les années qui suivirent. Les Guaranis<br />
qui avaient fait partie <strong>de</strong> l’armée d’Artigas retournèrent au Paraguay après son échec<br />
militaire; d’autres firent partie <strong>de</strong> l’armée <strong>de</strong> Rivera, et bien d’autres arrivèrent sur le<br />
territoire lorsque Rivera mena <strong>la</strong> reconquête <strong>de</strong>s missions orientales.<br />
Les certificats <strong>de</strong> baptême et <strong>de</strong> décès prouvent <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> 30 000 habitants guaranis<br />
inscrits <strong>de</strong>puis l’époque coloniale jusqu’en 1851. Ce flux humain pose <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société rurale uruguayenne : certains d’entre eux restèrent en marge <strong>de</strong> <strong>la</strong> société hispanique,<br />
menant une vie noma<strong>de</strong> et errante, même si plus tard ils formeraient <strong>de</strong>s peup<strong>la</strong><strong>de</strong>s<br />
sé<strong>de</strong>ntaires. La plupart intégrèrent <strong>la</strong> société <strong>de</strong> l’époque. Ils nous <strong>la</strong>issèrent tous<br />
leur culture, leurs coutumes et leurs traditions, qui influencèrent notablement <strong>la</strong> formation<br />
<strong>de</strong> notre société 31 .<br />
Pratiques curatives générales et <strong>de</strong>rmatologiques<br />
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
■ Pratiques curatives générales et <strong>de</strong>rmatologiques<br />
Nous parlerons maintenant <strong>de</strong>s ressources traditionnelles que les Charruas et les<br />
Guaranis utilisaient pour guérir.<br />
Abel<strong>la</strong> soutint qu’avant l’arrivée <strong>de</strong> Colomb, tous les peuples d’Amérique étaient en<br />
contact entre eux. Il existe <strong>de</strong> nombreuses preuves <strong>de</strong> troc traditionnel entre toutes les<br />
communautés, y compris entre les communautés andines, les Guaranis, les Indiens pampas<br />
et ceux <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ines. Les signaux <strong>de</strong> fumée étaient une façon <strong>de</strong> communiquer 18 . On<br />
constata aussi que les indigènes étaient <strong>de</strong>s canoteurs habiles, et l’hydrographie <strong>américaine</strong><br />
fut propice aux voies <strong>de</strong> communication. Le canoë constituait pour les aborigènes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> zone le moyen <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong> communication habituel et efficace, et <strong>la</strong> flore<br />
405
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
406<br />
indigène fournissait <strong>la</strong> matière première appropriée à sa construction : <strong>de</strong>s arbres tels<br />
le timbó et l’angico pour les canoës et le tacuaruzú (caña tacuara) pour les ra<strong>de</strong>aux 21 .<br />
La similitu<strong>de</strong> entre les ressources thérapeutiques charruas et celles <strong>de</strong>s Guaranis<br />
nous permet d’abor<strong>de</strong>r le sujet dans son ensemble. Un double phénomène caractérisait<br />
les <strong>de</strong>ux groupes : d’un côté le guérisseur, le prêtre et le sorcier étaient liés entre eux;<br />
<strong>de</strong> l’autre, les p<strong>la</strong>ntes curatives étaient connues.<br />
Des peuples très différents <strong>de</strong> par leur niveau social, politique, économique et religieux<br />
coexistèrent en Amérique, mais ils partageaient une tradition magico-religieuse et<br />
possédaient <strong>de</strong>s concepts <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies semb<strong>la</strong>bles, les mêmes bases théoriques et les<br />
mêmes pratiques curatives.<br />
Depuis <strong>de</strong>s temps immémoriaux, l’homme essaya <strong>de</strong> comprendre le mon<strong>de</strong> qui l’entourait,<br />
cherchant l’équilibre entre l’empirisme et <strong>la</strong> magie. Le guérisseur était le maître<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort. De cette façon, <strong>la</strong> cause et l’origine <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies furent considérées<br />
comme <strong>de</strong>s phénomènes magiques régis par les esprits, représentés sur terre par<br />
les chamans, les sorciers ou les guérisseurs, qui agissaient comme interprètes <strong>de</strong> l’occulte<br />
et dominaient par conséquent <strong>la</strong> nature magique du mon<strong>de</strong>.<br />
Plusieurs peuples indigènes américains décrivirent maintes fois <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s pratiques<br />
à contenu chamanique, constituant <strong>la</strong> survie <strong>de</strong> systèmes <strong>de</strong> croyances très anciens,<br />
originaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> région néosibérienne d’Asie, arrivés avec les habitants émigrés<br />
<strong>de</strong> ce continent. Pi Ugarte soutint que malgré <strong>la</strong> durée <strong>de</strong> développement et le vaste espace<br />
<strong>de</strong> dispersion, les croyances présentaient <strong>de</strong>s éléments communs fortement enracinés,<br />
soutenus par <strong>de</strong>s cérémonies <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> similitu<strong>de</strong> 32 .<br />
Abel<strong>la</strong> offrit un récit intéressant à propos d’une expérience confirmant ce que nous<br />
venons <strong>de</strong> dire. On distribua <strong>de</strong>s crayons aux membres <strong>de</strong>s ethnies guaranis pay tavyterá<br />
et aua chiripá en leur <strong>de</strong>mandant <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiner <strong>de</strong>s herbes médicinales <strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt. Derrière<br />
les p<strong>la</strong>ntes ils <strong>de</strong>ssinèrent les esprits protecteurs qui leur correspondaient, sans les<br />
yeux, car ils affirmaient que les esprits prêtaient les yeux à <strong>la</strong> personne qui s’approchait<br />
et lui transmettaient leur énergie. Dans notre pays, <strong>de</strong>s pictogrammes représentant <strong>de</strong>s<br />
formes humaines également sans yeux furent découverts à Durazno.<br />
Les connaissances du chaman sur les spectres <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature et les propriétés curatives<br />
<strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes lui conféraient <strong>de</strong> l’autorité et en même temps l’obligeaient à fournir <strong>de</strong>s réponses.<br />
Les chamans étaient le bras exécutif <strong>de</strong> <strong>la</strong> magie. Tout le mon<strong>de</strong> ne pouvait pas<br />
acquérir <strong>la</strong> condition <strong>de</strong> chaman à volonté; seules les personnes nées avec certains dons<br />
pouvaient y accé<strong>de</strong>r, signe que leurs pouvoirs procédaient et appartenaient au mon<strong>de</strong><br />
surnaturel. Le chaman cherchait plusieurs moyens <strong>de</strong> communication avec les dieux;<br />
dans ce sens, le mon<strong>de</strong> onirique était très important. Des cérémonies <strong>de</strong>stinées à entrer<br />
en contact avec les esprits avaient lieu, conduisant le chaman dans un état <strong>de</strong> transe ou<br />
d’extase qui garantissait l’entrée dans l’autre mon<strong>de</strong> pour guérir le patient ou pour neutraliser<br />
le mal causé par un autre chaman. Le chaman pouvait également générer <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies ou <strong>de</strong>s mauvais esprits 33 .<br />
Les Guaranis appe<strong>la</strong>ient le chaman paje, ñan<strong>de</strong>rú o pai 21 . Le cacique Senaqué, amené<br />
à Paris en 1831, fut l’un <strong>de</strong>s chamans charruas dont on se souvient encore.<br />
En 1753, le père Marimón raconta les pratiques <strong>de</strong>s Guenoas et <strong>de</strong>s Minuans : « Les<br />
sorciers obtiennent leur diplôme sur <strong>la</strong> colline Ybiti María, les Guenoas infidèles s’y rassemblent,<br />
fabriquent leur aljaba, se piquent, percent leur corps et font mille diableries<br />
jusqu’à ce qu’apparaisse le diable sur <strong>la</strong> colline 27 .»<br />
Les aptitu<strong>de</strong>s curatives <strong>de</strong>s chamans étaient <strong>de</strong>stinées à expulser l’entité nocive qui affectait<br />
le patient, tentant <strong>de</strong> <strong>la</strong> neutraliser pour qu’elle ne produise pas davantage <strong>de</strong> mal.<br />
Ceci déterminait <strong>la</strong> réussite ou l’échec du chaman : l’affrontement entre les bons et les<br />
mauvais esprits, les véritables protagonistes <strong>de</strong> l’affrontement santé-ma<strong>la</strong>die, vie-mort.<br />
Quant à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die, les indigènes <strong>la</strong> croyaient liée à trois origines principales: a) causée<br />
par <strong>de</strong>s personnes vivantes méchantes (notamment d’autres chamans); b) procédant
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte interne entre l’« âme animale » (négative) et l’« âme divine » (positive) du<br />
propre individu; c) produite par <strong>de</strong>s « esprits » et <strong>de</strong>s êtres surnaturels <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature.<br />
Toute action pour guérir <strong>la</strong> victime nécessitait <strong>la</strong> thérapie du chaman 33 .<br />
La procédure pour capturer l’âme fuyante du patient et les manipu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> son<br />
corps, telles <strong>la</strong> succion ou l’« aspiration » <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau à <strong>la</strong> hauteur <strong>de</strong> l’estomac pour lui<br />
extraire <strong>de</strong>s substances nocives (projectiles mystiques, pierres, épines, insectes, etc.), faisaient<br />
partie <strong>de</strong>s pratiques habituelles. Le souffle, les frictions, l’échauffement ou <strong>la</strong> brûlure<br />
étaient également caractéristiques <strong>de</strong> plusieurs peuples indigènes américains, y<br />
compris les Guaranis et les Patagons. Les techniques d’extase, <strong>de</strong> jeûne et <strong>de</strong> mortifications<br />
diverses étaient communes à d’autres ethnies, même parmi les indigènes <strong>de</strong>s prairies<br />
<strong>de</strong> l’Amérique du Nord 33 .<br />
Félix <strong>de</strong> Azara (1796) dit à propos <strong>de</strong>s Charruas : « Leurs mé<strong>de</strong>cins appliquent à tout<br />
type <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies le même remè<strong>de</strong>, qui consiste à sucer avec force l’estomac du patient,<br />
le persuadant qu’ils extirpent ainsi les maux pour qu’il soit sou<strong>la</strong>gé. » Il ajoute à propos<br />
<strong>de</strong>s Minuans : « Ils guérissent leurs ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s en leur suçant l’estomac, comme les Charruas<br />
26 . » La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> succion, disait le jésuite autrichien Dobrizhoffer, s’étendait à<br />
« un ulcère ou une blessure saignante, étant très bénéfique… pour les piqûres <strong>de</strong> serpent<br />
» et affirmait qu’il s’agissait d’une métho<strong>de</strong> habituelle dans toute l’Amérique 34 .<br />
En 1812, le colonel Díaz racontait que dans les tribus charruas, il était permis aux<br />
femmes <strong>de</strong> guérir : il y avait « parmi eux <strong>de</strong>s Indiennes qui faisaient office <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins 34 .»<br />
Les frictions consistaient à enduire le patient avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse <strong>de</strong> nandou, d’aguará<br />
tigre, <strong>de</strong> tatou, d’iguane ou <strong>de</strong> poisson, et à frotter ensuite le corps à l’ai<strong>de</strong> d’un morceau<br />
<strong>de</strong> cuir; on utilisait aussi <strong>de</strong>s cendres chau<strong>de</strong>s. Parfois, les cérémonies étaient accompagnées<br />
d’herbes fumantes autour du patient 22 .<br />
Le Dr Schiaffino nous dit que les peuples charruas pratiquaient les saignées et même<br />
en abusaient, non seulement pour apaiser leurs maux mais aussi pour se sou<strong>la</strong>ger, courir<br />
plus vite ou pour leurs fêtes solennelles et funéraires. Les Guaranis saignaient les<br />
veines <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête, du cou<strong>de</strong> ou du mollet, suivant qu’ils vou<strong>la</strong>ient guérir les céphalées, les<br />
fièvres ou d’autres maux.<br />
Les bains figurent parmi les métho<strong>de</strong>s thérapeutiques préférées; les Charruas les<br />
préféraient froids tandis que, pour les Guaranis, ils <strong>de</strong>vaient être chauds. Nos rivières<br />
étaient réputées pour avoir <strong>de</strong>s pouvoirs curatifs. Dans son ouvrage Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Conquista [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête], d’après une source indigène, Lozano attribua à <strong>la</strong><br />
rivière Hum (Río Negro) <strong>de</strong>s pouvoirs curatifs, « car elle traverse <strong>de</strong>puis son origine <strong>de</strong>s<br />
terres où abon<strong>de</strong> <strong>la</strong> salsepareille ».<br />
Schiaffino raconta aussi que pour aligner les fractures et les luxations, on utilisait <strong>de</strong>s<br />
procédures analogues sur tout le continent. Le musée <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> La P<strong>la</strong>ta (Argentine)<br />
expose <strong>de</strong>s os parfaitement consolidés. Selon <strong>la</strong> région géographique, on employait <strong>de</strong>s<br />
p<strong>la</strong>ntes diverses : pour les Guaranis, le caapitá guazú, et dans nos <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>s probablement<br />
le caroubier et le faux poivrier 34 .<br />
La mé<strong>de</strong>cine aborigène ne se limitait pas seulement à <strong>la</strong> magie ou au symbolisme; il<br />
existait parallèlement un certain type <strong>de</strong> recherche méthodique datant <strong>de</strong> plusieurs centaines<br />
d’années, qui permit <strong>de</strong> découvrir les vertus curatives <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes et <strong>de</strong>s fleurs, les<br />
liens entre elles, leurs causes et leurs effets sur l’organisme. Ces connaissances nous parviennent<br />
grâce à <strong>la</strong> tradition orale.<br />
Le père Furlong dit qu’« entre <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>américaine</strong> et européenne, il n’y a pas eu<br />
<strong>de</strong> choc mais plutôt une acco<strong>la</strong><strong>de</strong> ». Plusieurs récits <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conquête comportent <strong>de</strong> nombreuses<br />
notes sur <strong>la</strong> botanique et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigènes — comme ceux <strong>de</strong> Gonzalo<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Oviedo, Alonso <strong>de</strong> Zurita, Cieza <strong>de</strong> León, l’Inca Garci<strong>la</strong>so, entre autres auteurs<br />
35 .<br />
Après qu’il fut guéri par <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins aztèques, Hernán Cortés écrivit à l’empereur en<br />
1522 : « Ne pas <strong>la</strong>isser passer <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins dans <strong>la</strong> Nouvelle Espagne, les natifs suffisant 36 .»<br />
407
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
408<br />
En 1570 Philippe II exprima dans une <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s (tome V titre VI) ses souhaits<br />
d’envoyer en Espagne un ensemble <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong>s indigènes sur les p<strong>la</strong>ntes, les<br />
herbes et les graines médicinales, ainsi que sur <strong>la</strong> façon <strong>de</strong> les préparer, les ingérer, les<br />
appliquer et les cultiver. Il décida avec le Conseil <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s d’envoyer son propre mé<strong>de</strong>cin,<br />
Francisco Hernán<strong>de</strong>z, lors d’une <strong>de</strong>s multiples expéditions, accompagné <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>ssinateurs<br />
mexicains chargés <strong>de</strong> répertorier 3 000 p<strong>la</strong>ntes à travers 2 000 illustrations.<br />
Vers <strong>la</strong> fin du XVIII e<br />
siècle, le 24 avril 1793, le Dr Antonio Lamel<strong>la</strong>, installé à Montevi<strong>de</strong>o,<br />
reçut une pension pour se consacrer aux étu<strong>de</strong>s botaniques, en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong><br />
quantité <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales qui existaient dans <strong>la</strong> région37 .<br />
L’expédition du naturaliste Ma<strong>la</strong>spina (1779) permit <strong>de</strong> découvrir plus <strong>de</strong> 500 p<strong>la</strong>ntes<br />
répertoriées dans le sud-est <strong>de</strong> notre pays, dont 50 étaient inconnues <strong>de</strong>s Européens38 .<br />
Dom Pernetty — connu comme l’« Abbé curieux » — voyagea avec le capitaine Bougainville<br />
(1767) et décrivit minutieusement <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes médicinales cultivées dans un<br />
jardin appartenant à <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce d’un officier espagnol (mío-mio, ronce, herbe<br />
meona, paico carqueja, guaycurú, charrua, higuerita, ca<strong>la</strong>gua<strong>la</strong>). Ses chroniques firent<br />
référence à un traité médical sur <strong>la</strong> flore <strong>américaine</strong> publié par Nicolás Monar<strong>de</strong>s<br />
au XVI e<br />
siècle, dans lequel était exposé « un mé<strong>la</strong>nge pilé <strong>de</strong> carapace <strong>de</strong> tatou cuit en<br />
sève qui guérit les ma<strong>la</strong>dies vénériennes et fait sortir les épines <strong>de</strong> n’importe quel endroit39<br />
.»<br />
La biogéographie est <strong>la</strong> science qui étudie les différentes zones écologiques présentant<br />
<strong>de</strong>s caractéristiques données. Elle permit d’effectuer <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssifications territoriales<br />
mondiales40 . Ces zones, appelées phytogéographies, ne coïnci<strong>de</strong>nt pas avec les frontières<br />
politiques d’Amérique; on les appelle provinces phytogéographiques41 . La province uruguayense<br />
s’étend vers <strong>la</strong> Mésopotamie argentine et vers Rio Gran<strong>de</strong> do Sul; elle ne correspond<br />
pas à <strong>la</strong> zone du Parana. Notre zone est subsidiaire à une zone subtropicale<br />
humi<strong>de</strong>, avec <strong>de</strong>s forêts appauvries si on les compare aux zones situées plus au nord<br />
(province paranaense). Nos p<strong>la</strong>ntes partagent les caractéristiques <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s pays voisins,<br />
dans une même région phytogéographique. Plusieurs zones possè<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes<br />
ayant une gran<strong>de</strong> capacité à s’adapter.<br />
D’après le récit <strong>de</strong> A. Ribeiro, lors <strong>de</strong> son exil au Paraguay, Artigas soignait les ulcères<br />
<strong>de</strong> ses jambes avec du tapacué (Acanthospermum australe), connu chez nous comme<br />
agarrabicho ou yerba <strong>de</strong> <strong>la</strong> oveja (herbe <strong>de</strong> <strong>la</strong> brebis). Le même auteur mentionne <strong>la</strong><br />
connaissance d’Artigas <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ntes médicinales42 . Au cours <strong>de</strong>s batailles pour l’indépendance,<br />
lui et ses Indiens durent sans doute avoir recours plusieurs fois à ces « pharmacies<br />
<strong>de</strong> chemin » citées dans les travaux d’Abel<strong>la</strong>6 .<br />
PHARMACIES DE CHEMIN<br />
La plupart <strong>de</strong>s chroniques s’accor<strong>de</strong>nt à souligner <strong>la</strong> bonne santé <strong>de</strong>s Charruas :<br />
« Une constitution corporelle telle et une santé très soli<strong>de</strong>, que <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Européens<br />
envieraient », affirme Dobrizhoffer 34 . Azara écrit (1786) : « J’ai remarqué qu’ils ne souffrent<br />
pas <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>die particulière ni <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s Gaulois, et je crois qu’ils vivent plus longtemps<br />
que nous 38 .»<br />
Les Charruas vivaient extrêmement vieux, leurs corps se détériorant moins que ceux<br />
<strong>de</strong>s Européens; leurs cheveux ne <strong>de</strong>venaient jamais complètement b<strong>la</strong>ncs. Leur peau<br />
était d’une couleur foncée, brun olive, tel que D’Orbigny le décrivit en 1829. Le Dr Fleurens<br />
mena en 1833 une étu<strong>de</strong> anatomique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong>s Charruas qui avaient été<br />
conduits à Paris, révé<strong>la</strong>nt qu’elle ressemb<strong>la</strong>it à celle <strong>de</strong>s Noirs. Fleurens précise qu’il fait<br />
référence à l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure histologique plutôt qu’à <strong>la</strong> couleur et il ajoute : « Le<br />
bulbe pileux est normal, légèrement plus petit que celui <strong>de</strong>s Européens; il présente dans<br />
sa partie supérieure un gros cumul <strong>de</strong> pigment, <strong>la</strong> partie inférieure étant moins pigmentée…<br />
<strong>la</strong> tige est plus fine que celle <strong>de</strong>s Européens 11, 22 .»
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Ils enduisaient leur corps avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> graisse animale et « ils s’allongeaient ensuite au<br />
soleil pour qu’elle pénètre », raconte le colonel Díaz (1812) dans <strong>la</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong>s Repúblicas<br />
<strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta [<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s Républiques du P<strong>la</strong>ta]. La graisse <strong>de</strong> tigre était employée<br />
pour soigner plusieurs ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. « C’était un médicament infaillible contre les<br />
vers <strong>de</strong> terre » car on présumait qu’ils « abandonnaient les cavités à cause <strong>de</strong> l’o<strong>de</strong>ur<br />
nauséabon<strong>de</strong> dégagée par <strong>la</strong> substance ». Comme ils étaient souvent au contact <strong>de</strong> l’eau<br />
ils utilisaient aussi d’autres graisses, qu’ils mé<strong>la</strong>ngeaient parfois avec <strong>de</strong>s herbes afin <strong>de</strong><br />
repousser les insectes 22, 34 .<br />
Les Charruas s’infligeaient <strong>de</strong> multiples incisions sur <strong>la</strong> peau soit pour <strong>de</strong>s mortifications<br />
funéraires, soit pour indiquer le nombre d’ennemis tués.<br />
Le régime <strong>de</strong>s aborigènes était riche en protéines grâce à <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> cerf,<br />
<strong>de</strong> nandou, <strong>de</strong> tatou, <strong>de</strong> perdrix, <strong>de</strong> din<strong>de</strong> <strong>de</strong>s bois, <strong>de</strong> poisson et <strong>de</strong> mollusques; le régime<br />
se complétait <strong>de</strong> fruits : butiá arazá, mburucuyá, cœur <strong>de</strong> ceibo et du miel <strong>de</strong> lechiguana,<br />
camoatí et camoatá en abondance 43 . Le bois indigène était un<br />
« supermarché » dont ils profitaient doublement : le bois fruitier et à miel, source <strong>de</strong><br />
protéines, fournisseur <strong>de</strong> boisson, et le bois comme pharmacie, avec quarante-huit espèces<br />
<strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales connues 44 .<br />
Les indigènes américains eurent un rapport « religieux » avec les arbres natifs. Dans<br />
notre région les Charruas et les Guaranis vénéraient l’higuerón, l’ombu et l’aruera,<br />
considérant que chaque espèce avait un esprit gardien. Ils respectaient et préservaient<br />
les légen<strong>de</strong>s sur les arbres sacrées, les p<strong>la</strong>ntes magiques ou diaboliques, les herbes médicinales<br />
ou hallucinogènes, les transmettant à leurs <strong>de</strong>scendants.<br />
Gonzalo Abel<strong>la</strong> rapportait les paroles d’un voisin <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Artigas : « Ma grandmère<br />
charrua me racontait <strong>de</strong>s choses et me <strong>de</strong>mandait <strong>de</strong> ne pas oublier… après elle<br />
m’emmenait dans <strong>la</strong> campagne et m’obligeait à saluer certains arbres et je <strong>de</strong>vais me rappeler<br />
qu’ils étaient sacrés 6 . » Des <strong>de</strong>scendants charruas qui habitent actuellement dans <strong>la</strong><br />
province d’Entre Ríos, en Argentine, parlent du caroubier b<strong>la</strong>nc comme d’un « arbre<br />
sacré pour ses dons » 45 .<br />
Plus <strong>de</strong> 170 espèces <strong>de</strong> <strong>la</strong> flore autochtone uruguayenne ont <strong>de</strong>s vertus médicinales,<br />
dont plus <strong>de</strong> 40 pour le traitement <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. La compi<strong>la</strong>tion consultée,<br />
rassemb<strong>la</strong>nt une longue tradition orale, dénote leur application pour <strong>de</strong> multiples lésions<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> peau — blessures, « p<strong>la</strong>ies », ulcères, éruptions, inf<strong>la</strong>mmations <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et<br />
<strong>de</strong>s muqueuses, teigne, gale, furonculose et « boutons », « durillons » et verrues,<br />
« p<strong>la</strong>ies syphilitiques » — comme cicatrisant, astringent, etc.<br />
Parmi ces p<strong>la</strong>ntes, notons quelques-unes <strong>de</strong>s plus importantes : tribule, f<strong>la</strong>mboyant<br />
d’Hyères, agarrabicho, absinthe, ambroise, pied-<strong>de</strong>-mouton, faux poivrier, angico, araza<br />
bardana, mburucuyá, ca<strong>la</strong>gua<strong>la</strong>, centáurea, caraguatá, carqueja, ceibo, barraco, cipo,<br />
cu<strong>la</strong>, curupí, charrúa, épine-vinette, espinillo (Acacia caven), guaycurú, higuerón, huevo<br />
<strong>de</strong> gallo, mauve, mio-mio, ortie, pa<strong>la</strong>n-palán, paja brava, jambe-<strong>de</strong>-vache, saule, sureau<br />
noir, vergerette du Canada, salsepareille 45, 46 .<br />
Les préparations <strong>de</strong>s herbes médicinales suivaient les métho<strong>de</strong>s traditionnelles d’infusion,<br />
<strong>de</strong> cuisson et <strong>de</strong> macération, soit <strong>de</strong> <strong>la</strong> tige, soit <strong>de</strong>s feuilles, soit <strong>de</strong>s fleurs, soit<br />
<strong>de</strong> l’écorce ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> racine, avant application sur <strong>la</strong> zone à traiter.<br />
La mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire développée par les Charruas et les Guaranis <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong><br />
Misiones connut une vaste diffusion et une forte imp<strong>la</strong>ntation en Uruguay. Elle fut pratiquée<br />
si intensément qu’elle fut employée pendant plusieurs années non seulement par<br />
les guérisseurs mais aussi par <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion rurale et dans bien d’autres<br />
secteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Elle fut également assimilée dans <strong>la</strong> communauté afro; <strong>de</strong> ce fait,<br />
le Noir yuyero et <strong>la</strong> guérisseuse noire sont <strong>de</strong>s personnages caractéristiques, représentés<br />
aujourd’hui par les personnages du carnaval, tel le sympathique negro gramillero 16 .<br />
La Mésopotamie argentine hébergea <strong>de</strong>s Charruas; elle abrite actuellement leurs <strong>de</strong>scendants.<br />
Un site Internet édité par l’association Pueblo Jaguar, située à Vil<strong>la</strong>guay<br />
409
ROBERTO RAMPOLDI BESTARD<br />
410<br />
(province d’Entre Ríos, Argentine), publie une liste <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes médicinales et <strong>de</strong> leurs applications<br />
sous le titre « Jardin ethnobotanique du peuple charrua ». Don Santos Mornico<br />
est le yuyero charrua responsable du site : « Dans l’esprit <strong>de</strong> nos yuyeros et<br />
guérisseurs se réfugient nos savoirs et nos pratiques; leur travail persiste autant que le<br />
bois persistera. Les traditions seront vivantes si elles sont transmises aux nouvelles générations,<br />
aujourd’hui et toujours, et leur efficacité incite à conserver, à récupérer et à<br />
protéger une connaissance traditionnelle dans l’intérêt <strong>de</strong> l’humanité 45 .»<br />
Barrán soutient qu’entre <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine académique et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine popu<strong>la</strong>ire il n’y a<br />
pas eu d’abîme mais une continuité, surtout jusqu’en 1875-1880 47 . Les habitants <strong>de</strong>s provinces<br />
<strong>de</strong> notre pays emploient couramment les p<strong>la</strong>ntes médicinales pour beaucoup d’affections,<br />
indépendamment du fait <strong>de</strong> reconnaître et <strong>de</strong> respecter <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
académique.<br />
Les « pharmacies <strong>de</strong> chemin » existent toujours. Au cours <strong>de</strong> l’été 2003, nous participâmes<br />
à une excursion dans <strong>la</strong> sierra <strong>de</strong> Carapé, conduits par un vil<strong>la</strong>geois, Dom<br />
Tomás. Un membre <strong>de</strong> l’expédition infortuné souffrit d’une intense gastro-entérocolite<br />
aiguë; notre gui<strong>de</strong> s’éloigna alors du chemin et offrit à son retour une herbe « Santa<br />
María » pour <strong>la</strong> boire en infusion. Il obtint <strong>de</strong> très bons résultats.<br />
Nous arrivâmes plus tard dans un bois centenaire <strong>de</strong> coronilles que nous cherchions.<br />
C’est là que Dom Tomás nous par<strong>la</strong> <strong>de</strong> maintes p<strong>la</strong>ntes curatives qui existaient dans les<br />
alentours; son grand-père et son oncle lui avaient appris tout ce qui est en rapport avec<br />
les p<strong>la</strong>ntes médicinales et leurs propriétés. Moi, je l’écoutais, étendu par terre, mais il<br />
me conseil<strong>la</strong> <strong>de</strong> ne pas rester là parce que « le printemps me causerait du prurit ».<br />
Le retour à Montevi<strong>de</strong>o fut prurigineux. Le soir je compris pourquoi ces herbes sont<br />
appelées « printemps » : elles sont pleines <strong>de</strong> « poussées ». ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Zorril<strong>la</strong> <strong>de</strong> San Martín J.<br />
Tabaré, leyenda épico-lírica.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Cruz <strong>de</strong>l Sur;<br />
2003.<br />
2. Yapez Castillo A. Historia<br />
Universal. Pob<strong>la</strong>miento<br />
original <strong>de</strong> América. Caracas:<br />
Larousse; 1995.<br />
3. Colón C. Diario. Tercero y<br />
cuarto viajes. Colección<br />
Descubrimiento y Conquista.<br />
Tomo 5. Montevi<strong>de</strong>o: La<br />
República; 1992. p. 442.<br />
4. Galeano E. Las venas abiertas<br />
<strong>de</strong> América Latina.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: América Latina;<br />
1970: 8, 23.<br />
5. Vespucio A. Las navegaciones <strong>de</strong><br />
Américo Vespucio II. Colección<br />
Descubrimiento y Conquista.<br />
Tomo 7. Montevi<strong>de</strong>o: La<br />
República; 1992: 650.<br />
6. Abel<strong>la</strong> G. Nuestra raíz charrúa.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Betun-San;<br />
2003.<br />
7. Mariño R. Crónica <strong>de</strong> los<br />
inmigrantes en Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Polifemo; 1999:<br />
80.<br />
8. Abel<strong>la</strong> G. Mitos, leyendas y<br />
tradiciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental. Montevi<strong>de</strong>o: Betun-<br />
San; 2003: 37,115.<br />
9. La herencia misionera:<br />
ocupación <strong>de</strong> <strong>la</strong> región<br />
misionera. Disponible sur:<br />
http://territoriodigital.com/heren<br />
cia/indice.asp?herencia3/pági<br />
nas/cap04.<br />
Septembre 2005<br />
Hacia <strong>la</strong>s fronteras. Disponible sur:<br />
http://territoriodigital.com/heren<br />
cia/indice.asp?herencia3/pági<br />
nas/cap05.<br />
10. Picerno R. Etnocidio. El<br />
<strong>la</strong>berinto <strong>de</strong> Salsipue<strong>de</strong>s.<br />
Cronología. Disponible sur:<br />
http://www.internet.com.uy/charr<br />
úas/html/etnocidio.html<br />
11. Rivet P. Los últimos charrúas.<br />
Prólogo y traducción <strong>de</strong><br />
Mónica Sans. 2 e éd.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>za. Colección Testimonios;<br />
2002: 13-23, 74-75.<br />
12. Barrios Pintos A. Aborígenes<br />
indígenas <strong>de</strong>l Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Banda Oriental; 1975.<br />
13. Martínez Barboza R. El<br />
último charrúa. De<br />
Salsipue<strong>de</strong>s a <strong>la</strong> actualidad.
Montevi<strong>de</strong>o: Rosebud; 1996.<br />
14. Picerno, R. Orgullo y<br />
vergüenza nacional.<br />
Disponible sur:<br />
http://www.internet.com.uy/<br />
charrúas/htlm/publicaciones.<br />
html.<br />
15. Picerno R. Los últimos<br />
charrúas. Disponible sur:<br />
http://www.internet.com.uy/<br />
charrúas/htlm/publicaciones.<br />
html.<br />
16. Cau<strong>la</strong> N. Artigas Ñemoñaré II.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Rosebud; 2004:<br />
30, 98-117.<br />
17. INDIA, Integración <strong>de</strong><br />
Indígenas Americanos.<br />
Estatutos. Disponible sur:<br />
http://members.tripod.com/<br />
indiauy/estatuto.htm<br />
18. Vidart D. El Uruguay visto por<br />
los viajeros. II. Tierras sin<br />
ningún provecho.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Banda Oriental; 1999: 5, 53.<br />
19. Vespucio A. Las navegaciones<br />
<strong>de</strong> Américo Vespucio I.<br />
Colección Descubrimiento y<br />
Conquista. Tomo 6.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: La República;<br />
1992: 509.<br />
20. Vidart D. El Uruguay visto por<br />
los viajeros. I. Paraná-Guazú,<br />
el río como mar. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental; 1999: 14, 46.<br />
21. González Torres D. Cultura<br />
guaraní. Asunción <strong>de</strong>l<br />
Paraguay; 1997: 14, 168.<br />
22. Sosa M. La nación charrúa.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Letras; 1957:<br />
71-104.<br />
23. Vidart D. El Uruguay indígena.<br />
Colección Descubrimiento y<br />
Conquista. Tomo 28.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: La República;<br />
1991.<br />
24. Vidart D. 10.000 años <strong>de</strong><br />
prehistoria uruguaya.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Hernandarias;<br />
1987: 46-55.<br />
25. Cor<strong>de</strong>ro S. Los charrúas.<br />
Origen racial. C<strong>la</strong>sificación<br />
étnica. Montevi<strong>de</strong>o; 1962:<br />
179.<br />
Les indigènes <strong>de</strong> l’Uruguay et leur rapport à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
26. Azara F. Descripción e historia<br />
<strong>de</strong>l Paraguay y Río <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>ta. Buenos Aires: Bajel;<br />
1943.<br />
27. Barrios Pintos A. Los<br />
aborígenes <strong>de</strong>l Uruguay. Del<br />
hombre primitivo a los<br />
últimos charrúas.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Linardi y Risso<br />
Ed; 1991: 8-13.<br />
28. Semanario INCHALA.<br />
Defen<strong>de</strong>r el patrimonio<br />
intangible <strong>de</strong> los pueblos<br />
indígenas <strong>de</strong>l Uruguay. Feb.<br />
2004. Disponible sur:<br />
http://members.tripod_en<br />
línea/MarIncha<strong>la</strong>/<br />
023_02º4.htm<br />
29. Melogno T. Artigas: <strong>la</strong> causa<br />
<strong>de</strong> los pueblos, Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental. La República; 1996:<br />
96, 119-124.<br />
30. Reyes Abadie W. Historia<br />
uruguaya. Artigas y el<br />
fe<strong>de</strong>ralismo. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental. La República; 1998:<br />
81-88, 143-145.<br />
31. González R., Rodríguez S.<br />
Nuestras raíces. Guaraníes y<br />
paisanos. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Nuestra Tierra. 1990; (3): 21-<br />
37.<br />
32. Pi Ugarte R. Los indígenas <strong>de</strong>l<br />
Uruguay. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Mapfre; 1993: 125-129.<br />
33. Ogdon R. Apuntes sobre <strong>la</strong><br />
magia guaraní en Paraguay.<br />
Disponible sur:<br />
htlm://www.temakel.com/revistak<br />
enosdos.htm<br />
34. Schiaffino R. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Uruguay.<br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong><br />
Montevi<strong>de</strong>o. Tomo I. 1927:<br />
239-292.<br />
35. Molina R. « Primeros médicos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ciudad <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santísima<br />
Trinidad ». Dans: Influencia<br />
<strong>de</strong> América en <strong>la</strong> Medicina<br />
Universal. Buenos Aires:<br />
Lancestremere; 1948.<br />
36. Álvarez R. El tesoro médico<br />
que España <strong>de</strong>jó en América.<br />
Disponible sur:<br />
http://www.diariomedico.com/edi<br />
ción/noticia/0,2458,468830.0<br />
0.html<br />
37. Beltrán JR. Historia <strong>de</strong>l<br />
protomedicato <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires. Buenos Aires: El<br />
Ateneo; 1937: 11-15 y 202.<br />
38. Re<strong>la</strong> W. Viajeros, marinos y<br />
naturalistas en <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental en el siglo XVIII.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
P<strong>la</strong>ta; 1992: 125.<br />
39. Vidart D. El Uruguay visto por<br />
los viajeros. La sociedad<br />
colonial. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Banda<br />
Oriental; 2002: 62-63.<br />
40. Museo y Jardín Botánico.<br />
Inten<strong>de</strong>ncia Municipal <strong>de</strong><br />
Montevi<strong>de</strong>o. Departamento<br />
<strong>de</strong> Cultura. Flora indígena.<br />
Curso <strong>de</strong> conocimiento y<br />
reconocimiento; 2001.<br />
41. Muñoz J., Ross P., Cracco P.<br />
Flora indígena <strong>de</strong>l Uruguay.<br />
Árboles y arbustos<br />
ornamentales. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Hemisferio Sur; 1992: 17-21.<br />
42. Ribeiro A. El caudillo y el<br />
dictador. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
P<strong>la</strong>neta; 2003: 528, 371.<br />
43. Hunter J.A. El po<strong>de</strong>r charrúa.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Tupac-Amaru;<br />
1989: 11-12.<br />
44. Carrere R. Monte indígena.<br />
Mucho más que un conjunto<br />
<strong>de</strong> árboles. Brecha Nordan<br />
Comunidad; 2001: 45-54.<br />
45. Morinico S. Jardín charrúa.<br />
Jardín etnobotánico <strong>de</strong>l<br />
pueblo charrúa. Disponible<br />
sur:<br />
httm://www.prodiversitas.bioetic<br />
a.org/nota71.htm<br />
46. González M., Lombardo A.<br />
P<strong>la</strong>ntas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina vulgar<br />
<strong>de</strong>l Uruguay. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Talleres Gráficos Cerrito;<br />
1936.<br />
47. Barrán J.P. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Uruguay,<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Ediciones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Banda Oriental; 1990: 43.
ólogo<br />
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE<br />
EN URUGUAY<br />
RAÚL VIGNALE<br />
COLLABORATEUR: FRANCISCO AMOR GARCÍA<br />
■ P rologue<br />
Si on <strong>de</strong>mandait aux <strong>de</strong>rmatologues les plus âgés <strong>de</strong> rédiger une <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, ils seraient obligés d’étudier <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> leur pays<br />
pour pouvoir ensuite l’écrire ; ils seraient les seuls à pouvoir accomplir cette tâche car<br />
ils ont vécu suffisamment longtemps pour se souvenir <strong>de</strong>s concepts et <strong>de</strong>s faits transmis<br />
<strong>de</strong> génération en génération. Cette rédaction implique également <strong>de</strong> se référer, <strong>de</strong> manière<br />
anecdotique et biographique, au patrimoine scientifique national riche et extrêmement<br />
<strong>de</strong>nse, face au progrès constant d’une science <strong>de</strong> plus en plus vaste et complexe en<br />
raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> connaissances liées aux nouvelles formes et techniques <strong>de</strong> l’information.<br />
L’activité <strong>de</strong> l’homme contemporain est plongée dans un tel tourbillon que son<br />
échelle <strong>de</strong> valeurs en est altérée. Nous reléguons plusieurs fois, sans le considérer à sa<br />
juste valeur, ce passé si riche en travail, en constance, en persévérace, en talent et à l’originalité<br />
bien réelle, sans nous arrêter sur ce qui est vraiment important et perceptible,<br />
comme par exemple les gran<strong>de</strong>s figures <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine uruguayenne — surtout <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmato-syphiligraphie — aux XVIII e<br />
et XX e<br />
siècles.<br />
C’est pour ce<strong>la</strong> que nous croyons indispensable d’évoquer les racines qui sont à l’origine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée contemporaine. La vaste démarche <strong>de</strong> ce groupe <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins notables et<br />
bril<strong>la</strong>nts se reflète non seulement à travers leur profession médicale publique mais aussi et<br />
fondamentalement à travers les publications scientifiques qu’ils nous léguèrent en témoignages<br />
<strong>de</strong> ce travail constant, et qui sont à <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> conscience médicale <strong>de</strong> notre culture.<br />
Ce travail que nous entreprîmes comme <strong>de</strong>s coordinateurs enthousiastes (mais nous<br />
dûmes également faire face aux difficultés liées au manque <strong>de</strong> sources d’information)<br />
vise à retracer l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphiligraphie en Uruguay, <strong>de</strong> <strong>la</strong> manière<br />
<strong>la</strong> plus complète possible, sur <strong>la</strong> base <strong>de</strong>s documents conservés dans les bibliothèques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine. Les premiers documents et les revues publiés dans le<br />
Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta sont conservés dans son départerment <strong>de</strong>s archives et dans ceux du ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique.<br />
Nous remercions le soutien fondamental du Dr Fernando Mañé Garzón, professeur et<br />
directeur du département d’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, ainsi que<br />
celui <strong>de</strong> ses col<strong>la</strong>borateurs, qui rédigèrent plusieurs articles se rapportant à une longue<br />
pério<strong>de</strong> qui comprend les XVII e<br />
, XVIII e<br />
et XIX e<br />
siècles.<br />
413
Figure 1.<br />
Premier hôpital<br />
<strong>de</strong> Caridad (1788).<br />
Musée <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Maciel<br />
RAÚL VIGNALE<br />
Cette brève publication n’aurait pas vu le jour sans <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration très désintéressée<br />
<strong>de</strong>s auteurs suivants, tous réputés pour leurs vastes connaissances en <strong>de</strong>rmatologie<br />
provenant essentiellement <strong>de</strong> leur long parcours hospitalier : les Prs Drs Juan Francisco<br />
Tost, Eustaquio Montero, Esther Vi<strong>la</strong>boa (née Casel<strong>la</strong>), Ana Cassinelli, Probo Pereira,<br />
Moris Margounato, Néstor Macedo et Griselda <strong>de</strong> Anda, ainsi que les Drs Carmen Riveiro<br />
et Francisco Amor García.<br />
L’Uruguay est un petit pays situé entre l’Argentine et le Brésil; ses côtes bor<strong>de</strong>nt le<br />
Río <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta et l’océan At<strong>la</strong>ntique et sa popu<strong>la</strong>tion est d’environ 3 millions d’habitants.<br />
Le pays possè<strong>de</strong> une seule faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine située dans <strong>la</strong> capitale, Montevi<strong>de</strong>o; tous<br />
les mé<strong>de</strong>cins uruguayens y étudièrent. Elle est installée dans un ancien immeuble où<br />
sont dispensées les matières basiques, tandis que <strong>la</strong> formation pratique est effectuée à<br />
l’hôpital universitaire Manuel Quinte<strong>la</strong>. L’enseignement a également lieu dans les hôpitaux<br />
du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, tels les hôpitaux Maciel, Pereyra Rossell, Pasteur<br />
et l’institut d’hygiène. Étant donné <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> croissance du nombre d’étudiants en mé<strong>de</strong>cine<br />
au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années, certaines matières cliniques sont enseignées dans<br />
les hôpitaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> certains départements du pays.<br />
■ Le Le premier soin hospitalier soin à hospitalier Montevi<strong>de</strong>o à Montevi<strong>de</strong>o<br />
414<br />
Lorsque Bruno Mauricio <strong>de</strong> Zaba<strong>la</strong> fonda en 1726 <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o, il <strong>de</strong>vint nécessaire<br />
<strong>de</strong> soigner les premiers habitants. À ce moment-là, le centre-ville hébergeait<br />
400 habitants tandis que 4 000 personnes résidaient dans les environs.<br />
C’est ainsi que débuta <strong>la</strong> première époque sanitaire. Les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s graves étaient envoyés<br />
à Buenos Aires, une ville avec <strong>la</strong>quelle le contact était quotidien, créant ainsi ce<br />
qu’on appe<strong>la</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta. Les soins étaient pratiqués dans les maisons<br />
particulières; on faisait appel aux<br />
mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> prison pour assister les<br />
prisonniers et les soldats. En 1760 fut<br />
installé à Maldonado un petit foyermaison<br />
appelé hôpital Real, dans le but<br />
d’apporter <strong>de</strong>s services médicaux aux<br />
patients éloignés <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale. Plus<br />
tard, près du port <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o, un<br />
petit local hébergea un hôpital appelé<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Marina. Francisco Maciel et<br />
Mateo Vidal, accompagnés d’un petit<br />
groupe <strong>de</strong> notables appartenant au<br />
conseil municipal, créèrent en 1775 <strong>la</strong><br />
confrérie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Charité <strong>de</strong> San José. La gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s obligea à <strong>la</strong> création<br />
<strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong> Caridad 1-13 (figure 1) entre 1775 et 1789, visant à offrir plus <strong>de</strong> confort et<br />
<strong>de</strong> meilleurs soins aux patients; en 1791, il fut transféré à un autre endroit pour être<br />
agrandi. Finalement, <strong>la</strong> première pierre du nouvel hôpital définitif, appelé Maciel en<br />
l’honneur <strong>de</strong> son premier fondateur, fut posée le 24 avril 1825 9-16 . L’hôpital <strong>de</strong> Caridad<br />
fonctionna entre 1788 et 1825, connaissant <strong>de</strong>s agrandissements successifs.<br />
Les premiers mé<strong>de</strong>cins se formèrent à Buenos Aires, où il existait déjà une faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. Ces premières années furent néfastes pour <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, car les nombreux<br />
blessés <strong>de</strong>s guerres entre les Orientaux, les Espagnols et les Portugais, guerres provoquées<br />
par les invasions continuelles principalement entre 1813 et 1816, venaient s’ajouter<br />
aux ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s locaux. Plus tard, Dámaso Antonio Larrañaga, vicaire <strong>de</strong> l’église Matriz,<br />
et Pintos <strong>de</strong> Araujo Correa agrandirent ces endroits pour un soin hospitalier plus <strong>la</strong>rge
en créant <strong>la</strong> Casa Cuna pour <strong>de</strong>s enfants<br />
abandonnés et ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s.<br />
Entre 1825 et 1881 eut lieu <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>uxième époque, pendant <strong>la</strong>quelle<br />
l’hôpital Maciel fonctionna définitivement<br />
selon les meilleurs paramètres <strong>de</strong><br />
l’époque (figure 2). Le 17 juin 1888 fut<br />
célébré le premier centenaire <strong>de</strong> l’hôpital<br />
<strong>de</strong> Caridad. D’autres hôpitaux furent<br />
fondés pendant ces années, aidant<br />
au soin <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, qui augmentait<br />
vite en raison <strong>de</strong> l’immigration <strong>de</strong><br />
personnes originaires <strong>de</strong> divers pays<br />
européens.<br />
La première faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, fondée en 1875 près <strong>de</strong> l’hôpital Maciel, déménagea<br />
en 1908 à son emp<strong>la</strong>cement définitif avenue Général Flores.<br />
José Brito Foresti quitta <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1890; en 1897 il créa et dirigea à<br />
l’hôpital Maciel <strong>la</strong> première polyclinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis — appelée ensuite<br />
Clínica Dermosifilopática (1908) 12-16 — constituant ainsi un fait historique qui marqua <strong>la</strong><br />
fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie uruguayenne. En 1994, <strong>la</strong> clinique déménagea à l’hôpital<br />
universitaire <strong>de</strong>s cliniques Dr Manuel Quinte<strong>la</strong>, où elle fonctionne actuellement. Pendant<br />
toute cette longue pério<strong>de</strong>, plusieurs générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues se formèrent sous <strong>la</strong><br />
direction <strong>de</strong>s maîtres. C’est ainsi que fut fondée <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong>rmatologique nationale,<br />
dont l’histoire intègre les chapitres suivants.<br />
Portrait <strong>de</strong>s figures les plus importantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay. XIX e et XX e siècles<br />
José Brito Foresti<br />
Raúl A. Vignale, Francisco Amor García<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
■ Portrait <strong>de</strong>s figures les plus importantes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay. XIX e<br />
et X X e<br />
siècles<br />
Né à Montevi<strong>de</strong>o le 24 octobre 1870, il reçut son diplôme à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
en 1890 (figure 3). Sa thèse <strong>de</strong> doctorat (1894) Quelque chose sur <strong>la</strong> désinfection publique<br />
manifesta sa préoccupation pour les problèmes sanitaires et l’influence <strong>de</strong>s<br />
nouveaux concepts <strong>de</strong> Louis Pasteur. Durant <strong>la</strong> même année il s’instal<strong>la</strong> à Paris, travail<strong>la</strong>nt<br />
comme assistant à l’hôpital Saint-Louis pendant trois ans, aux côtés <strong>de</strong>s<br />
grands maîtres tels que Besnier, Fournier, Hallopeau et Gaucher, entre autres ; il retourna<br />
plusieurs fois en Europe. En janvier 1897, il fut désigné par concours chef <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> première Policlínica Dermosifilopática à l’hôpital Maciel ; il y travail<strong>la</strong> pendant plus<br />
<strong>de</strong> quarante ans dans le soin et l’enseignement, complétant ses cours au pavillon Ricord,<br />
où étaient hospitalisés les patients. Le 21 mars 1908, il fut désigné professeur titu<strong>la</strong>ire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmosyphilopathique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, poste qu’il<br />
occupa jusqu’à sa mort survenue en 1939, alors qu’il était âgé <strong>de</strong> 68 ans. Ses mérites<br />
et ses publications sont nombreux. Il fut le premier prési<strong>de</strong>nt et membre honoraire <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Société uruguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fondée en 1918 ; il présida plusieurs congrès,<br />
<strong>de</strong>s réunions scientifiques et une infinité d’activités <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité. Le 30 juillet 1960,<br />
<strong>la</strong> Société Uruguayenne <strong>de</strong> Dermatologie, présidée par le Pr Dr Bartolomé Vignale et<br />
dont le secrétaire était le Dr Carlos María Fosatti, <strong>de</strong>manda à <strong>la</strong> Direction départementale<br />
<strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o <strong>de</strong> baptiser une rue du nom du mé<strong>de</strong>cin, ce qui fut approuvé<br />
en 1969.<br />
415<br />
Figure 2.<br />
Hôpital <strong>de</strong> Caridad<br />
(1857),<br />
actuellement<br />
monument national.<br />
On observe<br />
l’é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong><br />
l’ancienne enceinte,<br />
sur <strong>de</strong>ux étages,<br />
avec <strong>de</strong>s salles pour<br />
les femmes et pour<br />
les hommes. Sur un<br />
angle du bâtiment,<br />
<strong>la</strong> première chapelle<br />
<strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />
Figure 3.<br />
José Brito Foresti,<br />
premier professeur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Clínica<br />
Dermosifilopática<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’hôpital Maciel
Figure 4.<br />
Bartolomé Vignale,<br />
successeur du Pr<br />
José Brito Foresti à<br />
<strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Clínica<br />
Dermosifilopática<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine à<br />
l’hôpital Maciel<br />
RAÚL VIGNALE<br />
416<br />
Ses disciples les plus notables furent Bartolomé Vignale, Aquiles Amoretti, José María<br />
Tiscornia et Héctor Santomé, qui occupèrent plus tard les postes <strong>de</strong> professeurs auxiliaires<br />
et titu<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté.<br />
Pr Dr Bartolomé Vignale<br />
Raúl A. Vignale, Francisco Amor García<br />
Il est né à Montevi<strong>de</strong>o le 3 février 1892 au sein d’une famille d’immigrants génois (figure<br />
4). Il commença ses étu<strong>de</strong>s à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine en 1911 et les termina en 1916.<br />
Des concours publics lui permirent <strong>de</strong> gravir les échelons <strong>de</strong> l’enseignement à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine. Il fut chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> Clínica Dermosifilopática entre 1919 et 1922, professeur auxiliaire<br />
en 1928 et professeur titu<strong>la</strong>ire entre 1947 et 1965, année <strong>de</strong> sa retraite; il fut alors désigné<br />
professeur émérite par le conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté. Il fut essentiellement formé aux côtés du Pr<br />
Dr Brito Foresti. Il voyagea plusieurs fois à Paris pour se spécialiser à l’hôpital Saint-Louis,<br />
et par <strong>la</strong> suite en Italie et en Espagne, avec les principaux maîtres <strong>de</strong>s différents services.<br />
Pendant les premières années, il exerça à l’hôpital Maciel, et il regagna plus tard, en 1954,<br />
l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques. Ses immenses mérites, ses nombreuses publications dans <strong>de</strong>s revues<br />
médicales et sur <strong>la</strong> spécialité font <strong>de</strong> Vignale un <strong>de</strong>s maîtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il présida<br />
plusieurs congrès et <strong>de</strong>s réunions scientifiques. C’était une personne exquise et extraordinaire,<br />
remarquable pour ses excellentes qualités humaines, son respect envers ses pairs et<br />
sa bonne humeur. Il fut coéditeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Revista Uruguaya <strong>de</strong> Dermatología avec le Pr May<br />
et délégué <strong>de</strong>s professeurs au sein du conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté, entre autres mérites. Il eut l’idée<br />
<strong>de</strong> créer avec son professeur <strong>la</strong> section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
médicale <strong>de</strong> l’Uruguay et, en 1956, les fameuses Journées riop<strong>la</strong>tenses <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui<br />
se réalisaient tous les <strong>de</strong>ux ans, en alternance à Montevi<strong>de</strong>o et à Buenos Aires.<br />
Pr Dr Aquiles Amoretti<br />
Il succéda au Pr Bartolomé Vignale à <strong>la</strong> Clínica Dermosifilopática <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
comme professeur titu<strong>la</strong>ire (1959-1969). Son parcours dans l’enseignement se fit par concours<br />
à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine; il occupa les postes <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> clinique, d’assistant et <strong>de</strong> professeur<br />
adjoint. Sa carrière au sein du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique se fit également par concours,<br />
débutant comme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmo-vénéréologue dans les dispensaires antisyphilitiques et <strong>de</strong>s<br />
ma<strong>la</strong>dies vénériennes, appelés plus tard d’hygiène sexuelle, pour accé<strong>de</strong>r ultérieurement au<br />
poste <strong>de</strong> chef du service <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau <strong>de</strong> l’hôpital Pasteur; il occupa ce poste pendant plusieurs<br />
années, ayant succédé au Dr Pedro Raúl Alonso, fondateur du service. Il fut le mé<strong>de</strong>cin généraliste<br />
par excellence, un grand sémiologue, un exemple <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong> l’école française et<br />
<strong>de</strong>s professeurs qui le précédèrent, comme J. May et B. Vignale. Son insistance sur le diagnostic<br />
clinique le mena même à soutenir que l’histopathologie ai<strong>de</strong> au diagnostic, mais qu’à<br />
<strong>la</strong> fin, en cas <strong>de</strong> doute, c’est l’examen clinique qui prévaut. Il poursuivit l’organisation <strong>de</strong>s Journées<br />
riop<strong>la</strong>tenses, il présida <strong>la</strong> Société uruguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie ainsi que <strong>de</strong> nombreux<br />
congrès. Il publia une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> travaux dans les Annales <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
dont plusieurs en col<strong>la</strong>boration avec R. Vignale, tous comportant <strong>de</strong>s cas cliniques inédits qui<br />
méritèrent plusieurs distinctions, notamment en Argentine et au Brésil.<br />
Pr Dr Raúl Vignale<br />
Raúl Vignale, Francisco Amor García<br />
Né le 26 novembre 1924, il était le fils ca<strong>de</strong>t <strong>de</strong> Bartolomé Vignale et <strong>de</strong> Beatriz<br />
Maragliano. Il débuta son parcours dans l’enseignement lorsqu’il était encore étudiant,
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
aidant aux cours du département d’histologie et d’embryologie p<strong>la</strong>cés sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
Washington Buño, et ensuite par concours comme assistant du cours <strong>de</strong> physiopathologie<br />
et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine avec les Prs Drs José P. Migliaro, F. Herrera Ramos et Manlio Ferrari.<br />
Ayant obtenu son diplôme en 1954 avec une thèse <strong>de</strong> doctorat sur <strong>la</strong> Tumeur <strong>de</strong> Malherbe<br />
(mention très bien), il obtint par concours tous les postes à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine avant<br />
d’accé<strong>de</strong>r à celui <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire en 1969. Quelques années plus tard il fut remp<strong>la</strong>cé<br />
par le Pr Dr Probo (1988). Suite à l’obtention du prix Artigas — récompense maximale<br />
qu’un étudiant pouvait recevoir à l’époque —, sa thèse lui permit <strong>de</strong> gagner une<br />
bourse; il sollicita un séjour à New York avec Alfred Hopf, mais <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> son père le<br />
conduisit à choisir une ville plus proche : il s’instal<strong>la</strong> à Buenos Aires pendant cinq ans<br />
(1958-1962) et se spécialisa avec les Prs Luis E. Pierini, David Grinspan, Julio M. Borda,<br />
Jorge Abu<strong>la</strong>fia, R. Mazzini, Pomposiello et Jonquières à l’hôpital Rawson; avec Marcial<br />
Quiroga, M.A. Mazzini et Magnin à l’hôpital Ramos Mejía et avec Dagoberto Pierini à <strong>la</strong><br />
Casa Cuna-hôpital pour enfants Pedro <strong>de</strong> Elizal<strong>de</strong>. Ce fut surtout à l’hôpital Rawson — où<br />
le Dr Jorge Abu<strong>la</strong>fia, véritable maître <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité, travail<strong>la</strong>it comme <strong>de</strong>rmo-pathologiste<br />
— que Raúl Vignale se forma. Le temps passé à ses côtés, <strong>de</strong> 7 heures à 18 heures<br />
tous les jours, lui permit d’approfondir ses connaissances cliniques et anatomo-pathologiques,<br />
en cultivant en même temps <strong>de</strong>s amitiés dont il se souvient encore.<br />
Pendant plusieurs années, il se consacra à cette sous-spécialité en voyageant tous les<br />
mois et en travail<strong>la</strong>nt dans les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie <strong>de</strong>s différents hôpitaux. Il<br />
appliqua aussi l’immunologie à <strong>la</strong> clinique comme élément fondamental pour expliquer<br />
<strong>la</strong> physiopathologie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies. Il travail<strong>la</strong> comme anatomo-pathologiste au sein du<br />
service <strong>de</strong> <strong>la</strong> Clínica Dermosifilopática <strong>de</strong> l’hôpital Maciel, accompagnant le Pr Dr Luis<br />
Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa, tâche qu’il poursuivit à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques Dr Manuel Quinte<strong>la</strong>. Remarquons<br />
que l’anatomie pathologique se pratiqua toujours au sein <strong>de</strong> ce service, <strong>de</strong>puis<br />
les temps lointains <strong>de</strong> l’hôpital Maciel, et ensuite à l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques.<br />
Quant au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, il passa son premier concours en tant que<br />
<strong>de</strong>rmatologue du SAYPA (Service et assistance et préservation antituberculeuse); il y soigna<br />
pendant quatre ans les patients atteints <strong>de</strong> tuberculose présentant <strong>de</strong>s lésions cutanées<br />
et n’étant plus hospitalisés à l’hôpital Saint-Bois. Quelques années plus tard, il dut<br />
passer un nouveau concours pour le poste <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmo-vénéréologue et d’hygiène<br />
sexuelle, charge qu’il exerça dans les dispensaires antisyphilitiques et <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies vénériennes.<br />
Ultérieurement un autre concours lui permit d’obtenir le poste récemment<br />
créé <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin-chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’hôpital Pereyra Rossell; il y<br />
travail<strong>la</strong> jusqu’en 1969, date <strong>de</strong> sa nomination comme professeur titu<strong>la</strong>ire à <strong>la</strong> Clínica<br />
Dermosifilopática <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques. Il travail<strong>la</strong> à <strong>la</strong> polyclinique <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong> l’institut d’oncologie aux côtés du Dr José Espasandin et <strong>de</strong>s nouveaux adjoints <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
clinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté.<br />
En résumé, il fit tout son parcours au ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, où il exerça<br />
même <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> chef, et celle <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire à <strong>la</strong> faculté. Pendant plusieurs<br />
années il fut assistant en anatomie pathologique dudit ministère à <strong>la</strong> Posta Central <strong>de</strong><br />
l’hôpital Pereira Rosell, dirigée par le Pr Matteo. Il reçut <strong>de</strong> nombreux prix, honneurs et<br />
distinctions <strong>de</strong> diverses académies internationales <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, telle <strong>la</strong> distinction<br />
octroyée par <strong>la</strong> commission directive du CILAD à Má<strong>la</strong>ga qui le reconnut comme étant<br />
l’un <strong>de</strong>s principaux <strong>de</strong>rmatologues ibéro-<strong>la</strong>tino-américains; ultérieurement, dans le<br />
grand amphithéâtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, le comité international <strong>de</strong> Ligues <strong>de</strong>s sociétés<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie lui attribua un « certificat d’appréciation » pour ses mérites extraordinaires<br />
dans les domaines <strong>de</strong> l’enseignement, <strong>la</strong> recherche et <strong>la</strong> coopération<br />
internationale en <strong>de</strong>rmatologie. Pour ce <strong>de</strong>rnier événement, le Pr Ana Kaminsky, <strong>de</strong> Buenos<br />
Aires, se dép<strong>la</strong>ça en Uruguay comme délégué du comité international dont le siège<br />
se trouve aux États-Unis. Il fut également fondateur, secrétaire et prési<strong>de</strong>nt d’ULACETS<br />
(Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles) et prési<strong>de</strong>nt<br />
417
RAÚL VIGNALE<br />
418<br />
<strong>de</strong> plusieurs congrès internationaux avec d’autres professionnels notables d’Uruguay et<br />
d’Amérique <strong>la</strong>tine.<br />
Pr Dr Probo Pereira da Silva<br />
Mentionner cet illustre professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique, d’une personnalité<br />
exquise, respectueux <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>voirs et <strong>de</strong> ses obligations, est pour nous un <strong>de</strong>voir<br />
incontournable. La <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay et dans les pays voisins continua <strong>de</strong><br />
grandir grâce à lui. Il créa le département <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique et <strong>la</strong> section <strong>de</strong>rmatite<br />
<strong>de</strong> contact que dirige actuellement le Pr Dr Selva Alé. Il consacra sa vie à l’enseignement,<br />
en créant <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail qui se révèlent être actuellement très<br />
fructueux dans les domaines du soin et <strong>de</strong> l’enseignement. Étant donné son grand intérêt<br />
pour <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, il envoya plusieurs jeunes mé<strong>de</strong>cins à Buenos Aires<br />
et à Córdoba afin qu’ils se spécialisent dans cette branche <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Il pensait<br />
à l’avenir, à ce que <strong>de</strong>vrait être <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les années futures : ces mérites<br />
sont plus que suffisants pour le désigner comme père <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mo<strong>de</strong>rne. Il fut<br />
à plusieurs occasions le dirigeant d’ULACETS, secrétaire et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société uruguayenne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> maints congrès sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Nous ne voulons pas terminer cette brève synthèse sans mentionner plusieurs mé<strong>de</strong>cins<br />
qui consacrèrent leur vie à notre spécialité, en accédant par concours à toutes les<br />
charges au sein du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, y compris<br />
celle <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin-chef. Nous citerons Juan F. Tost, Cándido Prego, Pablo Klestorny,<br />
B<strong>la</strong>nco, Héctor Abreu, José M. Infantozzi, Carmen Riveiro, Esther Vi<strong>la</strong>boa (née Casel<strong>la</strong>),<br />
Eustaquio Montero, Luis Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa, Ana Cassinelli. Bien d’autres se distinguèrent<br />
en enseignant chaque jour minutieusement et méthodiquement <strong>la</strong> sémiologie à l’hôpital;<br />
c’était <strong>de</strong>s gens exquis au quotidien, respectueux <strong>de</strong>s opinions <strong>de</strong> leurs collègues.<br />
Nous éprouvons envers eux une gran<strong>de</strong> affection et un profond respect. Il est impossible<br />
<strong>de</strong> tous les citer mais ils contribuèrent à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong>issèrent <strong>de</strong>s traces profon<strong>de</strong>s<br />
et indélébiles pour que les plus jeunes puissent tirer <strong>de</strong>s leçons <strong>de</strong> leurs enseignements.<br />
Nous retrouvons chez beaucoup <strong>de</strong> nos confrères <strong>la</strong> marque <strong>de</strong> leurs<br />
immenses vertus caractérisées par <strong>la</strong> gran<strong>de</strong>ur et l’altruisme; souvenons-nous d’eux<br />
avant qu’ils ne trépassent.<br />
Nous vivons maintenant à l’ère mo<strong>de</strong>rne, avec les nouvelles générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues,<br />
qui apprirent <strong>de</strong> leurs aînés et qui assument l’obligation d’enseigner et <strong>de</strong> transmettre<br />
les connaissances <strong>de</strong> génération en génération. Il s’agit <strong>de</strong>s adjoints <strong>de</strong> clinique, <strong>de</strong>s<br />
assistants, <strong>de</strong>s professeurs adjoints : les Drs Néstor Macedo, Miguel Martínez et Selva Ale,<br />
ainsi que l’actuelle professeur titu<strong>la</strong>ire Dr Griselda <strong>de</strong> Anda, véritable moteur, travailleuse<br />
géniale et in<strong>la</strong>ssable, qui consacra sa vie à l’enseignement, au soin et à <strong>la</strong> recherche. Professeur<br />
et maître en <strong>de</strong>rmatologie clinique et en <strong>de</strong>rmo-pathologie, elle créa également les<br />
sections spécialisées telles que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique et les ulcères <strong>de</strong>s jambes, <strong>la</strong><br />
chirurgie et les <strong>de</strong>rmatites <strong>de</strong> contact. Elle voyagea continuellement dans le but d’apprendre<br />
toujours, participant notamment aux meetings annuels <strong>de</strong> l’académie <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>s États-Unis. Sa production scientifique, très vaste, comprend d’innombrables<br />
articles publiés dans <strong>de</strong>s revues nationales et étrangères, ainsi que plusieurs participations<br />
à <strong>de</strong>s congrès, <strong>de</strong>s symposiums et <strong>de</strong>s réunions scientifiques en Uruguay, aux États-Unis et<br />
dans d’autres pays <strong>la</strong>tino-américains et européens.<br />
Grâce à son enthousiasme et son dévouement extraordinaires, le Pr <strong>de</strong> Anda fit<br />
en sorte que <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie uruguayenne s’élève au niveau international au cours<br />
<strong>de</strong>s vingt <strong>de</strong>rnières années. Nous pouvons dire <strong>la</strong> même chose <strong>de</strong> ses prodigieux col<strong>la</strong>borateurs<br />
— les Drs Macedo, Alé et Martínez — et d’autres col<strong>la</strong>borateures plus<br />
jeunes, qui présentèrent continuellement <strong>de</strong> nombreux articles et livres, obtenant
plusieurs prix internationaux. On peut affirmer qu’une infinité <strong>de</strong> disciples naquirent<br />
aux côtés du Pr <strong>de</strong> Anda. Il s’agit là <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième étape glorieuse <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en Uruguay.<br />
Hopitaux possédant <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Hôpitaux dépendant du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
■ Hôpitaux possédant <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
HÔPITAL MACIEL<br />
Il représente toute une gloire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine uruguayenne sur plusieurs siècles 1-16 .<br />
Depuis ses origines, il fonctionnait comme hôpital du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique,<br />
mais les activités étaient divisées; y travail<strong>la</strong>ient <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tels José Brito Foresti, Bartolomé Vignale, José María Tiscornia Denis, Héctor Santomé,<br />
Antonio B<strong>la</strong>nco et Juan F. Tost (figures 5 et 6). Distinguons les figures extraordinaires <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique comme José May, Cándido<br />
Prego, Héctor Abreu, Eustaquio Montero, B<strong>la</strong>nco, Esther Vi<strong>la</strong>boa (née Casel<strong>la</strong>) et Ana<br />
Cassinelli. Il faut également citer d’excellents mé<strong>de</strong>cins qui passèrent dans ces services :<br />
Levy, Rampoldi, Dos Santos, Susana Dorce, Diab, Macedo, Bruno, Mocobocki et Conti.<br />
L’hôpital Maciel est, <strong>de</strong>puis peu d’années, l’un <strong>de</strong>s principaux hôpitaux <strong>de</strong> référence<br />
pour tout l’Uruguay. Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong>s Drs Cassinelli et Diab, le<br />
lien avec le service d’hémato-oncologie et <strong>de</strong> greffés <strong>de</strong> <strong>la</strong> moelle osseuse,<br />
le service <strong>de</strong> chirurgie thoracique et spécialement avec le seul<br />
centre <strong>de</strong> thérapie gravitationnelle du pays et celui <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
psychosociale (unique en Santé publique) est très flui<strong>de</strong>. Son<br />
immeuble fut agrandi en 1999 et dispose <strong>de</strong> tous les éléments mo<strong>de</strong>rnes<br />
pour un meilleur soin <strong>de</strong>s patients. L’ultime réussite du Dr<br />
Cassinelli fut l’inclusion dans le va<strong>de</strong>mecum <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s médicaments<br />
spécifiques à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pouvant être prescrits seulement<br />
par les spécialistes, ce qui permit le maintien d’une quantité re<strong>la</strong>tivement<br />
stable <strong>de</strong> médicaments. Nous voulons signaler très spécialement<br />
le travail intense et extraordinaire du Dr Cassinelli, qui fit <strong>de</strong><br />
son service l’un <strong>de</strong>s meilleurs d’Amérique.<br />
HÔPITAL FERMÍN FERREIRA<br />
Il fut créé vers <strong>la</strong> fin du XIX e siècle pour l’hospitalisation et le traitement<br />
<strong>de</strong> patients tuberculeux. Deux pavillons étaient séparés du<br />
noyau principal <strong>de</strong> l’immeuble, <strong>de</strong>stinés à héberger les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s souffrant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre; il s’agissait <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie primitive, dirigée durant<br />
<strong>de</strong> longues années par Ernesto Stirling, un homme qui consacra<br />
toute sa vie au soin <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s avec tendresse, enthousiasme et dévouement.<br />
Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> fermeture <strong>de</strong> cet hôpital, les patients furent soignés<br />
dans l’institut hansénien, un immeuble spécialement conçu<br />
dans les environs <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o. Il disposait <strong>de</strong> quatre salles — <strong>de</strong>ux<br />
pour les femmes et <strong>de</strong>ux pour les hommes —, six maisons indépendantes du noyau central<br />
pour les patients qui vivaient en couple et <strong>de</strong>s bureaux <strong>de</strong>stinés à <strong>la</strong> direction et à<br />
l’administration; cette section était dirigée par le Dr Víctor Rosen, tandis que les Drs<br />
Moris Margounato et Nieves Vare<strong>la</strong> étaient chargés <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s. L’institut possédait tout<br />
le matériel et les médicaments indispensables et comptait également <strong>de</strong>s odontologistes,<br />
<strong>de</strong>s neurologues, <strong>de</strong>s chirurgiens et <strong>de</strong>s physiothérapeutes. La campagne et <strong>la</strong> lutte<br />
contre <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Hansen au niveau national étaient à <strong>la</strong> charge du Dr Vázquez.<br />
419<br />
Figure 5.<br />
Dans <strong>la</strong> cour <strong>de</strong><br />
l’hôpital Maciel (1926).<br />
De gauche à droite :<br />
Demaestri (appariteur),<br />
B. Vignale et Brito<br />
Foresti ; <strong>de</strong>rrière,<br />
Santomé, Klestorny,<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins adjoints<br />
et l’infirmière
Figure 6.<br />
Dans <strong>la</strong> cour <strong>de</strong><br />
l’hôpital Maciel<br />
(1956). De gauche<br />
à droite : (assis)<br />
Badhou, B. Vignale,<br />
<strong>de</strong>s praticiens,<br />
Infantozzi, Abreu,<br />
Santomé et<br />
Tiscornia; (<strong>de</strong>bout)<br />
Ferro (infirmier),<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
adjoints, Amoretti,<br />
<strong>de</strong>s infirmières et<br />
Sanjinés<br />
RAÚL VIGNALE<br />
420<br />
HÔPITAL PEREIRA ROSSELL<br />
Il s’agit d’un immense immeuble divisé en plusieurs<br />
pavillons pour les cliniques gynécologiques et un pavillon<br />
central pour les cliniques pédiatriques. L’un <strong>de</strong>s<br />
services dirigés par le Pr Dr Eucli<strong>de</strong>s Peluffo en 1962<br />
comptait le Dr Raúl Vignale, qui s’y rendait pour examiner<br />
les enfants présentant <strong>de</strong>s lésions cutanées et<br />
pour dispenser l’enseignement. En 1964, le ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique créa <strong>la</strong> polyclinique <strong>de</strong>rmatologique,<br />
et le Dr Vignale occupa le poste <strong>de</strong> chef du service.<br />
Un an plus tard le Dr Walter Tena, qui travail<strong>la</strong>it<br />
comme mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>rmo-vénéréologue au dispensaire<br />
nº 1, obtint le poste d’assistant <strong>de</strong> clinique; le Dr Vignale<br />
avait occupé ce poste et le céda au Dr Tena avant<br />
<strong>de</strong> se présenter au concours pour le poste <strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Clínica Dermosifilopática <strong>de</strong><br />
l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques en 1969, succédant au Pr Dr Aquiles Amoretti.<br />
La polyclinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> l’hôpital Pereira Rossell, dirigée par <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
réputés comme les Drs Pazos, Valls, Viña, Pous et Salmentón, le Dr Tena étant toujours<br />
le chef, fonctionne actuellement toute <strong>la</strong> journée avec <strong>la</strong> même efficacité et le même dévouement<br />
habituel : soin <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s en consultation externe et <strong>de</strong>s patients hospitalisés.<br />
Notons que le Pr Dr Griselda <strong>de</strong> Anda, professeur à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, y participe avec assiduité, ad honorem, pour col<strong>la</strong>borer à ces activités,<br />
faisant preuve d’un travail scientifique efficace. En plus, les trois cliniques pédiatriques<br />
et gynécologiques dispensent comme d’habitu<strong>de</strong> l’enseignement. C’est un centre<br />
<strong>de</strong> référence pour tout le pays.<br />
Cet hôpital abrite un centre spécialisé pour le traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau<br />
(CETEP en espagnol), qui dépend du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique. Son chef est le professeur<br />
auxiliaire Néstor Macedo; il est accompagné <strong>de</strong>s Drs Bessonart, Piñeyro, Tcheckmedyian,<br />
Delucchi, Mén<strong>de</strong>z, Kleist, Moriyama, Labat et Casanova. Ce centre soigne aussi<br />
bien <strong>de</strong>s adultes que <strong>de</strong>s enfants et possè<strong>de</strong> un fichier qui constitue un modèle en Uruguay.<br />
Les différents traitements sont effectués avec <strong>la</strong> plus haute technologie : photo-chimiothérapie,<br />
cryothérapie, échographie, bloc opératoire pour <strong>de</strong>s interventions<br />
mineures. La polyclinique consacrée aux « ulcères <strong>de</strong>s jambes » affiche d’excellents résultats.<br />
Tous les <strong>de</strong>rniers mardis du mois sont organisés <strong>de</strong>s ateliers où sont invités les<br />
collègues <strong>de</strong>s différents hôpitaux et chaque mercredi on discute <strong>de</strong>s cas cliniques. C’est<br />
ainsi qu’un excellent groupe <strong>de</strong> travail s’est formé, dont l’avenir est plus que prometteur.<br />
C’est un autre exemple <strong>de</strong> l’extraordinaire valeur scientifique d’assistance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
uruguayenne avec d’autres services d’hôpitaux divers.<br />
HÔPITAL PASTEUR<br />
Fondé et inauguré vers <strong>la</strong> fin du XVIII e<br />
siècle, il possédait à l’origine une polyclinique<br />
<strong>de</strong>rmatologique; c’est là que le Pr Dr Héctor Raúl Alonso débuta comme chef <strong>de</strong> service,<br />
et il y travail<strong>la</strong> pendant plusieurs années. Lui succédèrent Aquiles Amoretti, Eustaquio<br />
Montero, Moris Margounato, Ana Urruty et Ana Miralles, accompagnés <strong>de</strong> nombreux col<strong>la</strong>borateurs.<br />
Il fonctionne actuellement le matin et l’après-midi. Le dispensaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
peau et d’hygiène sexuelle adjoint à ce service était dirigé il y a quelques années par le<br />
Pr Dr Juan F. Tost; il passa ensuite sous <strong>la</strong> dépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau.<br />
Nous voulons souligner <strong>la</strong> tâche extraordinaire et le travail immense et in<strong>la</strong>ssable <strong>de</strong> tous<br />
ces mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong> leurs col<strong>la</strong>borateurs eu égard à leur hiérarchie scientifique et à leur<br />
travail hospitalier vaste et profitable : ceux-ci examinaient aussi bien les patients en<br />
consultation externe que les patients hospitalisés. Nous voulons également mentionner<br />
les mé<strong>de</strong>cins assistants Munch, Civi<strong>la</strong>, Ponasso et Vareika.
HÔPITAL DES CLINIQUES DR MANUEL QUINTELA<br />
Tel que nous l’avons déjà signalé, c’est là que fonctionne actuellement <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, sous <strong>la</strong> direction du Pr Griselda <strong>de</strong> Anda. Une<br />
photographie prise en 1978 montre le Pr Aquiles Amoretti et ses col<strong>la</strong>borateurs alors que<br />
celui-là exerçait <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> professeur titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique (figure 7). Ce centre est<br />
une référence importante pour tous les <strong>de</strong>rmatologues du pays.<br />
Hôpitaux indépendants du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
HÔPITAL DE POLICE<br />
Il fut fondé en 1980 pour assister le personnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> police et leur familles; le Dr Eustaquio<br />
Montero y débuta en tant que chef <strong>de</strong> service. Fort d’une extraordinaire conception<br />
hospitalière, il possè<strong>de</strong> toutes les ressources indispensables au soin médical.<br />
Montero, qui consacra sa vie à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmo-pathologie, fit ses premières<br />
étu<strong>de</strong>s à Phi<strong>la</strong><strong>de</strong>lphie (USA);<br />
ayant obtenu <strong>la</strong> spécialisation dans<br />
les <strong>de</strong>ux domaines, il atteignit plus<br />
tard le niveau maximal dans <strong>la</strong> recherche<br />
scientifique et dans le soin<br />
grâce à son grand enthousiasme,<br />
son dévouement et son sacrifice. Sa<br />
polyclinique <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau constitue un<br />
exemple à suivre pour les jeunes<br />
<strong>de</strong>rmatologues en ce qui concerne<br />
le soin <strong>de</strong>s patients; il y travaille<br />
aux côtés <strong>de</strong>s Drs Arévalo, Cateura<br />
et Tcheckmedyian, avec une excellente<br />
assistance médicale. On y réalise<br />
tout type <strong>de</strong> procédures<br />
médicales et chirurgicales, ainsi que <strong>de</strong>s examens anatomo-pathologiques interprétés<br />
par le Dr Montero lui-même. C’est un exemple <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mo<strong>de</strong>rne.<br />
HÔPITAL MILITAIRE<br />
Tout comme l’hôpital <strong>de</strong> police, un immeuble énorme, multiple et complexe fut<br />
construit pour les hospitalisations et les polycliniques du personnel militaire. Il s’agissait<br />
à l’origine d’un petit hôpital pour les urgences, mais il <strong>de</strong>vint ensuite l’un <strong>de</strong>s hôpitaux<br />
les plus importants d’Amérique. Son premier chef fut le professeur adjoint Luis Torres<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa; accompagné du Dr Rotkier, ils transformèrent cette polyclinique, dotée d’un<br />
véritable potentiel scientifique, en un hôpital très complet, disposant d’un excellent fichier<br />
<strong>de</strong> photographies et <strong>de</strong> préparations histologiques bien documenté. Actuellement<br />
le service est dirigé par le Dr Del<strong>la</strong> Santa, accompagné <strong>de</strong>s Drs Santurión, Bazzano,<br />
Costa, Iglesias, Lacuesta, Machado, Téllez et Vainsencher.<br />
PEDRO VISCA<br />
Ceci fut un hôpital <strong>de</strong> pédiatrie disposant d’un grand nombre <strong>de</strong> polycliniques, dont<br />
celle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Dès ses débuts et jusqu’à sa fermeture définitive, <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
ce service fut à <strong>la</strong> charge du professeur adjoint José María Tiscornia Denis, enseignant<br />
extraordinaire. Seule cette personne pouvait faire ce travail avec autant d’enthousiasme,<br />
effectuant l’in<strong>la</strong>ssable tâche <strong>de</strong> tous les matins, seul ou accompagné d’un élève en cours<br />
<strong>de</strong> spécialisation. Un fait témoigne <strong>de</strong> sa personnalité exquise : outre les soins dispensés,<br />
il expliquait aux familles <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s <strong>la</strong> façon <strong>de</strong> suivre le traitement correspondant<br />
421<br />
Figure 7.<br />
À l’hôpital <strong>de</strong>s<br />
cliniques, avec tout<br />
le personnel<br />
d’enseignement et<br />
les infirmières<br />
(1957). De gauche<br />
à droite : (assis)<br />
Tost, Prego,<br />
Tiscornia, B.<br />
Vignale, Amoretti,<br />
Sanjinés et Abreu ;<br />
(<strong>de</strong>bout) Ramos<br />
(infirmière),<br />
Aronovich<br />
(responsable <strong>de</strong>s<br />
archives), Klestorny,<br />
Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa,<br />
R. Vignale, B<strong>la</strong>nco<br />
et García<br />
(infirmière)
RAÚL VIGNALE<br />
et, tel un véritable père, il leur donnait continuellement <strong>de</strong>s conseils sur <strong>la</strong> manière<br />
d’éduquer un enfant pour qu’il ait un avenir sûr et prometteur. On ne peut trouver cette<br />
vertu extraordinaire que chez lui.<br />
INSTITUT D’HYGIÈNE<br />
Il abrite <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine et du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique<br />
; il est situé à côté <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques et intègre un complexe <strong>de</strong> bâtiments<br />
disposant <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux entrées indépendantes. Une partie abrite l’institut même, où se<br />
trouvent les sièges <strong>de</strong>s chaires <strong>de</strong> parasitologie, <strong>de</strong> bactériologie, d’immunologie parasitaire<br />
et hygiène, <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine préventive ainsi qu’une partie du <strong>la</strong>boratoire d’immunologie<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> chimie ; l’autre partie abrite l’hôpital d’hygiène, <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies infectieuses et une polyclinique pour les patients externes, tout comme<br />
<strong>de</strong>s salles d’hospitalisation <strong>de</strong>stinés aux patients atteints du sida. Il est d’usage que<br />
ces patients reçoivent le soin <strong>de</strong> plusieurs spécialistes (infectiologues, internistes et<br />
<strong>de</strong>rmatologues). Les médicaments antirétroviraux sont fournis gratuitement par le ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, même si les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ne possè<strong>de</strong>nt pas le carnet <strong>de</strong> soins<br />
délivré par le ministère ; <strong>de</strong> cette façon, tout ma<strong>la</strong><strong>de</strong> est toujours soigné, ce qui est essentiel<br />
à sa guérison.<br />
L’intervention du Dr Liliana Ca<strong>la</strong>ndria, professeur adjoint <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à<br />
l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques et actuellement chef du service pour les patients atteints du sida,<br />
et celle <strong>de</strong>s infectiologues et autres col<strong>la</strong>borateurs sont remarquables. Le rôle du Dr Liliana<br />
Ca<strong>la</strong>ndria est reconnue au niveau national et international. Elle est prési<strong>de</strong>nte<br />
d’URUSIDA (Société uruguayenne <strong>de</strong> sida), secrétaire et prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> nombreux congrès<br />
nationaux et internationaux sur le sida; elle est aussi <strong>la</strong> principale consultante <strong>de</strong>s<br />
centres américains et européens les plus importants dans le diagnostic et le traitement<br />
du virus.<br />
DISPENSAIRE DE PROPHYLAXIE DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES<br />
Il fut fondé pour soutenir les prostitués et les homosexuels et se trouve à côté <strong>de</strong>s annexes<br />
<strong>de</strong> l’hôpital Maciel; le service reçoit le matin les prostituées et l’après-midi les homosexuels.<br />
Le poste <strong>de</strong> chef fut occupé par divers mé<strong>de</strong>cins : Riveiro, Vi<strong>la</strong>boa, Dos Santos,<br />
Boggio, Canetti et Nico<strong>la</strong>. Le dispensaire est en rapport constant avec <strong>la</strong> section assistance<br />
et prophy<strong>la</strong>xies vénériennes du ministère et avec <strong>la</strong> police, qui conserve aussi les archives<br />
<strong>de</strong>s patients, dont un contrôle est actuellement effectué tous les mois.<br />
■ <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>s publications publications <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>rmatologiques<br />
<strong>de</strong>s XIXe et XXe siècles<br />
<strong>de</strong>s XIX e<br />
422<br />
et X X e<br />
siècles<br />
Nous présentons ici un panorama <strong>de</strong>s premières publications du XIX e<br />
siècle et du début<br />
du XX e<br />
siècle, époque du démarrage <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle spécialité en Uruguay, à peine un siècle<br />
après <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> sa capitale, Montevi<strong>de</strong>o (1726). Une sélection étant nécessaire, nous<br />
ne citerons que les publications pionnières <strong>de</strong>s premiers professeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité et,<br />
pour les années postérieures, celles <strong>de</strong>s professeurs chargés <strong>de</strong>s services, pour <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine aussi bien que pour le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique.<br />
Les premiers travaux sur les pathologies <strong>de</strong>rmatologiques chez quelques patients parurent<br />
vers 1850 dans <strong>la</strong> publication La Facultad <strong>de</strong> Medicina (revue bimensuelle); elle<br />
inclut pendant quelques années <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmo-syphilipathique <strong>de</strong> l’hôpital<br />
<strong>de</strong> Caridad présentés par le Pr Dr José Brito Foresti. Les Anales <strong>de</strong> Medicina Montevi<strong>de</strong>ana<br />
(1852-1932) comportent également d’autres articles sur le sujet.<br />
La Revista Médica <strong>de</strong> Uruguay (1898-1932) commença à paraître en 1898; cette<br />
revue à caractère mensuel constitua l’unique publication pendant plusieurs années et
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
jeta les bases <strong>de</strong> celles qui paraîtraient au début du XX e<br />
siècle. Le comité <strong>de</strong> rédaction<br />
était composé par diverses personnalités <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, José Brito Foresti en étant le<br />
secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> rédaction. Entre 1898 et 1926 Brito Foresti et ses collègues publièrent<br />
71 articles au total, dont plusieurs comportant <strong>de</strong>s affections décrites pour <strong>la</strong> première<br />
fois, conjointement avec B. Vignale et ses col<strong>la</strong>borateurs. Bartolomé Vignale présenta<br />
d’autres publications dans cette revue, qui était l’organe officiel <strong>de</strong> l’Organisation médicale<br />
<strong>de</strong> l’Uruguay créée à l’époque : 41 <strong>de</strong> ses articles parurent entre 1919 et 1926. En<br />
1917 furent publiés les premiers articles du Dr José May (<strong>de</strong>s 91 qu’il publia au total).<br />
Nous nous <strong>de</strong>vons <strong>de</strong> mentionner tous les mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues qui col<strong>la</strong>borèrent à<br />
ces publications : Juan A. Rodríguez, J.F. Canessa, Raúl <strong>de</strong>l Campo, J. Canabal, R. Scaltriti,<br />
J. Rosen<strong>de</strong>, J. <strong>de</strong> Salterain, A. Prunell, ainsi que <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins d’autres spécialités,<br />
les maîtres <strong>de</strong> notre mé<strong>de</strong>cine nationale.<br />
Les Anales <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad <strong>de</strong> Medicina, organe officiel <strong>de</strong> cette faculté, parurent en<br />
1916, comportant <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> travaux <strong>de</strong> plusieurs mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté et du ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o et <strong>de</strong>s provinces, toutes spécialités confondues.<br />
Ultérieurement, entre 1955 et 1965, les Anales publièrent <strong>de</strong>s articles <strong>de</strong>s<br />
professeurs et <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins du service <strong>de</strong> l’hôpital <strong>de</strong>s cliniques Dr Manuel Quinte<strong>la</strong> —<br />
inauguré et dont <strong>la</strong> Clínica <strong>de</strong>rmosifilopática fonctionnait déjà — tels que les Prs Drs<br />
Aquiles Amoretti, José María Tiscornia Denis, Héctor Santomé et les Drs Raúl Vignale,<br />
Luis Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa, Antonio B<strong>la</strong>nco, Pablo Klestorny, Cándido Prego, ainsi que<br />
d’autres collègues <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
L’an 1966 marqua <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> première étape <strong>de</strong>s Anales; <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième s’étendit <strong>de</strong><br />
1978 à 1981.<br />
Il faut aussi mentionner les Archivos <strong>de</strong> Medicina, Cirugía y especialida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Uruguay<br />
(1936-1938 et 1940-1953), bien qu’ils aient inclus <strong>de</strong> rares articles sur notre spécialité.<br />
Une autre publication fut créée vers <strong>la</strong> même époque, exclusivement pour notre spécialité<br />
: <strong>la</strong> Revista Uruguaya <strong>de</strong> Dermatología y Sifilografía, débutant par un volume<br />
double (1-2) le 18 mars 1936, fut publiée jusqu’en 1953. Son premier directeur fut le Pr<br />
Dr José May; les rédacteurs adjoints étaient les Drs Gloria May (née Alonso), Roberto Riveiro<br />
Rivera et Carlos Galfetti Urioste. Le Pr Dr José May était mé<strong>de</strong>cin par concours au<br />
ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique et occupait le poste <strong>de</strong> chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et<br />
<strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> l’hôpital Maciel. Il dédia le premier numéro <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication au Dr<br />
José Brito Foresti, dont <strong>la</strong> photographie parut sur <strong>la</strong> première page. Les Drs Radamés<br />
Costa, Julián Rosen<strong>de</strong>, Mario Taglioreti, Nicolás Tiscornia, ainsi que Enrique Apolo, Luis<br />
Gastaldi, Juan Carlos <strong>de</strong>l Campo, Ángel Cuervo, Héctor Ardao, Rafael Turcio, Miguel Rubino,<br />
Héctor Santomé, Carlos Bor<strong>de</strong>s et autres, comptaient parmi ses col<strong>la</strong>borateurs.<br />
Cette publication traita particulièrement le problème <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre; on y trouve le compte<br />
rendu détaillé <strong>de</strong>s séances <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chambre <strong>de</strong>s députés lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> présentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi <strong>de</strong><br />
lutte contre <strong>la</strong> lèpre en Uruguay, approuvée et complétée plus tard par le projet <strong>de</strong> règlement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre et le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> lèpre. Le projet <strong>de</strong> loi avait<br />
été présenté pour <strong>la</strong> première fois au cours du II e<br />
Congrès sud-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> syphiligraphie, à Montevi<strong>de</strong>o en 1921.<br />
Nous signalerons aussi l’article Le traitement <strong>de</strong> <strong>la</strong> fièvre jaune, rédigé en français<br />
puisqu’à l’époque, à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> chaque réunion <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique, on préparait dans cette<br />
<strong>la</strong>ngue un résumé écrit <strong>de</strong>s cas présentés <strong>de</strong>stiné à être publié dans <strong>la</strong> revue. Il convient<br />
également <strong>de</strong> mentionner <strong>la</strong> présence à plusieurs occasions <strong>de</strong> personnalités françaises<br />
notables telles que Gastón Milian, H. Gougerot, R. Burnier et Lucien Périn <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Saint-Louis <strong>de</strong> Paris, gloire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> l’époque. Nous<br />
distinguons également les publications extraordinaires sur <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Nico<strong>la</strong>s et<br />
Favre, reproduites dans plusieurs articles et livres <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue française.<br />
Remarquons aussi que le Pr. Dr José May fut le créateur <strong>de</strong>s mou<strong>la</strong>ges en cire que Von<br />
Rommel, un exilé habitant Montevi<strong>de</strong>o, effectuait avec une rare précision <strong>de</strong>s affections.<br />
423
RAÚL VIGNALE<br />
Ce musée extraordinaire, qui ressemb<strong>la</strong>it à celui <strong>de</strong> l’hôpital Saint-Louis, fut le premier<br />
dans son genre en Amérique Latine.<br />
En avril 1947 parut <strong>la</strong> Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> cátedra <strong>de</strong> <strong>la</strong> Clínica Dermosifilopática <strong>de</strong> <strong>la</strong> Facultad<br />
<strong>de</strong> Medicina-Hôpital Maciel. Son directeur était le Pr Dr Bartolomé Vignale et les<br />
secrétaires <strong>de</strong> rédaction les Drs Carlos María Infantozzi et Pablo Klestorny, chefs <strong>de</strong> clinique.<br />
Klestorny était aussi le photographe <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique, où les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s étaient pris en<br />
photo. La revue publiait les cas cliniques les plus importants du mois, y compris les discussions<br />
suscitées à <strong>la</strong> chaire. Sa parution se termina en octobre 1949 pour <strong>de</strong>s raisons<br />
économiques.<br />
Entre 1989 et 1991 fut publié Dermatología Uruguaya, l’organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
uruguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, sous <strong>la</strong> direction du Pr Dr Probo Pereira.<br />
Un fait inédit et historique mérite d’être mentionné en 1940 : l’amphithéâtre <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine abrita une gran<strong>de</strong> exposition d’environ 500 photographies <strong>de</strong> patients<br />
présentant différentes affections cutanées, qui appartenaient à <strong>la</strong> clinique <strong>de</strong>rmosyphilipathique.<br />
L’exposition put avoir lieu grâce au travail du Pr Vignale et notamment du Dr<br />
Pablo Klestorny — col<strong>la</strong>borateur in<strong>la</strong>ssable, silencieux, très talentueux et d’une gran<strong>de</strong><br />
humanité — ; plusieurs mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s milliers d’étudiants en mé<strong>de</strong>cine lui rendirent<br />
visite tout le long <strong>de</strong>s quatre mois <strong>de</strong> l’exposition.<br />
Ce n’est là qu’une brève synthèse <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s débuts <strong>de</strong> notre spécialité, créée<br />
par nos grands hommes, véritables maîtres, les Prs Drs Brito Foresti, José May et Bartolomé<br />
Vignale. Rappelons qu’ils complétèrent tous leur formation en France principalement;<br />
nous voulons aussi souligner les rapports excellents qu’ils entretenaient avec le<br />
groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues argentins — comme Pedro L. Baliña, Pablo Bosq, Fidanza,<br />
Schujman, J. Fernán<strong>de</strong>z et Carrillo —, avec qui ils échangèrent leurs connaissances à<br />
plusieurs occasions, lorsqu’ils préparaient les réunions <strong>de</strong>s cliniques <strong>de</strong>s sièges respectifs<br />
14-16 .<br />
■ Congrès, symposia symposiums et journées et journées<br />
424<br />
Nous présentons très brièvement une synthèse <strong>de</strong>s principales réunions scientifiques du<br />
XX e<br />
siècle dans notre pays. Les premiers congrès riop<strong>la</strong>tenses eurent lieu à Montevi<strong>de</strong>o en<br />
1918, <strong>la</strong> même année que le II e<br />
Congrès sud-américain (Rio <strong>de</strong> Janeiro).<br />
En 1938, les Ires Journées médicales uruguayennes, section <strong>de</strong>rmatologie et syphiligraphie,<br />
donnèrent à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie uruguayenne un niveau scientifique <strong>de</strong> premier<br />
p<strong>la</strong>n. Les Drs May et Vignale présidèrent l’événement, qui compta <strong>de</strong>s collègues notables<br />
d’Argentine (Fidanza, Contardi et Schujman — Rosario —, Garzón et Moco<strong>la</strong> — Córdoba<br />
—, Puente, Carrillo, Orol Arias, Gómez, Mazzini, Gomis, Picerna, Costané Decoud, Cordivio<strong>la</strong>,<br />
Braseras, Kaminsky, Castex, Borda, Quiroga, Pierini, Abu<strong>la</strong>fia et Sánchez Basso),<br />
du Brésil (Paulo Vieira, <strong>de</strong> Souza Campos, Lin<strong>de</strong>mberg, da Fonseca Bicudo, Póvoa et Berardinelli),<br />
du Paraguay (Boggini et Ugarriza), du Chili (Macchiavello et Coutts) et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
France (Rabut).<br />
Plusieurs réunions et congrès se succédèrent les années suivantes, comptant <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
<strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o et <strong>de</strong>s provinces, ce qui marqua un notable progrès scientifique<br />
à l’époque.<br />
Les Ires Journées riop<strong>la</strong>tenses <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie eurent lieu en décembre 1956, encouragées<br />
par Bartolomé Vignale, qui éprouvait une amitié particulière envers Quiroga,<br />
Garzón, Pierini, Mazzini, Kaminsky, entre autres. Elles connurent un succès extraordinaire,<br />
se répétant par conséquent tous les <strong>de</strong>ux ans alternativement dans les <strong>de</strong>ux pays<br />
du Rio <strong>de</strong> <strong>la</strong> P<strong>la</strong>ta. La dixième réunion eut lieu en 1970 au Balnéaire Solis (station balnéaire)<br />
et fut présidée par le Dr Eustaquio Montero. Ces réunions seront plus tard suspendues<br />
pour donner lieu à <strong>la</strong> RADLA (figure 8).
La RADLA (Réunion annuelle <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains du<br />
cône sud) connut un énorme succès<br />
avec le temps, et atteignit une dimension<br />
internationale. Le siège alterne<br />
entre l’Uruguay, l’Argentine,<br />
le Brésil, le Chili et le Paraguay, <strong>la</strong><br />
Bolivie et le Pérou s’y étant ajoutés<br />
<strong>de</strong>rnièrement. Cette union <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
du cône sud, à qui<br />
s’ajouteront probablement dans<br />
l’avenir les <strong>de</strong>rmatologues d’autres<br />
pays, tels l’Équateur, <strong>la</strong> Colombie et<br />
le Venezue<strong>la</strong>, constitue un événement<br />
très important.<br />
Le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain, <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
région, mondialement reconnue, organise <strong>la</strong> réunion <strong>la</strong> plus importante <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues<br />
espagnols, portugais et <strong>la</strong>tino-américains. Cette rencontre, qui a lieu tous les<br />
quatre ans, est un événement sur le p<strong>la</strong>n scientifique autant que l’occasion <strong>de</strong> célébrer<br />
l’amitié entre l’Europe et l’Amérique.<br />
La Société uruguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, dont le passé historique est plein <strong>de</strong> gloires,<br />
est l’institution essentielle qui réunit tous les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> l’Uruguay. Depuis plusieurs<br />
années elle organise son congrès bisannuel. En octobre 2005 a eu lieu le Xe Congrès uruguayen <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en même temps que <strong>la</strong> X e<br />
Réunion internationale <strong>de</strong><br />
thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique et les VI es<br />
Journées d’actualisation <strong>de</strong> thérapeutique <strong>de</strong>rmatologique<br />
du CETEP. Ces congrès accueilleront les <strong>de</strong>rmatologues du pays afin qu’ils<br />
exposent leurs expériences; <strong>de</strong>s professionnels réputés d’Amérique Latine, d’Europe et<br />
<strong>de</strong>s États-Unis y sont toujours invités.<br />
La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’intérieur, à travers l’activité <strong>de</strong> sa commission directive,<br />
réalise aussi tous les <strong>de</strong>ux ans son congrès dans <strong>la</strong> capitale d’un département.<br />
La Société <strong>de</strong> Dermatologie <strong>de</strong> l’Uruguay<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
■ La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Uruguay<br />
La Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’Uruguay, toujours très étroitement liée à tous les mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong>rmatologues et vénéréologues <strong>de</strong>s hôpitaux Maciel, Pereira Rossell, Pasteur,<br />
Pedro Visca, militaire et <strong>de</strong> police, à l’institut d’hygiène, et aux dispensaires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et d’hygiène sexuelle, fut créée le 15 mai 1918 comme une section <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société médicale <strong>de</strong> l’Uruguay. Il s’agissait là d’un besoin<br />
indispensable pour remp<strong>la</strong>cer les anciens cercles qui fonctionnaient séparément dans<br />
chaque centre hospitalier.<br />
Le 1 er<br />
septembre 1927, le Pr Dr José May proposa <strong>la</strong> création du règlement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société<br />
uruguayenne; une commission composée par les Prs José Brito Foresti, Bartolomé<br />
Vignale et Máximo Halty fut désignée pour le rédiger.<br />
La société fonctionna <strong>de</strong> façon irrégulière à l’hôpital Maciel. Ce ne fut qu’en 1956 que<br />
l’activité fut re<strong>la</strong>ncée à nouveau, stimulée par Bartolomé Vignale, avec <strong>la</strong> participation<br />
<strong>de</strong> prestigieux <strong>de</strong>rmatologues qui représentaient les différents services. Ce fut <strong>la</strong> première<br />
fois que tous les <strong>de</strong>rmatologues étaient réunis, fait significatif dans l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société. Une nouvelle réglementation fut rédigée et <strong>la</strong> commission directive se forma,<br />
dont le mandat avait une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans et les membres étaient renouvelés au moyen<br />
d’élections périodiques. Le jour <strong>de</strong> réunion fut fixé au <strong>de</strong>rnier samedi du mois, date toujours<br />
respectée.<br />
425<br />
Figure 8.<br />
Journée riop<strong>la</strong>tense<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
lors <strong>de</strong> l’hommage<br />
au Dr B. Vignale à<br />
l’occasion <strong>de</strong> son<br />
départ à <strong>la</strong> retraite<br />
comme professeur<br />
<strong>de</strong> clinique. Parmi<br />
les assistants :<br />
Pr. Dr X. Vi<strong>la</strong>noba<br />
(Barcelone),<br />
Kaminsky, Tost,<br />
Fosatti et d’autres<br />
collègues argentins
RAÚL VIGNALE<br />
À l’origine <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, les participants étaient les illustres Drs Rafael Turcio, Cándido<br />
Prego, Ernesto Cacciatore, Luis A. Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa, Héctor Abreu, Arturo Prunell,<br />
Arnaldo Lombardi, Manuel Terán, Radamés Costa, Angel Sanjinés, Juan F. Tost,<br />
Antonio B<strong>la</strong>nco, Leocadio Alvarez. Les cas cliniques <strong>de</strong> chaque service y étaient présentés<br />
et discutés, et très souvent les plus intéressants étaient publiés dans les revues<br />
<strong>de</strong> l’époque.<br />
Pendant douze ans, durant <strong>la</strong> Dictature militaire, toutes les réunions, quelles qu’elles<br />
soient, furent interdites, ce qui entraîna <strong>la</strong> suspension <strong>de</strong>s séances <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. En 1984,<br />
elle reprit ses activités avec un nouvel é<strong>la</strong>n et beaucoup d’enthousiasme, ce qui aida au<br />
développement <strong>de</strong>s réunions mensuelles et à <strong>la</strong> rénovation <strong>de</strong>s commissions directives à<br />
l’occasion <strong>de</strong>s congrès nationaux (bisannuels).<br />
Un autre fait remarquable fut <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’intérieur,<br />
étant donné <strong>la</strong> quantité <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues exerçant leur profession dans les divers départements<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
Depuis six ans, <strong>la</strong> Société uruguayenne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie possè<strong>de</strong> un local propre, un<br />
secrétariat permanent, un fichier où sont conservés les actes <strong>de</strong>puis ses origines, <strong>de</strong>s ordinateurs<br />
pour <strong>la</strong> recherche bibliographique et une bibliothèque comportant les <strong>de</strong>rnières<br />
revues internationales récemment souscrites. Ceci est le résultat d’un travail<br />
ardu, et tenace <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s commissions directives, avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration efficace <strong>de</strong>s<br />
<strong>la</strong>boratoires. Tel que nous l’avons déjà signalé, <strong>la</strong> revue Dermatología Uruguaya, organe<br />
officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société (arrêtée pour <strong>de</strong>s problèmes économiques), fut publiée pendant trois<br />
ans.<br />
Finalement, il faut signaler que les prési<strong>de</strong>nts et les commissions directives successifs<br />
travaillèrent intensément et pendant plusieurs années, faisant preuve d’un intérêt et<br />
d’un dévouement singuliers, réussissant à atteindre une p<strong>la</strong>ce d’honneur internationale.<br />
De nos jours, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues uruguayens publient une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong><br />
travaux scientifiques dans diverses revues étrangères telles que Archivos Argentinos <strong>de</strong><br />
Dermatología, Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación Argentina <strong>de</strong> Dermatología, Revista Chilena <strong>de</strong><br />
Dermatología, Annais Brasileiros <strong>de</strong> Dermatología, Actas Dermosifilográficas (Espagne),<br />
ainsi que dans plusieurs publications <strong>de</strong>s États-Unis. Nos félicitations à eux tous.<br />
Macedo et <strong>de</strong> Anda organisèrent <strong>de</strong>s réunions mensuelles et notamment <strong>de</strong>s cours intensifs<br />
sur divers aspects <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mo<strong>de</strong>rne, comme <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine esthétique,<br />
très profitable aux générations futures.<br />
■ <strong>Histoire</strong> et évolution et évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre <strong>de</strong> les ma<strong>la</strong>dies <strong>la</strong> lutte sexuellement contre transmissibles les ma<strong>la</strong>dies<br />
en Uruguay<br />
s exuellement transmissibles en Uruguay<br />
426<br />
Dans les premiers temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie à Montevi<strong>de</strong>o, le soin était essentiellement basé sur<br />
<strong>la</strong> charité chrétienne. Mais avec le temps, ces idées changèrent; alors on établit l’obligation<br />
<strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> prendre en charge les personnes qui, faute <strong>de</strong> ressources, avaient besoin<br />
d’ai<strong>de</strong> médicale; c’est ainsi que plusieurs centres hospitaliers furent créés. Les<br />
ma<strong>la</strong>dies vénériennes, actuellement appelées ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
(MST), constituaient l’un <strong>de</strong>s problèmes sanitaires les plus importants <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
Le grand nombre <strong>de</strong> patients affectés obligea le gouvernement, à travers les autorités <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Santé publique et par disposition du Conseil national d’hygiène, à fon<strong>de</strong>r le 23 mai<br />
1917 l’institut prophy<strong>la</strong>ctique <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis au nom <strong>de</strong> <strong>la</strong> prophy<strong>la</strong>xie et du traitement <strong>de</strong><br />
ces ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s et pour protéger <strong>la</strong> santé <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Le premier directeur en fut le Dr<br />
Juan A. Rodríguez, à qui succéda le Dr Manuel Terán jusqu’à 1949, date à <strong>la</strong>quelle entra<br />
en fonction le Pr Dr José May. L’institut fut le premier bâtiment en Amérique à se consacrer<br />
exclusivement à cette ma<strong>la</strong>die. Le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé publique, créé en 1933, inclut<br />
l’institut prophy<strong>la</strong>ctique <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis comme section d’assistance et <strong>de</strong> prophy<strong>la</strong>xie
vénérienne. Nous y remarquons le travail immense, dévoué et bénéfique <strong>de</strong>s Drs Mario<br />
Taglioreti, Arnaldo Lombardi, Rubén Cusmanich, Pablo Klestorny, Héctor Abreu et Francisco<br />
Amor García. Le Pr Dr José Brito Foresti et Joaquín Canabal à l’hôpital Maciel furent<br />
les mé<strong>de</strong>cins chargés <strong>de</strong> cette lutte dans les cliniques hospitalières; <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong><br />
l’hôpital national <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis était entre les mains du Dr Germán Segura et <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong> l’hôpital militaire. Selon <strong>la</strong> symptomatologie, les patients étaient traités par plusieurs<br />
spécialistes; ils étaient hospitalisés dans le pavillon Ricord. Jusqu’à 1906, <strong>la</strong><br />
plupart <strong>de</strong>s prostituées syphilitiques inscrites dans les registres policiers étaient hospitalisées<br />
à <strong>la</strong> clinique gynécologique du Pr Dr Enrique Puey, par disposition <strong>de</strong> l’inspection<br />
médicale <strong>de</strong> <strong>la</strong> prostitution qui dépendait du Conseil national d’hygiène, et au<br />
pavillon Dr Germán Segura, où fut établi le service hospitalier <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes,<br />
dirigé par le Dr Juan A. Rodríguez. Les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s appartenant à l’armée et à <strong>la</strong> police<br />
étaient hospitalisés à l’hôpital militaire. L’institut était chargé d’effectuer tout ce qui<br />
concernait les réactions <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire — Wasserman et LCR —, d’é<strong>la</strong>borer les protocoles<br />
pour les différents traitements, <strong>de</strong> superviser <strong>la</strong> prévention et <strong>de</strong> contrôler les dispensaires<br />
antisyphilitiques créés quelques années auparavant et les statistiques correspondant<br />
à chaque département.<br />
Les mé<strong>de</strong>cins étaient sélectionnés par concours; ces professionnels furent appelés à<br />
un moment donné « mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues et d’hygiène sexuelle ». Alberto Scaltriti et<br />
Ángel Canabal travaillèrent à l’institut, avec <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> différents hôpitaux et<br />
dispensaires. Depuis sa fondation en 1917, cet institut fut un exemple et un lieu <strong>de</strong> référence<br />
pour toute l’Amérique <strong>la</strong>tine; ses rapports furent les premiers à être publiés suivant<br />
les normes <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> l’école européenne, notamment <strong>de</strong> l’école française.<br />
Quelques années plus tard, l’institut fut chargé <strong>de</strong> contrôler toutes les ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
et pas seulement <strong>la</strong> syphilis. Cette tâche posa les bases fondamentales pour les<br />
générations suivantes en raison du sérieux habituel du travail, <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong>s examens<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire, <strong>de</strong> l’originalité <strong>de</strong>s recherches et du contrôle <strong>de</strong> tout ce qui avait trait à<br />
ces ma<strong>la</strong>dies 21 .<br />
Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre les ma<strong>la</strong>dies sexuellement<br />
transmissibles (ULACETS)<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Uruguay<br />
La création <strong>de</strong> cette nouvelle entité fut proposée au cours d’un congrès du CILAD, à<br />
l’initiative d’un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues centre-américains. La commission directive et<br />
les règlements prirent forme entre 1974 et 1976. L’importance <strong>de</strong> cette institution, <strong>de</strong> renommée<br />
mondiale, fut reconnue par l’OPS-OMS, et nous fûmes désignés conseillers pour<br />
ces MST.<br />
Plusieurs congrès eurent lieu en Amérique <strong>la</strong>tine, périodiquement et bisannuellement,<br />
dont trois à Montevi<strong>de</strong>o, p<strong>la</strong>cés sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Raúl Vignale, Probo Pereira et<br />
Hilda Abreu. Un bulletin était publié tous les trois mois, en col<strong>la</strong>boration avec le Pr Walter<br />
Belda du Brésil (alma mater <strong>de</strong> l’institution) et <strong>de</strong>s personnalités telles que Woscoff,<br />
Flichman, Vignale et autres collègues <strong>la</strong>tino-américains, qui travaillèrent <strong>de</strong> manière intense<br />
et dévouée pendant plusieurs années. Le bulletin présentait les nouvelles découvertes<br />
scientifico-médicales et apportait <strong>de</strong>s commentaires sur les congrès. C’était <strong>la</strong><br />
première époque glorieuse d’ULACETS.<br />
Il y a quelques années, l’apparition du sida produisit une division : ULACETS d’un côté<br />
et l’Union <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> contre le sida <strong>de</strong> l’autre. Lors du congrès CILAD-2004 à Buenos<br />
Aires, une nouvelle commission directive d’ULACETS fut formée sous <strong>la</strong> direction du<br />
Dr Parizzi et Hilda Abreu; les réunions furent entreprises et on fixa les sièges <strong>de</strong>s prochains<br />
congrès. Ce sera <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième étape glorieuse d’ULACETS-UPICETS. ■<br />
Septembre 2005<br />
427
RAÚL VIGNALE<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. B<strong>la</strong>nco Acevedo P. Historia <strong>de</strong>l<br />
Uruguay [monografía].<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina; 1900.<br />
2. Ponce <strong>de</strong> León L.R. El primitivo<br />
Hospital <strong>de</strong> Caridad<br />
[monografía]. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina; 1907.<br />
3. Acevedo E. editor. Anales<br />
Históricos <strong>de</strong>l Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Barreiro y<br />
Ramos; 1933.<br />
4. Jáuregui M.A. Historia <strong>de</strong>l<br />
Hospital <strong>de</strong> Caridad. La<br />
gran<strong>de</strong>za <strong>de</strong>l pequeño<br />
Hospital. 1788-1825<br />
[monografía nº 2].<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina; 1952.<br />
5. Jáuregui M.A. Historia <strong>de</strong>l<br />
Hospital <strong>de</strong> Caridad <strong>de</strong><br />
Montevi<strong>de</strong>o. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Rogal Imp; 1952.<br />
6. Schiaffino R. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: El Siglo<br />
Ilustrado; 1953.<br />
7. Pérez Fontana V. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Imprenta<br />
Nacional. 1967; I, II, III y IV.<br />
8. Fernán<strong>de</strong>z Saldaña J.M.<br />
Historias <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o<br />
antiguo [monografía].<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina; jun-oct 1967.<br />
9. Reyes Thevenet A. Hospital <strong>de</strong><br />
Caridad 1913 [monografía].<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina; 1968.<br />
10. Castel<strong>la</strong>nos A.R. Montevi<strong>de</strong>o<br />
Siglo XIX [tesis <strong>de</strong><br />
doctorado]. Montevi<strong>de</strong>o:<br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina; 1971.<br />
11. Bacigalupi Gorlero R. El<br />
Hospital <strong>de</strong> Caridad <strong>de</strong><br />
Montevi<strong>de</strong>o. Sus raíces<br />
históricas. I<strong>de</strong>as y proyectos<br />
para su insta<strong>la</strong>ción. La<br />
inauguración. Primera época<br />
<strong>de</strong>l Hospital <strong>de</strong> Caridad<br />
(1788-1925) [monografía].<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina; 1972.<br />
12. Buño W., Bellini-Folchi H.<br />
« La historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina<br />
uruguaya entre 1881-1902 »<br />
[tesis <strong>de</strong> doctorado]. Facultad<br />
<strong>de</strong> Medicina <strong>de</strong> Montevi<strong>de</strong>o.<br />
Revista Histórica <strong>de</strong>l<br />
Uruguay. Montevi<strong>de</strong>o. Tomo<br />
III. Año XXIII. 1980; (15).<br />
13. Lockhart J. editor. La historia<br />
<strong>de</strong>l Hospital Maciel.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: Revista Pu;<br />
1982.<br />
14. Mañé Garzón F., Burgues<br />
Roca S., editores. Historia <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s publicaciones médicas<br />
uruguayas <strong>de</strong> los siglos XVIII y<br />
XIX. Montevi<strong>de</strong>o: Facultad <strong>de</strong><br />
Medicina. Clínica <strong>de</strong>l Libro<br />
AEM; 1996.<br />
15. Schiaffino R. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en el Uruguay.<br />
Montevi<strong>de</strong>o: El Siglo<br />
Ilustrado; 1953.<br />
16. Schiaffino R. « Crónicas <strong>de</strong><br />
tiempos viejos. Siglos XVII,<br />
XVIII ». Dans: Mañé Garzón<br />
F., Burgues Roca S., Gil O.<br />
Sesiones <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sociedad<br />
Uruguaya <strong>de</strong> Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina. Montevi<strong>de</strong>o. 1995;<br />
XVI(16): 1-23.<br />
17. May J., editor. Revista<br />
Uruguaya <strong>de</strong> Dermatología y<br />
Sifilografía. Montevi<strong>de</strong>o.<br />
1938; 1(1-9).<br />
18. May J., editor. Revista<br />
Uruguaya <strong>de</strong> Dermatología y<br />
Sifilografía. Montevi<strong>de</strong>o.<br />
1943; 2.<br />
19. Vignale B., editor. Revista <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Cátedra <strong>de</strong> Clínica<br />
Dermosifilopática.<br />
Montevi<strong>de</strong>o. 1947-1949; 1-3.<br />
20. Trochón I. « La prostitución.<br />
Las políticas públicas.<br />
Debates en el Uruguay en<br />
1895-1932 ». Dans: F. Mañé<br />
Garzón, Burgues Roca S., Gil<br />
J. editores. Sesiones <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Sociedad Uruguaya <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Medicina.<br />
Montevi<strong>de</strong>o, 1992; 18: 12-<br />
45.
HISTOIRE DE LA<br />
DERMATOLOGIE AU<br />
VÉNÉZUELA<br />
CONCEPTION, NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT<br />
« Plus vous saurez regar<strong>de</strong>r loin dans le passé, plus vous<br />
verrez loin dans le futur. » Winston Churchill<br />
Première étape. Depuis l’ époque <strong>de</strong>s indigènes jusqu’à 1904. Conception<br />
Époque indigène<br />
ALFREDO LANDER MARCANO, JAIME PIQUERO-MARTÍN,<br />
ANTONIO RONDÓN LUGO, OSCAR REYES FLORES, BENJAMÍN<br />
TRUJILLO REINA, HERNÁN VARGAS MONTIEL<br />
■ P remière étape. De l’époque <strong>de</strong>s indigènes<br />
jusqu’à 1904. Conception<br />
La connaissance <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées (figure 1) <strong>de</strong>s indigènes du Venezue<strong>la</strong>, avant<br />
l’arrivée <strong>de</strong> Christophe Colomb sur le Nouveau Mon<strong>de</strong> au cours <strong>de</strong> son troisième voyage,<br />
est basée sur <strong>de</strong>s écrits « médicaux » provenant principalement <strong>de</strong>s religieux qui étaient<br />
venus sur le continent avec les découvreurs et les colonisateurs. Ils étaient étrangers à<br />
<strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine, avaient très peu <strong>de</strong><br />
connaissances <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies et, en<br />
général, beaucoup <strong>de</strong> préjugés 1 .<br />
L’expression mé<strong>de</strong>cine précolombienne<br />
est inexacte puisque, quand<br />
Colomb arriva sur le continent américain,<br />
il n’existait pas une seule mé<strong>de</strong>cine<br />
mais autant <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cines<br />
que <strong>de</strong> peuples habitant le territoire<br />
2 . Au Venezue<strong>la</strong>, les Arawakos<br />
et les Karibes se disputaient <strong>la</strong> suprématie<br />
sociale, anthropologique,<br />
médicale et guerrière 3 .<br />
La plupart <strong>de</strong>s Indiens étaient <strong>de</strong>s<br />
429<br />
Figure 1.<br />
Mural Ma Peau. La<br />
peau. Par Gabriel<br />
Bracho (fresquiste<br />
vénézuélien).<br />
Œuvre exposée<br />
à l’auditoire <strong>de</strong><br />
l’institut <strong>de</strong><br />
biomé<strong>de</strong>cine,<br />
à Caracas
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
430<br />
personnes physiquement fortes et saines, avec <strong>de</strong> bonnes <strong>de</strong>nts et une gran<strong>de</strong> résistance<br />
pour les travaux physiques. Les ma<strong>la</strong>dies cutanées étaient rares, peut-être en raison <strong>de</strong>s<br />
bains qu’ils prenaient assidûment et <strong>de</strong> <strong>la</strong> teinture <strong>de</strong> rocou qu’ils appliquaient sur leur<br />
peau, dans un but esthétique et comme signe d’i<strong>de</strong>ntité. Actuellement, on reconnaît à<br />
cette teinture une certaine vertu contre les piqûres d’insectes.<br />
Les aborigènes et les peuples primitifs ne considéraient pas les ma<strong>la</strong>dies comme le produit<br />
<strong>de</strong> l’action d’un agent invisible et intangible; soit elles étaient dues à l’influence exercée<br />
par un ennemi, soit elles constituaient le résultat <strong>de</strong> l’emprise d’un esprit malin ou <strong>de</strong><br />
quelque chose <strong>de</strong> surnaturel lié à <strong>de</strong>s croyances religieuses. Ce<strong>la</strong> justifie l’existence parmi<br />
ces peuples <strong>de</strong> personnages capables <strong>de</strong> les délivrer <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies avec <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s curieuses<br />
et primitives telles que l’exorcisme, les enchantements, les prières, les émanations<br />
<strong>de</strong> fumée, l’ingestion <strong>de</strong> breuvages, les danses, les gestes, <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> mains et <strong>de</strong>s tours<br />
<strong>de</strong> magie; tout ceci visait à invoquer l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s esprits, les effrayer ou réussir à les expulser<br />
du corps du ma<strong>la</strong><strong>de</strong>. Ces métho<strong>de</strong>s étaient appliquées aux ma<strong>la</strong>dies en général, et les<br />
pathologies <strong>de</strong>rmatologiques n’étaient sûrement pas une exception 1 .<br />
Les peuples natifs souffrirent <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cutanées; parmi celles-ci, le carate (carare,<br />
pinta), l’impétigo et d’autres infections telles que <strong>la</strong> tungose (nigua ou pique), <strong>la</strong> pédiculose<br />
(poux), <strong>la</strong> gale (Sarcoptes scabiei), les myiases, <strong>la</strong> leishmaniose (mal <strong>de</strong>s An<strong>de</strong>s ou uta), les intoxications<br />
et piqûres d’insectes et les morsures <strong>de</strong> reptiles étaient les plus courantes. En ce<br />
qui concerne <strong>la</strong> syphilis, certains auteurs affirment que <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die fut importée en Europe<br />
lors du retour <strong>de</strong>s découvreurs et <strong>de</strong>s conquistadors, tandis que d’autres croient le contraire.<br />
Les indigènes utilisaient beaucoup <strong>de</strong> préparations d’origine animale, végétale et minérale<br />
pour traiter les affections cutanées. Ils employaient <strong>de</strong>s racines, <strong>de</strong>s tiges, <strong>de</strong>s<br />
fleurs, <strong>de</strong>s résines, <strong>de</strong>s extraits et <strong>de</strong>s poudres <strong>de</strong> diverses p<strong>la</strong>ntes, y compris l’anaco ou<br />
guayacán, utilisé plus tard comme traitement spécifique <strong>de</strong> <strong>la</strong> syphilis par <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine espagnole<br />
et d’autres pays du mon<strong>de</strong>. Ils employaient aussi différents baumes pour guérir<br />
les blessures, ainsi que plusieurs herbes et p<strong>la</strong>ntes : barro macho, mangle rouge, agave,<br />
anacardier, pois gratté (p<strong>la</strong>nte <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s Caraïbes), salsepareille, vera, entre<br />
autres; le figuier était employé comme kératolytique et <strong>la</strong> canthari<strong>de</strong> comme caustique.<br />
Le rocou, connu sous d’autres noms selon les tribus et les régions (achote, bija ou bijo,<br />
écorce <strong>de</strong> bijo, urucú, roucou, achioti, safran), était fréquemment utilisé pour se protéger<br />
du soleil et <strong>de</strong>s piqûres <strong>de</strong>s insectes. Les tribus <strong>de</strong> l’ouest utilisaient <strong>la</strong> coca (Erythroxylon<br />
coca ou peruvianum), elles en mâchaient les feuilles mé<strong>la</strong>ngées à <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaux.<br />
Elles employaient aussi <strong>de</strong>s extraits <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ntes du genre Datura (so<strong>la</strong>nacées), riches en<br />
alcaloï<strong>de</strong>s, atropine, hyoscyamine et hyocine ou scopo<strong>la</strong>mine, afin <strong>de</strong> se saouler, en les<br />
mé<strong>la</strong>ngeant avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> chicha ou d’autres boissons qui favorisaient leur effet.<br />
La morelle noire ou yocoyoco (So<strong>la</strong>num niarum) était fréquemment utilisée pour guérir<br />
les affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau présentant <strong>de</strong> « petites bombes » (vésicules), les infections<br />
herpétiques, l’impétigo, <strong>la</strong> gale et les ulcères (p<strong>la</strong>ies). Son emploi est toujours en vigueur.<br />
La camomille (Rhus striata, Hippomane mancine<strong>la</strong>) fut aussi employée pour <strong>de</strong>s affections<br />
cutanées semb<strong>la</strong>bles à celles traitées avec <strong>de</strong> <strong>la</strong> morelle noire. On sait actuellement<br />
que les effets bénéfiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux p<strong>la</strong>ntes sont dus à l’aci<strong>de</strong> tannique qu’elles<br />
contiennent et qui leur confère un effet astringent.<br />
La tusil<strong>la</strong> (Dorstenia contrahierba) était employée sur les affections prurigineuses<br />
comme l’urticaire et sur les affections <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone génitale.<br />
Le curare — extrait végétal obtenu <strong>de</strong> différentes espèces du genre Strychnos, qui<br />
pousse en abondance aux bords <strong>de</strong> l’Orénoque — est un puissant paralysant du muscle<br />
strié. Les indigènes l’utilisaient possiblement pour traiter les contractures muscu<strong>la</strong>ires et<br />
le tétanos, bien qu’il fût principalement employé contre les conquistadors : il était appliqué<br />
sur <strong>la</strong> pointe <strong>de</strong>s flèches afin <strong>de</strong> causer <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> l’ennemi par paralysie respiratoire.<br />
Ils connaissaient aussi certaines herbes qui empêchaient l’action du venin lorsque, une fois<br />
pilées, elles étaient appliquées sur les blessures produites par <strong>de</strong>s flèches empoisonnées 1, 3, 4 .
Époque coloniale<br />
L’époque coloniale commença le 19 août 1498 avec <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong> <strong>la</strong> région appelée<br />
ultérieurement Venezue<strong>la</strong>. Lors <strong>de</strong> son troisième voyage, Colomb débarqua sur les<br />
côtes orientales, au sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Paria, dans le port qu’il appe<strong>la</strong> Macuro, actuellement<br />
port Christophe Colomb, dans l’État <strong>de</strong> Sucre.<br />
Cette longue étape s’étendit <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> fin du XV e<br />
siècle jusqu’au 5 juillet 1810, jour <strong>de</strong><br />
l’indépendance du Venezue<strong>la</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
L’arrivée <strong>de</strong>s conquistadors et <strong>de</strong>s colonisateurs européens en Amérique, notamment<br />
les Espagnols, entraîna une situation sociale, environnementale et culturelle difficile et<br />
compliquée. La confrontation <strong>de</strong> ces groupes d’êtres humains ayant <strong>de</strong>s origines, <strong>de</strong>s<br />
coutumes, <strong>de</strong>s <strong>la</strong>ngues, <strong>de</strong>s connaissances et <strong>de</strong>s ressources très différentes, créa un<br />
grand problème ethnologique et <strong>de</strong> transculturation (NDT : <strong>la</strong> transculturation désigne<br />
le processus par lequel une communauté emprunte certains matériaux à <strong>la</strong> culture majoritaire<br />
pour se les approprier et les refaçonner à son propre usage).<br />
Les premiers professionnels <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine arrivèrent avec les conquistadors. Selon <strong>la</strong><br />
réglementation <strong>de</strong>s rois catholiques, les embarcations <strong>de</strong>vaient disposer <strong>de</strong> personnel<br />
consacré aux services sanitaires. C’est ainsi que les mé<strong>de</strong>cins venus d’Espagne et les guérisseurs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région se rencontrèrent, dont plusieurs jouissaient d’une certaine renommée.<br />
Vers 1585, les ma<strong>la</strong>dies les plus fréquentes étaient <strong>la</strong> variole, <strong>la</strong> rougeole, <strong>la</strong> dysenterie,<br />
les « chaleurs », les romadizos (rhinites), le paludisme, les ulcères et <strong>la</strong> bouba apportés<br />
par les Africains, que les indigènes traitaient avec le guayaco. La première<br />
épidémie <strong>de</strong> variole ou cumaragua se produisit en 1580, provenant <strong>de</strong>s esc<strong>la</strong>ves noirs<br />
originaires <strong>de</strong> Guinée.<br />
La culture aborigène se démembrait, mais pas <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène, car étant donné<br />
le manque <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et le retard dans l’art <strong>de</strong> guérir <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule Ibérique, les envahisseurs<br />
étaient obligés <strong>de</strong> se plier aux critères et aux coutumes <strong>de</strong>s natifs et <strong>de</strong> se soumettre<br />
à <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine indigène <strong>de</strong>s guérisseurs et <strong>de</strong>s piaches.<br />
Cette situation est reflétée dans une lettre envoyée par Cortés à Charles Quint dans<br />
<strong>la</strong>quelle il dit « ne pas permettre aux mé<strong>de</strong>cins espagnols <strong>de</strong> passer au Mexique,<br />
l’adresse et les connaissances <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins aztèques les rendant inutiles1-5 .»<br />
Époque républicaine<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
Le Venezue<strong>la</strong> ayant obtenu son indépendance du royaume espagnol en 1810, <strong>la</strong> République<br />
entreprit le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine.<br />
Certains mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’époque commencèrent à s’intéresser aux ma<strong>la</strong>dies cutanées;<br />
nous pouvons citer parmi eux le Dr José María Vargas, qui entama ses cours d’anatomie<br />
en 1826 et effectua les premières observations histologiques au Venezue<strong>la</strong> avec le microscope<br />
qu’il avait apporté d’Europe. Il fut le premier recteur <strong>de</strong> l’université centrale<br />
du Venezue<strong>la</strong> (élu en 1827), dont <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut créée le 23 juin <strong>de</strong> <strong>la</strong> même<br />
année par un décret signé par le libérateur Simón Bolívar. Ultérieurement José María<br />
Vargas fut le premier prési<strong>de</strong>nt civil du Venezue<strong>la</strong>.<br />
Divers travaux liés à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie parurent pendant cette époque, dont nous citerons :<br />
– Affections cutanées <strong>de</strong>s enfants, par José Félix Rivas A<strong>la</strong>s;<br />
– Gangrène, par A. F. Delgado;<br />
– Ma<strong>la</strong>dies vénériennes, par C. Arvelo, M. Porras et M.M. Ponte;<br />
– Teignes, par D. Armas;<br />
– Lèpre, par R. Lares Baralt, L.D. Beauperthuy et A. Dominici.<br />
Le Dr Louis Daniel Beauperthuy exerça <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine pendant <strong>la</strong> décennie 1850 et écrivit<br />
sur <strong>la</strong> lèpre, prouvant ses vastes connaissances sur les ma<strong>la</strong>dies tropicales.<br />
431
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
Il n’existait pas <strong>de</strong> spécialités comme <strong>de</strong> nos jours, mais l’obstétrique, l’ophtalmologie<br />
et <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine légale se profi<strong>la</strong>ient déjà. Pendant toute cette pério<strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
était exercée par diverses personnes aux talents variés : docteurs, diplômés en mé<strong>de</strong>cine,<br />
chirurgiens, algébristes, barbiers chirurgiens, barbiers saigneurs, apothicaires,<br />
guérisseurs, infirmières et sages-femmes. Les honoraires étaient fixés par annuités.<br />
Même si les premiers hôpitaux furent l’hôpital <strong>de</strong> San Pablo (1602) (disparu au<br />
XIXe siècle), l’hôpital Real <strong>de</strong> San Lázaro (institution du XVIIIe siècle) et l’hôpital militaire<br />
<strong>de</strong> Caracas (du XVIII e<br />
siècle), <strong>la</strong> création d’un hôpital <strong>de</strong>stiné à soigner les ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s du pays<br />
eut lieu <strong>de</strong>ux siècles plus tard, grâce au Dr Juan Pablo Rojas Paúl, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
(1888-1890); il fut inauguré le 1er janvier 1891 par le Dr Raimundo Andueza<br />
Pa<strong>la</strong>cios, successeur <strong>de</strong> Rojas Paúl. Il fut appelé hôpital Vargas, constituant le berceau<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong>, qui était déjà une discipline médicale spécialisée.<br />
Le Dr Nicanor Guardia (fils) fut le premier mé<strong>de</strong>cin à exercer <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
(1882), après avoir suivi <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité à Paris1, 4, 5 .<br />
En 1903, le Dr Manuel Pérez Díaz établit le premier service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital<br />
Vargas.<br />
■ Deuxième étape. étape. De 1905 à 1946. De Naissance 1905 à 1946. Naissance<br />
432<br />
Faits historiques<br />
1903. Le Pr Manuel Pérez Díaz, chef du service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> l’hôpital Vargas, obtint<br />
<strong>de</strong>s modèles en cire <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées apportés <strong>de</strong> Paris, organisant ensuite un<br />
musée dans le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
1903. Premier service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital Vargas <strong>de</strong> Caracas.<br />
1906. Inauguration <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco, dans le district fédéral.<br />
1908. Création <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique à <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
Caracas, dont le premier professeur fut le Dr Manuel Pérez Díaz.<br />
1910. La chaire <strong>de</strong>vint obligatoire pour les étudiants <strong>de</strong> <strong>la</strong> sixième année.<br />
1917. Les Drs Juan Iturbe et Eudoro González publièrent le premier cas <strong>de</strong> leishmaniose<br />
cutanée au Venezue<strong>la</strong> dans <strong>la</strong> Gaceta Médica <strong>de</strong> Caracas.<br />
1920. Publication du premier cas <strong>de</strong> b<strong>la</strong>stomycose humaine observé au Venezue<strong>la</strong>.<br />
1921. Le Dr Luis Razetti présenta un projet <strong>de</strong> loi pour <strong>la</strong> défense antivénérienne au<br />
III e Congrès vénézuélien <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine à Valence.<br />
1926. Le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong> l’Assistance sociale créa le premier dispensaire<br />
antivénérien.<br />
1936. Fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> syphiligraphie et <strong>de</strong> léprologie, actuellement<br />
appelée Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
1936. Création du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Mérida, hôpital Los An<strong>de</strong>s.<br />
1936. Parution du livre Dermosifilografía Venezo<strong>la</strong>na [Dermo-syphiligraphie vénézuélienne],<br />
écrit par le Pr Dr Miguel Jiménez Rivero et qui constitua le premier texte <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie publié au Venezue<strong>la</strong>.<br />
1938. Création <strong>de</strong> <strong>la</strong> division <strong>de</strong> vénéréologie.<br />
1938. Le Dr Pablo Guerra effectua pour <strong>la</strong> première fois <strong>de</strong>s tests allergiques et <strong>de</strong>s<br />
patch-tests qu’il créa.<br />
1938. Le Dr Pablo Guerra fut désigné professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire clinique, où il mit en<br />
p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s changements complémentaires radicaux : les diagnostics étaient confirmés par<br />
<strong>de</strong>s examens directs au microscope, <strong>de</strong>s cultures histopathologiques et <strong>de</strong>s tests immunologiques.<br />
1938. Arrivée à Caracas du Pr José Sánchez Covisa, titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> Madrid;
il fut nommé conseiller <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et se distingua pour son<br />
travail dans l’enseignement.<br />
1939. Fondation du dispensaire-école <strong>de</strong> Caracas, qui contribua à former le premier<br />
groupe <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins vénéréologues du pays.<br />
1939. Le Dr Humberto Campins fonda le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Barquisimeto, hôpital<br />
Antonio María Pineda.<br />
1941. Déc<strong>la</strong>ration du caractère obligatoire du traitement <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes.<br />
1941. Les Drs Arminio Martínez Niochett et Adolfo Pons découvrirent et rapportèrent<br />
le premier cas <strong>de</strong> ka<strong>la</strong>-azar au Venezue<strong>la</strong> chez un patient <strong>de</strong> l’État <strong>de</strong> Guarico.<br />
1945. Le Dr Martín Vegas <strong>de</strong>vint chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à l’hôpital Vargas<br />
<strong>de</strong> Caracas.<br />
1945. Fondation <strong>de</strong> l’hôpital militaire et naval Antonio José <strong>de</strong> Sucre, à Caracas.<br />
1945. Le Dr Francisco Scannone fonda le service <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau à l’institut<br />
oncologique Luis Razetti, à Caracas.<br />
1947. Création <strong>de</strong> l’institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine tropicale <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong><br />
l’université centrale du Venezue<strong>la</strong> afin d’étudier les ma<strong>la</strong>dies dominantes du milieu<br />
rural.<br />
1948. Constitution du Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) à La<br />
Havane, Cuba 4, 5 .<br />
Brève biographie <strong>de</strong> nos grands hommes<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
Dr Manuel Pérez Díaz (1872-1931) (figure 2). Né à Caracas le 30 avril 1872, il<br />
obtint son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin en 1895 à l’université centrale du Venezue<strong>la</strong>. Il<br />
reçut <strong>la</strong> même année une bourse pour poursuivre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à<br />
l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> Paris. Il fut membre fondateur <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine en 1904. Dès 1910, il fut chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vargas,<br />
poste qu’il occupa jusqu’à sa mort.<br />
Il exerça également <strong>la</strong> charge d’inspecteur général <strong>de</strong>s léproseries <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
Distinguons parmi ses travaux ceux qui se rapportent à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatite<br />
herpétiforme <strong>de</strong> Duhring, au pemphigus vulgaire et au sarcome cutané.<br />
Il marqua le premier tiers du XX e<br />
siècle par son lea<strong>de</strong>rship dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
vénézuélienne4-8 . Il mourut à Caracas le 17 mars 1931.<br />
Dr Miguel Jiménez Rivero (1822-1938). Successeur du Dr Pérez Díaz, mé<strong>de</strong>cin<br />
auteur <strong>de</strong> plusieurs ouvrages académiques et didactiques, il fit son doctorat à l’université<br />
<strong>de</strong> Caracas et à Rome. Il fut désigné professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1929. Il<br />
publia le premier livre sur <strong>la</strong> spécialité sous le nom <strong>de</strong> Dermosifilografía Venezo<strong>la</strong>na<br />
[Dermo-syphiligraphie vénézuélienne]. Il mourut à Caracas le 7 décembre 19384, 5, 7, 8 .<br />
Dr Pablo Guerra (1903-1944). Il naquit à Caracas le 3 mai 1903 et poursuivit ses<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie à Paris, où il présenta une excellente thèse intitulée Rôle <strong>de</strong>s levures<br />
dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui obtint un prix. Il retourna au Venezue<strong>la</strong> en 1937 et<br />
confirma son titre <strong>de</strong> docteur à l’université centrale du Venezue<strong>la</strong>. Il publia beaucoup <strong>de</strong><br />
travaux liés à <strong>la</strong> spécialité, seul ou avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’autres mé<strong>de</strong>cins parmi lesquels<br />
se distinguent : Martín Vegas, J.A. O’ Daly, Gil Yépez et José Sánchez Covisa. Il travail<strong>la</strong><br />
dans les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et d’anatomie pathologique <strong>de</strong> l’hôpital Vargas,<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital pour enfants <strong>de</strong> Caracas. Il fonda le service d’allergologie<br />
et, accompagné du Dr Carlos J. A<strong>la</strong>rcón, il ouvrit un service pour le traitement <strong>de</strong>s ulcères<br />
<strong>de</strong>s jambes; il fonda également le <strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie. En 1939, il fut nommé<br />
professeur <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> l’université centrale du<br />
Venezue<strong>la</strong> suite à <strong>la</strong> mort du Pr Jiménez Rivero.<br />
En 1943, il fut l’un <strong>de</strong>s organisateurs <strong>de</strong>s Ires Journées vénézuéliennes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et vénéréologie, avec d’autres mé<strong>de</strong>cins remarquables comme Juan Iturbe, Martín<br />
433<br />
Figure 2.<br />
Dr Manuel Pérez Díaz
Figure 3.<br />
Dr Martín Vegas<br />
Figure 4.<br />
Dr Jacinto Convit<br />
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
434<br />
Vegas, Félix Lairet, Armando Castillo P<strong>la</strong>za, Abel Mejías, José Sánchez Covisa et Il<strong>de</strong>maro<br />
Lovera4, 5, 8 .<br />
Il mourut soudainement, en pleine production scientifique, à Caracas le 6 février<br />
1944.<br />
Pr Dr José Sánchez Covisa (1881-1944). Il naquit à Hueste (Espagne) en 1881.<br />
Nommé docteur ès sciences médicales <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Madrid en 1903, il fut professeur<br />
titu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Madrid,<br />
doyen <strong>de</strong> <strong>la</strong> faculté <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, membre <strong>de</strong> l’Académie nationale, prési<strong>de</strong>nt du<br />
collège <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins et prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Académie espagnole <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. En 1938, il<br />
arriva au Venezue<strong>la</strong>, qu’il choisit comme patrie d’adoption pour <strong>de</strong>s raisons politiques.<br />
Il occupa le poste <strong>de</strong> conseiller technique <strong>de</strong> <strong>la</strong> division <strong>de</strong> vénéréologie du ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé et <strong>de</strong> l’Assistance sociale ; il fut vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Ires Journées <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
titu<strong>la</strong>ire ad honorem <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> clinique <strong>de</strong>rmatologique et syphiligraphique<br />
<strong>de</strong> l’université centrale du Venezue<strong>la</strong>. Il publia en Espagne plusieurs textes <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong>s articles sur <strong>la</strong> spécialité, qui connurent une <strong>la</strong>rge diffusion au Venezue<strong>la</strong>4,<br />
5, 8 .<br />
Dr Martín Vegas (1897-1991) (figure 3). Né à Caracas le 23 mars 1897, il obtint<br />
son diplôme <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cin chirurgien à l’université centrale du Venezue<strong>la</strong> le 20 juin<br />
1920. Cinq ans plus tard il obtint le titre <strong>de</strong> docteur ès sciences médicales. Il se rendit<br />
en France en 1922 pour étudier <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>la</strong> syphiligraphie à l’hôpital<br />
Saint-Louis <strong>de</strong> Paris, ainsi que <strong>la</strong> microbiologie à l’institut Pasteur. Il créa le premier<br />
cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Croix-Rouge vénézuélienne, dirigé ensuite par le Dr Il<strong>de</strong>maro<br />
Lovera. Il fut chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong><br />
Cabo B<strong>la</strong>nco. Admis à l’Académie nationale <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, il succéda en 1944 au Dr Pablo<br />
Guerra à <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’université<br />
centrale du Venezue<strong>la</strong> et au service<br />
correspondant <strong>de</strong> l’hôpital Vargas.<br />
Il publia plusieurs travaux sur <strong>la</strong> spécialité et<br />
assista à maints réunions et congrès scientifiques.<br />
Au cours du <strong>de</strong>uxième tiers du XX e<br />
siècle,<br />
le Dr Martín Vegas prit le lea<strong>de</strong>rship que détenait<br />
le Dr Pérez Díaz4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 . Il mourut à Caracas<br />
en 1991.<br />
Sa mémoire reste vivante avec <strong>la</strong> création du<br />
prix et <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence Dr Martín Vegas, initiative du Dr Francisco Ker<strong>de</strong>l Vegas lorsqu’il<br />
était prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie en 1964.<br />
Dr Jacinto Convit (figure 4). Il naquit le 11 septembre 1913. En 1937, lorsqu’il était<br />
étudiant en mé<strong>de</strong>cine, il commença à travailler à <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco et y fut<br />
mé<strong>de</strong>cin rési<strong>de</strong>nt. Son aposto<strong>la</strong>t envers les plus démunis commença là.<br />
Il fit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> Skin and Cancer Unit<br />
<strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Columbia (New York, USA) et plus tard en épidémiologie à <strong>la</strong> Western<br />
Reserve University (Cleve<strong>la</strong>nd, Ohio, USA).<br />
En 1948, il fonda le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD) avec <strong>de</strong>s<br />
collègues d’Espagne et d’Amérique <strong>la</strong>tine.<br />
Il fut <strong>de</strong>rmatologue à l’hôpital Vargas dès 1948, ensuite chef du service et <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, fondateur <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (appelé plus tard Institut<br />
<strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine), créateur <strong>de</strong> l’Association pour <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>rmatologique et <strong>de</strong><br />
l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine en tant que centre <strong>de</strong> recherche biomédicale et au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s affections<br />
<strong>de</strong>rmatologiques. Il fut le promoteur du spectre clinico-histopathologique et immunologique<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmatologiques, notamment <strong>la</strong> lèpre et <strong>la</strong> leishmaniose,<br />
ainsi que <strong>de</strong> leur traitement et leur prévention au moyen <strong>de</strong> l’immunoprophy<strong>la</strong>xie et
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
l’immunothérapie. Plus <strong>de</strong> 300 publications dans <strong>de</strong>s revues internationales parlent du<br />
dévouement du Dr Jacinto Convit pour <strong>la</strong> recherche et <strong>la</strong> solution <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> santé<br />
du Venezue<strong>la</strong>.<br />
Le Dr Jacinto Convit est une figure éminente au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie vénézuélienne<br />
actuelle 4, 5,7,8, 12 .<br />
■ T roisième Troisième étape. étape. Depuis 1946 De jusqu’à 1946 nos jours. jusqu’à Développement nos jours. Développement<br />
En 1955, le Dr Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón fut nommé professeur titu<strong>la</strong>ire et chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> chaire<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> syphiligraphie <strong>de</strong> l’hôpital Vargas, accompagné <strong>de</strong>s Drs Jacinto<br />
Convit, Juan Di Prisco, Luis A. Velutini, Rafael Medina, Imelda Aasen Campos, Dante Borelli,<br />
César Lizardo, Armando Sa<strong>la</strong>s, Jacobo Obadía Serfaty et Oscar Reyes Flores, qui y<br />
assistait en tant qu’instructeur ad honorem.<br />
Le service et <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Caracas<br />
furent créés en 1958; l’hôpital avait été inauguré en 1956 dans <strong>la</strong><br />
cité universitaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville (figure 5).<br />
Jusque-là, le service et <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie avaient été successivement<br />
dirigés par Manuel Pérez Díaz, Pablo Guerra, Martín Vegas et<br />
Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón.<br />
Lors <strong>de</strong> leur création, le service et <strong>la</strong> chaire furent dirigés par le Dr Carlos<br />
Julio A<strong>la</strong>rcón, assisté <strong>de</strong> Juan Di Prisco, Luis A. Velutini, Imelda Campos,<br />
César Lizardo, Dante Borelli, Jacobo Obadía, Oscar Reyes Flores,<br />
Eduardo Estrada et Luis Gómez Carrasquero. Ensuite, leurs titu<strong>la</strong>ires successifs furent<br />
Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón, Juan Di Prisco, Oscar Reyes Flores, José Rafael Sardi, Homagdy Arévalo<br />
(née Rodríguez), Adriana Calebotta, Omaira Camejo (née Castel<strong>la</strong>nos), Zu<strong>la</strong>y Torres<br />
et Francisco González Otero.<br />
Les Drs Jacinto Convit (mé<strong>de</strong>cin-chef), Armando Sa<strong>la</strong>s, Mariano Medina, Francisco<br />
Ker<strong>de</strong>l Vegas et José Manuel Soto sont toujours à l’ancien service et chaire <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Vargas, transférés le 29 novembre 1971 dans un nouveau bâtiment situé à côté <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Vargas appelé à l’origine Institut national <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et plus tard Institut <strong>de</strong><br />
biomé<strong>de</strong>cine (22 octobre 1984) (figure 6).<br />
La conception et le succès <strong>de</strong> cette institution sont dus à l’effort et à <strong>la</strong> ténacité <strong>de</strong>s<br />
Drs Jacinto Convit et Francisco Ker<strong>de</strong>l Vegas; outre plusieurs <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> recherche,<br />
elle abrite les cabinets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie générale et spécialisée (léprologie, mycologie,<br />
<strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, leishmaniose, allergies, pathologies <strong>de</strong> <strong>la</strong> vulve, stomatologie,<br />
lupus, pathologies <strong>de</strong>s membres inférieurs, psoriasis, pathologies chirurgicales), les <strong>la</strong>boratoires<br />
d’immunologie, d’histochimie, <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmato-pathologie, ainsi qu’une bibliothèque<br />
et <strong>de</strong>s bureaux d’archivage, <strong>de</strong> statistiques et d’administration.<br />
Trois spécialisations universitaires y sont également dispensées : <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmato-pathologie microbiologique et <strong>la</strong> maîtrise en épidémiologie tropicale.<br />
Depuis son inauguration, l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine fut dirigé par le Dr Jacinto Convit;<br />
pour sa part, le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Vargas <strong>de</strong> Caracas, rattaché à l’institut,<br />
fut dirigé successivement par Jacinto Convit, José Manuel Soto, Antonio Rondón Lugo<br />
et Jaime Piquero Martín. En ce qui concerne <strong>la</strong> chaire <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
elle fut dirigée par Jacinto Convit, Eva Koves, Mauricio Goihman et Antonio Rondón<br />
Lugo.<br />
À l’initiative <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux chaires, <strong>de</strong>s projets pour mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie furent é<strong>la</strong>borés en 1962. Les directeurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation à<br />
l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine furent Jacinto Convit, José Manuel Soto et Antonio Rondón<br />
Lugo. Le premier cours débuta en 1964 avec une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans, passant ultérieurement<br />
à trois ans.<br />
435<br />
Figure 5.<br />
Hôpital universitaire<br />
<strong>de</strong> Caracas<br />
Figure 6.<br />
Institut <strong>de</strong><br />
biomé<strong>de</strong>cine
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
Aux <strong>de</strong>ux spécialisations d’origine à Caracas (hôpital Vargas et hôpital universitaire<br />
Luis Razetti) vint s’ajouter plus tard le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital militaire <strong>de</strong><br />
Caracas, dirigé au début par Hugo Naranjo A. et par les Drs Glenda Castro (née Cortez),<br />
Carlos De La Cabada et Fátima Ferreira successivement.<br />
D’autres centres d’assistance hospitalière gardèrent une intense activité <strong>de</strong> soin et<br />
d’enseignement, tels l’hôpital pour enfants <strong>de</strong> Caracas, le centre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et allergie<br />
<strong>de</strong> l’Assurance sociale et l’hôpital Luis Razetti 4, 5 .<br />
Ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles<br />
La division <strong>de</strong> vénéréologie fut créée en juillet 1938 (au sein du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé<br />
et <strong>de</strong> l’Assistance sociale <strong>de</strong> l’époque), qui avait à sa charge <strong>de</strong>s services antivénériens<br />
et <strong>de</strong>s dispensaires situés dans différentes villes du pays et disposant <strong>de</strong> matériel <strong>de</strong> <strong>la</strong>boratoire<br />
et <strong>de</strong> médicaments pour le diagnostic et le traitement. La lutte contre ces ma<strong>la</strong>dies<br />
fut dirigée par R. Sánchez Peláez, Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón, Rafael Medina, Cornelio<br />
Arévalo Morales et Mari Carmen Ferreiro.<br />
Les ma<strong>la</strong>dies sexuellement transmissibles sont soignées dans <strong>de</strong>s cabinets consacrés à<br />
ces affections, habituellement annexés aux cabinets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie générale.<br />
Actuellement, <strong>la</strong> division <strong>de</strong> vénéréologie offre, outre le soin médical, <strong>de</strong>s informations<br />
médicales par le biais <strong>de</strong> conférences, <strong>de</strong> réunions scientifiques, <strong>de</strong> stages, <strong>de</strong> formations<br />
pratiques et <strong>de</strong> cours 4 .<br />
■ Sous-spécialités<br />
436<br />
MYCOLOGIE<br />
Les centres d’assistance, <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> traitement sont situés à Caracas, dans les<br />
<strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> mycologie <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>s hôpitaux et les cabinets spécialisés,<br />
qui comptent <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>la</strong> matière. L’organisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité débuta<br />
grâce aux Drs Dante Borelli et María Albornoz (née Bastardo), fondatrice du<br />
<strong>la</strong>boratoire <strong>de</strong> mycologie <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine. Actuellement ce <strong>la</strong>boratoire est dirigé<br />
par Mireya Mendoza et Elsy Cavallera.<br />
Le Dr Dante Borelli fonda le <strong>la</strong>boratoire et le cabinet <strong>de</strong> l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Caracas,<br />
dirigé successivement par les Drs Homagdy Arévalo (née Rodríguez) et Ánge<strong>la</strong> Ruiz.<br />
Le Dr Carmen Marcano se chargea pendant plusieurs années <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
tropicale, accompagnée du Dr Dante Borelli.<br />
Il existe également plusieurs centres <strong>de</strong> référence dans différentes villes du pays dirigés<br />
par <strong>de</strong>s spécialistes en <strong>la</strong> matière et coordonnés par le Dr María Cecilia Albornoz, avec<br />
<strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration précieuse du Dr Tulio Briceño Maaz (<strong>de</strong>rmatologue et historien). Il s’agit<br />
<strong>de</strong>s centres suivants 4 : Ciudad Bolívar : Julman Cermeño et Ismery Cabello; Valencia :<br />
Rosa Briceño; Coro : Francisco Yegres; Barquisimeto : Segundo Barroeta, Ramón Zamora<br />
et Carolina Rojas; Maturín : Sara Rodolfo; Cumaná : Anabel<strong>la</strong> Sanabria (née Smitter);<br />
Trujillo : José V. Scorza; Maracaibo : Hernán Vargas Montiel.<br />
SERVICES DE LÉPROLOGIE ET DE DERMATOLOGIE SANITAIRE<br />
Le soin, <strong>la</strong> consultation, le diagnostic et le traitement se pratiquent tous à l’Institut <strong>de</strong><br />
biomé<strong>de</strong>cine et dans les dispensaires <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie sanitaire, situés dans les unités sanitaires<br />
<strong>de</strong>s capitales <strong>de</strong>s différents États. Le Dr Nacarid Aranzazu dirige le service central<br />
du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé <strong>de</strong>puis trente ans.<br />
Le traitement et le contrôle <strong>de</strong> ces affections sont gratuits aussi bien pour les patients<br />
que pour leur entourage. L’hospitalisation s’effectue dans les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong>s divers hôpitaux, dans les cas où elle est nécessaire.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
DERMATOLOGIE PÉDIATRIQUE<br />
Cette sous-spécialité se développa grâce à l’inquiétu<strong>de</strong> du Dr Eva Koves, qui commença<br />
sa consultation à l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine. Plus tard le Dr Luis A. González A. établit<br />
un cabinet pour <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>rmatologiques infantiles à l’hôpital Pérez Carreño,<br />
suivi du Dr Esther Wackzol à l’hôpital pour enfants J.M. <strong>de</strong> los Ríos, à Caracas. Le Dr<br />
Francisco González fonda le cabinet <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique au service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
<strong>de</strong> l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Caracas.<br />
IMMUNOLOGIE<br />
Le Dr Mauricio Goihman introduisit le développement <strong>de</strong> l’immunologie dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et effectua <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> recherche précieux à l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine, parallèlement<br />
aux Drs Marian Ulrich, María Cristina di Prisco, Nieves González et J.F. Tapia<br />
dans leurs <strong>la</strong>boratoires respectifs. Il dispensa également les premiers cours d’immunologie<br />
pour les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation; le Dr J.F. Tapia prit sa relève.<br />
INFORMATION DERMATOLOGIQUE<br />
La bibliothèque <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> biomé<strong>de</strong>cine, <strong>la</strong> revue Dermatología Venezo<strong>la</strong>na, et <strong>de</strong>puis<br />
1998 <strong>la</strong> publication sur Internet <strong>de</strong> Piel Latinoamericana, dirigée par Ro<strong>la</strong>ndo Hernán<strong>de</strong>z,<br />
J.F. Tapia et Jaime Piquero-Martín, sont <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> tâche éducative que <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie vénézuélienne promut pour le développement professionnel <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité.<br />
■ <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
et <strong>de</strong> chiru rgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société Vénézuélienne <strong>de</strong> Dermatologie et <strong>de</strong> Chirurgie Dermatologique<br />
L’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> société fut toujours très liée à l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine et <strong>de</strong>s institutions<br />
hospitalières et académiques. L’Académie nationale <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine fut fondée le 11<br />
juin 1904, durant le gouvernement du général Cipriano Castro.<br />
Selon l’acte initial, un groupe <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong>rmatologues décida le 14 novembre 1936<br />
<strong>de</strong> réunir leurs efforts pour « développer <strong>la</strong> solution adéquate à nos problèmes touchant à<br />
<strong>la</strong> syphilis et à <strong>la</strong> lèpre ». Les Drs A. Marcucci Delgado, Tomás Rodríguez, Manuel Murillo,<br />
J. M. López Olivares, Fe<strong>de</strong>rico Lizarraga, José Mejía, César Ávi<strong>la</strong> Chacín, Domingo A. Ca<strong>la</strong>trava<br />
et Rafael Campo Moreno décidèrent <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> syphiligraphie<br />
et <strong>de</strong> léprologie, et nommèrent prési<strong>de</strong>nt le Dr Martín Vegas. Rafael Campo<br />
Moreno faisait office <strong>de</strong> secrétaire et Tomás Rodríguez <strong>de</strong> bibliothécaire. Les premiers efforts<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société se concentrèrent sur l’organisation <strong>de</strong>s dispensaires <strong>de</strong> santé qui existaient<br />
déjà afin <strong>de</strong> lutter plus efficacement contre les ma<strong>la</strong>dies vénériennes en général, et<br />
contre <strong>la</strong> syphilis et <strong>la</strong> lèpre en particulier. La conception, l’organisation et <strong>la</strong> création <strong>de</strong><br />
dossiers cliniques uniques pour tous les dispensaires furent un travail <strong>de</strong> titan qui <strong>de</strong>manda<br />
l’effort <strong>de</strong>s tous les mé<strong>de</strong>cins travail<strong>la</strong>nt dans les dispensaires, dirigés par <strong>la</strong> société<br />
qui venait d’être créée, avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration déterminante <strong>de</strong>s autorités sanitaires.<br />
Au cours <strong>de</strong>s premières années, les activités tournaient autour <strong>de</strong> sujets <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
générale, <strong>de</strong> vénéréologie et <strong>de</strong> léprologie. Les réunions <strong>de</strong> <strong>la</strong> société naissante<br />
avaient lieu dans les dispensaires antivénériens.<br />
En 1937 fut promue <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Semaine antivénérienne, qui eut lieu pendant<br />
<strong>la</strong> première semaine <strong>de</strong> septembre. Les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> société avaient préa<strong>la</strong>blement<br />
mené une campagne d’information en utilisant <strong>de</strong>s espaces cédés à cette fin par les journaux,<br />
ainsi que <strong>de</strong>s brochures et <strong>de</strong>s publicités. On réussit à modifier avec succès <strong>la</strong> campagne<br />
antivénérienne que menait le ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.<br />
Le débat sur le traitement conseillé pour <strong>la</strong> syphilis, instauré avant <strong>la</strong> Semaine antivénérienne,<br />
se poursuivit pendant cette année-là. Le 4 septembre <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> Journée antivénérienne.<br />
437
Figure 7.<br />
Dr Juan Di Prisco<br />
Figure 8.<br />
Dr Francisco<br />
Scannone<br />
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
1936 : Martín Vegas<br />
1945 : Rafael Campo Moreno<br />
1946 : Leopoldo Briceño Iragorry<br />
1947 : Martín Vegas<br />
1949 : Jacinto Convit<br />
1951 : Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón<br />
1952 : Martín Vegas<br />
1954 : Rafael Medina<br />
1955 : Juan Di Prisco<br />
1956 : Francisco Scannone<br />
1957 : Luis Alberto Velutini<br />
1958 : Martín Vegas<br />
1959 : Oscar Reyes Flores (6 mois)<br />
1960 : Porfirio Irazabal (6 mois)<br />
1960 : Luis Alberto Velutini<br />
1962 : Porfirio Irazabal<br />
1964 : Mariano Medina Febres<br />
1966 : Juan Di Prisco<br />
1968 : Eduardo Estrada<br />
438<br />
Prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique<br />
4, 8<br />
<strong>de</strong> sa fondation jusqu’à 2004<br />
1970 : Francisco Ker<strong>de</strong>l Vegas<br />
1972 : Jacobo Obadia Serfaty<br />
1974 : Mauricio Goihman<br />
1976 : José Manuel Soto<br />
1978 : Cruz Graterol Roque<br />
1980 : Jorge Hómez Chacín<br />
1982 : Eva Koves <strong>de</strong> Amini<br />
1984 : Antonio Rondón Lugo<br />
1986 : Antonio Rondón Lugo<br />
1988 : Maria Antonieta Mejías<br />
1990 : Jaime Piquero Martín<br />
1992 : Cornelio Arévalo Morles<br />
1994 : Antonio Rondón Lugo<br />
1996 : Ricardo Pérez Alfonso<br />
1998 : Hernán Vargas Montiel<br />
2000 : Francisco González Otero<br />
2002 : Alfredo Lan<strong>de</strong>r Marcano<br />
2004 : Benjamín Trujillo<br />
En 1938, Domingo Ca<strong>la</strong>trava fut nommé vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, Rafael Campo<br />
Moreno secrétaire et Rafael Domínguez Sisco bibliothécaire.<br />
En 1944, <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> syphiligraphie et <strong>de</strong> léprologie <strong>la</strong>nça <strong>la</strong> publication<br />
<strong>de</strong> ses travaux dans <strong>la</strong> Revue <strong>de</strong> <strong>la</strong> polyclinique Caracas, dans <strong>la</strong> section <strong>de</strong>stinée à<br />
<strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
L’activité académique déployée <strong>de</strong> façon permanente par les membres fondateurs lors<br />
<strong>de</strong>s réunions <strong>de</strong> <strong>la</strong> société dépassa les limites <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte antivénérienne et antilépreuse;<br />
le 7 juillet 1945 se réunirent à Caracas les Drs Martín Vegas, Juan di Prisco (figure 7)<br />
Francisco Scannone (figure 8), Antonio Araujo, Leopoldo Briceño Iragorry, Mariano Medina<br />
Febres, A. Chávez, Rafael Campo Moreno, Juan Di Prisco, Juan Iturbe, Armando<br />
Sa<strong>la</strong>s, José Lucio González, Carmelo Lauria, Luis Rodríguez Santana, Jacinto Convit,<br />
Tomás Genatios, Il<strong>de</strong>maro Lovera et Carlos Julio A<strong>la</strong>rcón, pour enregistrer <strong>la</strong> société déjà<br />
fondée en 1936 sous un nouveau nom : Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et vénéréologie.<br />
Cinq membres élus intégraient <strong>la</strong> commission directive conformément aux statuts<br />
et exerceraient pendant un an les charges <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt, secrétaire <strong>de</strong>s actes,<br />
secrétaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> correspondance et <strong>de</strong>s publications, trésorier et bibliothécaire. De cette<br />
façon débutait l’activité académique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie proprement dite; les rêves <strong>de</strong>s<br />
membres fondateurs se concrétisèrent plusieurs années après avec <strong>la</strong> création <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie dans les hôpitaux Vargas et universitaire et, par<br />
<strong>la</strong> suite, à l’hôpital militaire <strong>de</strong> Caracas.<br />
Le 8 novembre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, pour <strong>la</strong> première fois dans l’histoire <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong><br />
spécialités médicales, une délégation officielle fut fondée à l’intérieur du pays, dans l’État<br />
<strong>de</strong> Zulia; le Dr Jorge Hómez Chacín, remarquable <strong>de</strong>rmatologue, fut élu prési<strong>de</strong>nt.<br />
Les premiers membres honorifiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> société furent nommés en juin 1948, selon<br />
leurs mérites. Cet honneur échut à quatre professeurs cubains, treize professeurs nordaméricains,<br />
un professeur français, quatre professeurs argentins, trois brésiliens et un<br />
professeur vénézuélien, le Dr Juan Larral<strong>de</strong>.<br />
Le 24 avril 1950, les Drs Martín Vegas et Rafael Medina, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuelienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, furent désignés membres du comité d’experts en ma<strong>la</strong>dies vénériennes<br />
<strong>de</strong> l’Organisation mondiale <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé, à l’initiative du ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Santé.<br />
En mars 1956, le Dr Rafael Medina fut nommé membre éminent <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, secrétaire<br />
local du Congrès international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu à Stockholm, Suè<strong>de</strong>.<br />
Le 14 novembre fut créé le prix Martín Vegas en commémoration <strong>de</strong>s vingt ans <strong>de</strong> <strong>la</strong>
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société; on établit également que ce jour <strong>de</strong>viendrait <strong>la</strong> date d’anniversaire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société, raison pour <strong>la</strong>quelle les congrès et les réunions annuelles ont lieu à<br />
cette époque.<br />
Le Congrès international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong>manda à <strong>la</strong> société <strong>de</strong> nommer un délégué<br />
du Venezue<strong>la</strong> : le Dr Francisco Scannone.<br />
La revue Dermatología Venezo<strong>la</strong>na, organe officiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société, fut fondée en décembre<br />
1958.<br />
Depuis sa création, <strong>la</strong> société avait changé son nom à trois reprises. Le 7 janvier 1970,<br />
elle reçut une nouvelle dénomination : Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, selon un<br />
communiqué <strong>de</strong>stiné à <strong>la</strong> commission directive <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération médicale vénézuélienne,<br />
« car <strong>de</strong> cette façon générique on sous-entend que <strong>la</strong> vénéréologie, <strong>la</strong> léprologie, <strong>la</strong> mycologie,<br />
l’allergologie, l’histopathologie <strong>de</strong>rmatologique, l’oncologie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong><br />
microbiologie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, <strong>la</strong> radiothérapie superficielle,<br />
<strong>la</strong> cosmétologie, ainsi que toutes les branches liées aux ma<strong>la</strong>dies cutanées et à ses<br />
annexes pouvant en dériver à l’avenir, complètent le contexte <strong>de</strong> cette spécialité ».<br />
Le 28 février 1972, le Dr Ker<strong>de</strong>l Vegas proposa <strong>la</strong> création d’une conférence annuelle<br />
en hommage permanent au Dr Martín Vegas; désormais cette conférence est le point<br />
central du congrès et <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion annuelle.<br />
En 1973, un accord fut passé avec l’Académie <strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pour réaliser<br />
<strong>de</strong>s cours d’actualisation au Venezue<strong>la</strong>, qui s’effectuent avec succès grâce à <strong>la</strong> gestion<br />
<strong>de</strong> Francisco Ker<strong>de</strong>l Vegas et <strong>de</strong> Mauricio Goihman Yahr.<br />
L’année 1973 marqua le début <strong>de</strong> l’étape <strong>de</strong> consolidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
Outre les réunions annuelles et mensuelles, <strong>la</strong> société rétablit les congrès vénézuéliens<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie; le <strong>de</strong>uxième congrès eut lieu sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Obadía<br />
Serfaty, le troisième (1978) fut dirigé par son prési<strong>de</strong>nt, le Dr Cruz Graterol Roque, et le<br />
quatrième congrès par le Dr Antonio Rondón Lugo.<br />
Depuis sa création, <strong>la</strong> SVD a organisé le VII e<br />
Congrès ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
en 1971, six congrès vénézuéliens <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et trente-neuf réunions annuelles.<br />
Elle octroya aussi les prix Dr Martín Vegas, Dr César Lizardo, Dr Jacinto Convit,<br />
réalisa les forums Dr Juan Di Prisco et Dr José M. Soto et accorda les prix aux posters<br />
Dr Víctor Suprani.<br />
Outre <strong>la</strong> revue Dermatología Venezo<strong>la</strong>na, un bulletin mensuel <strong>de</strong> <strong>la</strong> société commença<br />
à paraître vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong>s années 60, dans lequel étaient présentés les cas cliniques <strong>de</strong>s<br />
réunions mensuelles et l’information administrative sociétaire. Ce bulletin fut réactivé<br />
sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Jaime Piquero-Martín (1990-1992) ; à cette <strong>de</strong>uxième publication<br />
s’ajouta un service d’information <strong>de</strong>rmatologique comportant <strong>de</strong>s informations<br />
scientifiques; <strong>la</strong> revue Dermatología Venezo<strong>la</strong>na comprend aussi <strong>de</strong>s monographies<br />
comme suppléments.<br />
Tout au long <strong>de</strong>s trois pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Antonio Rondón Lugo, il fut<br />
convenu d’intégrer et <strong>de</strong> rassembler tous les <strong>de</strong>rmatologues au sein <strong>de</strong> l’association. La<br />
figure <strong>de</strong> membre actif fut créée pour les <strong>de</strong>rmatologues diplômés <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> spécialisation<br />
qui ne pouvaient pas être admis en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> rigidité <strong>de</strong>s normes; <strong>de</strong>s cours<br />
d’éducation médicale continue virent également le jour pour les <strong>de</strong>rmatologues, les mé<strong>de</strong>cins<br />
généralistes et pour <strong>la</strong> communauté.<br />
Grâce à <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiale occi<strong>de</strong>ntale et <strong>de</strong> <strong>la</strong> filiale orientale fondée à C<strong>la</strong>rines<br />
(État d’Anzoátegui), les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s provinces furent admis dans l’association. Finalement,<br />
en juillet 2001, <strong>la</strong> société créa <strong>la</strong> filiale sud-orientale, dont le premier coordinateur<br />
fut le Dr Alfredo Lan<strong>de</strong>r Marcano.<br />
Sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce du Dr Francisco González Otero, <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
changea <strong>de</strong> nom pour acquérir sa dénomination actuelle : Société vénézuélienne<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique.<br />
439
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
LA REVUE DERMATOLOGÍA VENEZOLANA<br />
Les recherches menées dans différents centres justifièrent plusieurs publications dans<br />
<strong>de</strong>s revues internationales et dans <strong>la</strong> revue Dermatología Venezo<strong>la</strong>na, organe <strong>de</strong> publication<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, ainsi que plusieurs travaux re<strong>la</strong>tifs à <strong>de</strong>s<br />
cas cliniques, <strong>de</strong>s relectures, <strong>de</strong>s considérations <strong>de</strong> cas, <strong>de</strong>s commentaires, entre autres.<br />
La publication <strong>de</strong> cette revue fut entreprise en décembre 1957 sous <strong>la</strong> direction du Dr<br />
Luis A. Velutini; <strong>de</strong>puis lors, elle fait paraître trois à quatre numéros par an.<br />
Luis A. Velutini, Rafael Medina, Jaime Piquero-Martín, Antonio Rondón Lugo, Oscar<br />
Reyes, Mauricio Goihman, Félix J Tapia et Margarita Oliver en furent les éditeurs.<br />
■ <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong> Dermatologie <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans les provinces dans les provinces<br />
440<br />
Jusqu’en 1956, <strong>la</strong> société « fut enfermée dans les murs <strong>de</strong> l’hôpital Vargas », selon les<br />
propos <strong>de</strong> Francisco Scannone, son prési<strong>de</strong>nt à l’époque; une décision unanime fixa <strong>la</strong><br />
réalisation <strong>de</strong> réunions scientifiques mensuelles ou <strong>de</strong> visites dans <strong>de</strong>s centres spéciaux,<br />
comme <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco, située sur le littoral du district fédéral.<br />
Lors <strong>de</strong> l’assemblée générale extraordinaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> société du 22 mars 1956, on établit<br />
<strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s délégations dans les villes <strong>de</strong>s provinces; une réunion eut lieu<br />
pour <strong>la</strong> première fois le 14 juillet à <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco avec <strong>de</strong>s invités d’autres<br />
sociétés et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s provinces, <strong>la</strong> lèpre étant l’unique sujet à traiter.<br />
ZULIA (OUEST)<br />
Le 8 novembre <strong>de</strong> <strong>la</strong> même année, pour <strong>la</strong> première fois dans l’histoire <strong>de</strong>s sociétés<br />
<strong>de</strong> spécialités médicales, une délégation officielle fut fondée dans l’État <strong>de</strong> Zulia; sa prési<strong>de</strong>nce<br />
fut assumée par Jorge Hómez Chacín. Cet événement marqua l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société <strong>de</strong> <strong>la</strong> capitale aux provinces, promouvant ainsi le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans tout le pays.<br />
Dans l’État <strong>de</strong> Zulia, plus spécifiquement à Maracaibo, le Dr Fernán<strong>de</strong>z Vautrai initia<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie comme une spécialité médicale dans les années 40, à l’ancien poste <strong>de</strong><br />
secours <strong>de</strong> l’hôpital central Dr Urquinaona. En 1948, le Dr Jorge Hómez Chacín prit en<br />
charge ce cabinet, après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> spécialisation en parasitologie, mé<strong>de</strong>cine tropicale<br />
et <strong>de</strong>rmatologie réalisées à l’université <strong>de</strong> Paris et à l’hôpital Saint-Louis <strong>de</strong> <strong>la</strong> même<br />
ville.<br />
Un an après, le Dr Pedro Lapenta prit en main <strong>la</strong> léproserie <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provi<strong>de</strong>nce<br />
sur le <strong>la</strong>c <strong>de</strong> Maracaibo; il exerça également à l’hôpital Chiquinquirá et à l’hôpital pour<br />
enfants <strong>de</strong> Maracaibo jusqu’en 1953 : cette année-là il fut nommé mé<strong>de</strong>cin-chef <strong>de</strong> <strong>la</strong> clinique<br />
antilépreuse <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco à Maiquetía et mé<strong>de</strong>cin directeur (1962 à 1965), ce<br />
qui l’amena à déménager à Maracay.<br />
Les Drs Nectario Durango Nazariego, Humberto Rincón Bracho et Humberto Bojana<br />
vinrent s’ajouter plus tard, suivis d’Hernán Vargas Montiel et César Barroso Tobi<strong>la</strong>.<br />
Nectario Durango Nazariego et Humberto Rincón Bracho travaillèrent au cabinet <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire à partir <strong>de</strong> 1960. Un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie d’excellence<br />
se forma plus tard, composé d’un groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues dirigés par Hernán<br />
Vargas Montiel, Anairma Durango Michailos et Elizabeth Guadagnini. Actuellement<br />
existe le projet d’ouvrir un service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie du SAHUM (service autonome <strong>de</strong><br />
l’hôpital universitaire <strong>de</strong> Maracaibo).<br />
En 1991, le groupe du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital universitaire organisa<br />
un cursus d’éducation médicale continue ; pour ce<strong>la</strong>, le cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie au<br />
jour le jour fut mis en p<strong>la</strong>ce, et ensuite le cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie itinérante, dispensé<br />
dans les États <strong>de</strong> l’ouest du pays tels que Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo et<br />
Zulia.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie au Venezue<strong>la</strong><br />
Ceci entraîna <strong>la</strong> réactivation — sollicitée par Antonio Rondón Lugo, prési<strong>de</strong>nt à<br />
l’époque <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société vénézuélienne <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie — <strong>de</strong> <strong>la</strong> délégation centre-ouest<br />
(appelée déjà filiale grâce au changement <strong>de</strong> statuts) <strong>de</strong> <strong>la</strong> société le 25 juin 1996, facilitant<br />
l’échange scientifique entre les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong>s différentes régions.<br />
BOLÍVAR (SUD)<br />
La <strong>de</strong>rmatologie nationale s’étendit jusqu’à Ciudad Bolívar avec le Dr Francisco Battistini.<br />
À son retour <strong>de</strong> France en 1949, il fonda le premier cabinet externe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans l’État <strong>de</strong> Bolívar. L’enseignement supérieur débuta en 1960, tandis que le<br />
résidanat <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie fut entamé en 1975. Les Drs Florencio<br />
García Morales et Ana María Brun (née Battistini) — à son retour <strong>de</strong> l’hôpital Saint-Louis<br />
—, qui resta à <strong>la</strong> charge <strong>de</strong> <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation initiée par son père, furent<br />
admis plus tard dans le service. Pour sa part, le Dr Oscar Perfetti revint d’Angleterre<br />
avec une préparation soli<strong>de</strong> et, en quelques années, il mena un travail digne d’éloges à<br />
Puerto Ordaz 13 . Le Dr Ismery Cabello compte aussi parmi les <strong>de</strong>rmatologues notables, aidant<br />
à <strong>la</strong> consolidation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région.<br />
CARABOBO (CENTRE)<br />
La <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> Valencia, dans l’État <strong>de</strong> Carabobo, débuta dans les années 50 avec<br />
le Dr Fernando Aguilera, qui revint au pays après <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s effectuées en Argentine et en<br />
France. Quelques années plus tard se joignirent à lui Omar Miret Ortega et Raúl Fachín<br />
Viso, une fois terminées leurs spécialisations à l’hôpital Vargas, à Londres et aux États-Unis.<br />
Le Dr Marco Tulio Mérida y fut admis ultérieurement; les premiers résidanats programmés<br />
débutèrent en 1976, et furent <strong>la</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie vers<br />
le début <strong>de</strong> 1985.<br />
Nous citerons Carlos Fachín, Marlene Mendoza, Olga Morel<strong>la</strong> Herrera, Rosa Oliveros<br />
et Ilse Angulo parmi les figures <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie locale.<br />
ARAGUA (CENTRE)<br />
La <strong>de</strong>rmatologie dans l’État d’Aragua débuta en 1965 avec le Dr Pedro Lapenta, après<br />
son passage aux léproseries <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> <strong>la</strong> Provi<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong> Cabo B<strong>la</strong>nco, secondé par<br />
Jorge Alvarado, Willian Vázquez, R. Otamendi, Lilian <strong>de</strong> Cequeda, Maritza Maya et Luis<br />
Felipe Guada.<br />
LARA (CENTRE-OUEST)<br />
À Barquisimeto, le premier service fut fondé en 1939 par le Dr Humberto Campins à<br />
l’ancien hôpital Antonio María Pineda, transféré ensuite à l’hôpital central Antonio María<br />
Pineda; en 1950, le Dr Carlos Zapata y fut admis comme auxiliaire. En 1954, le Dr J.J.<br />
Henríquez, provenant du Skin and Cancer Hospital, arriva dans le service; il resterait<br />
dans <strong>la</strong> ville jusqu’en 1966, date <strong>de</strong> son départ à Caracas.<br />
En 1958, le Dr Cruz A. Graterol Roque fut nommé chef intérimaire du service et le Dr<br />
Segundo Barroeta le rejoignit en 1963 après avoir effectué un cours <strong>de</strong> spécialisation à<br />
Buenos Aires; dès 1970, il dirigea le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>de</strong> l’hôpital Antonio María<br />
Pineda jusqu’à sa retraite en 2004. Il fut remp<strong>la</strong>cé par le Dr María Herminia Araujo.<br />
Les Drs María Antonieta Mejías et Segundo Barroeta furent les lea<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
dans l’État <strong>de</strong> Lara. La spécialisation débuta en 1971, sous <strong>la</strong> direction du Dr Segundo<br />
Barroeta, sous <strong>la</strong> forme d’un résidanat programmé. En 1987, il <strong>de</strong>vint un cours<br />
<strong>de</strong> spécialisation universitaire.<br />
MÉRIDA (SUD-OUEST)<br />
Depuis leur fondation en 1936, l’hôpital <strong>de</strong> Los An<strong>de</strong>s et le dispensaire antivénérien<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche sur <strong>la</strong> lèpre <strong>de</strong> l’unité sanitaire prirent initialement en charge les<br />
441
A. LANDER, J. PIQUERO, A. RONDÓN, O. REYES, B. TRUJILLO, H. VARGAS<br />
ma<strong>la</strong>dies <strong>de</strong>rmato-vénéréologiques dans cette région. Le Pr Pedro Guerra Fonseca était<br />
le chef du service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie et <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies vénériennes, assisté <strong>de</strong> J.M. Luengo<br />
Vale et Francisco Fonseca. Remarquons qu’actuellement les Drs Graterol et Luis Soucre<br />
sont les promoteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans cet État.<br />
TÁCHIRA (SUD-OUEST)<br />
La pratique <strong>de</strong>rmatologique débuta à San Cristóbal avec le Dr Francisco Cár<strong>de</strong>nas Becerra.<br />
Le Dr Adolfo Vivas Arel<strong>la</strong>no exercerait plus tard <strong>la</strong> spécialité à l’hôpital central <strong>de</strong><br />
San Cristóbal (dans les années 50), suite à une spécialisation en <strong>de</strong>rmatologie faite à Rio<br />
<strong>de</strong> Janeiro; le Dr Or<strong>la</strong>ndo Ramírez, chargé d’organiser le service <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie dudit<br />
hôpital, y fut admis quelques années plus tard.<br />
BARINAS (CENTRE)<br />
Le Dr Ro<strong>la</strong>ndo Hernán<strong>de</strong>z Pérez fut le chef <strong>de</strong> file important <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie vénézuélienne<br />
dans cette province 4 . ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Archi<strong>la</strong> R. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina en Venezue<strong>la</strong>,<br />
Caracas: Tipografía Vargas;<br />
1961.<br />
2. Diepgen P. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Medicina. 2 e éd. Madrid:<br />
Labor; 1932.<br />
3. Sarmiento F., Sáenz Astort J.A.<br />
Arte y Medicina. Caracas:<br />
Publicaciones Ediprosal;<br />
2003.<br />
4. Scannone F. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dermatología en Venezue<strong>la</strong>,<br />
Caracas: Cromotip; 1990.<br />
5. Briceño Maaz T. « Datos para <strong>la</strong><br />
historia <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
en Venezue<strong>la</strong> ». Derm. Ven.<br />
1978; 16: 29-40.<br />
6. Lizardo C. « Doctor Manuel<br />
Pérez Díaz ». Derm. Ven.<br />
1958; 1: 212-214.<br />
7. Briceño Maaz T. « Esbozo<br />
histórico <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dermatología<br />
en el Hospital Vargas <strong>de</strong><br />
Caracas ». Derm. Ven. 1991;<br />
29: 23-24.<br />
8. Rondón Lugo A.J, Sáenz Astort<br />
J.A. Aproximación histórica a<br />
<strong>la</strong> Dermatología venezo<strong>la</strong>na.<br />
Caracas: Producción<br />
Excelsior; 2001.<br />
9. Lapenta P., Obadya S.J. « Datos<br />
Septembre 2005<br />
biográficos <strong>de</strong>l Dr. Martín<br />
Vegas ». Derm. Ven. 1957; 1:<br />
23-26.<br />
10. Piquero Martín J. « Homenaje<br />
a Martín Vegas ». Derm. Ven.<br />
1991; 29: 25.<br />
11. Rondon Lugo A.J. « Homenaje<br />
a Martín Vegas ». Derm. Ven.<br />
1991; 29: 26.<br />
12. Ávi<strong>la</strong> Bello J.L. Revista <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Facultad <strong>de</strong> Medicina. Gente<br />
<strong>de</strong> Ciencia. 1987; 10: 113-<br />
115.<br />
13. Piquero Martín J. « Oscar<br />
Perfetti: un profesional<br />
idóneo ». Derm. Ven. 1991;<br />
29: 68.
LE COLLÈGE IBÉRO-<br />
LATINO-AMÉRICAIN<br />
DE DERMATOLOGIE<br />
(CILAD)<br />
ROBERTO ARENAS<br />
Une fois <strong>la</strong> guerre civile espagnole terminée (1936-1939), <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rmatologues notables,<br />
Enrique Álvarez Sáinz <strong>de</strong> Aja (Espagne) et Pedro Baliña (Argentine), se proposèrent<br />
<strong>de</strong> rassembler les spécialistes portugais, espagnols et <strong>la</strong>tino-américains pour pallier<br />
à l’interruption <strong>de</strong>s congrès internationaux. Tenant compte <strong>de</strong>s racines et <strong>de</strong>s dénominateurs<br />
communs et profitant <strong>de</strong> l’anniversaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société argentine <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
ils jetèrent en 1947 à Buenos Aires les bases d’une nouvelle institution 1 .<br />
Le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie fut fondé à La Havane le 11<br />
avril 1948, dans l’une <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> l’école municipale Rodríguez Valdés;<br />
l’acte <strong>de</strong> fondation fut signé par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues-léprologues d’Espagne, d’Amérique<br />
du Sud, <strong>de</strong> Cuba et du Mexique 1-3 . Le premier congrès eut lieu à Rio <strong>de</strong> Janeiro<br />
en 1950, présidé par João <strong>de</strong> Agui<strong>la</strong>r-Pupo, tandis qu’Antar Padilha<br />
Gonçalvez faisait office <strong>de</strong> secrétaire général. Les premiers statuts furent approuvés<br />
à Lisbonne en 1961. Selon l’article 2, le but <strong>de</strong> l’institution est d’encourager les<br />
échanges scientifiques, les liens fraternels et le contact intellectuel, afin <strong>de</strong> favoriser<br />
le progrès <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngue espagnole et portugaise. Le collège regroupe<br />
vingt-<strong>de</strong>ux pays ibéro-<strong>la</strong>tino-américains et constitue l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s<br />
sociétés <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie au mon<strong>de</strong> 4 (figure 1). Le CILAD est représenté auprès <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques. Une adresse électronique du<br />
CILAD est disponible: .<br />
PRÉSIDENTS DU COLLÈGE IBÉRO-LATINO-AMÉRICAIN DE DERMATOLOGIE AU COURS DE SON HISTOIRE<br />
1948-1950 João <strong>de</strong> Aguiar Pupo (Brésil)<br />
1950-1953 José Gay Prieto (Espagne)<br />
1953-1956 Fernando Latapí (Mexique)<br />
1957-1959 Augusto Sa<strong>la</strong>zar-Leite (Portugal)<br />
1959-1963 Luis E. Pierini (Argentine)<br />
1964-1967 Xavier Vi<strong>la</strong>nova (Espagne) et Juvenal Estévez (Portugal)<br />
1967-1971 Antar Padil<strong>la</strong> Gonçalves (Brésil)<br />
1972-1975 David Grinspan (Argentine)<br />
1976-1979 Rubem David Azu<strong>la</strong>y (Brésil)<br />
443<br />
Figure 1.<br />
Logotype du Collège<br />
ibéro-<strong>la</strong>tinoaméricain<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologie
ROBERTO ARENAS<br />
444<br />
1980-1983 Jorge Abu<strong>la</strong>fia (Argentine)<br />
1984-1987 Jorge Abu<strong>la</strong>fia (Argentine)<br />
1988-1991 Sebastião Sampaio (Brésil)<br />
1992-1995 Enrique Hernán<strong>de</strong>z Pérez (Salvador)<br />
1996-1999 Ana Kaminsky (Argentine)<br />
2000-2003 Francisco Camacho Martínez (Espagne)<br />
2003-2007 Roberto Arenas (Mexique)<br />
PRÉSIDENTS DES CONGRÈS<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro (1950), João <strong>de</strong> Aguiar Pupo<br />
Madrid (1953), José Gay Prieto<br />
Mexico D.F. (1956), Fernando Latapí<br />
Lisbonne (1959), Augusto Sa<strong>la</strong>zar-Leite<br />
Buenos Aires et Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta (1963), Luis E. Pierini<br />
Barcelone (1967), José Mercadal-Peyrí<br />
Caracas (1971), Martín Vegas<br />
San Salvador (1975), Oswaldo Ramírez<br />
Me<strong>de</strong>llin (1979), Alonso Cortés<br />
Rio <strong>de</strong> Janeiro (1983), Rubén D. Azu<strong>la</strong>y<br />
Madrid (1987), Antonio García-Pérez et Antonio Ledo<br />
Guada<strong>la</strong>jara (1991), José Barba Rubio<br />
San Juan <strong>de</strong> Puerto Rico (1995), Jorge L. Sánchez<br />
Ma<strong>la</strong>ga (1999), Miguel Armijo et Enrique Herrera-Ceballos<br />
Buenos Aires (2003), Ana Kaminsky<br />
Carthagène (2005), Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong><br />
C’est au cours du congrès <strong>de</strong> Lisbonne (1959) que naquit <strong>la</strong> revue Dermatología Ibero<strong>la</strong>tinoamericana<br />
(DILA) — organe officiel du collège —, dirigée par Augusto Sa<strong>la</strong>zar-<br />
Leite et Francisco Da Cruz Sobral, secrétaire général à vie du collège. La revue fêta ses<br />
14 ans sous leur mandat. En 1966 naquit <strong>de</strong> manière indépendante <strong>la</strong> revue Medicina<br />
Cutánea (Joaquín Piñol Aguadé). En 1973 les <strong>de</strong>ux revues fusionnèrent pour <strong>de</strong>venir Medicina<br />
Cutánea Ibero<strong>la</strong>tinoamericana (Med. Cutan. Iber. Lat. Am.) 5 . Le Pr José Mª Mascaró<br />
débuta dans sa rédaction en 1967 et resta à sa tête pendant vingt-huit ans 6 ; le Pr<br />
Mario Lecha et Carlos Ferrándiz Foraster (directeur adjoint), ce <strong>de</strong>rnier remp<strong>la</strong>cé par<br />
Juan Ferrando, prirent <strong>la</strong> relève. Ramón Grimalt et José M. Mascaró Galy col<strong>la</strong>borent<br />
également à <strong>la</strong> rédaction. Carmen Marcos fut chargée pendant <strong>de</strong>s années du secrétariat<br />
et <strong>de</strong> <strong>la</strong> coordination éditoriale. En 2004, à partir du volume 32, s’ajoutèrent Alberto<br />
Woscoff et Jayme <strong>de</strong> Oliveira Filho en tant qu’éditeurs associés.<br />
Medicina Cutánea Ibero<strong>la</strong>tinoamericana est l’organe officiel du CILAD; <strong>de</strong> parution bimestrielle,<br />
<strong>la</strong> revue est éditée en couleur et en trois <strong>la</strong>ngues : en espagnol, en portugais<br />
et en ang<strong>la</strong>is. Il existe également une version numérique sur le site Internet<br />
. En 2004, un bulletin (InfoCILAD) et une adresse électronique<br />
institutionnelle virent également le jour.<br />
Tout au long <strong>de</strong> son existence, <strong>la</strong> revue Medicina Cutánea se mo<strong>de</strong>rnisa quant à son<br />
format et son contenu. Actuellement elle comporte les rubriques suivantes : éditorial,<br />
travaux originaux, cas cliniques, rubriques spécialisées, symposium satellite, histoire <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie ibéro-<strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, information, courrier pour le directeur (à <strong>la</strong><br />
charge <strong>de</strong> Mauricio Goihman), actualités thérapeutiques (León Jaimovich) et formation<br />
continue en mé<strong>de</strong>cine (initiée en 1996 par Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>). ■<br />
Septembre 2004
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Latapí F. « Veinticinco años <strong>de</strong>l<br />
Colegio Ibero-<br />
Latinoamericano <strong>de</strong><br />
Dermatología. Editorial ».<br />
Dermatología Rev. Mex.<br />
1972; 16(3): 291-3.<br />
2. Saúl A. « Ecos <strong>de</strong> Portugal ».<br />
Dermatología Rev. Mex.<br />
1959; 3(3): 201-9.<br />
Le Collège ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (CILAD)<br />
3. Cañizares O. « La <strong>de</strong>rmatología<br />
en <strong>la</strong> América Latina ».<br />
Dermatología Rev. Mex.<br />
1960; 4(3-4): 185-95.<br />
4. Kaminsky A. « Bienvenida ».<br />
Programa 15º Congreso Ibero<br />
Latinoamericano <strong>de</strong><br />
Dermatología. Buenos Aires.<br />
21-25 oct. 2003.<br />
5. Sa<strong>la</strong>zar-Leite A., da Cruz<br />
Sobral F. « Final <strong>de</strong> um<br />
mandato ». Dermatol. Iber.<br />
Lat. Am. 1972; 4: 441-42.<br />
6. Mascaró J.M. « Informe <strong>de</strong>l<br />
director <strong>de</strong> Medicina Cutánea<br />
Ibero-Latinoamericana ».<br />
Med. Cut. ILA. 1995; 23:<br />
351-54.
RÉUNION ANNUELLE<br />
DES DERMATOLOGUES<br />
LATINO-AMÉRICAINS<br />
(RADLA)<br />
FERNANDO MAGILL<br />
Le 27 octobre 1972, à l’occasion du congrès argentin <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui s’est tenu<br />
dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Buenos Aires, a été décidée au cours <strong>de</strong> l’assemblée sollicitée par le Pr<br />
Pablo Viglioglia, prési<strong>de</strong>nt du congrès, <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> Réunion annuelle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues<br />
<strong>la</strong>tino-américains, suivant les spécifications <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration à <strong>la</strong>quelle avaient<br />
souscrit les représentants <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> treize pays <strong>la</strong>tino-américains : l’Argentine,<br />
<strong>la</strong> Bolivie, le Brésil, <strong>la</strong> Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Salvador, le Mexique,<br />
le Paraguay, le Pérou, Saint-Domingue, le Venezue<strong>la</strong> et l’Uruguay1, 3 . Il a été accordé que<br />
cette réunion se réaliserait une fois par an — à l’exception <strong>de</strong> l’année où elle coïnci<strong>de</strong>rait<br />
avec le Congrès ibéro-<strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie — et qu’elle <strong>de</strong>viendrait une<br />
réunion d’échange scientifique, d’apprentissage et <strong>de</strong> confraternité dont le but principal<br />
serait <strong>la</strong> mise à jour et <strong>la</strong> formation continue dans les divers domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie.<br />
La RADLA, selon le Dr Clovis Bopp1 , est le fruit <strong>de</strong> diverses initiatives surgies au préa<strong>la</strong>ble;<br />
en premier lieu, dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> réunion organisée par le Pr Alejandro Cor<strong>de</strong>ro<br />
à Buenos Aires, à <strong>la</strong>quelle ont participé <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues argentins et brésiliens, ainsi<br />
que dans les groupes formés à l’occasion du VII e<br />
Congrès ibéro-<strong>la</strong>tino-américain (Caracas,<br />
décembre 1971) et du XXIX e<br />
Congrès brésilien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie (Nueva Friburgo, du<br />
12 au 21 octobre 1972).<br />
Le Dr Sebastiao Sampaio2 affirme que lors du congrès du CILAD à Caracas en 1971,<br />
les Drs Juan Carlos Gatti, Pablo Viglioglia, Osvaldo Mangano et Sampaio lui-même ont<br />
suggéré <strong>de</strong> réaliser une réunion annuelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues argentins et brésiliens, une<br />
proposition à <strong>la</strong>quelle adhéra le Dr Tancredo A. Furtado.<br />
Un an après, lors du congrès brésilien <strong>de</strong> Nueva Friburgo en octobre 1972, cette idée<br />
fut <strong>de</strong> nouveau présentée par les <strong>de</strong>rmatologues mentionnés ci-<strong>de</strong>ssus, rejoints avec enthousiasme<br />
par le Dr Rubem Azu<strong>la</strong>y, prési<strong>de</strong>nt du congrès. À cette occasion, <strong>la</strong> proposition<br />
fut é<strong>la</strong>rgie pour <strong>de</strong>venir une réunion annuelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains.<br />
Une semaine plus tard, <strong>la</strong> RADLA voyait le jour. Il fut déterminé que <strong>la</strong> première<br />
réunion aurait lieu à Buenos Aires du 1 er<br />
au 4 novembre 1973. Celle-ci fut présidée par<br />
le Pr Pablo Viglioglia, le Pr Jorge Abu<strong>la</strong>fia étant le vice-prési<strong>de</strong>nt et le Pr Juan C. Gatti le<br />
secrétaire général. Environ 300 <strong>de</strong>rmatologues y assistèrent.<br />
Selon le statut en vigueur, <strong>la</strong> Réunion annuelle <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains<br />
(RADLA) fut créée en raison <strong>de</strong> l’importance croissante et <strong>de</strong>s enjeux médico-sociaux <strong>de</strong><br />
447
Conseil <strong>de</strong> délégués<br />
RADLA 2004<br />
FERNANDO MAGILL<br />
448<br />
La RADLA à travers le temps<br />
RADLA Siège Année Prési<strong>de</strong>nt Secrétaire général<br />
I Argentine (Buenos Aires) 1973 P. Viglioglia J.C. Gatti (+)<br />
II Brésil (Rio <strong>de</strong> Janeiro) 1974 R.D. Azu<strong>la</strong>y A.P. Mesquita<br />
III Argentine (Buenos Aires) 1977 A. Casalá O. Mangano (+)<br />
IV Brésil (Guarujá) 1978 S. Sampaio J. Costa Martins<br />
V Argentine (Buenos Aires) 1980 J.C. Gatti (+) J.E. Cardama (+)<br />
VI Brésil (Rio <strong>de</strong> Janeiro) 1981 R. D. Azu<strong>la</strong>y J. Servia<br />
VII Argentine (Buenos Aires) 1982 A. Woscoff E. Choue<strong>la</strong><br />
VIII Uruguay (Montevi<strong>de</strong>o) 1984 R. Vignale P. Pereyra<br />
IX Chili (Santiago) 1985 J. Honeyman G. Eguiguren<br />
X Argentine (Buenos Aires) 1986 O. Mangano (+) R. Galimberti<br />
XI Brésil (Sao Paulo) 1988 E. Rivitti F. Forim Alonso (+)<br />
XII Uruguay (Montevi<strong>de</strong>o) 1989 P. Pereyra N. Macedo<br />
XIII Brésil (Rio <strong>de</strong> Janeiro) 1990 A.C. Pereira Jr. (+) J. Ricart<br />
XIV Chili (Santiago) 1992 C. Vera Mora (+) M. Cifuentes<br />
XV Argentine (Buenos Aires) 1993 L. Jaimovich H. Cabo<br />
XVI Brésil (Porto Alegre) 1994 C. Bernardi H. Ponzio<br />
XVII Uruguay (Montevi<strong>de</strong>o) 1996 N. Macedo C. Carmona<br />
XVIII Chili (Santiago) 1997 R. Guarda R. Cabrera<br />
XIX Paraguay (Asunción) 1998 V. Caligaris A. Guzmán<br />
XX Argentine (Mar <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>ta) 2000 H. Cabrera P.D. Giovanna<br />
XXI Brésil (Foz <strong>de</strong> Iguazú) 2001 J.C. Empinotti J. Santamaría<br />
XXII Bolivie (Santa Cruz) 2002 J.M. Zamora M.E. González<br />
XXIII Pérou (Lima) 2004 Fernando Magill Gadwyn Sánchez<br />
XXIV Argentine (Buenos Aires) 2005 Edgardo Choue<strong>la</strong> Fernando Stengel<br />
XXV Chili (Santiago) 2006 Raúl Cabrera Félix Fich
Argentine Dr Pablo Viglolia (P)<br />
Dr Augusto Casalá (P)<br />
Dr León Jaimovich (P)<br />
Dr Alberto Woscoff (P)<br />
Dr Hugo Cabrera (P)<br />
Dr María Luisa Gómez (R)<br />
Dr Liliana Olivares (R)<br />
Bolivie Dr Juan Manuel Zamora (P)<br />
Dr Jorge Vargas (R)<br />
Dr María Isabel Mén<strong>de</strong>z (R)<br />
Brésil Dr Rubem David Azu<strong>la</strong>y (P)<br />
Dr Sebastián Sampaio (P)<br />
Dr Evandro Rivitti (P)<br />
Dr Cesar Bernardi (P)<br />
Dr Julio Cesar Empinotti (P)<br />
Dr Joao Roberto Antonio (R)<br />
Dr José Antonio Sánchez (R)<br />
Colombie Dr Bernardo Huyke (R)<br />
Dr Luis Hernando Moreno (R)<br />
Chili Dr Juan Honeyman (P)<br />
Dr Rubén Guarda (P)<br />
Dr María Isabel Herane (R)<br />
Dr Pi<strong>la</strong>r Valdés (R)<br />
Réunion annuelle <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains (RADLA)<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Amérique <strong>la</strong>tine; elle a lieu tous les ans dans différents sièges <strong>de</strong>s divers<br />
pays qui <strong>la</strong> composent, pour l’échange scientifique, l’apprentissage et <strong>la</strong> confraternité<br />
<strong>de</strong> tous les <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Elle comprend un programme scientifique<br />
intensif d’une durée <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux jours, précédé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux jours <strong>de</strong> cours d’actualisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
spécialité.<br />
La RADLA est dirigée par un conseil <strong>de</strong> délégués démocratiquement élus par les assistants,<br />
et ses membres se divisent en <strong>de</strong>ux catégories : permanente et renouve<strong>la</strong>ble.<br />
Vingt-trois réunions ont été réalisées jusqu’à présent; celle <strong>de</strong> Lima, connut un grand<br />
succès, avec <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> 1 250 participants. En 2005, le siège était Buenos Aires, en 2006<br />
Santiago du Chili. D’après l’accord conclu au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière réunion du conseil <strong>de</strong>s délégués<br />
en juillet à Lima, il a été décidé à l’unanimité <strong>de</strong> ne pas réaliser <strong>la</strong> RADLA en 2007,<br />
en raison du congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie qui aura lieu en Argentine. ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1. Bopp C. Preámbulo histórico <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> RADLA: Programa <strong>de</strong> <strong>la</strong> 5ª<br />
RADLA. Buenos Aires, 3 al 6<br />
La RADLA. Délégués permanents et renouve<strong>la</strong>bles<br />
mayo <strong>de</strong> 1986.<br />
2. Burstein Z. Informe sobre <strong>la</strong><br />
participación peruana en <strong>la</strong><br />
1ª RADLA. Comunicación<br />
dirigida al Rector <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Universidad Nacional Mayor<br />
<strong>de</strong> San Marcos. Lima, 8 <strong>de</strong><br />
Équateur Dr José María Ol<strong>la</strong>gue (R)<br />
Dr Gonzalo Calero (R)<br />
Mexique Dr Patricia Mercadillo (R)<br />
Dr Gilberto Adame (R)<br />
Paraguay Dr Luz María Flores <strong>de</strong> Lacarruba (R)<br />
Dr Gracie<strong>la</strong> Gorostiaga (R)<br />
Pérou Dr Fernando Magill (P)<br />
Dr Francisco Bravo (R)<br />
Dr Manuel <strong>de</strong>l So<strong>la</strong>r (R)<br />
Uruguay Dr Raúl Vignale (P)<br />
Dr Probo Pereyra (P)<br />
Dr Néstor Macedo (P)<br />
Dr Daniel<strong>la</strong> Bravo (R)<br />
Dr Carlos Bazzano (R)<br />
Venezue<strong>la</strong> Dr Francisco Gonzáles (R)<br />
Dr Ro<strong>la</strong>ndo Hernán<strong>de</strong>z (R)<br />
Septembre 2005<br />
enero <strong>de</strong> 1974.<br />
3. Sampaio S. Historia <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
RADLA. ¿Cómo nació<br />
<strong>la</strong> RADLA? Programa<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> 21ª RADLA. Foz <strong>de</strong><br />
Iguazú, 5 al 8 <strong>de</strong> mayo<br />
<strong>de</strong> 2001.
DÉVELOPPEMENT DE<br />
LA DERMATOLOGIE<br />
PÉDIATRIQUE EN<br />
AMÉRIQUE LATINE<br />
EVELYNE HALPERT, RAMÓN RUIZ MALDONADO, HÉCTOR CÁCERES<br />
La <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique <strong>de</strong>vint une spécialité pendant <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du XX e<br />
siècle, même si auparavant plusieurs <strong>de</strong>rmatologues et pédiatres avaient déjà travaillé dans<br />
cette branche <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine. En octobre<br />
1972, les Drs Ramón Ruiz Maldonado et Lour<strong>de</strong>s Tamayo organisèrent le I er Symposium<br />
international <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique à Mexico D.F.; lors <strong>de</strong> ce symposium fut<br />
créée <strong>la</strong> Société internationale <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, donnant officiellement naissance<br />
à cette spécialité dans le mon<strong>de</strong> entier. Plusieurs spécialistes réputés y participèrent,<br />
tels Martín Bear (Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong>); Ferdinando Gianotti (Italie); Joan E. Hodgman, Coleman Jacobson,<br />
Guinther Kahn, Andrew M. Margileth et Lawrence M. Solomon (États-Unis); Edmundo<br />
J. Moynahan (Angleterre); Dagoberto O. Pierini (Argentine); Ramón Ruiz Maldonado<br />
(Mexique); Eva Torok (Hongrie); Kasuya Yamamoto (Japon).<br />
Depuis lors, dix congrès mondiaux furent réalisés, et différentes sociétés régionales<br />
s’imp<strong>la</strong>ntèrent aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Amérique Latine.<br />
En 1973, Ramón Ruiz Maldonado et Lour<strong>de</strong>s Tamayo créèrent et consolidèrent au<br />
Mexique une école <strong>de</strong> formation en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, où plus <strong>de</strong> quatre-vingt spécialistes<br />
d’Amérique Latine, d’Europe, <strong>de</strong>s États-Unis et d’autres pays obtinrent leur diplôme.<br />
La spécialisation, reconnue <strong>de</strong> façon officielle, a une durée <strong>de</strong> trois ans pour les<br />
mé<strong>de</strong>cins pédiatres et d’un an pour les <strong>de</strong>rmatologues déjà diplômés. Le Dr Dagoberto O.<br />
Pierini créa plus tard le programme <strong>de</strong> formation en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique en Argentine,<br />
où existent actuellement <strong>de</strong>ux écoles <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité dirigées respectivement par les<br />
Drs Margarita Larral<strong>de</strong> et Adrián Martín Pierini. Au Venezue<strong>la</strong>, un programme dirigé par<br />
Luis Alfredo González Aveledo fonctionna pendant plusieurs années. De nos jours, les Drs<br />
Magalis Herrera Navarro et Leopoldo Díaz-Landaeta dirigent un programme <strong>de</strong> spécialisation<br />
en <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique à l’hôpital <strong>de</strong>s spécialités pédiatriques <strong>de</strong> Maracaibo.<br />
L’avènement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique en tant que spécialité bien définie favorisa<br />
le progrès dans <strong>la</strong> recherche, le diagnostic, le traitement et l’épidémiologie <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies<br />
<strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong> l’enfance. Son développement permit <strong>de</strong>s améliorations notables dans<br />
les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong> physiologie néonatale, du diagnostic prénatal, <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong> <strong>la</strong> kératinisation<br />
et dans <strong>la</strong> connaissance et le traitement <strong>de</strong> pathologies telles que l’épi<strong>de</strong>rmolyse<br />
bulleuse, les tumeurs vascu<strong>la</strong>ires et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatite atopique, entre autres.<br />
451
EVELYNE HALPERT, RAMÓN RUIZ MALDONADO, HÉCTOR CÁCERES<br />
Au cours du VI e<br />
Congrès péruvien <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, qui eut lieu à Lima au mois <strong>de</strong> novembre<br />
1996, il fut décidé <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique<br />
(SLADP). Parmi ses fondateurs, <strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong> différents pays<br />
<strong>la</strong>tino-américains réputés tels que Ramón Ruiz Maldonado, du Mexique; Evelyne Halpert,<br />
<strong>de</strong> Colombie; Héctor Cáceres et Leonardo Sánchez, du Pérou; Luis Alfredo González<br />
Aveledo, du Venezue<strong>la</strong>; Margarita Larral<strong>de</strong>, d’Argentine; Susana Giraldi, du Brésil et<br />
Danny Suqui<strong>la</strong>ndia, d’Équateur. Le premier prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> SLADP fut Ramón Ruiz Maldonado<br />
et <strong>la</strong> constitution légale fut obtenue à Mexico à travers l’acte nº 64.954, livre<br />
1059 <strong>de</strong> l’année 1996.<br />
Le premier congrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique se<br />
réalisa dans <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Santa Fe <strong>de</strong> Bogotá, en Colombie, en octobre 1997, organisé par<br />
Evelyne Halpert. C’est alors que <strong>la</strong> première assemblée générale eut lieu, désignant <strong>la</strong><br />
première commission directive : prési<strong>de</strong>nt, Dr Ramón Ruiz Maldonado; vice-prési<strong>de</strong>nte,<br />
Dr Evelyne Halpert; secrétaire, Dr Caro<strong>la</strong> Durán; secrétaire d’action scientifique,<br />
Dr Margarita Larral<strong>de</strong>; secrétaire syndicale, Dr Héctor Cáceres Ríos; secrétaire <strong>de</strong><br />
presse et publicité, Dr Luis Alfredo González Aveledo.<br />
Le IIe Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique, organisé par Luis Alfredo<br />
González Aveledo, eut lieu du 14 au 17 juin 2000 à Caracas. Une nouvelle commission<br />
directive fut élue à ce moment-là, présidée par le Dr Evelyne Halpert.<br />
À l’occasion du IX e<br />
Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique réalisé à Cancun en<br />
octobre 2001, <strong>la</strong> SLADP organisa avec grand succès un cours préliminaire appelé « Du<br />
nouveau-né à l’adolescent », qui accueillit plusieurs lea<strong>de</strong>rs actuels <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique du continent.<br />
Le IIIe Congrès <strong>la</strong>tino-américain <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie pédiatrique s’effectua à Lima en mai<br />
2003, sous <strong>la</strong> prési<strong>de</strong>nce d’Héctor Cáceres. Cet événement, qui déploya un nouveau programme<br />
interactif, accueillit <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s spécialistes d’Amérique Latine et fut l’occasion<br />
du renouvellement <strong>de</strong> <strong>la</strong> commission directive et <strong>de</strong> l’élection du Dr Cáceres comme<br />
prési<strong>de</strong>nt.<br />
Actuellement <strong>la</strong> SLADP est composée <strong>de</strong> quinze pays avec leurs représentants permanents<br />
respectifs et adhère à <strong>la</strong> Ligue internationale <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>rmatologiques.<br />
Chaque groupe organisa dans son pays divers événements dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
pédiatrique.<br />
Pendant les <strong>de</strong>rnières années, <strong>la</strong> SLADP se développa significativement, constituant<br />
<strong>de</strong> nos jours une soli<strong>de</strong> institution qui regroupe plus <strong>de</strong> 200 associés. Elle soutient le développement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Amérique Latine. Des livres sur <strong>la</strong> spécialité furent<br />
publiés dans plusieurs pays du continent et certains <strong>de</strong>rmatologues pédiatres <strong>la</strong>tinoaméricains<br />
participèrent à l’édition d’importants ouvrages aux États-Unis et en Europe.<br />
La Revista <strong>de</strong> Dermatología Pediátrica Latinoamericana fut récemment créée sous l’impulsion<br />
du Dr Héctor Cáceres et <strong>de</strong> son groupe <strong>de</strong> travail : elle est publiée tous les quatre<br />
mois et une version électronique est accessible sur le site . ■<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
Ruiz Maldonado R. « Pediatric<br />
Dermatology:<br />
Accomplishments and<br />
challenges for the 21st<br />
Century ». Arch. Dermatol.<br />
2000; 136: 84.<br />
Ruiz Maldonado R. « Pediatric<br />
Dermatology in Mexico ».<br />
Septembre 2005<br />
Dans: Oranje A.P., Kunz B.<br />
Symposium on training<br />
<strong>de</strong>mands in Pediatric<br />
Dermatology 2001. Ped.<br />
Dermatol. 2002; 19: 166-<br />
168.
L’AVENIR DE LA<br />
DERMATOLOGIE EN<br />
AMÉRIQUE LATINE<br />
RAFAEL FALABELLA<br />
■ Le passé El pasado et y el futuro l’avenir<br />
Lorsqu’on se tourne vers le passé, on découvre souvent <strong>de</strong>s versions différentes d’un<br />
même fait historique; mais lorsqu’on regar<strong>de</strong> vers l’avenir, il est difficile d’anticiper ce<br />
qui va se produire, car l’<strong>Histoire</strong> modifie généralement son parcours selon les événements<br />
récents déterminant le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong> ses participants. À l’aube du XXI e<br />
siècle, il est cependant<br />
possible d’imaginer les faits futurs à partir <strong>de</strong> faits réels contemporains… une<br />
réalité que seuls ceux qui vivront dans les années à venir connaîtront.<br />
■ La société La société et et <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie dans <strong>la</strong> région dans <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> <strong>la</strong> région <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
L’Amérique <strong>la</strong>tine est une région importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète rassemb<strong>la</strong>nt près <strong>de</strong> 400<br />
millions d’habitants, tous héritiers <strong>de</strong>s cultures hispanique et portugaise. Pour diverses<br />
raisons historiques et socio-politiques, nos pays connaissent un état <strong>de</strong> développement<br />
qui varie à l’échelle régionale voire locale. Fort <strong>de</strong> ses racines sécu<strong>la</strong>ires analogues, le<br />
Latino-Américain est dépeint comme une personne au caractère informel, aux liens familiaux<br />
très forts et à l’esprit joyeux, doté d’une volonté in<strong>la</strong>ssable <strong>de</strong> travailler et <strong>de</strong> se<br />
surpasser.<br />
Notre avenir est lié à l’union <strong>de</strong>s pays d’Amérique <strong>la</strong>tine, et plus particulièrement au<br />
phénomène <strong>de</strong> mondialisation, dont le traité <strong>de</strong> libre commerce (TLC) qui se concrétise<br />
chaque jour un peu plus est un bon exemple 1 .<br />
De <strong>la</strong> même manière qu’il existe <strong>de</strong>s blocs socio-économiques très forts entre certains<br />
pays, notre région tendra inexorablement à s’harmoniser au fil du temps, entraînant<br />
d’importantes répercussions dans le domaine scientifique, y compris en<br />
<strong>de</strong>rmatologie. Le problème fondamental rési<strong>de</strong>ra alors dans notre capacité à assumer<br />
ce défi. D’aucuns affirment qu’actuellement <strong>la</strong> région n’est pas suffisamment prête pour<br />
pouvoir concurrencer le mon<strong>de</strong> développé, car les pays qui l’intègrent ont déjà réglé<br />
leurs problèmes <strong>de</strong> base tandis qu’à l’inverse, nombre <strong>de</strong> nos pays commencent à peine<br />
à entreprendre leur développement. Nous risquons par là <strong>de</strong> connaître les ravages<br />
d’une compétitivité accrue potentiellement génératrice <strong>de</strong> chômage : une pauvreté majeure,<br />
<strong>de</strong>s coûts plus élevés dans le secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé et <strong>de</strong>s restrictions d’accès aux<br />
453
RAFAEL FALABELLA<br />
soins dispensés par les spécialistes ou aux médicaments mo<strong>de</strong>rnes en raison <strong>de</strong> leur coût<br />
excessif, comme nous en faisons déjà l’expérience. Ainsi nous savons qu’une seule dose du<br />
traitement du psoriasis avec <strong>de</strong>s médicaments conçus à partir <strong>de</strong> techniques biomolécu<strong>la</strong>ires<br />
2 peut coûter <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux à quatre fois le sa<strong>la</strong>ire d’un ouvrier (parfois plus). Par ailleurs,<br />
on insiste sur <strong>la</strong> propriété intellectuelle <strong>de</strong>s brevets <strong>de</strong>s nouveaux médicaments applicables<br />
dans les pays qui signeront les traités <strong>de</strong> libre commerce, mais les habitants <strong>de</strong> ces<br />
pays ne peuvent même pas y avoir accès en raison <strong>de</strong> leur coût. Le développement <strong>de</strong>s<br />
traitements à base d’herbes et <strong>de</strong> <strong>la</strong> phytothérapie, fréquemment utilisés comme compléments<br />
ou substituts à <strong>la</strong> nouvelle génération <strong>de</strong>s thérapies <strong>de</strong>rmatologiques sophistiquées<br />
3 , dépendra <strong>de</strong> l’accès du public à ces médicaments; actuellement, le public ne peut<br />
pas les obtenir car bien souvent ils ne sont pas remboursés par les services <strong>de</strong> santé.<br />
■ Un Un mon<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne mo<strong>de</strong>rne relié plus relié que jamais plus par <strong>la</strong> que technologie jamais par <strong>la</strong> technologie<br />
Le développement <strong>de</strong> nouveaux systèmes <strong>de</strong> communication, l’informatique et <strong>la</strong><br />
transmission rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> données ren<strong>de</strong>nt possibles les visioconférences; leur utilisation<br />
sera courante dans un futur proche, mais bien que le système ait fait ses preuves, son<br />
coût remet actuellement en question ses bénéfices 4 . Nonobstant, on ne peut que reconnaître<br />
les autres avantages tels que <strong>la</strong> diminution <strong>de</strong>s patients référés, <strong>la</strong> satisfaction du<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et l’augmentation <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins généralistes qui y participent<br />
5 . À l’avenir, les grands centres <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>vront répondre aux besoins <strong>de</strong>s<br />
villes plus petites et <strong>de</strong> certains centres ruraux. Il sera alors possible <strong>de</strong> visualiser <strong>de</strong>s lésions<br />
à plusieurs kilomètres <strong>de</strong> distance, <strong>de</strong> soumettre les conduites à tenir, <strong>de</strong> prescrire<br />
<strong>de</strong>s examens complémentaires et <strong>de</strong> suggérer <strong>de</strong>s traitements; enfin, les patients pourront<br />
bénéficier <strong>de</strong> l’opinion d’experts qu’ils ne peuvent quasiment jamais côtoyer, économisant<br />
du temps et <strong>de</strong> l’argent 6 . Il sera également possible <strong>de</strong> recruter <strong>de</strong>s patients qui<br />
col<strong>la</strong>boreront volontairement aux projets <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>rmatologique, notamment en<br />
<strong>de</strong>rmatoses rares.<br />
■ L’éducation <strong>de</strong>rmatologique et les écoles <strong>de</strong> spécialisation et les écoles <strong>de</strong> spécialisation<br />
454<br />
La technologie <strong>de</strong>s communications sera <strong>de</strong> plus en plus présente dans l’éducation<br />
médicale et l’interaction croissante entre les pays imposera, <strong>de</strong> façon à normaliser le<br />
curriculum <strong>de</strong>s programmes, <strong>la</strong> standardisation <strong>de</strong>s programmes éducatifs d’étu<strong>de</strong>s supérieures<br />
et <strong>de</strong> spécialisation p<strong>la</strong>cés sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s organismes d’éducation à caractère<br />
international. Grâce à cette interaction grandissante entre les habitants d’Amérique <strong>la</strong>tine<br />
et ceux <strong>de</strong>s autres pays, le jour viendra où existeront <strong>de</strong>s examens visant à harmoniser<br />
les diplômes pour qu’ils soient va<strong>la</strong>bles, sinon dans tous les pays <strong>la</strong>tino-américains,<br />
au moins dans <strong>la</strong> plupart d’entre eux, engendrant ainsi un niveau <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s soins<br />
<strong>de</strong>rmatologiques comparable sur tout le continent américain.<br />
Cette interaction entraînera par conséquent <strong>de</strong>s stages plus fréquents <strong>de</strong> professeurs<br />
venus d’ailleurs, ce qui stimulera fortement l’enseignement et <strong>la</strong> recherche <strong>de</strong>rmatologiques,<br />
ainsi que <strong>la</strong> création <strong>de</strong> doctorats en sciences basiques, rendant possible <strong>la</strong> formation<br />
en ressources humaines plus polyvalentes et propices à <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong>s<br />
problèmes d’Amérique <strong>la</strong>tine. L’accès du patient qui consulte en <strong>de</strong>rmatologie au mé<strong>de</strong>cin<br />
spécialiste sera très probablement plus rapi<strong>de</strong> et opportun, réduisant <strong>la</strong> morbidité et<br />
le taux <strong>de</strong> mortalité. Actuellement, selon le modèle <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>ns généraux <strong>de</strong> santé, les interconsultations<br />
sont rejetées sans justification aucune ou retardées, entraînant par<br />
conséquent une hausse du tarif <strong>de</strong>s services médicaux et <strong>de</strong>s complications dues à <strong>de</strong>s<br />
problèmes <strong>de</strong> diagnostic ou <strong>de</strong> thérapie.
La conception <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong>rmatologiques <strong>de</strong>vra maximiser, pour les étu<strong>de</strong>s supérieures,<br />
les ressources disponibles <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> spécialisation (infrastructure administrative,<br />
d’enseignement, <strong>de</strong> recherche et d’assistance). Les cursus <strong>de</strong>vront tenir<br />
compte <strong>de</strong>s problèmes cliniques les plus importants que l’étudiant rencontrera au cours <strong>de</strong><br />
son activité quotidienne, car les contenus <strong>de</strong>s cours précé<strong>de</strong>nts facilitaient l’apprentissage<br />
par cœur mais pas <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong>s problèmes auxquels le mé<strong>de</strong>cin sera confronté 7 .<br />
Avec les nouvelles technologies, les infections et les parasitoses cutanées seront définitivement<br />
traitées à l’avenir grâce à une prévention adéquate comprenant <strong>de</strong> nouveaux<br />
vaccins et médicaments. Il faudra prévoir également l’augmentation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatoses<br />
chez le patient gériatrique en raison <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> longévité humaine et <strong>de</strong><br />
l’accroissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s plus <strong>de</strong> 80 ans 8 .<br />
La <strong>de</strong>rmatologie en Amérique <strong>la</strong>tine<br />
L’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Amérique Latine<br />
■ La <strong>de</strong>rmatologie en Amérique <strong>la</strong>tine<br />
La prolifération d’écoles <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie entraînera à moyen terme une offre excessive<br />
<strong>de</strong> spécialistes — ce qui arrive déjà dans certains pays —, avec <strong>de</strong>s conséquences diverses<br />
: d’une part, il faudrait fixer <strong>de</strong>s normes pour restreindre <strong>la</strong> formation <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>rmatologues; d’autre part, les soins <strong>de</strong>rmatologiques seront proposés à davantage <strong>de</strong><br />
personnes. Cependant, on observe dans <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s pays une tendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s<br />
spécialistes à se concentrer dans les grands centres urbains, provoquant une répartition<br />
<strong>de</strong>s soins disproportionnée qu’il faudra résoudre 9 .<br />
De même, les technologies propres aux pays développés feront également partie du<br />
quotidien <strong>de</strong>s pays <strong>la</strong>tino-américains, et ce phénomène ira <strong>de</strong> pair avec le développement<br />
socio-économique. Nous ne pouvons pas ignorer l’influence future <strong>de</strong>s mouvements politiques<br />
ni les conséquences inhérentes à leur souhait <strong>de</strong> procurer davantage <strong>de</strong> bienêtre<br />
et d’améliorer les services sanitaires pour l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Cependant,<br />
cette préoccupation <strong>de</strong> pourvoir un niveau <strong>de</strong> salubrité approprié pourrait constituer<br />
uniquement une bonne affaire <strong>de</strong> santé.<br />
■ Les Les risques affrontés rencontrés par <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie par <strong>la</strong> en <strong>de</strong>rmatologie Amérique <strong>la</strong>tine en Amérique <strong>la</strong>tine<br />
Les traités <strong>de</strong> libre commerce modifieront substantiellement les revenus <strong>de</strong>s Latino-<br />
Américains, en fonction <strong>de</strong> leur apport pour rendre viable l’économie <strong>de</strong> leur pays. Si <strong>la</strong><br />
région travaille tel un bloc économique soli<strong>de</strong>, avec <strong>de</strong>s idées cohérentes et <strong>de</strong>s actions<br />
conjointes, sans chercher à annihiler ses voisins par <strong>la</strong> concurrence, les alliances vont se<br />
consoli<strong>de</strong>r pour fortifier nos économies, créer plus d’emplois et améliorer <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s<br />
biens <strong>de</strong> consommation qui élèveront le niveau <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s habitants <strong>de</strong> nos territoires<br />
communs. Par contre, si le défi est relevé <strong>de</strong> façon désordonnée et si <strong>de</strong>s avantages excessifs<br />
sont offerts en échange <strong>de</strong> quelques bénéfices moindres, nous annulerons toute<br />
possibilité <strong>de</strong> développement harmonieux qui profiterait aux parties en question.<br />
La prestation <strong>de</strong> services fait partie <strong>de</strong> ce contexte; les pays fortement industrialisés<br />
sont plus à l’aise dans ce domaine car ils en ont une connaissance approfondie et ils gèrent<br />
<strong>de</strong>s volumes importants, adaptant les coûts d’opération <strong>de</strong> manière à ce qu’ils soient<br />
très compétitifs. Ce qui arriva avec <strong>la</strong> technologie <strong>de</strong>s communications pourrait très bien<br />
se reproduire avec les technologies <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé : les plus puissants et les plus expérimentés<br />
dans le commerce international du secteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé pourraient y voir une bonne affaire.<br />
La <strong>de</strong>rmatologie fait aussi partie <strong>de</strong> ce groupe. Il est possible que <strong>de</strong>s entreprises<br />
multinationales étrangères gèrent notre santé en nous imposant leurs conditions.<br />
La prolifération <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues qui se consacrent à <strong>la</strong> cosmétique et à l’esthétique<br />
cutanées dans notre pays représente un autre risque. Le manque d’opportunités dans le<br />
455
RAFAEL FALABELLA<br />
domaine médical, l’« excès » <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues — dû à l’incapacité pour nos économies<br />
à les absorber —, ainsi que d’autres facteurs non moins importants, font que ceux qui<br />
maîtrisent parfaitement les techniques cosmétiques cherchent à travailler dans ces disciplines<br />
très attirantes; <strong>de</strong> nos jours déjà, un grand nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues s’occupent<br />
<strong>de</strong>s services d’embellissement corporel, facial et capil<strong>la</strong>ire. Ceci nous oblige à penser<br />
qu’il faudra présenter un panorama <strong>de</strong> cette situation au cours <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> manière à<br />
atteindre un équilibre raisonnable entre <strong>la</strong> pratique cosmétologique et esthétique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues et <strong>la</strong> pratique <strong>de</strong>rmatologique comme science fondamentale<br />
dans leur activité quotidienne.<br />
Dans le cas contraire, notre spécialité <strong>de</strong>viendra quelque chose d’insignifiant et <strong>de</strong> superficiel,<br />
comme une activité non médicale, sans importance, cédant peu à peu son<br />
champ d’action à d’autres spécialités; elle risquerait alors <strong>de</strong> disparaître complètement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> scène médicale, même si elle représente actuellement une science fondamentale<br />
dont les découvertes sont incomparables face à celles <strong>de</strong>s autres spécialités 10 : l’utilisation<br />
d’anticorps humanisés fabriqués par manipu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire pour<br />
le traitement du psoriasis 11 par exemple ou bien encore <strong>la</strong> greffe <strong>de</strong> peau cultivée dans<br />
<strong>la</strong> thérapie <strong>de</strong> l’épi<strong>de</strong>rmolyse bulleuse 12 .<br />
Au cours <strong>de</strong> ces vingt <strong>de</strong>rnières années, nous avons assisté au développement remarquable<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie <strong>de</strong>rmatologique, ce qui engendra quelques controverses sur<br />
notre rôle <strong>de</strong> chirurgiens <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau. Tandis que certains croient que notre spécialité est<br />
à caractère médical, les patients cherchent les services chirurgicaux du <strong>de</strong>rmatologue<br />
avec <strong>la</strong> conviction que ce spécialiste connaît parfaitement le tégument et qu’il accomplira<br />
un remarquable travail chirurgical.<br />
Sans vouloir polémiquer inutilement, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie, c’est un fait, est l’une <strong>de</strong>s spécialités<br />
médico-chirurgicales enseignées dans tous les services <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie, avec <strong>de</strong>s<br />
différences selon les écoles. L’avenir <strong>de</strong> cette discipline dépendra du <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> technicisation<br />
qu’on voudra lui accor<strong>de</strong>r, mais elle <strong>de</strong>vra intégrer dans son cursus <strong>de</strong>s techniques<br />
mo<strong>de</strong>rnes <strong>de</strong> biologie molécu<strong>la</strong>ire permettant <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> thérapies médico-chirurgicales<br />
pour le traitement <strong>de</strong> diverses <strong>de</strong>rmatoses; nous pouvons anticiper ainsi l’utilisation<br />
<strong>de</strong> peau autologue cultivée avec toutes ses composantes pour le traitement <strong>de</strong>s<br />
cicatrices causées par <strong>de</strong>s brûlures, ou bien pour <strong>la</strong> correction <strong>de</strong>s nævi congénitaux pigmentés<br />
géants, en remp<strong>la</strong>çant les zones <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau affectée par une peau conçue par <strong>de</strong>s<br />
experts et obtenue au moyen <strong>de</strong> cultures in vitro.<br />
■ La recherche, le moteur du développement.<br />
Son rôle dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
456<br />
La recherche, le moteur du développement. Son rôle dans <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
Dans un mon<strong>de</strong> technologiquement plus développé, <strong>la</strong> recherche a subi <strong>de</strong>s changements<br />
radicaux au cours <strong>de</strong> ces cinquante <strong>de</strong>rnières années : le <strong>de</strong>rmatologue est <strong>de</strong>venu<br />
un mé<strong>de</strong>cin à temps complet dans les sciences <strong>de</strong> base; les petits <strong>la</strong>boratoires sont<br />
<strong>de</strong>venus <strong>de</strong> grands <strong>la</strong>boratoires <strong>de</strong> recherche; on accor<strong>de</strong> une importance à <strong>la</strong> compréhension<br />
<strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> base <strong>de</strong> <strong>la</strong> peau normale et affectée; finalement, on passa <strong>de</strong><br />
l’observation clinique, <strong>de</strong> l’histologie et l’immunologie aux cultures cellu<strong>la</strong>ires, à <strong>la</strong> biologie<br />
molécu<strong>la</strong>ire, à <strong>la</strong> génétique, à <strong>la</strong> génomique et à <strong>la</strong> protéomique 13 . En même temps,<br />
les nouvelles générations se désintéressent <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mé<strong>de</strong>cine académique,<br />
ce qui provoque une gran<strong>de</strong> préoccupation pour l’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> spécialité; on tente<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier les facteurs expliquant ce phénomène 14 . Une enquête menée parmi un<br />
groupe <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologues révé<strong>la</strong> un intérêt inhabituel pour <strong>la</strong> cosmétologie ainsi qu’un<br />
intérêt significatif <strong>de</strong>s plus jeunes pour les travaux pratiques plutôt qu’académiques 15 .<br />
Ces tendances ne sont pas tout à fait étrangères à l’Amérique <strong>la</strong>tine. L’éveil <strong>de</strong> nos<br />
pays améliorera peut-être les ressources <strong>de</strong>stinées à <strong>la</strong> recherche sur les problèmes les
plus importants, tels que <strong>la</strong> maîtrise totale <strong>de</strong> <strong>la</strong> lèpre ou l’éradication <strong>de</strong> <strong>la</strong> leishmaniose<br />
qui affecte d’innombrables patients. Nonobstant, <strong>la</strong> survie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en tant que<br />
spécialité dépendra également en bonne partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> programmes <strong>de</strong> maîtrise<br />
et <strong>de</strong> doctorat qui permettront <strong>de</strong> relier stratégiquement les écoles <strong>de</strong> spécialisation<br />
et les institutions consacrées à <strong>la</strong> recherche qui maîtrisent ces technologies et qui sont<br />
déjà une réalité dans plusieurs pays <strong>la</strong>tino-américains.<br />
Le XXI e siècle, une ère nouvelle d’opportunités<br />
L’avenir <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie en Amérique Latine<br />
■ Le XXI e<br />
siècle, une ère nouvelle d’opportunités<br />
Permettre aux équipes rotatives mises en p<strong>la</strong>ce par les centres médicaux <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
villes d’œuvrer dans les régions où les spécialistes font défaut (dans <strong>de</strong>s noyaux ruraux<br />
éloignés, pendant un, <strong>de</strong>ux ou plusieurs mois par exemple) pourrait offrir une opportunité<br />
d’emplois et contribuer à une meilleure répartition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rmatologues.<br />
L’amélioration <strong>de</strong> <strong>la</strong> technologie <strong>de</strong> l’information et les nouvelles générations d’ordinateurs<br />
entraînera, d’abord dans les grands centres hospitaliers puis dans les endroits<br />
plus éloignés, le remp<strong>la</strong>cement progressif <strong>de</strong> l’image <strong>de</strong> l’ancien <strong>de</strong>rmatologue avec sa<br />
loupe par les technologies d’examen et <strong>de</strong> diagnostic mo<strong>de</strong>rnes 16 . La télé-<strong>de</strong>rmatologie<br />
sera l’un <strong>de</strong>s plus grands défis <strong>de</strong> l’avenir. La mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nouvelles technologies résoudra<br />
les difficultés du coût excessif actuel, au point qu’il sera plus économique <strong>de</strong> se<br />
servir <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> <strong>la</strong> télé-vidéo plutôt que <strong>de</strong> parcourir <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s distances pour obtenir<br />
le même service <strong>de</strong> consultation <strong>de</strong>rmatologique. Cependant, il est évi<strong>de</strong>nt que le<br />
succès <strong>de</strong> ces programmes dépendra du coût et du montage <strong>de</strong>s systèmes, <strong>de</strong> <strong>la</strong> disponibilité<br />
du <strong>de</strong>rmatologue, <strong>de</strong> <strong>la</strong> facilité d’accès à Internet, <strong>de</strong>s facilités administratives et<br />
<strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong> règlement ou <strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong>s spécialistes pour leur travail 17 .<br />
Par ailleurs, les progrès en systématisation rendront nécessaire l’amélioration <strong>de</strong>s dénominations<br />
<strong>de</strong>s ma<strong>la</strong>dies cutanées 18 ; l’Amérique <strong>la</strong>tine doit se préparer à col<strong>la</strong>borer à<br />
ce dictionnaire <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong>rmatologiques et <strong>de</strong>s diagnostics, pour le maintien <strong>de</strong> sa<br />
présence historique sur <strong>la</strong> scène internationale.<br />
Des étu<strong>de</strong>s préa<strong>la</strong>bles ont prouvé que les étudiants qui choisissent le roulement sélectif<br />
en <strong>de</strong>rmatologie acquéraient <strong>de</strong> manière significative les savoirs, les habiletés et <strong>la</strong><br />
capacité à conserver pendant plusieurs mois les connaissances acquises 19 . C’est là une<br />
belle opportunité pour les nouveaux mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’avenir qui, du fait d’avoir choisi ce<br />
roulement sélectif, ont déjà une prédisposition pour les connaissances <strong>de</strong>rmatologiques<br />
additionnelles; ceci suggère qu’il faut stimuler cette méthodologie pour améliorer l’apprentissage.<br />
Il sera également important <strong>de</strong> renforcer l’aspect académique <strong>de</strong>s spécialisations<br />
en <strong>de</strong>rmatologie par <strong>la</strong> création <strong>de</strong> sous-spécialités proposant <strong>de</strong>s alternatives<br />
différentes aux futurs <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains, en accord avec les besoins académiques<br />
et sociaux <strong>de</strong> chaque pays. ■<br />
Octobre 2004<br />
457
RAFAEL FALABELLA<br />
■ Références<br />
bibliographiques<br />
1.Silversi<strong>de</strong>s A. New free tra<strong>de</strong><br />
agreement could make<br />
generic drugs less accessible<br />
in the Americas. CMAJ. 2004;<br />
170: 935.<br />
2. Ga<strong>de</strong> J.N. « Clinical update on<br />
alefacept: consi<strong>de</strong>ration for<br />
use in patients with<br />
psoriasis ». J. Manag. Care<br />
Pharm. 2004; 10: S33-7.<br />
3. Dattner A.M. « From medical<br />
hierbalism to phytotherapy in<br />
<strong>de</strong>rmatology: back to the<br />
future ». Dermatol. Ther.<br />
2003; 16: 106-13.<br />
4. Whited J.D. « Tele<strong>de</strong>rmatology.<br />
Current status and future<br />
directions ». Am. J. Clin.<br />
Dermatol. 2001; 2: 59-64.<br />
5. Eedy D.J., Wootton R.<br />
« Tele<strong>de</strong>rmatology: a<br />
review ». Br. J. Dermatol.<br />
2001; 144: 697-707.<br />
6. Duker I., Eisner P. Dermatology<br />
in telemedicine. Possibilities<br />
and limits. Hautarzt. 2002;<br />
53: 11-7.<br />
7. Burge S.M. « Curriculum<br />
p<strong>la</strong>nning in <strong>de</strong>rmatology ».<br />
Clin. Exp. Dermatol. 2004; 29:<br />
100-4.<br />
8. Smith E.S., Fleischer Jr A.B.,<br />
Feldman S.R. « Demographics<br />
and skin disease ». Clin.<br />
Geriatr. Med. 2001; 17: 631-<br />
41.<br />
9. Resnek Jr J. « Too few or too<br />
many <strong>de</strong>rmatologists?<br />
Difficulties in assessing<br />
optimal working size ». Arch.<br />
Dermatol. 2001; 137: 1303-7.<br />
10. K<strong>la</strong>us W. « Quo vadis<br />
<strong>de</strong>rmatology: A scenario for<br />
the future ». J. Am. Acad.<br />
Dermatol. 2003; 48: 605-8.<br />
11. Ga<strong>de</strong> J.N. « Clinical update on<br />
alefacept: consi<strong>de</strong>ration for<br />
use in patients with<br />
psoriasis ». J. Manag. Care<br />
Pharm. 2004; 10: S33-7.<br />
12. Fivenson D.P., Scherschun L.,<br />
Choucair M., et al. « Graftskin<br />
therapy in epi<strong>de</strong>rmolysis<br />
bullosa ». J. Am. Acad.<br />
Dermatol. 2003; 48: 886-92.<br />
13. Moshell A.N. « The changing<br />
face of cutaneous biology as<br />
seen from the National<br />
Institutes of Health ». J.<br />
Investig. Dermatol. Symp.<br />
Proc. 2002; 7: 4-5.<br />
14. Rubenstein D.S., B<strong>la</strong>uvelt A.,<br />
Chen S.C., Darling T.N. « The<br />
future of aca<strong>de</strong>mic<br />
<strong>de</strong>rmatology in the United<br />
States: report on the resi<strong>de</strong>nt<br />
retreat for future physicianscientists.<br />
2001 Jun 15-17 ».<br />
J. Am. Acad. Dermatol. 2002;<br />
47: 300-3.<br />
15. Marcoux D., Gratton D. « The<br />
changing face of Canadian<br />
Dermatology ». J. Cutan. Med.<br />
Surg. 2002; 6: 430-3.<br />
16. Dill S.W., Digiovanna J.J. «<br />
Changing paradigms in<br />
Dermatology: information<br />
technology ». Clin. Dermatol.<br />
2003; 21: 375-82.<br />
17. Oakley A., Ra<strong>de</strong>maker M.,<br />
Duffill M. « Tele<strong>de</strong>rmatology<br />
in the Waikato region of New<br />
Zea<strong>la</strong>nd ». J. Telemed. Telecare.<br />
2001; 7 Suppl. 2: 59-61.<br />
18. DeVries D.T., Papier A., Byrnes<br />
J., Goldsmith L.A. « Medical<br />
and Dermatology dictionaries:<br />
an examination of unstructured<br />
<strong>de</strong>finitions and proposals for<br />
the future ». J. Am. Acad.<br />
Dermatol. 2004; 50: 144-7.<br />
19. Enk C.D., Gilead L., Smolovich<br />
I., Cohen R. « Diagnostic<br />
performance and retention of<br />
acquired skills after elective<br />
<strong>de</strong>rmatology ». Int. J.<br />
Dermatol. 2003; 42: 812-5.
ÉPILOGUE<br />
LES ÉDITEURS<br />
Toute œuvre finie traduit le point culminant d’un effort. Néanmoins, en relisant tout<br />
ce que nos chers collègues, les <strong>de</strong>rmatologues <strong>la</strong>tino-américains, ont écrit; en retraçant<br />
<strong>la</strong> carrière que nos prédécesseurs auprès <strong>de</strong> leurs patients; en appréciant les figures extraordinaires<br />
que ce continent a apportées à <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie mondiale, nous ne pouvons<br />
qu’imaginer que ce<strong>la</strong> ne constitue pas <strong>la</strong> fin mais, comme nous le disions dans le prologue<br />
<strong>de</strong> ce livre, le début d’un chemin.<br />
L’unité <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> n’est pas une utopie mais un besoin, tel que Rafael Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong><br />
le dit en réfléchissant à l’avenir <strong>de</strong> notre <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />
Malgré nos différences, nous partageons d’innombrables caractères et coutumes, qui<br />
sont le fruit du métissage entre les aborigènes, les conquérants et les immigrants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
fin du XIX e<br />
siècle.<br />
Nous partageons aussi d’innombrables problèmes tels que le surpeuplement médical<br />
<strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes et le déficit <strong>de</strong>s périphéries, ainsi que les disparités <strong>de</strong>s possibilités<br />
d’accès aux spécialistes et aux moyens <strong>de</strong> diagnostic et <strong>de</strong> traitement parmi les secteurs<br />
sociaux d’un même pays et <strong>de</strong> ses sous-régions.<br />
Mais nous partageons également <strong>la</strong> capacité créatrice <strong>de</strong> nos <strong>de</strong>rmatologues, prouvée<br />
par leur adaptation au jour le jour aux déficiences <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> santé, et par leur développement<br />
individuel lorsqu’ils travaillent dans <strong>de</strong>s milieux plus favorables.<br />
Nous partageons, finalement, <strong>la</strong> même <strong>la</strong>ngue, ce qui rend plus facile notre communication<br />
et qui nous permet à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> nous différencier grâce à nos régionalismes.<br />
Ces éléments, ces habiletés et cette capacité à faire face ensemble à <strong>de</strong>s travaux tels<br />
que <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce livre et l’organisation <strong>de</strong> ce XXI e<br />
Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie<br />
nous amènent à entrevoir <strong>la</strong> concrétisation <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>.<br />
Il n’est question que <strong>de</strong> rassembler les volontés, <strong>de</strong> décliner les envies<br />
personnelles et d’affronter un nouveau projet pour les générations futures.<br />
Les jeunes <strong>de</strong>rmatologues <strong>de</strong> notre région vont bénéficier <strong>de</strong> cette réalisation, et notamment<br />
toute <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion dépendant <strong>de</strong> leurs connaissances et <strong>de</strong> leurs découvertes<br />
scientifiques.<br />
Nous ne voulons pas clore cette <strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> sans<br />
nous excuser auprès <strong>de</strong> toutes les personnes omises ou mentionnées avec erreurs. Les<br />
Sociétés <strong>de</strong>rmatologiques d’Amérique Latine, avec d’infimes exceptions, ont désigné les<br />
personnes qu’elles considèrent idéales afin qu’elles rédigent l’histoire <strong>de</strong> chaque pays. Le<br />
matériel envoyé a été vérifié par le service technique adéquat et, une fois corrigé, il fut<br />
459
LES ÉDITEURS<br />
renvoyé aux auteurs pour leur approbation finale. Nous, éditeurs, avons à <strong>la</strong> fois révisé<br />
tout le corpus afin d’éviter <strong>de</strong>s erreurs f<strong>la</strong>grantes, mais toute notre bonne volonté peut<br />
avoir <strong>la</strong>issé passer quelques défauts ou omissions : nous présentons nos excuses à nos<br />
lecteurs et nos collègues.<br />
Ensemble nous avons déjà commencé à parcourir le chemin. ■
A<br />
Aasen Campos, Imelda, 435<br />
Abad, Adis, 166, 167<br />
Abad, Jaime, 223<br />
Abascal, Horacio, 162, 168<br />
Abeliuk Raschokvan, Samuel, 186,<br />
189<br />
Abeliuk Sharager, Jorge, 189<br />
Abel<strong>la</strong>, Francisco, 243<br />
Aberastury, Maximiliano, 34, 46<br />
Abisaad, Luz Stel<strong>la</strong>, 148<br />
Abreu, Ana María, 133<br />
Abreu, Héctor, 418, 419, 420, 421,<br />
426, 427<br />
Abreu, Hilda, 185, 427<br />
Abreu Daniel, Alfredo, 7, 12, 157,<br />
163, 164, 166<br />
Abreu e Lima, 74<br />
Abu<strong>la</strong>fia, Jorge, 37, 40, 42, 44, 45,<br />
48, 49, 50, 68, 69, 70, 89, 128,<br />
134, 227, 306, 321, 336, 377,<br />
393, 417, 424, 444, 447.<br />
Acevedo Ballesteros, Jaime, 128, 140,<br />
154<br />
Acevedo Merino, Gustavo, 136<br />
Acioly Filho, José Wilson, 94<br />
Ackerman, Bernard, 147, 181, 227,<br />
287, 384<br />
Acosta, Rafael, 343<br />
Acosta, Raysa, 393<br />
Acosta, Samira, 141<br />
Acosta, Santos, 124<br />
Acosta Madiedo <strong>de</strong> Hart, Álvaro<br />
INDEX<br />
DES NOMS PROPRES<br />
Enrique, 130, 133, 135, 137, 142,<br />
145, 149, 153, 155<br />
Acurio, B. 350, 365<br />
Adame, Gilberto, 7, 13, 265, 275, 449<br />
A<strong>de</strong>odato, J., 76<br />
Agip Díaz, Hernán, 371<br />
Agu<strong>de</strong>lo Alzate, Libardo, 126, 139<br />
Agüero, Gottardo, 363<br />
Aguiar, Otávio Garcez <strong>de</strong>, 93<br />
Aguiar Pupo, João <strong>de</strong>, 81, 82, 88, 89,<br />
103, 113, 161, 443, 444<br />
Agui<strong>la</strong>r Díaz, Erasmo, 286, 288, 289,<br />
290<br />
Agui<strong>la</strong>r Pico, Rigoberto, 277<br />
Aguilera, Fernando, 441<br />
Aguilera, Sergio, 183<br />
Aguirre, Amelia, 305<br />
Aguirre (née Iturre), Lucía, 43<br />
Aires, Maria Araci Pontes, 94<br />
A<strong>la</strong>rcón, Carlos Julio, 433, 435, 436,<br />
438<br />
A<strong>la</strong>rcón, Rosario, 177<br />
A<strong>la</strong>rcón Casanueva, Raúl, 175, 177,<br />
180, 186, 189, 193<br />
Albines Bernal, Asterio, 371<br />
Albornoz, María Cecilia, 436<br />
Albornoz (née Bastardo), María, 436<br />
Alchorne, Alice Ave<strong>la</strong>r, 86, 105, 106<br />
Alchorne, Maurício Mota <strong>de</strong> Ave<strong>la</strong>r,<br />
86, 90, 105<br />
Alé, Selva, 418<br />
Alegría, Elmer, 340, 341<br />
Aleixo, Antonio, 88, 96, 97<br />
Aleixo, Josephino, 96, 97<br />
Alencar, Nehemías <strong>de</strong>, 95<br />
Alencar-Ponte, Danielle, 7, 12, 117,<br />
142, 143<br />
Alfau Cambiaso, Rafael, 393<br />
Alfonso, Santiago, 166<br />
Allevato, Miguel Ángel, 39, 44, 48,<br />
50, 307<br />
Almeida Neto, Estevão, 105<br />
Almeida, Fernando Augusto <strong>de</strong>, 90,<br />
106<br />
Almodóvar, Pablo I., 7, 14, 381, 384,<br />
385, 386<br />
Alonso (voir May)<br />
Alonso, Fausto, 104<br />
Alonso, Héctor Raúl, 420<br />
Alonso, Pedro Raúl, 416<br />
Alperovich, Ben Ami, 43<br />
Altuzarra Galindo, Edgar Ricardo,<br />
141, 154<br />
Alvarado, Jorge, 441<br />
Alvarado C., Alberto, 218<br />
Álvares, Rosicler Aíza, 95<br />
Álvarez, Domingo, 252<br />
Álvarez, Erick, 140<br />
Álvarez, Gregorio, 36<br />
Álvarez, Humberto, 347<br />
Alvarez, Leocadio, 426<br />
Álvarez Ortiz, María Luisa, 289<br />
Álvarez Sáinz <strong>de</strong> Aja, Enrique, 443<br />
Alvarez Sa<strong>la</strong>manca, Augusto, 181<br />
Álvarez Villegas, Danilo, 136<br />
Alvear, José, 218<br />
461
INDEX ONOMASTIQUE<br />
462<br />
Alves, Antônio José, 76<br />
Amante, Leonardo, 47<br />
Amat Loza, Ferdinando <strong>de</strong>, 374<br />
Amaya, Q., 69<br />
Ambrona, Mario, 47<br />
Ambrosetti, Félix, 36, 39<br />
Ambrosetti, Luis, 36<br />
Ambrosi O., Juan, 223<br />
Amdur, Alfred, 44<br />
Amini (née Koves), Eva, 435, 437, 438<br />
Amonzabel, R., 68<br />
Amor García, Francisco, 7, 15, 414,<br />
415, 416, 427<br />
Amoretti, Aquiles, 415, 416, 420, 421,<br />
423<br />
Anaya, Javier, 45<br />
Ancic Cortéz, Ximena, 178, 189, 193<br />
Anda, Griselda <strong>de</strong>, 64, 414, 418, 419,<br />
420, 421, 426<br />
Andino Vélez, José, 219<br />
Andra<strong>de</strong> Chaparro, Emiro, 141<br />
Andra<strong>de</strong>, Fernando Laynes <strong>de</strong>, 110<br />
Andreis, Mario, 183<br />
Andueza Pa<strong>la</strong>cios, Raimundo, 432<br />
Anguita, Timoleón, 183<br />
Angulo y Urrue<strong>la</strong>, Rafael, 243, 251,<br />
252<br />
Angulo, Ilse, 441<br />
Anselmi, Silvia, 60<br />
Ante, Antonio, 215<br />
Antonio, Carlos Alberto, 107<br />
Antônio, João Roberto, 105, 107, 449<br />
Antúnez, D., 351, 365<br />
Aparicio, Abraham, 125<br />
Apolo, Enrique, 423<br />
Aragão, Henrique <strong>de</strong> Beaurepaire, 79<br />
Aragão, Raimundo, 84<br />
Aragón, Alonso, 242<br />
Arana Iturri, Pablo, 325, 342, 369,<br />
373, 375<br />
Arana Zapatero, Guillermo, 319, 327,<br />
337, 340, 375<br />
Arana, Byron, 245<br />
Arango, Diego, 136<br />
Aranzazu, Nacarid, 436<br />
Araujo, María Herminia, 441<br />
Araújo, José Antônio Pereira da Silva,<br />
75, 76, 77, 78<br />
Araújo, Oscar da Silva, 89<br />
Araya, Enrique, 184<br />
Arce y Almanza, J., 34<br />
Arce, Julián, 348, 353, 355, 364, 369<br />
Arcia, Mariano, 199<br />
Arcos, 200, 208<br />
Arcuri, Pascual B., 43, 47<br />
Ardao, Héctor, 423<br />
Arel<strong>la</strong>no, Francisco, 321<br />
Arenas Ramírez, Jorge, 147<br />
Arenas, Roberto, 7, 13, 16, 64, 165,<br />
222, 265, 306, 307, 443, 444<br />
Arévalo Durán, Álvaro, 141, 153<br />
Arévalo Morales, Cornelio, 436, 438<br />
Arévalo (née Rodríguez), Homagdy,<br />
435, 436<br />
Argote Ruiz, Arturo C., 138<br />
Argüelles, Darío, 163, 168<br />
Argüello Martínez, Hugo, 285, 287<br />
Argüello Pitt, Luis, 40, 41, 47, 337<br />
Argüello, Ramón, 40, 41<br />
Arias, Otto, 200<br />
Arias Argudo, C<strong>la</strong>udio, 7, 13, 195,<br />
200, 202, 207, 210, 219, 220,<br />
221, 222, 223, 224<br />
Arias Gómez, 7, 265<br />
Arias Pare<strong>de</strong>s, Enrique, 371<br />
Ariza, Amín, 139<br />
Armach, Fernando Jacobo, 393<br />
Armenteros, José Alfonso, 161, 162,<br />
163, 168<br />
Armijo, Miguel, 221, 222, 444<br />
Aroca, Felipe, 200<br />
Arpini, Ricardo, 42<br />
Arroyave, Rafael, 184<br />
Arroyo, Alex, 187<br />
Arroyo Eraso, César Gregorio, 140<br />
Arruda, Lucía Helena, 107, 109<br />
Arrunátegui, Adriana, 129, 131, 133,<br />
148, 150<br />
Arteaga, Oscar, 343<br />
Arteta, Juan, 214<br />
Arvelo, José, 164<br />
Asri<strong>la</strong>nt, M., 37<br />
Assunção, João Batista Gontijo, 87,<br />
89, 97, 98<br />
Astore, Ignacio, 41<br />
Atuesta, Juan Jaime, 143, 150<br />
Auad, Anuar, 83, 89, 96<br />
Aufgang, Abraham, 37<br />
Aunón, Álvaro <strong>de</strong>, 123<br />
Ávalos Vega, Arnaldo, 282, 287<br />
Ávalos y Porres, Manuel <strong>de</strong>, 242, 257,<br />
258<br />
Ávi<strong>la</strong> Camacho, Mabel Yaneth, 135,<br />
140, 150<br />
Ávi<strong>la</strong> Chacín, César, 437<br />
Ávi<strong>la</strong> Del Carpio, Emma, 374<br />
Ávi<strong>la</strong>, Roque, 305<br />
Ayaipoma Nicolini, Aldo, 372<br />
Ayaipoma Vidalón, Marcial, 319, 325,<br />
327, 337, 369, 372, 375<br />
Ayora, Isidro, 209<br />
Azambuja, Roberto Doglia, 95<br />
Azcurra Valle, José, 371<br />
Azu<strong>la</strong>y, Rubem David, 75, 85, 86, 87,<br />
89, 90, 92, 100, 101, 102, 103,<br />
443, 444, 447, 448, 449<br />
B<br />
Baca, Eligio, 243<br />
Badiano, Juan, 269, 275<br />
Báez Giangreco, Atilio, 305<br />
Bakos, Lúcio, 87, 111<br />
Ba<strong>la</strong>guer Rosas, Manuel, 373<br />
Ba<strong>la</strong>guer, Pedro, 167<br />
Balcázar Romero, Luis Fernando, 136,<br />
143, 148<br />
Balda, Walter, 306<br />
Baliña, Luis M., 36, 39, 47<br />
Baliña, Pedro L., 11, 34, 35, 36, 46,<br />
56, 424, 443<br />
Ballesteros, Daniel, 46<br />
Balsa, Raúl E., 43, 50, 321<br />
Banca<strong>la</strong>ri, C., 34<br />
Ban<strong>de</strong>ira, Valdir, 89<br />
Baños, Julio Eduardo, 7, 13, 225, 228<br />
Baquerizo, Gloria, 374<br />
Barba Gómez, Julio, 274<br />
Barba Rubio, José, 444<br />
Barbon, Tânia Regina, 107<br />
Barman, Julio M., 41<br />
Barnés, Francisco, 383<br />
Barona, María Isabel, 133, 143, 148<br />
Baros, Ramón, 69<br />
Barranca, 351<br />
Barraviera, Sílvia Regina, 109<br />
Barreneche Mesa, Julio César, 127<br />
Barrera, Víctor, 218<br />
Barrera Arenales, Antonio, 7, 12, 117,<br />
135, 136, 138, 141, 142, 155<br />
Barreto, Enio Ribeiro Maynard, 93<br />
Barría Morales, Cristián, 185<br />
Barrientos, Eduardo, 226, 229<br />
Barroeta, Segundo, 436, 441
Barros, Cecy, 227<br />
Barroso Tobi<strong>la</strong>, César, 440<br />
Bartelle, Cláudio José, 111, 112<br />
Barton, Alberto, 319, 355, 356, 365<br />
Basombrío, Guillermo, 35, 36, 39, 41,<br />
47, 319, 375<br />
Bassewitz, Ernst von, 111<br />
Bastardo (voir Albornoz)<br />
Bastos, Antonio Francisco, 109<br />
Bastos Filho, Antonio, 109<br />
Bastos, Manuel Ferreira dos Santos,<br />
94<br />
Batisttini, Telémaco, 347<br />
Battistini (voir Brun)<br />
Battistini, Francisco, 441<br />
Baudouin C., 54, 57<br />
Bay (voir García)<br />
Bayona Chambergo, Rosalía, 376<br />
Bayona (née Montoya), Luz Stel<strong>la</strong>,<br />
140, 154<br />
Bazzano, Carlos, 421, 449<br />
Beare, Martín, 278<br />
Beauperthuy, Louis Daniel, 431<br />
Bechelli, Luiz Marino, 84, 85, 88<br />
Bedoya, Julio, 343<br />
Beirana, Angélica, 279<br />
Belda, Walter, 109, 427<br />
Belin, Simón, 46<br />
Belli, Luis, 47, 69<br />
Belliboni, Norberto, 84, 108<br />
Belsito, Donald V., 222<br />
Beltrán Grados, Gustavo, 372, 377<br />
Benavi<strong>de</strong>s, Humberto, 343<br />
Benavi<strong>de</strong>s, María Isabel, 178<br />
Benavi<strong>de</strong>s, Rafael, 318<br />
Benavi<strong>de</strong>s Vázquez, Lázaro, 277, 278<br />
Bendaña Hurtado, Alfonso, 288<br />
Ben<strong>de</strong>ck, Gustavo, 185<br />
Benza, Francisco, 305<br />
Benzo, Ernesto, 391<br />
Benzo, Félix, 390<br />
Bergero, Adriana, 45<br />
Bermejo, Alcira, 47<br />
Bermejo y Roldán, Francisco, 317<br />
Bermeo M., Patricia, 223<br />
Bermeo Vivanco, Jorge, 200, 204<br />
Bermú<strong>de</strong>z, Andrés, 133<br />
Bermú<strong>de</strong>z, Victoriano, 161<br />
Bernardi, César Duílio Varejão, 90,<br />
112, 448, 449<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Bernhard, Armin, 111<br />
Berrio Muñoz, Joaquín Eliécer, 136<br />
Berrón Ruiz, Angélica, 279<br />
Bertoló, Soledad, 190<br />
Bessonart, 420<br />
Betancourt Osorio, Jaime, 127, 128,<br />
138, 139, 147, 150, 151, 154<br />
Biagini, Dante, 34<br />
Biagini, Roberto, 41, 43, 50<br />
Bianchi, Oscar, 45<br />
Biase, F. <strong>de</strong>, 34<br />
Bicudo Junior, João, 105<br />
Bigatti, A, 34<br />
Bingham, Hiram, 312<br />
Bitar Zapa, Rómulo, 141<br />
Bittar, Elías, 42, 193<br />
B<strong>la</strong>nco, Antonio, 419, 421, 423, 426<br />
B<strong>la</strong>si, E., 36<br />
B<strong>la</strong>ustein, Samuel, 46<br />
Bloch, Grete, 62, 64, 65<br />
Block, Susana, 44<br />
Blum, Edmundo, 200<br />
Boaknin, León, 42<br />
Bocanegra, Olga, 42<br />
Bod<strong>de</strong>n, Juan Antonio, 392<br />
Boente, María <strong>de</strong>l Carmen, 60<br />
Boeta, Leticia, 274<br />
Bogaert (née González), Luisa, 393,<br />
396<br />
Bogaert Díaz, Huberto, 390, 391, 393,<br />
394, 395, 396, 397<br />
Boggini, 424<br />
Bohórquez, Joseph Adalid, 242<br />
Bojana, Humberto, 440<br />
Bolte, Christel, 182<br />
Bomfard, Joel, 306<br />
Bonafina, Oscar, 36<br />
Bonamigo, Renan, 111<br />
Bonatto, Walmor, 111<br />
Bonifaz, Alejandro, 222<br />
Bonifazzi, Ernesto, 63<br />
Bonil<strong>la</strong> Espinoza, Julio, 338, 343, 344,<br />
370, 373, 378<br />
Bonnet, Francisco, 392<br />
Bopp, Clóvis, 84, 89, 90, 92, 111, 112,<br />
447, 449<br />
Borda, Julio Martín, 36, 42, 43, 48, 68,<br />
69, 89, 128, 227, 321, 417, 424<br />
Bor<strong>de</strong>s, Carlos, 423<br />
Bordón (née Pa<strong>la</strong>cios), Hermelinda,<br />
306<br />
Borelli, Dante, 435, 436<br />
Borges, Paulo Cezar, 96<br />
Borja, C., 69<br />
Bosq, Pablo, 424<br />
Botero, Fernando, 150<br />
Botrich, Harm, 36<br />
Bottene, Iza Maria, 106<br />
Bou, Alfredo L., 383<br />
Box, Pablo, 47<br />
Brache, Román, 392, 397<br />
Bracho Oña, Jorge, 203, 221<br />
Bran Quintana, Gerardo, 246, 248<br />
Brañas, Guillermo, 305<br />
Braseras, 424<br />
Braunstein, Samuel, 37<br />
Bravo, Daniel<strong>la</strong>, 449<br />
Bravo, Francisco, 269, 322, 338, 449<br />
Bravo, José Julián, 350<br />
Bravo, Raquel, 185<br />
Braz, Cláudia Valéria, 109<br />
Brianson, Jaime, 67, 68, 69<br />
Briceño Iragorry, Leopoldo, 438<br />
Briceño Maaz, Tulio, 436, 442<br />
Briceño (née Oliveros), Rosa, 436, 441<br />
Brieva Durán, Alberto, 178, 191<br />
Brito, Arival Cardoso <strong>de</strong>, 90, 94<br />
Brito, Thales <strong>de</strong>, 227<br />
Brito Foresti, José, 415, 416, 419,<br />
422, 423, 424, 425, 427<br />
Bruey, Silvina, 64<br />
Brun (née Battistini), Ana María, 441<br />
Bruning, Carmen, 184<br />
Brusco, Jorge, 44<br />
Bu<strong>de</strong>l, Analise Roskamp, 111<br />
Bueno, Cosme, 349<br />
Bulhões, Oscar <strong>de</strong>, 77<br />
Bulizani, Mônica, 106<br />
Bumaschny, P., 37<br />
Buño, Washington, 417, 428<br />
Burgos, César, 134, 138, 155<br />
Burnier, R., 423<br />
Burstein Alva, Zuño, 7, 14, 309, 319,<br />
320, 321, 322, 323, 331, 336,<br />
337, 338, 339, 340, 341, 342,<br />
343, 344, 345, 346, 347, 348,<br />
350, 352, 353, 354, 358, 359,<br />
363, 364, 365, 366, 375, 449<br />
C<br />
Cabada, Carlos <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 436<br />
Caballero, Alberto, 137<br />
463
INDEX ONOMASTIQUE<br />
464<br />
Caballero Garay, Virgilio, 305<br />
Cabello, Ismery, 436, 441<br />
Cabezas, Ana María, 176<br />
Cabieses, Fernando, 353, 379<br />
Cabo, Horacio, 40, 47, 49, 50, 448<br />
Cabrera, Hugo Néstor, 38, 39, 40, 50,<br />
222, 306, 448, 449<br />
Cabrera, Juan José, 288<br />
Cabrera, Marco A., 248<br />
Cabrera Moraga, Raúl, 176, 181, 183,<br />
187, 188, 189, 191, 192, 193,<br />
307, 448<br />
Cacciatore, Ernesto, 426<br />
Cáceres, Abraham, 351<br />
Cáceres, Camilo, 216<br />
Cáceres, Héctor, 7,16, 222, 306, 323,<br />
375, 376, 377, 452<br />
Cáceres Orozco, Sergio, 136, 141<br />
Ca<strong>de</strong>na (née Zuluaga), Ánge<strong>la</strong>, 134,<br />
138, 143, 148, 153<br />
Cádiz, Mamerto, 174, 177<br />
Caferri, María Isabel, 64<br />
Caino, Juan F., 44<br />
Ca<strong>la</strong>ndria, Liliana, 422<br />
Ca<strong>la</strong>trava, Domingo A., 437, 438<br />
Calb, Ignacio, 45<br />
Caldas Rodríguez, Antonio, 375<br />
Cal<strong>de</strong>rón, S., 70<br />
Calebotta, Adriana, 435<br />
Calero, Fernando, 384<br />
Calero Hidalgo, Gonzalo, 202, 204,<br />
205, 221, 449<br />
Caligaris, V., 448<br />
Calle Vélez, Gonzalo, 126, 133, 134,<br />
138, 139, 146<br />
Calles, Aquiles, 273<br />
Calvo, Jacqueline, 106<br />
Camacho, A<strong>la</strong>ín Alexan<strong>de</strong>r, 153, 154<br />
Camacho, Eleodoro, 325, 342<br />
Camacho, Francisco M., 140<br />
Camacho, Juan, 389<br />
Camacho Martínez, Francisco, 444<br />
Camacho Sánchez, Miguel, 140<br />
Camaño, O., 34<br />
Camejo (née Castel<strong>la</strong>nos), Omaira,<br />
435<br />
Campbell, G<strong>la</strong>dis, 95<br />
Campbell, Iphis, 90, 95, 115<br />
Campins, Humberto, 433, 441<br />
Campo, Amalia, 60<br />
Campo, Juan Carlos <strong>de</strong>l, 423<br />
Campo, Martha Helena, 139, 148<br />
Campo, Raúl <strong>de</strong>l, 423<br />
Campo Moreno, Rafael, 437, 438<br />
Campos, Ama<strong>de</strong>o, 41<br />
Campos, B<strong>la</strong>nca, 184, 185, 193<br />
Campos, Enio Candiota <strong>de</strong>, 111<br />
Campos, Miguel, 363<br />
Campos, Nelson <strong>de</strong> Souza, 113, 327,<br />
424<br />
Campos Carlés, Alejandro, 44, 60<br />
Campuzano, Ramiro, 208<br />
Canaán, José, 392<br />
Canabal, Ángel, 427<br />
Canabal, Joaquín, 423, 427<br />
Cana<strong>de</strong>ll (voir Puertas)<br />
Cancio, Carlos, 44<br />
Candiotti Vera, Jorge, 377<br />
Canese, Arquíme<strong>de</strong>s, 305<br />
Canessa, J. F., 423<br />
Cantídio, Walter Moura, 89<br />
Cantillo, Luz, 289<br />
Cantú (née Parra), Viviana, 42<br />
Capurro, E., 47<br />
Capurro, J., 34<br />
Carabelli, Susana, 47<br />
Carbajosa, Josefina, 274, 306<br />
Carboni, Eduardo, 41, 47<br />
Cardama, José E., 36, 39, 40, 45, 47,<br />
49, 448<br />
Car<strong>de</strong>mil, Alfredo, 177, 179, 193<br />
Cár<strong>de</strong>nas, Max, 376<br />
Cár<strong>de</strong>nas Becerra, Francisco, 446<br />
Cár<strong>de</strong>nas Jaramillo, Víctor, 127, 146<br />
Cár<strong>de</strong>nas Silva, Aurora, 371<br />
Cár<strong>de</strong>nas Uzquiano, Fernando, 7, 12,<br />
67, 68, 69, 71, 321<br />
Cardona, Héctor, 384<br />
Cardoso, Aldo <strong>de</strong> Sá, 95<br />
Cargniel, Carlos, 44<br />
Carmona, C., 448<br />
Caro, Apolinar, 67, 68<br />
Carpio, 271<br />
Carranza Amaya, Antonio, 226, 229<br />
Carranza Cordivio<strong>la</strong>, Emilio, 193, 373<br />
Carrasquil<strong>la</strong>, Juan <strong>de</strong> Dios, 125, 131,<br />
132, 155<br />
Carrera, José Luis, 35, 36, 39<br />
Carrera Cobos, Timoleón, 219<br />
Carril, Alberto, 45<br />
Carrillo, Alicia, 65<br />
Carrillo, Carlos, 347<br />
Carrillo, Francisco, 41, 424<br />
Carrión, Arturo L., 383, 385<br />
Carrión, Daniel Alci<strong>de</strong>s, 318, 319,<br />
324, 354, 355, 373<br />
Carrión, Jerónimo, 215<br />
Carrizales Ulloa, David, 338, 344,<br />
372, 373, 375, 377, 378<br />
Cartagena, N., 43<br />
Carvajal Hernán<strong>de</strong>z, Carlos, 205, 208,<br />
221<br />
Carvajal Huerta, Luis, 200, 205, 206<br />
Carvalho, Alberto, 36, 50<br />
Carvalho, Franco <strong>de</strong>, 89<br />
Carvalho, Leôncio <strong>de</strong>, 75<br />
Casafranca Lovatón, Adrián, 373<br />
Casalá, Augusto, 36, 40, 50, 448, 449<br />
Casanova, 420<br />
Casas, José G., 36, 45, 49, 50<br />
Casco, Ricardo, 47<br />
Casel<strong>la</strong> (voir Vi<strong>la</strong>boa)<br />
Cassinelli, Ana, 414, 418, 419<br />
Castanedo, Carlos, 162, 163, 164<br />
Castañeda, Gabriel José, 124, 125,<br />
131, 145<br />
Castañeda (née Prada), Stel<strong>la</strong>, 127,<br />
133, 139, 146, 154<br />
Castaño, Olga Lucía, 148<br />
Castel<strong>la</strong>no M., Gustavo, 137<br />
Castel<strong>la</strong>nos (voir Camejo)<br />
Castel<strong>la</strong>nos <strong>de</strong> La Roca, Álvaro, 246,<br />
247, 248<br />
Castel<strong>la</strong>nos Lorduy, Héctor José, 139,<br />
145, 154<br />
Castel<strong>la</strong>zzi, Zino, 392, 397<br />
Castelleto, Roberto, 43, 45<br />
Castellón, Manuel, 185, 186<br />
Castillo, Antonio, 65<br />
Castillo, E. B. <strong>de</strong>l, 127<br />
Castillo, Félix, 343<br />
Castillo, Fi<strong>de</strong>l <strong>de</strong>l, 216<br />
Castillo, Mariano, 247, 248, 252<br />
Castillo, Pau<strong>la</strong>, 182<br />
Castillo P<strong>la</strong>za, Armando, 434<br />
Castillo Porto, Carmelo, 128<br />
Castillo Riva<strong>de</strong>neyra, Wences<strong>la</strong>o, 319,<br />
320, 321, 333, 338, 343, 374,<br />
375, 378<br />
Castro, Abílio Martins <strong>de</strong>, 88<br />
Castro, Doralda, 148<br />
Castro, Lia Cândida Miranda <strong>de</strong>, 96
Castro, Nancy, 148<br />
Castro, Raymundo Martins, 84, 88,<br />
89, 105, 108, 110<br />
Castro Gómez, Julio, 376<br />
Castro (née Cortez), Glenda, 436<br />
Castro Mendivil, Luis, 343, 373<br />
Castro Ron, Gilberto, 136, 137, 228<br />
Catacora Cama, José, 323, 373<br />
Cateura, 421<br />
Cavalcanti, Jorge Duarte Quinte<strong>la</strong>, 95<br />
Cavallera, Elsy, 436<br />
Cavero Ortiz, Luis, 319, 373, 375<br />
Cavie<strong>de</strong>s López, Ernesto, 202, 208<br />
Ceballos, Gabriel, 136<br />
Celi, Alfinger, 140<br />
Cequeda, Lilian <strong>de</strong>, 441<br />
Cermeño, Julman, 436<br />
Cerqueira, Alexandre Evangelista <strong>de</strong><br />
Castro, 75, 76, 78, 93<br />
Cerruti, Humberto, 88, 103, 162<br />
Cervini, Andrea Bettina, 8, 11, 17<br />
Cestari, Tânia, 111<br />
Cevallos, Diego, 214<br />
Chagas, Carlos, 112<br />
Chaín, Fuad Muvdi, 138, 147<br />
Cha<strong>la</strong> Hidalgo, José Ignacio, 126, 145<br />
Chale<strong>la</strong> Mantil<strong>la</strong>, Juan Guillermo,<br />
138, 148, 149<br />
Champet, Arsenio, 247<br />
Chang, Anabel<strong>la</strong> <strong>de</strong>, 248, 254<br />
Chang, Patricia, 246, 248, 249<br />
Charris, Dubys, 139<br />
Chaul, Aiçar, 96<br />
Chaves, Bruno, 75, 77<br />
Chávez, A., 438<br />
Chávez, Carolina, 140<br />
Chávez, Guadalupe, 306<br />
Child, Raquel, 185<br />
Chiriboga Ardito, Luis, 204, 205, 221<br />
Chopitre, Emmanuel, 389, 397<br />
Choue<strong>la</strong>, Alfredo, 37, 49<br />
Choue<strong>la</strong>, Edgardo, 39, 45, 47, 448<br />
Cicero, Ricardo, 272<br />
Cifre Recinos, Edgar, 245<br />
Cifuentes Mutinelli, Mirtha, 173, 178,<br />
187, 189, 191, 192, 448<br />
Ciriani Anchorena, Bruno, 373<br />
Cisneros, Eudoro, 34<br />
Ciuffardi, Emilio, 324<br />
Civatte, Jean, 34, 126, 134, 175, 179,<br />
332, 393<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Civi<strong>la</strong>, Eduardo, 222, 420<br />
C<strong>la</strong>ra, Jorge, 44<br />
C<strong>la</strong>rk, José A., 160<br />
Close <strong>de</strong> León, Jorge, 243, 246, 247,<br />
248<br />
Cobar, Sergio Iván, 246, 248<br />
Coelho, Carlos Cley, 99<br />
Coello Uriguen, Mauricio, 8, 13, 195,<br />
207, 210, 220, 221, 222, 223,<br />
224<br />
Cofré, Julita, 182, 193<br />
Cofré, Pedro, 181, 182, 186, 189, 190<br />
Coiscou, Rafael, 392<br />
Coiscou Weber, Antonio, 391, 397<br />
Colichón A., 356<br />
Colmenares Porras, Pablo, 141<br />
Colón, Francisco, 384, 385<br />
Columbié, Yo<strong>la</strong>nda, 166<br />
Combariza, Epifanio, 124, 132<br />
Conant, Marcus, 191<br />
Condori Di Burga, Hugo, 374<br />
Consigli, Carlos, 41, 47, 50<br />
Consigli, Javier, 41<br />
Contardi, 424<br />
Conti, Alci<strong>de</strong>s, 43<br />
Conti, 419<br />
Contreras, Guillermo, 356, 363<br />
Contreras, Miguel, 321, 390<br />
Convit, Jacinto, 434, 435, 438, 439<br />
Cor<strong>de</strong>ro, Alejandro A., 35, 36, 38, 39,<br />
40, 48, 49, 50, 137, 306, 393,<br />
447<br />
Cor<strong>de</strong>ro, Alejandro (fils), 38, 46<br />
Cor<strong>de</strong>ro, Eduardo, 216<br />
Cor<strong>de</strong>ro A., Carlos N., 243, 248, 252,<br />
254<br />
Cor<strong>de</strong>ro C., Fernando A., 243, 244,<br />
247, 252<br />
Cor<strong>de</strong>ro Carrión, Luis, 200, 215, 217<br />
Cor<strong>de</strong>ro J., Leoncio, 202, 218, 219<br />
Cordisco, María Rosa, 60<br />
Cordivio<strong>la</strong>, 424<br />
Corea, Leonor, 282, 287<br />
Cornejo, Andrés, 43<br />
Cornejo Ubillus, J., 348, 350, 364<br />
Coronel, Manuel, 216<br />
Corral, Nicanor, 218<br />
Corrales Lugo, Hugo, 129, 140<br />
Corrales Medrano, Hugo, 129, 141<br />
Correa, Álvaro, 139, 140, 153<br />
Corrêa, Benedito, 106<br />
Corrêa, Cecilia Cassal, 112<br />
Correa, José, 383<br />
Correa Bustamante, Wilson, 201, 203,<br />
205, 207, 221<br />
Correa Galindo, Ernesto, 128, 134,<br />
139<br />
Correa Henao, Alfredo, 130, 134<br />
Correal, Alcibía<strong>de</strong>s, 137<br />
Correal Urrego, Gonzalo, 118, 132<br />
Corredor, Gustavo, 131<br />
Cortelezzi, Emilio, 34, 43<br />
Cortés, Alonso, 126, 133, 138, 139,<br />
144, 146, 444<br />
Cortés, Marta, 165<br />
Cortés Enciso, Carlos, 126, 137, 138,<br />
145<br />
Cortez (voir Castro)<br />
Corti, Rodolfo N., 36, 39<br />
Costa, Izelda, 96<br />
Costa, Oswaldo, 82, 88, 96, 97, 98<br />
Costa, Paulo Uchôa, 97<br />
Costa, Radamés, 421, 423, 426<br />
Costa Alfaro, Humberto, 374<br />
Costa Córdova, Horacio, 46<br />
Costa Jr., A. F. da, 89<br />
Costa Martins, José Eduardo, 90, 104,<br />
448<br />
Costa, Edgard Drohle da, 89<br />
Costané Decoud, 424<br />
Cotes, Margarita, 393<br />
Cotlear Dolberg, Aizic, 319, 330, 333,<br />
334, 335, 336, 337, 338, 339,<br />
340, 343, 344, 345, 364, 370,<br />
375<br />
Countar, Clement, 370<br />
Coutts, 424<br />
Covelli Mora, C<strong>la</strong>udia Marce<strong>la</strong>, 133,<br />
135, 137, 148<br />
Covo, Germán Enrique, 140<br />
Covo Segrera, Luis Miguel, 140, 154<br />
Cravioto, Joaquín, 278<br />
Crespi, Héctor G., 45, 49, 50<br />
Crespo, Emiliano J., 217<br />
Cox Cardoso, Alberto Eduardo, 90, 95<br />
Cruz, Alma, 385<br />
Cruz, Ana Cecilia, 392, 393<br />
Cruz, Martín <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 269<br />
Cruz, Oswaldo, 78, 79<br />
Cruz Argumedo, Fernando Adolfo,<br />
228<br />
Cuadra, 356<br />
Cuba Caparó, Alberto, 370<br />
465
INDEX ONOMASTIQUE<br />
466<br />
Cucé, Luiz Carlos, 89, 104, 105, 109<br />
Cuervo, Ángel, 423<br />
Cuervo Márquez, Luis, 145<br />
Cueto, Jorge, 43<br />
Cueto, Jorge (fils), 45<br />
Cueva, Carlos, 218<br />
Cueva Vallejo, Agustín, 215, 216, 217<br />
Cunha, Paulo Rowilson, 8, 12, 73, 91,<br />
92, 106, 107, 113<br />
Cunha, Pedro da, 101<br />
Cuomo, Gracie<strong>la</strong>, 46<br />
Curban, Guilherme V., 84, 105<br />
Curia, Luis, 36<br />
Cusanelli, Ricardo, 44<br />
Cusmanich, Rubén, 427<br />
D<br />
D’Alessandro, Miguel Ángel, 163<br />
D’Angelo, José María Roque, 43<br />
Dahl, Mark, 181, 191<br />
Daiber, Alberto, 183<br />
Damazio, Virgílio Clímaco, 77<br />
Danies, Josefina, 136, 141, 147<br />
Darier, Jean, 34, 56, 175, 179, 181<br />
Dávalos, José M., 317<br />
Dávalos y Peralta, José, 304<br />
David, Carlos, 248<br />
De Carli, Eduardo, 46<br />
De los Ríos, Eudoro H., 43, 64<br />
De Simoni, 74<br />
DeCastro, Patricia, 135, 142<br />
Defilló, Fernando Arturo, 390<br />
Degos, Robert, 126, 134, 320, 328,<br />
332<br />
Dekmak, Miguel, 321<br />
Del Pino, Gise<strong>la</strong>, 111, 321<br />
Del Río, 271<br />
Defina, Antônio Francisco, 105<br />
Delfino, Gisel<strong>la</strong>, 60<br />
Delgadillo, Alci<strong>de</strong>s, 282, 287<br />
Delgado, Sergio, 282<br />
Delgado Fernán<strong>de</strong>z, Víctor, 320, 370,<br />
376, 379<br />
Delgado González, Carlos, 282, 287<br />
Delgado Pare<strong>de</strong>s, José María, 128,<br />
141<br />
Delgado Riascos, José María, 127<br />
Delgado Sayán, César, 363<br />
Del<strong>la</strong> Giovanna, P., 448<br />
Del<strong>la</strong> Santa, 421<br />
Delucchi, 420<br />
De León G., Suzzette <strong>de</strong>, 8, 13, 231,<br />
251, 253<br />
Denegri, Juvenal, 372<br />
Desjeux, Phillippe, 69<br />
Di Pao<strong>la</strong>, Guillermo, 127<br />
Di Prisco, Juan, 435, 438, 439<br />
Di Prisco, María Cristina, 437<br />
Diab, 419<br />
Díaz, David, 217<br />
Díaz, Julio, 46<br />
Díaz, Luis A., 113, 137, 222<br />
Díaz, Luisa H., 140<br />
Díaz, María Antonia, 166<br />
Díaz, Pacífico, 34, 36, 59<br />
Díaz, Rafael, 390<br />
Díaz, Sandra, 187<br />
Díaz Almeida, José G., 8, 12, 157,<br />
163, 164, 165,166, 167<br />
Díaz Cardozo, Antonio, 121<br />
Díaz <strong>de</strong> <strong>la</strong> Rocha, José, 163, 164<br />
Díaz (voir Marte)<br />
Díaz Gómez, C<strong>la</strong>udia Juliana, 154<br />
Díaz Muñoz, Juana, 185<br />
Díaz Saubi<strong>de</strong>t Jorge, 61, 63<br />
Díaz-Landaeta, Leopoldo, 451<br />
Diez <strong>de</strong> Medina, Juan Carlos, 8, 12,<br />
67, 307<br />
Dillon, Neuza Lima, 86, 105, 108<br />
Diniz, Orestes, 88, 97<br />
Domenici, Rodovalho Men<strong>de</strong>s, 96<br />
Domínguez, Juan A., 28<br />
Domínguez, Luciano, 321<br />
Domínguez, Nayib Ambrad, 127, 130<br />
Domínguez Cherit, Judith, 274<br />
Domínguez Sisco, Rafael, 438<br />
Dorce, Susana, 419<br />
Dostrowsky, A., 349, 364<br />
Dover, C., 214<br />
Dragicevic, Vesna, 184<br />
Drapkin, Israel, 185<br />
Drassinower, Enrique, 325<br />
Driban, Nelson, 42<br />
Duarte (voir Rendón)<br />
Duarte, Ida, 104<br />
Duarte, Miguel F., 140<br />
Dhum, Gisel<strong>la</strong>, 36<br />
Duperrat, B., 328, 329, 336<br />
Duque Ossman, Yamil Alberto, 136<br />
Duque Perdomo, Matías, 159, 160<br />
Durán Mckinster, Caro<strong>la</strong>, 248, 278,<br />
279, 452<br />
Durán Merchán, María Mélida, 129,<br />
133, 136, 138, 144, 147<br />
Durango, María Bernarda, 149<br />
Durango Michailos, Anairma, 440<br />
Durango Nazariego, Nectario, 440<br />
Dutra, Van<strong>de</strong>rli, 96<br />
E<br />
Eaton, George E., 312<br />
Echegaray, Carlos, 375<br />
Echeverría, Enrique, 244<br />
Echeverría, F., 69<br />
E<strong>de</strong>lson, Richard, 223<br />
Egas, Eduardo, 209<br />
Eguiguren, Víctor, 375<br />
Eguiguren Lira, Gonzalo, 176, 178,<br />
181, 186, 189, 192, 448<br />
Eguren, Leopoldo, 69<br />
Eid, Lour<strong>de</strong>s, 140<br />
Elboli, José, 318<br />
Empinotti, Júlio César, 112, 306, 448,<br />
449<br />
Enca<strong>la</strong>da Córdova, Franklin, 205, 206,<br />
220, 221, 222, 224<br />
Encinas, Enrique, 346<br />
Estel<strong>la</strong> Entralgo, Honorato, 383, 385<br />
Esca<strong>la</strong>nte, Aníbal, 363<br />
Escobar, José J., 130<br />
Escobar, Julio, 145<br />
Escobar Gil, Olga Patricia, 148<br />
Escobar Restrepo, Carlos Enrique,<br />
133, 137, 143, 147, 148, 150<br />
Escomel, E., 348, 350, 353, 355, 364,<br />
365<br />
Escu<strong>de</strong>ro, Carlos Hugo, 65<br />
Esculies, José, 305<br />
Espail<strong>la</strong>t, Eida, 393<br />
Esparragoza y Gal<strong>la</strong>rdo, Narciso, 243<br />
Espasandin, José, 417<br />
Espejo, Luis, 214<br />
Espín, Carlos, 200<br />
Espinal Múnera, Hugo, 126, 150<br />
Espinosa, Teodoro, 220, 221, 223<br />
Espinosa Sotomayor, Roberto, 282<br />
Espinoza Bravo, 200, 207<br />
Espoz, Horacio, 184<br />
Estebanson, Santiago, 258<br />
Estete, Miguel <strong>de</strong>, 315<br />
Estévez, Fernanda Nanita, 393
Estévez, Juvenal, 443<br />
Estrada, Eduardo, 435, 438<br />
Estrada, Roberto, 306<br />
Estrel<strong>la</strong>, Bolívar, 200<br />
Eva, Adilia <strong>de</strong>, 284<br />
F<br />
Fachín Viso, Raúl, 441<br />
Fachín, Carlos, 441<br />
Facio, Ludovico, 35<br />
Faivre, João Mauricio, 74<br />
Faizal Geagea, Michel, 8, 12, 117,<br />
134, 135, 137, 140, 142, 145,<br />
149, 153, 155<br />
Fajardo Palencia, Aldo, 141<br />
Fa<strong>la</strong>bel<strong>la</strong>, Rafael, 8, 16, 128, 130,<br />
133, 137, 138, 139, 147, 148,<br />
154, 155, 444, 453, 459<br />
Falconí Vil<strong>la</strong>gómez, José, 199<br />
Faraday, Michel, 28<br />
Farfán, Manuel, 217, 218<br />
Faria, Antônio Januário <strong>de</strong>, 76<br />
Faria, Luiz da Costa Chaves, 74, 78,<br />
80, 100<br />
Farini, J., 34, 46<br />
Fariñas, Pastor, 161, 162, 167, 168<br />
Farrero, Cecilia, 65<br />
Fassio, Gustavo Adolfo, 199, 200<br />
Feijó, Carolina, 111<br />
Feijóo, Fernando, 42<br />
Fenno, Gerry, 227<br />
Fernan<strong>de</strong>s, Jorge, 73<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Arturo A., 34<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Enrique, 363<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Fernando, 164<br />
Fernán<strong>de</strong>z, José María, 41, 46, 47,<br />
327, 337, 424<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Kirshe, 393<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Mario, 390, 391<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Mariselda, 393<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Nilda, 393, 394<br />
Fernán<strong>de</strong>z, Víctor, 246, 249<br />
Fernán<strong>de</strong>z Báez, Rafael, 390<br />
Fernán<strong>de</strong>z B<strong>la</strong>nco, Emilio, 35, 48<br />
Fernán<strong>de</strong>z B<strong>la</strong>nco, Gracie<strong>la</strong>, 46, 50<br />
Fernán<strong>de</strong>z Bussy, Ramón, 42<br />
Fernán<strong>de</strong>z Dávi<strong>la</strong> M., Guillermo, 372<br />
Fernán<strong>de</strong>z Dávi<strong>la</strong>, José, 370<br />
Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Valenzue<strong>la</strong>, Pedro, 121<br />
Fernán<strong>de</strong>z Hernán<strong>de</strong>z-Baquero,<br />
Guillermo, 162, 163, 164, 165, 168<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Fernán<strong>de</strong>z Vautrai, 440<br />
Ferrándiz Foraster, Carlos, 444<br />
Ferrando, Juan, 444<br />
Ferrari, Manlio, 417<br />
Ferraro, Arlindo, 100<br />
Ferraz, Nei<strong>de</strong>, 93<br />
Ferreira, Fátima, 436<br />
Ferreira, José Alvimar, 101<br />
Ferreira, Ludgero, 76<br />
Ferreira, Luis, 40<br />
Ferreira-Marques, João, 42<br />
Ferreiro, Mari Carmen, 436<br />
Ferrer, Ismael, 161<br />
Ferrer, Jaime, 182<br />
Ferrer, Silvia, 140<br />
Ferretti Jurado, Humberto, 205<br />
Festa Neto, Cyro, 104<br />
Fich Schilcrot, Félix, 173, 178, 184,<br />
185, 187, 189, 190, 191, 192,<br />
193, 448<br />
Fidanza, Enrique, 34, 35, 41, 46, 424<br />
Figueira, Absalom Lima, 99, 100<br />
Filgueiras, Danilo Vicente, 101<br />
Figueroa, Luz D., 385<br />
Fin<strong>la</strong>y, Carlos Juan, 158<br />
Fleischmajer, Raúl, 37<br />
Fleisher, Lawrence, 383<br />
Fleurens, 408<br />
Flichman, Juan Carlos, 47, 69, 427<br />
Flom, Rosa Etlis <strong>de</strong>, 46<br />
Flores, Diana, 354<br />
Flores, Jaime, 327<br />
Flores, José Felipe, 242<br />
Flores (voir Lacarruba)<br />
Flores-Cevallos, Elbio, 8, 14, 300,<br />
309, 310, 338, 344, 379<br />
Flores-Cevallos, Luis, 8, 14, 300, 309,<br />
315, 319, 320, 321, 322, 324,<br />
325, 328, 337, 340, 369, 372,<br />
374, 375, 379<br />
Flores Díaz, Enrique, 228<br />
Flores González, Luis, 41<br />
Flórez Díaz Granados, Merce<strong>de</strong>s, 138<br />
Fonseca, Aureliano da, 321<br />
Fonseca, Francisco, 442<br />
Fonseca, Tiburcio, 33<br />
Fonseca Filho, Olympio da, 79, 83, 88<br />
Forero, Manuel, 135, 136, 141, 145<br />
Forim Alonso, Fausto, 306, 448<br />
Forman, Eugenio, 45<br />
Fortín Gu<strong>la</strong>rte, Guillermo, 245, 248<br />
Forster, Juliana, 222<br />
Fosatti, Carlos María, 415, 425<br />
Foss, Norma, 109<br />
Fracastore, Giro<strong>la</strong>no, 313<br />
Fraga, Armiño, 79<br />
Fraga, Sylvio, 87, 99, 100<br />
França, Emmanuel Rodrigues <strong>de</strong>, 94<br />
Francia Rojas, Rosa, 392, 393<br />
Franciscolo Castagnino, Enrique, 373,<br />
375<br />
Franco, Nélida, 36<br />
Franco, Roberto, 125, 132<br />
Freire, Patricio, 204<br />
Freitas, Ronaldo Barros <strong>de</strong>, 93<br />
Frey Gabler, Rodolfo, 185<br />
Freyre, Manuel, 40<br />
Frisancho, Oscar, 363<br />
Frucchi, Humberto, 104<br />
Fuentes, Jairo, 139<br />
Fuenzalida, Héctor, 177, 179<br />
Fuertes Álvarez, Juan, 43, 321<br />
Fundora, Victoria, 167<br />
Funes, Juan M., 247<br />
Furones, Esperanza, 167<br />
Furtado, C<strong>la</strong>risse, 111<br />
Furtado, Tancredo A., 88, 89, 92, 97,<br />
98, 447<br />
Fusseu, Dolores, 208<br />
G<br />
Gabizo, João Pizarro, 75, 77, 78, 80,<br />
99, 100<br />
Gáfaro Barrera, María Bernarda, 136,<br />
140<br />
Gago <strong>de</strong> Vadillo, Pedro, 317<br />
Ga<strong>la</strong>rza M., C<strong>la</strong>udio, 223<br />
Ga<strong>la</strong>rza Manyari, Carlos, 373, 378<br />
Galeano (voir Valdovinos)<br />
Galfetti Urioste, Carlos, 423<br />
Galimberti, Ricardo, 8, 11, 17, 45, 47,<br />
448<br />
Gal<strong>la</strong>rday Vásquez, Raúl, 320, 338,<br />
343, 373, 375<br />
Galli Mainini, Carlos, 127<br />
Gálvez Azteguieta, Ramiro, 244, 252<br />
Gálvez Brandon, José, 363<br />
Gálvez Molina, Luis, 243, 244, 246<br />
Gamarra Gálvez, Rafael, 322, 323, 373<br />
Gamboa Amador, Alfonso, 126, 145<br />
Gamboa Suárez, Luis Arturo, 150,<br />
151, 154<br />
467
INDEX ONOMASTIQUE<br />
468<br />
Gamonal, Aloísio, 98<br />
Gaona, José Miguel, 141, 154<br />
García, Edwin, 247<br />
García, Elizabeth, 134<br />
García, Evaristo, 125, 131<br />
García, Jorge, 127, 131<br />
García, José Joaquín, 125, 129, 131,<br />
132<br />
García, Lucy, 133, 143, 148<br />
García, María Amelia, 60, 61, 62, 63<br />
García, Raquel, 111<br />
García, Sandra, 39, 50, 222<br />
García, Vilma, 248<br />
García Arrese, Luis, 373<br />
García Cuadros, Roy, 371<br />
García Díaz, Rita, 46, 60, 64, 65, 306<br />
García Esquivel, Jorge, 282, 283, 287<br />
García Jiménez, Fernando, 135, 145,<br />
146, 154<br />
García (née Bay), Lorena, 246, 247,<br />
248, 254<br />
García Medina, Pablo, 125, 131<br />
García Morales, Florencio, 441<br />
García Pérez, Antonio, 444<br />
García Val<strong>de</strong>z, Arturo, 243, 245, 247,<br />
248<br />
García Vargas, Alejandro, 278, 279<br />
García Zubil<strong>la</strong>ga, Pedro, 8, 12, 59, 61,<br />
62, 63, 65<br />
Gardini, Wilfredo, 343<br />
Garibay, Juan Manuel, 165<br />
Garrido, Elena, 49<br />
Garzón, Eduardo, 208<br />
Garzón, Holger, 208, 210, 221<br />
Garzón, Rafael, 36, 39, 40, 46, 48, 49,<br />
50, 424<br />
Garzón, Rafael (fils), 40, 49<br />
Garzón, Tomás, 40<br />
Garzón Fortich, Carlos Alberto, 127,<br />
131, 140<br />
Garzona Baril<strong>la</strong>s, Ricardo Augusto,<br />
245, 246<br />
Gaspar, Antônio Pedro <strong>de</strong> Andra<strong>de</strong>,<br />
102<br />
Gaspar, Nei<strong>de</strong> Kalil, 101, 102, 103<br />
Gastaldi, Luis, 423<br />
Gastiaburú, Julio, 350, 356, 365<br />
Gatti, Carlos Fernando, 40, 50, 307<br />
Gatti, Juan Carlos, 39, 40, 45, 47, 49,<br />
68, 112, 447, 448<br />
Gatti, Thais Romero, 108<br />
Gaviria, John Harvey, 140, 147<br />
Gaviria, Juvenal, 126<br />
Gay Prieto, José, 161, 206, 443, 444<br />
Geier, Érika, 111<br />
Gelmetti, Carlo, 63<br />
Genatios, Tomás, 438<br />
Gerbase, José, 111<br />
Gerson Pena, 95<br />
Gianelli, Víctor, 185<br />
Gianotti, Ferdinando, 278, 451<br />
Giansante, Elda, 307<br />
Gil Jaramillo, Jaime, 8, 12, 117, 121,<br />
139, 142, 150, 151<br />
Gil, Bertina, 392<br />
Gill, Juan B., 296<br />
Giménez, A., 34<br />
Giménez, Manuel, 43, 47, 306<br />
Giménez, Manuel (fils), 43<br />
Giovo, María Elsa, 60, 65<br />
Giral<strong>de</strong>s, Antonio, 393<br />
Giraldi, Susana, 452<br />
Giraldo Neira, Bernardo, 128, 140,<br />
146<br />
Giraldo Restrepo, Nelson, 128, 133,<br />
134, 147, 148<br />
Godoy, Everardo, 42<br />
Goihman Yahr, Mauricio, 435, 437,<br />
438, 439, 440, 444<br />
Golberger (voir Mora)<br />
Goldberg, G., 60<br />
Gomes, Bernardino Antônio, 82<br />
Gómez, Alina, 289<br />
Gómez, Gonzalo, 139<br />
Gómez, María Luisa, 449<br />
Gómez Agámez, Adolfo, 137, 140<br />
Gómez Carrasquero, Luis, 435<br />
Gómez Hanssen, Orietta, 176, 181,<br />
184, 189, 192<br />
Gómez Orbaneja, José, 42, 206<br />
Gómez Orozco, Luis, 277<br />
Gómez Pérez, Diego Fernando, 127<br />
Gómez Sierra, Heriberto, 128, 133,<br />
138, 140, 146, 147<br />
Gómez Urcuyo, Francisco José, 282,<br />
283, 284, 285, 286, 287, 288,<br />
289, 290<br />
Gómez Uribe, José Ignacio, 139, 148,<br />
154<br />
Gómez Vargas, F<strong>la</strong>vio, 8, 12, 117, 126,<br />
127, 136, 137, 138, 139, 142,<br />
143, 146<br />
Gómez Vargas, Luz Marina, 149, 154<br />
Gomis, 424<br />
Gonçalves, Heitor <strong>de</strong> Sá, 94<br />
Gontijo, Bernardo, 87, 90, 98<br />
Gonzáles Will, Rafael, 375<br />
Gonzáles, Francisco, 449<br />
Gonzáles Garay, Humberto, 374, 375<br />
Gonzales Mugaburu, José, 347<br />
Gonzáles Pinillos, Víctor, 325, 327,<br />
328, 337, 369, 372<br />
González, Abel, 46<br />
González, Aparicio, 245, 247, 248<br />
González, Esteban, 121<br />
González, Eudoro, 432<br />
González, Gonzalo, 209, 210<br />
González, Hipólito, 147<br />
González, José Lucio, 438<br />
González, José R., 385<br />
González, Justo, 258<br />
González, María Teresa, 60<br />
González, Mario Ernesto, 128, 141,<br />
448<br />
González, Nieves, 437<br />
González, Norma, 150<br />
González, Silvina, 46<br />
González, Tomás, 305<br />
González Aveledo, Luis Alfredo, 437,<br />
451, 452<br />
González Bermú<strong>de</strong>z, Daniel, 139<br />
González Catán, M., 33<br />
González Chacón, Julio, 185<br />
González (voir Bogaert)<br />
González (voir Mén<strong>de</strong>z)<br />
González <strong>de</strong>l Cerro, Sebastián, 42<br />
González Díaz, Ignacio, 175, 177,<br />
178, 180, 181, 182, 186<br />
González Herrejón, Salvador, 272<br />
González Martin, Juan, 178<br />
González Ochoa, Antonio, 278<br />
González Oddone, Miguel, 305<br />
González Otero, Francisco, 435, 437,<br />
438, 439<br />
González Pérez, Guillermo, 161<br />
González Pren<strong>de</strong>s, Miguel A., 161,<br />
163, 167, 168<br />
González Rescigno, Gilberto, 46, 69<br />
González Rioseco, Héctor, 185, 186<br />
González Rodríguez, Guillermo, 136,<br />
141<br />
González Rojas, Carlos Horacio, 8, 12,<br />
117, 136, 138, 140<br />
González Urueña, Jesús, 272<br />
Gorbitz, G., 355
Gorostiaga, Gracie<strong>la</strong>, 449<br />
Gotlib, Natan, 36, 48<br />
Gotuzzo, Eduardo, 347, 363<br />
Gougerot, Henri, 34, 328, 423<br />
Gou<strong>la</strong>rt, Zopyro, 89<br />
Grandi, Paulina, 182<br />
Granizo H., Bolívar, 223<br />
Graterol Roque, Cruz A., 438, 439,<br />
441, 442<br />
Grau Triana, Juan, 161<br />
Greco, Nicolás V., 19, 20, 31, 34, 35,<br />
43, 57<br />
Greenberg Cor<strong>de</strong>ro, Peter A., 8, 13,<br />
231, 251, 252, 254<br />
Grees, Susana, 64, 65<br />
Grillo, Rafael, 165<br />
Grimalt, Ramón, 444<br />
Grinspan, David, 36, 40, 44, 46, 48,<br />
50, 56, 69, 306, 321, 393, 417,<br />
443<br />
Grinspan Bozza, Norberto, 46<br />
Guada, Luis Felipe, 441<br />
Guadagnini, Elizabeth, 440<br />
Guadamuz, Juan José, 283<br />
Guarda Tatin, Rubén, 8, 12, 169, 173,<br />
176, 178, 180, 181, 183, 186,<br />
187, 188, 189, 191, 192, 193,<br />
448, 449<br />
Guardia, Nicanor (fils), 432<br />
Gübelin, Walter, 176, 179, 181, 184,<br />
193<br />
Gue<strong>de</strong>s, Antonio Martins, 98<br />
Guerra, Humberto, 347<br />
Guerra, Pablo, 432, 433, 434, 435<br />
Guerra Carbajal, Carlos, 374<br />
Guerra Castro, Myra, 166<br />
Guerra Fonseca, Pedro, 442<br />
Guerra Mercado, Juan, 69<br />
Guerrero, Danie<strong>la</strong>, 393<br />
Guerrero, Laureano, 146<br />
Guerstein, Fanny, 182<br />
Guglielmetti, Antonio, 179, 193<br />
Guillén, Humberto, 210<br />
Guillot, Carlos Fe<strong>de</strong>rico, 36, 46, 48,<br />
49, 51<br />
Guillot, Pedro, 41<br />
Guimarães, Newton Alves, 89, 93,<br />
104<br />
Guinzburg, Alejandro, 222<br />
Gurfinkel, Andrea, 103<br />
Gutiérrez, Juan Gualberto, 124<br />
Gutiérrez, Manolo, 245<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Gutiérrez Aldana, Guillermo, 8, 12,<br />
117, 126, 133, 135, 137, 138,<br />
142, 145, 149, 153, 356<br />
Gutiérrez Arostegui, José Miguel, 289<br />
Gutiérrez Noriega, Carlos, 347<br />
Gutiérrez Y<strong>la</strong>ve, Zaida, 374<br />
Guzmán, A., 448<br />
Guzmán, Emma, 393<br />
Guzmán, Juan Pablo, 392<br />
Guzmán Barrón, Alberto, 350, 352,<br />
365<br />
H<br />
Habermann, Marta Cassoni, 109<br />
Haddad Júnior, Vidal, 109<br />
Halpert Ziskiend, Evelyne, 9, 16, 134,<br />
135, 136, 138, 141, 142, 143,<br />
154, 451, 452<br />
Halty, Máximo, 425<br />
Hanifin, John, 191<br />
Harper, John, 60<br />
Hartmann, 67<br />
Hassan, Merce<strong>de</strong>s, 39<br />
Hasselb<strong>la</strong>d, O., 394<br />
Hasson, Ariel, 178, 179<br />
Hayes, Rutherford B., 297<br />
Hebra, Ferdinand, 34, 77, 78<br />
Heins, Norberto, 185<br />
Hemb, Achyles, 111<br />
Henao, Mario, 146<br />
Henao B<strong>la</strong>nco, Tomás, 126, 137, 145<br />
Henríquez, J. J., 441<br />
Herane, María Isabel, 64, 178, 179,<br />
187, 188, 189, 191, 192, 449<br />
Hercelles, Oswaldo, 327, 356, 375<br />
Heredia, Cayetano, 318, 319, 369<br />
Hering, Mónica, 178, 179<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Azucena, 248<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Eduardo, 384<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Francisco, 212, 267, 269,<br />
367, 408<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Gonzalo, 209<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Juan F., 140<br />
Hernán<strong>de</strong>z, Walter León, 133, 135,<br />
146<br />
Hernán<strong>de</strong>z Guante, Alci<strong>de</strong>s, 393<br />
Hernán<strong>de</strong>z López, Héctor, 384<br />
Hernán<strong>de</strong>z Pérez, Enrique, 9, 13, 222,<br />
227, 228, 229, 321, 444<br />
Hernán<strong>de</strong>z Pérez, Ro<strong>la</strong>ndo, 437, 442,<br />
449<br />
Herrer, Arísti<strong>de</strong>s, 347, 349, 350, 351,<br />
352, 353, 354, 365<br />
Herrera, Guillermo, 390<br />
Herrera-Ceballos, Enrique, 444<br />
Herrera Navarro, Magalis, 451<br />
Herrera Ramos, F., 417<br />
Hertig, M., 350, 355<br />
Héry, Thierry <strong>de</strong>, 268<br />
Hevia Parga, Hernán, 170, 175, 176,<br />
177, 178, 179, 180, 181, 182,<br />
185, 186, 190, 193<br />
Hidalgo González, Carlos, 200<br />
Higueros, José, 246<br />
Hi<strong>la</strong>rio, Miriam, 392<br />
Hinostroza, Santos, 363<br />
Hodgman, Joan E., 451<br />
Hómez Chacín, Jorge, 438, 440<br />
Honeyman Mauro, Juan, 173, 176,<br />
178, 179, 180, 181, 183, 185,<br />
186, 187, 188, 189, 190, 191,<br />
192, 193, 306, 448, 449<br />
Hopf, Alfred, 417<br />
Horta, Paulo <strong>de</strong> Figueiredo Parreiras,<br />
76, 79, 82, 86, 89, 101<br />
Houler, J. R., 34<br />
Houssay, Bernardo Alberto, 127<br />
Howe, Cal<strong>de</strong>rón, 356<br />
Hoz Ulloa, Carmen Helena <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 135,<br />
137, 148<br />
Humboldt, Alexandrowich Ferdin, 67,<br />
68, 69<br />
Hurtado, Alberto, 370<br />
Hurtado, Aníbal, 184, 185<br />
Hurtado, J., 69<br />
Hurtado Pare<strong>de</strong>s, Raúl, 320, 355, 370<br />
Hurwitz, Sydney, 181, 278<br />
Huyke, Bernardo, 139, 140, 449<br />
I<br />
Ibarra, Guadalupe, 279<br />
Idrovo A., Juan, 218<br />
Iglesias, Manuel, 43, 421<br />
Ilho, Guillermo, 61, 63, 64<br />
Imery, Marcos, 259, 260<br />
Indacochea, Abe<strong>la</strong>rdo, 343<br />
Infantozzi, Carlos María, 424<br />
Infantozzi, José M., 418, 420<br />
Ingrata, Stel<strong>la</strong> Maris, 43<br />
Ipiranga, Sylvia, 109<br />
Irazabal, Porfirio, 438<br />
Iribas, José Luis, 39<br />
469
INDEX ONOMASTIQUE<br />
470<br />
Irigoyen, Carlos, 282, 287<br />
Isa Isa, Rafael, 9, 15, 392, 395, 397,<br />
398<br />
Isaza Zapata, Rafael, 136, 140<br />
Isaza, Víctor, 140<br />
Is<strong>la</strong>, Miguel <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 124<br />
Iturbe, Juan, 432, 433, 438<br />
Iturre (voir Aguirre)<br />
J<br />
Jacobs, Alvin, 278<br />
Jacobson, Coleman, 451<br />
Jacobsthal, E., 244<br />
Jadassohn, 329<br />
Jaimovich, Carlota, 44<br />
Jaimovich, León, 37, 38, 40, 45, 48,<br />
49, 50, 306, 444, 448, 449<br />
Jaller, Antonio, 139<br />
Jalón, Roberto, 200<br />
Jara, Mónica, 182<br />
Jara Padil<strong>la</strong>, Iván, 176, 181, 183, 187,<br />
189, 191, 192<br />
Jaramillo, Diego Elías, 139, 143, 146,<br />
148<br />
Jaramillo, Luis Carlos, 218, 219<br />
Jaramillo Ayerbe, Felipe, 133, 135,<br />
140, 142, 147, 154<br />
Jaramillo Bruce, Roberto, 174, 175,<br />
177, 185, 186<br />
Jaramillo Puertas, Juan, 204<br />
Jardim, Márcio Lobo, 89<br />
Jatobá, A<strong>de</strong>rbal Loureiro, 95<br />
Jiménez, Manuel, 305, 306<br />
Jiménez, Sol Beatriz, 148<br />
Jiménez Calfat, Guillermo, 134, 142,<br />
148, 149<br />
Jiménez Castil<strong>la</strong>, José Luis, 271, 273<br />
Jiménez Rivero, Miguel, 432, 433<br />
Job, Edgardo Jorge, 393<br />
Jones, Doraida, 393<br />
Jonquières, Enrique D., 34, 36, 37, 39,<br />
47, 50, 417<br />
Jorge, Eduardo, 89<br />
Junqueira, Hugo, 96<br />
K<br />
Kadunc, Bogdana Victoria, 106<br />
Kahn, Guinter, 278, 451<br />
Kaminsky, Ana, 37, 38, 39, 40, 44, 46,<br />
321, 417, 444, 445<br />
Kaminsky, Carlos, 38, 47, 321<br />
Kaminsky, Aarón, 35, 36, 37, 38, 39,<br />
40, 46, 50, 128, 227, 424, 425<br />
Kap<strong>la</strong>n, H. A., 37<br />
Kasuke, Ito, 321<br />
Kelber, Jaime, 127<br />
Ker<strong>de</strong>l Vegas, Francisco, 434, 435,<br />
438, 439<br />
Khoury, Michelle, 393<br />
Kien, María Cristina, 45<br />
Kis<strong>la</strong>nsky, Viviana, 60<br />
Klein Kohn, Oscar, 175, 176, 186,<br />
189, 193<br />
Kleist, 420<br />
Klestorny B<strong>la</strong>nco, Pablo, 418, 419,<br />
421, 423, 424<br />
Knopfelmacher, Oilda, 306<br />
Kobayashi, Márcia Mayko, 109<br />
Kohan, Ricardo, 61, 63, 64, 65<br />
Koves (voir Amini)<br />
Kowalczuk, Alicia, 45<br />
Kriner, José, 37, 46, 110<br />
Krumdieck, Carlos, 374<br />
Kuczynski-Godard, Maxime, 324, 350,<br />
357, 365<br />
Kuhl, Isabel C. P., 111<br />
Kuret, Colón, 391<br />
L<br />
Labat, 420<br />
Labrada, Melba, 150<br />
Lacarruba (née Flores), Luz María,<br />
449<br />
Lacaz, Carlos da Silva, 84, 104<br />
Lacentre, Eduardo, 36, 45<br />
Lacuesta, 421<br />
Laffargue, Jorge, 46, 65<br />
Lairet, Félix, 434<br />
Lamas Grubesich, Roger, 175, 180,<br />
186, 189, 190, 193<br />
Lamel<strong>la</strong>, Antonio, 408<br />
Lan<strong>de</strong>r Marcano, Alfredo, 9, 15, 429,<br />
438, 439<br />
Lanfranchi, Héctor, 64, 306<br />
Lapenta, Pedro, 440, 441, 442<br />
Lara, Luz Marina, 140<br />
Lara, Raúl, 70<br />
Larral<strong>de</strong>, Juan, 438<br />
Larral<strong>de</strong> (voir Luna)<br />
Larrañaga, Dámaso Antonio, 414<br />
Larrea, J. T., 218, 356<br />
Larrere, N., 350<br />
Laspril<strong>la</strong> (née Moncaleano), Cecilia,<br />
127, 128, 139<br />
Lasso, 200, 208<br />
Lastória, Joel Carlos, 109<br />
Latapí, Eugenio, 272<br />
Latapí, Fernando, 161, 225, 227, 272,<br />
275, 277, 278, 391, 443, 444,<br />
445<br />
Laterza, Amelia M., 279<br />
La Torre Tuesta, Iram, 378<br />
Lauria, Carmelo, 438<br />
Laveran, C., 350<br />
Laver<strong>de</strong>, Alfredo, 126, 137, 145<br />
Lavieri, Alberto, 60<br />
Lázaro, Pedro, 384<br />
Lazzarini, Rosana, 104<br />
Leão, Arêa, 79, 83<br />
Lecha, Mario, 444<br />
Ledo, Antonio, 444<br />
Legua, Pedro, 347<br />
Leitão, Artur da Silva, 93<br />
León, Armando, 247<br />
León, Juan <strong>de</strong>, 242<br />
León, Luis A., 208<br />
León Chérrez, Víctor, 205, 221, 223,<br />
224, 371<br />
León Romero, Doris Stel<strong>la</strong>, 141, 154<br />
León Ternera, Lesbia <strong>de</strong>, 139<br />
León (née Obregón), María <strong>de</strong>l<br />
Socorro, 246, 247, 248, 249<br />
Leonforte, José F., 42, 193<br />
Lerer, Cláudio, 103<br />
Leroux, María Bibiana, 47<br />
Lesmes Rodríguez, B<strong>la</strong>nca Lilia E.,<br />
134, 150, 154<br />
Leston, Nancy, 62, 64, 65<br />
Letona, Guillermo, 246, 247, 248, 254<br />
Lever, Walter, 181, 227<br />
Levites, Jacob, 106<br />
Levocci, Francisco, 109<br />
Levy, Moise, 60, 64, 419<br />
Lewley, Thomas, 223<br />
Leyton, Jerónimo, 213<br />
Librado Vásquez, José, 150<br />
Liceaga, Eduardo, 272<br />
Lima, Aldy Barbosa, 101<br />
Lima, João Francisco da Silva, 76, 82<br />
Lima, Margareth, 107<br />
Lima, Ricardo Barbosa, 101<br />
Linares Barrios, Mario, 143<br />
Linares, Lionel, 243, 248
Lin<strong>de</strong>mberg, Adolpho, 79, 80, 81, 82,<br />
88, 103, 424<br />
Liparoli, Julio César, 273<br />
Liviano, Cesarían, 393<br />
Lizardo, César, 435, 439, 442<br />
Lizarraga, Fe<strong>de</strong>rico, 437<br />
L<strong>la</strong>no, L., 47<br />
L<strong>la</strong>nos, Alejandro, 347<br />
L<strong>la</strong>nos, Bertha, 351<br />
L<strong>la</strong>nos, Enrique, 163<br />
L<strong>la</strong>nos Campo, Matil<strong>de</strong>, 141<br />
Lleras Acosta, Fe<strong>de</strong>rico, 125, 130,<br />
131, 133, 147, 155<br />
Llerena Gamboa, José, 226, 229<br />
Lobo, Jorge <strong>de</strong> Oliveira, 83, 87, 89, 95<br />
Lofêgo Filho, José Anselmo, 103<br />
Logemann, Heidi, 246<br />
Loizaga, Carlos, 296<br />
Lombardi, Arnaldo, 426, 427<br />
Londoño, Ánge<strong>la</strong>, 150<br />
Londoño González, Fabio, 126, 130,<br />
131, 133, 136, 138, 145, 147,<br />
155<br />
Lonza, Juan Pedro, 193<br />
Lopes, Cid Ferreira, 97<br />
López, Aurélio Ancona, 85, 105, 106<br />
López, Luis, 128<br />
López, Juan, 123<br />
López, Pedro, 268, 270, 389<br />
López Ballesteros, L., 67<br />
López Cortés, Néstor, 185<br />
López <strong>de</strong> Buiza, Pedro, 123<br />
López <strong>de</strong> Lozada, Mauricio, 242<br />
López <strong>de</strong> Mesa, Jorge, 126, 139<br />
López <strong>de</strong>l Campo, Mendo, 121<br />
López González, Gerónimo, 42, 50<br />
López López, Mariano, 126, 131, 135,<br />
136, 138, 141, 147, 149<br />
López Narváez, Gerardo, 132<br />
López Olivares, J. M., 437<br />
López Osorio, Damise<strong>la</strong>, 166<br />
López Ruiz, Rafael, 137<br />
Loredo, M., 70<br />
Lorenz, Ana María, 43, 62<br />
Lorenzano, Carlos, 61, 62, 63, 64, 65<br />
Loret <strong>de</strong> Mo<strong>la</strong>, Aurelio, 319, 325, 327,<br />
328, 334, 337, 342, 343, 369,<br />
370, 372, 375<br />
Lovera, Il<strong>de</strong>maro, 434, 438<br />
Lovio, Zobeida, 163, 166<br />
Lowy, Gabrie<strong>la</strong>, 101, 278<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Loyo<strong>la</strong>, Luis, 218<br />
Lozada, C<strong>la</strong>udia, 150<br />
Lucio, Rafael, 270, 272<br />
Lucky, Anne, 62<br />
Luengo Vale, J. M., 442<br />
Lugo-Somolinos, Aída, 385<br />
Lumbreras, Hugo, 343, 346, 347<br />
Luna (née Larral<strong>de</strong>), Margarita, 40,<br />
45, 46, 49, 306, 307, 451, 452<br />
Lurati, Carlos, 42<br />
Lutz, Adolfo, 74, 77, 79, 89<br />
M<br />
Macal, Antonio, 244<br />
Macca, Mário Luís, 108<br />
Macedo, Néstor, 307, 414, 418, 419,<br />
420, 426, 448, 449<br />
Mackehenie, Daniel, 342, 355<br />
Machado Filho, Carlos, 106, 109, 421<br />
Machado, Werneck, 89<br />
Machiavello, Juan, 375<br />
Maciel, Francisco, 414<br />
Ma<strong>de</strong>o, Vicente, 47<br />
Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre, Franklin, 9, 13,<br />
195, 205, 207, 222, 224<br />
Ma<strong>de</strong>ro Izaguirre, Mauro, 9, 13, 195,<br />
207, 224<br />
Maduro, Luis, 383<br />
Maestre Alonso, 389<br />
Maestre Juan, 389<br />
Maestre, Délio <strong>de</strong>l, 99<br />
Magalhães Neto, Eduardo, 89, 93<br />
Magaña García, Mario, 279<br />
Magaña Lozano, Mario, 277<br />
Magariños, Gabriel, 45, 50, 65<br />
Magariños, W., 70<br />
Magill, Fernando, 9, 16, 193, 322,<br />
447, 448, 449<br />
Magnani, Augusto, 41<br />
Magnin, Pedro Horacio, 36, 38, 39,<br />
40, 48, 49, 50, 417<br />
Maia, Marcus, 104, 114<br />
Maira Palma, María Elsa, 176, 181,<br />
182, 189, 193<br />
Maldonado, A., 355, 365<br />
Maldonado, H., 69<br />
Malo, Ignacio, 218<br />
Man, Abraham F., 36, 43<br />
Man<strong>de</strong>lbaum, Samuel, 109<br />
Mangano, Osvaldo, 40, 45, 50, 112,<br />
447, 448<br />
Manrique, Aníbal, 338<br />
Manrique, Vitaliano, 341, 343<br />
Manrique Ávi<strong>la</strong>, Juan, 319, 322, 323,<br />
329, 338, 343, 370, 373, 375,<br />
377<br />
Mansil<strong>la</strong> Arévalo, Juan José, 248, 254<br />
Mansil<strong>la</strong>, Carmen C. <strong>de</strong>, 248, 254<br />
Mantel<strong>la</strong>, Domingo, 321<br />
Manzano, Mauro, 223<br />
Manzi, Ricardo, 47<br />
Manzur, Gracie<strong>la</strong>, 9, 12, 59, 62, 63,<br />
64, 65<br />
Manzur, Julián, 165, 166<br />
Mañé Garzón, Fernando, 402, 413,<br />
428<br />
Maradona, Esteban Laureano, 24, 26,<br />
31<br />
Maragliano, Beatriz, 416<br />
Marcano, Carmen, 436<br />
Marcenaro, Beatriz <strong>de</strong>, 377<br />
Marchionini, Alfred, 88, 89<br />
Marcos, Carmen, 444<br />
Marcucci Delgado, A., 437<br />
Margileth, Andrew M., 451<br />
Margounato, Moris, 414, 419, 420<br />
Margulis, Carmen, 60<br />
Mariano, José, 96, 97<br />
Marini, Mario, 36, 39, 40, 47, 49, 50,<br />
306<br />
Mario, F., 34<br />
Marques, Antônio <strong>de</strong> Souza, 85, 100<br />
Marques, Mário, 109<br />
Marques, Sílvio Alencar, 105, 108,<br />
109, 306<br />
Marroquín, J., 350, 353, 365<br />
Marrugo Guardo, Gonzalo, 139, 140,<br />
154<br />
Marrugo Ramírez, Rubén, 127, 131<br />
Mars<strong>de</strong>n, Philip Davis, 95<br />
Marte, Ramón, 395<br />
Marte, Silvia, 393<br />
Marte (née Díaz), Ana Josefa, 393, 395<br />
Martín, Rafael F., 385<br />
Martínez, Carmen Alicia, 150<br />
Martínez, Dennis, 392<br />
Martínez, Miguel, 418<br />
Martínez, Sandra O., 140<br />
Martínez, Sergio, 150, 151, 154<br />
Martínez, Winston, 182<br />
Martínez Campos, Aldo Edgar, 9, 13,<br />
282, 284, 285, 286, 281, 287,<br />
288, 289<br />
471
INDEX ONOMASTIQUE<br />
472<br />
Martínez Campos, Oscar, 282<br />
Martínez Jiménez, Ángel, 282, 285,<br />
287<br />
Martínez Niochett, Armiño, 433<br />
Martínez Santamaría, Jorge, 132<br />
Martins, Carlos José, 101<br />
Martins, José Eduardo Costa, 90, 104,<br />
448<br />
Martins, Sarita, 90<br />
Mascaró B<strong>la</strong>nco, Antonio, 185<br />
Mascaró Galy, José Manuel, 444<br />
Mascaró, José María, 278, 321, 444<br />
Masi, Domingo, 305<br />
Mássimo, José Antonio, 9, 12, 46, 50,<br />
60, 61, 62, 63, 64, 65, 306<br />
Masson, Rodolfo, 111<br />
Matteo, 417<br />
Matus, Juan <strong>de</strong> Dios, 282<br />
Matus, Rodolfo, 283<br />
Mauricio, Rafael, 252<br />
Mauro, Diana, 43, 44<br />
May, José, 416, 419, 423, 424, 425,<br />
426, 428<br />
May (née Alonso), Gloria, 423<br />
Maya, Maritza, 441<br />
Mayor, Sylvia Souto, 104<br />
Mayorga Peralta, Rubén, 246<br />
Mazzini, Miguel Ángel, 34, 35, 36,<br />
37, 38, 39, 44, 48, 50, 57, 417,<br />
424<br />
Mazzini, Raúl, 36, 417<br />
Mc Ad<strong>de</strong>n, E., 46<br />
Meda, Telma, 248<br />
Me<strong>de</strong>llín, Julio César, 148<br />
Medina, Álvaro, 137<br />
Medina, Lidia, 178<br />
Medina, José, 257<br />
Medina, Rafael, 435, 436, 438, 440<br />
Medina Febres, Mariano, 435, 438<br />
Medina Pinzón, Alberto, 137, 148<br />
Medina Zepeda, María Eugenia, 288,<br />
289<br />
Meirelles, 74<br />
Mejía, José, 437<br />
Mejía, Milton, 150<br />
Mejía, Pau<strong>la</strong> Alexandra, 149<br />
Mejías, Abel, 434<br />
Mejías, María Antonieta, 438, 441<br />
Me<strong>la</strong>da, María Fernanda, 321<br />
Melén<strong>de</strong>z, Esperanza, 140<br />
Melén<strong>de</strong>z, L., 33<br />
Melén<strong>de</strong>z, Salomón, 225<br />
Melis <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vega, Manuel, 173, 178,<br />
182, 189, 193<br />
Mel<strong>la</strong>, Juan, 390<br />
Mello Filho, Alexandre, 85, 106<br />
Mello, Coaracy, 101<br />
Mello, Luis Campos, 89<br />
Mena Cedillos, Carlos, 279<br />
Men<strong>de</strong>s, José Pessoa, 89, 105<br />
Mén<strong>de</strong>z, María Isabel, 420, 449<br />
Mén<strong>de</strong>z (née González), Concha<br />
Marina, 246<br />
Mendoza, Marlene, 441<br />
Mendoza, Mireya, 436<br />
Mendoza Rodríguez, Dante, 332, 338,<br />
343, 344, 345, 370, 372<br />
Meneses, Oswaldo, 347<br />
Menezes, Caetano <strong>de</strong>, 89<br />
Menezes, Irene, 111<br />
Menocal, Raimundo G., 158, 159,<br />
160, 162<br />
Menta, Marcello, 307<br />
Mercadal Peyrí, José, 321, 444<br />
Mercadillo, Patricia, 449<br />
Mercau, Augusto, 42, 47<br />
Merchán, Nicanor, 218<br />
Merchán Manzano, Marcelo, 205,<br />
220, 221, 222, 223, 224<br />
Mérida, Marco Tulio, 441<br />
Merkel, Felipe, 324<br />
Mesa (voir Sanclemente)<br />
Mesa Cock, Aníbal, 135<br />
Mesa Cock, Jairo, 9, 12, 117, 128,<br />
140, 142, 143, 146, 147<br />
Mesa Restrepo, Jorge, 127, 139, 146,<br />
148<br />
Mesquita, P., 448<br />
Meth Tuesta, Víctor, 321, 327, 342,<br />
372, 378<br />
Meurehg, Charles, 273<br />
Meza, Desi<strong>de</strong>rio, 305<br />
Meza, José Joaquín, 141<br />
Meza Balbuena, Juan, 338, 343, 344,<br />
374<br />
Michel, Luis, 69<br />
Migliaro, José P., 417<br />
Milian, Gastón, 423<br />
Millán, María <strong>de</strong>l P., 384<br />
Mil<strong>la</strong>res, Francisco, 305<br />
Minelli, Lorivaldo, 110<br />
Miniño, Martha, 9, 15, 387, 396, 397,<br />
398<br />
Miniño Bhäer, José Antonio, 390<br />
Miquel, Alberto, 305<br />
Miralles, Ana, 420<br />
Miranda, Ana G., 70<br />
Miranda, Hernán, 347<br />
Miranda, J. Luiz, 88<br />
Miranda, Rui Noronha <strong>de</strong>, 87, 89, 92,<br />
110<br />
Miran<strong>de</strong>, Luis T., 43<br />
Miret Ortega, Omar, 441<br />
Miró Quesada, Oscar, 347<br />
Misad, Oscar, 363<br />
Miyares Cao, Carlos, 164<br />
Mocobocki, 419<br />
Moco<strong>la</strong>, 424<br />
Mogrovejo Carrión, José, 218, 219<br />
Molgó Novell, Monserrat, 178, 189,<br />
192<br />
Molina, Leonor, 135, 142<br />
Molina, María Teresa, 176<br />
Molina Leguizamón, Eduardo, 36<br />
Mom, Arturo, 36, 38, 48, 49<br />
Monar<strong>de</strong>s, Nicolás, 19, 120, 267, 408<br />
Monasterios, Guido, 70<br />
Moncada, Ximena, 178, 184<br />
Moncaleano (voir Laspril<strong>la</strong>)<br />
Moncayo, Luis, 204<br />
Monge, Carlos, 319, 326, 348, 350,<br />
355, 364, 365<br />
Monroy, Hugo, 337<br />
Mont, Luis, 247<br />
Montalbán, 355<br />
Moral, 355<br />
Montaña Granados, Eliseo, 125, 132<br />
Montenegro López, Galo, 9, 13, 195,<br />
202, 207, 208, 224, 306<br />
Montero, Eustaquio, 414, 418, 419,<br />
420, 421<br />
Montero Rivera, Luis, 175, 185<br />
Montes, Diego <strong>de</strong>, 152<br />
Montes <strong>de</strong> Oca, Leopoldo, 33<br />
Monti, Jorge, 45<br />
Monti, Juan, 42<br />
Montil<strong>la</strong>, Víctor, 383<br />
Montoya (voir Bayona)<br />
Montoya, R., 357<br />
Mora, Carlos Enrique, 136<br />
Mora (née Golberger), Eva, 60<br />
Moraes, Otávio, 106<br />
Moraga Miranda, Romeo Augusto,<br />
246, 248
Morales, Alejandro, 335, 338, 339,<br />
344, 345<br />
Morales, Enriqueta, 279<br />
Morales, Raúl, 384<br />
Morales Beltramí, Raúl, 185<br />
Morales Coello, J. R., 160<br />
Morales Ettienne, Armando, 282, 287<br />
Morales Saravia, Julio, 343<br />
Morales Segura, Antonio José, 129,<br />
131, 141<br />
Morante Sotelo, Victoria, 373<br />
Moreira, Juliano, 76, 89<br />
Morel<strong>la</strong> Herrera, Olga, 441<br />
Morelli, Joseph, 61, 63<br />
Moreno, Alger León, 278<br />
Moreno, Edgar, 140<br />
Moreno, Isabel, 178, 179, 193<br />
Moreno, Luis Felipe, 128, 154<br />
Moreno A., Gustavo, 223<br />
Moreno Agui<strong>la</strong>r, María E., 279<br />
Moreno Col<strong>la</strong>do, Clemente, 274<br />
Moreno Macías, Luis Hernando, 128,<br />
133, 136, 139, 140, 148, 154,<br />
449<br />
Moreno Valero, Germán, 200<br />
Morero Parra, Lisandro, 153<br />
Morey, Gilberto, 375<br />
Moreyra, Juan José, 372<br />
Morgan Zavaleta, Ángel, 371<br />
Moriyama, 420<br />
Moscoso, Sebastián, 218<br />
Moscoso Serrano, Eudoro, 200, 202,<br />
221<br />
Mosquera, Hernando, 140<br />
Mostajo Quiroz, Fredy, 370<br />
Mostajo Vargas, Juan José, 373<br />
Mosto, Santiago, 36, 48<br />
Mota, Joaquim, 75, 77, 78, 82, 89<br />
Motta Beltrán, Adriana, 149<br />
Moyano, M., 34<br />
Moynahan, Edmundo J., 278, 451<br />
Muir, Ernest, 161<br />
Muller, Luiz Fernando Bopp, 111<br />
Mullins, Enrique, 177<br />
Mundi, Guillermo Alejandro, 140<br />
Muñoz A., Osvaldo, 223<br />
Murgueytio Stacey, Raúl, 200, 202,<br />
206, 208<br />
Murillo, Manuel, 437<br />
Muschietti, A., 34<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
N<br />
Naar, Julio César, 140<br />
Nacucchio, Marcelo, 222<br />
Nagaro, Pablo, 373<br />
Nahuel, Raquel, 176, 179<br />
Nanni, María Elizabeth, 109<br />
Náquira, César, 346<br />
Naranjo A., Hugo, 436<br />
Natale, Carlos <strong>de</strong>, 44<br />
Nauck, Ernst Georg, 346<br />
Nava, Luis, 67, 68, 69<br />
Navarro César, Alfonso, 140<br />
Navarro Huamán, Pedro, 320, 335,<br />
338, 339, 374<br />
Navin, Thomas, 245<br />
Negroni, Pablo, 47, 48, 321<br />
Negroni, Ricardo, 47, 64<br />
Neira Cuadra, Jorge Isaac, 9, 13, 281,<br />
289, 290<br />
Neira P., Octavio, 202<br />
Neumann Scheffer, León, 9, 13, 265,<br />
273, 274<br />
Neves, René Garrido, 86, 89, 90, 101,<br />
102<br />
Newman, Julius, 227<br />
Neyra, José, 330<br />
Nogueira, Ana Maria, 107<br />
Nonohay, Ulisses <strong>de</strong>, 111<br />
Nopper, Amy, 61, 63, 306<br />
Nor<strong>de</strong>nskiold, Barón, 299<br />
Noria, Víctor, 358<br />
Nouel, Adolfo Arthur, 393<br />
Noussitou, Fernando, 35, 36, 39, 48<br />
Nu<strong>de</strong>nberg, Alberto, 41<br />
Nu<strong>de</strong>nberg, Bernardo, 41, 49, 50<br />
Núñez Andra<strong>de</strong>, Roberto, 277<br />
O<br />
Oliveros (voir Briceño)<br />
O’ Daly, J. A., 433<br />
Obadía Serfaty, Jacobo, 435, 438, 439<br />
Obregón (voir León)<br />
Obregón Sevil<strong>la</strong>no, Lisandro, 373, 376<br />
Ocampo Candiani, Jorge, 274<br />
Ochoa, Amparo, 135, 136, 141, 148<br />
Ochoa Cobos, José Humberto, 217<br />
Ochoa M., Xavier, 223<br />
Odriozo<strong>la</strong>, E., 355, 365<br />
Ojeda, Beatriz, 204<br />
Olchansky, Manuel, 36<br />
Olivares, Liliana, 40, 47, 48, 49, 50, 449<br />
Olivari, Ezio, 178<br />
Oliveira Filho, Jayme <strong>de</strong>, 444<br />
Oliveira, Sônia Antunes <strong>de</strong>, 98<br />
Oliver, Margarita, 440<br />
Ol<strong>la</strong>gue Loayza, Wences<strong>la</strong>o, 200, 201,<br />
202, 203, 204, 205, 206, 207,<br />
220, 221, 321<br />
Ol<strong>la</strong>gue Torres, José María, 205, 207,<br />
221, 449<br />
Oller, Francisco, 382<br />
Olmos Castro, Norberto, 43<br />
Oporto Gatica, Manuel, 185<br />
Opromol<strong>la</strong>, Milton W<strong>la</strong>dimir Araújo,<br />
108<br />
Oramas, José, 216<br />
Orel<strong>la</strong>na, Isabel <strong>de</strong>, 245<br />
Orol Arias, Ceferino, 34, 35, 424<br />
Ormaza Hinestrosa, Adolfo, 128, 138,<br />
140<br />
Oroz Montiglio, Julia, 173, 182, 186,<br />
189, 192, 193<br />
Orozco, Miguel A., 41<br />
Orozco Covarrubias, María <strong>de</strong> <strong>la</strong> Luz,<br />
279<br />
Orozco Topete, Rocío, 274<br />
Orsini, Olyntho, 96, 97<br />
Ortega, Antonio, 216<br />
Ortega, Juan José, 243<br />
Ortega, Miguel, 390, 397<br />
Ortega, Rinna, 184<br />
Ortiz, Donaldo, 140<br />
Ortiz, Luis Guillermo, 384<br />
Ortiz, Pedro, 343<br />
Ortiz, Salvador, 252<br />
Ortiz, Yo<strong>la</strong>nda, 9, 13, 265, 273, 274,<br />
306<br />
Ortiz Medina, Aníbal, 42, 45<br />
Ortiz Monasterio, Fernando, 227<br />
Osa, Ovidio <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 160, 161<br />
Osorio, Laureano, 148<br />
Osorio Camacho, Enrique Alonso,<br />
127, 138<br />
Ospina Alzate, José F., 141<br />
Otamendi, R., 441<br />
Oteiza, Alberto, 161<br />
Otero Marrugo, Víctor, 137, 141, 154<br />
Othaz, Ernesto L., 43<br />
Oviedo, Belia <strong>de</strong>, 41<br />
Oxilia, Mario, 47<br />
Oyarzún Carrillo, Fernando, 177, 180,<br />
189<br />
473
INDEX ONOMASTIQUE<br />
474<br />
P<br />
Pacheco, Aída, 247<br />
Pacheco Mora, Leónidas, 289<br />
Pacheco Solís, Nubia, 288<br />
Padilha-Gonçalves, Antar, 84, 89, 90,<br />
101, 443<br />
Padil<strong>la</strong>, Mariano, 243<br />
Padil<strong>la</strong> Corcuera, Hernán, 371<br />
Padil<strong>la</strong> G., Plínio, 223<br />
Padil<strong>la</strong> y Padil<strong>la</strong>, Carlos, 244<br />
Padrón, Alejandro, 363<br />
Pádua, Antonio <strong>de</strong>, 95<br />
Pagaza, M., 350, 365<br />
Pa<strong>la</strong>cios, Alberto, 48<br />
Pa<strong>la</strong>cios, Manuel, 216, 218<br />
Pa<strong>la</strong>cios, María Teresa, 148<br />
Pa<strong>la</strong>cios, Olga, 346, 354<br />
Pa<strong>la</strong>cios A., Jorge, 202<br />
Pa<strong>la</strong>cios Álvarez, Santiago, 204, 205,<br />
208, 222<br />
Pa<strong>la</strong>cios Bernal, Virginia, 136<br />
Pa<strong>la</strong>cios (voir Bordón)<br />
Pa<strong>la</strong>cios López, Carolina, 279<br />
Pa<strong>la</strong>cios P., Rolendio, 221, 223<br />
Palermo, Eliandre, 109<br />
Palma, Luis Fernando, 135, 142, 145<br />
Palma, R., 348, 350, 364, 365<br />
Palmieri, Jorge, 248<br />
Parada, Mauricio, 180<br />
Pardo Castelló, Vicente, 157, 159,<br />
160, 161, 167, 225<br />
Pardo Vil<strong>la</strong>lba, Guillermo, 126, 137,<br />
137, 144, 145, 153<br />
Pare<strong>de</strong>s, Domingo, 200<br />
Pare<strong>de</strong>s, Horacio Antulio, 245<br />
Pare<strong>de</strong>s, Ricardo, 208<br />
Pare<strong>de</strong>s Llerena, Guido, 373<br />
Pare<strong>de</strong>s Reynoso, Oswaldo, 373, 375<br />
Pareja, Bertha, 354<br />
Pareja, Wences<strong>la</strong>o, 218<br />
Pareja Coronel, Armando, 199<br />
Pargendler, Mirian, 111<br />
Parizzi, 427<br />
Parodi, Arturo, 329<br />
Parodi Bacigalupo, Alfredo, 373<br />
Parra, Cristóbal, 36, 39, 42, 50, 193<br />
Parra, Francisco, 200<br />
Parra, Ricardo <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 125, 131<br />
Parra, Rodrigo <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 176, 181<br />
Parra, Sócrates, 391<br />
Parra (née Pizza), Nélida, 42, 46, 50,<br />
60, 193<br />
Parra (voir Cantú)<br />
Parra Enríquez, Marco Antonio <strong>de</strong> <strong>la</strong>,<br />
175, 176, 180, 186, 189<br />
Parra García, Marlene, 283, 285, 287,<br />
288<br />
Pasarell, Rafael, 384<br />
Paschoal, Francisco Macedo, 90, 109<br />
Paschoal, Luiz Henrique Camargo, 81,<br />
85, 90, 104, 105, 109<br />
Pascua, Ladis<strong>la</strong>o <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 270, 272, 277<br />
Pascutto, Cristina, 47<br />
Pasmanik Guiñerman, Isidoro, 178,<br />
180, 184, 186, 189, 191, 192,<br />
193<br />
Pastrana, Fernanda, 166<br />
Patiño Camargo, Luis, 130, 133, 147,<br />
155, 355, 365<br />
Patrón, Pablo, 319<br />
Patrucco Puig, Raúl, 333, 362, 363<br />
Patrus, Orcanda Andra<strong>de</strong>, 90, 98<br />
Patterson, John, 76<br />
Pau<strong>la</strong>, Ribeiro <strong>de</strong>, 95<br />
Paulo Filho, Thomas <strong>de</strong> Aquino, 95<br />
Payese Gault, José Víctor, 199<br />
Paz Soldán, Carlos Enrique, 324, 339<br />
Paz y Paz, Ramiro, 246<br />
Pazmiño, Pedro, 214<br />
Pazos Vare<strong>la</strong>, Ricardo, 375, 420<br />
Pecolt, T., 74<br />
Pecoraro, Vicente, 41, 50<br />
Pe<strong>de</strong>monte, Luis H., 43, 65<br />
Peluffo, Eucli<strong>de</strong>s, 420<br />
Peniche, Jorge, 222, 273<br />
Peña U., Enmanuel, 202<br />
Peñaherrera Astudillo, Servio, 200,<br />
201, 202, 205, 206, 207, 220<br />
Peñaloza Rodríguez, Isaías, 376<br />
Peñaranda, Elkin, 142, 149<br />
Peragallo, Joaquín, 186<br />
Peralta, Pedro, 317<br />
Pereira, Carlos Adolfo, 88<br />
Pereira, Ignacio, 125<br />
Pereira, José M., 164<br />
Pereira, Luiz Carlos, 111<br />
Pereira Junior, Antônio Carlos, 84, 88,<br />
89, 90, 100, 448<br />
Pereira da Silva, Probo, 414, 418, 424,<br />
427<br />
Pérez, Aivlys, 385<br />
Pérez, Gustavo, 149<br />
Pérez, Lilian, 179, 182<br />
Pérez Alfonso, Ricardo, 307, 438<br />
Pérez Alonso, Alfonso, 282<br />
Pérez Alva, 356<br />
Pérez Chavarría, Edgar, 247, 248<br />
Pérez <strong>de</strong> Arce, Gonzalo, 185, 186<br />
Pérez <strong>de</strong>l Arca, César, 374<br />
Pérez Díaz, Manuel, 432, 433, 434,<br />
435<br />
Pérez-Cotapos Subercaseaux, María<br />
Luisa, 173, 178, 179, 189<br />
Perfetti, Oscar, 441<br />
Périn, Lucien, 423<br />
Peryassú, Demetrio, 83, 89, 101<br />
Peryassú, Marcius, 103<br />
Pesce, Hugo, 326, 327, 333, 343, 346,<br />
350, 356, 357, 364, 365, 366,<br />
375<br />
Pescetto, Fe<strong>de</strong>rico, 175, 189<br />
Pessano, Juan, 35<br />
Pesso<strong>la</strong>ni, Domingo, 305<br />
Petit, Pablo, 214, 319<br />
Pianeta Muñoz, Moisés, 127<br />
Piccone, Zulema, 46, 60<br />
Pierini, Adrián Martín, 9, 11, 17, 45,<br />
46, 48, 59, 60, 306, 307, 451<br />
Pierini, Dagoberto, 45, 48, 59, 278,<br />
417, 451<br />
Pierini, Luis E., 35, 36, 38, 40, 42, 44,<br />
48, 49, 127, 128, 319, 336, 417,<br />
424, 443, 444<br />
Piéro<strong>la</strong>, Luis F., 67, 68, 69<br />
Pignataro Antonio, 61, 63<br />
Pimenta, W., 88<br />
Pimentel, Thimo, 396<br />
Pimentel Imbert, Manuel Felipe, 390,<br />
392, 396, 397<br />
Pineda, Josefa, 282, 287<br />
Pinheiro, Ana Maria Costa, 95<br />
Pinheiro, Francisco, 93<br />
Pinkus, G., 335<br />
Pinto, Antônio Gentil <strong>de</strong> Castro<br />
Cerqueira, 76<br />
Pinto, Jackson Machado, 96<br />
Pinto, Jane Macy Neffá, 103<br />
Pinto Sa<strong>la</strong>s, Rogelio, 374<br />
Piñeiro, Ramón, 384<br />
Piñeiro, Raúl, 161, 163<br />
Piñol Aguadé, Joaquín, 444<br />
Piquero-Martín, Jaime, 9, 15, 307,<br />
429, 435, 437, 438, 439, 440,<br />
442
Piraino, Roberto, 110<br />
Pires, Ane K. Simões, 111<br />
Pires, Mario Cezar, 108<br />
Pires Caldas, María, 76<br />
Pizarro, Pedro, 349<br />
Pizarro, Policarpo, 125<br />
Pizzariello, Gracie<strong>la</strong>, 47<br />
Pizzi (voir Parra)<br />
P<strong>la</strong>ta, Zulma, 140<br />
Podoswa, Gregorio, 279<br />
Politi, Andrés, 48<br />
Polito, E., 34<br />
Pomposiello, Ismael, 36, 417<br />
Ponce <strong>de</strong> León, S., 34<br />
Pons, Adolfo, 433<br />
Pons, Sebastián, 42<br />
Ponzio, H., 448<br />
Porras (voir Quintana)<br />
Porres, Salvador, 243, 248<br />
Porto, Jarbas Anacleto, 75, 85, 89<br />
Porto, Alfredo, 89<br />
Portugal Gallegos, René, 370<br />
Portugal, Hil<strong>de</strong>brando, 83, 89<br />
Portugal, Pedro Menezes, 95<br />
Posada Arango, Andrés, 125<br />
Posada Trujillo, José, 126, 134, 138,<br />
139, 144, 146<br />
Pou, Víctor, 393<br />
Pous, 420<br />
Póvoa, 424<br />
Pozetti, Euri<strong>de</strong>s, 107<br />
Prada (voir Castañeda)<br />
Prado Barrientos, Fabio, 67, 68<br />
Prado Rocha, Fe<strong>de</strong>rico, 283, 285, 286,<br />
287, 289<br />
Prats González, Florencio, 175, 177,<br />
179, 181, 185, 186, 190, 191<br />
Prego, Cándido, 418, 419, 421, 423,<br />
426<br />
Pretelt, José, 140<br />
Primelles, Benjamín, 160<br />
Proença, Nelson Guimarães, 85, 103,<br />
104, 105<br />
Proença, Thais, 104<br />
Prose, Neil, 60<br />
Prunell, Arturo, 423, 426<br />
Prunés Risetti, Luis, 174, 175, 185,<br />
186, 191<br />
Puche, Albio, 129, 140<br />
Puente, José M., 35, 424<br />
Puertas (née Cana<strong>de</strong>ll), Elda, 321,<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
327, 334, 338, 344, 375<br />
Puey, Enrique, 427<br />
Pueyo, Silvia Teresita, 46, 50, 60, 61,<br />
63<br />
Puga, Raúl, 178<br />
Pupo Neto, João Roberto, 109<br />
Purcell Peña, Héctor, 390<br />
Puyó Medina, Luis, 174, 177, 191<br />
Q<br />
Quevedo, Emilio, 153, 154<br />
Quezada R., Alberto, 200, 224, 220<br />
Quezada, Carlos G., 248<br />
Quinete, Sergio, 100<br />
Quintana (née Porras), Luisa, 147,<br />
154<br />
Quintanil<strong>la</strong>, Emilio, 377<br />
Quintero, Alfonso, 147<br />
Quiñones, César A., 10, 14, 381, 384,<br />
386<br />
Quiñones, Jesús, 383<br />
Quiñones, Margarita, 392<br />
Quiñónez, Noemí, 246<br />
Quiroga, Marcial Ignacio, 19, 20, 35,<br />
38, 39, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 56,<br />
162, 334, 417, 424<br />
R<br />
Rabello, Eduardo, 78, 79, 80, 83, 85,<br />
86, 88, 89, 90, 100, 102, 112, 113<br />
Rabello, Francisco Eduardo, 76, 77,<br />
80, 83, 88, 89, 100, 102, 113<br />
Rabelo, José, 386<br />
Rabinovich, Rafael, 338, 344<br />
Raggio, Ximena, 177<br />
Ragusin, Neocle, 34<br />
Raimondo, Antonio, 36<br />
Ramírez, Ana Francisca, 149<br />
Ramírez, Aurea, 384<br />
Ramírez, Jorge, 200<br />
Ramírez, Martha S., 140<br />
Ramírez, Nerys, 393<br />
Ramírez, Or<strong>la</strong>ndo, 442<br />
Ramírez Bravo, Gastón, 177, 185,<br />
186, 193<br />
Ramírez Cienfuegos, Oswaldo, 225,<br />
226, 229, 444<br />
Ramírez Dávalos, Gil, 213<br />
Ramírez Delgado, Pedro, 242<br />
Ramos Arizpe, Sergio, 274<br />
Ramos e Silva, Márcia, 90, 93<br />
Ramos e Silva, João, 76, 88, 89, 90,<br />
101, 111<br />
Rampoldi Bestard, Roberto, 10, 15,<br />
399, 419<br />
Ranalletta, María, 60<br />
Rassi, Divino Miguel, 90, 96<br />
Ravelo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fuente, José <strong>de</strong> Jesús,<br />
390<br />
Razetti, Luis, 432<br />
Reátegui, Augusto, 359<br />
Rebagliati, R., 350, 355, 365<br />
Rebolledo Muñoz, Alfonso, 138, 139,<br />
140, 153<br />
Rega<strong>la</strong>do, Carlos, 343, 375<br />
Rega<strong>la</strong>do Ortiz, Pedro, 163, 165, 166<br />
Reina, Eduardo, 200<br />
Reinoso M., Edgar, 221, 223<br />
Reis, Carmélia Matos, 95<br />
Reis, Vitor Manoel Silva dos, 106, 108<br />
Rendón, Luis, 208, 209<br />
Rendón (née Duarte), Bertha, 200<br />
Rendón Pizano, Iván, 126, 139<br />
Restrepo Molina, Rodrigo, 149<br />
Restrepo Moreno, Ánge<strong>la</strong>, 126, 133,<br />
134, 146<br />
Retamoso, B<strong>la</strong>s, 128<br />
Revelo Hernán<strong>de</strong>z, Gema Esther, 136<br />
Rey, Gabriel, 141<br />
Rey, Pablo, 140<br />
Rey Sánchez, Tarci<strong>la</strong>, 338, 344, 364<br />
Reyes, Antonio, 204<br />
Reyes, Esteban, 225, 226<br />
Reyes, Jorge Humberto, 147<br />
Reyes, Juan <strong>de</strong> los, 241<br />
Reyes Baca, Oswaldo, 205, 208, 221<br />
Reyes Durán, Guillermo, 247<br />
Reyes Flores, Oscar, 10, 15, 429, 435,<br />
438, 440<br />
Reyes García, Gonzalo, 126, 137, 138,<br />
145<br />
Reynafarje Hurtado, César, 356, 370<br />
Ribas, Emilio, 113<br />
Ribas, Jonas, 93<br />
Ricart, J., 448<br />
Rifo, Patricio, 179, 187, 191, 193<br />
Rincón Bracho, Humberto, 440<br />
Rioja Ugaz, Luis, 373<br />
Ríos, Fe<strong>de</strong>rico, 305<br />
Ríos Flores, Marcial, 320, 343, 370,<br />
379<br />
Ríos León, Enrique, 161<br />
475
INDEX ONOMASTIQUE<br />
476<br />
Riscal<strong>la</strong>, Célia, 106<br />
Riva, Librado, 125<br />
Rivaro<strong>la</strong>, Emilce, 42<br />
Rivas, Fernando, 158<br />
Rivas Mejía, Fe<strong>de</strong>rico, 125<br />
Rivas Serrano, Sonia, 289, 290<br />
Riveiro, Carmen, 414, 418<br />
Riveiro Rivera, Roberto, 422, 423<br />
Rivera, Fabio, 128, 140, 146<br />
Rivera, Mónica, 149<br />
Rivera, Víctor M., 383<br />
Rivitti, Evandro, 103, 104, 306, 448,<br />
449<br />
Rizo Patrón Tassara, Carlos, 373<br />
Robiou, Gilberto Baltasar, 390<br />
Robledo Prada, Mary Ann, 133, 150,<br />
151, 154<br />
Robledo Villegas, Mario, 126, 134,<br />
146, 151<br />
Robles, Eugenio, 175<br />
Robles Soto, Miguel Eduardo, 244,<br />
246, 248<br />
Rocha, Glynne Leite, 83, 89, 100<br />
Rocha Lima, 79<br />
Ro<strong>de</strong>iro, Raúl, 36, 44<br />
Rodrigues, Vânia, 107<br />
Rodríguez, Araceli, 61, 63<br />
Rodríguez, Carlos Armando, 118, 132<br />
Rodríguez, Eduardo, 47, 305<br />
Rodríguez, Evangelina, 390<br />
Rodríguez (voir Arévalo)<br />
Rodríguez, Juan A., 423, 426, 427<br />
Rodríguez, Juan José, 226, 228, 229<br />
Rodríguez, Manuel, 46<br />
Rodríguez, Martín, 121<br />
Rodríguez, Tomás, 437<br />
Rodríguez, Virgilio, 128, 140<br />
Rodríguez Barboza, Rosa, 371<br />
Rodríguez Bermú<strong>de</strong>z, José <strong>de</strong>l<br />
Carmen, 118<br />
Rodríguez Castel<strong>la</strong>nos, Rafael, 390<br />
Rodríguez Cuenca, José Vicente, 118,<br />
132, 154<br />
Rodríguez Machado, José, 166<br />
Rodríguez Santamaría, Jesús, 90, 110,<br />
448<br />
Rodríguez Santana, Luis, 438<br />
Rodríguez Toro, Gerzaín, 131, 135,<br />
136, 142, 145, 148<br />
Rodulfo, Sara, 436<br />
Rohmann, Immo, 181<br />
Rojas, Carolina, 436<br />
Rojas, Elí, 383<br />
Rojas, H., 352, 365<br />
Rojas López, Ricardo F<strong>la</strong>minio, 140,<br />
154<br />
Rojas Cana<strong>la</strong>, A<strong>la</strong>n, 180, 182, 186,<br />
189<br />
Rojas Miranda, César, 338, 343, 350,<br />
375<br />
Rojas Paúl, Juan Pablo, 432<br />
Rojas Pizarro, Hilda, 176, 181, 187,<br />
189<br />
Rojas P<strong>la</strong>sencia, Percy, 371<br />
Román Cancino, José Vicente, 123<br />
Román Suárez, Pedro Miguel, 128,<br />
131, 141<br />
Romano Boix, Edgard, 42<br />
Romero, Arturo, 225<br />
Romero, Luis, 320, 343<br />
Romero, Oscar, 162, 314, 320, 333,<br />
338, 339, 343, 344, 346, 365,<br />
370, 373, 378<br />
Romero, Susana, 45<br />
Romitti, Ney, 86, 89, 105, 109<br />
Rondón Lugo, Antonio, 10, 15, 307,<br />
429, 435, 438, 439, 440, 442<br />
Rosa, Ival Peres, 105, 106<br />
Rosado, Marlene, 247<br />
Rosales <strong>de</strong> Martínez, Olga Marina,<br />
246, 247, 248<br />
Rosé Gonzáles, Alejandro, 373<br />
Rosen, Víctor, 419<br />
Rosen<strong>de</strong>, Julián, 423<br />
Rositto, Alicia, 60<br />
Rosner, Simón, 34<br />
Ross Maldonado, Mónica, 189<br />
Rossetti, Nico<strong>la</strong>u, 84, 88, 104<br />
Rossi, Anita, 61, 62, 63<br />
Rotberg, Abrahão, 84, 88, 104, 113<br />
Rothman, Stephen, 38<br />
Rotkier, 421<br />
Rotta, Andrés, 340<br />
Rovere, Pedro, 61, 62, 63, 64, 65<br />
Royo <strong>de</strong> Garfias, Margarita, 278<br />
Ruberto, Rubén, 43<br />
Rubin, Jaime, 46, 68, 69<br />
Rubino, Miguel, 423<br />
Rubinson, Rebeca, 60<br />
Rueda Pinto, Luis, 321<br />
Rueda P<strong>la</strong>ta, Luis Alfredo, 126, 130,<br />
131, 133, 134, 135, 138, 142,<br />
147, 155<br />
Rueda P<strong>la</strong>ta, Ricardo Augusto, 130,<br />
135, 142, 148, 155<br />
Rueda, Xavier, 142, 150<br />
Ruilova S., Vicente, 202, 219<br />
Ruiz, Ánge<strong>la</strong>, 436<br />
Ruiz, Jaime, 177<br />
Ruiz Agüero, José, 371, 376<br />
Ruiz Angulo, José, 252<br />
Ruiz Arroyo, Hiram, 384, 385<br />
Ruiz <strong>de</strong> Zárate, Serafín, 162, 163<br />
Ruiz Delgado, Pedro Juan, 123<br />
Ruiz Espinoza, Jorge, 202, 208<br />
Ruiz Lascano, Alejandro, 41<br />
Ruiz Maldonado, Ramón, 10, 13, 16,<br />
60, 222, 228, 265, 279, 280,<br />
306, 451, 452<br />
Ruiz Santiago, Hiram, 385<br />
Ruiz Soto, María Elena, 320, 375<br />
Ruqué, Luis, 163<br />
Ruso, José, 390<br />
Russo, Paco, 143<br />
Rutowitsch, Márcio Santos, 87, 90,<br />
103<br />
Rutowitsch, Mário, 87, 89<br />
Ruvertoni, Marcelo, 63<br />
S<br />
Saavedra Umpierrez, Tirza, 176, 187,<br />
189, 191<br />
Sabogal, Jairo, 140<br />
Sabogal Rey, Álvaro, 128, 131, 138,<br />
140<br />
Sabouraud, Raymond, 79, 88, 175<br />
Sáenz Ricard, Braulio, 159, 160, 161,<br />
168<br />
Saettone León, Arturo, 377<br />
Sáez <strong>de</strong> Ocaríz, Marimar, 279<br />
Safai, Bijan, 191<br />
Sagaró, Bartolomé, 163, 164, 165<br />
Sal y Rosas, F., 352, 365<br />
Sa<strong>la</strong>iman, Mufith, 141<br />
Sa<strong>la</strong>s, Armando, 435, 438<br />
Sa<strong>la</strong>s Brousset, Arturo, 325, 343, 369,<br />
373, 375<br />
Sa<strong>la</strong>zar Zumarán, José, 374, 375, 377<br />
Sa<strong>la</strong>zar-Leite, Augusto, 443, 444, 445<br />
Salcedo, Eduardo, 149<br />
Salcedo Cabal, Carlos, 127<br />
Saldaña Patiño, Julio, 373, 375<br />
Saldarriaga Arango, Enrique, 126,<br />
139, 146
Salles Gomes, Miguel, 89, 113<br />
Salterain, J. <strong>de</strong>, 423<br />
Salvo, Aurelio, 184<br />
Samayoa, Manuel Antonio, 247, 248<br />
Sampaio, Raimunda Nonata Ribeiro,<br />
95<br />
Sampaio, Sebastião <strong>de</strong> Almeida<br />
Prado, 45, 81, 88, 89, 90, 92,<br />
103, 104, 105, 108, 110, 112,<br />
113, 227, 306, 444, 447, 448,<br />
449<br />
Samper, José María, 124<br />
San Martín, A. M., 47<br />
San Martín Razzeto, José, 319, 336,<br />
338, 339, 344, 345, 374, 375<br />
Sánchez, Antón, 316<br />
Sánchez, Elfida, 393<br />
Sánchez, Gracie<strong>la</strong>, 45<br />
Sánchez, Guillermo, 244<br />
Sánchez, Idalina, 392, 393<br />
Sánchez, Jorge L., 384, 385, 444<br />
Sánchez, José Antonio, 449<br />
Sánchez, Néstor P., 384, 385<br />
Sánchez, William, 143<br />
Sánchez Angarita, Ximena, 154<br />
Sánchez Arbeláez, Julio, 134<br />
Sánchez Basso, 424<br />
Sánchez Caballero, Héctor J., 36, 47<br />
Sánchez Caballero, N., 36, 39<br />
Sánchez Carrión, Faustino, 371<br />
Sánchez Covisa, José, 432, 433, 434<br />
Sánchez <strong>de</strong> Miranda, Andrés, 242<br />
Sánchez Félix, Gadwyn, 374, 375,<br />
377, 448<br />
Sánchez Gómez, Teresa, 279<br />
Sánchez Millán, Leonardo, 176, 189,<br />
191, 192, 452<br />
Sánchez Parejo, Bartolomé, 242<br />
Sánchez Peláez, R., 436<br />
Sánchez Ropero, Martín, 121<br />
Sánchez Saldaña, Leonardo, 373, 375,<br />
377<br />
Sanclemente Mesa, Gloria, 134<br />
Sanclemente (née Mesa), Myriam,<br />
127, 133, 139, 146, 148<br />
Sandino, C<strong>la</strong>udio Galo, 287<br />
Sangüeza, Martín, 307<br />
Sangüeza, Pastor, 68, 69, 70<br />
Sanguinetti, Oscar, 45<br />
Sanjinés, Ángel, 420, 421, 426<br />
Sanjuán <strong>de</strong> los Ríos, Lope, 121<br />
Sans, Nora, 402<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Santacoloma Osorio, Germán, 140,<br />
147, 154<br />
Santan<strong>de</strong>r, Ester, 184<br />
Santiago, Maritza, 392<br />
Santomé, Héctor, 416, 419, 420, 423<br />
Santos, E<strong>la</strong>dio <strong>de</strong> los, 391<br />
Santos, Guillermo <strong>de</strong> los, 390<br />
Santos, Itamar Belo dos, 94<br />
Santos, Josemir Belo dos, 94<br />
Santos, Mi<strong>la</strong>gros, 246, 248<br />
Santos, Valéria Pereira, 109<br />
Santurión, 421<br />
Saraceno, Esteban, 40, 47, 49<br />
Saracho, Eduardo, 68<br />
Saravia, Francisco, 247<br />
Sardi, José Rafael, 435<br />
Sarria Berríos, Or<strong>la</strong>ndo, 283<br />
Sarzosa, Mario, 208, 210<br />
Sasseron, Glória, 109<br />
Saúl, Amado, 10, 13, 165, 265, 275,<br />
391, 445<br />
Savoia, Jorge, 60<br />
Saza, Evencio, 140<br />
Scaltriti, Alberto, 427<br />
Scaltriti, R., 423<br />
Scannone, Francisco, 433, 438, 439,<br />
440, 442<br />
Scappini, Félix, 43<br />
Scappini, J., 47<br />
Schachner, Lawrence, 61, 63<br />
Schaffer Suárez, Hermann Al<strong>la</strong>n, 287,<br />
288, 290<br />
Schaffer Urbina, Hermann Al<strong>la</strong>n, 283,<br />
285, 286, 287, 289<br />
Schafranski, Aída, 111<br />
Schiavi, Álvaro Jr., 111<br />
Schnei<strong>de</strong>r, P., 55<br />
Schnei<strong>de</strong>wind, A., 34<br />
Schnitzler, Roberto, 110<br />
Schroh, Roberto G., 45, 49<br />
Schujman, Salomón, 41, 46, 327, 424<br />
Schwein<strong>de</strong>n, José, 110<br />
Scorza, José V., 436<br />
Segers, Alfredo, 37<br />
Segura, Germán, 427<br />
Sehtman, Lázaro, 321<br />
Sei<strong>de</strong>l Arango, Ánge<strong>la</strong>, 136, 137<br />
Seife, Roberto, 166<br />
Seminario, Carlos M., 34<br />
Sempértegui V., Julio, 202<br />
Seoane, Manuel, 36, 39<br />
Sepúlveda, Ricardo, 183, 186<br />
Serial, Augusto, 42, 47<br />
Serra-Estivell, Juan, 321<br />
Serrano Camargo, Miguel, 126, 137,<br />
138, 145<br />
Serrya, José, 89<br />
Servia, J., 448<br />
Servín, Juan, 305<br />
Sevinsky, Bernardo, 37<br />
Sevinsky, Luis, 44, 47<br />
Siegfried, E<strong>la</strong>ine, 62<br />
Sierra, Beatriz, 139<br />
Sierra, Martha, 136<br />
Sifuentes, Enrique, 338, 343, 375<br />
Sigüenza C., Norma, 223<br />
Siles, Norah, 67, 68<br />
Silva, Armando, 384<br />
Silva, Beatriz <strong>de</strong>, 248<br />
Silva, Domingos Barbosa da, 83, 89, 94<br />
Silva, F<strong>la</strong>viano da, 93<br />
Silva, Manuel José, 125, 137, 145,<br />
153<br />
Silva, Sergio, 178, 182<br />
Silva-Lizama, Eduardo, 10, 13, 231,<br />
240, 245, 246, 248, 253, 264<br />
Silva Martínez, Eduardo, 243, 244,<br />
246, 252, 264<br />
Silva Siwady, José Gerardo, 274<br />
Silvares, Maria Regina, 109<br />
Silveira, Agenor, 106<br />
Silvestre, Eduardo, 185<br />
Simón, Ramón Daniel, 166<br />
Sittart, Alexandre, 105, 106<br />
Small Arana, Octavio, 374<br />
Smith, Archibald, 350<br />
Smitter <strong>de</strong> Sanabria, Anabel<strong>la</strong>, 436<br />
Smoje, Gabrie<strong>la</strong>, 182<br />
Soares, Magali, 109<br />
Sobral, Francisco da Cruz, 321, 444,<br />
445<br />
Sodré, Celso Tavares, 100<br />
Sojos, Nicolás, 218, 219<br />
Sojos, Luis A., 218<br />
So<strong>la</strong>no, Elfrem, 321<br />
So<strong>la</strong>r, Manuel <strong>de</strong>l, 338, 449<br />
So<strong>la</strong>res A<strong>la</strong>va, Efraín, 127, 131<br />
So<strong>la</strong>ri, E., 34<br />
Solís, René, 347<br />
Solomon, Lawrence M., 278, 451<br />
Solórzano <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cerda, Marco Vinicio,<br />
246, 248<br />
477
INDEX ONOMASTIQUE<br />
478<br />
Sommer, Baldomero, 20, 33, 34, 56,<br />
57<br />
Soñé Uribe, Víctor Manuel, 390, 397<br />
Sorensen, Ricardo, 183<br />
Sornas, Spencer, 109<br />
Sosa, Jaime, 296<br />
Sosa, Enrique <strong>de</strong>, 242<br />
Sosa Arto<strong>la</strong>, Belisario, 326, 369<br />
Soto, José Manuel, 435, 438, 439<br />
Soto, Rosamary, 178<br />
Soto Mancipe, Jaime, 134, 135, 136,<br />
141, 142, 143, 148, 154<br />
Soto Sandoval, Haroldo, 246<br />
Sotomayor Tribín, Hugo Armando,<br />
118, 132, 154<br />
Soubhia, Rosa Maria, 107<br />
Soucre, Luis, 442<br />
Souza, Argemiro Rodrigues <strong>de</strong>, 105<br />
Souza, Elemir Macedo <strong>de</strong>, 109<br />
Souza, Mo<strong>de</strong>sto José <strong>de</strong>, 111<br />
Souza, Valeria, 104<br />
Souza Filho, João Basílio <strong>de</strong>, 99<br />
Souza Filho, Jorge José <strong>de</strong>, 87, 89,<br />
112<br />
Sovin, S., 34<br />
Staffeld, Alfredo, 392<br />
Staforelli, Ramón, 179, 193<br />
Stegman, Sam, 227<br />
Steiner, Dense, 107<br />
Stemphelman, Hugo, 40<br />
Stengel, Fernando, 40, 45, 47, 48,<br />
222, 448<br />
Sternick, Manoel, 100<br />
Stirling, Ernesto, 419<br />
Stoff, Hamilton Ometto, 109<br />
Stoichevich, Flora, 43<br />
Sto<strong>la</strong>r, Esther, 47<br />
Stringa, Osvaldo, 47<br />
Stringa, Sergio, 40, 48, 50, 69, 321<br />
Strong, R., 350, 356, 366<br />
Suárez, Jorge, 67, 68, 69<br />
Suárez Eliot, Luis, 320, 370<br />
Suárez Peláez, Enrique, 135, 136,<br />
141, 142<br />
Succi, Isabel, 103<br />
Sudy, Emilio, 178<br />
Suqui<strong>la</strong>ndia, Danny, 452<br />
Svartz, Analía, 44<br />
Sylvester Rasch, Eduardo, 185<br />
T<br />
Táboas, Manuel, 164<br />
Taglioreti, Mario, 423, 427<br />
Tajan Calvo, Alí, 128<br />
Talhari, Sinésio, 90, 93, 99, 101<br />
Tamayo Sánchez, Lour<strong>de</strong>s, 165, 222,<br />
278, 279, 451<br />
Tapia, Arturo, 377<br />
Tapia, Félix J., 437, 440<br />
Tapia, Francisco, 132<br />
Tapia Dueñas, Nicolás, 320, 321, 375,<br />
377, 378, 379<br />
Tartajo, Cristóbal, 242<br />
Tavera, Juan <strong>de</strong> Dios, 125<br />
Tavera, Marie<strong>la</strong>, 142<br />
Taveras, Carmen Yris, 393<br />
Tcheckmedyian, 420, 421<br />
Teive, Víctor <strong>de</strong>, 89<br />
Tejada, Abe<strong>la</strong>rdo, 338, 343, 344, 345,<br />
350, 351, 364, 365<br />
Tejada, Eva, 321<br />
Tello, Enrique E., 40, 41, 47, 50, 319,<br />
337<br />
Tello, Julio C., 312, 372<br />
Tena, Walter, 420<br />
Terán, Manuel, 426<br />
Terra, Fernando, 78, 79, 80, 83, 89,<br />
100<br />
Testart, Jorge, 179<br />
Tiant, Francisco, 161<br />
Timm, Carlos, 200, 201<br />
Tincopa Montoya, Luis, 320, 371, 376<br />
Tincopa Wong, Oscar, 371, 377, 379<br />
Tirado, Herbert, 374<br />
Tiscornia Denis, José María, 419, 420,<br />
421, 423<br />
Tiscornia, Nicolás, 423<br />
Tobar C., José, 223<br />
Tobías, Edith, 248, 254<br />
Tobin, Howar, 227<br />
Tobón Pizarro, Hernán, 127, 138, 139,<br />
144, 147<br />
Tobón, Carlos Enrique, 126, 139, 146<br />
Toledo, Ignacio Segundo, 41<br />
Tolic Rodríguez, A<strong>de</strong><strong>la</strong>ida, 177, 189,<br />
193<br />
Torero, Alberto, 373<br />
Toro Genkel, Luis, 177, 185, 186<br />
Toro Vil<strong>la</strong>, Gabriel, 132<br />
Torok, Eva, 278, 451<br />
Torre, Asdrúbal <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 208<br />
Torrelo, Antonio, 64<br />
Torres, Andrés, 140<br />
Torres, Antonio, 393<br />
Torres, Héctor, 383<br />
Torres, Julio César, 136<br />
Torres, María C<strong>la</strong>udia, 148<br />
Torres, Silvio, 200<br />
Torres, Víctor M., 383<br />
Torres, Zu<strong>la</strong>y, 435<br />
Torres Correa, Rubén, 371<br />
Torres Cortijo, Alberto, 42, 47, 193<br />
Torres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Llosa, Luis, 417, 418, 421,<br />
423, 426, 421<br />
Torres Flores, Dalia, 285, 287<br />
Torres Muñoz, Antonio José, 127,<br />
128, 131, 134, 142, 147, 148<br />
Tost, Juan Francisco, 414, 418, 419,<br />
420, 421, 425, 426<br />
Tregnaghi, Miguel, 64<br />
Trepat, Luis, 34, 36, 59<br />
Trespa<strong>la</strong>cios, Fernando, 161, 162<br />
Trevizo <strong>de</strong> Moreno, María <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s,<br />
278, 279<br />
Trigo, N., 69<br />
Tril<strong>la</strong>, Emilio, 383<br />
Trinda<strong>de</strong> Neto, Pedro Bezerra da, 94,<br />
95<br />
Tróchez Rodríguez, Pablo Alonso, 137,<br />
148<br />
Troielli, Patricia, 39, 47, 49, 50<br />
Trope, Beatriz Moritz, 90<br />
Trujillo Mén<strong>de</strong>z, Rodolfo Augusto,<br />
134, 139<br />
Trujillo Reina, Benjamín, 10, 15, 436,<br />
438<br />
Tschen, Eduardo, 247, 248, 264<br />
Turcio, Rafael, 423, 426<br />
Turjansky, Eliécer, 47<br />
U<br />
Ubogui, J., 47<br />
Ugarriza, Ricardo, 305, 424<br />
Ugaz, Humberto, 338, 343<br />
Ulrich, Marian, 437<br />
Unna, Paul Gerson, 74, 89<br />
Uraga Peña, Enrique, 200, 201, 204,<br />
205, 206, 219, 220<br />
Urbina, Francisco, 178, 179<br />
Urcia, J., 349, 350, 351, 364<br />
Urgilés, Hernán, 223<br />
Uribe Ángel, Manuel, 124
Uribe, C<strong>la</strong>udia, 148<br />
Uribe, José Ignacio, 125, 145<br />
Uribe, Rafael, 147<br />
Uribe Escobar, Gustavo, 126, 130,<br />
133, 134, 135, 146<br />
Uribe Jaramillo, Fabio, 126, 139<br />
Uriburu, J., 34<br />
Uricochea, Luis J., 145<br />
Urquizu Dávi<strong>la</strong>, Pablo Humberto, 10,<br />
13, 231, 247, 248<br />
Urra, Liliana, 184<br />
Urrelo Novoa, Amaro, 319, 369, 375<br />
Urrutia, José, 252<br />
Urruty, Ana, 420<br />
Urteaga, Oscar, 343, 356<br />
Utiyama, Yassubonu, 106<br />
Uttendale, Chantal, 393<br />
V<br />
Vainsencher, 421<br />
Vaisman, Bernardo, 185, 186<br />
Va<strong>la</strong>dares, Jorge, 73<br />
Valbuena Mesa, Martha Cecilia, 150,<br />
151, 154<br />
Valda, Luis, 69, 70, 71<br />
Valdés Alvariño, Andrés, 163, 164<br />
Valdés Arrieta, Pi<strong>la</strong>r, 176, 189, 190,<br />
449<br />
Valdés, José Manuel, 252<br />
Val<strong>de</strong>ttaro, Alfieri, 373<br />
Val<strong>de</strong>z, Raúl, 47<br />
Valdieso, N., 350, 365<br />
Valdivia Blon<strong>de</strong>t, Luis, 10, 14, 320,<br />
323, 339, 367, 373, 375, 376,<br />
377<br />
Valdizán, Hermilio, 319<br />
Valdovinos (née Galeano), Gloria, 378<br />
Valega, Juan Francisco, 346<br />
Valença, Zirelli, 95<br />
Valenzue<strong>la</strong> Valver<strong>de</strong>, Alfredo, 199<br />
Val<strong>la</strong>dares, Edgar Manolo, 245<br />
Valle, Lidia, 10, 11, 36, 39, 46, 48, 60<br />
Vallejo Cadavid, Fernando, 146, 154<br />
Vallejo y Vallejo, Luis, 43<br />
Valver<strong>de</strong> Bejarano, Daniel, 374<br />
Valver<strong>de</strong> López, Jenny, 371<br />
Van <strong>de</strong>n En<strong>de</strong>n, Lucía, 140, 147, 150<br />
Vanoni Martínez, Magdalena, 202,<br />
208<br />
Vaquero, Noemí, 47<br />
Vare<strong>la</strong>, Nieves, 419<br />
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Vare<strong>la</strong> Hernán<strong>de</strong>z, César Iván, 10, 12,<br />
117, 121, 122, 137, 138, 139,<br />
142, 148, 149, 150, 151, 155<br />
Vargas, Jorge, 141, 449<br />
Vargas, José María, 431<br />
Vargas, Marcelino S., 125<br />
Vargas, Myriam Jazmín, 139, 148<br />
Vargas Montiel, Hernán, 10, 15, 429,<br />
436, 438, 440<br />
Vargas Morales, Pedro, 324<br />
Vargas Reyes, Antonio, 124, 130<br />
Vargas Uribe, Juan Bautista <strong>de</strong>, 123<br />
Vásquez, Isabel Cristina, 148<br />
Vásquez B<strong>la</strong>nco, Francisco Ro<strong>la</strong>ndo,<br />
246, 247, 248, 249<br />
Vásquez <strong>de</strong> Molina, Juan, 253, 255<br />
Vásquez Lobo, Armando, 140, 153<br />
Vázquez, Honorato, 217<br />
Vázquez, Juan Bautista, 215<br />
Vázquez, Mirta, 10, 12, 61, 63<br />
Vázquez, William, 441<br />
Vázquez Botet, Miguel, 385<br />
Vecchio, E. <strong>de</strong>l, 34<br />
Vega, Gloria <strong>de</strong> <strong>la</strong>, 384<br />
Vegas, Martín, 433, 434, 435, 437,<br />
438, 439, 444<br />
Ve<strong>la</strong>sco, Marta, 183<br />
Ve<strong>la</strong>sco Cár<strong>de</strong>nas, Germán, 141, 154<br />
Velásquez, Francisco, 227<br />
Velásquez, Margarita, 133<br />
Velásquez Berruecos, Juan Pedro, 10,<br />
12, 117, 127, 136, 137, 138, 139,<br />
135, 142, 146, 150, 151, 152<br />
Velázquez Arel<strong>la</strong>no, Edmundo, 279<br />
Vélez, Julio César, 140<br />
Vélez, L., 350, 365<br />
Vélez Torres, Rafael, 384<br />
Velutini, Luis Alberto, 435, 438, 440<br />
Vera Mora, Carlos, 177, 180, 186,<br />
189, 190, 192, 448<br />
Ver<strong>de</strong>soto G., José, 223<br />
Vergara, Enrique, 67, 68<br />
Verges, Jorge, 62<br />
Veríssimo, Ril<strong>de</strong>, 109<br />
Viana, Gaspar, 79, 80, 87, 89<br />
Victoria Chaparro, Jairo, 64, 136, 139,<br />
141, 148<br />
Vidal, Guillermo, 303, 304<br />
Vidal, Mateo, 414<br />
Viegas, María Lour<strong>de</strong>s, 90<br />
Vieira, Paulo, 88, 424<br />
Viglioglia, Pablo A., 10, 11, 33, 36, 37,<br />
38, 39, 45, 46, 47, 49, 50, 69,<br />
112, 447, 448<br />
Vignale, Bartolomé, 44, 415, 416,<br />
419, 420, 421, 423, 424, 425,<br />
428<br />
Vignale, Raúl, 10, 15, 221, 222, 306,<br />
413, 415, 416, 417, 420, 421,<br />
427, 448, 449<br />
Vi<strong>la</strong>boa (née Casel<strong>la</strong>), Esther, 414,<br />
418, 419<br />
Vi<strong>la</strong>nova, Xavier, 89, 425, 443<br />
Vil<strong>la</strong>cís, Eduardo, 208<br />
Vil<strong>la</strong>cís, Manuel, 208<br />
Vil<strong>la</strong>cís O., Hernán, 223<br />
Vil<strong>la</strong>gomez, Omar, 67, 68, 69<br />
Vil<strong>la</strong>lba, Lidia Inés, 46<br />
Vil<strong>la</strong>lobos Fernán<strong>de</strong>z, Alejandro, 128,<br />
140<br />
Vil<strong>la</strong>lobos Toro, Daniel, 173, 178, 180,<br />
181, 182, 184, 185, 186, 189,<br />
190, 191, 192, 193<br />
Vil<strong>la</strong>mizar Betancourt, José Rómulo,<br />
145, 154<br />
Vil<strong>la</strong>nueva Ochoa, Carlos, 245, 247,<br />
248<br />
Vil<strong>la</strong>nueva Val<strong>de</strong>z, Neftalí, 244, 245,<br />
247, 248<br />
Vil<strong>la</strong>nueva, Julia, 208<br />
Vil<strong>la</strong>vicencio Ponce, Ricardo, 207,<br />
208, 217<br />
Vintimil<strong>la</strong> A., Jaime, 200, 202, 219<br />
Vio<strong>la</strong>nte, Norma, 279<br />
Vitale, María A., 306<br />
Vivas Arel<strong>la</strong>no, Adolfo, 442<br />
Vivot, Narciso, 36<br />
Vólquez, C<strong>la</strong>udio, 392<br />
W<br />
Wackzol, Esther, 437<br />
Wa<strong>de</strong>, H. W., 161<br />
Wageman, Enrique, 179<br />
Webster, Richard, 227<br />
Weinberg, Samuel, 278<br />
Weinstein Rudoy, Mauricio, 175, 178,<br />
185, 186, 190<br />
Weiss Harvey, Pedro, 313, 319, 325,<br />
342, 343, 348, 349, 350, 352,<br />
353, 356, 364, 365, 369, 375<br />
Weissbluth, Marlene L., 111<br />
Welsh, Oliverio, 274<br />
Wenyon, Ch., 350, 365<br />
Wernicke, R., 34<br />
479
INDEX ONOMASTIQUE<br />
Wilkinson, Félix, 47<br />
Williams, Hunter, 312<br />
Winter, John, 28<br />
Wolf, Juan Carlos, 133<br />
Wolf, René, 176, 180<br />
Wong Galdamez, Antonio, 244, 245,<br />
248<br />
Woscoff, Alberto, 10, 11, 33, 37, 38,<br />
39, 40, 47, 48, 49, 50, 306, 427,<br />
444, 448, 449<br />
Wucherer, Otto, 72, 78<br />
X<br />
Xavier, Célia Antonia, 106<br />
Y<br />
Yamamoto, Kasuya, 278, 451<br />
Yamamoto, Manuel Palomino, 373,<br />
375, 377<br />
Yamashita, Jane Tomimori, 105<br />
Yáñez Garrido, Daniel, 185, 186<br />
Yegres, Francisco, 436<br />
Ye<strong>la</strong>, Joaquín, 243<br />
Yépez, Bernardo, 218<br />
Yépez, Gil, 433<br />
Yerovi, Agustín, 216<br />
Yerovi, Elena, 200, 201<br />
Yong Laos, Alfredo, 375<br />
Yoshiyama Tanaka, Enrique, 375<br />
Yuén, Alberto, 363<br />
Z<br />
Zaba<strong>la</strong>, María Teresa, 62, 63, 65<br />
Zai<strong>de</strong>stein, David, 305<br />
Zaitz, C<strong>la</strong>risse, 90, 104, 115, 306<br />
Zambrano Payán, José Félix, 129, 131,<br />
141<br />
Zambrano, Víctor Manuel, 126, 145,<br />
155, 208<br />
Zamith, Vinicio Arruda, 105<br />
Zamora, Juan Manuel, 307, 448, 449<br />
Zamora, Ramón, 436<br />
Zampese, Márcia S., 111<br />
Zaniboni, Mariana, 109<br />
Zapata, Carlos, 441<br />
Zapata Cárcamo, Lilia, 323, 370<br />
Zapata Gutiérrez, Aníbal, 126, 139<br />
Zárate Ortiz, Catalina, 141, 154<br />
Zárate, Miguel, 140<br />
Zéas Domínguez, Iván, 220, 221, 222,<br />
223, 224<br />
Zeballos, Alfredo, 70<br />
Zegarra Araujo, N., 353, 365<br />
Zegarra Pupi, José, 324<br />
Zegpi, María Soledad, 178, 182<br />
Zegpi Trueba, Emilia, 176, 189<br />
Zerda, Liborio, 132<br />
Zuluaga (voir Ca<strong>de</strong>na)<br />
Zúñiga, Pedro, 258
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Carte <strong>de</strong><br />
l’Amérique
Cet ouvrage a été achevé d’imprimer en avril 2007<br />
sur les presses <strong>de</strong> l’imprimerie<br />
ART & CARACTÈRE<br />
Lavaur (81).<br />
Imprimé en France.
<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong><br />
Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
RICARDO GALIMBERTI, ADRIÁN MARTÍN PIERINI, ANDREA BETTINA CERVINI<br />
Ce livre à été réalisé à l’initiative du comité d’organisation<br />
du XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie. Rédigé par 73 auteurs<br />
représentant <strong>la</strong> communauté <strong>de</strong>rmatologique <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong>, il constitue<br />
le ca<strong>de</strong>au officiel du XXI e Congrès mondial <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie,<br />
organisé à Buenos Aires du 1 er au 5 octobre 2007.<br />
L’<strong>Histoire</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>rmatologie <strong>la</strong>tino-<strong>américaine</strong> est publiée grâce à un fonds<br />
éducatif sans restriction <strong>de</strong>s Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.<br />
EAU THERMALE AVÈNE • DUCRAY • A-DERMA • PIERRE FABRE DERMATOLOGIE<br />
ALFREDO ABREU DANIEL (Cuba), GILBERTO ADAME MIRANDA (Mexique), DANIELLE ALENCAR-PONTE<br />
(Colombie), PABLO I. ALMODÓVAR (Porto Rico), FRANCISCO AMOR GARCÍA (Uruguay), ROBERTO ARENAS<br />
(Mexique), CLAUDIO ARIAS ARGUDO (Équateur), MA. ISABEL ARIAS GÓMEZ (Mexique), JULIO EDUARDO<br />
BAÑOS (Salvador), ANTONIO BARRERA ARENALES (Colombie), AMALIA M. BORES (Argentine), INÉS A.<br />
BORES (Argentine), ZUÑO BURSTEIN (Pérou), HÉCTOR CÁCERES (Pérou), PABLO CAMPOS MACÍAS<br />
(Mexique), FERNANDO CÁRDENAS UZQUIANO (Bolivie) (✝), ANDREA BETTINA CERVINI (Argentine),<br />
MAURICIO COELLO URIGUEN (Équateur), JULIO CORREA (Paraguay), PAULO R. CUNHA (Brésil), SUZZETTE<br />
DE LEÓN G (Guatema<strong>la</strong>), JOSÉ G. DÍAZ ALMEIDA (Cuba), JUAN CARLOS DIEZ DE MEDINA (Bolivie),<br />
MICHEL FAIZAL GEAGEA (Colombie), RAFAEL FALABELLA (Colombie), ELBIO FLORES-CEVALLOS (Pérou),<br />
LUIS FLORES-CEVALLOS (Pérou), RICARDO GALIMBERTI (Argentine), PEDRO GARCÍA ZUBILLAGA<br />
(Argentine), JAIME GIL JARAMILLO (Colombie), FLAVIO GÓMEZ VARGAS (Colombie), CARLOS HORACIO<br />
GONZÁLEZ ROJAS (Colombie), PETER A. GREENBERG CORDERO (Guatema<strong>la</strong>), RUBÉN GUARDA TATÍN<br />
(Chili), GUILLERMO GUTIÉRREZ ALDANA (Colombie), EVELYNE HALPERT (Colombie), ENRIQUE HERNÁNDEZ<br />
PÉREZ (Salvador), RAFAEL ISA ISA (République Dominicaine), ALFREDO LANDER MARCANO (Venezue<strong>la</strong>),<br />
FRANKLIN MADERO IZAGUIRRE (Équateur), MAURO MADERO IZAGUIRRE (Équateur), FERNANDO MAGILL<br />
(Pérou), GRACIELA MANZUR (Argentine), ALDO EDGAR MARTÍNEZ CAMPOS (Nicaragua), JOSÉ ANTONIO<br />
MÁSSIMO (Argentine), JAIRO MESA COCK (Colombie), MARTHA MINIÑO (République Dominicaine), GALO<br />
MONTENEGRO LÓPEZ (Équateur), JORGE ISAAC NEIRA CUADRA (Nicaragua), LEÓN NEUMANN SCHEFFER<br />
(Mexique), YOLANDA ORTIZ (Mexique), ADRIÁN MARTÍN PIERINI (Argentine), LUIS DAVID PIERINI<br />
(Argentine), JAIME PIQUERO MARTÍN (Venezue<strong>la</strong>), LEANA QUINTANILLA SÁNCHEZ (Salvador), CÉSAR<br />
QUIÑÓNEZ (Porto Rico), ROBERTO RAMPOLDI BESTARD (Uruguay), OSCAR REYES FLORES (Venezue<strong>la</strong>),<br />
ANTONIO RONDÓN LUGO (Venezue<strong>la</strong>), RAMÓN RUIZ MALDONADO (Mexique), AMADO SAÚL (Mexique),<br />
EDUARDO SILVA-LIZAMA (Guatema<strong>la</strong>), BENJAMÍN TRUJILLO REINA (Venezue<strong>la</strong>), PABLO HUMBERTO<br />
URQUIZU DÁVILA (Guatema<strong>la</strong>), LUIS VALDIVIA BLONDET (Pérou), LIDIA E. VALLE (Argentine), CÉSAR IVÁN<br />
VARELA HERNÁNDEZ (Colombie), HERNÁN VARGAS MONTIEL (Venezue<strong>la</strong>), MIRTA VÁZQUEZ (Argentine),<br />
JUAN PEDRO VELÁSQUEZ BERRUECOS (Colombie), PABLO A. VIGLIOGLIA (Argentine), RAÚL VIGNALE<br />
(Uruguay), ALBERTO WOSCOFF (Argentine).