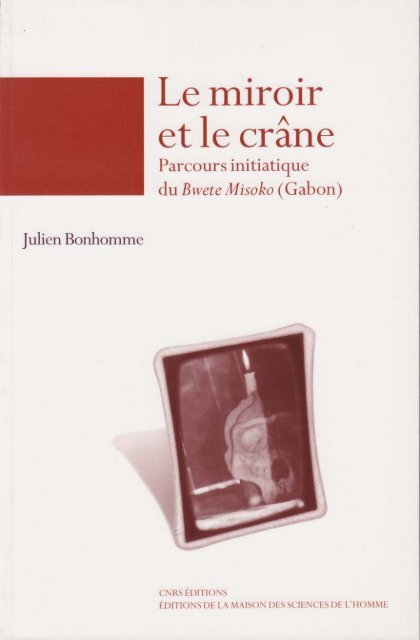Bonhomme Miroir Crane - Julien Bonhomme
Bonhomme Miroir Crane - Julien Bonhomme
Bonhomme Miroir Crane - Julien Bonhomme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
“Oh, Kitty, comme ce serait merveilleux si l’on pouvait entrer dans la Maison du <strong>Miroir</strong> ! Je<br />
suis sûre de ce que je dis, oh ! elle contient tant de belles choses ! Faisons semblant d’avoir<br />
rendu le verre inconsistant comme de la gaze et de pouvoir passer à travers celui-ci. Mais,<br />
ma parole, voici qu’il se change en une sorte de brouillard ! Cela va être un jeu d’enfant que<br />
de le traverser…”<br />
(Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva)<br />
“Enfin bref, la Demoiselle suit Crâne dans sa maison et cette maison, c’était un terrier dans<br />
le sol. Arrivés là, ils entrent tous les deux dans le terrier. Mais c’était un terrier qui n’était<br />
habité que par des Crânes.”<br />
(Amos Tutuola, L’ivrogne dans la brousse)<br />
-2-
Remerciements<br />
Les remerciements d’un travail ethnographique tiennent de la gageure tant l’enquête<br />
de terrain endette le chercheur auprès d’un nombre considérable de personnes sans qui,<br />
évidemment, rien n’aurait été possible.<br />
Je tiens à remercier tout particulièrement :<br />
– au Gabon, G. Salaün pour son hospitalité indéfectible ; les membres du Laboratoire<br />
Universitaire de la Tradition Orale et du Laboratoire d’Anthropologie à l’Université de<br />
Libreville, notamment R. Mayer, J.-É. Mbot, J. Tonda ; A.-C. Ngembet et tous les siens, à qui<br />
je dois énormément ; enfin, ma dette est inacquittable envers les nombreux initiés du Bwete<br />
que j’ai fréquentés 1 .<br />
– en France, en sus de ma famille et mes proches, P. Descola, M. Houseman, A. Mary,<br />
C. Severi, M.-F. Rombi, M. David-Ménard, pour le soutien, les encouragements et les<br />
conseils avisés 2 .<br />
1 J’ai choisi de préserver dans les citations l’anonymat des informateurs, les affaires initiatiques étant un sujet<br />
délicat, surtout quand jalousie et sorcellerie s’en mêlent.<br />
2 Ce livre est tiré d’une thèse de doctorat en anthropologie soutenue à l’EHESS en novembre 2003.<br />
-3-
Note sur l’orthographe<br />
Pour la transcription des termes vernaculaires, j’utilise l’Alphabet Scientifique du<br />
Gabon, élaboré à partir de l’Alphabet Phonétique International par le Laboratoire<br />
Universitaire de la Tradition Orale (Université de Libreville) 3 . Font exception les toponymes<br />
et les noms propres dont la transcription écrite courante provient du français. La notation des<br />
tons est en outre délibérément omise.<br />
Je donne ci-dessous l’alphabet phonologique du getsɔgɔ (groupe linguistique mεmbε,<br />
groupe B30 dans la classification des langues bantu de Guthrie) qui constitue la base de<br />
l’idiome rituel du Bwete 4 .<br />
Getsɔgɔ :<br />
-Voyelles : i, e, ε, a, ɔ, o, u<br />
-Consonnes : b, d, g, k, m, n, p, s, t, v, z<br />
-Semi-voyelles : w, y<br />
-Règles particulières de réalisation phonétique :<br />
v → [β] (fricative bilabiale sonore)<br />
ny → [ɲ] (nasale dorso-palatale)<br />
ts → [ts] ou [tʃ] en variante libre<br />
n → [ŋ] devant /g/, [n] partout ailleurs<br />
z → /z/ ne se rencontre qu’après /n/ sous la forme /nz/ réalisée [nz] ou [nʒ] en variante libre<br />
g → [g] après /n/, [ɣ] (fricative vélaire sonore) partout ailleurs 5 .<br />
Le Gabon compte, selon les auteurs, entre 37 et 62 langues différentes qui relèvent<br />
toutes de la famille linguistique bantu (à l’exception de la langue des pygmées baka du Nord<br />
Gabon qui appartient au groupe oubanguien). Le français étant la seule langue véhiculaire à<br />
l’échelle nationale, nombre de propos rapportés dans ce travail m’ont ainsi été livrés en<br />
français.<br />
3<br />
“Alphabet scientifique des langues du Gabon”, Revue Gabonaise des Sciences de l’Homme, n°2, 1990.<br />
4<br />
Les langues vernaculaires différencient les termes désignant le collectif pluriel de l’ethnie (mitsɔgɔ), un<br />
locuteur singulier (motsɔgɔ) et sa langue (getsɔgɔ).<br />
5<br />
On note l’absence des phonèmes /l/ et /r/, présents dans des langues voisines du même groupe linguistique. Le<br />
yipunu ou le yisangu (groupe mεryε) font également usage des phonèmes /f/ et /j/.<br />
-4-
Cartes du Gabon<br />
-5-
Cette carte mentionne les ethnies principales du Gabon et les zones de l’enquête de<br />
terrain. Elle distingue également les trois groupes ethnolinguistiques les plus cités dans cet<br />
ouvrage. Les mεmbε regroupent les six ethnies mitsɔgɔ, gapinzi, bavove, baviya, simba,<br />
bakande (groupe B30 dans la classification des langues bantu de Guthrie) et correspondent à<br />
l’entité administrative kande-tsogo. Les mεryε regroupent les masangu, bapunu, gisira,<br />
bavungu, balumbu, bavarama, ngubi (groupe B40 de Guthrie) et correspondent à l’entité<br />
administrative sira-punu. Les myεnε regroupent les galwa, mpongwε, orungu, nkɔmi,<br />
adyumba, enenga (groupe B10 de Guthrie) 6 . Sur une population nationale d’un million<br />
d’habitants, les kande-tsogo représente 3-4%, les sira-punu 34%, et les myεnε 5-6%. Cette<br />
carte donne à voir le territoire traditionnel d’une ethnie, territoire qui ne correspond pas<br />
exactement aux zones effectives de peuplement du fait des mouvements migratoires et de<br />
l’urbanisation.<br />
6 Mais, ni l’inventaire des langues et ethnies, ni leur appariement en groupes homogènes ne font l’objet d’un<br />
consensus (Idiata 2002).<br />
-6-
Introduction<br />
La scène se passe au cœur d’une nuit gabonaise. Pourtant, tout le monde ne dort pas.<br />
Au corps de garde, un homme est assis devant un miroir qu’il scrute, les yeux étonnamment<br />
fixes. Il prend la parole et raconte des scènes étranges qu’il dit voir dans le miroir, apparitions<br />
fantastiques ou sombres histoires de familles. Il les raconte à d’autres hommes qui sont<br />
massés autour de lui, l’écoutent avec attention, et s’exclament à ces récits. Il s’agit d’une<br />
initiation au Bwete. Ce travail a pour ambition de saisir ce qui se passe au cours de cette<br />
scène. Ou plus exactement de comprendre comment ces hommes en sont arrivés à occuper ces<br />
places, l’un derrière le miroir, les autres autour de lui.<br />
Le Bwete (ou Bwiti) est un rituel initiatique masculin, d’origine mitsɔgɔ ou gapinzi<br />
(province de la Ngounié, Gabon central) mais répandu bien au-delà, des bapunu du Gabon<br />
méridional aux fang du Gabon septentrional. Le rite de passage impose l’absorption des<br />
racines hallucinogènes de l’arbuste eboga (Tabernanthe iboga) à des fins visionnaires 7 . Le<br />
Bwete repose ainsi sur une nette division entre profane et initié, séparation qui s’articule<br />
autour du rôle fondamental des visions et du secret. Entre initiés prévaut le principe<br />
hiérarchique de la séniorité, transposé de la parenté lignagère vers la parenté initiatique : le<br />
cadet banzi, l’initié confirmé kombo ou nganga, l’aîné et père initiateur nyima. L’organisation<br />
sociologique des communautés du Bwete est acéphale : chaque communauté initiatique est<br />
organisée de manière autonome au niveau du village ou du quartier, autour d’un corps de<br />
garde (mbandja) qui sert de temple, avec à sa tête un père initiateur ou un collège d’aînés –<br />
tous les initiés dépendant d’un même corps de garde n’habitant toutefois pas à demeure. Ce<br />
principe d’autonomie n’empêche pas la circulation intense des initiés entre communautés<br />
locales, au gré des affinités et des alliances.<br />
Le Bwete se ramifie en diverses branches et sous-branches, selon les images<br />
autochtones de l’arbre, des chemins ou des bras de rivière. Le Disumba représente les racines<br />
de cet arbre, ou selon une autre métaphore, la mère de tous les autres Bwete. Cette primauté<br />
est à la fois une antériorité historique et une prééminence hiérarchique. Dans les villages où le<br />
Bwete Disumba est en vigueur (notamment chez les mitsɔgɔ et gapinzi), les garçons doivent<br />
se faire initier (entre dix et quinze ans) pour devenir de vrais hommes et participer aux<br />
7 “Eboga” vient du verbe “bogaga” qui signifie “soigner”. Le français local dit communément “iboga” ou<br />
encore “bois sacré” ou “bois amer”. L’utilisation d’hallucinogènes est un fait plutôt rare en Afrique, par<br />
comparaison à l’Amérique (chamanismes amazoniens, Santo Daime, peyotisme de la Native American Church,<br />
etc.).<br />
-7-
décisions collectives prises par la communauté masculine. Le Bwete Disumba est sans doute<br />
né du culte lignager des ancêtres – les reliques d’ancêtres y jouant toujours un rôle de premier<br />
plan – sur lequel est venu se greffer l’usage visionnaire de l’eboga, mais aussi une complexité<br />
rituelle et un enseignement initiatique dont un simple culte des ancêtres peut habituellement<br />
fort bien se passer.<br />
La principale ramification latérale du Bwete est le Misɔkɔ qui représente une véritable<br />
spécialisation fonctionnelle par rapport au Disumba : le Misɔkɔ (et ses sous-branches Myɔbε,<br />
Ngɔndε, Sengedya, etc.) possède une fonction thérapeutique. D’une part, ses initiés sont des<br />
devins-guérisseurs, les nganga-a-Misɔkɔ 8 . D’autre part, on s’y fait initier suite à l’épreuve<br />
d’infortunes répétées. L’initiation est donc individuelle et circonstancielle, alors que celle du<br />
Disumba est collective et quasi-obligatoire. Cette distinction dans l’arborescence du Bwete<br />
correspond ainsi à une ligne de démarcation et d’articulation du champ thérapeutico-religieux<br />
à l’intérieur d’une seule et même société initiatique. Il faut encore dire que si le Disumba est<br />
exclusivement masculin, certaines communautés du Misɔkɔ acceptent aujourd’hui l’initiation<br />
de femmes (qui prennent alors le nom de mabundi).<br />
L’arbre du Bwete et ses branches<br />
Si l’on peut estimer que l’introduction des mabundi remonte à une cinquantaine<br />
d’années tout au plus, on ne peut en revanche avancer aucune date concernant l’origine des<br />
Bwete Disumba et Misɔkɔ. D’une part, l’histoire orale autochtone repousse l’origine du Bwete<br />
dans les limbes des temps mythiques. D’autre part, le Bwete est né dans l’hinterland, bien<br />
avant que les expéditions occidentales ne quittent les comptoirs côtiers pour s’aventurer dans<br />
la grande forêt. Alors que les côtes gabonaises sont atteintes par les navigateurs Portugais dès<br />
1471-1473, il faut atteindre le XIX e siècle pour que l’intérieur du pays commence à être<br />
8 Cette figure du nganga se retrouve dans tout le monde bantu, bien qu’il ne dépende pas forcément d’une société<br />
initiatique aussi développée que le Bwete. Les nganga ont sans doute préexisté au Bwete dans la région du<br />
Gabon, puisque dans sa compilation de 1686, O. Dapper mentionne déjà leur importance dans la zone du Loango<br />
dont la frontière septentrionale atteignait le sud du Gabon actuel (Description de l’Afrique ou du pays des<br />
Nègres, extraits dans Merlet 1991). L’essor du Disumba a ainsi dû constituer un pôle d’attraction pour les<br />
corporations de nganga préexistantes, donnant alors naissance au Bwete Misɔkɔ.<br />
-8-
vraiment exploré. Paul du Chaillu fut le premier à atteindre l’actuelle province de la Ngounié,<br />
berceau du Bwete, en passant par l’estuaire du Fernan-Vaz pour atteindre finalement les<br />
massifs du sud du pays qui portent aujourd’hui son nom. Au cours de ses diverses expéditions<br />
(1855-1865), il note l’existence du Bwete (orthographié Mbuiti) chez les mitsɔgɔ, baviya,<br />
bakεlε, bapunu et masangu, assistant même à une veillée rituelle chez ces derniers (du Chaillu<br />
1996 et 1868) 9 . Dans la seconde moitié du XIX e siècle, la société initiatique est donc déjà bien<br />
installée au centre et au sud du pays. Conformément à l’histoire orale, on peut donc faire<br />
l’hypothèse que le Bwete est né chez les mitsɔgɔ ou les gapinzi à une date indéterminée, et<br />
s’est ensuite diffusé dans toute la région, en passant aux masangu, aux bakεlε et aux autres<br />
populations du groupe mεmbε (baviya, bavove, simba), puis aux populations mεryε (gisira,<br />
bapunu, balumbu, etc.) et de manière périphérique aux myεnε. La progression du Bwete vers<br />
le Nord finit pas atteindre les fang aux alentours de 1910, via les contacts interethniques dans<br />
les chantiers forestiers autour de Lambaréné.<br />
Le Bwete est loin d’être inconnu dans la littérature ethnographique 10 . Mais l’essentiel<br />
des recherches ont concerné le Bwiti fang. Les fang sont pourtant la population la plus<br />
éloignée de la contrée d’origine du rituel initiatique, n’ayant emprunté que tardivement le<br />
Bwete aux autres populations, suite à l’implantation coloniale française. Ils lui ont de plus fait<br />
subir des transformations d’importance (syncrétisme chrétien, orientation prophétique,<br />
condamnation de l’usage des fétiches et des ossements humains) 11 . En revanche, le Bwete<br />
Misɔkɔ est étrangement absent de la littérature ethnographique, alors qu’il est très présent en<br />
milieu urbain comme villageois et qu’il est en pleine expansion. Le recours aux devins-<br />
guérisseurs est bien enraciné au village, par exemple chez les mitsɔgɔ où le Misɔkɔ constitue<br />
un pendant thérapeutique du Disumba. En ville, le recours aux nganga ne fléchit pas, bien au<br />
contraire. Il a pour lui les nouvelles infortunes liées aux épreuves de la vie urbaine, et<br />
symétriquement les opportunités de carrière qu’offre le métier de devin-guérisseur pour des<br />
chômeurs citadins. Le Misɔkɔ peut alors y mener une vie plus indépendante du Disumba<br />
traditionnel qui reste largement villageois.<br />
Comblant ce point aveugle de l’ethnographie, ce travail concerne spécifiquement le<br />
Bwete Misɔkɔ, et plus exactement la sous-branche Ngɔndε spécialisée dans la divination et les<br />
9<br />
Il mentionne également nombre d’autres rituels initiatiques encore en activité aujourd’hui (Mwiri, Nyεmbε,<br />
Ombwiri, Okukwe ou Olɔgɔ), ainsi que la circulation intense de ces rituels au sein des populations.<br />
10<br />
Cf. en bibliographie, les travaux d’A. Raponda-Walker, G. Balandier, O. Gollnhofer, R. Sillans, J. Fernandez,<br />
S. Swiderski, P. Sallée, R. Bureau, A. Mary.<br />
11<br />
Les problématiques de recherche sur le Bwiti fang se sont de ce fait focalisées sur les thèmes de la réaction<br />
culturelle ou du syncrétisme.<br />
-9-
soins 12 . Privilégiant la logique interne du parcours initiatique, j’ai fait le choix d’une certaine<br />
dispersion géographique et d’une certaine hétérogénéité ethnique, enquêtant au sein de<br />
nombreuses communautés de Misɔkɔ (et occasionnellement de Disumba ou d’autres rituels<br />
initiatiques), principalement avec des initiés mitsɔgɔ, bavove, masangu, bapunu ou gisira 13 .<br />
Certes, le rituel ne possède pas une identité immuable par-delà toutes les vicissitudes<br />
historiques ou ethniques. Cependant, la logique des variations et transformations rituelles<br />
n’est pas directement ou du moins pas uniquement ethnique : une même population pratique<br />
communément plusieurs branches du Bwete ; une même branche initiatique peut inversement<br />
être pratiquée par plusieurs groupes ethniques sans variations notables. Il existe de toute façon<br />
une nette homogénéité socioculturelle entre les populations originaires du Gabon central et<br />
méridional que j’ai côtoyées 14 . Et la différence ethnique est d’abord une différence<br />
linguistique : les termes vernaculaires traduits par “ethnie” (eɔngɔ en getsɔgɔ) désignent en<br />
réalité uniquement la langue.<br />
Pour ce qui concerne le champ rituel, la région se distingue par un réseau intriqué de<br />
nombreux rituels initiatiques, soumis à des innovations permanentes et circulant par le biais<br />
de circuits locaux (mariages, migrations économiques, etc.) qui ne placent pas forcément<br />
l’origine ethnique au premier plan. Les points d’accrochage ou de décrochage entre identité<br />
initiatique et identité ethnique sont en effet variables selon les rituels. Bwete Disumba et<br />
Bwete Misɔkɔ diffèrent à ce sujet. Le Disumba est bien porteur d’une identité collective (à la<br />
fois sexuelle et ethnique), puisqu’il faut être initié pour être un vrai homme motsɔgɔ 15 . Par<br />
contraste, le Misɔkɔ n’est pas un vecteur d’identité ethnique, l’infortune étant le lot commun :<br />
le novice y est avant tout identifié par ses coordonnées lignagères, puisque son malheur y<br />
12<br />
La création du Ngɔndε remonte probablement à un siècle environ, provenant des masangu et des bavove au<br />
contact des mitsɔgɔ. Les diverses sous-branches du Misɔkɔ correspondent tantôt à une spécialisation<br />
fonctionnelle (guérisseurs du Myɔbe, devins du Ngɔndε) ou sexuelle (branche féminine des Mabundi), tantôt à<br />
des scissions au sein d’une branche suite à des innovations rituelles (Sengedya issu d’une scission du Ngɔndε).<br />
13<br />
Les données ont été recueillies au cours de plusieurs séjours de terrain (mai-juin 2000, février 2001-janvier<br />
2002, juillet-août 2002, juin-août 2004) couvrant trois principales zones d’enquête (cf. carte supra) : au cœur<br />
traditionnel du Bwete en pays mitsɔgɔ (des villages de Sindara à Ikobé et Etéké, province de la Ngounié) ; dans<br />
la province de l’Estuaire (notamment la route Libreville-Kango où se trouvent une pléthore de communautés<br />
initiatiques de diverses origines ethniques) ; à Koulamoutou et ses environs (province de l’Ogooué-Lolo) dans la<br />
région des bavove qui pratiquent beaucoup la branche Ngɔndε.<br />
14<br />
Pour le système de parenté : terminologies de type Crow, alliances préférentielles, polygamie de prestige, clans<br />
matrilinéaires exogames, résidence patrilocale. Pour les structures économiques : agriculture vivrière sur brûlis<br />
(manioc, taro, igname, banane, palmier à vin et huile, quelques fruitiers), chasse, pêche, artisanat (tissage du<br />
raphia, vannerie, forge). En zone rurale, en l’absence de toute agriculture commerciale, les maigres perspectives<br />
de revenu se réduisent essentiellement aux chantiers forestiers. Pour les structures sociopolitiques : segmentation<br />
lignagère (par englobement du segment minimal jusqu’au clan) et acéphale (le village est la seule véritable unité<br />
locale – il y un chef de village, appartenant au clan fondateur, mais nul chef clanique ou ethnique). Ce système<br />
lignager traditionnel est aujourd’hui intégré dans le réseau des autorités politico-administratives qui se ramifient<br />
de l’État jusqu’au village.<br />
15<br />
Pour le cas particulier du Bwiti fang, variante du Disumba, pris entre renaissance de l’identité ethnique et<br />
prophétisme universaliste, cf. Mary 1999.<br />
-10-
trouve nécessairement sa raison sous la figure d’un parent sorcier. Le Misɔkɔ peut ainsi se<br />
diffuser plus facilement que le Disumba, au gré des infortunes et des emprunts, sans véhiculer<br />
une identité collective bien marquée.<br />
Cette ethnographie du Bwete Misɔkɔ s’inscrit plus largement dans un projet de<br />
renouvellement et d’approfondissement de l’anthropologie du rituel – et plus particulièrement<br />
du sous-ensemble des rites initiatiques. Il s’agit, pour reprendre une formule de Claude Lévi-<br />
Strauss, d’ “étudier le rituel en lui-même et pour lui-même, afin de […] déterminer ses<br />
caractères spécifiques” (1971 : 598). Adoptant une épistémologie empiriste, cet ouvrage part<br />
du principe que le général est dans le particulier plutôt que l’inverse : ce n’est qu’en<br />
s’enfonçant aussi loin que possible dans le détail ethnographique d’un rituel que l’on peut<br />
espérer dégager des propriétés générales ou généralisables concernant le rituel 16 .<br />
Le Bwete Misɔkɔ constitue alors un cas ethnographique exemplaire pour étudier la<br />
logique du “rituel en lui-même et pour lui-même”. Un profane vient au Misɔkɔ pour raisons<br />
d’infortune. Il consulte un devin et, si son cas l’exige, se fait initier en mangeant l’eboga. Un<br />
certain nombre s’en tiennent là, ne voulant pas s’investir davantage dans le Bwete. Pourtant,<br />
l’initiation stricto sensu n’est que la première étape d’un long parcours. Celui qui aura choisi<br />
de faire carrière dans le Bwete Misɔkɔ devra franchir de nombreuses étapes initiatiques et<br />
suivre un apprentissage de plusieurs années. Le Misɔkɔ recouvre ainsi une série de rituels<br />
différenciés et articulés par la logique de la reproduction initiatique. L’une des propriétés<br />
notables du rituel initiatique est en effet sa récursivité auto-référentielle : le processus<br />
initiatique produit les conditions de sa reproduction 17 . Ce livre décrit ainsi le parcours<br />
initiatique du Misɔkɔ qui fait d’un profane (etema) un novice (banzi) puis un initié confirmé et<br />
enfin, éventuellement, un père initiateur (nyima). Mais le Misɔkɔ est également centré sur la<br />
résolution de l’infortune et la formation du devin-guérisseur nganga. A la classique<br />
reproduction novice-initiateur, il faut donc ajouter les séries malade-guérisseur et patient-<br />
devin. La logique interne du parcours initiatique repose en définitive sur un jeu de<br />
permutations conjointes dans le système des places de l’initiation, de la divination et de la<br />
guérison.<br />
16<br />
Cette méthode était déjà celle du Naven de G. Bateson (1936), ambition reprise par Houseman & Severi<br />
(1994).<br />
17<br />
Cf. Zempléni 1991 : 377 : “ce n’est qu’en devenant initiateur qu’on devient pleinement initié”.<br />
-11-
La reproduction initiatique<br />
Pour reprendre une piste ouverte, mais largement laissée inexplorée, par Lévi-Strauss,<br />
trois questions serviront alors de fil directeur à cette étude du parcours initiatique du Bwete<br />
Misɔkɔ : “au cours des rites, de quelle manière distinctive parle-t-on ? Comment gesticule-t-<br />
on ? Et quels critères particuliers président au choix des objets rituels et à leur<br />
manipulation ?” (Lévi-Strauss 1971 : 600) 18 . Cette triple problématique suggère à juste titre<br />
que le rituel constitue avant tout un système spécifique d’interactions – le concept<br />
d’interaction englobant en effet les trois registres. D’une part, les objets rituels sont moins des<br />
symboles abstraits que des supports manipulables – et manipulation signifie action. D’autre<br />
part, la parole rituelle est elle-même un type particulier d’action, et relève donc autant d’une<br />
analyse pragmatique de l’énonciation que d’une analyse sémantique des énoncés. Enfin, ces<br />
actions impliquant évidemment autrui, ce sont des interactions. Pour comprendre les<br />
mécanismes de la reproduction initiatique dans le Bwete Misɔkɔ, nous serons ainsi amenés à<br />
étudier le rituel comme un système récursif d’interlocutions et d’interactions médiatisées par<br />
des objets.<br />
Pour ce faire, on cherchera alors à descendre jusqu’aux actes en situation afin de<br />
dégager la spécificité des contextes rituels. Cette approche résolument pragmatiste va à<br />
l’encontre d’une conception (trop exclusivement) sémiotique des phénomènes rituels : un<br />
rituel se caractérise davantage par ce qu’il fait que par ce qu’il dit. Selon l’approche<br />
sémiotique, le rituel se définirait avant tout par sa fonction de communication, fonction<br />
expressive reposant sur un code symbolique conçu par analogie avec le code linguistique. La<br />
logique rituelle consisterait alors en un ordre symbolique que l’anthropologue aurait pour<br />
tâche de décoder. On ne peut nier, bien sûr, que les représentations symboliques abondent<br />
dans le rituel – l’image de la “forêt de symboles” (Turner 1967) convient d’ailleurs fort bien<br />
au Bwete. Cependant, un rituel ne saurait être réduit à sa mythologie implicite ou explicite.<br />
L’action rituelle ne constitue de toute façon pas une transmission fiable et directe de messages<br />
qui, pris ensemble, formeraient un système symbolique exprimant les valeurs cardinales d’une<br />
18 Les éléments de réponse qu’il donne sont néanmoins trop abstraits et décevants, puisqu’ils le conduisent à<br />
réduire le rite à un “abâtardissement de la pensée consenti aux servitudes de la vie” (1971 : 603).<br />
-12-
culture 19 . Comme nous le verrons, le symbolisme du Bwete se caractérise en effet par<br />
l’ambiguïté, l’indétermination, la surabondance, le paradoxe, le désaccord ou l’idiosyncrasie.<br />
Et dans l’énonciation rituelle, c’est souvent moins le contenu de l’énoncé lui-même que la<br />
relation entre locuteur et allocutaire qui est véritablement en jeu. Le processus initiatique ne<br />
vise pas spécifiquement à communiquer un ordre symbolique, mais plutôt à organiser et<br />
réorganiser les rapports entre différents acteurs.<br />
Il s’agit en définitive d’étudier non des relations abstraites entre symboles mais des<br />
relations dynamiques entre agents. En effet, les multiples interactions rituelles s’organisent<br />
dans une véritable logique relationnelle. La matrice commune des interactions dans le Bwete<br />
Misɔkɔ repose ainsi sur la combinaison de relations asymétriques entre agents : notamment<br />
devin/patient, guérisseur/malade, sorcier/victime, ancêtres/vivants, initié/profane,<br />
homme/femme, aîné/cadet, oncle/neveu, père/fils, mère/enfant. Ces relations dyadiques se<br />
combinent sans cesse dans des relations d’ordre supérieur, si bien que la logique relationnelle<br />
du rituel n’est pas essentiellement binaire. Comme nous le verrons, la logique du secret<br />
initiatique déborde la dyade initié/profane pour inclure également les relations aîné/cadet,<br />
homme/femme, vivant/ancêtres. Cette logique relationnelle n’est en outre pas figée : le<br />
parcours initiatique repose justement sur des séries de permutations dans le système<br />
relationnel des places qui coordonne les interactions rituelles. Ce sont ces jeux de<br />
permutations, de transformations, d’enchaînement ou d’écho entre les différents registres<br />
d’interaction qui sont au principe de la cohérence d’ensemble du Bwete Misɔkɔ. Les contextes<br />
rituels de l’interaction sont donc des cadres contraignants articulés les uns aux autres et<br />
orientés vers la reproduction du système initiatique.<br />
En plaçant ainsi la reproduction initiatique au cœur de l’analyse, ce travail s’écarte<br />
d’une approche (trop exclusivement) fonctionnaliste. On ne peut nier, bien entendu, que le<br />
rituel s’insère dans un contexte social plus large. L’infortune sorcellaire, désordre corporel et<br />
lignager qui sert de point d’entrée dans le cycle initiatique du Misɔkɔ, trouve en effet sa raison<br />
dans une logique sociale qui déborde amplement le cadre du rituel. Si le rituel constitue alors<br />
une scène où peuvent se jouer des “drames sociaux”, nous verrons cependant qu’il ne sert pas<br />
à raccommoder l’ordre lignager menacé par l’infortune, l’initiation ayant au contraire pour<br />
effet de prolonger les tensions et de relancer la sorcellerie 20 . L’explication fonctionnaliste<br />
pêche ainsi souvent par son recours normatif à des causes finales (intégration, cohésion,<br />
19 Je rejoins ainsi les critiques de l’approche sémiotique formulées par Sperber (1974) et Boyer (1980).<br />
20 Sur le rituel comme “drame social”, cf. Turner 1972, Turner 1974.<br />
-13-
homéostasie) trop larges et trop abstraites pour décrire finement l’articulation entre logique<br />
interne du rituel et logique sociale.<br />
On cherchera alors plutôt cette articulation dans la façon dont le processus initiatique<br />
permet de reconfigurer le réseau relationnel de l’initié. Certaines relations en jeu dans le<br />
Misɔkɔ sont des relations internes, n’ayant pas d’existence hors du contexte rituel : ainsi les<br />
relations dyadiques initié/profane, père initiateur/fils initiatique, ou même devin/patient.<br />
D’autres sont aussi des relations externes, au sens où elles préexistent à l’initiation : ainsi les<br />
relations dyadiques sorcier/victime, père/fils, homme/femme, aîné/cadet ou ancêtre/vivants.<br />
L’articulation entre ordre rituel et ordre social réside alors dans la manière dont les dyades<br />
externes sont reprises à un autre niveau dans le Bwete, se combinant avec les dyades internes<br />
pour engendrer des relations d’ordre supérieur. Or, cette articulation n’est pas un simple<br />
rapport d’expression ou d’intégration, puisqu’elle laisse la place à toutes sortes de décalages<br />
et de manipulations : la transposition de la parenté lignagère dans la parenté initiatique repose<br />
par exemple sur une série d’écarts et de ruptures. Il s’agit donc de déterminer de quelle<br />
manière spécifique le Bwete Misɔkɔ met en scène, manipule, joue, décompose et recompose<br />
l’ordre des relations sociales.<br />
On peut dire que c’est l’identité de l’initié qui est ici en jeu, si l’on donne toutefois à<br />
ce terme un sens relationnel et non substantiel : le sujet se caractérise moins par une identité<br />
prédéfinie que par l’ensemble des relations qu’il entretient avec autrui 21 . Il est un index ou un<br />
nœud de relations – à la fois l’un des pôles actifs et le produit de ce champ relationnel. Le<br />
processus initiatique fabrique des initiés en procédant par recomposition des relations<br />
constitutives de la personne. Nous verrons ainsi comment il instaure un autre type de rapport<br />
au lignage, notamment à travers la reconfiguration des relations aux sorciers, aux femmes et<br />
aux ancêtres. L’identité initiatique est donc elle-même une relation : un rapport à soi qui, loin<br />
de se réduire à la tautologie de l’identité, constitue au contraire une relation réflexive d’ordre<br />
supérieur incluant une multiplicité d’autres relations. La transformation initiatique ne se<br />
résume donc pas à un simple changement automatique de statut validé par un rite de passage,<br />
mais mobilise toute une série de complications rituelles qui font progressivement de l’initié<br />
un “homme compliqué”, c’est-à-dire un sujet fabriqué par des relations 22 . La parole constitue<br />
alors une dimension décisive de cette transformation, puisque le Bwete Misɔkɔ forme des<br />
21 C’était déjà l’argument central de M. Leenhardt dans Do Kamo (1971). Cette approche relationnelle de la<br />
personne a été depuis largement reprise, entre autres, par M. Strathern dans The Gender of the Gift (1988) dont<br />
A. Gell (1999a) donne une synthèse éclairante.<br />
22 “Homme compliqué” est le terme français que les fang utilisent couramment pour qualifier le sorcier nem<br />
beyem (Fernandez 1982 : 262). Mais il convient tout aussi bien aux initiés du Bwete Misɔkɔ – les sorciers étant<br />
de toute façon réputés être de grands initiés.<br />
-14-
devins-guérisseurs : il s’agit par là de produire un énonciateur complexe en compliquant la<br />
relation d’interlocution. Le processus initiatique est ainsi adossée à un type spécifique de<br />
discours que l’on peut appeler, à la suite des initiés, la parole du Bwete, et dont il nous faudra<br />
démêler les attendus relationnels.<br />
Nous serons donc amenés à étudier la fabrication de cet homme compliqué qu’est<br />
l’initié à travers l’articulation des différentes configurations relationnelles, en suivant plus<br />
particulièrement les trois fils que sont les modalités rituelles de l’interaction, de l’énonciation<br />
et de la manipulation des objets. Comme nous le verrons, ces configurations interactionnelles<br />
constituent autant de pièges garantissant l’implication des individus dans la communauté<br />
initiatique. Par une véritable ruse de la raison rituelle, les initiés sont ainsi amenés à se<br />
capturer mutuellement dans la société initiatique – l’implication des uns reposant sur celle des<br />
autres. Cette image du piège est d’abord une métaphore autochtone servant à décrire la<br />
divination : le devin parvient à prendre le patient au piège comme un gibier, en le capturant<br />
dans un jeu de signes visibles et d’énoncés. Mais nous verrons pourquoi il n’est pas exagéré<br />
d’étendre la pertinence de cette métaphore, au-delà de la situation divinatoire, à l’ensemble<br />
des configurations relationnelles du Bwete. L’image du piège fait également écho au “piège à<br />
pensée”, formule inventée par P. Smith pour qualifier le lien entre des opérations telles que<br />
sortie de masques ou manipulation de rhombes et l’efficacité spécifique du rituel (Smith 1979<br />
et 1984) 23 . Le Bwete Misɔkɔ repose bien sur une série de pièges à pensée qui organisent le<br />
type de croyance propre au rituel initiatique. Et nous verrons que cette croyance, au plus loin<br />
de l’adhésion crédule, fait la part belle au doute et à l’ambivalence réflexive. Le rituel ne se<br />
réduit cependant pas à un registre cognitif : les pièges à pensée du Bwete sont également des<br />
pièges à émotion, à action et à relation. “Piège relationnel” serait donc préférable à “piège à<br />
pensée” pour bien marquer qu’il s’agit moins de croyances que de dynamiques d’action. C’est<br />
le style d’ensemble des pièges rituels du Bwete que ce livre cherche en définitive à dégager.<br />
Le plan de l’ouvrage suit le parcours initiatique du Bwete Misɔkɔ et ses différentes<br />
étapes. Il est divisé en trois parties qui correspondent aux trois principaux grades initiatiques :<br />
BANZI (novice), NGANGA (initié) et NYIMA (initiateur). La première partie (BANZI) décrit le<br />
cycle initiatique élémentaire qui fait d’un profane un néophyte puis un initié à part entière. Le<br />
chapitre I expose les raisons qui conduisent un profane à l’initiation et décrit les rites de<br />
passage, tandis que les chapitres III et IV concernent les deux étapes initiatiques suivantes. Le<br />
chapitre II retrace l’organisation rituelle d’une veillée de Bwete Misɔkɔ. La seconde partie<br />
(NGANGA) analyse les deux pôles de l’implication des nganga dans la communauté<br />
23 P. Boyer reprend l’expression dans Barricades mystérieuses et pièges à pensée (1988).<br />
-15-
initiatique : d’une part, le travail de devin-guérisseur (chapitre V) ; d’autre part,<br />
l’enseignement initiatique (chapitre VI et VII). La dernière partie (NYIMA) retrace la fin du<br />
parcours rituel qui fait d’un initié un père initiateur : les chapitres X et XII décrivent ainsi les<br />
dernières étapes initiatiques. Les autres chapitres de cette partie concernent plus précisément<br />
l’identité relationnelle de l’initié : le chapitre VIII est consacré à la relation initiatique au<br />
lignage et aux ancêtres, tandis que les chapitres IX et XI analysent plus spécifiquement les<br />
relations que l’initié entretient avec les sorciers et les femmes. Enfin, un long chapitre<br />
conclusif est consacré au style ironique de la relation initiatique.<br />
Deux thèmes reviennent constamment dans plusieurs chapitres, comme des leitmotiv<br />
entêtants : la sorcellerie et la consultation divinatoire. Tout le Bwete Misɔkɔ est construit<br />
contre la sorcellerie, les nganga étant en lutte perpétuelle avec les sorciers. La sorcellerie<br />
revient donc dans chacune des trois parties comme une menace inquiétante : sorcellerie qui<br />
conduit un infortuné à l’initiation (chapitre I), sorcellerie que diagnostiquent et soignent les<br />
nganga (chapitre V), mais aussi ambivalence sorcellaire des initiés (chapitre IX). Pour<br />
déjouer ces sorciers, le Bwete Misɔkɔ forme des devins. Tout le parcours initiatique s’organise<br />
ainsi autour de la maîtrise progressive de la parole divinatoire. La divination revient donc<br />
également dans chacune des trois parties comme un espoir de délivrance de la sorcellerie. La<br />
séance divinatoire est ainsi décrite sous trois point de vue différents : du point de vue du<br />
patient (chapitre I), du point de vue du devin (chapitre V), et enfin du point de vue<br />
supérieurement ironique d’un père initiateur qui en révèle les ruses ambiguës (conclusion).<br />
Avant de clore cette introduction, je dois dire quelques mots de ma position<br />
ethnographique. J’ai été initié au Bwete. Contrairement à R. Jaulin qui avait dû batailler pour<br />
parvenir à se faire initier chez les sara du Tchad (Jaulin 1967), dans mon cas, l’offre est<br />
rapidement venue des initiés eux-mêmes, comme une condition sine qua non de mon travail.<br />
Dans le discours des initiés, l’initiation s’impose pour deux raisons. D’une part, l’initiation est<br />
l’expérience personnelle d’un savoir mystique : on ne peut comprendre le Bwete si on ne l’a<br />
pas vu de ses propres yeux en mangeant l’eboga. D’autre part, l’initiation est le rite de<br />
passage d’une société secrète : un profane n’a accès ni aux significations ni aux séquences<br />
rituelles secrètes. Cette seconde raison était pour moi la plus importante : une procédure<br />
institutionnelle d’autorisation plutôt qu’une quête – bien illusoire – d’un savoir mystique<br />
immédiat. En effet, si les initiés présentent souvent les visions comme la clef du savoir<br />
initiatique, c’est en réalité l’inverse qui est vrai, puisqu’elles ne valent rien sans les<br />
interprétations des aînés.<br />
-16-
L’intégration au groupe des initiés permet ainsi d’accéder à un savoir secret.<br />
L’initiation n’est cependant pas un sésame magique : la transmission du savoir initiatique est<br />
plus une affaire de rétention organisée que de libre divulgation, puisque ce savoir forme<br />
l’assise du pouvoir des aînés. Opter pour l’initiation impose donc une soumission aux aînés<br />
sans garantie d’un accès effectif au savoir. Mais les ethnologues qui ont tenu à rester profanes<br />
ont dû se plier eux aussi aux exigences de leurs informateurs initiés 24 . Profane ou initié, on<br />
n’échappe donc pas aux relations de pouvoir qui déterminent l’accès au savoir. Mais dès lors<br />
que l’on cherche moins à accumuler les données d’un savoir initiatique abstrait qu’à<br />
comprendre la logique concrète de son usage et de sa transmission, être pris avec les cadets<br />
dans le piège de la rétention de l’information orchestrée par les aînés constitue moins une<br />
impasse qu’une épreuve pertinente. Se laisser prendre au piège de la relation initiatique offre<br />
ainsi une source précieuse d’informations objectives quant à la nature de cette relation. Il ne<br />
s’agit donc pas d’empathie ou d’identification mais de structure relationnelle : se trouver pris<br />
dans un dispositif initiatique, fait d’éléments matériels et relationnels parfaitement objectifs<br />
(miroir, obligation de récit, etc.), et en éprouver certains effets 25 .<br />
Une fois dit cela, se pose encore le problème du conflit entre le caractère secret du<br />
savoir initiatique et le caractère public du savoir académique. Se faire initier exige de<br />
respecter les règles de la communauté, au premier rang desquelles se trouve la préservation du<br />
secret : le Bwete ne se divulgue pas à un profane. Or, ce livre est inévitablement amené à<br />
tomber entre les mains de lecteurs profanes. J’y reviendrai plus loin, mais je me dois de<br />
donner déjà quelques précisions afin de ne pas empoisonner la lecture des premiers chapitres<br />
par une suspicion de trahison malhonnête. Mes interlocuteurs initiés savaient que je menais<br />
une recherche universitaire et ont donc accepté de me parler le Bwete en connaissance de<br />
cause. Le père qui m’a initié a même inventé une admirable astuce pour justifier la motivation<br />
singulière de mon initiation et la transgression du secret initiatique. Puisque chacun vient à<br />
l’initiation avec sa “maladie”, il a déclaré publiquement que mon problème personnel n’était<br />
pas une affliction sorcellaire mais tenait au fait qu’il me fallait écrire une thèse sur le Bwete.<br />
Les nganga se devaient donc de tout mettre en œuvre pour résoudre mon problème, même si<br />
cela impliquait une entorse vis-à-vis du secret initiatique. Ce coup de force astucieux a ainsi<br />
permis de réinscrire ma demande singulière dans l’ordre des motivations ordinaires, en faisant<br />
24 Tant O. Gollnhofer pour le Bwete mitsɔgɔ traditionnel que R. Bureau ou A. Mary pour le Bwiti fang – pourtant<br />
réputé plus ouvert – décrivent les sacrifices financiers, la participation active aux veillées, la dépendance à<br />
l’égard des aînés ou leurs stratégies continuelles de diversion.<br />
25 C’est ainsi que J. Favret-Saada décrit sa propre implication ethnographique dans son travail sur la sorcellerie<br />
dans le bocage mayennais : ce n’est que lorsqu’elle a été, malgré elle, prise dans le dispositif sorcellaire (en<br />
position de désorceleuse puis d’ensorcelée) qu’elle a pu en tirer un savoir objectivable (Favret-Saada &<br />
Contreras1981, Favret-Saada 1990).<br />
-17-
d’une recherche universitaire une sorte d’étrange maladie des Blancs et de son achèvement<br />
une guérison – ce qui n’est sans doute pas si éloigné de la vérité. J’ai donc reçu une<br />
autorisation explicite de publication de la part de mes principaux interlocuteurs que je tiens<br />
encore à remercier pour cette décision qui a pu ou peut encore provoquer des litiges avec des<br />
initiés plus récalcitrants. J’espère sincèrement que le Mwiri – l’esprit qui protège le secret<br />
initiatique – n’avalera ni moi ni mes interlocuteurs bavards.<br />
-18-
PREMIERE PARTIE<br />
BANZI<br />
-19-
Chapitre I<br />
Le <strong>Miroir</strong> : vision et initiation<br />
1. Le chemin de l’infortune : la consultation du devin<br />
“Ma famille était dans le Bwete. Tout ça à cause des problèmes. Parce qu’on perdait<br />
trop les gens dans la famille. On n’arrivait plus à comprendre ce qui se passait. C’est comme<br />
ça, c’est arrivé à mon tour. Puisque je suis le seul garçon de la famille, ils [les sorciers] ont<br />
voulu profiter de moi aussi.” Comme le montre ce témoignage d’un initié, c’est le malheur et<br />
la sorcellerie qui motivent l’initiation. Le Bwete Misɔkɔ diffère en cela du Bwete Disumba. Le<br />
Disumba est un rite de passage obligatoire, même si la décision du moment opportun est<br />
laissée au libre choix du novice. Généralement accompagné d’autres camarades, le jeune<br />
garçon part un beau jour manger le bois sacré sans prévenir ses parents – tout au plus avertit-il<br />
son oncle maternel de son entreprise. Tous les hommes sont donc normalement initiés, mais<br />
chaque homme décide librement de se faire initier. Par opposition, l’initiation au Misɔkɔ est<br />
contrainte par l’infortune, même si elle reste circonstancielle : tous les hommes ne sont pas<br />
initiés, mais ceux qui le sont ont été forcés de l’être 26 . Lorsqu’un nganga veut initier un fils,<br />
un neveu ou un beau-frère – comme cela arrive souvent – c’est généralement à l’occasion<br />
d’une série de malheurs.<br />
Le Misɔkɔ se rapproche ainsi des diverses sociétés féminines de possession de la<br />
région, également facultatives et à vocation thérapeutique (Ombwiri, Elɔmbo, Abanzi,<br />
Mbumbayano, Ombudi, Olɔgɔ, Mugulu, Abambo). Cependant, dans ces sociétés de<br />
possession, l’affliction est perçue comme le signe d’une relation singulière avec un génie –<br />
l’initiation permettant de retourner le génie persécuteur en un génie protecteur. Alors que<br />
dans le Misɔkɔ, l’infortune constitue simplement l’occasion malheureuse de l’initiation, mais<br />
jamais le signe d’une élection, l’indice d’un don divinatoire ou le comportement ad hoc<br />
donnant à voir une vocation personnelle (comme c’est le cas dans de nombreux chamanismes<br />
eurasiens ou amérindiens). La maladie en elle-même n’est grosse d’aucune promesse.<br />
L’infortuné consulte un devin, se fait soigner ou initier et “guérit” éventuellement. S’il décide<br />
ensuite de s’impliquer durablement dans le Bwete pour devenir nganga, c’est pour des raisons<br />
personnelles qui ne sont pas directement liées à la nature de l’affliction initiale. Il n’y a<br />
26 Il arrive d’ailleurs que ce soient des parents de l’infortuné qui le contraignent à l’initiation (par exemple, une<br />
belle famille menaçant un homme de reprendre son épouse s’il ne s’initie pas pour faire cesser l’affliction qui<br />
plane sur son foyer).<br />
-20-
pourtant pas de cassure nette entre traitement de l’infortune et formation initiatique, les<br />
premières étapes rituelles illustrant bien ce chevauchement : le plat rituel edika sert à éviter<br />
les empoisonnements, mais possède également une fonction divinatoire. Il faut aussi noter que<br />
le Misɔkɔ ne constitue pas forcément la première initiation de l’impétrant. Les parcours polyinitiatiques<br />
sont en effet le lot commun. Soit parce que certaines initiations sont<br />
complémentaires : un homme doit être initié à la fois au Bwete et au Mwiri ; et l’initiation au<br />
Mwiri appelle bientôt celle du Kɔnɔ. Soit parce que la répétition de l’infortune ou<br />
l’insatisfaction personnelle pousse à se faire initier ailleurs, dans une société rivale ou une<br />
branche voisine – le jeu de la concurrence sévissant sur le marché des biens de salut-<br />
délivrance.<br />
Tâchons maintenant de déterminer ce que désigne cette infortune au principe du<br />
Misɔkɔ. Le banzi est un “malade” (mobεyi en getsɔgɔ, dérivé de ebεa “maladie” et bεaga<br />
“être malade”). Mais fort classiquement, le terme vernaculaire a une extension plus large que<br />
le seul champ des maladies organiques ou même mentales 27 : entrent ainsi dans cette catégorie<br />
celui qui fait des chutes à répétition ou qui perd successivement deux parents, l’enfant en<br />
échec scolaire, le citadin sans travail ou la première épouse délaissée par son mari. Il n’est<br />
donc pas étonnant que dans le français local, “maladie” ait pour synonymes “problème” ou<br />
“malchance”. Le malade n’est pas seulement celui qui souffre dans son corps, c’est avant tout<br />
celui qui subit dans son existence des événements malheureux. En outre, pour en arriver à se<br />
faire initier au Bwete Misɔkɔ, il faut cumuler les malheurs. La maladie ne concerne jamais un<br />
champ univoque d’infortune mais toujours plusieurs registres : selon nos découpages, le mal<br />
est à la fois somatique, psychologique, conjugal, financier, familial 28 . Cette démultiplication<br />
de l’affliction fait prendre conscience que quelque chose ne va pas. Mais ce quelque chose se<br />
soustrait à l’appréhension, planant au-dessus de l’existence comme une menace imprécise<br />
mais omniprésente. Les multiples infortunes particulières ne sont donc que les symptômes<br />
d’une atteinte plus grave qui lierait ensemble les registres du malheur comme les facettes d’un<br />
même problème. Cela se traduit par l’impression vive d’être dans une situation d’impasse,<br />
l’expression “mes chances étaient bloquées” revenant de manière récurrente 29 .<br />
Souvent, c’est alors une série rapprochée d’incidents malchanceux qui précipite la<br />
décision de tout mettre en œuvre pour trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard. La<br />
27<br />
Cf. M. Augé, “Ordre biologique, ordre social : la maladie, forme élémentaire de l’événement” in Le sens du<br />
mal, 1984, pp.35-91.<br />
28<br />
Et les malheurs frappant des parents proches ajoutent en effet à sa propre infortune. Il n’est ainsi pas rare<br />
qu’une mère se fasse initier pour régler les problèmes de ses enfants en même temps que les siens.<br />
29<br />
Ce sentiment d’entrave décrit particulièrement bien le vécu de citadins scolarisés – population très présente<br />
dans les communautés initiatiques urbaines – dont les espoirs de réussite se heurtent à l’absence de perspectives<br />
réelles.<br />
-21-
épétition des malheurs est en effet un signe de sorcellerie. Chuter une fois passe encore, mais<br />
chuter trois fois d’affilée est la preuve que quelqu’un cherche à vous faire tomber. Les<br />
soupçons hésitent cependant souvent entre plusieurs personnes et restent nécessairement<br />
incertains tant qu’un devin n’a pas été consulté. En effet, la sorcellerie est par nature une<br />
dissimulation : le sorcier est invisible car il agit la nuit ou dans le dos de ses victimes. On<br />
suppose donc que l’intentionnalité mauvaise d’un tiers jaloux est au principe de l’infortune,<br />
sans préjuger de l’identité exacte de l’auteur ou des modalités de toute façon occultes de ses<br />
actes. La sorcellerie repose ainsi, par définition, sur la présomption d’un lien causal entre une<br />
intention virtuelle et un malheur effectif, et sur l’impossibilité d’établir la chaîne des causes et<br />
des effets.<br />
Dans un contexte où l’individu se définit d’abord en référence à sa parentèle, la<br />
sorcellerie renvoie avant tout à un problème relationnel au niveau du lignage. C’est pourquoi<br />
le sorcier présumé est toujours un parent 30 . Les rumeurs qui circulent en permanence dans la<br />
famille ou le simple souvenir d’une dispute suffisent alors à faire cristalliser le malheur en<br />
une suspicion de sorcellerie. Les histoires de sorcellerie renvoient ainsi aux antagonismes<br />
interpersonnels qui minent inévitablement l’harmonie toute idéale des relations lignagères.<br />
Elles tournent par exemple souvent autour de conflits d’héritage (spirituel autant que matériel)<br />
entre germains ou entre le fils et le neveu utérin du défunt. Mais parfois, notamment en milieu<br />
urbain, le malheur concerne plus fondamentalement encore le lien même au lignage. De là ces<br />
histoires d’infortune qui se focalisent sur des parents éloignés ou décédés avec lesquels les<br />
individus ne savent plus quelles relations ils entretiennent. Les infortunés sont hantés par des<br />
relations irrésolues et incertaines auxquelles ils rapportent tous leurs malheurs. Parmi les<br />
jeunes adultes sans emploi – population surreprésentée dans les communautés urbaines du<br />
Misɔkɔ –, l’interprétation du malheur se cristallise souvent autour d’un reproche ambigu<br />
adressé aux parents restés au village : au lieu de leur donner les moyens de leur émancipation<br />
et de leur autonomie, ces parents chercheraient au contraire à leur nuire en les abandonnant<br />
sans ressource 31 . Les situations d’échec sont ainsi attribuées à la persécution sorcellaire d’une<br />
parentèle cruellement absente. L’émancipation urbaine a en effet pour revers la vulnérabilité –<br />
un individu sans famille est un individu sans soutien. Dans tous les cas, la sorcellerie renvoie<br />
en définitive à un trouble relationnel qui, sur fond de malheurs répétés, touche le<br />
positionnement problématique de l’individu au sein de son réseau de parentèle.<br />
30 Si les rumeurs de sorcellerie – notamment dans la presse – évoquent souvent des contextes plus larges que le<br />
cadre lignager (sphère politique nationale, immigrés ouest-africains, etc.), l’infortune sorcellaire qui touche<br />
personnellement un individu implique cependant toujours des parents.<br />
31 Sur l’ambivalence des processus d’individualisation dans l’Afrique contemporaine, cf. Marie 1997.<br />
-22-
Cette infortune sorcellaire ne mène toutefois pas directement à l’initiation. Elle passe<br />
d’abord par la consultation d’un nganga-a-Misɔkɔ qui lui seul peut diagnostiquer la nécessité<br />
de manger le bois sacré 32 . Cette consultation divinatoire est ainsi la véritable première étape<br />
de l’insertion dans le circuit initiatique. Parfois même, le patient ne prémédite pas la<br />
consultation du devin, saisissant une occasion à la faveur d’une veillée à laquelle il était<br />
d’abord venu en spectateur. Mû davantage par la curiosité que par le malheur, il se fait alors<br />
consulter et pourra en ressortir convaincu de devoir se faire initier. L’un des adages favoris<br />
des nganga affirme en effet que “tout le monde est malade, même s’il l’ignore”, la<br />
consultation servant justement à révéler cette maladie.<br />
La description de la consultation divinatoire faisant l’objet d’un chapitre spécifique,<br />
contentons nous ici de montrer comment le devin fait de l’initiation un passage nécessaire sur<br />
la voie de la résolution de l’infortune. Après le paiement du prix de la consultation au nganga<br />
et la présentation du patient, la séance divinatoire peut commencer. Le devin scrute son<br />
miroir, trace de mystérieux signes au kaolin sur le corps du patient, puis énonce un certain<br />
nombre d’affirmations concernant sa vie, les maux dont il souffre et leur origine. Cette<br />
consultation donne au patient une version plausible de son expérience du malheur, mobilisant<br />
les catégories nosologiques traditionnelles et confirmant ses soupçons de sorcellerie 33 . L’effet<br />
du discours du devin est tel qu’il n’est pas rare que les patients se mettent à pleurer,<br />
bouleversés d’avoir été percé à jour. Toutes les séances divinatoires ne mènent cependant pas<br />
à l’initiation. La plupart des malades n’en sortent qu’avec la prescription de simples soins.<br />
Certains, toutefois, s’entendent dire que leur cas exige de manger le bois sacré. Comment<br />
distinguer alors simples malades et candidats à l’initiation ?<br />
L’initiation n’est proposée que pour les cas jugés les plus graves par le devin.<br />
Pourtant, elle ne constitue pas un traitement spécifique. Simples malades et futurs initiés<br />
souffrent en fait généralement des mêmes maux. Mais, le devin, qui est la plupart du temps<br />
aussi père initiateur, a tout intérêt à proposer l’initiation. En revanche, le malade souhaite<br />
résoudre son problème au moindre coût – l’initiation étant le traitement le plus onéreux en<br />
termes d’investissement personnel et financier. La divination ne se réduit cependant pas à une<br />
ruse machiavélique au service d’un père initiateur intéressé. Si le devin dit à un patient qu’il<br />
doit s’initier, c’est en réalité pour qu’il puisse découvrir par lui-même l’origine de son mal<br />
32<br />
On consulte souvent différents devins avant toute prise de décision. Mettre ainsi les devins à l’épreuve du<br />
doute témoigne d’un pragmatisme fort éloigné de la croyance candide que l’on prête souvent aux infortunés en<br />
détresse. Selon Gollnhofer & Sillans (1973 : 553), le recours jusqu’à une dizaine de devins est même chose<br />
normale. Un patient peut en outre consulter d’autres devins que ceux du Misɔkɔ (devins de la sagaie,<br />
devineresses du Nyεmbε ou des sociétés de possession).<br />
33<br />
Le nganga se contente le plus souvent de mentionner la responsabilité du matrilignage ou du patrilignage, sans<br />
identifier explicitement le coupable.<br />
-23-
dans les visions d’eboga, et notamment qu’il identifie le parent sorcier responsable.<br />
L’initiation constitue ainsi la promesse d’un approfondissement de la consultation divinatoire.<br />
A cette différence près que ce n’est plus le nganga qui consulte un tiers, mais bien le malade<br />
qui voit par lui-même les tenants et les aboutissants de son problème 34 . Initiation et<br />
consultation s’opposent donc comme l’évidence visuelle s’oppose à la confiance dans le récit<br />
d’un tiers. Les expressions communes qualifiant l’initiation appartiennent effectivement au<br />
champ sémantique de la vision : “voir son propre corps”, “voir sa propre vie”, “découvrir les<br />
choses cachées”.<br />
Comme le disait un père initiateur à un patient : “tu vas découvrir beaucoup de choses,<br />
si vraiment tu veux manger le bois sacré. Dans quelques jours, tu auras le miroir devant toi,<br />
tu vas consulter comme moi. Je serai à côté de toi qui seras le nganga. Ce n’est pas moi qui<br />
vais te dire, c’est toi-même qui va voir. C’est pourquoi je dis le vrai juge, c’est le miroir, c’est<br />
le bois sacré. Celui dont tu as peur, parfois ce n’est pas lui qui te fait du mal. Celui que tu<br />
embrasses, c’est lui qui te bouffe”. L’initiation est ainsi présentée comme la promesse d’une<br />
vérification personnelle : vérification de l’exactitude de la consultation du nganga, mais aussi<br />
souvent vérification des rumeurs sorcellaires, de rêves supposément prémonitoires, de<br />
prédictions familiales. A ce sujet, les initiés qui ont une connaissance du catéchisme ne<br />
manquent jamais de faire référence à Saint Thomas : il faut le voir pour le croire, i.e. il faut<br />
voir dans l’initiation pour croire à la consultation.<br />
Ainsi, le devin propose au patient l’initiation comme une vérification visionnaire de sa<br />
propre consultation. Ce qui sous-entend que la consultation se présente elle-même comme une<br />
parole peut-être mensongère, en tout cas toujours douteuse. En effet, selon les maximes<br />
maintes fois répétées par les nganga à leurs patients, l’initiation n’existe que parce que “les<br />
nganga sont des menteurs” et que “les malades doutent toujours”. Le devin ne signifie pas par<br />
là que tous les autres nganga sont des charlatans et qu’il est le seul à dire le vrai. Il enferme<br />
au contraire délibérément sa parole divinatoire dans le cadre du paradoxe classique<br />
d’Épiménide le Crétois 35 : “moi qui parle, je suis un menteur”. S’il procède de la sorte, c’est<br />
pour laisser planer un doute sur sa consultation et amener ainsi la conclusion essentielle :<br />
34 D’où le fait que l’échec d’un parcours thérapeutique conduise ordinairement à l’initiation : si le nganga n’a<br />
rien pu faire, il ne reste plus au malade qu’à aller lui-même chercher la solution dans l’initiation.<br />
35 L’antinomie d’Épiménide le Crétois qui déclare “tous les Crétois sont des menteurs” est au fondement de la<br />
théorie des types logiques de Russell et de la distinction entre langage et métalangage de la sémantique de<br />
Tarski. Nous verrons que le Bwete est tout entier construit autour de la transgression délibérée d’une telle<br />
conception sémantique de la vérité.<br />
-24-
seule l’initiation est une consultation indubitable et véridique 36 . Ce piège paradoxal sert à<br />
capturer le patient profane dans le Bwete.<br />
La séance divinatoire vise donc moins à imposer des certitudes qu’à proférer des<br />
énoncés troublants pour placer le patient dans un état d’esprit ambivalent, ni complètement<br />
convaincu, ni parfaitement sceptique : “un jour, j’assistais à une veillée. C’est comme ça<br />
qu’un beau-frère vient et me dit, si tu as 500 francs CFA, donne-moi, on va te faire consulter.<br />
Ils m’ont consulté. Et moi je ne croyais pas. Vraiment, on parlait de ma tante, que c’est elle<br />
qui nous gaspillait dans la famille. Un côté, j’ai pris ça en considération. Mais l’autre côté,<br />
j’ai négligé”. Lors de la consultation, l’initiation n’est donc pas acceptée par les patients plus<br />
crédules, mais au contraire par les plus incrédules et les curieux de nature : ceux qui doutent<br />
du bien-fondé de la parole du devin, parole pourtant suffisamment troublante pour qu’ils<br />
veuillent la vérifier par eux-mêmes dans les visions d’eboga. En définitive, ceux qui croient,<br />
on les soigne ; ceux qui doutent, on les initie.<br />
2. Rituels préliminaires<br />
L’initiation, stricto sensu, ne dure qu’un seul jour et comprend deux phases distinctes :<br />
une série de rituels diurnes en forêt, puis la veillée nocturne au cours de laquelle le néophyte<br />
(banzi) mange les racines d’eboga à des fins visionnaires 37 . Le jour de la veillée, père<br />
initiateur et banzi partent en forêt afin d’accomplir les rituels prophylactiques nécessaires au<br />
périlleux voyage initiatique, cette mort temporaire qui voisine toujours avec la mort réelle. Ils<br />
sont accompagnés de quelques aides initiés et d’un parent de confiance du banzi (initié ou<br />
non), témoin capital qui assiste à l’initiation afin que la famille ne puisse ensuite accuser le<br />
père initiateur de sorcellerie. De peur que les sorciers du lignage ne cherchent à faire échouer<br />
l’initiation, les autres parents ne sont prévenus que le lendemain matin, pour constater que le<br />
nouveau banzi se porte bien et recevoir avec lui la bénédiction collective. L’initiation au<br />
Misɔkɔ implique donc une coupure relative de l’initié par rapport à son lignage.<br />
La première tâche consiste à collecter les écorces et plantes nécessaires à l’initiation.<br />
Avant de prélever des écorces, le père initiateur doit obtenir l’accord des mikuku mya go pindi<br />
(litt. “esprits de la forêt”) : après une courte invocation, il frappe le tronc d’un coup de<br />
36 Comme le dit en effet un proverbe, “de l’œil et du nganga, c’est l’œil qui l’emporte”.<br />
37 Mais, lato sensu, l’initiation forme un cycle d’au moins trois cérémonies (veillée d’initiation proprement dite,<br />
veillée d’edika et veillée de remise de bwete). Tant qu’il n’a pas achevé ce premier cycle initiatique, l’initié reste<br />
un banzi, c’est-à-dire un novice en cours d’initiation.<br />
-25-
machette et y colle prestement son oreille pour écouter la réponse de l’arbre 38 . Une autre<br />
modalité de communication avec les esprits sylvestres consiste à décoller un petit losange<br />
d’écorce que l’on fait choir au sol : s’il tombe face interne au-dessus, la réponse est favorable.<br />
Mais l’initiation ayant déjà commencé, il ne saurait être question de la remettre à plus tard. En<br />
cas de réponse négative, l’épreuve est donc répétée jusqu’à obtenir la réponse souhaitée – le<br />
nombre de refus préalables constituant une évaluation prémonitoire des obstacles à surmonter<br />
au cours de l’initiation.<br />
La valeur négative ou affirmative de la réponse au test divinatoire importe donc en<br />
réalité moins que le fait même de la réponse. La procédure divinatoire stipule que<br />
l’orientation du losange d’écorce n’est pas l’effet du hasard mais l’expression intentionnelle<br />
d’un esprit (hypothèse plausible dès lors qu’à chaque tirage aléatoire, deux événements au<br />
moins sont réalisables). L’essentiel n’est alors pas ce que les esprits sylvestres répondent mais<br />
simplement qu’ils répondent. En dehors de toute considération empirique de résultat, la<br />
procédure valide en effet l’énoncé implicite suivant : des agents non-humains se sont<br />
manifestés et sont les garants du bon déroulement de l’initiation. Il s’agit donc moins d’un test<br />
divinatoire – aucune question n’est véritablement posée – que d’une extorsion de<br />
l’assentiment et de la participation des esprits sylvestres avec lesquels les nganga ont un<br />
rapport privilégié puisque la forêt constitue la source principale de leur pharmacopée. Cela<br />
constitue pour le banzi le premier indice que l’initiation n’est pas une manipulation purement<br />
humaine puisque des agents non-humains y tiennent une place décisive.<br />
Le second rituel préliminaire, la confection du fétiche mbando, possède une fonction<br />
plus nettement prophylactique : il s’agit de “blinder” le banzi contre les attaques sorcières.<br />
Dans un petit paquet de tissu sont placés écorces, rognures d’ongle et cheveux. Le père<br />
initiateur y ajoute un peu d’une poudre secrète, ingrédient incontournable de toute préparation<br />
rituelle mais dont le novice ignore encore la nature exacte. Les ongles (pouce et auriculaire<br />
des mains et des pieds) et les cheveux (front et nuque) sont à la fois ceux du banzi et du père<br />
initiateur. Si le mbando est un double du novice, il incorpore donc également la personne du<br />
père initiateur. L’initiation inaugure en effet un processus par lequel le banzi se trouve<br />
irrémédiablement lié à d’autres agents, notamment au père initiateur. L’initié est désormais<br />
pris dans les rets contraignants de la parenté initiatique – ce qu’illustrent matériellement les<br />
objets fétiches comme le mbando. Une fois les ingrédients disposés, le paquet de tissu est<br />
ficelé aussi solidement que possible (la solidité du lien garantissant l’immunité contre les<br />
38 Puisque l’arbre est une personne, ce prélèvement d’écorces constitue une véritable blessure. L’initié soigne<br />
donc la plaie du tronc à vif en la frottant d’un peu d’humus.<br />
-26-
sorciers), maquillé de kaolin blanc (pεmba) et rouge (tsingo), parfois transpercé d’aiguilles<br />
pour dissuader davantage les sorciers. Noix de cola et graine de nzingo (Monodora myristica)<br />
sont ensuite crachées dessus afin d’animer le fétiche 39 .<br />
Le père initiateur enterre ensuite ce double du novice en un lieu caché, au pied d’un<br />
fromager. Le banzi est désormais à l’abri des sorciers puisque “son corps est caché en<br />
brousse”. Lorsqu’un sorcier essaiera de l’attaquer, il n’apercevra à sa place qu’une épaisse<br />
forêt. Ce gage d’immunité a néanmoins pour prix l’assujettissement bien réel des initiés au<br />
père initiateur qui peut toujours menacer d’aller déterrer le mbando à des fins funestes si on<br />
ne lui obéit pas : “il n’y a que papa qui sait où il m’a caché. Tant qu’il ne révèle pas la route<br />
à un sorcier, je ne crains rien”. La coupure de la relation victime/sorcier passe ainsi par<br />
l’établissement d’une nouvelle relation fils initiatique/père initiateur.<br />
L’étape suivante est celle du ifulu, purification par fumigation et sudation qui est l’un<br />
des soins les plus communs du Bwete. Le banzi entre dans une hutte, assemblage sommaire de<br />
feuilles de palmier doté d’une étroite ouverture pour sortir la tête et éviter l’asphyxie. A<br />
l’intérieur des feuilles fraîches et du bois de padouk (Pterocarpus soyauxii) provoquent une<br />
épaisse fumée. Encore suant, le novice est ensuite conduit dans la rivière pour le second rituel<br />
purificateur, le bain mososo (du verbe sosaga “laver”). Faisant face à l’amont, le banzi est<br />
lavé à l’aide d’un mélange préparé dans une large cuvette blanche, contenant diverses feuilles<br />
et écorces (bois au tronc glissant permettant de faire glisser les maux, bois à résine rouge qui<br />
figure le nouveau sang du novice, etc.), boissons (bière, soda, liqueur, parfum), kaolin blanc<br />
et rouge, ainsi que de la poudre secrète du Bwete. Le fond de la cuvette est ensuite versé entre<br />
les jambes du banzi vers l’aval de la rivière, geste qui figure la saleté emportée par l’eau<br />
courante derrière le novice. Cette orientation amont-aval est déterminante : l’amont représente<br />
l’origine, la seconde naissance par laquelle le banzi va passer au cours de son initiation ;<br />
l’aval représente la mort ainsi que l’impureté et l’infortune laissées derrière soi grâce à<br />
l’initiation 40 . Le novice, maintenant purifié, peut alors quitter son pagne noir pour en revêtir<br />
un blanc.<br />
Le banzi est ensuite oint de “pommade des pygmées”, mixture à base d’écorces,<br />
parfum, liqueur et tsingo 41 . Cette pommade porte-bonheur est employée en maquillage dans la<br />
plupart des cérémonies (mariage, naissance, levée de deuil, initiation). Ainsi badigeonné, le<br />
39 C’est le cas pour toute préparation rituelle. Avec les coquilles vides du nzingo, les initiés effectuent également<br />
un test divinatoire sur le modèle de l’épreuve du losange d’écorce (face interne au-dessus, oracle favorable).<br />
40 Dans le mososo du Disumba, cette topologie est encore plus nette : le banzi plonge vers l’amont et passe entre<br />
un losange de branchages figurant le sexe maternel.<br />
41 Ce sont les femmes qui râpent le tsingo, poudre rouge de bois de padouk associée au sang menstruel. Mélangé<br />
au kaolin pour en faire une boule compacte, il est alors appelé kaolin rouge. Sous sa forme pure, on l’attribue<br />
communément aux pygmées, même si toutes les populations bantu du Gabon en produisent également.<br />
-27-
novice est identifié à un pygmée, personnage mythique du Bwete. Ceci marque une nouvelle<br />
étape dans la transformation du banzi dont la guérison passe par une relation privilégiée à<br />
l’espace sauvage de la forêt. Le rituel suivant, parfois omis, est un échange purificateur de<br />
sang entre le banzi et un arbre à résine rouge appelé mugubi (Staudtia gabonensis). Cinq<br />
incisions sont faites sur le corps du banzi (nuque, épaules, lombaires) et de manière<br />
homologue sur le tronc du mugubi. A l’aide de dix bâtonnets distincts (pour éviter toute<br />
contamination), le sang impur du novice et le sang pur de l’arbre sont échangés – l’arbre<br />
prenant sur lui la souillure.<br />
A l’issue de ces rituels préliminaires, le banzi peut alors commencer à manger ses<br />
premières bouchées d’eboga et faire l’épreuve de son épouvantable amertume 42 . Cette<br />
manducation d’eboga constitue le cœur de l’initiation – se faire initier se dit d’ailleurs “a<br />
ma’a maboga” (litt. “il a mangé les eboga”). La Tabernanthe iboga est une apocynacée<br />
arbustive d’Afrique centrale, poussant plus particulièrement au Gabon. Ce fut Henri Baillon<br />
qui créa le genre en 1889 à partir de l’échantillon rapporté du Gabon par un chirurgien de la<br />
Marine, Griffon du Bellay. Son alcaloïde principal, appelé ibogaïne et isolé en 1901 par<br />
Landrin, est un dérivé de la sérotonine qui partage de nombreuses similarités avec<br />
l’harmaline, alcaloïde actif de Banisteriopsis caapi, la liane hallucinogène de nombreux<br />
chamanismes amazoniens (yage ou ayahuasca) 43 . Au Gabon, l’arbuste, qui peut parfois<br />
dépasser les deux mètres, se trouve en forêt à l’état sauvage, mais les initiés en plantent<br />
toujours un pied aux abords du corps de garde. Seules les râpures d’écorces des racines sont<br />
directement ingérées pour l’initiation. Le reste des racines est mis à bouillir pour en tirer une<br />
décoction buvable. En forêt, le père initiateur donne cérémonieusement au banzi agenouillé sa<br />
première pincée d’eboga puis une banane grillée truffée d’écorces. Il est alors temps de<br />
rentrer au village avant que l’état d’incoordination motrice du novice ne le permette plus. Le<br />
banzi doit s’en aller sans se retourner afin de ne pas rendre la bénédiction purificatrice qu’il<br />
est venu prendre en brousse.<br />
42 Pour cette raison, outre “bois sacré”, l’eboga est aussi appelé “bois amer”.<br />
43 Pour la pharmacologie de la plante et son histoire, cf. Goutarel & alii 1992.<br />
-28-
3. Visions initiatiques<br />
Nganga préparant l’eboga<br />
La seconde partie de l’initiation se déroule au village à l’intérieur du corps de garde<br />
(mbandja) ou dans une pièce calme – la concentration étant la condition sine qua non des<br />
visions initiatiques. Le banzi porte pour la première fois l’accoutrement des initiés : vêtu du<br />
cache-sexe ibari (pagne de coton et pièce de raphia passés entre les jambes), entièrement<br />
badigeonné de kaolin blanc, une peau de la genette (mosingi – Genetta tigrina ou servalina)<br />
pendant à sa ceinture, la plume caudale rouge du perroquet gris (ngoso ou kusu – Psittacus<br />
erithacus) ornant son front. Il porte certains des fétiches du père initiateur, confiés à titre de<br />
protection le temps de la veillée. Il tient également en permanence dans sa main droite le<br />
-29-
chasse-mouches kombo, attribut emblématique de l’éloquence, afin de bien marquer le<br />
pouvoir de sa parole visionnaire 44 .<br />
Le banzi est assis sur une natte face à un miroir 45 . Le père initiateur est à ses côtés afin<br />
de veiller sur lui, tandis que les autres initiés, massivement venus pour l’occasion, lui font<br />
face. On lui donne régulièrement de grosses pincées d’eboga qu’il fait passer en buvant la<br />
décoction de racines. Au cours de la nuit, il va ainsi avaler une ou deux petites corbeilles<br />
pleines d’écorces et plusieurs gobelets d’infusion, dépassant très largement la dose stimulante<br />
pour arriver aux effets psychodysleptiques. Le père initiateur estime la quantité nécessaire en<br />
fonction de la corpulence du banzi et de ses réactions. Si le novice réagit lorsqu’on le pique<br />
d’une aiguille ou lui tire les poils, il faut continuer de lui donner l’eboga jusqu’à l’anesthésie.<br />
L’insensibilité ne doit toutefois pas aller jusqu’à la catatonie complète, le banzi devant<br />
toujours pouvoir parler et répondre aux questions des initiés. On secoue donc régulièrement le<br />
banzi, on le fait se lever et sauter, on l’oblige à agiter constamment son chasse-mouches. Il<br />
n’est en outre pas nécessaire de donner beaucoup plus de bois sacré à un banzi qui voit vite et<br />
bien. Le père initiateur interrompt même totalement les prises lorsqu’il estime que le banzi a<br />
“vu son Bwete”, c’est-à-dire qu’il a vu ce qu’il devait et voulait voir.<br />
Le banzi vomit régulièrement au début de la nuit, l’eboga étant un puissant émétique.<br />
Ces vomissements sont encouragés car ils servent à expulser toutes les impuretés du corps.<br />
Les initiés scrutent même les déjections pour y trouver la confirmation d’un empoisonnement<br />
sorcier et ne manquent pas d’y déceler poils pubiens, arêtes de poisson, charbon ou poudre à<br />
fusil. Les vomissements contribuent également à faire de l’initiation une renaissance,<br />
notamment dans la branche du Disumba : le banzi doit vomir jusqu’à la première goutte de<br />
lait maternel, substance blanchâtre supposément reconnaissable parmi les vomissures. Il n’est<br />
alors plus l’enfant de sa mère biologique et peut renaître en tant que fils de la mère mythique<br />
Disumba. L’initiation repose ainsi sur une rupture de la relation maternelle qui se trouve<br />
transposée à un autre niveau. Ces vomissures sont conservées pour être plus tard enterrées en<br />
forêt, car il faut cacher toutes les substances corporelles qui pourraient être utilisées par un<br />
sorcier. Estimation de la juste quantité de bois sacré et élimination des toxines par<br />
vomissements sont d’autant plus importants que l’ingestion d’une dose massive d’eboga<br />
comporte des risques bien réels (délire psychotique persistant, mort par arrêt cardiaque). Du<br />
point de vue des initiés, la manducation d’eboga provoque une excorporation temporaire de<br />
44<br />
Lors des discours publics, les hommes doivent toujours brandir un chasse-mouches afin que leurs paroles<br />
portent.<br />
45<br />
Un autre procédé, moins usité, remplace le miroir par les flammes d’une torche.<br />
-30-
l’esprit, c’est-à-dire une mort passagère et une folie réglée. Poussée trop loin, elle peut donc<br />
devenir mort irréversible ou folie incontrôlée 46 .<br />
Toute la nuit durant, le banzi doit fixer intensément le miroir qui lui fait face, sans<br />
détourner le regard ni trop ciller. Les visions sont en effet le fruit d’une focalisation attentive<br />
sur l’image du miroir. L’eboga est pour cela un auxiliaire de choix : puissant stimulant de la<br />
vigilance, il empêche le sommeil et excite la pensée. L’initiation visionnaire du Bwete se situe<br />
ainsi à l’opposé des rituels initiatiques de possession où les femmes sont prises de crises<br />
violentes 47 . Rapidement après les premières bouchées d’eboga, les initiés impatients exhortent<br />
le banzi à voir et surtout à parler – les deux exigences les plus impérieuses de l’initiation. La<br />
plupart des opérations rituelles accomplies au cours de la nuit ont d’ailleurs pour dessein de<br />
favoriser les visions du novice : torche passée tout autour de lui pour éclairer son chemin et en<br />
chasser les mauvais esprits, collyre (à base de piment) pour lui dessiller les yeux, feuille ou<br />
pagne noir déchiré au-dessus de sa tête pour dégager les obstacles. Enfin, l’arc musical<br />
mongɔngɔ joue en permanence ses mélodies entêtantes pour guider le banzi. En cas de<br />
blocage, un tiers (initié ou parent) peut même manger l’eboga à son tour pour tenter d’aller<br />
ouvrir le chemin du novice. Les échecs visionnaires complets – rares mais possibles – sont<br />
interprétés en termes de résistance intentionnelle : soit le néophyte est tenu pour<br />
personnellement responsable de son échec, en raison de son manque de courage à manger<br />
l’eboga (sous-entendu comme une femme), ou de sa propre malveillance et de son impureté<br />
(sous-entendu comme un sorcier) ; soit un tiers est suspecté d’entraver volontairement son<br />
voyage initiatique et de chercher à le tuer. Mais sous l’effet conjugué de la pression<br />
collective, de l’eboga et de la focalisation sur le miroir, le banzi finit généralement par voir,<br />
ou du moins par parler.<br />
46 De tels accidents, heureusement fort rares, sont toujours interprétés en termes sorcellaires, du moins par la<br />
famille du postulant qui accuse le père initiateur d’avoir empoisonné son parent.<br />
47 Le champ thérapeutico-religieux gabonais est en effet structuré par un contraste très net entre vision masculine<br />
et possession féminine (Mary 1983a).<br />
-31-
Banzi face au miroir<br />
Dans le Bwete Disumba, les banzi initiés par cohorte sont censés parcourir le même<br />
chemin que leurs aînés : une visite à rebours de la cosmogonie collective, à la rencontre des<br />
ancêtres mythiques dans le village de Bwete (le soleil Kombe, sa femme la lune Ngɔndε, leurs<br />
enfants les étoiles Minanga, l’éclair Ngadi, le premier ancêtre Nzambe Kana, etc.). Le<br />
scénario visionnaire est donc invariable, toute vision non conforme étant discréditée. Par<br />
contraste, dans le Bwete Misɔkɔ, chaque banzi vient manger l’eboga pour “voir sa vie” et<br />
l’origine de son infortune personnelle. Il n’y a donc pas de scénario prescrit. Au-delà des<br />
histoires de vie toujours singulières, les registres de l’infortune sont cependant peu nombreux,<br />
et les façons de se positionner face à elle sont toujours les mêmes. La comparaison de<br />
différents récits visionnaires révèle ainsi nombre de traits récurrents. Structure et thèmes sont<br />
suffisamment uniformes pour qu’on puisse dégager un scénario visionnaire idéal-typique.<br />
Lorsqu’on l’installe face au miroir, le banzi voit tout d’abord sa propre image –<br />
évidence qui revêt en réalité une importance capitale. C’est en effet cette image qui se<br />
transforme en premier lieu : “je me transforme en gorille”, “je suis comme un pygmée”, “je<br />
suis un vieillard” 48 . Cette métamorphose du visage est le signe visible d’une transformation<br />
complète de la personne : prisonnier du malheur, le novice sait qu’il ne pourra s’en sortir que<br />
par une modification du rapport qu’il entretient à sa propre existence, modification dont la<br />
vision dans le miroir est le premier indice 49 . Cela s’accompagne souvent d’un changement<br />
soudain de lieu : “je suis en brousse”, “je suis dans le village de mes parents”. Ces<br />
transformations identitaires et spatiales sont la condition de toutes les autres visions. Si la<br />
simple réflexion optique n’offre qu’une identité tautologique, le fait de se voir dans le miroir<br />
48<br />
Les visions, citées ici pour leur représentativité, proviennent des multiples récits visionnaires recueillis<br />
pendant la nuit même de l’initiation.<br />
49<br />
Ce travail réflexif sur soi n’implique pourtant aucun solipsisme : au contraire, la plupart des visions mettent en<br />
scène des rencontres.<br />
-32-
autrement ou autre part instaure en effet un dédoublement problématique du banzi qui<br />
entretient désormais un rapport à la fois d’identification et de distinction avec son image<br />
spéculaire. Il est double, assis au mbandja scrutant un miroir au milieu d’une assemblée<br />
d’initiés, mais aussi ailleurs, dans le miroir ou plutôt de l’autre côté ou au-delà du miroir, dans<br />
le monde du Bwete.<br />
Après ces visions initiales suivent généralement une série de brèves apparitions que le<br />
novice observe du dehors, comme un spectateur passif. Visages, paysages, animaux, objets<br />
s’enchaînent sans cohérence apparente, comme un inventaire à la Prévert : “une femme qui<br />
ressemble à ma grand-mère décédée”, “un singe grimpant à un arbre”, “un panier à l’angle<br />
d’une maison”, “l’ombre d’une jeune femme”, “deux Blancs sur une plage”. Progressivement,<br />
ces images s’animent et deviennent de véritables scènes (selon les termes des initiés, on passe<br />
alors des flashes aux films). Mais le banzi semble réduit à un œil désincarné, voyant sans être<br />
lui-même présent dans une scène qu’il décrit ensuite de l’extérieur (focalisation externe ou<br />
vision du dehors) 50 .<br />
Dans certaines scènes, le banzi parvient cependant à dépasser la perspective de<br />
l’observateur extérieur, pour acquérir un regard quasi-omniscient qui lui donne la capacité de<br />
déceler ce qui échappe à la perception ordinaire et d’assister à des scènes auxquelles il<br />
n’aurait normalement pas dû pouvoir assister (focalisation zéro). Les plus marquantes d’entre<br />
elles sont celles où le banzi observe les manigances d’un sorcier qui croit ne pas pouvoir être<br />
observé : “je vois ma première femme cuisiner un poisson et prélever l’arête pour fabriquer<br />
un médicament [poison]”, “la grand-mère des enfants de ma grande sœur a un bâton de la<br />
nuit [sexe mystique]. Elle entre dans la chambre de ses petits-enfants pour les séduire avec ce<br />
bâton”. Le novice parvient également à se voir lui-même tel que le sorcier l’a affecté (scènes<br />
autoscopiques) : il s’agit le plus souvent de corps entravés ou de membres volés et enfermés.<br />
Il arrive encore à détecter les objets maléfiques dissimulés par le sorcier pour nuire à sa<br />
victime : “au niveau de la porte de la cuisine se trouve un serpent [allié invisible du sorcier].<br />
C’est là où le sorcier urine. Derrière la porte de la cuisine, il y a un trou à l’intérieur duquel<br />
l’ex-femme de tonton K. met le poison”. L’œil halluciné du banzi fonctionne ici comme une<br />
sonde qui perce au jour l’invisible (scènes diascopiques).<br />
Ce voyeurisme visionnaire est donc intimement lié à la sorcellerie, ou plutôt à son<br />
décèlement : le banzi parvient à voir les situations ou actes sorcellaires secrets à l’origine de<br />
50 La distinction des trois niveaux de focalisation (externe, zéro, interne) est empruntée à Genette 1972.<br />
L’opposition entre vision du dehors et vision par derrière provient de Pouillon 1946. Pour les deux auteurs, il<br />
s’agit de qualifier les rapports possibles d’un narrateur à son récit. Je transpose cela à la position du banzi vis-àvis<br />
de ses visions.<br />
-33-
son infortune. Si l’initiation donne accès au “monde mystique” et permet de “voir l’invisible”,<br />
il ne faudrait pas croire que le visionnaire découvre un autre monde, surnaturel et fantastique,<br />
totalement étranger au monde ordinaire. Les visions sont avant tout des scènes de la vie<br />
quotidienne, et même souvent des scènes de la vie familiale. Mais les relations de parenté (ce<br />
que les parents font en plein jour) ont pour revers nocturne les agissements sorciers (ce que<br />
les parents font, par jalousie, dans le dos des autres). Voir l’invisible signifie donc atteindre la<br />
perception crue des agissements malintentionnés au-delà de l’hypocrisie et de la dissimulation<br />
diurnes. Les visions initiatiques donnent l’occasion inestimable – puisque par définition<br />
impossible en situation normale – de prendre le sorcier en flagrant délit 51 . Si le sorcier est<br />
celui qui manigance dans le dos des autres, le visionnaire accomplit alors l’exploit peu<br />
ordinaire de voir par-dessus l’épaule du sorcier, prenant ainsi la sorcellerie à revers. A ces<br />
scènes correspond bien l’expression “vision par-derrière” forgée par J. Pouillon pour désigner<br />
les situations romanesques où le narrateur est un spectateur privilégié qui connaît le dessous<br />
des cartes. Le banzi est le témoin de l’invisible, c’est-à-dire le témoin paradoxal de scènes qui<br />
n’ont ordinairement pas de témoins.<br />
Dans d’autres visions, le point de vue du banzi devient intérieur à la scène<br />
(focalisation interne). Il est le témoin de scènes qui s’adressent directement à lui, les autres y<br />
agissant en fonction de sa présence. Dès lors qu’il est pris dans le point de vue d’un tiers, le<br />
banzi ne peut en effet plus maintenir sa position de spectateur extérieur et passe lui-même<br />
dans le monde invisible, comme happé. Les rencontres deviennent alors possibles. Les<br />
personnages rencontrés se répartissent aisément en adjuvants (parents alliés, père initiateur,<br />
personnages bénéfiques comme Sirènes, Pygmées ou Blancs) ou opposants (parents sorciers<br />
et leurs auxiliaires). Les interactions avec les adjuvants sont essentiellement des remises<br />
d’objets, révélations de secrets ou bénédictions qui sont à interpréter comme des promesses de<br />
fortune, c’est-à-dire des renversements de la situation d’affliction. Manger l’eboga permet<br />
notamment de rencontrer des parents décédés afin de régler post-mortem ce que leur mort<br />
avait laissé en suspens : révélation de la cause véritable de la mort et de l’identité du<br />
coupable, réconciliation, ou règlement de querelles d’héritage qui comptent souvent pour<br />
beaucoup dans les motivations de l’initiation : “mon père me dit que son cœur et son crâne me<br />
sont réservés”. Le voyage initiatique constitue ainsi une véritable quête d’interlocuteurs et de<br />
partenaires. A ce titre, l’un des temps forts des visions est la rencontre avec celui qui divulgue<br />
au banzi son kombo et sa signification ésotérique. Une initiation reste en effet inachevée tant<br />
51 La sorcellerie est quelque chose dont on parle quotidiennement mais que l’on ne voit jamais (ou dont on<br />
constate les effets douloureux sans pouvoir observer les causes).<br />
-34-
que le novice n’a pas reçu un kombo, nom initiatique qui remplacera désormais son nom civil<br />
dans toutes les interactions avec les initiés 52 . Le novice sera acclamé si, outre ce nom, il<br />
ramène encore de son voyage initiatique une chanson distinctive, le signe d’un talent<br />
personnel (comme joueur d’arc musical), ainsi qu’un remède inédit 53 .<br />
Les interactions avec les opposants consistent quant à elles en un jeu attendu<br />
d’agressions et de ripostes. Mais il est notable que ce combat entre le novice et son sorcier<br />
soit avant tout une lutte perceptive : la perception elle-même est mise en scène, devenant<br />
l’enjeu principal de la vision. Ainsi les nombreuses scènes de croisement de regard, de<br />
dissimulation ou d’esquive : “une femme me tourne le dos lorsque je la regarde”, “ma mère<br />
en train de me lorgner”, “mon frère cadet arrive et fuit après m’avoir aperçu”. Il s’agit à<br />
chaque fois du sorcier qui, se voyant vu, cherche à se soustraire au regard. Les personnages<br />
masqués qui hantent les visions appartiennent à ce même registre de mise en abyme de la<br />
perception : “un personnage masqué qui cache une parente”, “un homme qui change sans<br />
arrêt de visage. Je finis par reconnaître mon cousin O.”, “ma figure n’arrête pas de changer.<br />
Mais ce n’est pas vraiment ma figure. Derrière ces films, quelqu’un se cache que je n’arrive<br />
pas encore à identifier”. C’est encore le sorcier qui, pour ne pas être reconnu, se cache<br />
derrière un masque d’emprunt – le masque étant la figure privilégiée de l’occulte. Comble du<br />
travestissement, dans la dernière de ces visions, le sorcier va jusqu’à prendre l’apparence de<br />
sa propre victime pour ne pas être découvert.<br />
L’identification du sorcier supposément responsable de l’infortune constitue ainsi l’un<br />
des thèmes centraux des visions : “tonton K. se cache en plusieurs endroits et porte plusieurs<br />
figures avec des masques. Je le poursuis au fond d’une grotte dans une forêt. Je lui ôte son<br />
masque et découvre sa figure”. Le plus souvent, le banzi avait déjà des soupçons quant à<br />
l’identité du parent persécuteur, les visions n’étant alors qu’une confirmation 54 . Il arrive<br />
néanmoins que l’identification visionnaire soit une surprise, le suspect se révélant être un allié<br />
fiable, alors qu’un parent de confiance s’avère être un dangereux dissimulateur. Mais, simple<br />
vérification ou étonnement authentique, cette identification est décisive puisqu’elle modifie<br />
radicalement la nature de l’imputation de sorcellerie. Voir le visage de son sorcier, c’est faire<br />
sortir la sorcellerie de l’invisible en passant de la rumeur incertaine à la certitude d’une<br />
perception visuelle. Les initiés soulignent cependant que si le banzi a pu voir son sorcier, ce<br />
dernier l’a également vu le voyant – ce qu’attestent les visions mettant en scène le jeu des<br />
52 Les homonymes sont légion, même si le kombo est censé refléter la personnalité de chaque initié. Dans le<br />
Disumba, le kombo appartient de toute façon à une liste close de noms disponibles.<br />
53 Chaque nouvelle initiation, et souvent même les simples rêves des nganga, enrichissent donc la pharmacopée<br />
végétale, qui ne saurait donc être le répertoire clos et systématique que l’ethnomédecine décrit souvent.<br />
54 S’il peut y avoir plusieurs sorciers complices, ils agissent ordinairement sous l’impulsion d’un sorcier en chef.<br />
-35-
egards croisés. Le sorcier sera désormais d’autant plus sur ses gardes et redoublera d’effort<br />
pour lui nuire. L’initiation a donc pour résultat moins l’apaisement que l’exacerbation des<br />
tensions qui se cristallisent autour des imputations de sorcellerie 55 .<br />
Ce jeu de cache-cache entre le banzi et son sorcier donne à l’expérience visionnaire<br />
son dynamisme propre. La relation sorcellaire a en effet tendance à s’inverser au cours de la<br />
nuit : le novice mène une véritable traque et c’est le sorcier qui se retrouve finalement en<br />
position de proie. Ce retournement constitue l’enjeu majeur des visions du Misɔkɔ : le banzi<br />
doit parvenir à reprendre l’initiative face à l’adversité sorcellaire. Cela se traduit par des<br />
scènes visionnaires dans lesquelles le novice cesse d’être spectateur passif pour devenir<br />
protagoniste actif, l’acteur principal de ses propres films. Et l’assistance des initiés cherche<br />
délibérément à guider le banzi sur cette voie. En effet, les visions ne sont pas une expérience<br />
intime et privée mais un phénomène collectif auquel l’assistance contribue tout autant que le<br />
visionnaire. Le banzi doit raconter toutes ses visions au fur et à mesure qu’elles se<br />
produisent 56 . Cette narration simultanée rend possible le pilotage du novice par les initiateurs,<br />
grâce à un jeu d’interprétations, de questions et d’injonctions : “fouille dans le panier !”,<br />
“pars là-bas !”, “demande-lui qu’il te donne la bénédiction !”, “tape-le !”. L’assistance<br />
exhorte ainsi le banzi à ne pas se contenter de voir mais à agir ses visions. Traduisant<br />
directement ces injonctions en actes, le banzi se livre même parfois à de véritables mimes des<br />
actions qu’il est censé accomplir dans ses visions (devant rester assis, il ne peut cependant<br />
utiliser que ses bras). L’exemple le plus typique consiste à mimer le fait de frapper le sorcier<br />
en assénant dans le vide des coups de chasse-mouches, sous les applaudissements du public 57 .<br />
Dynamisme visionnaire<br />
Ces scènes actives, vers lesquelles tendent à la fois le banzi et l’assistance des initiés,<br />
culminent dans les scènes de représailles ou de délivrance. Le banzi riposte contre le parent<br />
55<br />
Et il n’y a pas besoin de faire l’hypothèse que le présumé sorcier sait réellement qu’il a été vu : il suffit que le<br />
banzi agisse de son côté comme si cela était le cas.<br />
56<br />
Narration intégrale puisque l’interprétation des visions est du seul ressort des initiateurs. L’initiation instaure<br />
ainsi une situation paradoxale où le banzi voit des choses invisibles à des tiers qui sont pourtant les seuls<br />
capables in fine d’en évaluer le sens. L’expérience visionnaire, bien qu’individuelle, a donc pour conséquence<br />
directe l’assujettissement aux aînés du Bwete.<br />
57<br />
Opérant le passage du récit à la représentation dramatique, ces mimes sont également une façon de rendre un<br />
peu plus tangibles des scènes visionnaires sinon privées de toute réalité autre que narrative : le banzi donne ainsi<br />
à voir l’invisible à une assistance autrement aveugle.<br />
-36-
sorcier : “K. [le sorcier] enlève sa ceinture, la brandit et me provoque en duel. Il me dit qu’il<br />
me cherchait. Je lui réponds que je suis venu le voir. On se bat. Je prends le bwete [fétiche<br />
protecteur] que je porte en bandoulière : il lance des lumières et transperce K. qui tombe à la<br />
renverse”. Il parvient à détruire ses fétiches maléfiques : “je rentre chez mon beau-père. Il a<br />
placé une boîte sous terre à gauche de la barrière du portail. C’est de la magie. Je lui<br />
demande pourquoi il a fait cela. Il me répond que c’est pour contrôler tous ceux qui rentrent<br />
chez lui. Avec un bâton pointu, je transperce la boîte et je la déterre. Je l’ouvre et j’y mets le<br />
feu”. Il réussit enfin à se délivrer lui-même : “mes maux de tête sont dus au fait que ma tête<br />
est coupée et posée sur un morceau de bois en feu. C’est M., la sœur de mon père qui est<br />
responsable. Je récupère ma tête qui était sur le morceau de bois en feu [elle mime le geste]”.<br />
Le sorcier est finalement défait, le banzi triomphe. Si les visions offrent ainsi la possibilité<br />
d’une vengeance imaginaire qui peut aller jusqu’à l’élimination du sorcier, il n’y a cependant<br />
dans le monde réel pas ou peu de mesures de rétorsion, mais essentiellement des mesures de<br />
protection. Selon le proverbe, “un parent reste un parent”, même si par jalousie, il se fait<br />
sorcier. Le Bwete Misɔkɔ n’éradique pas la sorcellerie, mais donne seulement les moyens de<br />
vivre avec son sorcier.<br />
La délivrance de l’infortune sorcellaire constitue ainsi le thème focal qui oriente toutes<br />
les expériences visionnaires du Bwete Misɔkɔ, justifiant par-là même l’élaboration d’un<br />
scénario idéal-typique 58 . Les efforts conjoints du banzi qui se concentre sur son image<br />
spéculaire et de l’assistance des initiés qui le guident orientent les visions dans un sens bien<br />
déterminé. A cela s’ajoutent encore les réinterprétations du père initiateur qui, le lendemain<br />
matin ou les jours suivant la veillée, s’attache à ramasser les visions du banzi dans une<br />
narration simple et stéréotypée. Cette mise en intrigue contribue à donner une cohérence<br />
d’ensemble au flux parfois désordonné des images. L’initiateur s’ingénie également à établir<br />
des correspondances entre les visions du banzi et les thèmes centraux du Bwete et de son<br />
rituel – l’effet attendu étant de convaincre le novice que son salut individuel passe par<br />
l’implication durable dans la communauté initiatique.<br />
L’expérience visionnaire s’agence finalement selon un schéma actantiel élémentaire<br />
dont le banzi est le sujet central. Une temporalité contrastive oriente l’intrigue : les scènes<br />
malheureuses rejetées dans le passé pré-initiatique s’opposent aux scènes heureuses qui<br />
appartiennent au futur proche. La conversion du malheur en bonheur passe alors par le<br />
58 Même si aucune expérience réelle ne saurait correspondre parfaitement au modèle, la fréquence d’occurrence<br />
des traits décisifs du scénario idéal-typique dans l’échantillon des récits recueillis sur le terrain prouve sa<br />
pertinence : scènes de décèlement de la sorcellerie dans 100% des cas, scènes d’identification du sorcier dans<br />
plus de 75%, scènes de riposte ou de délivrance dans plus de 60%.<br />
-37-
etournement de la relation sorcellaire. Ce dénouement de la crise est amené par les deux<br />
péripéties essentielles de l’intrigue visionnaire qui permettent de briser la relation<br />
d’opposition : d’une part, l’identification d’un parent proche, pris en flagrant délit, comme<br />
étant le sorcier responsable de l’infortune ; d’autre part, la riposte contre ce sorcier et la<br />
délivrance concomitante de l’infortune.<br />
Dynamique actantielle des visions<br />
Dans un contexte où l’infortune renvoie toujours à un trouble relationnel, la scène<br />
initiatique permet au banzi de manipuler des relations. Les visions initiatiques sont en effet un<br />
moyen d’insérer le banzi dans un faisceau de relations dynamiques afin qu’il y joue et déjoue<br />
la relation sorcellaire et qu’il rétablisse par-là le lien qui l’unit à son propre bonheur. Ce<br />
retournement de la relation sorcellaire serait toutefois impossible sans l’aide des adjuvants. Le<br />
voyage initiatique et le combat du banzi contre son sorcier ne peuvent en effet être solitaires,<br />
car aucun individu ne saurait prétendre à une pleine autonomie personnelle, synonyme<br />
d’isolement et donc d’extrême vulnérabilité. Malgré les tendances individualistes du Misɔkɔ,<br />
les visions initiatiques réaffirment donc avec insistance que nul individu ne saurait survivre<br />
sans le secours de sa parentèle, qu’il s’agisse de la parenté lignagère ou de la parenté<br />
initiatique dans laquelle le banzi est maintenant pris, et cela alors même que les sorciers qui le<br />
tourmentent font nécessairement partie de cette parentèle.<br />
-38-
4. Visions et pouvoir de guérison<br />
Une banzi et et une initiée<br />
Les visions sont au cœur du pouvoir de guérison de l’initiation. Tous les bonheurs, les<br />
biens matériels ou immatériels entrevus sont pourtant condamnés à rester imaginaires, et<br />
relèvent bien de ce que Freud appelle la réalisation hallucinatoire du désir (Freud 1995a et<br />
1995b). Les nombreuses visions de maisons à véranda ou pourvues de vitres sont ainsi à<br />
comprendre comme les inversions fantasmatiques d’une réalité sociale profondément<br />
inégalitaire. Mais la satisfaction attachée à cette réalisation hallucinatoire ne peut suffire à<br />
enclencher une guérison réelle : le retour à une réalité qui reste trop visiblement privée des<br />
biens désirés impose bien vite le désenchantement, les initiés n’étant pas des hallucinés<br />
chroniques qui vivraient à tout jamais prisonniers de leurs visions. En revanche, le<br />
renversement de la relation sorcellaire – et plus largement le schème général de l’activation<br />
(passage des scènes passives aux scènes actives) – est au principe d’un processus plus effectif<br />
de guérison. Avant son initiation, le banzi endure des infortunes à répétition sans pouvoir s’y<br />
opposer et reprendre l’initiative. La passivité est ainsi une coordonnée fondamentale du<br />
malheur, sa tonalité existentielle : l’infortuné subit passivement l’adversité et s’y sent piégé.<br />
L’activation visionnaire fonctionne alors comme un embrayeur sur la voie de la résolution.<br />
D’où le fait que les pleurs fassent l’objet d’une désapprobation unanime pendant<br />
l’initiation, alors qu’ils constituaient le meilleur indice de réussite de la consultation<br />
divinatoire. Cette inversion d’attitude tient à une inversion de configuration relationnelle. Le<br />
-39-
patient de la consultation est dans une position passive : il est objectivé dans le discours d’un<br />
tiers et doit se contenter d’acquiescer. Le banzi doit au contraire quitter cette posture passive<br />
pour venir occuper une place plus active (parler, agir). Les pleurs n’y sont donc plus<br />
tolérables. De là, l’exhortation rageuse de l’assistance à frapper le sorcier : il s’agit de<br />
reprendre enfin l’ascendant sur le responsable supposé de l’enfermement dans la passivité<br />
malheureuse. Le passage à l’acte du banzi, même imaginaire, constitue alors une désinhibition<br />
bien réelle. Et lorsqu’il mime effectivement les coups assénés, il ajoute encore le poids d’un<br />
acte moteur réel à cette riposte imaginaire 59 . On résume d’ailleurs parfois une initiation<br />
réussie par l’expression “il a bien tapé le serpent” – métaphore animale de l’infortune<br />
sorcellaire. Cette décharge agressive permet en effet une véritable inversion d’attitude à<br />
l’égard de l’affliction : ne plus s’y sentir piégé, mais se montrer capable d’y faire face et<br />
réagir. Les visions permettent donc de rouvrir des perspectives temporelles jusque-là bloquées<br />
par l’infortune massive. C’est pour cela que les initiés insistent tant sur le fait que le Bwete<br />
permette de voir présent, passé et avenir : les visions dénouent les affaires du passé et<br />
débloquent l’impasse du présent pour enfin rouvrir la possibilité du futur.<br />
De fait, les initiés interrogés à ce sujet affirment généralement qu’ils vont nettement<br />
mieux depuis leur initiation, tout en reconnaissant que les tourments qui les ont conduits à<br />
manger l’eboga n’ont pas disparu pour autant. Leurs maux peuvent s’être aggravés, ils ont<br />
néanmoins le sentiment d’être désormais sur la voie d’une amélioration. La même trame<br />
incertaine d’événements tantôt heureux tantôt malheureux continue pourtant de tisser leur vie,<br />
comme partout et toujours. Mais au lieu que chaque menu incident soit la preuve d’une<br />
infortune accablante, par une conversion du regard, c’est désormais chaque petit succès qui<br />
devient la promesse du bonheur. L’initiation n’offre donc évidemment pas une éradication<br />
bien improbable du malheur, mais plus concrètement la possibilité, qui ne se réduit pas à de la<br />
résignation pure et simple, de faire avec son infortune et de vivre avec son sorcier.<br />
La mise en scène visionnaire permet ainsi au banzi d’initier une véritable<br />
réappropriation de sa puissance d’agir, i.e. une conversion du rapport qu’il entretient à sa<br />
propre existence en un rapport actif. Cette transformation du rapport à soi passe<br />
nécessairement par une transformation du rapport à autrui au sein du réseau de la parentèle :<br />
réaffiliation avec les parents alliés, opposition agressive à l’égard du parent sorcier, mais aussi<br />
nouvelle affiliation de la parenté initiatique. En définitive, si l’initiation au Bwete Misɔkɔ ne<br />
“guérit” pas à proprement parler, elle participe néanmoins d’un processus plus large dont la<br />
59 La perception est de toute façon déjà une action simulée, une anticipation de l’action – les réseaux neuronaux<br />
impliqués dans l’observation et dans l’exécution d’une action étant similaires (Berthoz 1997).<br />
-40-
guérison serait un sous-ensemble : une amélioration qui touche à la fois le rapport à soi, au<br />
corps et à autrui. Pour un accès de paludisme ou même un pied paralysé par un “fusil<br />
nocturne” et traité par des onguents, la cause immédiate de l’amélioration est une<br />
modification de l’état du corps – ce qu’on peut à bon droit appeler une guérison. Alors que<br />
pour l’infortune sorcellaire qui mène à l’initiation, c’est une modification complexe du triple<br />
rapport (à soi, au corps, à autrui). Ce qu’on pourrait appeler une résolution, conversion<br />
relationnelle qui permet une réappropriation de la capacité à se déterminer du banzi.<br />
5. “Base !” ou la vérité visionnaire<br />
Pour approuver et applaudir un acte rituel bien fait (discours, danse, musique, etc.), les<br />
initiés usent abondamment de l’exclamation “base !”, l’un des énoncés les plus importants du<br />
Bwete Misɔkɔ 60 . Pendant l’initiation, l’auditoire des initiés acquiesce ainsi par des “base !”<br />
appuyés à chaque récit par le banzi de l’une de ses visions. Ces exclamations collectives<br />
valident les visions, garantissant que ce ne sont pas de simples hallucinations mensongères.<br />
“Base !” fonctionne ainsi comme le marqueur de la vérité visionnaire. Les visions les plus<br />
significatives concernent pourtant des actes sorcellaires par définition invisibles et donc<br />
soustraits à toute vérification hors du contexte visionnaire. Ces visions ne décrivent en<br />
conséquence pas des états de fait susceptibles d’un jugement classique de vérité, au sens<br />
d’une adéquation d’un énoncé au réel.<br />
Les exclamations de l’assistance évaluent plutôt la pertinence des visions relativement<br />
à la situation personnelle du banzi. Les “base !” qui ponctuent le récit de scènes d’action – par<br />
exemple une riposte contre le sorcier – signifient que la modification induite par cette action<br />
est pertinente eu égard à l’objectif principal de l’initiation, la “guérison” du novice. De même,<br />
les “base !” qui ponctuent le récit d’une vision malheureuse – par exemple une corde ligotant<br />
le banzi impotent – signifient que cette scène exprime de façon congrue l’expérience de<br />
l’infortune du novice. Et la vision sera jugée d’autant plus pertinente qu’elle confirmera le<br />
diagnostic préalable du devin qui, le plus souvent, est également le père initiateur.<br />
L’acquiescement des initiés n’exprime donc pas la reconnaissance qu’un énoncé est adéquat<br />
au réel. Il confirme plutôt cet énoncé en le rapportant à un énoncé antérieur qui n’est pas lui-<br />
même dans un rapport simple d’adéquation au réel. Les visions ne sont donc “vraies” qu’au<br />
60 Les initiées mabundi disent plutôt “iya o, iya o” (litt. “ô mère, ô mère”).<br />
-41-
sens où elles vérifient la consultation et parviennent ainsi à exprimer de façon pertinente<br />
l’expérience de l’infortune à la fois pour l’infortuné et pour les initiés 61 .<br />
Ces renvois entre consultation et initiation expliquent la valeur décisive de<br />
l’acquiescement “base !” dans la constitution de la vérité visionnaire. En effet, lors de la<br />
séance divinatoire, le patient devait également répondre “base !” aux énoncés du devin qu’il<br />
jugeait pertinents. C’était même la seule parole qui lui était autorisée. Les “base !” de<br />
l’assistance pendant l’initiation sont ainsi à comprendre comme des échos inversés des<br />
“base !” du patient pendant la consultation. Ce n’est plus le patient qui acquiesce aux<br />
révélations du nganga qui scrute son petit miroir divinatoire, ce sont les nganga qui<br />
acquiescent aux récits visionnaires du banzi qui scrute le miroir initiatique. Cette inversion<br />
des places des locuteurs marque que, le temps d’une veillée, le pouvoir divinatoire se trouve<br />
du côté du novice. L’initiation est l’occasion unique d’une auto-consultation : le banzi<br />
découvre par lui-même les causes véritables et les remèdes possibles de son infortune 62 .<br />
L’inversion des places<br />
La logique des usages du “base !” rend manifeste la relation de circularité et<br />
d’inversion qui nouent les contextes de communication divinatoire et initiatique.<br />
L’exclamation a ainsi valeur d’indice métalinguistique. Le vocable “base !” est d’ailleurs<br />
l’une des principales marques distinctives du Bwete, n’ayant de sens dans aucun contexte<br />
ordinaire : un profane, ou un initié dans une conversation profane, n’exprimera jamais son<br />
accord de cette façon. L’acquiescement rituel porte donc à la fois sur l’énoncé précédent qu’il<br />
avère et sur le contexte d’énonciation lui-même. Il véhicule un message implicite à caractère<br />
métalinguistique du type “ceci est une situation de communication singulière, différente de la<br />
conversation quotidienne” 63 . Ce contexte singulier de l’énonciation rituelle, les initiés<br />
61 Pertinence au sens de Sperber & Wilson 1989 : un énoncé est d’autant plus pertinent dans un contexte qu’il y<br />
produit des effets contextuels importants. Dans le cadre du Bwete, ces effets contextuels consistent à insérer le<br />
banzi et son infortune dans l’horizon initiatique.<br />
62 Pour une nuit en position de devin, le banzi acquiert également le pouvoir de consulter son entourage, se<br />
livrant à de véritables diagnostics avec étiologie sorcellaire et recommandations thérapeutiques. La description<br />
visionnaire laisse alors la place à une parole oraculaire.<br />
63 Ce que la sociolinguistique appelle un indice de contextualisation (contextualization cue) : indice qui signale<br />
les cadres dans lesquels l'énoncé doit être interprété (Duranti & Goodwin 1992).<br />
-42-
l’appellent souvent la “parole du Bwete”. Les “base !” de l’assistance pendant l’initiation<br />
indiquent en définitive au banzi qu’il parle désormais le langage du Bwete.<br />
Peu importe alors que le banzi puisse parfois affabuler, puisque la simulation<br />
éventuelle satisfait tant le novice que les initiés. D’une part, le banzi est incité à raconter des<br />
visions à un auditoire qui, par ses acquiescements insistants, le conforte dans l’idée que ce<br />
qu’il dit doit bien être pertinent. L’initiation constitue ainsi un exutoire possible pour une<br />
parole émancipée des règles habituelles de la réserve et pourtant prise au sérieux. D’autre<br />
part, puisqu’ils constituent une vérification de la consultation, les récits même simulés du<br />
banzi confirment le pouvoir divinatoire des nganga qui s’empressent donc d’y acquiescer.<br />
L’initiation d’un banzi peut ainsi rassurer rétrospectivement le nganga trop conscient des<br />
petits artifices mensongers au principe de sa propre consultation. Et plus généralement, si l’on<br />
peut toujours avoir des doutes sur sa propre initiation, les initiations subséquentes auxquelles<br />
on assiste désormais en tant qu’initiateur auxiliaire sont une preuve que le rituel n’est pas une<br />
vaste supercherie. Par le jeu de la circularité du discours visionnaire, banzi et initiés se<br />
fournissent donc mutuellement les raisons de croire en la validité de l’initiation – le<br />
comportement de l’autre partie confirmant la légitimité de sa propre posture.<br />
6. Un sujet initiatique complexe<br />
Ce qui fondamentalement est en jeu dans l’initiation, c’est la redéfinition de l’identité<br />
relationnelle du banzi à travers son insertion dans un dispositif rituel singulier, dispositif qui<br />
peut être schématisé par un triangle dont les trois sommets sont le novice, le miroir et<br />
l’assistance des initiateurs. Le sujet initiatique est ainsi construit par la double relation du<br />
banzi au miroir et à l’assistance : relation de perception et relation de narration, rapport<br />
spéculaire à soi et rapport linguistique à autrui, qui garantissent que l’initiation est une<br />
expérience à la fois personnelle et communicable. Or, dans ce dispositif initiatique complexe,<br />
les trois instances de la vision, de la parole et de l’action ne sont plus ni nécessairement<br />
confondues ni strictement identifiables, comme c’est le cas pour un sujet ordinaire.<br />
Triangle initiatique<br />
-43-
Grâce à la surface réfléchissante du miroir, les visions disposent d’un support optique<br />
et d’un sujet virtuel. Le dédoublement et l’inclusion du banzi dans son propre champ de<br />
vision sont ainsi les conditions d’une identité relationnelle complexe que l’on pourrait à juste<br />
titre appeler une identité en miroir. Cette réflexivité spéculaire ouvre sur une série de<br />
décalages et d’ambiguïtés fécondes 64 . Le rapport du novice à son double n’est en effet pas un<br />
rapport simple, réductible à la dichotomie entre un corps inerte et un esprit actif. Le double du<br />
banzi, appelé gedina-dina en getsɔgɔ, est un reflet intégral de la personne explicitement pensé<br />
sur le modèle optique de l’ombre 65 . Qui est alors le sujet des visions ? Dans les séquences à<br />
focalisation externe, c’est le banzi devant le miroir qui assiste à une scène dans le miroir.<br />
Mais dans les séquences à focalisation interne, c’est le double dans le miroir qui est le témoin<br />
de la scène, opérant ainsi une mise en abyme de la perception visuelle. De même, si c’est bien<br />
le double qui agit dans le monde invisible du miroir et le banzi assis au corps de garde qui<br />
l’observe comme depuis un point de vue extérieur, la distinction se brouille pourtant lorsque<br />
le banzi se met à mimer les actions de son double. Ces mimes mettent en scène l’écart ambigu<br />
entre le novice et son double 66 .<br />
L’instance de l’énonciation est tout aussi problématique. Si le voyage visionnaire est<br />
analogue à une mort temporaire et au sommeil onirique, il en diffère néanmoins dans la<br />
mesure où le banzi doit rester lucide et pouvoir raconter ses visions. Pourtant, les initiés disent<br />
parfois que ce n’est pas vraiment le banzi qui parle mais le Bwete lui-même qui s’exprime à<br />
travers lui 67 . Parfois également, le banzi débute le récit de l’une de ses visions par “le Bwete<br />
me montre que…” comme si le Bwete était le véritable auteur de ses visions, tel un<br />
projectionniste caché. Les initiés n’allant pas au-delà de ces expressions, il serait artificiel d’y<br />
chercher une théorie sophistiquée sur les causes efficientes ou occasionnelles. La pertinence<br />
de ces formulations tient au contraire à leur indétermination. En effet, l’une des<br />
caractéristiques saillantes du Bwete est justement qu’il reste partiellement indéterminé<br />
jusqu’au terme du parcours initiatique. Bien souvent, l’un ou l’autre des personnages que<br />
rencontre le banzi dans ses visions est réputé être le Bwete lui-même. Mais cela reste un<br />
64<br />
Pour une analyse de la réflexivité rituelle au niveau de l’énonciation, cf. Severi 2002.<br />
65<br />
Ce qui prouve qu’initiation et expérience visionnaire sont moins façonnées par des représentations<br />
symboliques abstraites et arbitraires que contraintes par les propriétés formelles du dispositif matériel et<br />
relationnel de l’initiation.<br />
66<br />
Dans “Une théorie du jeu et du fantasme”, à partir de la théorie des types logiques de Russell, G. Bateson<br />
analyse le jeu – mais mentionne au passage le rituel – en termes de cadre paradoxal où il y a simultanément<br />
distinction et identification entre ces niveaux (Bateson 1977). Nous verrons comment le Bwete repose<br />
fondamentalement sur toute une série de cadres paradoxaux.<br />
67<br />
Ce qui ne signifie nullement que l’initiation soit une possession comme c’est le cas pour les rites d’affliction<br />
féminins.<br />
-44-
personnage vague, une entité flottante qui peut s’incarner dans plusieurs protagonistes à la<br />
fois.<br />
Par conséquent, dire que le Bwete est derrière les visions et les récits du banzi signifie<br />
que les instances de l’énonciation et de la perception visionnaires demeurent problématiques,<br />
puisqu’elles dépendent d’une entité elle-même problématique. Loin du Dieu de la troisième<br />
des Méditations métaphysiques de Descartes, point fixe qui met un terme définitif au doute et<br />
assure le sujet de son intégrité cognitive, le Bwete apparaît au contraire comme un génie en<br />
forme de point d’interrogation, un trickster instigateur d’ambiguïté et d’incertitude. Tout<br />
comme le Bwete dont il parle le langage, le banzi possède ainsi une voix flottante et<br />
indéterminable. La linguistique distingue dans toute énonciation le locuteur (la personne qui<br />
profère l’énoncé) et l’énonciateur (la personne à qui l’intentionnalité linguistique est<br />
attribuée). Or, dans le cas de l’énonciation visionnaire, le banzi en position de locuteur se<br />
distingue nettement de la figure énigmatique de l’énonciateur. La position du banzi dans la<br />
situation d’interlocution passe ainsi par la relation médiatrice au Bwete qui la complique La<br />
situation initiatique repose en définitive sur une série de décalages ambigus entre le banzi et<br />
son double, la perception et l’énonciation, le locuteur et l’énonciateur. Cette ambiguïté, que<br />
l’on retrouvera tout au long du parcours rituel du Bwete Misɔkɔ, est constitutive d’un sujet<br />
initiatique complexe.<br />
-45-
Chapitre II<br />
Une nuit de Bwete : l’organisation rituelle<br />
Le Bwete est un travail répété que ponctue la succession des veillées cérémonielles qui<br />
durent toute une nuit, du coucher au lever du soleil sans interruption 68 . Ce travail rituel est<br />
également minutieux, ce qu’atteste la liturgie complexe d’une veillée ainsi que les amendes et<br />
réprimandes qui pleuvent à chaque entorse. Chaque communauté locale étant libre de “faire<br />
son Bwete” comme elle l’entend, de nombreuses variations rituelles existent cependant 69 . La<br />
description d’une veillée ordinaire de Bwete Misɔkɔ permet tout de même d’apprécier le sens<br />
général du travail rituel au-delà des variations locales. Les innombrables interprétations<br />
exégétiques données par les initiés à ces actions rituelles sont réservées à des chapitres<br />
ultérieurs – ordre de description ethnographique qui n’est pas différent de l’ordre de<br />
l’apprentissage initiatique : un cadet commence par participer au rituel avant d’en apprendre<br />
les significations de la bouche des aînés.<br />
L’activité rituelle du Misɔkɔ est occasionnelle plutôt que périodique et concerne<br />
l’existence individuelle plutôt que la collectivité 70 . Les diverses occasions cérémonielles<br />
comprennent : une veillée initiatique pour un nouveau banzi, une veillée d’edika (étape<br />
suivant l’initiation au cours de laquelle le banzi mange un ragoût rituel), une veillée de<br />
motoba (étape suivant edika au cours de laquelle le banzi avale un esprit auxiliaire), une<br />
veillée de remise de bwete (au cours de laquelle le père initiateur remet à un initié un fétiche<br />
bwete), une veillée de mugungu ou lavage de Bwete (purification sacrificielle pour laver un<br />
malheur ou un décès), une veillée de coupure de corde (soins d’un malade), une veillée de<br />
mayaya (pour fêter un événement heureux ou donner une bénédiction). Quelle qu’en soit<br />
l’occasion, une cérémonie comporte un ensemble de séquences génériques inamovibles qui<br />
constituent la trame ordinaire du Bwete Misɔkɔ – les séquences spécifiques à chaque type de<br />
veillée venant simplement s’intercaler au cours de la nuit.<br />
Le déroulement d’une veillée est scandé par l’alternance entre séquences secrètes et<br />
séquences publiques. Les premières ont lieu au bwεnzε (étendue débroussée en forêt à<br />
proximité du village, sommairement enclose par une barrière de feuilles) et réunissent les<br />
68<br />
Une cérémonie ne dure qu’une seule nuit et non trois comme c’est systématiquement le cas dans le Bwiti fang.<br />
Une cérémonie importante peut cependant parfois être dédoublée en deux veillées successives (une première<br />
veillée propitiatoire, appelée “veillée de mwago”, permettant d’assurer le bon déroulement de la seconde).<br />
69<br />
Une veillée de Bwete Disumba diffère totalement d’une veillée de Bwete Misɔkɔ. Mais entre branches du<br />
Misɔkɔ et même entre communautés d’une même branche, les variations rituelles existent également.<br />
70<br />
Alors que les rites du Disumba sont souvent collectifs et parfois périodiques (par exemple, veillée pour les<br />
travaux de saison sèche).<br />
-46-
seuls initiés masculins qui se retirent en privé pour accomplir les manipulations rituelles les<br />
plus importantes et donc les plus secrètes 71 . Les secondes ont lieu au corps de garde (mbandja<br />
– on dit aussi ebanza ou tsapala) et comportent notamment les chants et danses exécutés<br />
devant l’assemblée des spectateurs profanes 72 . Ce corps de garde servait autrefois<br />
effectivement de poste d’observation défensive et était donc situé à l’extrémité du village.<br />
Aujourd’hui, il fait office de maison des hommes et de “temple” du Bwete. C’est un bâtiment<br />
rectangulaire d’environ huit mètres de long sur quatre mètres de large et deux mètres<br />
cinquante de haut, entièrement ouvert sur le devant. Les parois sont faites d’écorces fixées sur<br />
une ossature de bois. Le toit à deux pentes est recouvert de pailles et feuilles de palmier. Son<br />
avant est surbaissé par un auvent de feuilles manga (Sclerosperma mannii), cachant en partie<br />
les occupants et obligeant à se courber pour y pénétrer. La paroi postérieure est parfois percée<br />
sur sa gauche d’une ouverture formant passage. A l’intérieur, des bancs s’adossent aux deux<br />
parois latérales, tandis que les sièges des aînés sont disposés au fond.<br />
Mbandja en construction<br />
71<br />
En ville, le bwεnzε est par nécessité rabattu autour du corps de garde : appentis, petite case auxiliaire ou pièce<br />
de l’habitation.<br />
72<br />
Dans le Misɔkɔ, il arrive cependant parfois qu’une cérémonie, notamment une veillée de soins, se tienne au<br />
domicile d’un particulier, dont la pièce commune est alors dégagée pour l’occasion.<br />
-47-
Mbandja<br />
Un poteau central, situé en fait sur l’avant du corps de garde, soutient le faîtage,<br />
palliant l’absence de paroi frontale. Ce poteau central (eεngo) au pied duquel sont enterrés des<br />
fétiches concentre toute la puissance du Bwete dans le mbandja. Il est décoré (peint au kaolin<br />
rouge et blanc, habillé de pièces de raphia ou de pagnes, serti de morceaux de miroir ou orné<br />
d’un crâne animal) et parfois sculpté d’une figure anthropomorphe. Toute l’orientation de<br />
l’espace rituel se fait par rapport à ce poteau mitan qui divise le corps de garde en deux côtés<br />
symétriques selon le point de vue absolu d’un initié situé à l’extérieur face à l’entrée. Le côté<br />
droit du mbandja est masculin, le côté gauche est féminin. On entre toujours par la droite,<br />
côté masculin, pour contourner le poteau mitan et ressortir par la gauche, côté féminin 73 .<br />
•<br />
• •<br />
Liturgie d’une veillée de Bwete Misɔkɔ<br />
(séquences génériques)<br />
- Installation des corbeilles (vers 18h)<br />
- Arrivée des initiés<br />
- Prise d’eboga<br />
- Offrandes<br />
- Séquence introductive de la circulation des objets rituels (vers 22h)<br />
73 Il y a parfois des inversions selon les communautés, dans le Bwiti fang ou dans le Disumba – l’important étant<br />
de toute façon l’existence d’une division latérale porteuse de significations (Mary 1999).<br />
-48-
- Invocation masculine mwago<br />
- Invocation féminine mosema<br />
- Bain purificateur mososo<br />
- Habillage<br />
- Rentrée du Bwete (vers 1h)<br />
- Accueil des esprits mikuku<br />
- Début de la consultation<br />
- Danse des nganga (vers 3h)<br />
- Danse des mabundi (vers 5h)<br />
- Danse de consultation des mibele (vers 6h)<br />
- Danses finales<br />
- Séquence conclusive tsobula (vers 8h)<br />
- Déshabillage<br />
- Repas<br />
- Réunion au bwεnzε (vers 11h)<br />
•Préliminaires<br />
• •<br />
•<br />
A la tombée de la nuit, les femmes disposent les corbeilles des initiés (contenant leurs<br />
ritualia) au corps de garde, en les portant solennellement à deux mains comme si elles<br />
pesaient lourd. Chaque corbeille est placée sur les nattes qui occupent tout le pourtour de<br />
l’espace central, en face de la place occupée par son propriétaire. Plus rarement, les corbeilles<br />
sont toutes disposées ensemble sur un carré de nattes vers le fond du mbandja. La première<br />
disposition souligne l’individualisme du Misɔkɔ : chaque initié vient avec son propre<br />
“bagage” rituel. La seconde respecte davantage le communautarisme du Disumba : tous les<br />
ritualia concourent indistinctement à la force de la veillée. Une fois les corbeilles installées,<br />
l’espace intérieur du corps de garde devient le geliba (ou gediba), c’est-à-dire qu’il est<br />
désormais sacré. Ainsi, quand la veillée a lieu dans une maison particulière, l’espace<br />
domestique devient espace rituel dès lors que les corbeilles sont posées sur les nattes. Au son<br />
des appels de la corne getsika mbudi (corne du sitatunga mbudi, Tragelaphus spekei), les<br />
initiés arrivent progressivement, par petits groupes. Le nouvel arrivant se déchausse, salue<br />
l’assemblée d’un “bwεkaye !” vigoureux (la formule rituelle du salut), donne son kombo (nom<br />
initiatique), puis choisit sa place derrière le geliba en fonction de son rang dans le Bwete.<br />
Cette spatialisation hiérarchique obéit à deux règles simples. D’une part, une division<br />
sexuelle : un initié nganga s’assied du côté droit donc masculin du corps de garde, une initiée<br />
-49-
mabundi du côté gauche féminin 74 . D’autre part, un principe d’aînesse initiatique. Les<br />
relations entre initiés sont en effet régies par une hiérarchie fondée sur la parenté initiatique.<br />
L’initiateur est un père (tεta) pour ses initiés. La mère des banzi est une figure mythique :<br />
c’est le Bwete lui-même, à travers les figures maternelles que sont Disumba, Myɔbε ou<br />
Ngɔndε (dénominations éponymes des diverses branches initiatiques). Tous les initiés d’un<br />
même père initiateur sont germains ; et par extension, tous les initiés d’une même branche,<br />
voire du Bwete, le sont également. Entre eux, les rapports sont réglés par un principe<br />
d’aînesse initiatique : celui qui a été initié avant l’autre est l’aîné et est appelé frand frère<br />
(yaya). Les plus anciens des aînés sont appelés les “vieux”, le père initiateur entrant<br />
naturellement dans cette catégorie. Cet ordre de la parenté initiatique se traduit directement<br />
dans la hiérarchie spatiale du corps de garde. Le père initiateur est assis sur un fauteuil en bois<br />
au fond du mbandja. A sa gauche, l’aîné des initiés puis son cadet immédiat et ce, jusqu’au<br />
benjamin des banzi qui se trouve proche de la sortie, le plus éloigné du père initiateur. Les<br />
femmes mabundi s’assoient selon une symétrie latérale : l’aînée est située la plus au fond le<br />
long du côté gauche, ses cadettes se répartissant de proche en proche à sa droite 75 .<br />
Organisation spatiale d’une veillée<br />
74 Ce chapitre décrit une veillée mixte, bien que certaines communautés du Misɔkɔ maintiennent l’exclusion des<br />
femmes. Pour se faire une idée d’une veillée exclusivement masculine, il suffit de retrancher les séquences<br />
féminines et d’imaginer le côté gauche également occupé par les nganga.<br />
75 Malgré cela, il subsiste toujours des flottements dans la hiérarchie (présence d’initiés étrangers ou d’invités<br />
d’honneur, décalage entre aînesse et étapes initiatiques franchies), ce qui entraîne immanquablement des luttes<br />
de placement entre nganga.<br />
-50-
Assis à sa place avec ses affaires du Bwete devant lui, l’initié est désormais “posé” au<br />
geliba, son Bwete y étant “assis”. Il y a alors certaines règles à respecter sous peine<br />
d’amendes : ne pas somnoler, ne pas s’adosser ou reposer sa tête entre ses mains, ne croiser ni<br />
les jambes ni les bras (sous peine de bloquer le Bwete), ne pas piétiner par inadvertance les<br />
pieds d’un voisin, ce qui constituerait une agression sorcellaire minimale (l’excuse rituelle<br />
consiste à se joindre mutuellement les auriculaires pour former un maillon de chaîne<br />
rétablissant la solidarité).<br />
Toute la partie avant la séquence rituelle introductive se déroule sur un rythme<br />
décousu, plein de temps morts. S’il y a lieu, les aînés se retirent au bwεnzε pour accomplir les<br />
séquences spécifiques d’edika, motoba, mugungu ou de coupure de corde. Au mbandja, les<br />
premiers chants et morceaux musicaux sont lancés. L’arc musical à résonateur buccal<br />
mongɔngɔ est l’instrument majeur du Misɔkɔ (alors que la harpe ngɔmbi est l’instrument<br />
dominant du Disumba). Les autres instruments comprennent tambours à membranes, corne<br />
d’appel getsika, sonnailles et grelots, hochet musical sokε, baguettes entrechoquées, tringle<br />
sonore bakε, percussions en bambou creux et cloche kendo.<br />
Le père initiateur distribue une pincée de râpures d’écorces d’eboga à chaque initié et<br />
parfois même aux spectateurs. Cette petite dose doit permettre aux initiés d’avoir le corps<br />
“léger” pour danser toute la nuit (l’eboga est un tonique) et de “réveiller leur Bwete” pour être<br />
vigilant contre les sorciers et obtenir de bonnes visions (l’eboga est un stimulant de la<br />
vigilance). Il y toutefois une quantité limite d’eboga à ne pas dépasser au cours d’une veillée<br />
afin de ne pas empêcher l’exécution d’un travail rituel réglé : en aucun cas l’initié ne doit se<br />
retrouver dans l’état de confusion du banzi qui mange le bois sacré le jour de son initiation.<br />
Cette partie préliminaire est le temps des offrandes rituelles entre initiés (“poser le<br />
Bwete” ou “poser les mikuku [esprits]”). Le donateur, à genoux, présente à son donataire une<br />
offrande symbolique – on donnera ainsi une pièce de 25 FCFA en affirmant que ce sont des<br />
millions – et obtient en contrepartie une bénédiction 76 . Ces offrandes circulent généralement<br />
des cadets vers les aînés, réaffirmant ainsi le respect de la séniorité et la soumission aux<br />
vieux. C’est pourquoi, malgré les montants dérisoires, ce geste rituel réitéré en maintes<br />
occasions (enseignement initiatique, visites) est l’un des plus importants du Bwete.<br />
•Séquence introductive<br />
76 On donne la bénédiction en soufflant ou crachant dans les mains ou sur la tête (bénédiction se dit littéralement<br />
“salive”, matε). On peut aussi prendre la bénédiction en étreignant les flancs et en glissant les mains dessus<br />
comme pour attirer à soi le pouvoir contenu dans le ventre. Dans tous les cas, le sens du geste est le même :<br />
donner la bénédiction, c’est transmettre le pouvoir fécondant du souffle vital qui réside à l’intérieur du corps.<br />
-51-
Après le discours du père initiateur exposant les motifs de la veillée, la première<br />
séquence d’importance peut alors commencer vers dix heures : la circulation d’objets rituels<br />
parmi tous les initiés, séquence appelée “poser le Bwete” comme pour une simple offrande.<br />
Cette séquence marque le début véritable du travail rituel, puisque les initiés enchaînent une<br />
série d’actes qui les obligent à collaborer tous ensemble, coopération harmonieuse dont<br />
dépend directement le succès de la veillée. Un premier stade est ainsi franchi dans le sérieux<br />
exigé par l’entreprise collective : chacun doit être à sa place derrière le geliba, prêt à<br />
accomplir sa part du travail.<br />
Brandissant la torche mopitu, le bénéficiaire de la veillée tend un à un les objets rituels<br />
au nganga chargé de diriger la cérémonie ce jour-là, tandis que ce dernier lance la chanson<br />
correspondante et accomplit les gestes rituels appropriés 77 . L’objet est ensuite transmis,<br />
toujours de la main droite, au benjamin des banzi qui exécute les mêmes gestes avant de le<br />
passer à son voisin. L’objet circule ainsi de proche en proche jusqu’au père initiateur puis<br />
passe aux femmes mabundi avant d’être rendu au dirigeant de la veillée. Au final, tous les<br />
objets auront circulé parmi tous les initiés. Cette chaîne instaure donc bien un collectif<br />
solidaire et néanmoins différencié, puisque l’ordre de transmission procède selon l’ordre<br />
hiérarchique.<br />
Le premier de ces objets est une aiguille, le geste consacré consistant à se piquer la<br />
langue avec. La chanson et la symbolique gestuelle associent l’aiguille (ndongo) à la parole<br />
divinatoire qui “pique” et tombe toujours juste. Le second objet est une bougie allumée, le<br />
geste consistant à passer la flamme devant ses yeux. Cette lumière est associée à la<br />
clairvoyance des initiés qui démasque les sorciers. Le troisième objet est un billet de banque,<br />
le geste consistant à porter le billet à la bouche, puis à le frotter contre ses jambes et ses<br />
flancs, avant de l’agiter devant soi. Ce geste, accompli à chaque offrande reçue, attire à soi la<br />
réussite matérielle. Le quatrième objet est du tabac, et le geste consiste à souffler un peu de<br />
fumée sur sa corbeille rituelle afin d’activer la puissance des ritualia et réjouir les esprits<br />
mikuku. Le cinquième objet est une série de boissons (soda, bière, “petit vin”) et le geste<br />
consiste à feindre de boire au goulot, la boisson étant une rétribution du Bwete aux initiés. Le<br />
sixième objet est du sel passé dans une assiette et dont les initiés portent une pincée à la<br />
77 Il s’agit, non du père initiateur qui observe la cérémonie depuis son fauteuil, mais d’un jeune homme<br />
vigoureux, habile pour les danses et versé en liturgie.<br />
-52-
ouche. Le sel symbolise la richesse (c’était autrefois une denrée précieuse, circulant depuis<br />
la côte jusque loin dans l’intérieur des terres) mais aussi une protection contre les sorciers 78 .<br />
•Invocations<br />
Présentation de la bougie<br />
Annonçant le mwago, les appels de la corne getsika redoublent pour appeler les<br />
esprits. Puis, chacun des initiés pousse à tour de rôle un long murmure interrompu par un<br />
coup de glotte. L’orateur masculin, maquillé pour l’occasion, entame alors son invocation, la<br />
flamme de la torche mopitu lui faisant face afin de lui procurer le courage nécessaire. Dans la<br />
branche du Myɔbε, ce mwago s’étire en une sorte de longue lamentation mi-parlée mi-<br />
chantée. Dans la branche du Ngɔndε, réputée pour ses rythmes frénétiques, l’invocation est<br />
exécutée à une cadence haletante. Le mwago est un appel aux ancêtres pour qu’ils viennent<br />
seconder les vivants le temps de la veillée – d’où la récurrence au milieu des couplets de<br />
formules comme “yagagayi !” (“venez !”) ou “kɔkɔ dyano, ngongo dyano !” (demande<br />
respectueuse d’intercession). Sont évoqués “tous les aïeux qui sont passés avant nous dans le<br />
Bwete” : pères initiateurs défunts, fondateurs légendaires et personnages mythiques. Pour<br />
l’initiation d’un banzi, le mwago sert également à présenter aux ancêtres le nouveau venu<br />
dans le Bwete et les raisons de son initiation 79 .<br />
Lorsque l’orateur a fini, les autres initiés font à tour de rôle une invocation beaucoup<br />
plus brève, les moins experts se bornant à appeler “Bangooo !” (synonyme énigmatique du<br />
Bwete). Une série de chansons et une bénédiction collective viennent clore la séquence. C’est<br />
78 Au cours de la veillée, les offrandes seront d’abord déposées dans l’assiette de sel avant d’être touchées par le<br />
donataire, afin d’éviter les mauvais sorts cachés à l’intérieur (les dons étant toujours potentiellement<br />
empoisonnés).<br />
79 Il existe en réalité deux types d’invocations masculines, souvent mal distinguées : le mwago et le buluma. Le<br />
buluma, plus bref, brode sur des thèmes cynégétiques et devait donc être à l’origine une invocation préparatoire à<br />
une expédition de chasse. Aujourd’hui, il vaut plutôt comme invocation préparatoire à la consultation, chasse et<br />
divination étant symboliquement associées.<br />
-53-
alors au tour des femmes mabundi de faire leur invocation appelée mosema. Il s’agit d’une<br />
série de chants rythmés par le petit tambour à membrane mokiki, frappé à l’aide d’une<br />
baguette et d’usage strictement féminin. Chaque chanson est bissée par une seconde initiée<br />
afin d’évoquer la gémellité, thème dominant dans la branche des mabundi 80 .<br />
•Bain et habillage<br />
Bénéficiaire de la veillée en tête, les initiés masculins partent ensuite au bwεnzε (site<br />
secret en brousse) pour le bain mososo qui sert à la fois à laver les pollutions qui risqueraient<br />
de souiller le Bwete (notamment celle des relations sexuelles) et à se protéger contre les<br />
agressions sorcellaires 81 . Un conciliabule se tient ensuite afin de se répartir le travail rituel de<br />
la veillée : choix des trois premiers danseurs parmi les cadets à éprouver (le premier étant<br />
normalement le bénéficiaire de la veillée) et des trois derniers parmi les aînés expérimentés<br />
(danse de consultation). Les initiés vont après cela s’habiller et se maquiller pour les danses 82 .<br />
Cet accoutrement manifeste que, lors d’une veillée de Bwete, les initiés ne sont plus les<br />
personnes qu’ils étaient dans le monde diurne et profane.<br />
L’accoutrement minimal d’un nganga comprend un pagne de coton noué à la taille et<br />
passé dans l’entrejambe, une pièce de raphia tissé portée de la même manière, une peau de<br />
genette mosingi pendant entre les jambes, ainsi qu’une plume rouge de perroquet piquée dans<br />
les cheveux au-dessus du front 83 . Tout le corps est en outre badigeonné de kaolin blanc<br />
pεmba. La plupart des nganga ajoutent à cet accoutrement de base de nombreux atours :<br />
autres pièces de raphia pendant à la taille, bracelets de raphia non tissé aux bras et aux jambes,<br />
grelots pour être le plus sonore possible en dansant, folioles de palmier glissées à la ceinture,<br />
colliers de coquillages ou de crocs de panthère, couvre-chefs de raphia ornés de cauris ou de<br />
fragments de miroir ou diadèmes de plumes. A ce costume, il faut encore ajouter tous les<br />
fétiches bwete en bandoulière ou en sautoir, cannes sculptées mopango, chasse-mouches<br />
kombo en fibres de raphia ou en poils d’éléphant ou de buffle, etc. Plus un initié est âgé dans<br />
le Bwete, plus richement il sera vêtu. Certaines parures sont réservées à certains grades (par<br />
exemple, canne et peau de panthère pour les pères initiateurs). Le code du maquillage est<br />
strict : un banzi ne se badigeonne qu’au kaolin blanc ; il faut avoir avalé motoba pour tracer<br />
un trait rouge du nombril à la bouche ; il faut posséder l’herminette kwεto pour porter un trait<br />
80<br />
La gémellité représentant le comble bénéfique de la fécondité féminine.<br />
81<br />
Le seau purificateur comprend écorces, sel, jus des feuilles mukwisa (savon indigène utilisé notamment pour la<br />
toilette intime des femmes).<br />
82<br />
Jusqu’à présent, ils étaient torse et pieds nus, vêtus d’un pagne simplement noué à la ceinture.<br />
83<br />
L’habillage est méticuleux : si une pièce du costume venait à tomber au cours d’une danse, il faudrait payer<br />
une amende (notamment pour la peau de mosingi qui symbolise le pénis).<br />
-54-
ouge aux lèvres ; il faut avoir traversé le Bwete pour posséder un maquillage corporel et<br />
facial plus élaboré (composition individuelle de points et de traits, blancs, rouges, ocres et<br />
noirs).<br />
Nganga<br />
-55-
Nganga et son fils<br />
L’accoutrement des femmes mabundi, qui sont allées s’habiller à part, est un peu<br />
moins chargé que celui des hommes : pagne brodé, rouge, blanc et noir, noué autour de la<br />
poitrine, trois tresses “civils” (collées le long de la tête), ornés par une plume rouge de<br />
perroquet d’un côté et une plume de pintade kanga de l’autre, colliers de perles multicolores<br />
en sautoir et en bandoulière, grelots ou raphia non tissé à la ceinture, hochet sokε, couteau ou<br />
sabre de bois. Le front est maquillé au kaolin rouge ainsi que la tresse centrale, un point de<br />
kaolin blanc est ajouté au milieu des sourcils.<br />
Ainsi habillés et maquillés, nganga et mabundi méconnaissables se sont<br />
métamorphosés en véritables esprits mikuku. La pénombre, la fatigue et les effets de l’eboga<br />
aidant, il n’est d’ailleurs pas difficile de prendre ces initiés accoutrés de peaux, plumes et<br />
feuilles pour d’étranges entités mi-animales mi-végétales. Ils sont alors prêts à entamer la<br />
partie décisive de la veillée, celle des danses.<br />
-56-
•La rentrée du Bwete<br />
Autour d’une heure du matin, le rythme effréné des tambours a débuté à l’intérieur du<br />
mbandja. En file indienne serrée, premier danseur en tête, tous les initiés dansant et chantant<br />
quittent le bwεnzε pour rejoindre le corps de garde. La file des initiés s’enroule en spirale à<br />
l’intérieur du mbandja pour converger vers la torche centrale itsamanga en un cercle compact<br />
oscillant à l’unisson en une sorte de houle centripète 84 . Cette séquence marque l’ouverture de<br />
la phase décisive de la cérémonie et revêt une importance rituelle considérable : les initiés<br />
sont allés chercher les esprits mikuku et le Bwete au bwεnzε (en brousse) pour les faire rentrer<br />
avec eux au mbandja (au village) – d’où le nom de la séquence. S’asseyant de nouveau au<br />
geliba (l’espace intérieur du corps de garde), les initiés “font asseoir le Bwete” parmi eux,<br />
comme on fait asseoir un chef coutumier sur le siège kwanga lors de son intronisation. Avec<br />
la rentrée du Bwete, un nouveau stade est ainsi franchi dans l’implication collective : la houle<br />
compacte des initiés massés autour du feu est bien le climax collectif de la veillée, climax qui<br />
se maintient sur un plateau pour décroître lentement jusqu’au matin.<br />
La rentrée du Bwete<br />
Après avoir fait rentrer le Bwete et les esprits mikuku, il faut encore les accueillir<br />
dignement. Avec son chasse-mouches, un initié balaie le sol du corps de garde au son de la<br />
chanson “vengo, vengo” (“dehors, dehors” – sous-entendu la saleté, les sorciers) : c’est la<br />
séquence mogɔmbo (litt. balayer). Il entonne ensuite la chanson “samba o samba” (litt.<br />
bienvenue) et fait le tour de l’assemblée dont il badigeonne mains ou coudes d’une pommade<br />
84<br />
Cette grosse torche cylindrique posée au sol a été allumée au début de la séquence et brûlera sans interruption<br />
jusqu’au matin.<br />
-57-
servant à anéantir toute attaque sorcellaire. Il jette ensuite de la poudre de kaolin blanc tout<br />
autour de l’étendue centrale du corps de garde, afin de délimiter l’espace des danses et de le<br />
protéger des sorciers.<br />
•Début de la consultation<br />
Balayage rituel mogɔmbo<br />
Les nganga invitent ensuite les spectateurs qui souhaitent recevoir la consultation<br />
divinatoire (ordinairement une à trois personnes par veillée) à se faire connaître et à payer leur<br />
écot. Le nganga choisi pour la divination se fait passer aiguille et bougie, puis demande au<br />
patient son nom ainsi que ceux de son père et de sa mère. Le patient doit se présenter de face<br />
puis de dos, afin de ne rien cacher de sa vie au nganga. On lui demande alors d’aller se<br />
rasseoir, la consultation proprement dite n’ayant lieu qu’au matin. Mais lors de leurs danses,<br />
les nganga pourront déjà concentrer leur puissance de clairvoyance sur ces cas.<br />
•Danse des nganga et des mabundi<br />
Autour de trois heures, après une brève invocation, les trois premiers danseurs – les<br />
trois nganga – vont sortir danser. La torche mopitu à ses pieds, flamme dirigée vers la sortie<br />
afin de lui montrer le chemin, le premier nganga empoigne un chasse-mouches et des<br />
rameaux de mabunza qu’il secoue frénétiquement tout en bousculant furieusement la tête. Il<br />
entonne alors une chanson reprise en chœur, saisit la torche et se lève pour danser devant le<br />
feu central itsamanga, courrant frénétiquement sur place en secouant violemment la torche<br />
devant lui 85 . Le danseur va ensuite prendre la bénédiction du père initiateur – et s’il s’agit<br />
d’une veillée de remise de bwete, c’est à ce moment que le père initiateur lui remet son<br />
nouveau fétiche – puis sort du corps de garde pour aller jusqu’au bwεnzε chercher les mikuku<br />
(sous-séquence de la “sortie en dibadi”). Après avoir invoqué “Bangooo !” face à l’entrée, il<br />
85<br />
Cette danse extrêmement rapide, appelée mwεnge, est caractéristique du Misɔkɔ Ngɔndε. Dans le Misɔkɔ<br />
Myɔbε, la danse est plus lente, l’initié tournant autour du feu central.<br />
-58-
entre au mbandja et danse un moment avant de saluer l’assemblée d’un vigoureux<br />
“bwεkaye !”. Il tend enfin à la femme qui l’avait remplacé à sa place au geliba (sa propre<br />
épouse ou une initiée mabundi) la torche qu’elle éteint avec un rameau de mabunza.<br />
Les deux autres nganga accomplissent à la suite leur tour de danse selon la même<br />
chorégraphie. Les trois danseurs enchaînent enfin une longue série de danses, danses lentes au<br />
son de l’arc musical ou danses rapides au son des tambours, puis vont rejoindre leur place au<br />
geliba, épuisés par l’effort. Les autres initiés masculins vont ensuite danser à tour de rôle,<br />
selon l’ordre hiérarchique inversé. Sans sortir du mbandja ni brandir la torche, ils peuvent<br />
faire étalage de figures acrobatiques (voltes mobisa), rivalisant d’agilité en sortant leurs<br />
“bottes secrètes”. Reprenant les analyses de V. Turner sur la communitas, J. Fernandez fait du<br />
sentiment de communion (oneheartedness) l’objectif principal du rituel du Bwiti fang<br />
(Fernandez 1982 : 532-564). Dans le Misɔkɔ, l’expression de la solidarité du groupe<br />
initiatique est pourtant tempérée par des séquences où rivalité et agressivité trouvent à<br />
s’exprimer. Ainsi ces danses masculines qui peuvent aller jusqu’à prendre une connotation<br />
sorcellaire, lorsque des nganga malintentionnés lancent à leurs rivaux des “fusils nocturnes”<br />
afin de les faire chuter en public.<br />
Arrive ensuite le tour de danse des femmes, après une nouvelle invocation. Les deux<br />
aînées, tenant un petit miroir, du kaolin rouge, un couteau ainsi qu’une torche mopitu, sortent<br />
du mbandja en dansant de manière synchronisée. Elles rentrent pour faire le tour de<br />
l’assemblée et marquer au kaolin rouge spectateurs et initiés, au poignet pour les femmes, à la<br />
cheville pour les hommes, d’une large croix sur la poitrine pour les pères de jumeaux. Les<br />
autres mabundi vont ensuite danser en duos au milieu de l’espace central, brandissant un petit<br />
couteau et le hochet sokε. Cette danse, moins rapide et acrobatique que celle des hommes,<br />
consiste en déhanchements vigoureux (rythme appelé mademba) 86 .<br />
•Danse de consultation<br />
C’est ensuite au tour des “vieux” d’effectuer la danse de consultation (danse des<br />
mibele) autour de six heures. Ces trois ou quatre aînés, dont le père initiateur, sont richement<br />
vêtus et arborent d’impressionnants visages mouchetés ou zébrés de rouge, de blanc et de<br />
noir. Leur danse, alternant figures acrobatiques et moments de pose affectée, ressemble à celle<br />
des trois premiers nganga en plus démonstrative. La danse des deux derniers mibele possède<br />
en outre une fonction divinatoire. Brandissant torche, miroir de consultation et kaolin (blanc<br />
pour l’avant-dernier mobele, rouge pour le dernier), ils parcourent l’assemblée et consultent<br />
86<br />
Ce type de danse se retrouve dans la plupart des sociétés initiatiques féminines au Gabon (Nyεmbε, Ombudi,<br />
etc.).<br />
-59-
chacun au passage en lui traçant sur le corps des marques de kaolin. Ces signes divinatoires<br />
possèdent une signification précise selon leur localisation corporelle. A ses co-initiés, le<br />
mobele fait généralement un signe de bonheur. Aux spectateurs, qui sont tous des malades<br />
potentiels pour un nganga, il fait plutôt signes d’infortune – ceux qui avaient précédemment<br />
demandé à se faire consulter faisant l’objet d’une attention particulière. Les interprétations<br />
orales de ces signes attendront toutefois le matin.<br />
•Séquence conclusive<br />
Après un ultime tour de danse, il est temps de clore la veillée car, dehors, le soleil est<br />
déjà levé (séquence tsobula Bwete – litt. terminer le Bwete). Réunis en cercle autour de la<br />
torche centrale, les initiés, mains tendues et paumes ouvertes, reçoivent la bénédiction<br />
collective d’un aîné qui se lance dans un long récitatif alternant chants et discours. Quand tout<br />
est dit, la grosse torche itsamanga est éteinte à l’aide d’un bouquet de mabunza au son de la<br />
formule “etsobu-tsobu” (“c’est fini”). Les initiés sortent alors un instant contempler les<br />
premiers rayons du soleil. Le premier nganga salue une dernière fois par un “bwεkaye !”<br />
auquel tout le monde répond “ h aaayye !” : la veillée est finie. Les initiés peuvent alors se<br />
dévêtir et, avec les spectateurs profanes, profiter ensemble du repas servi au corps de garde<br />
dans une atmosphère désormais détendue et informelle. Au fur et à mesure de la matinée, les<br />
initiés s’en vont progressivement, sans se retourner ni saluer l’assemblée pour ne pas rendre la<br />
bénédiction du Bwete 87 .<br />
•Réunion au bwεnzε<br />
La matinée est consacrée au bwεnzε, réunion privée qui peut se poursuivre jusque tard<br />
dans la journée 88 . Sa partie semi-publique (avec des profanes) comprend l’achèvement de la<br />
consultation avec les patients, ainsi que les conseils et la bénédiction donnés au bénéficiaire<br />
de la veillée et à ses parents. Sa partie privée (entre initiés) comprend le débriefing de la<br />
veillée et l’enseignement initiatique des cadets (concernant les multiples significations<br />
secrètes des séquences rituelles). Les amendes pour infractions rituelles pleuvent et les<br />
palabres entre initiés ne manquent jamais. En effet, la solidarité de façade est de mise pendant<br />
la veillée : lorsqu’une dispute menace d’éclater, l’aîné s’exclame “base !” sur un ton impératif<br />
jusqu’à extorquer au cadet un autre “base !” en réponse. Cela ne signifie pas que ce dernier<br />
approuve, mais seulement qu’il accepte de reporter la discussion au bwεnzε du matin. Ce<br />
87 De même, il faut attendre le soir pour se laver, car sueur et crasse de la veillée portent chance.<br />
88 Le bwεnzε désigne d’abord le lieu où les initiés accomplissent les séquences rituelles secrètes, mais aussi par<br />
extension métonymique toute réunion privée entre initiés.<br />
-60-
“base !” forcé sert ainsi à faire référence au contexte contraignant du rituel afin d’éviter de le<br />
mettre en péril par un acte non-pertinent. Si le mbandja est le théâtre public où s’exprime la<br />
solidarité officielle entre initiés, le bwεnzε est donc le lieu privé de gestion des conflits.<br />
-61-
1. Edika<br />
Chapitre III<br />
Edika et son double<br />
La seconde étape du parcours initiatique du Bwete Misɔkɔ est la veillée d’edika au<br />
cours de laquelle le banzi mange un ragoût rituel carné 89 . Au début de la veillée, une parente<br />
du banzi – qui n’est pas en période de menstruation – pile les ingrédients du plat rituel que<br />
tous les initiés viennent déposer à tour de rôle dans le mortier au milieu du corps de garde :<br />
arachides, graines de courge (Cucumeropsis edulis), écorces de geɔmba (Pycnanthus<br />
angolensis), muninzi, osambi (Uapaca le testuana) et getodo (Plagiostyles africana). Alors<br />
que ce pilage est public, la confection du paquet d’edika a lieu en secret au bwεnzε avec les<br />
initiés ayant déjà franchi cette étape, les femmes étant exclues y compris lorsque edika est<br />
destiné à l’une d’entre elles.<br />
Il faut tout d’abord sacrifier un coq (ou une pintade kanga – Guttera Plumifera – pour<br />
un edika féminin). Une plume rouge de perroquet, dont l’une des significations secrètes<br />
renvoie à la langue, est fichée dans le bec du volatile afin d’en faire un auxiliaire de la parole<br />
du Bwete. Puis, l’officiant (l’initiateur ou l’un de ses auxiliaires de confiance) secoue<br />
frénétiquement le coq jusqu’à ce que mort s’ensuive – modalité singulière de sacrifice car les<br />
os du cou doivent rester intacts et le sang ne doit pas couler. La volaille, plumée et grillée<br />
superficiellement, est divisée en trois parts : chair, tête et pattes, abats. Le gésier fait l’objet<br />
d’un traitement particulier : il est fendu et truffé d’un peu de la mixture pilée, puis refermé à<br />
l’aide d’une ficelle.<br />
Ensuite, deux initiés assis face à face jambes écartées disposent sur de grandes feuilles<br />
de bananier placées entre eux tous les ingrédients du plat rituel. Des anneaux et gourmettes<br />
sont éventuellement mis au fond du paquet pour en faire des porte-bonheur chargés de la<br />
puissance d’edika. Au centre, gésier, tête et pattes sont méticuleusement dressés et ajustés<br />
ensemble pour façonner une “personne”, le cœur vivant d’edika. La chair du coq, quelques<br />
quartiers de viande de gibier (antilope, porc-épic ou éléphant) et la mixture pilée sont<br />
agglomérés autour. Plusieurs litres d’huile de palme, de l’huile de mwabi (Mimusops djave),<br />
du miel et du sel sont ajoutés. Tous les ritualia du Bwete (instruments de musique, fétiches,<br />
chasse-mouches, etc.) sont ensuite grattés symboliquement au-dessus du plat afin de mettre à<br />
contribution leur puissance.<br />
89 Le délai entre deux étapes n’est pas fixe et ne dépend que de la volonté et des moyens de l’initié.<br />
-62-
Les feuilles de bananier sont rabattues de manière à former un gros paquet que l’on<br />
ficelle à l’aide d’une corde tressée de feuilles de palmier. Le schème de la coopération rituelle<br />
est de nouveau mobilisé : la longue corde qui symbolise le python mbɔmɔ passe par tous les<br />
initiés avant d’être enroulée autour du paquet au son de la chanson “dwarisa na mikatu<br />
mikatunga” (“nous nous renforçons par d’étroits liens de corde”). Les deux officiants, cette<br />
fois placés dos-à-dos, nouent à l’aveugle le paquet qui est disposé entre eux. Procéder de dos<br />
est une façon de se soustraire à l’emprise des sorciers, et pour la même raison, le nœud doit<br />
être le plus serré possible. Quelques feuilles de palmier sont enfin piquées au sommet du<br />
paquet afin de “l’habiller”. On confectionne en outre sur le même modèle un paquet miniature<br />
qui renferme les abats du coq, nourriture qui sera offerte aux génies mikuku.<br />
Le portage d’edika jusqu’au feu de cuisson se fait de singulière manière : l’officiant,<br />
courbé, appuyé sur une canne, chasse-mouches kombo en main et besace pεngε soutenue par<br />
le front, porte le paquet à son pied gauche, la boucle du cordon enfilée dans son gros orteil.<br />
Au bout d’une ou deux heures sous la braise, edika est prêt. Sa consommation constitue<br />
ensuite la partie la plus secrète de la veillée 90 . Les abats et de petits morceaux de banane<br />
bouillie sont jetés aux quatre coins du bwεnzε pour les esprits mikuku. Puis, sur une peau de<br />
genette mosingi, on dispose une feuille de bananier, et sur cette dernière, une portion de chair<br />
du coq. Le bénéficiaire de la veillée rampe à plat ventre vers la nourriture, une autre peau de<br />
mosingi placée sur sa tête. Il la hume avant de la manger sans s’aider des mains, comme un<br />
animal. Lorsqu’il a fini, il se relève pour faire tomber de sa tête la peau de genette et salue<br />
l’assemblée 91 .<br />
Peau de la genette mosingi<br />
Il mange ensuite le gésier du coq et suce la chair de la tête et des pattes, accompagnée<br />
de bananes bouillies, en prenant bien garde de ne pas briser les os qui serviront à<br />
90<br />
Au edika d’une femme, les mabundi sont admises (alors qu’elles restaient exclues de la confection du paquet).<br />
91<br />
Pour l’edika d’une femme, l’initiée mange agenouillée avec une peau de mosingi sur son épaule gauche (côté<br />
féminin du corps).<br />
-63-
confectionner le fétiche tsombi. Les autres initiés peuvent alors se partager avidement le reste<br />
d’edika, se frottant le corps avec la sauce afin de s’imprégner de sa puissance. Une fois la<br />
viande mangée, les initiés retournent au corps de garde poursuivre la veillée – les reliquats<br />
d’edika, feuilles et carcasse du coq, étant mis de côté pour être plus tard enterrés en forêt.<br />
Paquet d’edika<br />
Edika remplit plusieurs fonctions. Il forme tout d’abord le soubassement nécessaire de<br />
tous les autres plats rituels : c’est la “maison” des bwete ou le “matelas” sur lequel ils<br />
viendront reposer (du fait de sa texture moelleuse). Mais c’est également un “médicament”<br />
qui guérit les plaies internes et prévient les empoisonnements en rejetant les nourritures<br />
impures (par vomissements ou selles). Edika est conçu comme un véritable auxiliaire spirituel<br />
qui alerte son propriétaire en cas d’agressions sorcières. C’est un double du cœur, organe<br />
animé et doué d’intentionnalité. En mangeant edika, le banzi a en effet ingurgité une véritable<br />
“personne”, ce qu’atteste le traitement rituel du gésier et de la tête du coq. Le gésier du coq<br />
est son nzanga – son “vampire” – qui lui permet de parler et consulter (le coq est un devin car<br />
son chant est un avertissement contre les sorciers) 92 . Edika forme donc un vampire auxiliaire<br />
qui parle à son propriétaire, préfigurant en plus faible et moins fiable, l’esprit divinatoire<br />
motoba au centre de l’étape rituelle suivante. Il participe ainsi à la construction d’un sujet<br />
initié arc-bouté à la maîtrise progressive de la parole divinatoire grâce à des incorporations<br />
rituelles.<br />
Si edika est une personne, c’est parce qu’à l’origine, les initiés étaient censés sacrifier<br />
un être humain pour confectionner leur ragoût. Le rituel était donc un repas anthropophage.<br />
Afin d’éviter de décimer les villages, les hommes ont cependant décidé de substituer un coq à<br />
la personne humaine. Cette équivalence permet de maintenir les “débuts du Bwete” dans<br />
temps mythique à la fois proche et lointain : la substitution de la volaille opère un saut logique<br />
tout en réactivant le souvenir du sacrifice humain. Le mythe d’origine d’edika rend compte<br />
des raisons de ce sacrifice humain et de l’identité de la victime (qui diffèrent selon les deux<br />
versions concurrentes).<br />
92 Le nzanga ou “vampire” désigne en réalité l’organe de sorcellerie, ou plus exactement l’organe intentionnel de<br />
la puissance efficace. Sur l’ambivalence du vampire, cf. chapitre IX.<br />
-64-
M 1 (edika)<br />
“Un jour, une femme trouve le Bwete en brousse et le ramasse. Elle le ramène au<br />
village et son mari s’en empare. Le frère de la femme arrive au village pour voir<br />
ce Bwete dont tout le monde parle. Les deux hommes se réunissent en secret<br />
pour faire le premier edika. Dibenga, la fille du couple, pénètre à l’improviste<br />
dans la case et découvre le secret. Les hommes la sacrifient et la mettent dans le<br />
paquet d’edika. Le soir, la mère cherche sa fille en pleurant Dibenga ooo…<br />
C’est comme cela que le mwago [invocation rituelle] a commencé. Dans la case,<br />
les deux hommes se disputent la paternité du Bwete : le père dit que c’est sa<br />
fille ; l’oncle dit que c’est sa nièce. Le Bwete reste finalement avec le père et<br />
l’oncle retourne dans son village. Mais bientôt, le père installé au corps de garde,<br />
voit l’oncle revenir pour les palabres. Il fait mmm… C’est comme cela que le<br />
gima [séquence rituelle du murmure] a commencé.”<br />
M 2 (edika)<br />
“Le premier qui a fait edika, c’était un homme qui s’appelait Mongo mwana ya<br />
Pindo [Mongo fils de sa mère Pindo]. Il part en brousse faire son edika sans<br />
prévenir sa femme. L’épouse curieuse décide de le suivre pour découvrir son<br />
secret. En chemin, elle trouve les pièges qu’il a posés en forêt. Un porc-épic dont<br />
il manque un gigot est accroché au premier. Une antilope dont il manque aussi<br />
un gigot est accrochée au second. Elle trouve ensuite un éléphant mort dont un<br />
gigot avait été arraché. Elle arrive enfin à l’endroit où son mari s’apprête à<br />
manger le paquet d’edika dans lequel il a mis la viande de l’éléphant, du porcépic<br />
et de l’antilope. Le mari entend un craquement de brindilles et part se<br />
cacher derrière un arbre. Il voit la genette mosingi qui vient goûter edika. Le<br />
mosingi entend un autre bruit et se sauve à son tour. C’est une pintade qui vient<br />
manger sa part d’edika. Un nouveau bruit fait fuir l’oiseau. C’est la femme qui,<br />
affamée depuis le village, goûte à son tour edika. Son mari surgit dans son dos et<br />
la tue avec l’herminette kwεto pour la punir d’avoir découvert son secret. Il la<br />
découpe en morceaux et la met dans le paquet d’edika.” 93<br />
Les oppositions structurelles entre ces deux versions sont évidentes : village versus<br />
brousse, enfant sacrifiée par son père et son oncle maternel versus épouse sacrifiée par son<br />
mari, sacrifice à cause de la découverte accidentelle de secrets rituels versus sacrifice à cause<br />
de la découverte volontaire d’un secret de chasse. Par-delà ces oppositions se dessine<br />
néanmoins un schéma d’ensemble : la découverte du secret des hommes par une femme exige<br />
un sacrifice. Les deux secrets masculins sont d’ailleurs liés, pour autant que le Bwete a à voir<br />
avec la chasse. Et l’identité des deux victimes l’est également, puisque c’est la fécondité<br />
féminine qui est sacrifiée à travers l’épouse ou la jeune enfant, comme le prouve la<br />
symbolique du paquet d’edika : le paquet de feuilles est le ventre d’une femme, l’huile de<br />
93 L’épisode de la genette chapardeuse explique l’étrange façon de manger edika qui est celle des initiés : le<br />
banzi qui porte une peau de genette sur la nuque, rampe et hume la nourriture imite en fait le mosingi du mythe –<br />
premier animal à avoir mangé edika.<br />
-65-
palme non filtrée (rouge orangé) son sang menstruel, la plume rouge de perroquet piquée dans<br />
les feuilles son clitoris, la corde tressée son cordon ombilical, le nœud son nombril. Les restes<br />
d’edika sont en outre enterrés à l’issue de la veillée au pied d’un palmier qui représente<br />
encore une femme (les régimes de noix de palme figurant son sang menstruel).<br />
La rivalité entre les deux hommes à propos de l’appropriation du Bwete dans la<br />
version M 1 évoque alors les tensions structurelles qui existent entre le père et l’oncle<br />
maternel dans un système social dysharmonique tendu entre filiation matrilinéaire et<br />
résidence virilocale. Malgré la filiation matrilinéaire, l’importance du père est en effet<br />
parfaitement reconnue 94 . Le mythe met ainsi en scène le litige fondamental touchant<br />
l’appropriation masculine de la force productive des femmes 95 . La capacité procréatrice va<br />
normalement au lignage du frère (matrilinéarité) et la force de travail au lignage du mari<br />
(virilocalité). Mais lorsqu’une femme découvre le Bwete en brousse, qui du frère ou du mari a<br />
le droit de le garder dans son village ? La question provoque des palabres interminables<br />
comme l’illustre le retour de l’oncle à la fin du récit.<br />
Les mythes d’origine d’edika racontent ainsi l’histoire d’un sacrifice féminin qui<br />
tourne autour du lien entre secret initiatique et exclusion rituelle des femmes. Ce sacrifice<br />
originel a une valeur fondatrice puisque c’est lui qui institue véritablement edika : tous les<br />
edika requièrent désormais un sacrifice (sacrifice humain ou équivalent animal). Mais<br />
qu’avait de si important ce secret découvert par l’enfant ou l’épouse pour qu’il impose leur<br />
meurtre ? D’après M 2, le ragoût de gibier d’edika renvoie à l’appropriation secrète par les<br />
hommes des produits de la chasse, activité exclusivement masculine contrairement à la pêche.<br />
L’épouse qui mange le gibier de son mari est sacrifiée pour cette transgression de la division<br />
sexuelle des activités, et le plat rituel commémore cette transgression (d’où la présence de<br />
quelques quartiers de gibier en sus du coq).<br />
La version M 1 offre cependant une version plus ambiguë : il n’est jamais dit ce que<br />
les deux hommes faisaient de si secret dans la case d’edika pour que cela nécessite de sacrifier<br />
séance tenante leur fille et nièce. Le sacrifice originel n’est donc pas perpétré pour préserver<br />
un secret particulier mais bien le secret initiatique en général, pure forme sans contenu. C’est<br />
par conséquent le sacrifice originel qui institue le secret, et non le secret malencontreusement<br />
découvert qui nécessite le sacrifice. Edika possède ainsi un caractère auto-référentiel : les<br />
hommes sacrifient une enfant pour maintenir un secret qui n’est en réalité rien d’autre que le<br />
sacrifice lui-même. Et le seul véritable secret initiatique d’edika porte aujourd’hui encore sur<br />
94 La société n’est donc que minimalement matrilinéaire, comparée au modèle trobriandais où le père n’est pas<br />
reconnu comme géniteur et ne désigne à la limite que l’époux de la mère, un allié plutôt qu’un consanguin.<br />
95 Puisque le Bwete, comme nous le verrons, organise l’appropriation rituelle du pouvoir féminin.<br />
-66-
le sacrifice rituel du coq et sa signification : à travers un sacrifice animal, edika répète et<br />
dissimule l’histoire du sacrifice humain.<br />
Sacrifice d’edika et secret initiatique renvoient donc conjointement à l’exclusion<br />
rituelle des femmes. Or, le récit M 2 justifie paradoxalement l’inclusion des femmes mabundi<br />
dans le Bwete : l’épouse sacrifiée est la sœur aînée de toutes les mabundi. C’est depuis ce<br />
sacrifice que les femmes sont dans le Bwete : “la première mabundi, c’était la femme du<br />
nganga qui avait fait edika en brousse. C’est elle qu’on a sacrifiée pour qu’elle ne dévoile<br />
pas le secret. Nos mabundi sont ses sœurs. C’est leur chair qu’on mange. C’est pourquoi on<br />
les a acceptées dans le Bwete”. Les hommes n’ont cependant pas accepté les femmes pour se<br />
faire pardonner mais bien pour perpétuer le secret d’edika, ou plus exactement pour le<br />
sécréter. La sécrétion du secret, au sens que lui donne A. Zempléni, désigne le processus par<br />
lequel le secret s’exhibe devant ses destinataires sans être pour autant révélé par ses<br />
détenteurs (Zempléni 1976). Cette ostension dissimulatrice manifeste le secret tout en<br />
masquant son contenu.<br />
Or, les mabundi présentes aux veillées de Bwete donnent justement à voir le secret du<br />
sacrifice de leur aînée mythique, secret dont elles restent pourtant exclues alors même qu’elles<br />
y participent activement. En effet, si les mabundi peuvent manger edika, elles ne peuvent en<br />
aucun cas assister au sacrifice de la volaille ni à la confection du paquet. Les hommes sont les<br />
détenteurs du secret d’edika, les femmes en sont seulement les destinataires et jamais les<br />
dépositaires. La sécrétion du secret se fait ainsi sur mode particulièrement ironique qui laisse<br />
entrevoir la forme relationnelle complexe au principe de l’inclusion des femmes dans le<br />
Bwete Misɔkɔ : par leur simple présence, les femmes exhibent à leur insu le secret des<br />
hommes dont elles sont exclues.<br />
2. Tsombi<br />
Les os intacts de la tête et des pattes du coq d’edika servent à fabriquer une protection<br />
rituelle appelée tsombi, le premier des fétiches bwete que le banzi reçoit des mains de son<br />
père initiateur au cours d’une nouvelle veillée. La confection préalable du tsombi s’effectue<br />
en secret au bwεnzε, parfois en l’absence du bénéficiaire. S’il est présent, les aînés<br />
s’emploient de toute façon à préserver leurs secrets par des ruses : “à un moment, on te dit<br />
d’aller chercher quelque chose et on met le dernier ingrédient sans te montrer”. Si l’initié<br />
possède un bwete, il ne sait donc pas encore ce qu’est un bwete puisqu’il n’en maîtrise pas la<br />
fabrication.<br />
-67-
Sur un lit d’humus (le “lit” du Bwete) placé sur un petit carré de pagne sont déposées<br />
la tête et les pattes du coq imbriquées. Une queue de porc-épic est introduite dans la tête. Des<br />
rognures d’ongle et des touffes de cheveux du banzi ainsi qu’une rognure du gros orteil droit<br />
du père initiateur sont incorporées comme dans toute protection. Une multitude d’ingrédients<br />
disparates est ensuite ajoutée – chacun des officiants apportant sa contribution personnelle<br />
selon une logique de l’accumulation maximale : écorces (arbre au tronc glissant pour<br />
détourner les attaques des sorciers, arbre qui projette ses graines au loin comme une salve de<br />
plomb, etc.), ossements animaux (panthère, hippopotame, buffle, gorille, rat palmiste, aigle,<br />
pangolin, éléphant, tortue, daman, écureuil, potamogale, etc.), coquillages, quartz (“écailles de<br />
tonnerre”), poudre à fusil, aiguille 96 … Mais, cette recette ne serait pas complète sans<br />
l’ingrédient principal du Bwete, dont le novice ne connaît toutefois pas encore la véritable<br />
nature.<br />
Le petit paquet de tissu est ensuite refermé et ligoté avec un soin obsessionnel, comme<br />
pour le paquet d’edika. Plus le tsombi est solidement emmailloté, plus longtemps il résistera<br />
aux sorciers – le relâchement des liens étant une preuve directe d’agression sorcière. Le père<br />
initiateur crache cola et nzingo sur le fétiche pour l’animer. Puis, comme tout bwete, le paquet<br />
est maquillé au kaolin, orné de cauris, peaux, fragments de miroir ou clochettes. Il est enfin<br />
cousu à une cordelette ou à l’intérieur d’un bandeau de pagne, afin de pouvoir le porter en<br />
bandoulières.<br />
Deux tsombi<br />
Comme edika, le tsombi est une “personne” – le coq ayant été métamorphosé en un<br />
génie auxiliaire. D’après une devinette initiatique, le coq qui picore des asticots fut le premier<br />
à avoir avalé l’esprit divinatoire motoba. Le tsombi matérialise cette image, les poils de la<br />
96<br />
Le tsombi est à la fois une protection et une arme contre les sorciers – d’où les ingrédients “agressifs” comme<br />
poudre à fusil ou épines.<br />
-68-
queue du porc-épic introduite dans la tête du coq représentant les asticots. Si bien que le<br />
tsombi est un coq picorant, c’est-à-dire un nganga clairvoyant. Cette métamorphose du coq<br />
renvoie également à l’enfant ou l’épouse sacrifiée dans edika puis ressuscitée dans le tsombi.<br />
Ces deux étapes rituelles mettent ainsi en scène l’un de ces miracles du Bwete inlassablement<br />
racontés : les initiés sacrifient un nourrisson pendant une veillée, le mangent à la vue de tous,<br />
puis le ressuscitent au matin 97 . Mais le tsombi est aussi très clairement un double du banzi,<br />
puisqu’il incorpore ses ongles et ses cheveux. C’est ainsi le banzi lui-même qui peut renaître,<br />
grâce à l’initiation, dans le tsombi.<br />
A l’issue de cette veillée, l’initié peut également emporter chez lui sa corbeille du<br />
Bwete. Il s’agit d’une corbeille en rotin dans laquelle l’initié place tous ses maganga 98 . S’y<br />
entasse un fatras rituel où se mêlent plumes et peaux, graines et écorces, menue monnaie,<br />
sonnailles, flacons, tabac, couteau, cartouche et poudre à fusil, morceau de termitière ou terre<br />
prélevée sur la tombe d’un parent. C’est également là que le tsombi et les autres fétiches sont<br />
rangés après une veillée. Cette corbeille accompagne l’initié à chaque cérémonie où elle est<br />
posée au geliba devant sa place 99 . C’est à elle autant qu’aux autres initiés que les saluts<br />
s’adressent. Plus encore que le tsombi, la corbeille est en effet un double de son propriétaire.<br />
Si l’initié ne l’amène pas à une veillée, on considèrera même qu’il n’est pas véritablement<br />
présent, du moins qu’il n’est pas venu avec l’intention de faire sérieusement le Bwete.<br />
Au fur et à mesure de sa carrière, l’initié remplit progressivement sa corbeille. Une<br />
corbeille bien pleine est l’indice d’un initié qui “pèse lourd” dans le Bwete 100 . Et les hommes<br />
rivalisent entre eux à travers l’exhibition ostentatoire de leurs corbeilles embellies et<br />
surchargées. La corbeille est ainsi toute la vie d’un initié du Bwete Misɔkɔ. Des règles<br />
tatillonnes entourent d’ailleurs sa manipulation. L’initié doit s’être purifié pour éviter la<br />
souillure des relations sexuelles. La corbeille ne doit jamais être enjambée, renversée ou<br />
déplacée par autrui. Si elle était par mégarde renversée, c’est en effet toute la vie de l’initié<br />
qui basculerait avec elle.<br />
3. Interdits initiatiques<br />
Comme en témoignent les règles de manipulation de la corbeille du Bwete, l’initiation,<br />
puis les veillées d’edika et motoba, entraînent un certain nombre de prescriptions et<br />
97 C’est pour ne pas empêcher cette résurrection que le banzi ne doit pas briser les os du coq en mangeant edika.<br />
98 Le terme maganga désigne l’ensemble des objets rituels du Bwete.<br />
99 Le pεngε, petit sac en fibres végétales porté à l’épaule, est un équivalent de la corbeille.<br />
100 La corbeille doit d’ailleurs toujours être soulevée des deux mains, pour manifester qu’elle est lourde.<br />
-69-
d’interdits. L’initié a mangé le Bwete et doit donc s’efforcer de ne pas gâter ce pouvoir<br />
incorporé en respectant des prohibitions initiatiques 101 . La majorité des interdits sont<br />
alimentaires et temporaires (de quelques mois à un an selon la mansuétude du père initiateur).<br />
Un novice doit ainsi proscrire citron, ail, feuilles de manioc, oseille, sauces huileuses, alcool<br />
et café. Les plats ou boissons trop lourds, trop forts et surtout trop acides risqueraient en effet<br />
de détruire le pouvoir du Bwete, notamment celui d’edika et motoba à l’intérieur du ventre.<br />
Certaines prohibitions alimentaires sont définitives : sur le modèle des interdits claniques, un<br />
initié ne doit jamais manger la genette ou la panthère qui sont désormais ses parents. Enfin,<br />
l’initiation aggrave la prohibition générale qui interdit aux hommes de manger des aliments<br />
préparés par une femme en période de menstruation.<br />
L’autre grande classe des prohibitions initiatiques concerne les interdits sexuels. Un<br />
banzi doit s’abstenir de tout rapport sexuel pendant les quelques mois qui suivent son<br />
initiation. S’il avait des relations sexuelles avec une femme, tout le pouvoir du Bwete<br />
passerait dans l’organisme de sa partenaire. Pour les mêmes raisons, après la période<br />
d’abstinence, la fellation est normalement réservée à l’épouse ou aux épouses légitime(s). De<br />
même, après une veillée, l’initié doit avoir un rapport sexuel avec son épouse avant tout autre<br />
femme. Ces interdits montrent que les relations sexuelles constituent de véritables<br />
inséminations génitales ou orales du Bwete : le sperme est ou contient le Bwete. C’est pour<br />
cela qu’il faut en éviter la dissémination hors du foyer domestique 102 . En outre, il est interdit à<br />
un initié de manipuler les ritualia ou de s’asseoir au geliba, s’il ne s’est pas purifié après des<br />
relations sexuelles (purification à l’eau simple, au sel ou au savon végétal mukwisa). Enfin, la<br />
corbeille rituelle, souvent rangée dans la chambre, doit être couverte d’un pagne lorsque<br />
l’initié a un rapport sexuel. C’est dire qu’outre le risque de dissémination du Bwete, les<br />
rapports sexuels portent en eux un risque de souillure 103 .<br />
101 La transgression d’un interdit peut provoquer malheur et maladies. La détection rétrospective d’une<br />
transgression offre ainsi une alternative possible à l’étiologie sorcellaire de l’infortune.<br />
102 Cette menace est renforcée par l’opinion répandue parmi les hommes, qui veut que la femme soit une sorte de<br />
vampire cherchant à aspirer leur force vitale, notamment au cours des relations sexuelles.<br />
103 La prohibition sexuelle la plus importante concerne le cunnilingus qui représente la souillure maximale,<br />
conjonction de la bouche de l’initié et du sexe de la femme. L’analyse de cette proscription définitive est<br />
réservée au chapitre XI.<br />
-70-
1. Le génie-silure motoba<br />
Chapitre IV<br />
Motoba ou la parole du Bwete<br />
Après l’étape initiatique d’edika vient la veillée de motoba, au cours de laquelle<br />
l’initié gobe en secret le génie-silure éponyme 104 . Le banzi, assis sur une natte au bwεnzε, est<br />
maquillé d’un trait rouge du nombril à la bouche qui figure le trajet du silure dans<br />
l’œsophage, mais aussi le chemin inverse de la parole du motoba. Il commence par manger<br />
momεnε, mixture gluante de feuilles budyambu (Senecio gabonensis) et tangimina<br />
(commelinacée indéterminée), de blanc d’œuf et de miel, assortie de tranches de bananes<br />
mûres. La banane sert de nourriture au génie motoba, tandis que les autres ingrédients<br />
facilitent le passage du silure pour qu’il glisse bien dans la gorge du banzi et circule dans son<br />
organisme afin de lui envoyer des signaux corporels. La feuille tangimina (litt. “se souvenir”)<br />
constitue en outre un aide-mémoire pour la parole divinatoire véhiculée par le motoba. Le<br />
père initiateur administre ensuite le petit alevin de silure, ébarbé mais toujours frétillant, sur<br />
lequel il a déposé un peu de la mystérieuse du Bwete afin de le métamorphoser en génie<br />
divinatoire. Le banzi doit alors gober le silure vivant, tout rond pour ne pas tuer motoba 105 .<br />
Le génie-silure va se loger au fond du ventre du banzi, dans le “marigot” d’edika. Le<br />
ragoût moelleux d’edika permet en effet au motoba de retrouver son biotope naturel, le<br />
marécage, hors duquel il ne saurait survivre. Le silure représente ainsi le génie Mwiri qui,<br />
selon le mythe d’origine de la société initiatique masculine éponyme, est un caïman<br />
monstrueux qui vit dans un lac boueux en maître de la faune aquatique. Mais le silure<br />
représente également un de ces esprits-embryons que les femmes enceintes sont censé aller<br />
puiser dans une calebasse à la rivière pour ramener au village l’esprit de l’enfant à naître. Et<br />
ce sont d’ailleurs des femmes qui doivent aller pêcher à la rivière les mitoba, alors même qu’il<br />
leur est strictement interdit d’avaler motoba. Les hommes justifient cette exclusion initiatique<br />
(qui redouble l’exclusion du Mwiri masculin) par un argument physiologique : la femme,<br />
ouverte par son sexe, ne pourrait retenir le silure dans son corps. C’est dire que pour une<br />
104 Motoba a lieu indifféremment avant ou après la veillée du tsombi. L’étape exige en outre d’être déjà initié au<br />
Mwiri car il y a un lien entre le silure motoba et le génie aquatique Mwiri, mais de nombreux initiateurs font des<br />
entorses à cette règle. Enfin, parmi les branches du Bwete Misɔkɔ, seul le Ngɔndε – spécialisé dans la<br />
divination – possédait à l’origine motoba.<br />
105 Comme il y a habituellement plusieurs alevins disponibles, les initiés présents – qui ont tous déjà franchi<br />
l’étape – peuvent en profiter pour recevoir un nouveau motoba qui viendra renforcer leur pouvoir divinatoire.<br />
-71-
femme, l’insémination d’un esprit est nécessairement une procréation qui appelle un<br />
accouchement. Tandis que pour un homme, cette insémination orale sert non pas<br />
l’enfantement mais le pouvoir rituel et la parole divinatoire 106 .<br />
Le banzi qui gobe motoba avale ainsi un esprit supplémentaire qui s’ajoute à celui<br />
qu’il avait déjà reçu à sa naissance. Les propriétés attribuées à cet auxiliaire spirituel le<br />
rapprochent encore davantage qu’edika d’une sorte d’homuncule incorporé. Il est animé –<br />
animation visible dans le fait que le silure est avalé vivant. Il est personnalisé : plutôt de sexe<br />
féminin comme la plupart des génies aquatiques, l’image la plus répandue étant celle d’une<br />
sirène, belle femme à la peau blanche et la chevelure immense. Il est également doté d’une<br />
intentionnalité saillante : motoba alerte et défend l’initié en cas d’agression sorcière,<br />
notamment pendant le sommeil.<br />
Le sommeil, associé à une mort temporaire, est en effet synonyme de vulnérabilité<br />
maximale : le cœur continue de battre, tandis que l’esprit vagabonde hors du corps du<br />
dormeur. Et les rêves proviennent de ce vagabondage erratique. Or, les sorciers sortent<br />
également de leur corps la nuit venue. Cette excorporation, appelée “sortie en vampire”,<br />
diffère de l’errance du dormeur innocent : l’esprit du sorcier se dirige tout droit au chevet de<br />
sa victime pour l’assaillir 107 . Cette agression sera d’abord perçue par la victime dans un rêve,<br />
avant d’être douloureusement ressentie dans son corps au réveil. Un cauchemar n’est donc<br />
rien d’autre que l’effraction violente d’un sorcier dans le rêve d’autrui. L’acharnement des<br />
sorciers exigerait une vigilance de tous les instants, mais le sommeil est le contraire de l’état<br />
de veille du fait de la vacance de l’esprit. Cette âme surajoutée qu’est motoba sert alors à<br />
pallier le manque de vigilance de l’esprit inné. Elle veille le dormeur et l’alerte en cas<br />
d’attaque nocturne : elle le réveille brusquement avant que le sorcier n’ait eu le temps d’agir,<br />
ou bien provoque un rêve agressif contre l’assaillant. Motoba est ainsi le vigile du sommeil de<br />
l’initié, son gardien de nuit.<br />
2. La parole de motoba<br />
Au-delà de ces rêves d’alerte, le motoba possède une fonction divinatoire qui fait de<br />
lui un agent essentiel de la consultation des nganga : il est le messager indispensable de la<br />
parole du Bwete, cette modalité spécifique de communication au cœur du Misɔkɔ. Génie<br />
106 Un homme qui a déjà avalé le silure peut toutefois transmettre motoba à une mabundi en ayant avec elle un<br />
rapport sexuel, le génie embryon passant dans le sperme.<br />
107 Il ne faut pas confondre le “vampire” (nzanga) – organe spirituel qui n’est pas nécessairement maléfique – et<br />
la “sortie en vampire” (du verbe vembaga en getsɔgɔ) – acte d’excorporation de l’esprit toujours à des fins<br />
maléfiques.<br />
-72-
loquace, le motoba parle à son propriétaire, et dit toujours vrai. Il peut parler en n’importe<br />
quelle occasion, mais c’est pendant une veillée qu’il le fait le mieux : “pendant la veillée,<br />
quand tu danses, tu bouscules ça, le motoba monte au cœur et te transmet des pensées, te fait<br />
dire des vérités. Alors tu parles devant tout le monde, il faut avoir le courage. Ce que tu dis,<br />
c’est vrai. Personne ne peut rien dire, on peut juste dire : base !”. Cette parole à valeur<br />
divinatoire emprunte trois canaux : les rêves, les visions et pensées inspirées, les signaux<br />
corporels. Motoba garantit la véracité et la pertinence d’une production onirique jusque-là<br />
déjà signifiante mais hasardeuse : de simples songes, il fait des vérités prémonitoires. De<br />
même, motoba amplifie la valeur divinatoire des pensées inspirées ou des visions que l’initié<br />
pouvait déjà obtenir en ingérant une petite dose d’eboga. Ce sont néanmoins les signaux<br />
corporels qui constituent le canal spécifique de la parole du motoba.<br />
Ces signaux comprennent l’ensemble des manifestations épidermiques involontaires :<br />
tressaillements musculaires, frissons, picotements, impatiences, palpitations. Motoba convertit<br />
ainsi en messages divinatoires toutes ces minuscules perturbations corporelles qui surviennent<br />
constamment, mais échappent à tout contrôle et sont d’ordinaire tenues pour parfaitement<br />
insignifiantes. Il est possible – et même plausible – de considérer que ces manifestations<br />
automatiques du corps sont bien des signaux envoyés par motoba, dans la mesure où elles<br />
sont à la fois involontaires et immanentes au corps : aucune volonté intérieure ne les<br />
déclenche, aucune cause extérieure ne les provoque. Elles proviennent donc de l’action d’un<br />
autre que soi qui agit à l’intérieur de soi : il s’agit du petit silure ingéré vivant qui, par ses<br />
frétillements, titille l’initié pour l’avertir de quelque chose.<br />
Dans le même registre, les faux-pas sont également tenus pour des signaux<br />
prémonitoires : bon augure quand on trébuche du pied droit, mauvais augure du pied gauche.<br />
De même, éternuements et bâillements indiquent la proximité des génies mikuku. Et si un<br />
initié qui renverse par maladresse boisson ou nourriture, c’est seulement le signe que les<br />
mikuku veulent prendre leur part 108 . Il y a là une parenté évidente entre faux-pas, maladresses,<br />
éternuements et tressaillements, qui sont tous en quelque sorte des “erreurs” du corps. On<br />
pourrait appeler à juste titre “lapsus corporels” l’ensemble de ces phénomènes corporels ou<br />
comportementaux involontaires, puisque lapsus signifie étymologiquement faux-pas. Si la<br />
psychanalyse freudienne postule que le lapsus linguæ ou calami est un acte manqué qui<br />
constitue un message voilé où affleure l’inconscient, le Bwete Misɔkɔ postule plutôt que le<br />
lapsus corporel est un message divinatoire par lequel le Bwete parle aux initiés.<br />
108 Avant de boire, il faut toujours prendre soin de verser quelques gouttes au sol en libation aux ancêtres.<br />
-73-
Ces signaux corporels du motoba s’organisent en un véritable code divinatoire,<br />
relativement stable et univoque : la signification d’un tressaillement diffère selon sa<br />
localisation corporelle 109 . La symétrie corporelle fournit la dichotomie organisatrice. Le code<br />
divinatoire exploite en effet le couplage entre différence sexuelle et latéralité, association<br />
sémantique qui se retrouve dans la majorité des langues bantu : la droite est masculine, la<br />
gauche féminine (en getsɔgɔ par exemple, l’homme momogo et la droite gemogo s’opposent à<br />
la femme mogεto et la gauche gegεto). Un tressaillement au pied gauche annoncera ainsi<br />
l’arrivée d’une femme, au pied droit d’un homme. En réalité, la symétrie corporelle hésite<br />
souvent entre division sexuelle (homme-femme) et division lignagère (patrilignage-<br />
matrilignage). Ainsi, au cours d’une consultation, le nganga peut interpréter un tressaillement<br />
du côté gauche comme le signe de la responsabilité sorcellaire soit d’une femme, soit du<br />
matrilignage. Les couples fondamentaux du code divinatoire sont donc : droite : gauche ::<br />
homme : femme :: patrilignage : matrilignage.<br />
Le code corporel repose ensuite sur un jeu d’analogies simples (sachant que les<br />
signaux concernent la personne en vis-à-vis – exemplairement le patient lors d’une<br />
consultation –, ou bien la personne à qui l’initié est en train de penser, voire l’initié luimême)<br />
110 .<br />
- Orteil = atteinte par fusil nocturne (qui touche le pied)<br />
- Plante des pieds = arrivée imminente d’un étranger<br />
- Côté (ou plante) du pied = atteinte par le serpent invisible mbumba<br />
- Cheville = prise d’un gibier au piège (lacet)<br />
- Tibia = accident imminent<br />
- Talon d’Achille (ou mollet) = mauvais esprit qui poursuit la personne<br />
- Genou = il faut aller prendre la bénédiction (se mettre à genoux)<br />
- Dessus du genou, mouvement ascendant = rentrée imminente d’argent<br />
- Dessus du genou, mouvement descendant = sortie imminente d’argent<br />
- Devant de la cuisse = adulte malade<br />
- Arrière de la cuisse = enfant malade<br />
- Cuisse = décès imminent (on se tape sur les cuisses en cas de malheur)<br />
- Entrejambe = adultère<br />
- Sexe = maladie vénérienne<br />
- Sexe, mouvement ascendant = homme viril (érection)<br />
- Sexe, mouvement descendant = homme impuissant<br />
- Flanc = femme enceinte<br />
- Sein = femme allaitante<br />
- Ventre, mouvement ascendant = ventre sale (empoisonnement, impureté) qui exige un<br />
vomitif<br />
109 Si l’ingestion du motoba suffit à rendre signifiants les tressaillements involontaires, il faut encore une période<br />
d’instruction au cours de laquelle l’initié apprend à comprendre cette parole. Le motoba n’est qu’un premier<br />
jalon, encore insuffisant pour faire de l’initié un devin professionnel.<br />
110 La liste ci-dessus cumule les informations recueillies auprès de plusieurs nganga.<br />
-74-
- Cœur = palpitations<br />
- Main = quelqu’un va venir offrir quelque chose<br />
- Poignet = prison (menottes)<br />
- Avant-bras = problème<br />
- Coude gauche = concerne le Mwiri (les scarifications initiatiques du Mwiri sont sur le coude<br />
gauche)<br />
- Bras = grossesse sans problème (la femme enceinte porte des protections rituelles en<br />
brassard)<br />
- Haut de l’épaule = promotion sociale (“recevoir un galon”)<br />
- Épaule = mauvais esprit, colère<br />
- Derrière de l’épaule = mauvais esprit qui colle la personne (le mauvais esprit s’accroche<br />
dans le dos des gens pour les persécuter)<br />
- Haut de l’épaule à la base du cou = mort imminente (on porte le cadavre sur l’épaule)<br />
- Gorge = empoisonnement qui exige un vomitif<br />
- Nuque (ou front) = céphalées<br />
- Mâchoire = personne qui garde des ossements humains chez elle (la mâchoire est l’os<br />
humain le plus important pour les fétiches)<br />
- Bouche = palabres<br />
- Lèvre = personne qui a déjà mangé edika<br />
- Bas de la lèvre = annonce d’une bonne nourriture<br />
- Joue = personne qui a déjà mangé eboga (on garde longtemps l’eboga dans les joues avant<br />
de pouvoir l’avaler)<br />
- Nez = personne qui sent mauvais suite à un mauvais sort et à qui il faut administrer un bain<br />
purificateur<br />
- Oreille = personne qui entend des voix<br />
- Oreille = quelqu’un est en train de critiquer la personne<br />
- Pavillon de l’oreille = personne qui n’écoute pas les conseils<br />
- Lobe de l’oreille = personne malentendante<br />
- Derrière de l’oreille = personne intelligente<br />
- Yeux = personne qui a les yeux ouverts (clairvoyante)<br />
- Yeux = mort imminente d’un parent (larmes)<br />
- Entre les deux yeux = bonne étoile (la chance est supposément logée entre les yeux)<br />
- Front = un sorcier travaille mystiquement avec l’esprit de la personne (l’esprit se loge<br />
supposément au niveau du front)<br />
- Sommet du crâne = avertissement d’un danger<br />
- Fontanelle = tête ouverte (l’esprit sort par la fontanelle)<br />
Le motoba permet en définitive d’inscrire durablement dans le corps de l’initié une<br />
modification qui n’était que ponctuelle avec la veillée initiatique. Grâce à lui, le nganga peut<br />
avoir des pensées inspirées ou des images mentales analogues aux visions initiatiques, tout en<br />
se passant de l’ingestion répétée de fortes doses d’eboga 111 . Le dispositif du motoba permet en<br />
effet de pérenniser la structure ambivalente de la parole initiatique, avec sa voix flottante<br />
cachée derrière le locuteur de chair et d’os : pour rapporter à autrui les messages transmis par<br />
son motoba, l’initié use de la tournure “le Bwete (ou motoba) me dit que…”, reproduisant de<br />
111 Le motoba, spécificité du Bwete Misɔkɔ, permet ainsi aux initiés de “voir” tous les jours, alors que les banzi<br />
du Bwete Disumba se contentent de voir la seule nuit de leur initiation (même s’ils voient plus “loin” en raison<br />
d’une prise d’eboga plus importante et du caractère plus religieux des visions).<br />
-75-
la sorte la modalisation spécifique des énoncés visionnaires. L’intentionnalité au fondement<br />
de l’énoncé est ainsi déplacée du locuteur vers le motoba, entité à la fois étrangère et proche.<br />
L’intentionnalité propre de l’initié n’est pas pour autant complètement annulée au profit du<br />
génie, elle est plutôt creusée de l’intérieur et mise en suspens, au sens où les véritables lieu et<br />
auteur des productions psychiques et verbales de l’initié sont suspendus dans l’ambivalence.<br />
3. Les maganga : entre fétiches et médicaments<br />
Des rites de passage à l’étape du motoba, le banzi est mis en relation avec une série<br />
d’entités étranges : silure motoba, gésier d’edika, paquet enterré mbando, corbeille du Bwete<br />
ou paquet fétiche tsombi. Ces entités appartiennent toutes à la catégorie des maganga, terme<br />
que les initiés traduisent spontanément “médicaments” ou “fétiches” 112 . Ces maganga sont les<br />
opérateurs essentiels de la fabrication du sujet initiatique, car ils servent de médiations<br />
constitutives de la personne et de l’intentionnalité du banzi. On peut distinguer deux<br />
mouvements croisés dans ces médiations par lesquelles le sujet initiatique est composé,<br />
décomposé et recomposé : l’incorporation au soi et la projection du soi.<br />
Le premier mouvement correspond aux maganga-médicaments incorporés.<br />
L’ingestion des esprits auxiliaires que sont edika et motoba est ainsi une dimension essentielle<br />
de la transformation initiatique – l’expression “manger le Bwete” désignant d’ailleurs<br />
métonymiquement l’initiation. L’initié est ce qu’il mange, puisque les maganga sont les<br />
ingrédients actifs de sa personne 113 . Le second mouvement correspond aux maganga-fétiches<br />
dans lesquels l’initié se projette : tsombi, mbando et corbeille rituelle sont des doubles de<br />
l’initié, incarnés dans des objets à qui l’on attribue une forme d’intentionnalité. Le terme<br />
“fétiche” ne désigne donc pas un objet de culte doté de pouvoirs surnaturels, mais plus<br />
simplement un artefact rituel servant de médiateurs de la personne initiée. Les fétiches<br />
acquièrent ainsi le statut de quasi-sujets, sujets prothétiques à travers lesquels les initiés<br />
distribuent leur intentionnalité pour mieux la manifester 114 .<br />
Le Bwete Misɔkɔ fabrique ainsi des initiés à travers un double processus de diffraction<br />
de la personne dans des objets rituels et d’adjonction d’instances à l’intériorité. L’ensemble<br />
des rapports entre l’initié et ces maganga constitue un espace transitionnel où, par un jeu<br />
112 Termes mis en équivalence puisque la corbeille qui contient les fétiches du Bwete représente le ventre du<br />
nganga : les fétiches sont donc à la corbeille ce que les médicaments sont au ventre de l’initié.<br />
113 D’où la méfiance constante d’un empoisonnement sorcier par “médicament” trafiqué.<br />
114 Sur les fétiches comme artefacts médiateurs, cf. Latour 1996, Gell 1998.<br />
-76-
dialectique d’introjections et de projections, se construit un sujet complexe 115 . La fabrication<br />
du sujet initiatique s’opère en effet dans un espace de relations entre entités dont le lieu est<br />
indécidable car il se situe à la fois à l’intérieur du corps de l’initié et dans le monde extérieur.<br />
Les frontières de la personne ne s’arrêtent désormais plus à la surface du corps propre,<br />
puisque le corps de l’initié est “caché en brousse” dans le fétiche enterré mbando et est<br />
simultanément présent au geliba sous forme d’une corbeille rituelle. De son côté, le corps<br />
propre du banzi ne s’en sort pas indemne, puisqu’il est lui-même travaillé de l’intérieur par<br />
des entités incorporées. Et le cas emblématique du motoba illustre que cette complication de<br />
soi peut littéralement être ressentie par l’initié : ce qui traverse son esprit, ce qui chatouille<br />
son épiderme provient désormais d’un autre que lui-même à l’intérieur de lui-même. Le<br />
rapport intime à soi perd alors son évidence.<br />
La construction de la figure singulière du nganga passe ainsi par la mise en relation<br />
sérielle avec des maganga. Et derrière la logique substantielle des médicaments et des fétiches<br />
se cache en réalité une logique toute relationnelle : le processus initiatique utilise des<br />
substances pour faire des relations. L’exemple paradigmatique est l’incorporation<br />
systématique dans les fétiches de la relation de subordination de l’initié à son père initiateur<br />
sous la forme de rognures d’ongles et de cheveux de l’initiateur qui s’ajoutent à ceux du<br />
banzi. Dans le Bwete Misɔkɔ, devenir sujet, c’est ainsi être assujetti aux maganga et au père<br />
initiateur qui les a “travaillés”. Le travail concret de manipulation, accumulation et agrégation<br />
des substances est donc un travail sur les relations. Les maganga sont des entités hybrides où<br />
se mêlent inextricablement les figures du père initiateur, des génies, des ancêtres, des esprits<br />
sylvestres et animaux, figures auxquelles le banzi est désormais lié. Doubles du banzi dont ils<br />
incorporent les exuviae, ils font en définitive de l’initié un être hybride qui se définit moins<br />
par une identité substantielle que par l’ensemble des relations accumulées dans ses fétiches.<br />
Les maganga sont ainsi les index réifiés des relations constitutives du sujet initiatique.<br />
115 Pour D. Winnicott, l’espace transitionnel forme une aire intermédiaire entre la réalité psychique interne et<br />
l’environnement extérieur, un espace ni au-dedans ni au-dehors du sujet, lieu indécidable du jeu des projections<br />
et des introjections qui relient par exemple le pouce du nourrisson, son ours en peluche et le sein maternel<br />
(Winnicott 1975).<br />
-77-
DEUXIEME PARTIE<br />
NGANGA<br />
-78-
Chapitre V<br />
Le nganga devin-guérisseur<br />
Une fois qu’il a mangé edika, reçu son tsombi et sa corbeille de Bwete, et avalé<br />
motoba, le novice cesse d’être un banzi pour devenir un nganga-a-Misɔkɔ, un initié à part<br />
entière. En dehors des étapes rituelles qu’il reste encore à franchir, la carrière d’un nganga<br />
s’oriente alors autour de deux axes génériques, objets de cette seconde partie : soigner les<br />
malades, acquérir le savoir initiatique. C’est en effet au tour du jeune nganga, ancien malade,<br />
de prendre en charge de nouveaux malades 116 . Certes, le cadet n’est d’abord qu’un assistant au<br />
service du père nganga, devin-guérisseur accompli à qui seul profitent les revenus tirés des<br />
soins, de l’initiation et de la consultation 117 .<br />
1. La séance divinatoire<br />
La consultation des nganga-a-Misɔkɔ exigeait traditionnellement une veillée<br />
complète 118 . Une nuit de danses effrénées était en effet nécessaire aux devins pour réactiver<br />
leurs pouvoirs et se mettre en relation avec les esprits mikuku qui inspirent leurs révélations.<br />
Si aujourd’hui encore chaque veillée de Bwete Misɔkɔ comporte une séance divinatoire, les<br />
nganga consultent pourtant également en plein jour, sans veillée ni danse, mais selon les<br />
mêmes procédés formels.<br />
Le patient commence par tendre au devin une bougie allumée, une aiguille et une<br />
bouteille de boisson (qui représentent respectivement la clairvoyance, la parole divinatoire et<br />
la richesse) puis s’acquitte de sa contribution financière (de quelques centaines à quelques<br />
milliers de francs CFA selon les exigences du nganga et les moyens du malade). Il doit<br />
ensuite dire à haute voix son nom puis ceux de ses deux parents. Ces trois noms constituent la<br />
carte d’identité lignagère du patient : un individu singulier rattaché par le biais de ses deux<br />
parents à deux lignages distincts. Cette triple nomination est un élément décisif d’une<br />
consultation qui est en grande partie une évaluation de la situation du malade par à rapport à<br />
ses matri- et patri-lignages 119 .<br />
116 Les nganga de la branche Myɔbε sont plus spécialisés dans les soins, ceux du Ngɔndε dans la divination – la<br />
distinction correspondant à une inflexion d’un côté ou de l’autre de la double fonction de devin-guérisseur.<br />
117 La société initiatique reconduit ainsi l’appropriation de la force productive des cadets par les aînés du lignage.<br />
118 La divination se dit sɔkeɔ, du verbe sɔkɔgo (découvrir). Le terme Misɔkɔ en dérive directement.<br />
119 Malgré la filiation unilinéaire, le poids des deux lignages est donc reconnu. La symétrie entre patri- et matrilignage<br />
étant projetée sur la symétrie corporelle, penser que seul un lignage suffirait à définir ego reviendrait<br />
d’ailleurs à l’amputer d’une moitié de lui-même.<br />
-79-
Le patient tenant la bougie allumée devant son visage se présente ensuite de face puis<br />
de dos, afin que le devin puisse sonder son passé comme son futur (la divination étant à la fois<br />
rétrospective et prémonitoire). A la lumière de sa torche, le nganga scrute alternativement le<br />
patient et son petit miroir, instrument essentiel de la divination dans lequel il est censé voir la<br />
vie du malade et le diagnostic de son mal 120 . Ce dispositif visionnaire reproduit celui de<br />
l’initiation, même si le nganga, guidé par son esprit auxiliaire motoba, n’a pas eu besoin de<br />
prendre plus d’une petite pincée d’eboga.<br />
Nganga consultant son miroir…<br />
Au fur et à mesure de ses visions, le nganga trace sur le corps du malade des marques<br />
au kaolin blanc, traits ou gros points. Ces signes divinatoires s’interprètent selon le code<br />
corporel du motoba : à chaque partie du corps du malade correspond analogiquement un<br />
trouble, une prémonition ou un traitement. En réalité, la plupart des consultations tournent<br />
habituellement autour de quelques signes récurrents : au pied pour un fusil nocturne, à la taille<br />
pour un serpent invisible mbumba, au sternum pour un empoisonnement, au cœur pour des<br />
palpitations, à la paume pour des problèmes financiers, au dos pour un mauvais esprit, à la<br />
tête pour la tête ouverte. Les signes fournissent ainsi une grille de lecture du malheur très<br />
simple, simplicité qui renvoie à la monotonie des troubles et des diagnostics établis par le<br />
nganga.<br />
Ces marques divinatoires constituent un intermédiaire visible entre les images<br />
mentales et la parole du nganga. Elles sont les supports sensibles des énoncés de la<br />
consultation orale. Grâce à elles, la parole divinatoire ne repose pas uniquement sur des<br />
images mentales privées, mais peut s’appuyer également sur des signes publics, visibles tant<br />
120 Selon une devinette initiatique, le premier miroir divinatoire fut une flaque d’eau dans laquelle se reflète la<br />
lune Ngɔndε (ce qui explique que la branche initiatique éponyme soit spécialisée dans la divination). Et la<br />
surface réfléchissante de l’eau a réellement servi de support divinatoire avant que les miroirs de traite ne<br />
circulent, comme du Chaillu a pu le noter au milieu du XIX e siècle parmi les gisira de l’hinterland (cité in Merlet<br />
1991 : 294).<br />
-80-
par le patient et l’assistance que par le nganga. Dans le cas d’une consultation à plusieurs, les<br />
marques au kaolin servent d’ailleurs à “donner la route” aux autres devins. Pourtant,<br />
lorsqu’un nganga est seul à consulter, il trace encore des signes sur le corps de son patient. Ce<br />
qui prouve que les marques divinatoires ont en réalité pour destinataire principal le malade<br />
lui-même, quand bien même ce dernier n’en connaît pas la signification précise.<br />
Les marques constituent une ruse graphique qui vise à faire entrer le malade et son<br />
corps dans le jeu de la consultation, ce qui a pour effet de renforcer la pertinence et<br />
l’efficacité du discours divinatoire. La parole du devin est en effet supposée décrire<br />
adéquatement l’état du malade. Mais l’état du malade n’est pas un ensemble de symptômes<br />
somatiques manifestes : il s’agit plutôt d’un agrégat de troubles variés, organiques ou non,<br />
mais aussi d’histoires de famille et de fantômes, d’événements passés et futurs. Les signes au<br />
kaolin servent alors à rassembler et manifester cette affliction protéiforme à même le corps du<br />
patient, lui donnant ainsi une cohérence charnelle 121 . Ils sont les symptômes visibles d’une<br />
maladie, indices sur lesquels fait fond la parole du nganga. Le malheur devient lisible à la<br />
surface du corps du malade.<br />
…puis traçant une marque au kaolin<br />
Sans marques, il n’existerait en définitive aucun lien évident entre le discours du devin<br />
et l’état du patient : le patient resterait extérieur à la consultation. Grâce à elles, la<br />
consultation devient une relation tangible entre deux protagonistes, relation qui se focalise<br />
autour du corps du patient. L’artifice graphique sert ainsi à piéger le malade et son corps dans<br />
les rets de la relation divinatoire. Cette métaphore est explicite dans le discours des initiés<br />
eux-mêmes : la consultation est un piège de chasse (getambo), lacet tendu par le nganga pour<br />
attraper ce gibier qu’est le malade. Il existe en effet un fort lien entre chasse et divination 122 .<br />
Le devin est d’ailleurs également rapproché du chien de chasse qui flaire une piste et hume un<br />
121<br />
C’est pour cela que la purification représente le soin par excellence : si le malheur est rassemblé à la surface<br />
du corps, alors laver le corps, c’est bien lever l’infortune.<br />
122<br />
Les grandes chasses collectives, aujourd’hui en voie de disparition, ne pouvaient avoir lieu sans une<br />
consultation divinatoire préalable.<br />
-81-
gibier ; et il saisit parfois effectivement la main d’un patient pour en renifler la paume afin de<br />
déceler ses problèmes 123 .<br />
Nganga humant une patiente<br />
Un bon nganga-a-Misɔkɔ, c’est donc celui qui sait piéger le patient dans la<br />
consultation, l’attraper au piège du Bwete. Le patient peut bien sûr toujours douter de la<br />
parole du devin. Mais l’artifice graphique contribue en quelque sorte à détourner l’attention et<br />
renforce ainsi la force illocutoire attachée à la parole divinatoire 124 . L’anthropologie oppose<br />
classiquement deux modèles divinatoires : la divination inductive (ou mécanique) et la<br />
divination intuitive. La première ne repose que sur le pur hasard objectif. Dans le Bwete, c’est<br />
le test divinatoire du losange d’écorces ou des coquilles de nzingo. Mais cette méthode<br />
divinatoire est si mécanique et aléatoire qu’elle ne peut que difficilement coller à<br />
l’expérience. Comme le notent A. Adler et A. Zempléni, “plus librement, [les systèmes<br />
divinatoires] laissent jouer les lois du simple hasard, moins facilement ils encourent le<br />
reproche de la non-objectivité. Mais, plus les réponses sont aléatoires, moins elles sont<br />
conciliables avec les données de l’expérience” (1972 : 141). D’où la fréquente manipulation<br />
humaine de la divination mécanique : ainsi, la répétition du test de l’écorce jusqu’à<br />
l’obtention d’un augure favorable. D’où également dans le Bwete, la valeur plus prémonitoire<br />
que diagnostique de ce type de tests divinatoires : ils ne décrivent pas adéquatement une<br />
expérience réelle, ils anticipent plutôt un événement à venir.<br />
123 R. Devisch note chez les devins yaka (Zaïre) la même pratique du flair, toujours associée au pouvoir<br />
divinatoire présumé du chien (Devisch 1991 : 117-118). Il arrive également que le nganga-a-Misɔkɔ “goûte” le<br />
patient en plaçant son auriculaire dans sa bouche. En sus du registre classique de la vision, la divination implique<br />
ainsi les sens de l’odorat et du goût.<br />
124 Selon les définitions canoniques d’Austin (1970), l’acte locutoire est l’acte de dire quelque chose, l’acte<br />
illocutoire l’acte effectué en disant quelque chose, et l’acte perlocutoire l’acte effectué par le fait de dire quelque<br />
chose.<br />
-82-
De son côté, la divination intuitive repose purement sur l’inspiration et l’interprétation<br />
humaines. La consultation du nganga-a-Misɔkɔ en est un exemple typique : nulle intervention<br />
du hasard, puisque tout dépend du devin et de sa performance verbale. Cette seconde<br />
méthode, à l’inverse de la première, est donc trop humaine et trop subjective pour n’être pas<br />
sujette à caution. D’où la nécessité d’une mise en scène qui dramatise la divination pour le<br />
patient. C’est là tout l’objet des médiations tangibles de la consultation du nganga : le miroir<br />
divinatoire, les fétiches, et surtout les marques corporelles au kaolin qui donnent un crédit<br />
visible à la parole du devin. Elles font penser que la divination n’est pas une procédure<br />
exclusivement intuitive puisqu’elle s’appuie également sur l’interprétation de signes objectifs,<br />
sans pourtant s’annuler dans le pur hasard.<br />
2. L’énonciation divinatoire<br />
Après l’apposition des marques au kaolin, le nganga peut alors commencer la<br />
consultation orale (mabenga). Ces révélations sont au premier chef des énoncés factuels sur la<br />
vie du malade et les maux qui l’affligent. Le nganga révèle au malade le vécu intime de son<br />
affliction : “ton cœur bat la chamade”, “tu as mal au ventre”, “tu vois des mauvaises choses<br />
en rêve” 125 . Ou bien des événements passés liés à l’infortune présente : “il y a eu une dispute à<br />
propos d’un véhicule avec un ami”, “tu as perdu un frère récemment”. Le nganga fait enfin<br />
des prédictions d’événements heureux ou malheureux : “tu auras des jumelles” ou “tu risques<br />
de te faire empoisonner”. Dans une situation où tous les registres du malheur se mêlent, le<br />
nganga ne cherche nullement à les isoler pour les traiter séparément. Il s’attache au contraire<br />
à les lier tous ensemble, suggérant entre eux des connexions non fortuites pour dessiner la<br />
figure d’une infortune générale. Comme A. Zempléni l’a ailleurs relevé, des malheurs<br />
disparates sont enchaînés dans une même chaîne de causalité (Zempléni 1985).<br />
Tout au long de cette performance orale, le patient doit s’en tenir à répondre par la<br />
formule rituelle de l’acquiescement “base !” si les affirmations du devin lui semblent justes,<br />
ou à démentir dans le cas contraire. Et celui qui veut trop en dire se fait aussitôt réprimander<br />
par les nganga. Tout irait pourtant plus vite si le malade exposait lui-même son problème et<br />
ses symptômes. Mais, cela bouleverserait la relation entre nganga et patient : le nganga est<br />
devin-guérisseur et non simple guérisseur. Il importe donc que le patient se contente<br />
d’approuver ou non la version de son malheur livrée par le devin. Il s’agit d’une affaire de<br />
pertinence émotionnelle et relationnelle. La valeur de vérité des énoncés divinatoires n’est en<br />
125 Très souvent, le patient décide en effet d’aller voir un devin suite à un rêve prémonitoire troublant.<br />
-83-
effet pas une propriété sémantique : elle réside moins dans leur strict rapport d’adéquation au<br />
réel que dans un contexte relationnel singulier. Le patient se sent enfermé dans un état de<br />
perplexité impuissante, incapable d’articuler de manière cohérente son propre malheur. La<br />
séance divinatoire instaure alors un cadre relationnel singulier : le malade écoute en silence ce<br />
qu’il ne pouvait pas formuler à propos de lui-même et que le devin exprime à sa place. Son<br />
expérience du malheur, son existence sensible se trouvent soudain objectivées, saisies dans le<br />
discours d’un tiers. L’effet produit est sans aucun doute violent, et il n’est d’ailleurs pas rare<br />
qu’un patient éclate en sanglots au cours de la consultation, bouleversé d’avoir été percé à<br />
jour.<br />
Mais comment le nganga arrive-t-il à décrire si pertinemment les symptômes intimes<br />
d’un patient qu’il parvient à le faire pleurer ? Comme me l’a avoué un père initiateur, les<br />
devins mettent habituellement en œuvre un certain nombre de petites ruses discursives visant<br />
à “attraper” le malade dans la consultation. D’une part, le nganga peut parfois inférer l’état du<br />
malade d’après des indices manifestes : “pour les fusils nocturnes, c’est facile. La personne a<br />
mal au pied, elle arrive en boitant”. D’autre part, le devin commence souvent par proférer des<br />
évidences : “tu dis, – L’argent que tu gagnes, il ne reste pas avec toi. Il ne va pas dire le<br />
contraire [éclats de rire]. Il va forcément dire Base !”. Les énoncés divinatoires sont ainsi un<br />
subtil compromis entre des affirmations si générales qu’elles ne peuvent qu’être vraies (parce<br />
qu’elles ne font que répéter la prémisse obligée de tout recours à un nganga : le patient a un<br />
problème) et des affirmations beaucoup plus précises que le devin teste une à une.<br />
Le devin procède en effet par balayage des possibles à partir des multiples signes au<br />
kaolin qu’il a tracés sur le corps du patient : il passe ainsi en revue les symptômes les plus<br />
courants des principaux maux sorcellaires, escomptant que le patient finira bien par se<br />
reconnaître dans l’un d’entre eux 126 . De la sorte, le nganga peut explorer des pistes variées en<br />
les abandonnant ou les approfondissant selon les réactions du patient qu’il scrute avec<br />
attention : “si tu vois que ça ne marche pas, si la personne ne répond pas Base !, tu changes<br />
de route”. Ses révélations péremptoires sont ainsi des questions déguisées. D’ailleurs, si le<br />
patient nie l’un de ses énoncés, le nganga peut encore le rectifier en lui assignant une valeur<br />
prédictive : “Tu dis, – Tu as raté la mort par un accident. Il va dire oui. S’il dit non, tu vas<br />
dire, – Pas encore. Parce que le Bwete dit le futur et pas seulement le passé et le présent”. Par<br />
un subtil jeu de déplacements, le nganga parvient finalement à se focaliser sur un petit<br />
nombre de symptômes et de problèmes sensibles pour le patient.<br />
126 Il présume ensuite une liaison entre des symptômes qui se présentent habituellement en constellations<br />
régulières : la peur va avec les cauchemars et le sentiment d’être poursuivi (c’est un mauvais esprit) ;<br />
l’étouffement va avec la fatigue et les palpitations (c’est le mbumba).<br />
-84-
Ayant ainsi évoqué le vécu personnel du malade, le devin peut alors avancer le<br />
diagnostic qui y colle au mieux (“tu ne vas pas lui dire directement [qu’il a] un mauvais<br />
esprit, sinon il aura les doutes”). Cette subsomption d’une affliction multiforme sous un label<br />
simple donne une certaine unité à une expérience qui en était jusque-là dépourvue : “tu as le<br />
sperme d’un homme mort dans ton ventre. C’est cet homme qui te persécute en rêve [mauvais<br />
esprit qui est le fantôme d’un parent décédé]” ; “un ver te bloque au niveau du foie [atteinte<br />
par un serpent invisible mbumba]. C’est un blocage de ta machine économique”. Ces maux<br />
diagnostiqués sont évidemment ceux qui relèvent du domaine de compétence thérapeutique<br />
des nganga : mauvais esprit, fusil nocturne, serpent invisible mbumba, tête ouverte ou<br />
empoisonnement. De cette façon, l’infortune personnelle du patient est arrimée aux catégories<br />
nosologiques communes du Bwete Misɔkɔ. Une étiologie, invariablement sorcellaire, est<br />
associée à ce diagnostic. Parmi les énoncés factuels concernant la vie du patient, le devin a<br />
soin d’évoquer les conflits familiaux : “il y a une mésentente entre les côtés paternel et<br />
maternel”, “il y a un problème avec les femmes et tes enfants”. Cela avive des suspicions qui<br />
ne sont de toute façon jamais très loin, tout malheur ne pouvant être que la conséquence de la<br />
persécution injuste d’un parent jaloux.<br />
Selon la classification populaire, il n’y a en effet que deux types de maladie : les<br />
maladies naturelles ou maladies de Dieu (litt. ebεa a Nzambe en getsɔgɔ, bwali ba Nyambi en<br />
yipunu) et les maladies des sorciers (litt. ebεa a mogodo en getsɔgɔ, bwali ba balɔsi en<br />
yipunu) souvent appelées maladies “mystiques” (bwali ba dikolu – maladie de l’occulte – en<br />
yipunu). Cette distinction est moins symptomatique qu’étiologique. Une affliction est<br />
sorcellaire lorsqu’elle est supposément causée par l’intentionnalité mauvaise d’un tiers<br />
(humain vivant, ascendant défunt, esprit – sachant qu’esprits et fantômes sont souvent au<br />
service d’un sorcier qui les manipule). Une maladie est naturelle lorsqu’on postule une<br />
absence d’intentionnalité 127 . Les maladies naturelles ne relèvent pas d’une catégorie<br />
spécifique de thérapeutes. La médecine occidentale est estimée très efficace à leur égard, les<br />
malades n’hésitant pas à y recourir s’ils le peuvent. La “médecine des Blancs” est en revanche<br />
réputée totalement impuissante contre les maladies sorcellaires. Celles-ci relèvent en effet<br />
exclusivement de la “médecine des Noirs”, celle des nganga dont c’est le fonds de commerce<br />
principal, ce qui leur fait dire que la plupart des maladies sont en réalité sorcellaires. Cette<br />
opposition entre “maladies des Noirs” et “maladies des Blancs” ne recouvre pas la dichotomie<br />
entre trouble organique et trouble psychologique (ou psychosomatique). Une “maladie<br />
127 De ce point de vue, Dieu n’est pas véritablement un agent intentionnel – d’où l’appellation “maladies de<br />
Dieu”. Ou plutôt, son intentionnalité n’est pas susceptible d’être mise en accusation (l’infortune sorcellaire étant<br />
une persécution injuste).<br />
-85-
mystique” englobe en effet des symptômes hétérogènes qui ne sont ni exclusivement<br />
organiques ni même exclusivement psychologiques. Le contraste recouvre en réalité moins<br />
une différence de symptômes qu’une alternative dans leur prise en charge sociale : une<br />
anémie traitée au dispensaire deviendra chez un nganga la preuve d’un vampirisme<br />
sorcellaire, et inversement. Le nganga fait ainsi de toute infortune une pathologie<br />
relationnelle, le plus souvent liée à des tensions lignagères.<br />
La nature sorcellaire du malheur est en réalité une prémisse implicite de la<br />
consultation, pour le nganga comme pour le patient. En effet, si ce dernier entend apprendre<br />
ce qu’il a, il veut surtout savoir qui lui inflige cela. Pourtant, face à cette demande, le nganga<br />
est généralement réticent et refuse d’accuser nommément quelqu’un. Tout au plus conforte-til<br />
une suspicion lorsque le patient est déjà convaincu de la culpabilité d’un parent. Mais il se<br />
contente le plus souvent de peser sans plus de précision la responsabilité collective des deux<br />
lignages du patient : “le problème est du côté maternel”, “les pères sont plus impliqués que<br />
les mères”, “tu es atteint des deux côtés” 128 . En effet, le nganga ne tient pas à semer la zizanie<br />
dans les familles, ce qui risquerait fort de lui valoir des problèmes en retour. Aussi s’efforce-til<br />
de ne pas “casser l’œuf” ou de ne pas “défaire le paquet” selon les métaphores en usage,<br />
préférant concentrer son art sur les soins proprement dits. Mais le devin ne cherche pas pour<br />
autant à décourager les suspicions de son patient. Sa consultation attribue à l’inverse une<br />
étiologie sorcellaire à la moindre infortune. Le nganga n’œuvre donc pas du tout en artisan de<br />
la paix des familles. Son intervention n’obéit nullement au modèle classique de la restauration<br />
de l’harmonie lignagère suite à la rupture d’un ordre à la fois corporel et social. Elle reconduit<br />
et durcit au contraire les tensions au sein du lignage. Même s’ils évitent les accusations<br />
nominales, les nganga-a-Misɔkɔ jouent en définitive moins le rôle de conciliateurs que<br />
d’agitateurs, leurs nombreux détracteurs ne manquant pas d’insister sur ce point.<br />
3. Maux et soins<br />
Vue de près, la consultation du nganga-a-Misɔkɔ apparaît finalement comme une<br />
performance rusée et bien calibrée, avec ses inévitables subterfuges et ses fulgurances<br />
troublantes. Cette consultation offre au patient une version congrue de son expérience du<br />
malheur : l’entrelacement des divers énoncés divinatoires tisse un discours sur le vécu intime<br />
128 Responsabilité pondérée qui est toujours marquée par des signes au kaolin : un trait le long du bras droit<br />
désigne le patrilignage, le long du bras gauche le matrilignage. Si ce trait est coupé perpendiculairement au<br />
niveau du poignet, cela signifie que le lignage concerné est impliqué ; s’il n’est pas coupé, qu’il est innocent.<br />
-86-
du malade, traduit dans une nosologie simple, et pris dans la trame dramatique d’une étiologie<br />
sorcellaire. Il ne reste alors plus au nganga qu’à proposer une série de traitements 129 .<br />
Pour des soins prolongés, le malade reste souvent à résidence chez le nganga, parfois<br />
accompagné par son conjoint et ses jeunes enfants. Il ne repartira qu’une fois guéri, après une<br />
veillée de Bwete organisée à son domicile, rituel de réintégration du malade à sa famille. La<br />
relation thérapeutique constitue en effet une forme d’adoption temporaire : un enfant malade<br />
(on reste toujours l’enfant de son lignage) est confié par sa famille à un nganga. Le père<br />
nganga, sa parentèle et la communauté locale des initiés représentent ainsi une famille de<br />
substitution pour le malade. Les malades partent d’ailleurs parfois se faire soigner dans un<br />
village éloigné (par exemple auprès d’une ethnie réputée pour les soins). Cette séparation du<br />
lignage et l’intégration temporaire dans une communauté de substitution a sans doute un rôle<br />
proprement thérapeutique – d’autant que le sorcier responsable de l’affliction fait<br />
habituellement partie du lignage d’origine. La relation thérapeutique s’organise ainsi, comme<br />
la relation initiatique, autour d’une pseudo-parenté qui place le père nganga en position de<br />
chef de famille (d’où le fait que pour initier et soigner, il faille être déjà mari, père et<br />
propriétaire d’une maison et d’un corps de garde). Dans la relation thérapeutique, l’usage de<br />
l’idiome de la parenté est cependant plus lâche et moins réglé que dans la relation initiatique<br />
qui définit un véritable groupe de filiation où chacun occupe une place précise. Pour des soins<br />
et plus encore pour l’initiation, le traitement de l’infortune repose ainsi sur une coupure<br />
relative par rapport au lignage d’origine, coupure qui permet de modifier à son avantage la<br />
relation du malade à sa parentèle.<br />
Les traitements des nganga sont fort variés : bain, fumigation, onction, collyre,<br />
vomitif, purge nasale (“vidange du mauvais cerveau”), boisson, transfert du mauvais sang (sur<br />
un arbre ou sur une poule), “vaccin” (incisions aux chevilles, genoux, mains ou tempes que<br />
l’on frotte d’une mixture protectrice), fétiche protecteur (enterré, portatif ou domestique),<br />
barrage symbolique du domicile (tesa, spécialité de la branche Myɔbε), “retour à l’envoyeur”,<br />
piège à sorcier (kɔsi, spécialité des bapunu), etc. Les procédés peuvent varier d’un initié à<br />
l’autre, puisqu’ils proviennent autant de l’innovation onirique que de la transmission<br />
initiatique. Néanmoins les traitements majeurs, qui correspondent aux afflictions sorcellaires<br />
les plus communes, mobilisent des schémas opératoires fort stables.<br />
•La corde<br />
129 Lorsque le malade paraît gravement atteint, le nganga effectue un test divinatoire avant d’accepter<br />
d’entreprendre le moindre traitement. Par exemple, un coq doit venir manger une mixture mâchée et recrachée<br />
par le malade. Si le coq refuse de manger, le malade est renvoyé chez lui.<br />
-87-
Fatigue, perte d’appétit, maux de reins, sensation d’étouffement, palpitations, tension,<br />
grossesses difficiles ou faiblesse sexuelle, sont les symptômes manifestes du nongu (chez les<br />
mitsɔgɔ) ou mbumba (chez les mεryε), serpent invisible associé à l’arc-en-ciel qui étouffe et<br />
avale progressivement sa victime tout en lui suçant le sang jusqu’à la mort 130 . Ce serpent<br />
constricteur, souvent désigné par le terme figuré de “corde”, est l’allié invisible d’un sorcier<br />
qui s’empare par son intermédiaire de la force vitale de sa victime (force vitale qui concerne<br />
avant tout la sexualité et la fécondité). Cette thématique sorcellaire du ligotage et de<br />
l’étouffement constitue une métaphore pertinente pour ces nombreux patients qui se sentent<br />
perpétuellement entravés et enfermés dans une vie malheureuse.<br />
Soigner un malade pris par le mbumba exige une veillée rituelle au cours de laquelle<br />
les nganga effectuent la “coupure de corde”. Avant cette veillée, les initiés ont fabriqué en<br />
secret le mbumba. Le corps du serpent se présente sous forme d’une corde de liane d’une<br />
dizaine de mètres à l’extrémité de laquelle se trouve une tête, petit paquet de pagne noir<br />
(renfermant entre autres poudre à fusil, écailles de tonnerre, écaille et dent de python)<br />
maquillé de kaolin rouge et surmonté d’une plume de perroquet. Il s’agit là d’un second<br />
mbumba, du sexe opposé à celui qui tourmente le malade. Au cours de la veillée, le malade<br />
est fermement ligoté des épaules à la taille avec cette liane au son des chansons “dwarisa na<br />
mikatu mikatunga” (“nous nous renforçons par des liens serrés”) et “mbɔmɔ a ma vuta” (“le<br />
python s’est déroulé”). Cela revient à marier ensemble les deux serpents. Ils ne restent alors<br />
plus aux nganga qu’à couper vivement la corde en tronçons à l’aide d’une machette, libérant<br />
ainsi le malade de l’emprise maléfique du mbumba 131 . Mbumba visible et invisible étant<br />
étroitement enlacés, couper l’un permet en effet de se débarrasser de l’autre.<br />
130 Mbumba est un terme polysémique qui désigne à la fois un mal sorcellaire (serpent invisible), une société<br />
féminine de possession (mbumba-iyano) et des reliques d’ancêtres (mbumba-a-bwete). Notons enfin que dans<br />
l’aire Kongo plus au sud, le mbumba, toujours associé au python arc-en-ciel, n’est pas un mal sorcellaire mais<br />
une entité bénéfique.<br />
131 S’ajoute le sacrifice d’un coq, voire d’un cabri pour les cas les plus graves.<br />
-88-
Malade ligotée par le mbumba<br />
Le serpent conjoint constitue donc une sorte de leurre ou d’appât qui détourne le<br />
mbumba maléfique de sa victime pour l’attirer dans le traquenard des nganga qui le guettent,<br />
machette en main. Une coupure de corde revient finalement à construire un piège pour<br />
entraîner dans le visible une entité invisible. Et l’artifice est ingénieux. Faire comme si la<br />
corde était directement l’incarnation visible du mbumba maléfique serait en effet une<br />
supercherie grossière : tout le monde sait que cette corde a été fabriquée par les nganga, qui<br />
ne peuvent donc prétendre combattre ce qu’ils viennent eux-mêmes de confectionner. En<br />
revanche, puisque la corde de liane ne représente pas le serpent malfaisant mais plutôt son<br />
conjoint séducteur, elle ne sert, plus subtilement, que d’adjuvant visible, opérant littéralement<br />
comme un charme à l’égard du véritable destinataire invisible. En même temps, le glissement<br />
de l’un à l’autre est aisé : la corde qui ligote le malade ressemble trop au mbumba qui<br />
l’enserre pour ne pas l’être un peu. L’artefact matériel a ainsi l’avantage de rendre visible un<br />
-89-
agresseur invisible, sans toutefois n’être qu’un vulgaire tour de passe-passe ou une simple<br />
substitution symbolique.<br />
•Le fusil nocturne<br />
Le fusil nocturne (bota-a-pitsi, littéralement “fusil de la nuit”) est un mal physique<br />
bien localisé : il se manifeste par une intense douleur qui commence dans le pied, remonte<br />
dans la jambe et peut aller jusqu’à la nécrose et la paralysie. Cette affliction est la<br />
conséquence d’un coup de fusil invisible tiré par un sorcier, ou bien d’un piège de chasse<br />
invisible que la victime a déclenché à son insu. Les nganga disent d’ailleurs souvent trouver<br />
dans les plaies cheveux, ongles ou tessons, preuves du caractère sorcellaire du mal.<br />
Le traitement, communément appelé “déclenchement du fusil nocturne”, consiste à<br />
fabriquer un autre fusil nocturne et à le déclencher contre la jambe atteinte afin d’annuler le<br />
mal. Le pied incisé du malade est placé au-dessus d’un petit brasier à fumigation creusé à<br />
même le sol. Au fond du trou, a été ajouté un petit paquet contenant entre autres poudre à<br />
fusil, quartz, résine inflammable et graines de nzingo. Au bout de quelques instants, le paquet<br />
s’enflamme brusquement comme un petit feu de Bengale sous la jambe du malade (qui est<br />
ensuite aspergée et baignée). Ce paquet est un fusil nocturne antagoniste du fusil nocturne du<br />
sorcier (les graines de nzingo représentant les plombs de la salve que fait exploser la poudre à<br />
fusil). En déflagrant, il l’anéantit, ce qui doit permettre la guérison du membre atteint. Mais ce<br />
fusil nocturne vise également le sorcier en retour, telle une contre-attaque qui renvoie le mal à<br />
son expéditeur. Le déclenchement opère donc sur un double mode : d’un côté, il soigne la<br />
victime ; de l’autre, il châtie le coupable. L’opération sert en définitive à matérialiser un fusil<br />
nocturne autrement invisible. En même temps, ce fusil n’est pas exactement celui responsable<br />
de l’atteinte. C’est un artefact rituel à la fois similaire à et antagoniste de la cause supposée du<br />
mal.<br />
•Le mauvais esprit<br />
Une personne affligée par un mauvais esprit manifeste les symptômes suivants : elle<br />
entend des voix qui l’appellent derrière elle mais n’aperçoit personne lorsqu’elle se retourne ;<br />
elle a l’impression d’être sans cesse suivie par quelqu’un ; elle est en proie à des accès<br />
inexpliqués de peur, fait des cauchemars et a des hallucinations diurnes terrifiantes. Ces<br />
troubles sont le signe manifeste du harcèlement par un mauvais esprit. Ce mauvais esprit est<br />
réputé être le fantôme d’un mort (etεngɔ chez les mεmbε, ditεngu chez les mεryε), inverse<br />
maléfique des ancêtres protecteurs dont s’occupent justement les sociétés initiatiques comme<br />
le Bwete. Dans un premier temps, ce fantôme ne fait que talonner sa victime sans la laisser en<br />
-90-
paix (d’où le signe divinatoire au talon d’Achille qui indique un mauvais esprit en poursuite).<br />
Puis, il réussit à agripper sa victime et se cramponne alors à son échine (d’où le signe<br />
divinatoire entre les deux omoplates indiquant un mauvais esprit “collé”). Le mauvais esprit a<br />
ainsi pour caractéristique principale d’être un agent persécuteur qui attaque toujours par-<br />
derrière (ce qui explique son invisibilité et l’angoisse d’être suivi).<br />
Ce fantôme est parfois un parent défunt qui tourmente sa victime simplement parce<br />
qu’il se sent négligé. Il convient alors de l’apaiser par une offrande propitiatoire placée sur sa<br />
tombe. Mais le plus souvent, ce fantôme est en réalité une sorte de zombi au service d’un<br />
parent sorcier 132 . Le fantôme exigera alors en contrepartie que le sorcier lui donne un conjoint<br />
post-mortem en sacrifiant un autre parent. Un fantôme tourmentera donc préférentiellement<br />
un parent de sexe opposé afin de s’unir à lui. De là vient le fait que les cauchemars attribués<br />
au mauvais esprit soient si souvent des rêves d’agression sexuelle incestueuse. On considère<br />
également parfois que le mauvais esprit n’est en fait que le double invisible du sorcier luimême<br />
qui cherche à avoir des relations sexuelles avec un parent pour ensuite s’approprier sa<br />
progéniture 133 . En définitive, le sorcier utilise des fantômes serviles pour sacrifier des parents,<br />
ou bien sacrifie des parents pour en faire des fantômes serviles. Et ces fantômes exigent à leur<br />
tour des victimes. Ce cercle vicieux du sacrifice sorcellaire est amené à retomber sur le sorcier<br />
lui-même, lorsqu’il n’aura plus personne à donner en pâture à ses fantômes – justice<br />
immanente qui, selon l’opinion commune, doit punir in fine le coupable en retournant sa<br />
propre arme contre lui.<br />
Pour guérir l’atteinte d’un mauvais esprit, le nganga cherche à séparer le fantôme de<br />
sa victime afin qu’il cesse de la harceler. Avec un vieil habit appartenant au malade, il<br />
confectionne une petite poupée sommairement anthropomorphe qu’il part attacher en forêt, à<br />
un arbre ou auprès d’un petit autel funéraire (bouteille de boisson, bougie, barrière de<br />
rameaux) érigé pour l’occasion. Cette poupée représente soit le malade et le mauvais esprit<br />
qui colle à sa victime, soit en réalité un fantôme de sexe opposé qui sert de leurre pour attirer<br />
le mauvais esprit 134 . De toutes les façons, l’opération consiste à arrimer le mauvais esprit en<br />
forêt afin de s’en libérer définitivement.<br />
132<br />
Seul un parent peut faire un fantôme obéissant et corvéable à merci, en vertu de l’idéologie intra-lignagère de<br />
la sorcellerie.<br />
133<br />
On appelle cela “mettre l’enfant dans le médicament” (i.e. dans le fétiche censé apporter pouvoir et richesse).<br />
134<br />
Tous les agents maléfiques invisibles (mauvais esprit ou serpent) semblent ainsi être des célibataires à la<br />
recherche d’un époux – le sacrifice sorcellaire d’un parent n’étant alors que l’envers d’un mariage dans le monde<br />
des morts. D’où le schéma opératoire commun consistant à fabriquer un leurre de conjoint afin de débarrasser la<br />
victime de l’entité persécutrice.<br />
-91-
•La tête ouverte<br />
Arrimer le mauvais esprit<br />
Le malade qui a la tête ouverte vit un cauchemar éveillé, atteint d’hallucinations<br />
terrifiantes qui entraînent des comportements pathologiques (panique, délires, chutes, etc.).<br />
Contrairement aux autres troubles que soignent les nganga, cette sorte de folie n’est pas<br />
provoquée par un parent sorcier mais par un dérèglement de l’esprit du malade lui-même.<br />
L’esprit du malade a en effet la fâcheuse propension de sortir de son corps par la fontanelle<br />
(qui est restée ouverte à la naissance) pour aller divaguer dans un monde invisible peuplé de<br />
sorciers et de fantômes (d’où les hallucinations violentes). L’affliction, proche de la faculté<br />
visionnaire des initiés, s’en distingue dans la mesure où cette capacité à voir l’invisible est<br />
erratique et néfaste. Elle est néanmoins une promesse pour peu que le malade parvienne un<br />
jour à discipliner ses visions.<br />
Le traitement de la tête ouverte consiste alors à refermer la fontanelle afin d’empêcher<br />
l’esprit d’en sortir. Le nganga arrime sur le crâne du malade un mélange de poudre d’os de<br />
bêtes féroces (gorille, panthère, éléphant, buffle, etc.) recouvert d’une peau de genette et d’un<br />
pagne noir. Le malade doit garder cet étrange couvre-chef une dizaine de jours afin de barrer<br />
littéralement la route à l’esprit vagabond (les bêtes féroces ayant un rôle dissuasif).<br />
4. Schèmes opératoires et efficacité thérapeutique<br />
Dans nombre de cas, ces divers traitements semblent bien entraîner une amélioration<br />
relative de l’état du malade. Il serait néanmoins difficile de parler de guérison autrement que<br />
métaphoriquement, étant donné la plurivocité habituelle d’une affliction qui cumule différents<br />
registres (somatique, psychologique, familial, financier, etc.). Il ne saurait donc s’agir d’un<br />
rétablissement strictement physiologique, mais plutôt d’une ré-évaluation personnelle par le<br />
malade de sa situation d’infortune. Certes, ces traitements incluent souvent des soins<br />
additionnels visant à guérir les symptômes somatiques les plus manifestes : ainsi les bains,<br />
-92-
massages et pommades pour un pied atteint par un fusil nocturne. Et la riche pharmacopée<br />
végétale des nganga leur permet d’être relativement efficace en cette matière.<br />
Cependant, le noyau central de tous les traitements majeurs des nganga repose sur une<br />
manipulation symbolique visant l’agent sorcellaire responsable du mal : coupure de la corde,<br />
déclenchement du fusil nocturne ou enterrement du mauvais esprit. Leur efficacité serait donc<br />
symbolique plutôt que directement physiologique : ce type de traitement permet de rendre<br />
pensable l’expérience affective informe des malades en l’intégrant dans un schéma culturel<br />
cohérent, schéma mis en actes par des manipulations verbales et/ou matérielles 135 . Si elle ne<br />
suffit pas à guérir, cette intégration d’une souffrance inarticulée dans un scénario culturel<br />
partagé procure sans doute au moins une forme de satisfaction cognitive. C’est là la version<br />
minimale de l’efficacité symbolique 136 .<br />
Toutefois, contrairement à l’incantation cuna qui constitue l’exemple majeur de Lévi-<br />
Strauss dans “L’efficacité symbolique”, le nganga ne raconte aucun récit mythique mimant<br />
l’affliction du malade. Il ne se soucie pas d’expliquer le sens de ses gestes et tient secrète la<br />
composition de ses médicaments. Si bien que le malade ne sait pas nécessairement ce qu’on<br />
lui fait subir, ni comment cela peut le guérir. C’est là un des défauts d’une interprétation en<br />
termes d’efficacité symbolique : le traitement serait d’autant plus efficace qu’il s’adresserait à<br />
un expert ; or, le commun des malades est au contraire largement ignorant des pratiques du<br />
nganga et de leur signification précise.<br />
Cela dit, dans ce que fait le nganga, certains objets ou événements sont volontairement<br />
saillants : ainsi l’inflammation de la poudre pour le déclenchement du fusil nocturne ou le lien<br />
de liane dans la coupure de corde. Or, si le malade ignore ce que renferme précisément la tête<br />
du mbumba ou le paquet du déclenchement, il voit cependant bien que la liane dont on le<br />
ligote avant de la découper en morceaux ressemble à un serpent, et que la poudre qui<br />
s’enflamme brusquement près de son pied mime la déflagration d’un fusil. Plutôt que sur des<br />
significations ésotériques, c’est donc sur cette forme minimale d’intelligibilité (qui tient aux<br />
manipulations sensibles impliquant le corps du patient) que repose l’efficacité de ces<br />
traitements. Or, ces significations saillantes sont d’autant plus aisément intelligibles que, par-<br />
135<br />
C’est la thèse centrale des deux articles canoniques de Lévi-Strauss sur l’efficacité symbolique (1958a,<br />
1958b).<br />
136<br />
L’hypothèse maximale voudrait que cette intégration culturelle débloque un processus proprement<br />
physiologique de guérison, par un jeu d’induction entre structures homologues de niveaux différents<br />
(manipulations rituelles, schéma culturel, psychisme inconscient, corps organique). Il faut pourtant reconnaître<br />
que les ressorts réels de cette induction demeurent parfaitement mystérieux, les concepts d’abréaction et de<br />
conversion psychosomatique mobilisés par Lévi-Strauss étant peu convaincants. Dans sa version maximale, la<br />
notion d’efficacité symbolique reste donc largement problématique.<br />
-93-
delà leur diversité apparente, elles se réduisent en réalité à deux ou trois schèmes opératoires<br />
généraux que les nganga mettent constamment en œuvre.<br />
Le schème de la purification se retrouve dans la plupart des traitements sous<br />
différentes modalités : laver le corps (bain, onction, fumigation), expulser le mal (vomitif,<br />
laxatif, purge nasale), transférer le mal à un substitut (transfert du mauvais sang sur l’arbre,<br />
mbando, mauvais esprit, sacrifice animal). Cette purification sert à lever une infortune<br />
indéterminée, qui se présente sous la figure du malheur ou de la malchance : il s’agit de passer<br />
d’un corps sale (infortuné) à un corps propre (fortuné). Toutes ces formes de purification ont<br />
l’intérêt de localiser l’infortune en faisant de la malchance et du malheur une souillure, à la<br />
surface ou à l’intérieur du corps. Et toutes les situations où le malade doit tourner le dos<br />
(rentrer et sortir de la hutte à fumigation à reculons, tourner le dos à l’aval pendant le bain de<br />
rivière, ne pas se retourner en partant du site de brousse) appartiennent à ce même registre de<br />
la purification. Il s’agit de se détourner du malheur en le laissant derrière soi.<br />
Lorsque le traitement concerne non plus l’infortune mais le sorcier qui en est<br />
responsable, le schème opératoire est celui de la protection. Mais il est remarquable que cette<br />
protection cache en fait systématiquement une opération de riposte agressive. Si l’enterrement<br />
du fétiche protecteur mbando soustrait le corps du malade aux regards du sorcier, c’est aussi<br />
un “retour à l’envoyeur” contre l’agresseur : le paquet est hérissé d’aiguilles pointes vers<br />
l’extérieur et des tessons protègent le site. On répond donc au mal par le mal, à la violence par<br />
la violence.<br />
Dans un article, J. Favret-Saada et J. Contreras décrivent les procédures thérapeutiques<br />
mises en œuvre par Madame Flora, cartomancienne et désorceleuse du bocage mayennais<br />
(Favret-Saada & Contreras 1985). La situation d’ensorcellement oppose une victime<br />
innocente mais sans force à un sorcier mauvais mais puissant. Le désorcèlement vise à<br />
redonner au patient sa force happée par le sorcier. La méthode de Madame Flora consiste<br />
alors, par le support des cartes, à subtilement compromettre le patient avec la violence et le<br />
sorcier, alors même qu’il ne cesse de se proclamer innocent et étranger à tout mal 137 . Par ce<br />
biais, l’attention du patient est détournée du malheur, et le désespoir impuissant est<br />
transformé en force agressive, en acceptation inconsciente des vœux de mort. Les auteurs<br />
appellent ce dispositif un “embrayeur de violence”.<br />
De ce point de vue, les fétiches protecteurs comme le mbando, ainsi que les mises en<br />
scène rituelles qui leur correspondent, constituent également des “embrayeurs de violence”.<br />
137 Les cartes sont en effet appariées en chiasme : le roi et la dame de carreau désignent l’ensorcelé et la sorcière,<br />
la dame et le roi de pique l’ensorcelée et le sorcier.<br />
-94-
Ils permettent et dissimulent une violence agressive dirigée contre le sorcier en la maquillant<br />
en une protection défensive. Tout d’abord, l’attribution de l’infortune à un sorcier rend<br />
possible la canalisation d’une agressivité flottante sur un objet déterminé. La décharge<br />
agressive mise en scène dans la riposte rituelle permet ensuite de reprendre l’ascendant sur le<br />
sorcier présumé, et par là de sortir du cercle vicieux de la passivité malheureuse en retournant<br />
l’angoisse d’impuissance 138 .<br />
Mais il importe que cette riposte agressive ne se dise pas explicitement comme telle, à<br />
moins de faire basculer nganga et malades du côté de la sorcellerie. La vendetta n’est en effet<br />
pas un comportement légitime. La compromission avec la violence sorcellaire doit donc<br />
toujours se présenter sous la figure d’une protection des innocents contre le mal. Le “retour à<br />
l’envoyeur” qui consiste à placer des fragments de miroir au seuil de l’habitation illustre bien<br />
cette ambivalence légèrement hypocrite : la surface réfléchissante du miroir retourne<br />
mécaniquement l’agression contre l’agresseur. C’est ainsi son propre fusil nocturne qui<br />
revient frapper le sorcier, laissant sauve la prétention d’innocence du malade 139 . Un autre fait<br />
contribue d’ailleurs à disculper le patient au moment où il se compromet avec cette violence<br />
sorcellaire. Le désir agressif de vengeance qu’il ne saurait assumer seul est délégué à un tiers<br />
légitime : c’est en effet au nganga qu’il revient de manipuler aiguilles, tessons ou poudre à<br />
fusil en lieu et place de son patient.<br />
Dans les trois traitements majeurs (corde, fusil nocturne, mauvais esprit), la visée<br />
générale est moins protectrice que curative. S’y retrouve néanmoins la même duplicité sousjacente<br />
que dans le schème de la protection agressive : afin d’éliminer l’agent maléfique<br />
responsable de l’affliction, le nganga en confectionne un double antagoniste. Là encore, le<br />
mal n’est défait que par le mal, seule une violence peut annuler une autre violence : serpent<br />
contre serpent, fusil nocturne contre fusil nocturne, fantôme contre fantôme. Ce procédé a<br />
l’avantage de matérialiser, non plus la souillure de l’infortune comme pour le schème de la<br />
purification, mais l’agent de l’infortune, jusque-là parfaitement invisible. Le nganga donne<br />
ainsi à voir au malade un artefact médiateur qui représente à la fois l’agent du mal et son<br />
remède, tous deux de même nature. La délivrance rituelle opère donc comme un embrayeur<br />
de violence qui dissimule sans doute encore une riposte : la déflagration de la poudre anéantit<br />
le fusil nocturne mais atteindre également le sorcier par un choc en retour. En définitive, le<br />
traitement de l’infortune – du moins de la dimension relationnelle de celle-ci – consiste à<br />
138 Ce qui fait de la riposte rituelle un procédé fort similaire à l’activation permise par les visions initiatiques.<br />
139 Les enfants de nos cours de récréation procèdent de même lorsque, paume tournée vers leur interlocuteur, ils<br />
s’écrient “miroir réfléchissant !” pour renvoyer une insulte. En plus de n’être pas touché par l’injure, l’intérêt<br />
pour l’enfant est ici de pouvoir insulter en retour sans avoir à proférer le moindre juron.<br />
-95-
inverser la charge agressive de la relation sorcellaire (un sorcier persécutant un parent) en<br />
l’intégrant dans une relation d’ordre supérieur qui passe par le nganga et ses objets<br />
médiateurs.<br />
-96-
Chapitre VI<br />
Les secrets du bwεnzε : savoir et enseignement initiatiques<br />
Le parcours initiatique du Bwete Misɔkɔ inclut la transmission d’un savoir secret qui<br />
dépasse largement le seul savoir-faire thérapeutique. Tout initié doit ainsi en passer par un<br />
enseignement initiatique proprement interminable : il s’agit moins en effet de la transmission<br />
d’un corpus unifié de connaissances partagées que d’un type spécifique de discours et<br />
d’interaction entre cadets et aînés 140 . Puisque dans le Bwete, tout relève virtuellement du<br />
savoir initiatique, mieux vaut alors se focaliser sur les formes de ce savoir et les contextes de<br />
son enseignement, plutôt que sur ses contenus de détail (qui ont été ou seront abordés<br />
thématiquement dans d’autres chapitres).<br />
1. Gestes et paroles des ancêtres : le formalisme rituel<br />
L’idéologie au fondement du Bwete, comme de toute société initiatique, postule<br />
qu’une frontière ontologique sépare initiés et profanes : le monde se divise entre ceux qui en<br />
sont et savent et ceux qui n’en sont pas et ne peuvent donc rien savoir. La parole des profanes<br />
est donc systématiquement disqualifiée, alors même que certains d’entre eux en savent<br />
beaucoup sur le Bwete. Il ne saurait y avoir d’autre savoir autorisé sur la société initiatique<br />
que le savoir initiatique lui-même. Pour les spectateurs profanes qui viennent admirer à<br />
chaque veillée les prouesses acrobatiques des initiés, le Bwete se limite donc au<br />
divertissement d’une danse publique. Et effectivement, le terme “danse” sert parfois à<br />
désigner les diverses sociétés initiatiques : la danse Bwete, la danse Elɔmbo, etc 141 .<br />
Mais pour certains jeunes initiés également, le Bwete ne représente guère plus qu’une<br />
distraction leur donnant l’occasion de faire étalage de leur talent de danseur. Cette situation<br />
est moins le résultat du dévoiement des jeunes générations que de la méfiance des aînés qui<br />
maintiennent délibérément la masse des cadets dans l’ignorance, choisissant seulement<br />
quelques éléments prometteurs pour leur transmettre leurs secrets et assurer la reproduction<br />
initiatique. Il est alors suffisant que la plupart des initiés viennent danser et chanter, sans en<br />
savoir beaucoup plus sur le Bwete. Si les profanes sont en position d’ignorance, tous les<br />
initiés ne se trouvent donc pas pour autant dans une position d’omniscience.<br />
140<br />
C’est dire, avec P. Boyer, que la tradition est une forme de communication orale plutôt qu’une vision du<br />
monde (Boyer 1990).<br />
141<br />
Chaque société initiatique se distingue effectivement par une danse et un rythme singuliers qui en constituent<br />
donc la meilleure signature publique.<br />
-97-
En effet, un banzi commence toujours par participer aux veillées sans saisir le sens<br />
exact des actes que les aînés lui demandent d’accomplir. La maîtrise progressive des<br />
chansons, gestes et pas de danse lui permet au bout d’un temps de prendre part à l’action<br />
rituelle sans passer pour ridicule. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il connaisse les<br />
significations – généralement secrètes – attachées à tous ces actes. La liturgie d’une veillée est<br />
de toute façon suffisamment complexe pour qu’il y ait toujours un certain nombre de gestes<br />
qu’un initié, aussi expert soit-il, accomplira sans en connaître précisément la motivation et le<br />
sens. Mais s’il ne sait pas vraiment ce qu’il en train de faire, les aînés, eux, doivent bien le<br />
savoir. Il s’exécute donc, parce qu’il a appris des aînés à faire ainsi, et qu’au fond, les ancêtres<br />
ont toujours fait de même.<br />
La légitimation traditionnelle par les ancêtres reste en effet la première et la dernière<br />
justification permettant de rendre raison du Bwete, comme le dit explicitement une chanson :<br />
maganga ma kala na ma tsika biboto (“les choses rituelles d’autrefois, laissées par les<br />
anciens”). Que les ancêtres aient toujours fait ainsi suffit à fabriquer un rituel, qui n’est en<br />
définitive rien d’autre qu’une suite d’actes prescrits. Une veillée de Bwete sert d’ailleurs avant<br />
tout à réjouir les ancêtres par la bonne exécution d’un travail rituel collectif : c’est le sens du<br />
terme mayaya – réjouissance – qui désigne une veillée simple (sans occasion spécifique).<br />
Cette dimension autotélique de l’action est sans doute un trait essentiel de tout rituel : l’acte<br />
rituel est à lui-même sa propre fin.<br />
Un initié doit donc faire le Bwete comme les ancêtres l’ont toujours fait, sans<br />
nécessairement se poser la question du sens des actes. Vouloir alors trouver partout des<br />
signifiants et des motivations symboliques ne serait que déformation professionnelle<br />
d’anthropologue. Parfois, les gloses des initiés ne sont effectivement que des réponses ad hoc<br />
destinées à contenter l’ethnographe. Si un rituel peut donc fort bien se passer de<br />
commentaires herméneutiques, le Bwete possède néanmoins très nettement une tradition<br />
exégétique propre. Les initiés sont rapidement capables – et avides – de développer un<br />
discours abondant sur les significations de tel geste ou objet rituel, d’après leurs propres<br />
interprétations et celles que leur ont divulguées les aînés.<br />
Cette tension permanente au cœur du rituel entre la forme vide de l’obligation<br />
traditionnelle (je fais cela parce que c’est ainsi) et la surabondance des motivations<br />
symboliques (je fais ceci parce que ceci signifie cela) ne fait que refléter le décalage entre la<br />
performance rituelle et son exégèse. La mémorisation et la maîtrise opératoire des séquences<br />
-98-
d’actes précèdent leur éventuelle explicitation 142 . Et la séance d’enseignement des cadets par<br />
les aînés est toujours reléguée au matin qui suit la veillée. L’implication rituelle repose donc<br />
sur un écart entre l’exécution de séquences d’actions bien définies et un savoir sur ces actions<br />
irrémédiablement incomplet et incertain. Cet écart ne se résorbe jamais complètement : la<br />
relance indéfinie du jeu interprétatif fait qu’aucune exégèse ne viendra jamais combler<br />
totalement la distance entre la performance rituelle et la compréhension qu’on peut en avoir.<br />
On voit ainsi apparaître les rapports complexes qu’entretiennent l’action rituelle et les<br />
significations exégétiques qui lui sont attachées. En tant que suite des gestes et paroles des<br />
ancêtres dont les aînés ont la garde, le rituel du Bwete se suffit à lui-même et pourrait à la<br />
limite se passer de toute interprétation exégétique. La collaboration réglée des initiés dans<br />
l’action rituelle ne nécessite donc aucun code symbolique partagé par tous les acteurs 143 . Au<br />
contraire, un tel code appauvrirait sensiblement le Bwete. C’est justement parce qu’il n’y a<br />
pas d’entente préalable sur ce que signifie exactement le rituel que ce dernier peut<br />
s’accommoder de multiples interprétations, donner lieu à des exégèses si bavardes, et toujours<br />
laisser penser qu’il recèle encore d’autres mystères.<br />
La performance rituelle est donc une action formalisée qui en elle-même ne<br />
communique aucun contenu signifiant. Cet argument peut paraître acceptable pour l’action<br />
rituelle – la conception sémiotique selon laquelle gestes et danses communiquent un message<br />
n’étant déjà qu’une analogie discutable. Mais l’hypothèse est plus contestable pour la parole<br />
rituelle dont on attend qu’elle véhicule un contenu propositionnel signifiant – le langage étant<br />
avant tout un medium de communication.<br />
Pourtant, nombre d’initiés profèrent chants et invocations sans vraiment comprendre<br />
les paroles prononcées, qui ne sont pas nécessairement dans leur langue maternelle et que<br />
l’élocution chantée contribue de toute façon à déformer. Mais l’intelligibilité immédiate des<br />
paroles n’a en réalité que peu d’importance pour le locuteur comme pour l’auditoire – chacun<br />
se contentant d’une interprétation fort libre sur le sens général de la performance. L’important<br />
est moins le contenu que la forme de l’acte verbal qui doit respecter une structure prosodique<br />
distinctive. Ainsi l’invocation masculine mwago se caractérise par une structure répétitive et<br />
un style d’élocution entre la parole et le chant, imitant vaguement une lamentation. Ces traits<br />
formels permettent de distinguer l’invocation à la fois de la parole normale et des autres<br />
142 A partir de l’exemple du rituel jaïniste puja, Humphrey & Laidlaw (1994) soutiennent ainsi que le rituel est<br />
une suite d’actions prescrites mais dénuées de sens sur laquelle un commentaire exégétique se surimpose après<br />
coup.<br />
143 Humphrey & Laidlaw (ibid.) rejettent cette hypothèse d’un code symbolique partagé au principe du rituel,<br />
hypothèse qu’ils nomment paradigme Ndembu en référence aux analyses de V. Turner. Il n’y a pas de consensus<br />
à propos de la signification du rituel jaïniste. Seule la dévotion individuelle rend signifiant le rituel.<br />
-99-
chants de la veillée 144 . Des contrastes prosodiques séparent également les différentes branches<br />
du Bwete, tels des marqueurs distinctifs audibles : par rapport à l’invocation articulée du<br />
Myɔbε, celle du Ngɔndε est exécutée sur un tempo effréné qui rend délibérément la parole<br />
inintelligible 145 .<br />
Une performance orale réussie doit donc respecter certaines formes prosodiques, mais<br />
n’a pas besoin de transmettre un message entièrement intelligible. Certes, l’invocation n’est<br />
pas en elle-même dénuée d’un sens littéral. Mais elle n’est justement jamais envisagée en<br />
elle-même, comme pourrait l’être un texte. Elle est toujours un acte de parole singulier attaché<br />
à un contexte spécifique. Il n’est alors pas pertinent de considérer la valeur propositionnelle<br />
des énoncés hors de leur contexte d’énonciation, puisque cette valeur n’est pas une pure<br />
propriété intrinsèque de l’énoncé. Dans les chants et les invocations, le langage ne sert donc<br />
pas à transmettre fidèlement un message. Il s’agit plutôt d’une transformation de la parole<br />
ordinaire reposant sur une formalisation distinctive.<br />
M. Bloch a bien analysé l’importance de cette formalisation du langage dans le rituel<br />
de circoncision des merina à Madagascar (Bloch 1974) 146 . Discours formel, incantation et<br />
chant y sont autant d’étapes d’un même processus de transformation du langage ordinaire (la<br />
danse étant l’équivalent pour les mouvements corporels). Dans ce langage formalisé, la force<br />
propositionnelle de l’énoncé (son aptitude à décrire la réalité) s’annule quand sa force<br />
illocutoire (son aptitude à influencer les gens) atteint son maximum. La parole rituelle merina<br />
ne dit en définitive rien sur le monde mais repose sur l’utilisation de la forme comme moyen<br />
de pouvoir. Elle n’est en effet rien d’autre que la parole autoritaire des aînés, parole provenant<br />
originellement des ancêtres (“speaking the words of the ancestors”). Le Bwete fait<br />
sensiblement le même usage de la parole rituelle. Chants et invocations des veillées ne<br />
s’adressent d’ailleurs pas directement aux hommes mais d’abord aux ancêtres. Peu importe<br />
alors que les hommes n’en comprennent pas les paroles si les ancêtres entendent les bonnes<br />
formules et la bonne musique.<br />
Cette transformation du langage ordinaire qui rend largement incompréhensibles<br />
formules, invocations et chants du Bwete repose sur l’usage d’une langue secrète. Chez les<br />
bavove (dont la langue est le gevove), ce langage initiatique est connu sous le terme mitimbo.<br />
Gevove ordinaire et mitimbo s’opposent comme le cadet et l’aîné, le village et la forêt, le<br />
villageois et le pygmée, la visibilité et l’invisibilité, l’évidence et l’énigme. Le mitimbo est la<br />
144 Sur la parole rituelle, cf. Du Bois 1986.<br />
145 Rapidité qui se retrouve dans les danses et les chants.<br />
146 Bloch se situe ici dans la lignée pragmatiste de Malinowski pour qui la fonction principale du langage n’est<br />
pas de communiquer un message mais d’agir sur le comportement (Malinowski 1974 : annexe I). Dans le même<br />
esprit, cf. également Tambiah 1968.<br />
-100-
parole insaisissable des anciens, parole dont la signification se dissimule comme le pygmée en<br />
forêt. Concrètement, l’écart par rapport à la langue ordinaire est marqué d’une part par un<br />
usage abondant de périphrases, métaphores et métonymies, d’autre part par de nombreux<br />
emprunts aux langues des populations voisines desquelles les bavove ont reçu le Bwete<br />
(notamment mitsɔgɔ et masangu). Or, si le getsɔgɔ appartient au même groupe linguistique<br />
que le gevove (groupe B30), ce n’est pas le cas du yisangu (groupe B40).<br />
La situation se complique encore lorsque le Bwete se transmet des bavove à d’autres<br />
populations. L’important brassage ethnique dans le Bwete du sud Gabon fait alors du mitimbo<br />
un sabir où aucun locuteur ne retrouverait plus sa langue maternelle. C’est là d’ailleurs un<br />
thème initiatique explicite : le mitimbo porte la trace sédimentée des pérégrinations du Bwete,<br />
de village en village, d’ethnie en ethnie, depuis ses origines jusqu’à nos jours. Ce sabir rituel<br />
oblitère délibérément la compréhension. Au bout de cette chaîne de diffusion, il devient<br />
même une langue purement formelle qui ne véhicule plus aucun message littéral. Ainsi en va-<br />
t-il du popi (ou popè na popè), langue rituelle du Bwiti des fang du nord Gabon qui la<br />
comparent d’ailleurs au latin d’Église (Mary 1983b : 267-279). Les initiés se contentent alors<br />
de mémoriser des formules qu’ils répètent mécaniquement sans en comprendre le sens.<br />
Mais à faire ce chemin à l’envers pour retourner au cœur historique de la société<br />
initiatique, parmi les communautés mitsɔgɔ du Bwete Disumba dans la région Dibowa (entre<br />
les villages Ikobé et Etéké), on constate que la langue rituelle ne redevient pas pour autant<br />
transparente. Le povi, orateur du Disumba, parle bien en getsɔgɔ, mais dans une langue encore<br />
obscurcie et travestie. Les emprunts moins nombreux aux langues voisines laissent alors la<br />
place à un art consommé des doubles sens et autres transpositions imagées. Le pénis s’appelle<br />
ainsi Mosuma mwana Etsike a ma tsika ka mbeyi mikanga, c’est-à-dire Mosuma fils d’Etsike<br />
qui a laissé les rivières percées – ce qui renvoie à la défloration, le vagin étant désigné par le<br />
terme Mobogwe qui est le nom d’une rivière. Tout l’art du povi est de dissimuler un sens<br />
secret sous un sens littéral. Comme le note R. Sillans (1967 : 74-99), les récits initiatiques<br />
sont en outre pleins d’incohérences, inversions et répétitions, et sont de toute façon débités à<br />
une cadence si soutenue qu’ils en deviennent inintelligibles.<br />
Cet usage singulier du getsɔgɔ ordinaire doit d’abord permettre de cacher le sens du<br />
message aux profanes lorsque le povi parle en public. Mais, puisque le povi travestit encore<br />
ses paroles à l’écart de toute oreille profane, il s’agit tout aussi bien d’obscurcir la<br />
signification pour les initiés eux-mêmes. Ainsi, les initiés du Disumba tsɔgɔ ignorent eux<br />
aussi la plupart du temps la signification exacte des formules rituelles. La fonction de la<br />
langue rituelle sert donc moins à protéger le secret qu’à le créer et le suggérer : elle ne cache<br />
-101-
pas aux profanes une vérité transparente aux initiés ; elle rend le Bwete énigmatique à tous, y<br />
compris aux initiés.<br />
Des riches métaphores du povi tsɔgɔ au formalisme vide du popi des fang en passant<br />
par la situation hybride du mitimbo des bavove, il n’y a donc qu’une seule et même logique :<br />
celle d’un refus de la littéralité au service des aînés. La langue rituelle ne conserve pas<br />
précieusement les secrets initiatiques. Elle ne vise pas à transmettre fidèlement des messages,<br />
même cryptés. Elle instaure plutôt une hétéronomie dans l’accès aux significations<br />
initiatiques : elle suggère un savoir possible mais inaccessible, et impose ainsi le recours à<br />
l’interprétation des aînés qui en détiennent le monopole 147 . Ce recours aux aînés s’impose en<br />
réalité dès la première veillée d’initiation lorsque le banzi se fait expliquer ses visions par le<br />
père initiateur. D’emblée, lui est refusé un accès autonome à la signification de sa propre<br />
expérience. Ce décalage entre l’expérience rituelle et son élucidation interminable joue ainsi<br />
un rôle constitutif dans la structuration du rapport au savoir initiatique.<br />
2. Le bwεnzε : l’enseignement initiatique<br />
Cet enseignement initiatique est tout à fait spécifique et marque une rupture avec le<br />
cadre de la conversation ordinaire. Ce n’est qu’au bwεnzε qu’on peut “parler le Bwete”<br />
(vɔvɔkɔ Bwete ε) 148 . Le bwεnzε désigne d’abord le site en forêt interdit aux profanes mais<br />
aussi, par extension, n’importe quel lieu où les initiés peuvent parler en aparté. Le bwεnzε est<br />
le lieu du secret. Les initiés n’hésitent pas à se mettre entièrement nus, lorsqu’il s’agit de<br />
montrer la nudité du Bwete, c’est-à-dire d’aborder les affaires les plus secrètes. Un bwεnzε<br />
(i.e. une séance d’enseignement initiatique) est organisé le lendemain matin de chaque veillée<br />
rituelle : les aînés y reviennent sur ce qui a été fait au cours de la nuit – ce qui illustre bien la<br />
dimension rétrospective du commentaire initiatique. Mais on peut aussi profiter de toute autre<br />
occasion : visite chez un parent initié, invitation d’aînés à venir parler.<br />
L’enseignement initiatique, c’est aussi un certain type de relation entre aînés et cadets.<br />
La transmission du savoir suit scrupuleusement la hiérarchie initiatique : des aînés supposés<br />
savoir enseignent à des cadets désirant savoir. Le père initiateur est le premier à enseigner ses<br />
banzi. Mais dans les faits, n’importe quel aîné, y compris celui d’une autre communauté<br />
147 Pour l’ethnographe, cette situation rend impossible toute traduction littérale : “il ne faut pas parler exactement<br />
le Bwete mais tourner autour” (Sillans 1967 : 329). Le refus systématique de la traduction laisse alors place à<br />
des gloses, sur fond d’ignorance dissimulée ou de trahison délibérée de la littéralité. La parole est en effet<br />
d’autant plus interprétable qu’elle est intraduisible.<br />
148 Ou au nzimbe qui est l’équivalent du bwεnzε dans la branche Disumba.<br />
-102-
locale, peut venir occuper la place du maître dans le dispositif du bwεnzε. Souvent, une<br />
séance commence par quelques énigmes posées au cadet, afin de tester sa connaissance, mais<br />
aussi de l’obliger à se déclarer ignorant, et donc de réaffirmer explicitement la relation<br />
d’inégalité au principe de la transmission.<br />
Cette relation de subordination se traduit directement dans le système des attitudes.<br />
C’est ce que les initiés appellent mabɔndo ou digɔba, le respect dû aux aînés : “pour<br />
connaître tout ça, il faut plier les genoux”. Le cadet doit parfois s’agenouiller effectivement<br />
pour recevoir la connaissance de son aîné, signe de soumission qui reproduit la posture de<br />
prise de bénédiction. A l’inverse, les aînés savent instrumentaliser la rétention du secret (taire,<br />
mentir, faire attendre) à leur profit : peu importe alors le contenu dissimulé du secret, du<br />
moment que le seul fait de le taire affirme manifestement le rapport de subordination 149 . Au<br />
bwεnzε, le savoir et l’ignorance se manipulent et le respect se joue – les cadets n’étant pas les<br />
derniers à ruser pour parvenir à “arracher le Bwete” à ceux qui savent.<br />
Cette relation de subordination s’exprime également dans l’obligation d’une<br />
rétribution matérielle, le plus souvent monétaire (de quelques centaines à quelques milliers de<br />
francs CFA) : il faut “poser le Bwete” à celui qui parle le Bwete. Si l’aîné donne un secret, le<br />
cadet doit lui donner quelque chose en échange. Comme le dit crûment la formule “le Bwete,<br />
c’est l’argent”, tout se paie dans la société initiatique (et plus largement dans toutes les<br />
sociétés initiatiques au Gabon) : veillées, fétiches, médicaments, savoir 150 . Le prix du Bwete<br />
dépend de la valeur du savoir divulgué, c’est-à-dire en réalité de la valeur de l’aîné. A un père<br />
initiateur, on donnera plus qu’à un aîné proche de soi (et celui qui s’estime lésé en dira<br />
moins). Si le cadet n’a rien à donner sur le moment, il cueille une feuille et la tend à l’aîné qui<br />
en arrache la moitié : le partage des deux moitiés vaut comme une reconnaissance de dette 151 .<br />
S’il ne s’acquitte pas de la contrepartie, le débiteur est censé oublier tout ce qui lui a<br />
été raconté dès la fin du bwεnzε : “en donnant, tu crois que tu donnes à la personne qui va<br />
attraper l’argent, mais c’est aux génies que tu donnes. C’est pour faire en sorte que tout ce<br />
qu’ils vont te parler, ça rentre dans la tête et dans le cœur, et c’est inoubliable”. Le<br />
destinataire du don est en réalité multiple : l’aîné qui empoche l’argent, mais surtout les<br />
génies mikuku et le Bwete lui-même (d’où les expressions “poser les mikuku” ou “poser le<br />
149 C’est l’argument central de Jamin 1977.<br />
150 Les rapports monétaires semblent plus importants dans le Misɔkɔ que dans le Disumba. Le Misɔkɔ concerne<br />
en effet santé, fortune et pouvoir – affaires éminemment monnayables. Il est en outre bien implanté en ville où<br />
l’argent joue de facto un rôle plus important. L’initiation (stricto sensu) peut ainsi coûter plusieurs centaines de<br />
milliers de francs CFA – dépense considérable mais n’excédant pas la charge d’un enterrement, retrait de deuil<br />
ou mariage, autres occasions rituelles coûteuses mais indispensables.<br />
151 C’est exactement le sens du συµβολον grec (du verbe “joindre”) : objet partagé entre deux personnes pour<br />
servir entre elles de signe de reconnaissance.<br />
-103-
Bwete”). Les aînés ne sont en effet que les détenteurs actuels d’une connaissance initiatique<br />
dont les ancêtres sont les détenteurs originaires. Le paiement du bwεnzε s’inscrit ainsi dans un<br />
système plus général de la dette initiatique. Être initié, c’est être débiteur d’une dette infinie<br />
contractée envers les ancêtres mikuku et le Bwete : dette proprement inacquittable d’avoir été<br />
de nouveau mis au monde à travers l’initiation. Le père initiateur n’occupe donc jamais que la<br />
seconde place, après le Bwete et les ancêtres. Il entre évidemment dans de tels discours<br />
quelque hypocrisie qui tient à la mystification des rapports économiques d’appropriation. Il<br />
est cependant vrai que le père initiateur lui-même continue de payer la dette du Bwete, à<br />
travers les dépenses et les efforts du travail rituel. Tout le monde paie aux ancêtres le savoir et<br />
le pouvoir qu’ils ont légués avec le Bwete.<br />
Avant chaque bwεnzε, l’aîné donne aux cadets une mixture, appelée dikasi ou ekasi,<br />
contenant du miel, de la cola pilée et des feuilles écrasées de tangimina (commelinacée<br />
indéterminée dont le nom signifie “se souvenir”). Cette préparation permet au cadet de ne pas<br />
oublier ce qu’on lui raconte, conjurant ainsi un risque inhérent au caractère oral de<br />
l’enseignement initiatique. La conception sous-jacente de l’oubli est en réalité plus complexe<br />
qu’il n’y paraît : “c’est un dikasi qu’on te donne pour que cela reste dans ta tête. Malgré<br />
n’importe qui à qui tu vas parler, tu as déjà tout encaissé. Parce que si on te dit une parole<br />
aujourd’hui, toi aussi, tout de suite, tu dis à l’autre. Quand tu parles, cela reste avec l’autre,<br />
ça part sur lui pour toujours. Donc on ne parle pas le Bwete n’importe comment. Ce sont tes<br />
réserves, tes secrets”. L’oubli ne provient pas d’un défaut d’attention mais d’une dilapidation<br />
du savoir initiatique. C’est pour cela que l’aîné mange également sa part de la mixture : il doit<br />
conjurer le risque de perdre son savoir en le divulguant au cadet. Transmettre un secret à un<br />
tiers, c’est risquer de le perdre en l’oubliant aussitôt – ce qui révèle bien que la valeur du<br />
secret tient à sa rétention. L’enseignement initiatique du Bwete se situe donc à l’opposé d’une<br />
pédagogie humaniste transmettant un savoir commun partageable, conception dominante de<br />
notre système académique et de son savoir scientifique.<br />
C’est pourquoi coucher par écrit l’enseignement initiatique ne se fait pas. La trace<br />
écrite, au lieu de pallier les mémoires défaillantes, redoublerait au contraire le risque d’oubli.<br />
Elle constitue une divulgation publique qui confine à la dilapidation totale. Si l’enseignement<br />
initiatique est détaché de toute performance orale, il risque en effet d’échapper aux aînés qui<br />
en perdent le contrôle. Malgré cet interdit, quelques initiés disposent de documents personnels<br />
sur le Bwete (texte de chants ou invocations). Mais il est notable que ces documents écrits,<br />
-104-
soigneusement cachés dans des sacs, ne sont généralement pas destinés à être montrés à des<br />
tiers ou alors uniquement dans le secret du bwεnzε 152 .<br />
Le savoir initiatique est ainsi fermement attaché au cadre spécifique de sa transmission<br />
au bwεnzε. Le discours tenu sur le rituel a lieu dans un contexte lui-même fortement ritualisé<br />
(coupure marquée par rapport aux contextes ordinaires de communication). Trop souvent,<br />
dans les descriptions anthropologiques du rituel, le lecteur ne sait quelle valeur et quel statut<br />
accorder aux interprétations qui lui sont données, faute de précision explicite. A la description<br />
de l’action rituelle s’ajoutent toujours des exégèses dont on ne sait jamais très bien de qui<br />
elles sont le fait : interprétations de l’auteur, commentaires d’initiés ou de profanes. Et quand<br />
il est précisé que les initiés en sont les auteurs, on ignore souvent dans quel contexte cette<br />
information a été transmise à l’ethnographe : discussion libre entre initiés ou rationalisation<br />
ad hoc pour satisfaire l’anthropologue, banale conversation ou discours spécifique. On ignore<br />
par conséquent si les commentaires touchant le rituel font pleinement partie de la société ou<br />
ne sont qu’une élaboration secondaire largement factice. Ce défaut de contextualisation des<br />
exégèses rituelles peut légitimement entraîner une suspicion d’artificialité 153 . Le commentaire<br />
sur le rituel est loin d’être un discours naturel et évident, universellement partagé par les<br />
initiés et les anthropologues. C’est toujours au contraire un type spécifique de discours,<br />
culturellement marqué et donc éminemment variable.<br />
L’essentiel des exégèses que j’ai pu recueillir sur le Bwete l’ont été dans le cadre<br />
d’innombrables séances de bwεnzε entre initiés. Commentaires, interprétations et<br />
rationalisations appartiennent pleinement à la tradition initiatique locale : le Bwete est disert et<br />
n’en finit jamais de se décrire lui-même, de revenir sur ses propres actes en leur attribuant des<br />
significations. La classique situation ethnographique de recueil d’information a donc pu et dû<br />
s’insérer dans un contexte autochtone préexistant, avec ses règles propres mais aussi ses<br />
relations de subordination dans lesquelles il a bien fallu accepter de me laisser enfermer. Ces<br />
contraintes de l’enseignement initiatique contrarient parfois les nécessités du travail<br />
ethnographique, ce qu’illustre bien le problème de la prise de notes. Un ethnographe est avant<br />
tout quelqu’un qui passe son temps à coucher sur de petits carnets tout ce qu’il observe et ce<br />
qu’on lui dit, source inépuisable d’amusement et d’étonnement pour les enquêtés. Mais dans<br />
le secret du bwεnzε, cette activité professionnelle heurte de front l’interdit de l’écrit (ou de<br />
152 Ils ressemblent donc, dans un autre domaine, à nos journaux intimes : documents écrits qui ne sont pas<br />
destinés à circuler et dont le dévoilement subreptice est associé à une perte ou une trahison – perte des secrets<br />
intimes du moi dans un cas, perte des secrets initiatiques dans l’autre.<br />
153 Par exemple, F. Barth : “my strong suspicion is that the bodies of native explanation that we find in<br />
anthropological literature are often created as an artefact of the anthropologist’s activity” (1975 : 226).<br />
-105-
l’enregistrement) qui protège le pouvoir des aînés. Je n’ai heureusement pas eu tout le temps à<br />
me fier à ma simple mémoire et aux vertus de la feuille tangimina : après avoir installé une<br />
relation de confiance avec les initiés, j’ai pu la plupart du temps prendre en notes ou<br />
enregistrer les séances au bwεnzε.<br />
Les justifications et conditions de cette transgression tolérée du secret et de l’oralité<br />
variaient selon les initiés. Beaucoup reportaient le problème en aval : je peux écrire ou<br />
enregistrer, à condition que je sois également initié au Mwiri (ce qui a été fait), de manière à<br />
protéger mes propres secrets et assurer ma responsabilité. D’autres avaient accepté que le<br />
Bwete devienne public et s’écrive dans des livres : le Bwete appartient désormais à tout le<br />
monde et ne doit pas être accaparé par quelques aînés jaloux. Les remises en cause du<br />
dispositif de transmission du savoir existent donc au sein même du champ initiatique 154 . J’ai<br />
ainsi pu obtenir de la part de mes principaux informateurs l’autorisation explicite d’écrire et<br />
publier. On verra de toute façon plus loin comment l’ironie du Bwete minimise en réalité<br />
beaucoup le péril de la transgression de ce secret.<br />
3. Le bricolage du savoir initiatique<br />
L’attachement du savoir initiatique au cadre spécifique du bwεnzε pèse sur la forme<br />
même de ce savoir. La multiplication des occasions de bwεnzε et des aînés avides d’occuper<br />
la place du maître donne notamment du savoir initiatique une image éclatée. Les initiés<br />
soulignent qu’il n’est pas bon de recevoir le Bwete des mains et de la bouche d’une seule<br />
personne, fût-ce son propre père initiateur. Les rencontres et échanges entre initiés sont<br />
d’ailleurs intenses, à travers les invitations entre communautés voisines, les carrières<br />
individuelles croisant plusieurs branches et sociétés initiatiques, ou encore les périples<br />
initiatiques (chez les ethnies réputées expertes dans les choses initiatiques, comme les<br />
mitsɔgɔ, gapinzi, bavove, simba ou pygmées). Les initiés ont ainsi l’occasion d’entendre de<br />
nombreuses voix souvent divergentes.<br />
Malgré l’ancrage local des communautés, le savoir initiatique est donc le résultat d’un<br />
brassage d’éléments de provenances diverses. Les cent kilomètres de la route entre Libreville<br />
et Kango, dont les bas-côtés révèlent d’innombrables mbandja de multiples sociétés<br />
initiatiques et origines ethniques, en sont la meilleure illustration. Mais cette logique est<br />
154 La Bible joue sans doute un rôle dans l’affaire : qu’une religion, que les Gabonais connaissent tous de près ou<br />
de loin, soit divulguée dans un livre universellement disponible peut modifier par rebond la fonction du secret<br />
initiatique. Même si inversement, certains initiés chargent au contraire la Bible de messages cryptés<br />
supposément inintelligibles pour des lecteurs profanes.<br />
-106-
commune à l’ensemble des communautés initiatiques, qui sont en quelque sorte des zones de<br />
contact permanentes, y compris en milieu villageois. Le savoir initiatique du Bwete est ainsi le<br />
produit d’un bricolage de fragments parfois hétérogènes. A. Mary a minutieusement analysé<br />
la logique de ce bricolage dans le Bwiti des fang, où le syncrétisme chrétien est<br />
particulièrement important (Mary 1999). Plus au sud, les éléments chrétiens sont absents ou<br />
nettement plus rare. Comme le montre bien le sabir rituel, c’est plutôt la logique des emprunts<br />
entre populations voisines qui règle ce bricolage – les échanges entre ces populations étant<br />
anciens, intenses et souvent indémêlables (situation particulièrement nette pour les groupes<br />
B10, B30 et B40).<br />
La fiction du vieux sage indigène, détenteur omniscient d’un système de pensée bien<br />
ordonné, est donc parfaitement intenable – la multiplication des sources ayant vite fait de<br />
révéler lacunes et contradictions 155 . Le savoir initiatique du Bwete est moins un savoir à<br />
proprement parler qu’un agrégat de discours fragmentaires inégalement distribués entre<br />
initiés. Cette polyphonie du Bwete est d’autant plus marquante qu’elle est souvent<br />
discordante : le premier poteau du corps de garde, est-ce le fil de l’araignée ou le pénis en<br />
érection ? Doit-on placer la torche à droite ou au gauche du poteau central lors de la sortie des<br />
danseurs ? Dans ces fréquents désaccords entre initiés se jouent en réalité les rapports de force<br />
entre aînés pour le contrôle des cadets au niveau de la communauté locale. Servant à exprimer<br />
indirectement les jalousies et rivalités entre initiés et communautés, le savoir initiatique fait<br />
donc l’objet d’une manipulation intéressée.<br />
A cette polyphonie discordante s’ajoute encore le rôle des inventions personnelles. Les<br />
initiés reconnaissent en effet l’importance de l’innovation individuelle dans le savoir<br />
initiatique, à travers la place accordée au rêve (ndɔti) et à la vision. L’activité onirique inspire<br />
ou sert ainsi à justifier des innovations liturgiques, exégétiques ou mythiques dont les plus<br />
significatives mènent parfois à des schismes et à la création de nouvelles branches<br />
initiatiques 156 . Le rêve joue d’ailleurs un rôle décisif dans les mythes d’origine du Bwete : un<br />
parent mort divulgue en rêve les secrets de l’eboga, la recette des fétiches, la conduite à tenir<br />
pour soigner, consulter ou faire une chasse miraculeuse. Le Bwete commence ainsi par le<br />
rêve, principal moyen de communication avec les ancêtres. Le rêve est donc au principe d’un<br />
155 On a coutume de lire aujourd’hui Dieu d’Eau de M. Griaule comme le plus bel exemple de cette mystification<br />
anthropologique. Il est vrai que la Préface, avec ses passages sur le vieux sage détenteur de la doctrine<br />
métaphysique dogon, est suffisamment édifiante. Une lecture détaillée révèle cependant que M. Griaule se<br />
méfiait parfois d’Ogotemmêli et prenait soin de faire confirmer ou infirmer ses dires auprès d’autres<br />
informateurs.<br />
156 Un initié expliquait ainsi à R. Sillans : “on crée une branche chaque fois que l’on voit des choses qui diffèrent<br />
dans le bois amer”(1967 : 32). Par exemple, la création récente de la branche Sengedya du Misɔkɔ provient<br />
d’une vision d’un initié du Ngɔndε dans laquelle il a vu un nouveau génie mikuku.<br />
-107-
paradoxe qui permet et justifie l’innovation individuelle : message révélé à un individu<br />
singulier, il surpasse pourtant l’enseignement initiatique des aînés puisqu’il émane des<br />
ancêtres dont provient censément tout le savoir du Bwete. L’innovation individuelle procède<br />
donc directement des ancêtres.<br />
Il n’est ainsi pas rare de recueillir sur le terrain des récits mythiques qui diffèrent des<br />
versions canoniques et semblent d’invention récente. Les innovations réussies ne sont<br />
pourtant pas des créations ex nihilo mais des reconfigurations de récits classiques qui mettent<br />
en relief des éléments souvent déjà présents de manière implicite. Ce processus de<br />
réagencement permet ainsi de générer des histoires inédites et pourtant immédiatement<br />
familières pour une oreille initiée. Mais il est normal qu’une société initiatique qui repose<br />
autant sur l’implicite et le secret octroie une place conséquente à l’innovation individuelle 157 .<br />
L’indétermination et le caractère allusif qui sont les caractéristiques premières du langage<br />
rituel appellent naturellement les interprétations idiosyncrasiques. Et cela d’autant plus<br />
facilement que le Bwete fonctionne sur le principe de la pleine autonomie des communautés<br />
initiatiques locales. Le travail de création peut donc s’exercer sur un vaste champ de<br />
connotations partiellement indéterminées, mais mobilisant des champs thématiques renvoyant<br />
à des expériences communes et donc facilement partageables (sexualité, naissance, mort,<br />
sorcellerie – thèmes abordés plus précisément dans la troisième partie de l’ouvrage). Tel initié<br />
pourra ainsi accentuer systématiquement la symbolique sexuelle féminine, alors que tel autre<br />
jouera au contraire sur les allusions phalliques. Tel insistera sur le rôle de l’oncle utérin, tel<br />
autre sur celui du père.<br />
La norme de l’innovation est donc claire : de nouveaux contenus peuvent venir<br />
enrichir indéfiniment le savoir initiatique tant qu’ils prennent bien la forme du savoir légué<br />
par les ancêtres (formes stéréotypées décrites en détail au prochain chapitre). Le savoir<br />
initiatique n’est donc pas un catalogue figé de représentations collectives mais au contraire le<br />
lieu d’une articulation entre élaborations personnelles et formes traditionnelles. Je rejoins sur<br />
ce point les analyses de P. Boyer (1980) : l’enseignement des aînés sert à inculquer aux<br />
novices la grammaire des rapports entre symbolisme individuel et tradition. Le savoir<br />
initiatique est donc plus un méta-savoir (une forme spécifique d’énoncés) qu’un véritable<br />
savoir (un corpus d’énoncés).<br />
157 Pour rendre compte de la forte variabilité des idées et pratiques religieuses des populations des montagnes Ok<br />
de Papouasie Nouvelle-Guinée, F. Barth a bien dégagé la corrélation qui existe entre un savoir fondé sur le<br />
secret et l’implicite, et l’innovation individuelle (Barth 1987). L’innovation s’explique ainsi par la forme<br />
spécifique d’un savoir initiatique dépendant d’une organisation sociale particulière, plutôt que par les mystères<br />
ineffables du génie créateur.<br />
-108-
A force de circuler, se transformer et se contredire, les énoncés du savoir initiatique<br />
paraissent en définitive flotter sans que l’on sache bien à qui les attribuer au-delà de leur pure<br />
performance par un locuteur singulier : invention individuelle, représentation collective<br />
émanant de la communauté locale, de la branche ou de la société initiatique ? Et faut-il<br />
derrière cela entendre le discours anonyme de la culture du locuteur ou de l’ethnie d’origine<br />
de la branche initiatique ? Les énoncés du savoir initiatique semblent en définitive faire partie<br />
de formations collectives intermédiaires, sorte de culture initiatique spécialisée mais<br />
inégalement distribuée entre les acteurs et possédant un fort coefficient de dispersion 158 . C’est<br />
donc moins une cosmologie indigène bien ordonnée qu’un ensemble “inventif et complexe<br />
mais faiblement systématisé” (“creative and complex yet poorly systematized”), pour<br />
reprendre une expression de F. Barth (1975 : 222) à propos des baktaman qui convient fort<br />
bien au Bwete. Le terme “savoir initiatique” ne doit donc pas être pris en son sens littéral de<br />
système de connaissances portant sur le monde, mais plutôt comme une catégorie autochtone<br />
ou un raccourci commode pour désigner l’ensemble hétérogène des énoncés divulgués dans le<br />
contexte spécifique du bwεnzε.<br />
Et il ne faudrait pas croire que cette non-systématicité du savoir initiatique provienne<br />
de la dégradation irréversible d’une tradition mythique et rituelle autrefois harmonieuse mais<br />
dont le temps violent de l’histoire n’aurait laissé que des lambeaux déchiquetés. Comme si le<br />
Bwete n’était plus aujourd’hui que le reflet dégradé de son propre passé. Cette conception<br />
entropique est parfois relayée par l’idéologie autochtone qui affirme que les générations<br />
précédentes en ont toujours su plus. Ce jugement, tout relatif, ne fait en réalité que réaffirmer<br />
la place constitutive des ancêtres dans le Bwete. L’idéologie initiatique repose en effet sur un<br />
enchantement (ou un ré-enchantement) systématique du passé, qui survalorise les ancêtres et<br />
les anciens sur le mode nostalgique de la perte irrémédiable. Sans aucun doute, bien des<br />
éléments rituels et mythiques ont dû disparaître, mais d’autres ont été introduits et le sont<br />
continuellement. Le Bwete, aujourd’hui bien vivant au Gabon, n’est pas un conservatoire figé<br />
du passé, mais une tradition en perpétuelle transformation. L’unité du Bwete n’existe ainsi<br />
que comme l’horizon inaccessible de l’enseignement initiatique : loin d’être le produit de la<br />
détérioration du temps, l’aspect fragmentaire du Bwete permet de faire de l’acquisition du<br />
savoir initiatique une tâche proprement interminable.<br />
158 La société initiatique Bwete est en fait un réseau de communautés locales à la fois autonomes et en interaction<br />
constante (invitations réciproques aux veillées, liens de parenté initiatique, etc.). Le savoir initiatique désigne<br />
corrélativement le résultat émergent de la distribution et de la dynamique des énoncés initiatiques à l’intérieur de<br />
ce réseau.<br />
-109-
4. “Le Bwete ne finit jamais”<br />
L’une des formules favorites des initiés affirme que “dans le Bwete, tout a une<br />
explication”. Les mitsɔgɔ assurent même que c’est à cause de cela qu’ils ont longtemps refusé<br />
l’École des Blancs, persuadés de la supériorité du savoir transmis dans le Bwete. Le Bwete<br />
possède en effet la propension à absorber la moindre chose pour en faire une entrée du savoir<br />
initiatique : il est censé pouvoir rendre raison de la feuille que le vent fait bouger ou du chien<br />
qui aboie. Les initiés ne s’intéressent cependant pas à ces phénomènes pour eux-mêmes, et ne<br />
cherchent pas à énoncer quelque chose de leur nature. Ils ne les intègrent au Bwete que pour<br />
leur donner la forme canonique du savoir initiatique, les insérant dans des énoncés<br />
standardisés 159 . Le Bwete arrache au monde des items pour en faire la matière d’énigmes,<br />
d’homologies secrètes ou de récits d’origine.<br />
On est là exactement dans ce que D. Sperber appelle le savoir ou dispositif symbolique<br />
(Sperber 1974). Le savoir symbolique est infini et semble porter sur le monde comme le<br />
savoir encyclopédique. En réalité, il ne porte pas sur les phénomènes mais seulement sur leurs<br />
représentations. Un énoncé symbolique est une représentation mise entre guillemets pour faire<br />
l’objet d’une seconde représentation. Si dans le Bwete, tout possède une explication, c’est<br />
ainsi parce que tout item peut faire l’objet d’une mise entre guillemets dans le savoir<br />
initiatique. Un vulgaire caillou y acquiert des significations cachées : d’où vient ce caillou ?<br />
qui a fait le premier caillou ? dans quel village ? à quelle partie du corps renvoie-t-il ? Et<br />
chaque item possède toujours plusieurs entrées dans le savoir initiatique et ne reçoit jamais<br />
une valeur unique : le chasse-mouches a pour analogue la main, la tête et les cheveux, ou la<br />
queue du porc-épic ; le corps de garde, c’est un homme courbé ou un éléphant.<br />
Cette polysémie est structurée par l’ordre des secrets, selon la métaphore autochtone<br />
de la profondeur qui organise la progression de l’enseignement initiatique. Ce qui a le plus de<br />
valeur, c’est l’origine (go ebando) et le fond (go tsina) d’une chose. La métaphore renvoie<br />
aux paquets-fétiches du Bwete, méticuleusement emballés dans des feuilles, des tissus ou des<br />
raphias, solidement ligotés, puis cachés au fond des corbeilles en rotin ou des besaces pεngε.<br />
Divulguer un secret, c’est ainsi “ouvrir le pεngε” ou “défaire le paquet”. Et recevoir le dernier<br />
secret, c’est voir enfin “le fond du sac”. Mais la métaphore de la profondeur renvoie<br />
également à la forêt : plus on s’y enfonce, plus les secrets y sont importants – d’où la valeur<br />
symbolique des pygmées et du campement de chasse. Le savoir initiatique possède ainsi une<br />
159 Comme l’écrit P. Boyer (1980), si l’initié n’en sait pas plus que le profane sur le monde, il envisage en<br />
revanche différemment la connaissance du monde.<br />
-110-
structure feuilletée en niveaux de profondeur 160 . L’enseignement initiatique se présente<br />
comme un approfondissement indéfini du secret : chaque signification secrète appelle<br />
toujours une autre explication plus profonde.<br />
Ceci apparaît bien dans un trait singulier du savoir initiatique. Nombre des entrées de<br />
ce savoir font l’objet d’un dédoublement systématique : les initiés leur octroient un deuxième<br />
nom qu’ils accolent au premier par la conjonction na. Nzimbe (lieu secret) devient Nzimbe na<br />
Makaka. Mabundi (femme initiée) devient Mabundi na Modanga. Ndea (branche rituelle)<br />
devient Ndea na Disanga. Le principe est simple : X, c’est en fait X na Y. Or, ce second<br />
terme possède généralement une signification obscure, parfois même aucune signification<br />
précise. Ainsi, selon mon interlocuteur, Makaka désigne la même chose que Nzimbe mais<br />
sous une appellation “plus secrète”. Il ne s’agit donc pas de qualifier un terme pour le<br />
préciser, mais bien au contraire de l’obscurcir en lui adjoignant un vocable plus mystérieux.<br />
Le procédé va parfois plus loin encore. Selon un mythe initiatique, la genèse de<br />
l’homme s’est déroulée au bord d’une rivière appelée Ngobwe. C’est ce que mon interlocuteur<br />
m’a d’abord révélé. Puis, se livrant à une véritable mise en scène du dévoilement progressif<br />
du secret, il est revenu à plusieurs reprises me préciser ce nom, ajoutant d’autres termes<br />
jusqu’à ce que la rivière devienne Ngobwe na Gedemba na Makube mabae na Minzonzi na<br />
Tongo. Supposément, chacun des noms auxiliaires, plus secret que le précédent, désignait un<br />
affluent de la rivière principale. Dans le Bwete, connaître une chose, c’est en effet connaître<br />
son origine. Pour une rivière, cela revient donc à déterminer d’où provient son eau, c’est-àdire<br />
à connaître le nom de ses affluents. Mais il faudrait pouvoir remonter jusqu’à la source, et<br />
en réalité jusqu’à la première goutte d’eau. L’adjonction de noms est donc virtuellement<br />
indéfinie : chaque ajout augmente la valeur secrète du nom, mais appelle aussitôt un nouvel<br />
ajout.<br />
Il n’y a donc aucun point d’arrêt à l’acquisition du savoir initiatique. Nombre de<br />
formules initiatiques soulignent bien cela : “le Bwete ne finit jamais”, “Bwete gemanε” (le<br />
Bwete est intarissable). Le Bwete, c’est la mer ou le geliba, étendue d’eau profonde qui ne<br />
peut jamais tarir. De même, l’enseignement du Bwete est inexhaustible comme les taches de<br />
la panthère (ou les écailles du python) qu’on ne peut pas compter. En effet, le jeu de<br />
l’interprétation exégétique est proprement interminable puisqu’il se nourrit de lui-même. Les<br />
associations analogiques multiplient à l’infini les connexions entre les différents items du<br />
savoir initiatique, mais elles n’expliquent rien. On ne sort jamais de la forme du savoir<br />
160 F. Barth relevait la même structure feuilletée dans le savoir initiatique des baktaman, la comparant à des<br />
pelures d’oignon ou des poupées gigognes (1975 : 82).<br />
-111-
initiatique. L’enseignement des aînés ne consiste donc pas en un dévoilement progressif d’un<br />
système de plus en plus cohérent. C’est au contraire un obscurcissement progressif à travers<br />
différentes couches symboliques 161 .<br />
Cet approfondissement interminable du secret est isomorphe à la hiérarchie initiatique.<br />
Les aînés soulignent avec insistance que certains secrets sont trop profonds pour les cadets qui<br />
n’ont pas encore franchi telle ou telle étape initiatique. Le secret vaut donc autant entre initiés<br />
qu’à l’égard des profanes : séparation absolue et formelle à l’égard des profanes (frontière<br />
externe), séparation continue et relative entre initiés (frontière interne) 162 . Ce n’est qu’entre<br />
nyima qu’il n’y a en principe plus aucun secret : deux pères initiateurs peuvent tout se dire. A<br />
qui connaît beaucoup, on dit beaucoup ; mais à qui connaît peu, on dit peu. De là finalement<br />
le caractère déceptif du savoir initiatique. Les aînés font tourner les cadets en rond avant de<br />
leur divulguer des secrets qui peuvent n’être que des mensonges, des histoires destinées à<br />
“embrouiller les enfants” 163 . Il est alors impossible de déterminer au final si l’on peut prendre<br />
pour argent comptant une révélation ou si l’on est en train de se faire berner une fois de plus.<br />
Chaque séance au bwεnzε entraîne ainsi sa part de doute et d’insatisfaction. Toute<br />
divulgation d’un secret met en scène une rétention qui en constitue le revers nécessaire : “je<br />
vais t’ouvrir le paquet du Mwiri. Mais je te donne seulement les trois-là [l’explication des<br />
trois scarifications initiatiques au poignet] mais pas celui-là [la marque du coude]. Je ne<br />
veux pas trop parler l’affaire là. Il y a des choses que je cache pour les donner à mes fils”. Au<br />
moment même où il est divulgué, le savoir initiatique est présenté comme inadéquat et<br />
insuffisant. L’enseignement initiatique ne repose donc pas sur un contrat tacite de<br />
compréhension comme la conversation ordinaire. Il présuppose au contraire qu’une<br />
compréhension totale est impossible.<br />
Pris entre les deux principaux leitmotiv de l’enseignement initiatique – “dans le Bwete,<br />
tout a une explication” et “le Bwete ne finit jamais” –, l’initié fait en définitive l’épreuve d’un<br />
savoir énigmatique qui ne s’éclaircit pas au fur et à mesure de sa divulgation, mais qui lui fait<br />
miroiter l’existence d’une vérité désirable et cependant toujours ajournée. L’intérêt porté au<br />
savoir initiatique se nourrit ainsi paradoxalement de la déception, du doute, de l’ambivalence<br />
et de l’insatisfaction. Plus l’initié s’enfonce et s’empêtre dans les profondeurs secrètes du<br />
Bwete, plus le fond semble reculer, mais plus aussi cela renforce sa conviction qu’il y a une<br />
161<br />
Comme l’écrit F. Barth : “the principle of symbolic substitution is used to augment the secrecy and mystery of<br />
the rite” (1975 : 189).<br />
162<br />
Ce qu’avait bien vu G. Simmel dans Secret et sociétés secrètes (1996 : 93-94).<br />
163<br />
La métaphore du puzzle est ici appropriée, si l’on veut bien y entendre toutes les connotations du vocable<br />
anglais : l’énigme, l’embarras, la perplexité. J.W. Fernandez affirme ainsi que les images complexes des sermons<br />
du Bwiti fang visent à une “edification by puzzlement” (1982 : 509).<br />
-112-
vérité plus importante au-delà de ce qu’il a pu voir ou savoir. C’est bien ce qu’on peut appeler<br />
un piège à pensée, une chausse-trape de plus sur le chemin du Bwete.<br />
Un même principe d’inachèvement se retrouve souvent dans les contes épiques au<br />
Gabon. Ainsi, Mumbwanga (conte bapunu) procède de digression en digression, littéralement<br />
de fourche (dipaku) en fourche (Kwenzi Mikala 1997). Si bien qu’il est réputé ne jamais<br />
finir : “jusqu’à la mort, le Mumbwanga ne finira pas”. Le conteur s’arrête avec le chant du<br />
coq au matin (la récitation est toujours nocturne) sans avoir véritablement achevé son histoire<br />
à tiroirs. Le terme de la récitation est donc en même temps une promesse de continuation,<br />
puisque les raisons circonstancielles de l’arrêt du conteur sont extérieures à la logique interne<br />
du récit : “je m’arrête là, mais le Mumbwanga ne finira pas”. La même structure sans fin se<br />
retrouve dans Bitola (conte épique des bavove), mais aussi dans les épopées du mvët des fang<br />
dont P. Boyer (1988) a bien mis au jour les “emboîtements baroques”. Le conte ne s’arrête<br />
accidentellement qu’avec le terme de la séance de récitation et finalement avec la mort du<br />
conteur. De même, le savoir initiatique s’interrompt artificiellement avec la fin du bwεnzε, et<br />
ne cesse en réalité qu’avec le dernier souffle de l’initié : “le Bwete ne finit jamais, sauf le jour<br />
de la mort”.<br />
Mais la mort n’est pas seulement le terme accidentel du savoir ; elle est aussi le<br />
moment essentiel de sa divulgation. Dans le Bwete, la valeur d’un secret tient moins à son<br />
contenu réel qu’au fait qu’il soit hors de portée d’un certain nombre de personnes. Valeur et<br />
diffusion du secret sont donc inversement proportionnelles. Pousser cette logique jusqu’au<br />
bout conduit au paradoxe du maximum : le plus grand secret est celui qu’une seule personne<br />
possède et qu’elle ne transmet pas 164 . Les initiés du Bwete font de cette antinomie le problème<br />
central de la transmission du savoir initiatique. Si le savoir n’est pas transmis, la survie<br />
intergénérationnelle du Bwete est menacée. Mais si on le divulgue trop facilement à trop<br />
d’initiés, ce savoir perd de sa valeur. Cette économie du secret permet de comprendre le rôle<br />
véritable de la feuille aide-mémoire tangimina et du paiement du savoir : dire un secret, c’est<br />
le dévaluer et donc le perdre. Ce drame de la transmission du savoir est généralement formulé<br />
comme un conflit entre générations : les jeunes gaspillent le Bwete, les anciens refusent de<br />
donner le Bwete. Le vieux, c’est celui qui sait mais ne dit (presque) rien : “moi, je ne dis rien<br />
ou peut-être deux mots seulement. Les gens, ils savent déjà que je suis kɔkɔ Kombi [un ancien<br />
du Bwete]”.<br />
164 Ce que F. Barth avait déjà repéré cela chez les baktaman : “the value of information seemed to be regarded as<br />
inversely proportional to how many share it. […] Its value is greatest when it stops being information at all :<br />
when only one person has it and does not transmit it” (1975 : 217).<br />
-113-
Afin d’éviter à la fois la dévalorisation de son savoir initiatique pour cause de<br />
transmission et sa disparition pour cause de rétention, un père initiateur doit alors attendre le<br />
jour de sa propre mort pour divulguer ses secrets de plus grande valeur. Et s’il meurt sans<br />
avoir eu l’occasion de transmettre ce secret, il le dévoilera post-mortem dans un message<br />
onirique adressé à son héritier. Les plus grands secrets ne se disent donc qu’à l’agonie : “le<br />
maître a toujours un secret pour lui-même personnel. C’est peut-être le jour où il voit qu’il ne<br />
peut plus vivre qu’il va le dire à quelqu’un. Mais tant qu’il vit encore, c’est avec lui dans la<br />
tête. Toujours une dernière botte secrète. Les enfants, tu vas leur parler des choses qui sont<br />
en haut. Mais en bas en bas, tu es obligé de garder ça pour toi-même. Jusqu’à ce que tu voies<br />
que tel enfant est assez mûr, ou bien le jour de ta mort, tu vas lui léguer telle chose” 165 .<br />
Le rapport entre secret et mort est donc au principe de la logique de circulation du<br />
savoir initiatique. L’ultime divulgation indéfiniment différée garantit à la fois la pérennité et<br />
la valorisation du Bwete. C’est le sens caché de l’expression “le Bwete ne finit jamais, sauf le<br />
jour de la mort”. Rétention et divulgation sont ainsi les pulsations élémentaires qui scandent<br />
la circulation des énoncés initiatiques.<br />
165 S’il faut toujours garder au moins un secret par-devers soi, c’est aussi pour ne pas donner prise aux sorciers.<br />
Divulguer un secret, c’est en effet s’exposer. On dit parfois de même que le banzi doit taire au moins une de ses<br />
visions initiatiques.<br />
-114-
Chapitre VII<br />
“Le premier qui…” : la forme des énoncés initiatiques<br />
L’enseignement initiatique touche un ensemble vaste et hétérogène de savoirs et de<br />
savoir-faire : liturgie, significations secrètes, danses, chants, etc. Au sein de cet ensemble se<br />
distingue néanmoins un domaine singulier d’énoncés stéréotypés : récits mythiques,<br />
correspondances analogiques et énigmes sont les énoncés les plus typiques et les plus typés du<br />
savoir initiatique. Ces trois types traditionnels d’énoncés ont en effet la particularité de ne<br />
renvoyer à rien d’autre qu’à eux-mêmes, à travers une circularité sans fin. Ils témoignent<br />
d’une pratique gratuite du symbolisme analogique qui sert à enfermer les initiés dans un<br />
discours interminable.<br />
1. Go ebando : les mythes d’origine<br />
Le secret de plus grande valeur, c’est le fond (go tsina) mais aussi l’origine (go<br />
ebando) d’une chose. Il faut savoir comment les choses ont commencé, d’où elles<br />
proviennent, puisque selon la formule initiatique classique, “toute chose a une origine” (soma<br />
setso gende na ebando). Cette obsession initiatique de l’origine s’exprime généralement en<br />
termes généalogiques : “un enfant qui connaît bien le fond de sa famille, c’est celui qui peut<br />
faire le Bwete comme il faut. Parce que tu dois connaître le nom de la première personne née<br />
dans ta famille”. Thème et moteur du savoir initiatique, ce schème généalogique est aussi au<br />
principe de son inachèvement, étant donné la récursivité de l’ascendance : les initiés racontent<br />
ainsi que Nzambe lui-même, le Dieu créateur ou le premier ancêtre, possède une mère et un<br />
oncle dont les noms sont tenus secrets 166 .<br />
Contrairement aux fang du nord Gabon dont la formule traditionnelle de présentation<br />
consiste en l’énoncé d’une ascendance patrilinéaire remontant jusqu’à Dieu, la connaissance<br />
de la généalogie lignagère est peu profonde parmi les populations matrilinéaires du sud du<br />
pays. La mémoire du lignage remonte rarement au-delà des arrière grands-parents. En<br />
revanche, l’histoire des clans joue un rôle important et les récits d’origine en sont<br />
généralement connus. Ces récits relatent comment le clan est né (souvent une scission suite à<br />
166 Il n’est pas clair si Nzambe est une figure autochtone ou importée. La diversité de ses noms (Mwanga benda,<br />
Evanga-vanga, Kɔkɔ-a-kanza, Nzambe ou Nzambe Kana) pose également problème : simples appellations ou<br />
entités distinctes ? De toutes les manières, dans le Bwete, Nzambe importe en réalité moins que les ancêtres et les<br />
génies.<br />
-115-
une dispute entre sœurs), d’où il vient géographiquement et où il a dû aller (il s’agit toujours<br />
de récits de migration), quelles péripéties ont eu lieu lors de ce voyage, et quels totems lui<br />
sont associés (les totems renvoyant aux péripéties) 167 . Ces récits sont mythiques dans la<br />
mesure où il n’existe aucune solution de continuité effective entre le clan et le lignage, et<br />
donc entre le temps du récit et la mémoire généalogique. Ego est membre de tel lignage<br />
(mbumu en getsɔgɔ) et sait retracer les liens réels de parenté qui l’unissent aux autres<br />
membres. Mais s’il appartient à tel clan (ebota), il est incapable de retracer dans sa totalité la<br />
chaîne généalogique qui fonde cette appartenance. Il ne peut ainsi se situer que<br />
métaphoriquement par rapport aux parents claniques qui ne font pas partie de son lignage.<br />
Or, le Bwete partage le même rapport à l’origine que ces récits claniques. Le savoir<br />
initiatique comporte en effet une série de récits qui racontent l’histoire du Bwete depuis ses<br />
débuts. Le commencement de cette histoire – partie la plus secrète qui doit donc<br />
théoriquement être racontée en dernier – nous projette au temps fondateur des ancêtres,<br />
temporalité mythique indéterminée. L’origine, c’est les ancêtres. Ce que confirme bien une<br />
série de chansons : “maganga ma gebando / maganga ma go tsina / maganga ma go tsεngε /<br />
maganga ma Nzambe Kana / maganga ma go mbεgo / maganga ma ge tsika biboto /<br />
maganga ma ge tsika payi”, c’est-à-dire “les choses (rituelles) du début, les choses du fond,<br />
les choses de la terre, les choses de Dieu, les choses d’autrefois, les choses laissées par les<br />
vieux, les choses laissées par les aînés”.<br />
Le corpus total des récits constitue ce que les mitsɔgɔ appellent le bokudu (bukulu chez<br />
les mεryε), terme qui signifie savoir généalogique. Il commence fort logiquement par la<br />
genèse du monde et de l’homme.<br />
M 3 (genèse du monde)<br />
“A l’origine, il n’y a qu’une boule noire où tout est enfermé dans une sorte<br />
d’océan boueux. Grâce à l’éclair Ngadi, Nzambe fait éclater cette boule qui se<br />
sépare en deux, le ciel en haut et la terre en bas. Les éclats projetés vers le haut<br />
forment le soleil Kombe, la lune Ngɔndε et les étoiles Minanga. Il y a maintenant<br />
alternance du jour et de la nuit. L’éclatement de la boule a aussi créé le vent<br />
Gepεpε qui anime toute chose et ride la surface de l’eau. Nzambe contemple sa<br />
création qui n’est encore qu’une vaste étendue d’eau sans terre émergée. Il<br />
envoie alors l’araignée Dibobe qui descend le long de son fil et navigue sur l’eau<br />
grâce à une feuille. Elle remonte et dit à Nzambe qu’il faut créer des terres parce<br />
que les êtres ne pourront pas vivre dans l’eau. Nzambe envoie alors les mouches<br />
maçonnes qui apportent la terre et la végétation. Puis il envoie la tortue Kudu qui<br />
vient aplanir les terres, les endroits non damés formant les montagnes. Les<br />
167 Quant au mythe d’origine de l’institution clanique elle-même, il raconte comment les clans mais aussi la<br />
matrilinéarité, l’exogamie et la compensation matrimoniale sont nés de la prohibition de l’inceste entre germains.<br />
-116-
tortues amènent également toutes les plantes cultivables, d’abord l’igname et le<br />
taro puis les autres tubercules et la banane.”<br />
M 4 (genèse de l’homme)<br />
“Nzambe Kana est au bord de la rivière appelée Ngobwe. A l’aide d’une<br />
calebasse, il puise l’esprit qui nageait dans l’eau comme un poisson. Il fabrique<br />
alors une statuette de glaise et se met à chanter la première de toutes les<br />
chansons. Puis il dépose l’esprit dans la statuette et souffle dessus. La statuette<br />
tousse et s’anime. C’est le premier homme. Mais cet homme s’ennuie tout seul.<br />
Au bout d’un temps indéterminé, Dieu crée alors par le même procédé la<br />
première femme. L’homme s’appelait Kombe (Soleil) et la femme Ngɔndε<br />
(Lune).” 168<br />
Mêlant inextricablement le mythe et l’histoire, le bokudu se poursuit par l’invention de<br />
la société humaine, les migrations claniques, les contacts avec les populations voisines, les<br />
guerres et l’origine des sociétés initiatiques, jusqu’aux épisodes les plus récents comme la<br />
rencontre avec les Blancs. Dans sa version la plus élaborée, le bokudu est réservé aux evɔvi,<br />
les juges-historiens coutumiers 169 . Ce savoir largement secret possède également une valeur<br />
judiciaire, puisque c’est habituellement la généalogie des lignages et l’histoire des clans qui<br />
permet de trancher les palabres. Le corpus du bokudu dépasse donc le cadre du Bwete. Seuls<br />
les evɔvi, dont la corporation relève d’une initiation supérieure au Bwete, sont en effet réputés<br />
détenir toute la tradition. Mais le povi du Disumba, l’orateur spécialiste des récits initiatiques,<br />
en connaît tout de même une portion conséquente. Dans le Misɔkɔ, cette fraction se réduit<br />
encore puisqu’il s’agit d’une branche secondaire du Bwete par rapport à la branche originelle<br />
du Disumba. Le Disumba se situe avant le Misɔkɔ, et connaît par conséquent mieux les vrais<br />
débuts de l’histoire : les mythes cosmogoniques qui mettent en scène Nzambe et le panthéon<br />
des entités religieuses comme Kombe, Ngɔndε ou Dinzona.<br />
Le corpus mythique pourrait ainsi être décrit comme une série d’emboîtements<br />
ordonnés à partir de l’ensemble maximal du bokudu. Cette systématisation demande toutefois<br />
à être nuancée. Le corpus n’est en réalité pas si articulé et hiérarchisé que cela. En vertu de<br />
ses spécificités rituelles, le Misɔkɔ comporte certains récits qui n’appartiennent pas au<br />
Disumba (par exemple le mythe d’edika). De toute façon, en raison de la place accordée à<br />
l’innovation individuelle, on dispose souvent de plusieurs variantes – parfois très différentes –<br />
d’un même récit. Et l’ordonnancement des mythes est loin d’être toujours possible.<br />
168 Résultat possible d’une importation, ces deux mythes comportent des ressemblances frappantes avec la<br />
Genèse biblique (l’eau primordiale, l’homme créé à partir du limon, la création postérieure de la femme). Dans<br />
le second récit, la rivière primordiale renvoie implicitement au sexe féminin, le rôle du souffle à l’éjaculation et à<br />
la bénédiction qui transmet un pouvoir.<br />
169 Chez les bavove et masangu, le bukulu est réservé aux hommes du Nzεgo, l’initiation suprême.<br />
-117-
O. Gollnhofer et R. Sillans notent même que la caractéristique première du bokudu est son<br />
“incohérence quasi-totale” (Gollnhofer & Sillans 1997 : 108) 170 . La logique du pouvoir prime<br />
en fait l’organisation du savoir : il importe que l’on proclame que le gevɔvi en sait plus que le<br />
povi qui en sait lui-même plus que le nganga, même si aucun d’entre eux ne dispose en réalité<br />
d’un savoir très organisé.<br />
Dans le Bwete Misɔkɔ, les récits mythiques les plus racontés concernent avant tout<br />
l’histoire des premiers initiés : comment les ancêtres ont découvert le Bwete et l’eboga,<br />
comment les différents rituels ont été inventés, d’où proviennent les fétiches. A ce sujet, le<br />
long récit des aventures d’Esinga est exemplaire.<br />
M 5 (histoire d’Esinga)<br />
“Esinga vit isolé en forêt avec ses parents. Un jour, son père meurt. La mère est<br />
vieille et Esinga doit s’occuper seul de la dépouille qu’il emmène au pied de<br />
l’arbre obaka. Chaque matin, il part visiter la tombe. Un jour, il trouve le coq de<br />
village Mabaka en train de manger les asticots sur le cadavre. C’est pourquoi le<br />
premier à avoir avalé motoba, c’est le coq ; et le premier motoba, c’est l’asticot.<br />
Une nuit, le père vient en rêve à Esinga et lui dit de retourner sur sa tombe. Il y<br />
trouve les deux chiens de chasse de son père, Bayuki et Mubengi. Grâce à eux, il<br />
chasse et peut nourrir sa vieille mère. Une autre nuit, le père revient en rêve et<br />
lui dit que sa mère va bientôt mourir et qu’il devra prélever sur son cadavre<br />
langue, sexe et crâne pour confectionner un fétiche. La mère meurt, Esinga<br />
fabrique le fétiche mongonda [fétiche majeur du Bwete].<br />
Comme Esinga est maintenant seul, il décide de partir avec ses fétiches, ses<br />
chiens et sa gibecière. C’est là où commence le mbando [série de chansons qui<br />
racontent le voyage d’Esinga] 171 . Il tue de nombreux gibiers en chemin. Il arrive<br />
enfin à une rivière qui s’appelait Ngwasa. Voyant des détritus d’arachides dans<br />
l’eau, il comprend qu’il y a des gens en amont. Il remonte jusqu’à un<br />
débarcadère où il voit une femme, appelée Manyogo, qu’il suit en cachette<br />
jusqu’au village Mitunga. Il y rencontre d’abord le frère de Manyogo, Bulipa<br />
mwana ya Paga, qui est en train de tisser le raphia. Les villageois l’accueille en<br />
lui donnant à boire.<br />
Esinga veut maintenant prendre Manyogo pour femme. La nuit venue, il sort<br />
percer le toit de la case de Manyogo avec une sagaie pour que la pluie y rentre.<br />
La femme est obligée de venir s’abriter dans sa case à lui. Ils ont finalement des<br />
rapports sexuels. Au matin, la femme part laver le sang qui a coulé de son sexe.<br />
Esinga et Manyogo décident alors de se marier. Cela entraîne des palabres avec<br />
le frère Bulipa qui avait une relation incestueuse avec sa sœur. Esinga est donc<br />
obligé d’échanger son Bwete contre la sœur de Bulipa : il initie son beau-frère au<br />
Bwete et lui donne tous les fétiches légués par ses parents.<br />
170 Ce qui, bizarrement, n’empêche pas les auteurs de faire du bokudu (auquel toute la seconde partie de leur livre<br />
est consacrée) un récit linéaire, cohérent et analytique – ce qu’ils appellent l’ethnohistoire des mitsɔgɔ.<br />
171 A un mythe correspond souvent une série de chansons qui correspond parfois elle-même à une séquence<br />
rituelle bien précise de la veillée. Mythe et rite, récitation au bwεnzε et veillée cérémonielle, sont donc dans un<br />
rapport complémentaire.<br />
-118-
Arrive le jour où Esinga, qui a déjà expliqué une bonne partie du Bwete à son<br />
beau-frère, doit lui donner edika. Mais Dibenga, la fille qu’ont eue ensemble<br />
Esinga et Manyogo, pénètre malencontreusement au beau milieu de la cérémonie<br />
secrète d’edika. Les deux hommes sont obligés de sacrifier Dibenga et de la<br />
mettre dans le paquet d’edika. La mère demande où est son enfant, mais les deux<br />
hommes ne répondent rien et la laissent pleurer. C’est là que le mwago a<br />
commencé.<br />
Un jour, Esinga quitte le village avec sa femme pour s’installer ailleurs.<br />
Malheureusement, il a donné tous ses fétiches à son beau-frère. Sa chance l’a<br />
donc quitté et il ne tue plus aucun gibier à la chasse. Déçue, sa femme décide de<br />
retourner chez son frère. Mais le village a disparu. Manyogo pleure la disparition<br />
de ses parents et de son village. C’est de là que vient le murmure rituel.”<br />
Ce récit est typique des récits initiatiques : il livre l’origine du Bwete et d’edika (mais<br />
aussi de quelques associations symboliques comme celle du motoba et de l’asticot) en<br />
l’insérant dans une narration unique se déroulant au temps indéterminé des ancêtres.<br />
Divulguer le savoir initiatique, c’est ainsi raconter l’histoire des origines de la société<br />
initiatique elle-même. Cette réflexivité du mythe est encore plus nette dans ces nombreux<br />
récits initiatiques qui relatent la diffusion du Bwete à travers le pays.<br />
M 6 (diffusion du Bwete – narrateur muvove)<br />
“Les mitsɔgɔ et les gapinzi sont les premiers à avoir pris le Bwete Disumba. Ils<br />
ont fait la première veillée au village Dibowa ya Mambudi. Mais ils se sont<br />
fatigués de danser tous les jours. Les masangu leur ont alors pris le Bwete. Au<br />
bout d’un temps, l’un d’entre eux, Mongo mwana ya Pindo, a vu que ses frères<br />
négligeaient le Bwete et le blessaient avec leurs machettes. Il est donc parti avec<br />
le Bwete chez les bavove. C’est Mbembo Bwanga qui a pris Mongo chez les<br />
masangu pour l’amener à Koulamoutou. Car dans son village, rien n’allait plus :<br />
les hommes ne tuaient plus de gibier, les femmes ne faisaient plus d’enfants.<br />
Mbembo a donné une sœur à Mongo en signe d’amitié. Mongo lui a laissé son<br />
Bwete en échange, et s’est installé au village de Mbembo jusqu’à sa mort. Avant<br />
de mourir, il a également donné le Bwete à ses neveux, Misambo, Ndomba, Diko<br />
na Ngoyi, Ngoma, Ndumu. Ceux-là aussi ont laissé de nombreux enfants. Voilà<br />
comment le Bwete est descendu ensuite chez les simba, les bakande, les myεnε,<br />
les bapunu.”<br />
Ce type classique de récits initiatiques raconte ainsi la diffusion du Bwete de personne<br />
en personne, de village en village, d’ethnie en ethnie, cheminement qui fait que le Bwete est<br />
devenu ce qu’il est aujourd’hui, avec son sabir rituel et ses diverses branches 172 . Transmettre<br />
le savoir initiatique, c’est donc raconter l’histoire de ses transmissions passées. Cette histoire<br />
réflexive est cependant moins une histoire à proprement parler qu’une géographie : le temps<br />
172 L’image des différentes routes du Bwete (nzea-a-Bwete) renvoient ainsi à sa diversité rituelle mais aussi, plus<br />
littéralement, aux chemins empruntés lors de sa diffusion.<br />
-119-
se déroule dans l’espace des migrations (collectives ou individuelles) et non dans une série de<br />
repères chronologiques. L’histoire clanique consiste en effet en la transmission de<br />
toponymes : tel clan provient de tel village qui a été fondé par telle personne, puis a migré<br />
dans un second village, etc. De même, l’histoire du Bwete consiste essentiellement en une<br />
série de noms de villages et de personnages réels ou imaginaires, acteurs et lieux qui ont<br />
marqué son cheminement à travers le pays.<br />
2. Énigmes et analogies<br />
L’enseignement initiatique consiste bien souvent à trouver à chaque chose des<br />
correspondants analogiques. Associer ainsi deux items par des rapports de similitude<br />
n’explique rien, au sens littéral du terme, et ne fait en réalité que compliquer les choses. Ces<br />
correspondances ne se font toutefois pas n’importe comment : elles obéissent à des schémas<br />
analogiques préférentiels qui indiquent à quel domaine appartient l’analogue et quel type de<br />
rapport fonde l’association. Ces schémas peu nombreux contribuent à donner au savoir<br />
initiatique son style si caractéristique.<br />
Le plus important de ces schémas consiste en mettre en rapport le corps humain et le<br />
monde, selon l’analogie classique entre microcosme et macrocosme : “tout ce qui est sur terre<br />
se retrouve dans notre corps”. Soit un item du monde extérieur trouve un correspondant dans<br />
le corps humain ; soit une partie du corps humain est l’analogue d’un item du monde<br />
extérieur. L’analogie la plus classique – l’une des premières qu’apprend le banzi – stipule<br />
ainsi que la plume de perroquet, c’est en fait la langue. Cette association repose sur la<br />
similarité de forme et de couleur entre la plume rouge et la langue, mais aussi sur la capacité<br />
du perroquet jacquot à imiter la parole humaine. Mais il existe d’innombrables autres<br />
analogies, souvent redondantes. La forêt, ce sont les cheveux. Mais les cheveux, c’est aussi<br />
bien le chasse-mouches. Les étoiles, ce sont les yeux. Mais l’œil, c’est aussi l’eau ou le<br />
miroir. La paupière, c’est une araignée. La queue de la genette, c’est le pénis. Le monde est<br />
comme un homme couché : son dos est la terre, sa face est le ciel.<br />
Ce même principe analogique fonde le symbolisme des couleurs dont les trois valeurs<br />
essentielles, comme dans toute la région de l’Afrique centrale, sont le rouge, le blanc et le<br />
noir. Ces trois couleurs sont réparties en deux paires contrastives : rouge versus blanc, blanc<br />
-120-
versus noir (mais jamais rouge versus noir). Le rouge, c’est le sang (notamment menstruel),<br />
tandis que le blanc, c’est le sperme. Le noir, c’est la peau, tandis que le blanc, c’est l’os 173 .<br />
Certaines analogies entre le corps et le monde sont plus complexes : les parties d’un<br />
tout sont associées aux parties d’un autre tout. Si le corps de garde est un nez, c’est parce que<br />
sa perspective frontale (le poteau central entre les deux parois) dessine les deux narines et<br />
l’arête du nez. Le palmier mbondokadi est une femme : les feuilles sont ses cheveux, la base<br />
du tronc est sa tête ou ses fesses, le cœur de l’arbre est son sexe, le régime de noix de palme<br />
est son sang menstruel. L’arc musical mongɔngɔ est un vieillard courbé : le bois courbe est sa<br />
colonne vertébrale, la liane est un de ses boyaux, les deux baguettes de percussion sont l’os de<br />
son tibia et celui de son avant-bras. De même, la harpe ngɔmbi est une femme : les huit cordes<br />
sont ses boyaux, la caisse de résonance est son ventre, l’ouverture de la caisse est son sexe, la<br />
hampe est sa tête. L’analogie complexe la plus classique et la plus systématique est celle du<br />
corps de garde : le mbandja représente un homme en position courbée, la tête à l’avant du<br />
corps de garde.<br />
Analogie humaine du mbandja<br />
Ces analogies sont parfois fondées sur une ressemblance physique entre les termes :<br />
les cils de la paupière ressemblent bien aux pattes de l’araignée. Parfois, la similitude n’est<br />
pas physique mais fonctionnelle : le miroir sert à la clairvoyance du nganga, comme les yeux<br />
servent à voir. Mais il arrive aussi que l’analogie passe par une ressemblance entre rapports<br />
sans qu’il n’y ait aucune ressemblance entre termes : le dos ne ressemble en rien à la terre,<br />
mais le dos est à la face ce que la terre est au ciel. De ce dernier type d’analogies se dégage<br />
ainsi le cas pur de l’association qui ne repose plus sur aucune autre motivation que le besoin<br />
173<br />
Mais on a aussi : le noir, c’est la crasse, le blanc la pureté. Ou encore : le rouge, c’est le soleil Kombe, le blanc<br />
la lune Ngɔndε.<br />
-121-
d’associer les items – véritable moteur de l’obsession interprétative des initiés. Ce schéma<br />
analogique fonctionne en effet comme un principe générateur susceptible d’engendrer une<br />
infinité de nouvelles correspondances.<br />
Les trois autres schémas analogiques obéissent au principe général du dédoublement<br />
symétrique. La première de ces oppositions est la différence sexuelle qui s’appuie ici sur la<br />
symétrie corporelle : la gauche est féminine, la droite est masculine. Les items du savoir<br />
initiatique sont ainsi communément regroupés en paires sexuellement complémentaires. Le<br />
grelot porté au pied gauche est féminin et sonne aigu, le grelot porté au pied droit est masculin<br />
et sonne grave. La grosse torche centrale itsamanga, c’est le sexe féminin. La torche manuelle<br />
mopitu, c’est le sexe masculin. L’arbre mwabi (Mimusops djave) à suc laiteux, c’est l’homme.<br />
L’arbre musuku (Scyphocephalum ochocoa) à résine rouge, c’est la femme.<br />
Le contraste du jour et de la nuit constitue un autre schéma d’opposition. Le blanc,<br />
notamment les taches claires de la livrée de la genette, c’est le jour. Le noir, notamment les<br />
taches sombres de la genette, c’est la nuit. De même, chien et civette sont associés : le premier<br />
chasse le jour, tandis que la seconde chasse la nuit. Le contraste entre village et forêt forme le<br />
dernier de ces schémas d’opposition, souvent pensé en termes de gémellité : “chaque chose au<br />
village a un jumeau en brousse”. On dit ainsi qu’il y a deux variétés d’eboga : l’une pousse au<br />
village à proximité du corps de garde ; l’autre, son jumeau, ne pousse qu’en forêt.<br />
L’opposition permet également d’associer les animaux en paires complémentaires opposant le<br />
domestique et le sauvage. Le chat, c’est la panthère du village. Le coq reste au village, mais la<br />
pintade est son équivalent en brousse. Le gorille est le double de l’homme qui est resté en<br />
brousse.<br />
Dernière forme typique des énoncés initiatiques, les énigmes d’origine sont<br />
particulièrement intéressantes car elles cumulent l’analogisme des correspondances<br />
symboliques et l’obsession de l’origine des récits mythiques. Ces énigmes initiatiques<br />
revêtent toutes la forme stéréotypée : “quel est le premier… ?”. La primauté en question dans<br />
ces énigmes ne désigne pas une antériorité temporelle factuelle, mais renvoie à la même<br />
origine mythique que celle des récits initiatiques. Les énigmes initiatiques nous projettent<br />
directement go ebando, au début et au fond des choses, pour les faire voir telles qu’elles ont<br />
été léguées par les ancêtres.<br />
“Quelle a été la première personne à boire le vin ?<br />
– C’est le colibri.”<br />
“Quelle a été la première corbeille rituelle ?<br />
-122-
– C’est le ventre.”<br />
Les réponses aux énigmes sont toujours motivées : la première personne à avoir bu le<br />
vin est le colibri, car il s’enivre du suc des fleurs ; la première corbeille est le ventre, car il est<br />
le réceptacle de tout ce qui est ingéré. C’est donc un rapport d’analogie qui unit l’énigme et sa<br />
réponse, tout comme pour les correspondances symboliques. La première énigme se<br />
comprend ainsi : (homme : vin de palme :: colibri : suc végétal :: ivresse). Dans la mesure où<br />
les fétiches sont souvent perçus comme une sorte d’aliment (les maganga-médicaments), la<br />
seconde énigme se comprend : (corbeille rituelle : fétiches :: ventre : aliments :: contenant :<br />
contenu). Dans les deux cas, il y a donc une véritable homologie de rapports plus qu’une<br />
simple ressemblance vague : A est à B, ce que C est à D. Et l’examen d’autres énigmes<br />
montrerait que c’est encore un tel rapport d’analogie qui unit le sujet de l’énigme et sa<br />
solution 174 .<br />
A examiner ensuite quels types d’entités sont en position de sujet d’énigme et quels<br />
autres en position de solution, on constate une très remarquable constance. D’un côté, les<br />
sujets des énigmes sont invariablement : soit un artefact humain, soit un comportement<br />
humain. “Quel est le premier pagne ?” ou “Quelle est la première personne qui a tressé ?”.<br />
Très souvent, il s’agit même d’une sous-classe de ces deux ensembles : soit un objet rituel,<br />
soit un comportement rituel (ayant trait au Bwete). “Quel est le premier kaolin blanc ?” ou<br />
“Quel est le premier nganga qui a dansé le mwεnge ?”. Le dénominateur commun de toutes<br />
ces classes, c’est donc l’homme en tant que homo faber et habilis. L’ensemble des sujets<br />
énigmatiques est le monde humain comme monde auto-produit, monde de comportements<br />
spécifiques. De l’autre côté, les solutions des énigmes sont invariablement : soit des animaux,<br />
soit des plantes, soit des phénomènes naturels, soit des parties du corps humain. “La première<br />
personne qui a tressé, c’est le mille-pattes” (à cause du mouvement de ses pattes). “Le<br />
premier kaolin blanc, c’est la feuille kalo” (dont l’envers est couvert d’une poudre blanche).<br />
“La première parole, c’est le vent” (parler, c’est transmettre un souffle). “Le premier pagne,<br />
ce sont les mains” (qui cachent la nudité). Le dénominateur commun est cette fois-ci la nature<br />
– l’homme n’y étant présent que sous la forme d’un corps biologique.<br />
Les énigmes stipulent ainsi que monde social et monde naturel se trouvent dans un<br />
rapport analogique. De là la relation de primauté : dans ce rapport analogique, le terme<br />
éminent auquel tout est rapporté est la nature. Le monde naturel constitue l’archétype<br />
174 Certaines énigmes ne sont cependant pas motivées par un rapport d’analogie, mais par un mythe d’origine<br />
dont elles évoquent un épisode. Ainsi, la première personne qui a mangé edika en brousse, c’est la genette<br />
mosingi, car le mythe d’origine d’edika (M 2) raconte comment une genette est venu chaparder subrepticement<br />
un peu de la viande qui cuisait dans le paquet d’edika, avant même que l’homme puisse y goûter.<br />
-123-
analogique du monde social, et en ce sens il est premier par rapport à lui. Cela vaut encore<br />
quand la solution de l’énigme est une partie du corps humain, puisqu’il s’agit toujours<br />
singulièrement d’un corps nu, non encore vêtu. C’est là tout le sens de ces énigmes<br />
paradoxales qui affirment que le premier vêtement de l’homme est sa nudité : “le premier<br />
pagne féminin, c’est la toison pubienne”. L’homme social, vêtu, n’est encore que l’analogue<br />
de l’homme naturel, nu, qui l’a précédé.<br />
L’origine évoquée dans les énigmes, c’est donc l’origine fictive d’un monde naturel et<br />
d’un homme encore à l’état de nature. Cette origine purement atemporelle est parfois projetée<br />
sur le temps de la naissance : “le premier boubou, c’est le placenta”, “la première maladie,<br />
c’est la faim du nouveau-né qui pleure après le sein maternel”, “le premier bwεnzε, c’est la<br />
plantation de bananiers derrière laquelle la femme part accoucher”. D’autres fois, elle se<br />
rapporte plutôt au temps des ancêtres : “le premier soulier, c’est une cosse [une cosse plate<br />
aux bouts recourbés en forme de babouche]” car lorsque les ancêtres sont arrivés démunis<br />
dans la grande forêt (“nos parents qui étaient encore comme des pygmées”), c’est tout ce<br />
qu’ils ont trouvé à porter.<br />
La majorité des énigmes portent spécifiquement sur la sous-classe des objets et<br />
comportements rituels plutôt que sur la classe générique du monde humain. Elles prennent<br />
alors souvent la forme : “quel est le premier nganga qui… ?”. “Le premier nganga qui a<br />
consulté, c’est le chien de chasse” (car il repère le gibier au flair comme le devin qui hume le<br />
malade). “Le premier nganga qui est sorti danser en dibadi, c’est la luciole” (car elle brille<br />
dans l’obscurité comme la torche de l’initié qui sort danser dans la nuit). Ce type<br />
d’associations indique que si le monde humain dans son ensemble trouve son gabarit<br />
analogique dans la nature, le monde initiatique du Bwete y est encore plus étroitement associé.<br />
Les objets et les comportements rituels sont analogiquement plus proches du monde naturel<br />
que le reste de la sphère humaine. Et tout le Bwete peut effectivement être interprété comme<br />
une tentative rituelle de retourner à l’origine – ce qui signifie retour à la nature, retour à la<br />
naissance et retour aux ancêtres.<br />
En définitive, trois types d’énoncés proférés au bwεnzε apparaissent caractéristiques<br />
du savoir initiatique en raison de leur saillance formelle : les mythes, les correspondances<br />
symboliques et les énigmes d’origine. Les premiers mettent en scène le thème de l’origine et<br />
illustrent que le Bwete est un legs immémorial des ancêtres qui se continue dans le présent.<br />
Les secondes reposent sur l’analogisme. Les dernières allient efficacement obsession de<br />
l’origine et analogisme naturel.<br />
-124-
Correspondances et énigmes mobilisent des procédés analogiques fort simples. D’une<br />
part, l’analogie entre corps et monde ainsi que celle entre monde naturel et monde social<br />
permettent de faire se correspondre les items. D’autre part, des couples contrastifs de<br />
référence (le masculin et le féminin, le jour et la nuit, le village et la brousse) permettent de<br />
les associer en paires complémentaires. Ces procédés élémentaires constituent de véritables<br />
schèmes générateurs permettant d’engendrer une infinité de rapports possibles entre les items<br />
du savoir initiatique, c’est-à-dire en fait entre n’importe quels items du monde.<br />
Cette générativité prend un tour particulier avec les énigmes d’origine : le monde<br />
naturel est érigé en origine analogique du monde social, et plus encore du monde initiatique.<br />
Les initiés brodant toujours autour des mêmes thèmes, on arrive cependant rapidement à une<br />
situation paradoxale : il n’est pas rare qu’une même énigme puisse recevoir plusieurs<br />
réponses. Il y a alors plusieurs candidats à l’origine : “tu vas toujours plus t’enfoncer dans les<br />
profondeurs et cela ne s’arrêtera jamais. On dit la première personne qui avait mangé edika,<br />
c’est le chien. Mais, il y a une première personne en dehors du chien : une fourmi qui ne dort<br />
jamais. Et peut-être que là en bas, il y a encore une autre personne qui avait mangé edika<br />
avant. S’il y a un vieux qui me dit, voilà, en dehors de la fourmi, il y avait encore un autre,<br />
c’est important pour moi”. Par le biais de cette multiplication virtuellement indéfinie des<br />
candidats à la primauté, la divulgation de l’origine est sans cesse reculée. La générativité<br />
analogique devient alors le moteur principal d’un savoir initiatique inachevable et ambivalent.<br />
Ces énoncés initiatiques caractéristiques n’ont en définitive pas d’autre fonction que<br />
d’enfermer les initiés dans un type singulier de discours, discours analogique auto-référentiel<br />
qui porte en lui-même les raisons de son propre inachèvement.<br />
-125-
TROISIEME PARTIE<br />
NYIMA<br />
-126-
1. Le cycle de la vie et de la mort<br />
Chapitre VIII<br />
La scène des ancêtres : lignage et relations initiatiques<br />
Les riches exégèses du bwεnzε permettent d’identifier les principales images focales<br />
autour desquelles s’organise une veillée de Bwete. L’action rituelle évoque avant tout le cycle<br />
de la vie et de la mort. Ce thème est d’une grande banalité, mais le rituel ne dit de toute façon<br />
rien à ce sujet qui ne fasse déjà partie de l’entendement profane : il faut deux sexes pour<br />
procréer, la femme met au monde, l’humain est mortel, les ancêtres interviennent dans le<br />
monde des vivants, la vie et la mort forment un cercle. Si une veillée de Bwete ne constitue<br />
donc pas un discours très original sur la reproduction, elle permet cependant aux initiés de<br />
rejouer sur la scène rituelle l’ensemble des relations fondamentales qui les inscrivent dans<br />
l’espace lignager des vivants et des morts. Comme nous allons le voir, la condensation rituelle<br />
des thèmes liés au cycle de l’existence souligne ainsi l’importance de relation au lignage et<br />
tout particulièrement aux ancêtres dans la construction du sujet initiatique.<br />
De nombreuses séquences rituelles de la veillée évoquent l’acte sexuel procréateur<br />
(figuration secrète car généralement non-mimétique). C’est notamment vrai de la danse des<br />
trois premiers nganga (juste après la rentrée du Bwete). Les nganga tiennent le rôle de<br />
l’homme viril. La torche mopitu qu’ils brandissent représente le pénis en érection (de même la<br />
queue de la genette mosingi qui pend entre leurs jambes). La grosse torche itsamanga posée<br />
au sol représente le sexe féminin ouvert (les braises l’intérieur de la vulve, la fumée les poils<br />
pubiens). L’épouse du nganga commence par allumer le mopitu dans itsamanga, geste qui<br />
symbolise la pénétration. Le nganga danse ensuite frénétiquement devant itsamanga,<br />
brandissant et secouant violemment le mopitu, danse qui représente le coït. Il interrompt sa<br />
danse par un salut abrupt qui représente l’éjaculation. Son essoufflement correspond à la<br />
fécondation : l’insémination du sperme est l’insufflation d’un esprit. Il rend ensuite le mopitu<br />
à son épouse qui l’éteint aussitôt avec un rameau, geste qui représente la femme essuyant le<br />
sexe de son mari. La danse en binôme des mabundi (au cours de laquelle deux d’entre elles<br />
font le tour de l’assemblée et marquent au kaolin rouge spectateurs et initiés, tout en tenant au<br />
creux de leur bras une torche allumée) figure également un rapport sexuel. La torche<br />
représente encore le pénis en érection, tandis que le kaolin rouge symbolise comme toujours<br />
-127-
le sang menstruel. Et toutes les séquences qui associent kaolin blanc pεmba (sperme) et kaolin<br />
rouge tsingo (sang menstruel) opèrent de même la conjonction procréatrice des deux sexes.<br />
Une veillée rituelle évoque également l’accouchement et la naissance. Les appels de la<br />
corne getsika tout au long de la cérémonie annoncent la rupture de la poche des eaux et la<br />
naissance imminente d’un enfant. La séquence du soupir rituel évoque les plaintes<br />
douloureuses de la parturiente ou son soupir de soulagement après la délivrance. Si la braise<br />
de la torche itsamanga représente le sexe féminin, les flammes et la fumée figurent aussi la<br />
tête de l’enfant en train de naître. La plupart des significations rituelles associées aux mabundi<br />
connotent la naissance de jumeaux, comble de la fécondité. Orientation du corps de garde et<br />
déplacements des initiés s’organisent autour de l’articulation entre rapport sexuel et naissance.<br />
Un initié doit toujours rentrer par la droite, côté masculin du mbandja, pour ressortir par la<br />
gauche, côté féminin. La rentrée est ainsi associée à la pénétration masculine, tandis que la<br />
sortie figure l’accouchement féminin (l’initié occupant alors la place du nouveau-né). De<br />
même, un nganga doit vêtir sa peau de mosingi du bas vers le haut, de la queue vers la tête –<br />
geste qui représente une pénétration. Mais, au terme de la veillée, il doit l’enlever en<br />
procédant inversement du haut vers le bas – geste qui représente la naissance, comme si le<br />
nganga accouchait 175 .<br />
Mais la veillée évoque tout autant l’autre extrémité de l’existence : l’agonie, la mort et<br />
les rites funéraires. Le geliba (espace des nattes où sont disposés corbeilles et autres objets<br />
rituels) figure le cadavre d’un parent que les initiés sont en train de pleurer. Les bougies<br />
allumées sur son pourtour sont des chandelles mortuaires. Les chasse-mouches et les rameaux<br />
constamment agités par les initiés servent à disperser les mouches et l’odeur du cadavre en<br />
décomposition 176 . Les mabundi sont vêtues du traditionnel pagne noir de deuil ebundi (plur.<br />
mabundi) d’où elles tirent justement leur nom. Les invocations, avec leurs modulations<br />
parlées-chantées, expriment les lamentations de parents endeuillés. La séquence masculine du<br />
bain (mososo) représente la toilette mortuaire du cadavre. Et si la danse des trois premiers<br />
nganga figure le coït, elle évoque également l’enterrement. Lorsque les trois nganga sortent<br />
l’un après l’autre du corps de garde pour aller jusqu’au bwεnzε avant de revenir danser, ils<br />
vont en réalité enterrer le cadavre. Le bwεnzε est en effet associé au cimetière<br />
175 Les initiés masculins endossent ainsi parfois eux-mêmes les rôles féminins sur la scène rituelle. Le pagne de<br />
raphia qu’ils portent en couche-culotte est d’ailleurs secrètement associé aux garnitures menstruelles des<br />
femmes. Et il arrive qu’ils arborent également des perruques féminines.<br />
176 Traditionnellement, on veille un mort plusieurs jours avant de l’enterrer. Autrefois, on laissait même le<br />
cadavre d’un notable pourrir toute une semaine au corps de garde.<br />
-128-
(traditionnellement un simple site en forêt, tout comme le bwεnzε). Le premier nganga va<br />
creuser la tombe, le second va y mettre le corps, le dernier va reboucher le trou 177 .<br />
De leur danse jusqu’au bwεnzε, les trois nganga ramènent un esprit mokuku, c’est-à-<br />
dire un ancêtre. Cette articulation entre enterrement et ancêtres condense dans une seule<br />
séquence rituelle le long processus des rites funéraires ordinaires dont la fonction est<br />
justement de transformer un mort en un ancêtre. Le dernier souffle du mourant expulse son<br />
esprit dans un mouvement tourbillonnant. Mais cet esprit restera attaché à son village tant que<br />
les rites funéraires n’auront pas opéré son départ définitif. Dès l’annonce du décès, les parents<br />
se réunissent pour pleurer autour du cadavre. Ils doivent alors dormir à terre pendant un à<br />
deux mois, demeurant ainsi auprès de l’esprit du défunt. Au bout de ce délai, la cérémonie<br />
dite de levée de terre leur permet de ne plus dormir au sol, première phase du détachement du<br />
mort du monde des vivants. Commence alors la période du port de deuil (kebo en getsɔgɔ),<br />
marquée par l’abstinence sexuelle, barbe et tenue négligée pour les hommes, tresses dites<br />
“civils” et pagne noir ebundi pour les femmes. Environ un an après (autrefois deux ans), la<br />
cérémonie de retrait de deuil (gebenda) permet aux parents de quitter leur tenue de deuil avant<br />
un bain purificateur. La veuve doit normalement avoir avec un rapport sexuel unique avec un<br />
étranger, afin de se débarrasser définitivement de la souillure du décès. Le retrait de deuil<br />
marque la coupure définitive entre les vivants et le défunt dont l’esprit quitte le village pour<br />
partir en brousse, dans l’eau ou au ciel (selon les opinions diverses). Le mort est alors devenu<br />
ancêtre.<br />
C’est ce processus d’ancestralisation des rites funéraires que le Bwete condense dans<br />
l’action rituelle : partir enterrer un mort, revenir avec un ancêtre. Une veillée de Bwete est<br />
ainsi une invite lancée aux ancêtres pour qu’ils viennent seconder les vivants. Les appels de la<br />
corne getsika sont des appels aux aïeux. C’est pourquoi ils s’intensifient au moment du<br />
mwago, la longue invocation des ancêtres dans laquelle abondent des formules telles que<br />
“yagagayi !” (“venez !”) ou “kɔkɔ dyano, ngongo dyano” (demande d’intercession) 178 . Les<br />
ancêtres invoqués par les initiés dépassent largement les seuls ascendants défunts du lignage.<br />
L’orateur du mwago invoque des aïeux proches (grands-parents, oncles, etc.), mais aussi toute<br />
une série d’ancêtres initiatiques où se mêlent les pères initiateurs du père initiateur de la<br />
communauté locale, les fondateurs légendaires du Bwete, les ethnies ou clans réputés dans les<br />
affaires initiatiques, le panthéon du Disumba (Nzambe Kana, le soleil Kombe, la lune Ngɔndε,<br />
177<br />
Leur danse s’appelle d’ailleurs mwεnge. Or, dans le Disumba, Bwete-a-mwεnge désigne justement le Bwete<br />
de deuil, organisé lors du décès puis du retrait de deuil d’un initié.<br />
178<br />
Mwago dérive d’ailleurs du terme eago qui désigne les offrandes faites aux ancêtres (dilago en yipunu et<br />
yisangu).<br />
-129-
la foudre Ngadi, les étoiles Minanga), des animaux (genette, panthère, perroquet), des arbres<br />
ou des ritualia (l’arc musical mongɔngɔ, la harpe ngɔmbi, les fétiches). La famille du Bwete<br />
(kinda-a-Bwete) repose ainsi sur une ancestralité plus initiatique que lignagère.<br />
Après l’appel du mwago, les initiés partent chercher les ancêtres pour les ramener au<br />
corps de garde. C’est le rôle de la séquence de la rentrée du Bwete (que répèteront ensuite<br />
individuellement les trois premiers nganga) : tous les initiés se rendent au bwεnzε puis<br />
rentrent en file indienne au corps de garde en chantant et dansant, désormais accompagnés par<br />
les mikuku et le Bwete qui ne sont rien d’autre que les ancêtres. Grâce aux rites funéraires, les<br />
esprits des défunts quittent le village (mboka) pour partir en forêt (pindi) où se situe le<br />
cimetière (pεsi) 179 . Les initiés leur font alors faire le chemin inverse en les ramenant du<br />
bwεnzε au mbandja. Il est notable que lors de cette séquence d’entrée des mikuku, seuls les<br />
humains rentrent au mbandja, rien n’indiquant matériellement la présence des esprits. Il y a<br />
pourtant un changement majeur par rapport aux séquences précédentes : les initiés sont<br />
désormais maquillés et parés de peaux, feuilles, raphia, coquillages et grelots. Les initiés en<br />
habit sont donc eux-mêmes les mikuku – ce que tous les témoignages confirment. Grâce à son<br />
maquillage et son lourd accoutrement qui le rendent méconnaissable, l’initié se transforme<br />
lui-même en mokuku.<br />
Le rapport des initiés aux mikuku dessine ainsi une relation complexe. En un sens, les<br />
mikuku désignent le collectif indifférencié des ancêtres, à la fois lignagers et initiatiques. En<br />
un autre sens, chaque aîné initiatique possède un esprit mokuku, sorte d’allié tutélaire parfois<br />
affublé d’un nom propre : il dira ainsi que “son” mokuku est assis à ses côtés pendant une<br />
veillée. Et, à travers son accoutrement rituel, il s’identifie lui-même à cet esprit ancestral.<br />
Cette relation privilégiée au mokuku passe également par une relation périphérique à l’animal.<br />
Le mokuku possède en effet toujours une forme animale. Et le maquillage des aînés, fait de<br />
mouchetures et de zébrures, en figure la livrée. Il s’agit le plus souvent d’une panthère,<br />
genette ou civette, c’est-à-dire toujours un mammifère carnivore réputé bon chasseur. Cette<br />
identification animale est en effet en rapport avec la pratique cynégétique. Selon les initiés, si<br />
le Bwete est venu à l’origine pour prendre soin des enfants, il est également venu pour le<br />
gibier. Les grandes chasses collectives exigeaient autrefois l’intervention d’un nganga<br />
spécialisé, chargé des augures, prières et sacrifices aux ancêtres. Et il y a aujourd’hui encore<br />
un lien manifeste entre Bwete et chasse – lien qui apparaît, par exemple, dans la présence<br />
dominante du thème cynégétique dans les invocations buluma. Le mokuku animal est donc<br />
179<br />
Cette association explique que les mikuku puissent aussi être des esprits sylvestres (mikuku mya go pindi – de<br />
pindi qui signifie forêt).<br />
-130-
comme un auxiliaire de chasse qui piste le gibier pour son maître. Et pendant une veillée,<br />
c’est l’initié lui-même qui se grime comme son animal auxiliaire.<br />
Cette identification animale se double encore d’une relation au pygmée. Le pygmée<br />
(mobɔngɔ) fait pourtant l’objet d’une forte stigmatisation sociale : selon les préjugés<br />
populaires, c’est un être sale, incorrigiblement nomade, inapte à l’agriculture, n’obéissant<br />
qu’aux brimades (Cheyssial 2000). Cette stigmatisation a toutefois pour contrepartie une<br />
survalorisation rituelle. Dans tous les récits de migration, le pygmée fut le guide à qui les<br />
populations bantu – venues des savanes – durent leur survie dans l’hostilité de la grande forêt.<br />
Si le pygmée représente l’état le plus sauvage de l’humanité (aux marges de l’animalité, il est<br />
souvent comparé au chimpanzé), il est du même tenant le médiateur indispensable dans le<br />
rapport à la forêt. Au Gabon, les bantu ont réussi à partiellement sédentariser aux abords de<br />
leurs villages des communautés pygmées avec lesquelles ils entretiennent des relations sur la<br />
base d’un échange des produits de la chasse et de la collecte (notamment du miel) contre ceux<br />
de l’agriculture et de l’artisanat. Les pygmées sont réputés leur avoir dévoilé les secrets des<br />
plantes médicinales, au premier chef l’eboga 180 . Ce prestige est nettement souligné dans le<br />
rituel du Misɔkɔ : parés de feuilles et maquillés en animal, les initiés se transforment en êtres<br />
de la forêt qui sont des pygmées fantasmés. Le pygmée joue ainsi le rôle d’une sorte d’archiancêtre<br />
symbolique (échappant à la logique lignagère) qui connaît les secrets de la forêt et<br />
constitue un modèle pour le chasseur et le guérisseur. Il permet un retour fantasmatique à<br />
l’origine et une appropriation rituelle du monde sauvage de la forêt.<br />
La présence des mikuku pendant les veillées souligne ainsi la relation privilégiée des<br />
initiés aux ancêtres, ainsi qu’au monde de la forêt (à travers l’animal et le pygmée). Après la<br />
séquence de la rentrée des mikuku, les initiés entonnent une chanson de bienvenue (“samba o<br />
samba”, “salut, ô salut”) qui s’adresse alors autant aux ancêtres assis parmi eux qu’à<br />
l’assemblée des vivants. Les mikuku s’assoient préférentiellement au fond du mbandja, à côté<br />
des aînés et du père initiateur. C’est pour cela que le poteau de soutènement arrière du corps<br />
de garde est associé au grand-père 181 . En effet, le grand-père (kɔkɔ) est celui sur qui l’enfant<br />
peut s’appuyer en toute confiance : grands-parents et petits-enfants entretiennent une relation<br />
privilégiée d’affection et de plaisanterie. Lors du décès du grand-père, c’est un petit-fils qui<br />
est chargé de porter le cadavre et qui doit moquer le mort en jouant le rôle d’une sorte de<br />
bouffon. Et l’héritage spirituel passe souvent directement au petit-fils. Le grand-père est ainsi<br />
180 C’est sans doute pour cette raison que le pygmée joue un rôle plus important dans le Misɔkɔ (où la<br />
pharmacopée végétale est au premier plan) que dans le Disumba (qui repose davantage sur l’identité du groupe).<br />
181 Le poteau mitan qui oriente le corps de garde figure quant à lui le père (tεta) ou l’oncle maternel (katsi). Les<br />
piliers de soutènement du mbandja représentent ainsi les trois pôles masculins du lignage.<br />
-131-
le représentant le plus proche des ancêtres, identification manifeste dans la terminologie. A<br />
partir de la génération G+3 par rapport à ego, les parents ne sont en effet pas marqués par un<br />
terme spécifique : le terme kɔkɔ sert alors encore à désigner les aïeux des générations<br />
supérieures (les ancêtres les plus éloignés étant appelés kɔkɔgɔ). Le grand-père représente en<br />
définitive la figure idéale d’un ancêtre bienveillant.<br />
Mbandja : procréation & parenté<br />
Toute la veillée est ainsi polarisée autour des ancêtres. C’est même en réalité pour eux<br />
que la cérémonie se tient : il s’agit de réjouir les mikuku par une exécution scrupuleuse du<br />
rituel. Au matin, les ancêtres doivent pouvoir repartir en brousse contents du spectacle auquel<br />
ils ont assisté et participé. Il y a ainsi quelque chose du culte des ancêtres dans le Bwete,<br />
rapprochement plus marqué dans le Disumba mais tout de même manifeste dans le Misɔkɔ. Le<br />
culte traditionnel des ancêtres, appelé maombe chez les mitsɔgɔ (malombe en geviya, bilumbi<br />
en yisangu, balumbi en yipunu), se réduit aujourd’hui à quelques pratiques discrètes comme<br />
libations et offrandes (eago) effectuées en privé par le chef de famille, notamment en cas<br />
d’infortune. Le Bwete a ainsi repris un certain nombre de traits de ce culte familial dans un<br />
rituel plus complexe qui dépasse le cadre lignager.<br />
Il est d’ailleurs notable que dans le groupe kota (B20 dans la classification Guthrie),<br />
au nord-est du Gabon (provinces de l’Ogooué-Ivindo et du Haut-Ogooué), le culte lignager ou<br />
clanique des reliques d’ancêtres s’appelait justement Bwete 182 . Cette homonymie n’est sous-<br />
tendue par aucun récit de transmission du Bwete du groupe tsogo vers le groupe kota (ni<br />
inversement) 183 . Et le Bwete kota n’a jamais possédé l’appareil rituel sophistiqué du Disumba.<br />
182 e<br />
Ce culte est aujourd’hui éteint, la disparition remontant sans doute à la première moitié du XX siècle (Perrois<br />
1969, Andersson 1953, Mabaza 1999).<br />
183<br />
Mais les récits des migrations du groupe tsogo (axe nord-est sud-ouest passant par l’Ivindo avant de rejoindre<br />
l’Ogooué puis la Ngounié) mentionnent une lointaine rencontre avec le groupe kota, et donc de possibles<br />
transferts culturels.<br />
-132-
Lors de cérémonies publiques, le chef de lignage sort les paniers qui contiennent les<br />
ossements des ancêtres et dresse la généalogie du lignage en nommant les reliques 184 . Les<br />
offrandes (volailles et bananes pilées) ont lieu dans une pièce privée au fond de la case<br />
familiale, sans autre forme de rituel. En cela, le Bwete kota se rapproche du Byeri, le culte<br />
familial des ancêtres chez les fang. Il ne repose cependant sur aucune initiation visionnaire,<br />
contrairement au Byeri qui faisait un usage initiatique de l’arbuste hallucinogène alan<br />
(Alchornea floribunda), finalement assez proche de l’emploi de l’eboga dans le Bwete du<br />
centre Gabon.<br />
2. L’englobement des ancêtres<br />
Ces articulations rituelles entre sexualité et naissance et entre deuil et ancêtres se<br />
trouvent elles-mêmes prises dans une relation circulaire plus large entre procréation et mort.<br />
Par le jeu des déplacements des initiés (à l’intérieur du mbandja, entre mbandja et bwεnzε) et<br />
de la condensation symbolique (une même séquence figurant plusieurs choses à la fois), la<br />
chorégraphie rituelle met en relation les moments opposés du cycle de l’existence. La division<br />
sexuelle du mbandja se double ainsi d’une seconde orientation : la droite est associée à la vie,<br />
la gauche à la mort. Si bien que les entrées et sorties des initiés évoquent le mouvement<br />
complémentaire de la naissance et du trépas. Des condensations paradoxales marquent<br />
clairement cette circularité au principe de l’existence : le cordon ombilical du nouveau-né<br />
représente en fait la corde qui servira plus tard à le descendre dans sa tombe. Et la liane<br />
tressée qui sert à transporter le paquet d’edika possède effectivement les deux significations.<br />
Inversement, partir dans la tombe, c’est retourner dans le sexe maternel. Le schème de la<br />
“naissance à l’envers”, dont A. Mary (1983b) a dégagé le rôle structurant dans le rituel du<br />
Bwiti fang, reste prégnant plus au sud 185 . L’initiation est une mort temporaire qui consacre une<br />
renaissance du banzi : dans le bain rituel mososo du Disumba, le banzi doit d’ailleurs plonger<br />
vers l’amont et passer au travers d’un losange de branchages représentant le sexe maternel. Et<br />
derrière le geliba, les initiés du Misɔkɔ pleurent un cadavre, mais attendent également une<br />
naissance imminente.<br />
184 Les reliquaires du groupe kota sont surmontés de statuettes anthropomorphes, en bois serti de fils de cuivre,<br />
figures fameuses des musées occidentaux, au style abstrait très différent des statuettes fang ou du centre et sud<br />
Gabon qui sont plus réalistes.<br />
185 L’auteur souligne l’“ambivalence permanente des schèmes rituels utilisés qui favorise le recouvrement des<br />
thèmes de la naissance et de la mort” (Mary 1983b : 68-69).<br />
-133-
La circularité de l’existence<br />
Cette condensation circulaire entre naissance et mort passe par la médiation nécessaire<br />
des ancêtres. Si les appels de la corne getsika sont simultanément des appels aux ancêtres et<br />
l’annonce d’un accouchement, c’est en effet parce que celui qui va naître, c’est l’ancêtre lui-<br />
même. Selon une image récurrente dans de nombreux chants, une veillée de Bwete est un<br />
voyage en pirogue dans l’étendue profonde du geliba. Or, l’eau du geliba évoque à la fois<br />
l’habitat des ancêtres mikuku (l’espace des corbeilles et fétiches dans une veillée), la fécondité<br />
féminine (la qualité fondamentale du vagin est son humidité) et la rivière de la genèse<br />
mythique de l’homme (d’où Nzambe a prélevé le premier esprit-embryon). Le voyage en<br />
pirogue au pays des ancêtres est donc en réalité une procréation 186 . Les esprits ancestraux sont<br />
d’ailleurs supposés résider dans les cours d’eau, dont chaque tronçon est ordinairement<br />
associé à un clan (le premier clan arrivé). Toute personne qui passe aux abords d’une rivière<br />
appartenant à son clan maternel ou paternel doit ainsi y jeter une offrande en l’honneur des<br />
esprits qui y demeurent. Et la femme enceinte qui va puiser l’eau à la rivière ramène avec elle<br />
l’esprit-embryon de l’enfant à naître. Brodant sur ce même thème, un mythe initiatique<br />
raconte comment la navette incessante de l’araignée Dibobe assure la rotation indéfinie des<br />
esprits entre les vivants et les morts. Lorsque l’esprit d’un mourant s’échappe dans un dernier<br />
souffle, l’araignée descend du ciel le long de son fil et vient le recueillir pour le ramener au<br />
village des ancêtres. Elle redescend ensuite déposer cet esprit qui est re-insufflé dans le ventre<br />
d’une femme lors de l’éjaculation.<br />
Ce thème de la réincarnation des ancêtres est récurrent, tant dans le rituel du Bwete<br />
que dans les conceptions communes de la procréation. Il ne s’agit donc pas d’un mystère<br />
ésotérique entretenu par les seuls initiés. Toute naissance est la réincarnation générique d’un<br />
ancêtre. Il serait pourtant incongru de dire que tel nouveau-né est la réincarnation de tel<br />
ancêtre singulier. L’identité personnelle est en effet un agrégat de composants (substances<br />
corporelles, noms, caractères, traits physiques, pouvoirs “mystiques”) hérités d’ascendants<br />
variés. Pour prendre l’exemple de l’anthroponymie, le nom est hérité d’un ascendant (défunt<br />
ou non). L’homonymie instaure alors une relation privilégiée : la personne gagne les relations<br />
186<br />
D’autant que la pirogue figure aussi par sa forme le sexe féminin, et la pagaie le pénis. Pagayer, c’est donc<br />
avoir un rapport sexuel.<br />
-134-
de parenté de son homonyme – des tiers s’adressant souvent au premier en employant le<br />
terme de parenté réservé au second. Le choix d’un nom fait l’objet d’une transaction entre le<br />
père (patrilignage) et l’oncle (matrilignage) 187 . La mère peut également intervenir, recevant<br />
des messages oniriques de l’enfant pendant la grossesse. Mais un individu possède<br />
communément plusieurs noms, sans compter les kombo (noms-devises sociaux ou<br />
initiatiques) dont il hérite. L’anthroponymie prouve ainsi que le thème de la réincarnation<br />
cache une réactualisation complexe et plurielle des multiples lignages dont un individu<br />
provient. Le nouveau-né n’est donc pas un ancêtre, mais sans les ancêtres, il n’est rien.<br />
La mobilisation des ancêtres dans le Bwete a ainsi pour visée première de favoriser les<br />
naissances et d’assurer la reproduction lignagère : “jusqu’à la fin de la vie, dans notre famille,<br />
on va bien accoucher. C’est ce qu’on dit dans les prières”. Les initiés soulignent avec<br />
insistance que le Bwete est d’abord venu pour les enfants, bien avant que le Misɔkɔ ne se<br />
concentre sur les soins des afflictions sorcellaires 188 . Le travail rituel d’une veillé de Bwete<br />
consiste en définitive à insérer les différents moments du cycle de l’existence dans une<br />
relation de circularité systématique par l’entremise des ancêtres mikuku. La relation aux<br />
ancêtres subordonne ainsi les multiples relations au principe de la reproduction lignagère.<br />
C’est en fait l’identité ambigüe du Bwete lui-même qui est en jeu ici. Lors de<br />
l’initiation visionnaire, le Bwete était apparu comme une entité au statut incertain et à la voix<br />
flottante. Le terme “bwete” reste ainsi incomplètement déterminé d’un point de vue<br />
sémantique, y compris pour les initiés. Radicalisant cette indétermination sémantique, les<br />
initiés en ont même fait un motif à plaisanteries : dans leurs conversations quotidiennes, un<br />
bwete n’est souvent rien d’autre qu’un “truc”, terme qui ne signifiant rien de précis est apte à<br />
tout signifier 189 . L’un dira “donne-moi le bwete-là” pour qu’on lui fasse passer un objet. Un<br />
autre déclarera “je dois faire un bwete” pour désigner une activité quelconque. Plus<br />
sérieusement, le terme “bwete” garde dans le rituel cette valeur de signifiant flottant qui peut<br />
venir occuper toutes les places. Les initiés affirment en effet que le Bwete se présente sous de<br />
nombreuses formes et ne cesse de se métamorphoser. Ainsi, au gré de diverses interprétations<br />
explicites, le Bwete, c’est l’ancêtre, le nouveau-né, le cadavre, la mère, l’épouse, l’homme,<br />
l’oncle, le grand-père, le pygmée, c’est soi-même et c’est tout le monde.<br />
Le Bwete apparaît ainsi comme un personnage flottant qui, tel un trickster, défie les<br />
catégorisations établies en les englobant toutes. Passant par toutes les places du cycle de la<br />
187<br />
Les noms de jumeaux forment une classe à part, répertoire fixe de termes appariés.<br />
188<br />
Maux sorcellaires dont les symptômes majoritaires sont de toute façon encore des problèmes d’infécondité, du<br />
moins pour les femmes (la stérilité étant supposément toujours féminine).<br />
189<br />
Ces détournements ludiques rappellent ainsi la conception lévi-straussienne du mana mélanésien (Lévi-<br />
Strauss 1950).<br />
-135-
eproduction lignagère, il se trouve finalement en surplomb, incarnant le processus dans son<br />
ensemble plutôt que l’un de ses protagonistes. Dans la mesure où il peut désigner n’importe<br />
lequel d’entre eux, le Bwete ne constitue donc pas véritablement lui-même l’un des termes des<br />
relations initiatiques, mais plutôt le principe d’enchaînement de toutes les relations. Ce<br />
principe organisateur repose sur un mouvement d’englobement hiérarchique qui subordonne<br />
toutes les relations à une relation d’ordre supérieur : la relation initiatique aux ancêtres<br />
mikuku 190 . Cet englobement est matérialisé par l’englobement des initiés à l’intérieur du<br />
mbandja qui figure, selon les exégèses, un corps humain ou un éléphant, c’est-à-dire en fait le<br />
corps du Bwete lui-même.<br />
En définitive, une veillée de Bwete Misɔkɔ s’organise principalement autour du rôle<br />
fécondant des ancêtres dans la reproduction lignagère 191 . Les condensations systématiques<br />
opérées par le travail du rituel opèrent la réintégration de toutes les relations dans le corps<br />
englobant de l’ancêtre. Dans un contexte d’infortune sorcellaire qui renvoie à un trouble au<br />
sein de la parentèle, ce mouvement permet de connecter les initiés avec une totalité lignagère<br />
idéalement régénérée dans le rituel. Renouer le lien ombilical aux ancêtres est en effet<br />
d’autant plus important que les histoires d’infortune parlent toujours de parents morts trop tôt,<br />
de fantômes et d’héritages en suspens. La transposition de la parenté lignagère dans une<br />
parenté initiatique surplombée par les ancêtres mikuku et le Bwete substitue cependant au<br />
lignage d’origine une communauté recomposée : le Bwete donne ainsi aux initiés la possibilité<br />
de changer de niveau de relations 192 . Il n’est toutefois pas rare qu’il y ait un point<br />
d’intersection entre parenté initiatique et parenté lignagère, que le père initiateur se trouve être<br />
un père, un mari, un oncle, un beau-frère, un grand-père ou même un parent clanique. La<br />
parenté initiatique est donc moins une parenté “fictive” totalement disjointe qu’une<br />
reconfiguration complexe et variable de la parenté “réelle” préexistante.<br />
Selon l’interprétation magistrale qu’en donne J. Fernandez (1982), l’adoption du Bwiti<br />
par les fang au début du XX e siècle a permis le renouveau d’une identité collective ébranlée<br />
par les transformations brutales subies par une société alors aux prises avec la colonisation<br />
française. Mettant systématiquement en relation une série d’oppositions (mort-vie, hommefemme,<br />
aîné-cadet, etc.), le Bwiti opère une résolution dialectique des contraires qui engendre<br />
190 La classe des ancêtres lignagers étant déjà englobée dans celle des ancêtres initiatiques.<br />
191 La relation au monde sauvage de la forêt (par l’entremise de l’animal auxiliaire et du pygmée) constitue une<br />
seconde ligne d’organisation du rituel, notamment autour de sa fonction cynégétique : “le Bwete venu pour la<br />
chasse”. Son caractère secondaire est marqué par la subordination de la petite invocation buluma (à thématique<br />
cynégétique) à la grande invocation mwago (centrée sur les ancêtres).<br />
192 Ce que J. Fernandez a bien noté dans le Bwiti fang : “[Bwiti] offers, to those who felt themselves ntôbot [sans<br />
famille], the centered corporate feeling of belonging to the Bwiti kin group.” (1982 : 98).<br />
-136-
un puissant sentiment de communion (“oneheartedness”, nlem mvôre en fang), communitas<br />
dans laquelle l’auteur voit la meilleure expression de la revivification de l’identité<br />
collective 193 . Cette circularité rédemptrice (“saving circularity”) permet de réconcilier toutes<br />
les différences au profit de la communion à l’intérieur de cet “equatorial pleasure dome”<br />
qu’est le temple du Bwiti, microcosme harmonieux qui tente de compenser les tensions<br />
cardinales de la société fang. La réaffirmation du lien ombilical avec les ancêtres, reliant le<br />
présent au passé, est alors une dimension essentielle de cette réintégration des initiés dans la<br />
totalité harmonieuse de la communitas rituelle (“return to the whole”).<br />
Chez les fang, le Bwiti célèbrerait ainsi l’unanimité, alors que le mvet (corporation des<br />
joueurs de harpe-cithare) exalterait plutôt la compétition au sein du groupe masculin (1982 :<br />
63-64). Comme nous l’avons vu, le Bwete Misɔkɔ passe lui aussi par une mise en relation<br />
systématique des contraires par l’entremise des ancêtres. La condensation de l’action rituelle<br />
permet d’opérer une réintégration des initiés dans le corps englobant du Bwete. Le sentiment<br />
de solidarité qui en découle est notable pendant la séquence de la “rentrée du Bwete”, climax<br />
de la veillée où le groupe compact des initiés dansant à l’unisson semble se fondre dans une<br />
totalité unifiée qui inclut également les ancêtres mikuku 194 . Cette solidarité rituelle est pourtant<br />
directement contrebalancée par l’expression de la rivalité entre initiés de même rang,<br />
notamment au cours des danses individuelles. Et nous verrons au chapitre IX comment la<br />
relation ambivalente qui oppose et rapproche tout à la fois nganga et sorciers renforce encore<br />
cette dimension agonistique au sein du Bwete Misɔkɔ. L’oscillation entre solidarité et rivalité<br />
au sein même du rituel incite donc à nuancer toute interprétation exclusive du Bwete en<br />
termes de cohésion ou de compensation fonctionnelle.<br />
J. Fernandez soutient en outre que la réconciliation rituelle opérée dans le Bwiti fang<br />
passe par l’abolition des oppositions entre aînés et cadets, entre hommes et femmes (1982 :<br />
545-546, 571). Dans le Bwete Misɔkɔ, la totalisation rituelle permise par l’entremise des<br />
ancêtres n’implique pourtant pas que toutes les différences soient rabattues sur un plan<br />
d’égalité. Le mouvement d’englobement du Bwete conserve la hiérarchie des relations, et sert<br />
même à la manifester. D’une part, la prééminence absolue des ancêtres n’annule en rien<br />
l’ordre de la séniorité initiatique. Les aînés entretiennent en effet une relation privilégiée avec<br />
les ancêtres, prérogative marquée par le fait que les mikuku s’assoient auprès d’eux au fond du<br />
mbandja. Et le chapitre XII confirmera que la hiérarchie entre ancêtres, aînés et cadets est<br />
193<br />
A la structure sociale (système hiérarchisé de positions), V. Turner (1990) oppose la communitas :<br />
communauté non structurée ou structurée de manière plus indifférenciée et égalitaire, qui apparaît notamment<br />
dans les situations liminaires propres au rituel, entre-deux ambigu où les assignations identitaires ne valent plus.<br />
194<br />
On retrouve d’ailleurs dans le Bwiti fang cette même danse en spirale convergente au principe du sentiment de<br />
communion (Fernandez 1982 : 454).<br />
-137-
maintenue tout au long du parcours rituel. D’autre part, le mouvement d’englobement du<br />
Bwete ne ramène pas non plus la distinction entre hommes et femmes à l’égalité ou la<br />
complémentarité harmonieuse. Le rituel accentue bien plus la différence que la ressemblance<br />
entre hommes et femmes. Il n’y a guère justement que lors de la “rentrée du Bwete”<br />
qu’hommes et femmes forment un groupe uni 195 . Et le chapitre XI confirmera que les rapports<br />
rituels entre les sexes sont régis par une logique autrement plus complexe que celle de la<br />
communitas égalitariste.<br />
195<br />
Et encore, dans certaines communautés, les femmes font rentrer le Bwete séparément, après le groupe des<br />
hommes.<br />
-138-
1. Sorcellerie<br />
Chapitre IX<br />
Le vampire du Bwete : sorcellerie et ambivalence<br />
Grâce aux visions initiatiques, le banzi peut identifier le ou les parents sorciers<br />
supposément responsables de son infortune. Mais ces derniers l’ont également vu, et savent<br />
désormais qu’il sait. Ils vont donc redoubler leurs attaques afin de mettre à l’épreuve le<br />
nouvel initié. Cette menace persistante justifie pour beaucoup l’implication durable dans la<br />
société initiatique. Loin de mettre un terme à la menace sorcellaire, l’initiation l’intensifie<br />
donc paradoxalement. Le Bwete Misɔkɔ tourne obsessionnellement autour de protections<br />
rituelles qui concernent autant les nganga eux-mêmes que les malades qu’ils soignent. Certes,<br />
grâce à ses fétiches, un initié est mieux “blindé” contre les sorciers qu’un profane. Mais le<br />
capital protecteur d’un fétiche s’épuise inexorablement : les attaques sorcières répétées défont<br />
progressivement les liens qui l’emmaillotent ; et si ces liens cèdent, le propriétaire mourra<br />
bien vite. Il faut donc se protéger sans cesse davantage parce que “quand tu es faible, tu es la<br />
viande des autres” 196 .<br />
A chaque veillée, il y a supposément toujours au moins un sorcier pour mettre les<br />
nganga à l’épreuve. Le père initiateur doit alors prendre soin de truffer son corps de garde de<br />
pièges et de barrières invisibles. Et tous les initiés doivent se frictionner d’un baume<br />
protecteur avant de commencer à danser. Le retournement, le nœud, la volte – gestes rituels<br />
récurrents – servent de même à éviter de “se faire contourner” par un sorcier dont la ruse<br />
préférée consiste en effet à passer par-derrière pour attaquer dans le dos sans être vu. Mais les<br />
nganga ne se limitent pas à la défense. Une veillée, c’est aussi un combat acharné contre les<br />
sorciers : “le Bwete, c’est la guerre”. Lorsque les initiés dansent avec la torche mopitu, ils en<br />
assènent des coups violents dans le vide, comme s’ils cherchaient à blesser ou mettre en<br />
déroute des sorciers invisibles 197 . De même, couteau, sagaie et chasse-mouches rituels sont<br />
des armes contre les sorciers.<br />
L’initiation amorce ainsi le cercle vicieux d’une lutte sans fin entre initiés et sorciers.<br />
Si les nganga sont bien des witch-doctors, jamais en effet ils ne laissent entendre que la<br />
sorcellerie pourrait être totalement éradiquée, contrairement à ces mouvements prophétiques<br />
qui surgissent périodiquement en Afrique comme ailleurs. En 1955, dans l’Ogooué-Ivindo<br />
196<br />
Idiome de la sorcellerie prédatrice et anthropophage qu’on retrouve identiquement au Cameroun (Geschiere<br />
1995).<br />
197<br />
Dans la confection du mopitu entrent d’ailleurs poudre à fusil et écailles de tonnerre (quartz).<br />
-139-
(nord-est du Gabon), un certain Emane Boncœur introduit le mouvement anti-sorcellerie<br />
Mademoiselle (Cinnamon 2002). Il dit détenir l’esprit d’une femme blanche qu’un Européen<br />
lui aurait donné afin de lutter contre les fétiches maléfiques. Il fait entrevoir la possibilité<br />
d’une fin définitive de la sorcellerie si les habitants de la région se purifient, se confessent et<br />
renoncent à leurs pratiques fétichistes et donc diaboliques. Son succès est important, et<br />
précipite l’abandon des sociétés initiatiques traditionnelles comme le Mongala ou le culte des<br />
reliques d’ancêtres. Ce type de mouvement anti-sorcellerie est assez éloigné de la logique du<br />
Bwete Misɔkɔ qui refuse l’opposition manichéenne entre le Bien et le Mal, Dieu et le Diable,<br />
le Prophète purificateur et le Sorcier 198 . Les rapports entre nganga et sorcier sont en effet<br />
pétris de bien plus d’ambivalence.<br />
Fréquemment, les initiés se suspectent mutuellement de sorcellerie. Toute rivalité<br />
s’exprime en effet immédiatement dans le registre de la sorcellerie, idiome surdéterminant du<br />
conflit dans les relations sociales. Un initié tombe au milieu d’une danse ou se brûle avec la<br />
torche : c’est très certainement un autre nganga qui lui a jeté un mauvais sort pour le<br />
déconsidérer publiquement. Et il ne se passe pas une veillée sans que des disputes éclatent<br />
entre initiés. Plus grave encore, les profanes accusent facilement les nganga d’être en fait les<br />
véritables sorciers. Il n’y a en réalité pas meilleur candidat à la sorcellerie qu’un initié,<br />
détenteur de pouvoirs dangereux et secrets dont on suspecte le possible usage à des fins<br />
néfastes. On soupçonne parfois également les nganga de s’entendre directement avec les<br />
sorciers afin de s’assurer une clientèle nombreuse – ce que dit très bien le proverbe bapunu<br />
“le nganga et le sorcier étaient des amis”.<br />
Cette fréquente implication des initiés dans les affaires de sorcellerie tient aux<br />
modalités sociales d’imputation et de sanction de la sorcellerie qui sont en fait peu<br />
structurées. Il n’y a quasiment pas d’accusations directes, où la victime accuserait son<br />
persécuteur présumé en public et en présence de ce dernier. Les imputations sorcellaires se<br />
bornent essentiellement à des rumeurs et des ragots confiés en privé à des tiers. Mais il n’est<br />
pas surprenant que la rumeur soit le mode narratif privilégié pour parler de la sorcellerie. Les<br />
histoires de sorcellerie, ce sont avant tout des suspicions, insinuations et ouï-dire qui brodent<br />
indéfiniment autour d’actes et d’acteurs fondamentalement invisibles. Et ces ragots qui<br />
circulent dans le lignage sont d’autant plus ambigus que le meilleur moyen de se défendre<br />
contre une insinuation consiste à la retourner contre l’accusateur. La rumeur constitue ainsi un<br />
198 Ce manichéisme est davantage prégnant dans les Églises Éveillées, souvent d’inspiration pentecôtiste, qui<br />
s’implantent massivement en milieu urbain (Tonda 2002, Mary & Laurent 2001).<br />
-140-
mode discursif homogène à son objet : opacité, dissimulation et incertitude caractérisent tant<br />
l’activité sorcellaire que les façons d’en parler.<br />
Chez les ethnies matrilinéaires du Gabon, le sorcier, c’est traditionnellement l’oncle<br />
utérin, à qui appartiennent les enfants de ses sœurs, sur qui il a droit de vie et de mort. L’oncle<br />
est pourtant loin d’être le seul sorcier possible : n’importe quel parent est en réalité un sorcier<br />
potentiel. Par le biais de la propagation et de l’amplification des rumeurs, les imputations<br />
peuvent même dépasser le cadre du lignage pour toucher virtuellement tout le monde (un<br />
voisin allié d’un parent sorcier, un nganga complice). Si bien que tout le monde vit en<br />
permanence avec la sorcellerie, soit comme victime, soit comme suspect. La sorcellerie<br />
imprègne, empoisonne littéralement, tous les rapports sociaux. Mais chacun doit apprendre à<br />
vivre et composer avec ses sorciers.<br />
Les procédures de sanction collective sont en effet tout aussi peu structurées que les<br />
modalités d’imputation. Les sanctions publiques ne sauraient concerner que les affaires les<br />
plus graves qui intéressent tout le village, et non l’écrasante majorité des affaires mineures de<br />
sorcellerie 199 . Sans l’insertion dans un contexte plus large (agitation urbaine, élections,<br />
antagonismes régionaux etc.), il est rare que les affaires de sorcellerie dégénèrent en lynchage<br />
collectif du sorcier présumé, débordements violents qui émaillent pourtant sporadiquement la<br />
chronique 200 . On a en définitive affaire à un modèle peu structuré de contrôle social de la<br />
sorcellerie. Face à la sorcellerie, aucune promesse d’éradication, de réconciliation ou de<br />
punition collective. Le modèle est plutôt celui de la protection individuelle : la victime<br />
s’adresse, parfois en catimini, à un nganga pour qu’il identifie le sorcier (consultation), qu’il<br />
la soigne et la protège (soins). Mais étant donné la prolifération des rumeurs sorcellaires, qui<br />
en viennent à toucher par ricochets tous les acteurs impliqués dans l’affaire, les nganga au<br />
centre du dispositif de traitement de la sorcellerie s’y retrouvent eux-mêmes pris.<br />
2. Vampire<br />
Si le Bwete est une lutte contre la sorcellerie, le nganga est toutefois étonnamment<br />
proche du sorcier. Cette proximité ambiguë tient en un mot : le “vampire”. Ce terme est le<br />
vocable français popularisé dans tout le Gabon pour désigner l’organe de sorcellerie. Il<br />
correspond au nzanga du groupe mεmbε, dikundu du groupe mεryε, inyemba du groupe<br />
199 Sur ces sanctions collectives, généralement orchestrées par la société initiatique Mwiri, cf. le chapitre X.<br />
200 Sur les liens entre sorcellerie, rumeurs et politique, cf. Stewart & Strathern 2004.<br />
-141-
myεnε, evus (evu, evur) chez les fang et apparentés du nord Gabon et sud Cameroun 201 . Cet<br />
organe est souvent localisé dans le ventre et parfois identifié à la vésicule biliaire. L’ancienne<br />
autopsie rituelle servait d’ailleurs à détecter dans les viscères du mort les signes d’une<br />
agression sorcière ou au contraire la présence du vampire. L’organe permet en effet au sorcier<br />
d’aller attaquer ses victimes dans le monde invisible de la nuit : le vampire du sorcier sort de<br />
son corps par la fontanelle et s’en va agresser les innocents dans leur sommeil (d’où le fait<br />
que le vampire soit parfois localisé dans la tête). C’est ce qu’on appelle la “sortie en vampire”<br />
(vembaga en getsɔgɔ).<br />
Le vampire est donc unanimement associé à la sorcellerie. Pourtant, les initiés<br />
affirment que tout le monde, homme comme animal, possède un vampire. Cette surprise est<br />
liée à un second motif d’étonnement : le vampire, d’origine maléfique, est en réalité une<br />
puissance profondément ambivalente. Le vampire possède en effet plusieurs usages<br />
intentionnels. Un homme décide toujours délibérément de l’emploi qu’il fait de son vampire :<br />
le plus souvent faire le mal, parfois faire le bien. La plupart des gens utilisent leur vampire à<br />
des fins maléfiques, pour nuire à autrui. Mais soigner ou consulter exige également de faire<br />
usage du vampire. Cet usage bénéfique est normalement celui des nganga-a-Misɔkɔ.<br />
Cette ambivalence provient du fait que le vampire désigne en réalité la source occulte<br />
de toute puissance efficace, source érigée en véritable composante de la personne au même<br />
titre que l’esprit. Le vampire n’est donc pas un simple organe de sorcellerie. C’est plutôt une<br />
disposition à agir efficacement, à réussir. Toute fortune matérielle, tout pouvoir politique<br />
implique en effet nécessairement la possession d’un vampire fort : “il n’y a que les vampireux<br />
qui réussissent”. Inversement, celui qui est privé de vampire ou possède un vampire faible est<br />
tenu pour un idiot impuissant. Le vampire désigne ainsi le pouvoir d’agir de tout homme,<br />
pouvoir néanmoins variable selon les individus. Les Gabonais soutiennent d’ailleurs souvent<br />
que la domination technico-économique occidentale vient du fait que les Blancs possèdent un<br />
vampire particulièrement puissant. C’est en effet le vampire des Blancs qui fait décoller les<br />
avions et fonctionner le téléphone. Les rapports des Gabonais aux Européens et à la modernité<br />
technologique sont ainsi directement pris dans la logique de la sorcellerie. Poussant cette<br />
logique jusqu’au bout, les initiés affirment que “Dieu lui-même est un vampireux, car il faut<br />
la puissance du vampire pour créer”. C’est pour cette raison que le Bwete n’est pas<br />
manichéen : l’existence du vampire rend absurde l’opposition de nature entre le Bien et le<br />
Mal, Dieu et le Diable.<br />
201 Sur le Cameroun, cf. Laburthe-Tolra 1985, Mallart Guimera 1981.<br />
-142-
Le vampire révèle ainsi que toute puissance est fondamentalement ambivalente. Cette<br />
ambivalence se retrouve dans les animaux emblématiques du pouvoir : la panthère nzεgo,<br />
l’aigle mbea et le python mbɔmɔ représentent le pouvoir car ils sont tous des prédateurs<br />
redoutables et incontestés dans leur niche écologique (forêt, air, marécage). Il n’est d’ailleurs<br />
pas anodin que la panthère soit à la fois la figure privilégiée du sorcier et de l’initié. Mais<br />
ambivalence du vampire ne signifie pas neutralité. L. Mallart-Guimera fait de l’evu des<br />
evuzok (groupe bëti, sud Cameroun) un terme à valeur symbolique zéro, comme le mana<br />
mélanésien selon Lévi-Strauss (Mallart-Guimera 1981). L’evu n’a “ni dos ni ventre” car il<br />
n’est a priori ni bon ni mauvais. Terme indifférencié, il se répartit en plusieurs catégories<br />
avec passages possibles de l’une à l’autre : evu inopérant, evu antisocial (sorcier), evu social<br />
(guérisseur). Cette neutralité de principe n’est pas repérable au Gabon. L’ambivalence du<br />
vampire y penche toujours nettement du côté sombre de la sorcellerie. Certes, le “vampire des<br />
Blancs” leur fait franchir les océans et communiquer à distance. Mais tous les Gabonais sont<br />
douloureusement conscients que le “vampire des Noirs” est une terrible puissance occulte que<br />
leurs prochains utilisent surtout à mauvais escient. La sorcellerie du vampire est ainsi perçue<br />
comme la malédiction d’un mésusage de la puissance, comme une trahison délibérée de toutes<br />
les promesses de développement 202 .<br />
Il y a ainsi un pessimisme et une méfiance radicale à l’égard du pouvoir. Pour réussir,<br />
il faut nécessairement affaiblir, exploiter, voire sacrifier un parent. Étendue hors du cadre<br />
traditionnel de la sorcellerie intra-lignagère, cette conception revient à affirmer que les<br />
puissants et les nantis ne le sont que parce qu’ils maintiennent délibérément la masse dans le<br />
dénuement. Comme dans un jeu à somme nulle, le pouvoir ne s’obtient qu’en rabaissant ses<br />
parents ou des tiers, en les privant par des moyens sorcellaires de leurs propres chances de<br />
réussite afin de les accaparer à son seul profit 203 . Or, ces moyens occultes sont unanimement<br />
mauvais, même si la fin est bonne et convoitée passionnément par tout le monde.<br />
Il nous faut maintenant examiner plus précisément comment ce vampire ambivalent<br />
intervient dans le Bwete Le vampire, que les initiés désignent le plus souvent sous le terme<br />
nzanga (terme du groupe mεmbε), peut être hérité d’un parent défunt ou transmis dès la<br />
naissance. Il accompagne alors souvent l’héritage d’un nom et d’un pouvoir rituel. En lui<br />
faisant téter sa salive à la place du lait maternel, un parent peut ainsi transmettre son vampire<br />
à un nouveau-né (la salive représentant la puissance logée au fond du ventre). Mais cet<br />
202 Sur les liens ambigus entre sorcellerie, pouvoir, technique et modernité, cf. Geschiere 1995, Comaroff &<br />
Comaroff 1993, Comaroff & Comaroff 1999, West & Sanders 2003.<br />
203 La mort est le terme inéluctable de cette appropriation sorcellaire : soit que le sorcier épuise progressivement<br />
la force vitale de sa victime, soit qu’il la sacrifie directement pour en faire un fantôme travaillant à son service.<br />
-143-
héritage peut passer par un simple rêve envoyé par un parent défunt. Il n’est de toute façon<br />
pas nécessaire d’avoir hérité du vampire d’un parent pour en posséder un.<br />
Il est en outre toujours possible d’affermir un vampire naturellement faible. Tout le<br />
Bwete peut en effet être envisagé comme une entreprise d’acquisition, de renforcement et de<br />
manipulation du vampire. L’initiation permet de “laver” le vampire. Cette purification ne rend<br />
pas le vampire moins puissant ou redoutable, mais renforce au contraire son pouvoir. De<br />
même, les maganga ingurgités sont des vampires additionnels dans le ventre de l’initié. Faire<br />
avaler motoba constitue ainsi pour le père initiateur un équivalent de la transmission lignagère<br />
du vampire par la salive. On peut aussi prélever physiquement le nzanga sur un cadavre, par<br />
exemple celui d’un grand initié, afin d’en faire l’ingrédient de nouveaux fétiches. Les veillées<br />
servent enfin à “réveiller”, “soulever”, “faire monter” ou “mettre debout” le vampire des<br />
initiés 204 . La prise d’une petite dose d’eboga et les danses permettent en effet d’activer le<br />
nzanga afin que le nganga puisse voir et consulter 205 . Selon la formule développée, le vampire<br />
se dit d’ailleurs nzanga na lemba – lemba signifiant “prier, invoquer”. Vampire et parole<br />
rituelle sont donc étroitement associés. L’activation du vampire de l’initié assure et fortifie sa<br />
parole pour la rendre apte à la divination ou à l’invocation des ancêtres. Si le vampire<br />
représente un pouvoir d’agir générique, celui du nganga-a-Misɔkɔ constitue donc plus<br />
spécifiquement un pouvoir de la parole.<br />
Le nzanga se trouve ainsi au principe d’une véritable théorie de la personne et de<br />
l’action. Le cœur (motema) et le vampire sont en communication directe. Le cœur est le<br />
centre de la volition et du désir. Mais sans le nzanga, il reste impuissant. Le vampire permet<br />
en effet de transformer le désir en action efficace : “le nzanga est là pour l’action. C’est lui<br />
qui donne toute sa force en envoyant sa puissance au cœur”. Le vampire, c’est ainsi le<br />
“courage”, la “force de caractère”, le “m’as-tu-vu” ou “le propulseur”, pour reprendre des<br />
expressions couramment employées par les initiés. Il est parfois comparé à une pile électrique<br />
ou un aimant 206 . Selon certains, du point de vue organique, le nzanga, c’est le dyome. Il s’agit<br />
supposément d’un viscère situé près du cœur, ou d’un muscle le long de la colonne vertébrale,<br />
qui colle au cœur et remonte jusqu’à la tête. Indépendamment de toute considération de réalité<br />
anatomique – qui reste sans doute secondaire –, on peut noter que le dyome permet de mettre<br />
en relation le cœur et la tête. Nzanga, cœur et tête forment ainsi un triangle relationnel : par ce<br />
204 Ces expressions connotent l’érection phallique. Le vampire masculin n’est certes pas localisé au niveau du<br />
pénis, mais la sexualité constitue le registre analogique principal de la puissance.<br />
205 Le nzanga est localisé au niveau de la vésicule biliaire. Or, l’eboga, par son amertume, est justement associé à<br />
la bile. Il constitue donc le fortifiant idoine du vampire.<br />
206 Et un père initiateur m’a un jour montré un petit bout de matière visiblement organique qui était réellement<br />
aimanté (par un moyen inconnu), en m’affirmant qu’il s’agissait là du nzanga humain.<br />
-144-
iais, les sources de la volition, de la pensée et de l’action sont interconnectées comme autant<br />
de composantes de l’intentionnalité du sujet. Le nzanga de l’initié lui permet en définitive<br />
d’accomplir avec détermination et assurance ce que son cœur ou sa tête lui enjoint de faire ou<br />
de dire.<br />
Le traitement rituel du vampire opère donc une véritable transformation de la personne<br />
en affermissant son cœur, ses actes et ses paroles. Cette transformation active prolonge et<br />
pérennise la désinhibition résolutoire permise par les visions d’eboga. Il s’agit pour l’initié de<br />
se réapproprier durablement une puissance d’agir dont il avait été dépossédé par l’adversité<br />
sorcière. La passivité est en effet la dimension fondamentale de l’infortune sorcellaire :<br />
l’infortuné se sent piégé au sein du réseau de parentèle dans une position d’impuissance, se<br />
pense entravé dans toutes ses entreprises par un parent malveillant. Le processus initiatique<br />
permet alors, sur le long terme, de sortir de cette position passive, non pas en neutralisant la<br />
sorcellerie et en réinsérant l’individu dans un lignage réconcilié, mais plutôt en s’appropriant<br />
de manière ambivalente les pouvoirs mortifères de la sorcellerie. La relation sorcier/victime<br />
n’est ni annulée ni inversée, mais plutôt déplacée et reprise à un niveau supérieur dans la<br />
relation initié/sorcier.<br />
En définitive, le vampire communément associé à la sorcellerie désigne dans le Bwete<br />
Misɔkɔ la disposition active au principe du pouvoir de l’initié. Les initiés s’efforcent<br />
généralement d’euphémiser cette dimension sorcellaire, la dissimulant sous l’oxymore du<br />
“bon vampire”. Mais elle n’est cependant jamais entièrement effacée : comme me l’a<br />
abruptement dit un père initiateur, “il ne faut pas se leurrer, ce qu’on fait, c’est le vampire”.<br />
A ce sujet, la comparaison entre Bwete Misɔkɔ et Bwiti fang est instructive. Sous l’effet de<br />
l’intériorisation des figures chrétiennes du Christ et de Satan, du Bien et du Mal, le Bwiti<br />
syncrétique des fang a introduit la figure intermédiaire du ngolongolo entre le sorcier (nnem)<br />
qui possède le vampire (evus) et l’innocent (miêmiê) qui n’en possède pas (Mary 1999 : 64-<br />
84). Ce personnage médiateur auquel l’initié peut lui-même s’identifier, ainsi que le<br />
redoublement des divisions (ngolongolo-miêmiê, ngolongolo-ngolongolo, ngolongolo-nnem),<br />
constituent une tentative pour s’éloigner du sorcier, tout en refusant de basculer complètement<br />
du côté de l’innocent, jugé trop naïf et trop faible. Dans le Bwiti fang, la prétention<br />
d’innocence des initiés est ainsi accentuée par rapport au Bwete Misɔkɔ. Les prophètes fang ne<br />
peuvent cependant pas rompre complètement avec les pouvoirs de l’evus, et se contentent<br />
donc de tenir les sorciers à distance par une série d’écarts conceptuels supplémentaires. Cela<br />
révèle bien la force d’attraction ambivalente que garde le pouvoir sorcier pour les initiés,<br />
même en situation de syncrétisme chrétien.<br />
-145-
3. Sacrifice<br />
La source occulte des pouvoirs du sorcier et de l’initié est donc identique. L’identité<br />
initiatique se construit ainsi autour d’une proximité troublante avec le sorcier : witch-doctor,<br />
le nganga est un peu witch lui-même. L’ambivalence des soins dispensés par les nganga a<br />
déjà été soulignée : il s’agit de répondre à l’agression sorcière par une riposte de même nature<br />
(retour à l’envoyeur). Leur clientèle ne s’y trompe d’ailleurs pas : il arrive que l’on vienne en<br />
catimini demander à un nganga de confectionner un fusil nocturne ou un poison. Mais c’est<br />
l’omniprésence du schème sacrificiel dans le Bwete qui illustre le mieux cette troublante<br />
proximité. Dans le rituel, tous les sacrifices animaux renvoient à un sacrifice humain<br />
mythique : la volaille d’edika remémore le meurtre anthropophage d’une parente. Cette<br />
idéologie sacrificielle se retrouve au principe même de l’initiation. Le paiement de la<br />
contrepartie initiatique est une dette de vie : la renaissance du banzi en fait le débiteur<br />
perpétuel de son père initiateur et des ancêtres. L’initiation étant envisagée comme un jeu à<br />
somme nulle, cette dette de vie est pourtant aussi une dette de mort : on doit “donner” un<br />
parent en échange du Bwete. L’argent ou les biens matériels remplacent ainsi ce qui était<br />
“autrefois” un parent (souvent nièce ou neveu) que l’on acceptait de sacrifier en échange de<br />
l’initiation. C’est pourquoi dans les sociétés initiatiques, l’argent garde une odeur de mort.<br />
Le Bwete voisine ainsi avec la sorcellerie qui repose également sur le sacrifice comme<br />
raccourci illicite vers la prospérité matérielle. En effet, si l’initiation est légitime, le sacrifice<br />
initiatique ne l’est pas et doit donc rester clandestin. Ce n’est pas un sacrifice rituel qui<br />
pourrait être assumé collectivement et publiquement par la communauté initiatique.<br />
Cependant les initiés reconnaissent fort bien que ce sacrifice initiatique fait l’objet d’un<br />
traitement symbolique dans le rituel, au sens littéral d’une substitution équivalente d’un terme<br />
par un autre. Le sorcier tue réellement ses parents. Mais les initiés ont substitué ce meurtre par<br />
le sacrifice et la consommation d’une volaille ou d’un cabri (sacrifice rituel) ou par le<br />
paiement en argent ou en biens matériels (contrepartie initiatique) afin, selon leurs dires,<br />
d’éviter de décimer le lignage. Cette équivalence satisfait l’idéologie sacrificielle tout en<br />
maintenant la sorcellerie à distance.<br />
Les initiés ne sacrifient donc pas leurs parents. Mais, à les écouter, autrefois, ailleurs et<br />
même tout juste à côté, d’autres initiés ont fait ou continuent de faire des sacrifices humains.<br />
On s’accuse en effet facilement de sorcellerie sacrificielle ou anthropophage entre<br />
communautés initiatiques voisines : pour un initié, l’initié d’à côté est souvent un sorcier. Les<br />
-146-
apports inter-communautaires, plus encore que les rapports intra-communautaires, se<br />
trouvent pris dans la logique empoisonnée de la sorcellerie. Et les initiations les plus fermées<br />
(le Nzεgo, les dernières étapes du Mwiri), les pratiques rituelles les plus secrètes (réactiver<br />
une grande relique) ou les miracles les plus extraordinaires (ressusciter un mort) sont réputés<br />
n’être pas monnayables et exigeraient encore un véritable sacrifice humain.<br />
Une pléthore d’histoires édifiantes de sacrifices initiatiques circule ainsi en<br />
permanence parmi les initiés ou les profanes, mais aussi dans la presse. Or, ces rumeurs<br />
relèvent d’un tout autre registre que les récits initiatiques. Dans le mythe et le rite d’edika, la<br />
distinction entre le sacrifice réel du coq et le sacrifice symbolique du parent est très nette du<br />
point de vue des initiés eux-mêmes 207 . Le propre de la rumeur est de se placer à l’inverse à un<br />
niveau où il n’est plus possible de faire la part du réel et de l’imaginaire. Certes, la plupart de<br />
ces histoires de sacrifice sont sans aucun doute fantaisistes. Pas toutes cependant, comme le<br />
prouvent les sordides affaires de meurtres et vols d’organes qui défraient régulièrement la<br />
chronique au Gabon 208 . Mais l’important est que ces histoires, contrairement au mythe, situent<br />
la contrepartie initiatique sacrificielle dans le réel, en dehors du registre de la substitution<br />
symbolique. Les initiés imputent ainsi constamment à autrui – mais à un autrui toujours<br />
proche – des dérapages sacrificiels hors du symbolique. Il s’agit de suggérer par là que le<br />
sacrifice humain n’est jamais très loin et que le partage entre initiation (substitution<br />
symbolique) et sorcellerie (réalité supposée) est toujours précaire.<br />
Cette proximité inquiétante du Bwete avec la sorcellerie est parfois même revendiquée<br />
à mi-mots en première personne. Même si ces confessions s’accompagnent d’un cortège<br />
d’euphémismes et de disculpations, il est toujours surprenant d’entendre un initiateur connu<br />
de longue date avouer : “là nous sommes au bwεnzε, je peux le dire, j’ai déjà tué, pas dans la<br />
malhonnêteté, dans l’honnêteté. […] J’ai déjà tué et mangé quelqu’un, mais c’était un<br />
sorcier”. Ce père initiateur m’avait déjà raconté comment son frère aîné avait cherché à le<br />
tuer pour s’approprier son pouvoir rituel. Mais ce frère sorcier avait échoué et en était mort,<br />
m’avait-il dit sans s’appesantir davantage. J’ai appris plus tard une autre version des faits qui<br />
inversait les rôles de sorcier et de victime : le frère avait en réalité été délibérément sacrifié et<br />
transformé en fantôme, afin de servir d’auxiliaire divinatoire au père initiateur.<br />
Troublantes revendications où des initiés confessent tuer honnêtement, manger des<br />
sorciers, voire assassiner un frère : l’initié endosse le rôle paradoxal du sorcier, tout en se<br />
207 Il ne faudrait donc pas croire que la perspective symbolique soit uniquement celle de l’observateur<br />
anthropologue, tandis que les acteurs seraient condamnés à tout prendre au premier degré.<br />
208 La publication de photos de cadavres mutilés (pour y prélever les “pièces détachées”) dans Le livre blanc des<br />
droits humains au Gabon (Ministère des Droits de l’Homme 2004 : 59-70) avère la réalité de ces sacrifices,<br />
même si rien n’indique qu’il s’agisse du Bwete plutôt qu’un autre “rituel”.<br />
-147-
disculpant immédiatement. J. Favret-Saada note que dans le bocage mayennais, la place du<br />
sorcier reste vide car il est impossible qu’un individu vienne l’occuper en première personne<br />
(Favret-Saada 1977 : 50). Le sorcier ne peut exister que dans le discours des ensorcelés et des<br />
désorceleurs. Mais, jamais il ne dit “je”. Au Gabon, la situation est plus équivoque. Les initiés<br />
du Bwete laissent entendre à mi-mots qu’ils sont eux-mêmes des espèces de sorciers, ce qui<br />
implique la reconnaissance d’un sacrifice humain, que la victime soit un (autre) sorcier ou<br />
plus directement un parent lignager “donné” en contrepartie d’un pouvoir initiatique. Peu<br />
importe alors que ces meurtres soient fantasmés ou réels. L’important est qu’ici, le “je” du<br />
sorcier trouve presque à s’exprimer 209 .<br />
Un proverbe dit : “le sorcier la nuit, le nganga le jour” (mogodo na pitsi, nganga<br />
n’omanda). Ce système dualiste se complique pourtant bien rapidement : les veillées de Bwete<br />
ne se tiennent pas le jour mais la nuit, aux heures où les profanes dorment et les sorciers<br />
agissent. Les maganga n’aiment pas la lumière du soleil et ne supportent que celle vacillante<br />
des torches et des bougies. Le Bwete se situe ainsi dans une position ambiguë, ce qu’illustre<br />
bien le cas de la branche initiatique Ngɔndε (Lune). La clarté blafarde de la lune appartient en<br />
effet simultanément aux deux registres de la lumière et de la nuit, du visible et de l’obscurité.<br />
L’oxymore de l’obscure clarté conviendrait parfaitement au Ngɔndε en particulier et au Bwete<br />
en général. Le Bwete est pris dans une opposition hiérarchique, où c’est la nuit – et son<br />
obscurité suspecte – qui sert de catégorie englobante 210 . Cette proximité inquiétante du Bwete<br />
avec la nuit marque ainsi la singularité ambiguë de l’initié qui doit se faire sorcier pour<br />
pouvoir être contre-sorcier.<br />
209<br />
Dans le Bwiti fang, l’identification des initiés glisse progressivement des sacrificateurs vers les victimes<br />
(sacrifice de soi du martyr) (Mary 1999 : chap. IV). Cela reste impensable dans le Misɔkɔ.<br />
210<br />
L’essai de P. Laburthe-Tolra (1985) sur la religion bëti (sud Cameroun) est tout entier construit sur les<br />
médiations ambiguës entre le jour et la nuit.<br />
-148-
1. L’initiation au Mwiri<br />
Chapitre X<br />
Mwiri : l’assermentation de la parole<br />
Il nous faut maintenant nous intéresser à l’initiation au Mwiri qui constitue une<br />
nouvelle étape du parcours rituel du Bwete et dont l’examen va nous donner l’occasion de<br />
revenir sur l’importance constitutive de la relation aux femmes et au sexe féminin dans la<br />
formation du devin-guérisseur nganga. Le Mwiri est une société initiatique masculine très<br />
répandue dans les groupes mεmbε et mεryε au sud Gabon 211 . Il partage de nombreux traits<br />
communs (fonction sociale, rites de passage, mythes) avec d’autres sociétés initiatiques<br />
comme le Mongala (groupe kota-kele), le Yasi (galwa), le Ngil (fang) ou le Ndjobi (Haut-<br />
Ogooué). La fonction première du Mwiri est celle d’un classique rite de passage pubertaire :<br />
fabriquer des hommes à partir de jeunes garçons. Seule l’initiation peut en effet octroyer la<br />
vraie masculinité, plus rituelle que biologique – les garçons non-initiés restant comme des<br />
femmes 212 .<br />
Mais le Mwiri constitue également une étape nécessaire dans le parcours initiatique du<br />
Bwete : il faut y être initié pour avoir accès aux secrets les plus importants. Le savoir secret ne<br />
peut en effet être divulgué que si l’on est certain que le dépositaire ne le trahira pas. Or,<br />
l’initiation au Mwiri a justement pour fonction de garantir ce respect du secret. Il y a donc une<br />
complémentarité intime entre Bwete et Mwiri. Peu importe alors l’ordre des initiations. Dans<br />
le cadre villageois, un garçon entre traditionnellement dans le Mwiri dès le début de son<br />
adolescence, avant de se faire initier au Bwete Disumba quelques années plus tard. En ville, la<br />
situation est souvent inversée : un homme se fait initier au Bwete Misɔkɔ pour raison<br />
d’infortune, puis sa progression rituelle exige au bout d’un temps qu’il entre dans le Mwiri,<br />
s’il ne l’avait déjà fait adolescent. Un nganga ne peut en effet avancer au-delà d’edika et<br />
motoba sur le chemin du Bwete sans en passer par le Mwiri. Avaler le silure motoba exige<br />
même normalement que l’on soit déjà dans le Mwiri, même si certains pères initiateurs<br />
acceptent aujourd’hui de passer outre. Mais le Mwiri reste une nécessité absolue pour ouvrir<br />
la voie à la dernière étape initiatique du Misɔkɔ, la traversée du Bwete.<br />
Comme le Disumba mais contrairement au Misɔkɔ, l’initiation au Mwiri se fait par<br />
cohorte (au moins trois ou quatre garçons). Dans les nombreux villages où le Mwiri reste un<br />
211 On dit plutôt Mweli chez les bavove, Mwei chez les mitsɔgɔ. Son origine ethnique est inconnue. Lorsque du<br />
Chaillu explore le sud du pays entre 1855 et 1865, il trouve le Mwiri déjà bien installé parmi les bapunu et les<br />
mitsɔgɔ.<br />
212 Sur la construction initiatique de la masculinité, cf. Houseman 1984.<br />
-149-
ite de passage obligatoire, c’est l’oncle maternel qui décide que le temps de l’initiation est<br />
venu pour ses neveux (vers neuf ou dix ans). Mais il n’est pas rare que de jeunes hommes<br />
citadins, voire des adultes, retournent au village se faire initier, tant est tenace l’idéologie<br />
selon laquelle on ne peut être un vrai homme sans le Mwiri. Une même cohorte initiatique ne<br />
forme de toute façon jamais une classe d’âge. L’initiation, qui laisse clairement apparaître la<br />
structure canonique des rites de passage (séparation, liminarité, réagrégation), commence par<br />
une phase de réclusion en brousse avant de se poursuivre au village, en privé au corps de<br />
garde puis en public dans la cour centrale.<br />
Les novices (appelés mbuna) sont brutalement séparés de leur village maternel et<br />
conduits en forêt jusqu’à l’enclos initiatique nzanga, place rectangulaire enclose par une<br />
barrière de feuilles de bananier. Ils doivent alors passer au milieu d’une double rangée<br />
d’initiés qui les rouent de coups, tandis que les grondements du Mwiri se font entendre à<br />
l’intérieur de l’enclos. Les novices doivent supporter stoïquement cette bastonnade pour<br />
prouver qu’ils sont des hommes valeureux – le courage étant l’une des vertus cardinales de la<br />
masculinité. Un mbuna peut néanmoins avoir un parrain initiatique (ngonza) qui le protège en<br />
prenant sur lui les coups les plus rudes. Les néophytes sont ensuite poussés dans le nziba,<br />
étendue boueuse située face à l’enclos, où l’on continue de les frapper. Le nziba représente,<br />
d’après le mythe d’origine, la mare aux abords du village où les femmes, par manque de<br />
courage, avaient laissé le monstre Mwiri et où les hommes l’avaient ensuite trouvé. Ce bain<br />
de boue revient ainsi à jeter les novices en pâture au Mwiri. Bastonnades et nziba mettent<br />
donc en scène la mort symbolique des mbuna.<br />
Boueux et meurtris, les mbuna doivent alors passer leur bras gauche à travers la<br />
cloison de feuillage de l’enclos, apeurés par le redoublement des grondements rauques. C’est<br />
à ce moment que le Mwiri leur fait les scarifications qui marqueront bien visiblement leur<br />
appartenance à la société initiatique. L’opération renvoie à un épisode du mythe d’origine,<br />
lorsque la première femme a glissé son bras dans un trou d’eau d’où provenaient de<br />
mystérieux grondements, et s’est fait mordre par le monstre. Au cours du rite de passage, il<br />
est important que les novices ne voient pas celui qui les “vaccine” de la sorte : la cloison de<br />
feuillage les sépare de l’opérateur ; on leur instille un collyre aveuglant et les oblige à fixer le<br />
soleil. Ces scarifications (appelées makembe ou makimba) sont situées au poignet et au coude<br />
du bras gauche. La marque du poignet consiste en une série de trois traits parallèles parfois<br />
dédoublés. La marque du coude ressemble quant à elle à un sexe féminin stylisé 213 . Tant que<br />
ces blessures ne seront pas guéries, le mbuna ne devra pas avoir de relations sexuelles : ce<br />
213 Les bapunu lui préfèrent souvent un signe en forme de double V superposé.<br />
-150-
serait rendre aux femmes le pouvoir du Mwiri, dont les hommes avaient réussi à s’emparer à<br />
leur seul profit.<br />
Scarifications du Mwiri<br />
Aussitôt les scarifications faites, les mbuna pénètrent à l’intérieur de l’enclos<br />
initiatique, opération qui figure l’engloutissement par le monstre. Jusqu’ici, les néophytes<br />
comme tous les profanes avaient seulement entendu le grondement du génie, mais ne l’avaient<br />
jamais vu 214 . En rentrant dans l’enclos, les mbuna peuvent enfin voir le Mwiri en face. Ils<br />
s’aperçoivent alors qu’il s’agit en fait d’un simple initié grimé. On leur révèle également que<br />
le grondement rauque du génie n’est que la voix travestie d’un homme 215 . Mais sitôt cette<br />
révélation faite, les novices doivent faire le serment solennel de ne jamais divulguer que le<br />
Mwiri est homme et non génie. Les aînés peuvent alors leur raconter le mythe d’origine et<br />
quelques autres secrets initiatiques.<br />
Commence ensuite la période de la réclusion et des brimades initiatiques (période qui<br />
pouvait durer deux mois mais se réduit souvent aujourd’hui à une semaine). Les novices<br />
restent dans l’enclos, y mangent et y dorment à même le sol, encore coupés de toute présence<br />
féminine. Outre la poursuite de l’enseignement oral, la réclusion consiste essentiellement en<br />
brimades diverses. Les mbuna ont la tête rasée, le corps enduit d’huile de palme et exposé au<br />
soleil, ou bien frotté au charbon. On les réveille au milieu de la nuit pour les obliger à danser<br />
et chanter. Du sable est glissé dans leur nourriture, de toute façon spartiate. Les garçons<br />
insolents sont brimés plus durement encore. Les aînés aiment d’ailleurs raconter qu’un<br />
incorrigible effronté était même souvent assassiné, et l’est encore parfois. Les initiés se<br />
contentent alors de dire à sa famille que le Mwiri a définitivement avalé leur fils,<br />
contrairement aux autres mbuna qu’il a bien voulu recracher.<br />
Au bout d’un temps, les mbuna quittent l’enclos de brousse pour s’installer au corps<br />
de garde, fermé pour l’occasion par une barrière de feuilles. Les brimades s’infléchissent alors<br />
en humiliation publique. Devant le mbandja, les novices sont contraints d’exécuter toutes<br />
sortes de danses et de mimes ridicules, face à un public et dans l’hilarité générale. Ils doivent<br />
214<br />
Outre l’initiation, le Mwiri se fait entendre lors du décès d’un initié, de la naissance ou de la mort de jumeaux,<br />
de la prise à la chasse d’une panthère nzεgo ou d’un crocodile ngando (animaux liés au Mwiri pour lesquels il<br />
faut organiser une veillée mortuaire).<br />
215<br />
Grâce à l’ingestion de la feuille d’Ancistrocarpus densispinosus qui, irritant les cordes vocales, déforme<br />
temporairement la voix.<br />
-151-
taper interminablement dans leurs mains, sauter à cloche-pied, hocher la tête sans fin, imiter<br />
des animaux ou bien un coït. Les profanes, notamment les femmes, sont ainsi mobilisés pour<br />
la première fois, à titre de spectateurs d’un spectacle risible. Cette période de brimades se<br />
termine par une cérémonie de réagrégation à la communauté villageoise, au cours de laquelle<br />
les mbuna badigeonnés de kaolin rouge dansent devant les femmes. Ces rites de passage<br />
auront en définitive orchestré la mort symbolique puis la renaissance du novice : avalé par le<br />
Mwiri, il est finalement régurgité pour être rendu aux siens. Il a entre temps subi une<br />
transformation irréversible : de garçon, il est devenu un homme.<br />
2. Jumeaux, femmes, fécondité<br />
Au Gabon, les jumeaux (mavasa en getsɔgɔ) sont unanimement considérés comme des<br />
génies (sauf, peut-être, chez les fang). Leurs noms sont spécifiques et appartiennent à une liste<br />
close de noms appariés. Les jumeaux sont réputés posséder des pouvoirs extraordinaires. On<br />
fabrique un kaolin des jumeaux (pεmba-a-mavasa), puissant porte-bonheur, en ajoutant au<br />
kaolin leur placenta pilé ou même leurs restes corporels. Et lors de leur naissance, le Mwiri<br />
lui-même vient sur les lieux de l’accouchement. Il existe ainsi un lien étroit entre Mwiri et<br />
gémellité. Les jumeaux n’y sont pas initiés comme de simples mbuna mais à titre de mata,<br />
grade supérieur qui leur épargne bastonnades et brimades. Les initiés manifestent à leur égard<br />
les signes du plus profond respect : sur le chemin qui mène du corps de garde à l’enclos<br />
initiatique, les jumeaux marchent sur des nattes ou sont portés sur les épaules. Ce prestige<br />
rejaillit sur leur père qui acquiert lui aussi le grade de mata. Depuis que les hommes se sont<br />
emparés du Mwiri, aucune femme ne peut y être initiée. Mais la mère de jumeaux, sans être<br />
véritablement initiée, acquiert un statut singulier : le Mwiri peut venir devant elle, elle peut<br />
assister à certains rites et lors des manifestations rituelles, elle se place désormais entre le<br />
groupe des hommes à l’avant et celui des femmes à l’arrière.<br />
La gémellité est valorisée parce qu’elle représente le comble de la fécondité féminine,<br />
fécondité qui était le pilier fondamental de ces sociétés lignagères et reste aujourd’hui une des<br />
valeurs sociales les plus importantes. Et c’est parce qu’il se place également sous le signe de<br />
la fécondité féminine que le Mwiri est si intimement lié à la gémellité. Le mythe de<br />
découverte du Mwiri met bien en relief ce caractère féminin 216 .<br />
M 7 (origine du Mwiri)<br />
216 Cf. également la version dans Gollnhofer & Sillans 1981.<br />
-152-
“Un jour, six femmes vont à la rivière pêcher à la nasse. Elles se nomment<br />
Misenzo, Dyambo Timba, Mongo Makita, Mogodi mwa Ngangè, Mogetu one<br />
ngongola divoko [la femme qui possède une pomme d’Adam], Mogetu gombola<br />
nzanga [la femme qui balaye l’enclos initiatique, associée à la poule]. Elles font<br />
un barrage pour dénicher les poissons. Dans un trou d’eau plein de silures, elles<br />
entendent un étrange grondement rauque. L’une des femmes y met la main, mais<br />
quelque chose la mord. Lorsqu’elle retire son le bras, elle a trois marques au<br />
poignet. Les femmes prennent alors une branche de diyombu [Aframomum<br />
citratum ou giganteum] pour fouiller le trou et réussissent à capturer un monstre<br />
qui n’a ni bras ni jambes. C’est le génie Mwiri. Elles le mettent dans leur nasse<br />
pour le ramener au village. Mais le monstre pèse trop lourd et perce les nasses.<br />
Pendant tout le trajet, il ne fait que gronder et cracher de l’eau. N’ayant plus le<br />
courage de le supporter plus longtemps, les femmes abandonnent alors le<br />
monstre aux abords du village. Délaissé, le Mwiri appelle les femmes.<br />
Entendant ces étranges cris depuis le corps de garde, les hommes se rendent sur<br />
les lieux et voient une grande étendue d’eau : le Mwiri a recraché plein d’eau<br />
afin de survivre hors de la rivière [c’est le nziba]. Interloqués, ils se demandent<br />
comment capturer la créature. Ils jettent un chiot à l’eau. Mais le Mwiri l’avale.<br />
Ils jettent alors successivement un tronc de bananier, une panthère et un pygmée,<br />
mais à chaque fois le Mwiri les avale. Ils chauffent finalement un marteau de<br />
forge (mutendo) et le jettent à l’eau. Ne pouvant l’avaler, le Mwiri sort de l’eau.<br />
Ils en profitent alors pour le capturer et l’installer dans un enclos de feuilles de<br />
bananier qui fut le premier enclos initiatique nzanga. Là, il y avait des oiseaux<br />
tisserins qui, depuis lors, signalent la présence d’un enclos du Mwiri. Il y avait<br />
également les grenouilles dont le coassement a été le premier tambour du Mwiri.<br />
Mais sans nourriture sans eau et sous le soleil, le monstre se meurt bientôt. A<br />
l’agonie, il demande aux hommes de perpétuer son existence en imitant sa voix.<br />
C’est le début de la société initiatique du Mwiri.<br />
Dans l’enclos, les hommes découvrent Mogetu gombola nzanga [la femmepoule<br />
qui balaye le corps de garde] et la sacrifient. De là vient le sacrifice rituel<br />
de la poule. Ils sacrifient de même les autres femmes qui avaient découvert avant<br />
eux le secret du Mwiri, afin de le garder pour eux seuls. Les hommes ont ainsi<br />
pris le Mwiri aux femmes et leur ont donné en échange leur danse Nyεmbε [ou<br />
Ndjεmbε, qui est depuis la principale société initiatique féminine]. Depuis lors,<br />
les femmes sont condamnées à servir l’homme, à cuisiner pour lui, à faire des<br />
enfants et s’en occuper.”<br />
Ce sont donc les femmes qui ont découvert le Mwiri les premières. Cette association<br />
privilégiée entre Mwiri et féminité est confirmée par une série de faits. Le Mwiri est<br />
étroitement associé à la gauche, le côté féminin : les scarifications initiatiques sont au bras<br />
gauche, et “passer dans la gauche” sert communément à désigner l’initiation 217 . La<br />
scarification du coude représente en outre un sexe féminin stylisé. Le génie est appelé Ma<br />
Mwiri (ou Iya Mwei), c’est-à-dire “Mère Mwiri”. Et lors des rites de passages, cette Mère<br />
Mwiri avale les néophytes par sa gueule comme un gros crocodile dévorateur, mais les<br />
217 S’il faut être dans le Mwiri pour être un “homme complet”, c’est donc parce que le Mwiri permet la<br />
complétion de deux moitiés symétriques : à travers ses scarifications, l’initié masculin englobe la gauche comme<br />
la droite, le féminin comme le masculin.<br />
-153-
ecrache par son sexe pour les remettre au monde. C’est donc le Mwiri lui-même qui incarne<br />
le pouvoir procréateur féminin. Le mythe d’origine raconte en effet comment le Mwiri<br />
prisonnier dans la nasse expulse tellement d’eau que cela forme bientôt sous lui une mare qui<br />
n’est rien d’autre que le nziba des rites de passage. Or, le nziba, c’est le “vagin du Mwiri” et<br />
l’inondation est explicitement comparée à la rupture de la poche des eaux avant<br />
l’accouchement. L’humidité excessive qui définit le Mwiri représente ainsi le comble de la<br />
fécondité : “le Mwiri, c’est la femme. Le Mwiri était dans l’eau. Et il y a l’eau dans le sexe de<br />
la femme”.<br />
Ce que le mythe d’origine raconte et ce que le rite met en œuvre, c’est alors<br />
l’appropriation masculine de ce pouvoir procréateur féminin : les hommes accaparent le<br />
pouvoir des femmes et deviennent capables de re-mettre au monde des enfants mâles pour en<br />
faire des hommes, avec l’aide rituelle de la mère Mwiri mais sans le concours effectif des<br />
femmes. Certes, aucun de mes interlocuteurs ne pouvait formuler cela de manière aussi crue.<br />
La présence d’une part d’implicite est sans doute une caractéristique fort générale tant du<br />
mythe que du rite. Et certainement, lorsque les rapports de genre sont en jeu, ce non-dit joue<br />
un rôle d’autant plus décisif. A cet égard, mythe et rite du Mwiri sont une manière<br />
particulièrement raffinée de tourner autour du pot : tous les prémisses sont là, mais tout se<br />
passe comme si la conclusion devait rester informulée.<br />
Cette forme d’évitement est rendue possible par un mécanisme de dissociation. Le<br />
mythe présente la découverte féminine comme un événement accidentel : les femmes trouvent<br />
le monstre au hasard d’une partie de pêche. Le lien entre Mwiri et féminité semble ainsi n’être<br />
que contingent alors qu’il est en réalité consubstantiel. La capacité reproductrice féminine a<br />
en effet été préalablement détachée des femmes pour s’incarner dans le monstre Mwiri. Elle<br />
est donc présentée comme quelque chose d’extérieur aux femmes. De cette façon, les femmes<br />
peuvent ensuite trouver par hasard ce qui leur appartenait en fait déjà 218 . Elles peuvent alors<br />
mettre le monstre dans leur nasse puis l’abandonner aux abords du village, et les hommes<br />
peuvent venir s’emparer de ce vagin portatif monstrueux qui inonde tout autour de lui. Cette<br />
dépossession opérée par les hommes n’est concevable que si le pouvoir procréateur a été<br />
dissocié des femmes pour devenir une chose appropriable 219 . Grâce à cette dissociation, la<br />
captation masculine de la capacité reproductrice féminine disparaît, masquée par le vol<br />
masculin d’un monstre découvert fortuitement par les femmes.<br />
218<br />
Et ce n’est pas un hasard que cela soit au cours d’une partie de pêche à la nasse, activité exclusivement<br />
féminine.<br />
219<br />
Pour l’analyse d’une dissociation similaire dans le cas d’objets rituels des aborigènes australiens, cf. Testart<br />
1993.<br />
-154-
3. Ordalies : enclume et poison<br />
Au-delà du classique rite de passage pubertaire, le Mwiri est également la société<br />
initiatique masculine chargée d’assurer le contrôle de l’ordre social et de punir les<br />
transgressions. Un vol, un adultère ou même un mensonge peut en effet entraîner une sanction<br />
magique, punition infligée par le génie Mwiri sous forme d’une maladie subite (dont le<br />
symptôme majeur est un gonflement du ventre). Et lorsque la justice humaine punit ellemême<br />
la transgression, ce sont les initiés du Mwiri qui s’en chargent. Ce sont encore eux qui<br />
peuvent accomplir le rituel de réparation après aveux publics du coupable. Cette justice du<br />
Mwiri repose essentiellement sur des pratiques de type ordalique permettant d’identifier le<br />
coupable.<br />
L’épreuve de la masse-enclume motεndo est la première de ces ordalies. Le motεndo<br />
est un morceau de fer ou une simple pierre que le forgeron utilise soit à demi-enterré comme<br />
enclume, soit à la main comme marteau. Son utilisation ordalique témoigne d’un lien unissant<br />
la forge et le Mwiri 220 . Lors d’un vol ou d’une dispute envenimée, on peut demander à un aîné<br />
du Mwiri de “taper le motεndo” (ou “taper le Mwiri”) afin que le génie punisse lui-même le<br />
coupable. L’initié applique sur la masse-enclume chauffée au feu un mélange d’herbes pilées<br />
et de jus de canne à sucre mâchée par les protagonistes du litige, afin de pouvoir éprouver leur<br />
culpabilité ou leur innocence. A l’aide d’une autre masse, il bat l’enclume, tout en invoquant<br />
le Mwiri et en lui expliquant l’affaire. Il jette ensuite à l’eau l’enclume ou bien un tronc de<br />
bananier qu’il a violemment frappé au sol. Ces opérations rituelles renvoient au mythe de<br />
découverte du Mwiri : jeter le motεndo ou un tronc de bananier dans l’eau comme les hommes<br />
avaient fait pour dominer le monstre, lui donner le coupable en pâture pour qu’il l’avale.<br />
Battre le motεndo chauffé au feu équivaut également à une forge symbolique – ce qui<br />
confirme le lien entre Mwiri et forge, le pouvoir ordalique du forgeron étant par ailleurs<br />
attesté dans la littérature (Collomb 1981).<br />
Une fois le motεndo tapé, le coupable ou le parjure tombera automatiquement malade.<br />
On dit alors qu’il est coincé dans le Mwiri, que ce dernier l’a attrapé ou même avalé. Les<br />
symptômes de ce mal sont un gonflement caractéristique du ventre et des jambes, suivi d’une<br />
mort rapide si rien n’est fait à temps. Le rituel de réparation a lieu au milieu du village, devant<br />
220 Aujourd’hui quasiment disparue, l’activité traditionnelle de la forge (réduction et fonte) était autrefois<br />
largement pratiquée, les vestiges archéologiques attestant sa présence au nord du Gabon dès 500 A.C. (de Maret<br />
1980, Pinçon & Dupré 1997, Clist 1995). La forge garde un rôle symbolique important dans de nombreuses<br />
sociétés initiatiques.<br />
-155-
le corps de garde, après aveux publics du coupable. Le mondonga, orateur et interprète des<br />
grondements rauques du Mwiri, se munit de la cloche à manche courbe kendo et invoque le<br />
génie pour lui demander de pardonner la faute commise et de recracher le coupable<br />
(Gollnhofer & Sillans 1978).<br />
Parallèlement à cet usage judiciaire du motεndo, il existe un usage plus asocial et<br />
moins avouable. Il arrive que quelqu’un aille secrètement voir un initié pour qu’il maudisse<br />
un ennemi personnel en tapant expressément le Mwiri afin de le rendre malade ou le tuer. Cet<br />
usage proche de l’agression sorcellaire explique pourquoi en français, le Mwiri est souvent<br />
appelé le Diable (on dit ainsi “taper le Diable”). Ce genre de pratique ferait alors du Mwiri<br />
non plus le garant de l’ordre collectif mais à l’inverse l’instrument d’une vengeance<br />
personnelle. C’est pourtant le Mwiri lui-même qui se charge de conjurer la menace introduite<br />
par le mésusage du motεndo : l’opérateur et le commanditaire d’un tel acte maléfique<br />
s’exposent de leur propre chef à ce que la puissance justicière du Mwiri se retourne contre<br />
eux. Paradoxalement, cette punition immanente qui garantit le Mwiri contre ses mésusages<br />
affaiblit par contrecoup son rôle régulateur : souvent dans un conflit, aucun des protagonistes<br />
ne craint que l’autre ne tape le motεndo, puisque, certain de son bon droit, chacun considère<br />
que son adversaire a indûment recouru au Mwiri et que cette attaque personnelle lui retombera<br />
dessus ; les deux parties iront donc taper le motεndo et le conflit s’envenimera.<br />
L’ordalie du poison constitue la seconde grande épreuve ordalique liée au Mwiri 221 . Ce<br />
poison à strychnine est obtenu par décoction des racines rouges de la liane mbondo (Strychnos<br />
icaja). Cette ordalie du mbondo est fort ancienne, puisque dans sa compilation de 1686,<br />
O. Dapper signale déjà sur la côte du Loango “l’épreuve des Bondes” qui sert à détecter<br />
l’origine sorcellaire d’une mort suspecte à l’aide d’un poison (repris dans Merlet 1991 : 393).<br />
Cette ancienneté se double d’une large diffusion : l’usage ordalique du poison est répandu<br />
dans tout le Gabon, et dépasse même le territoire national puisque le poison oraculaire benge<br />
des azande minutieusement décrit par Evans-Pritchard semble bien être encore le mbondo 222 .<br />
On recourt au mbondo pour les affaires les plus graves (meurtre, sorcellerie aggravée, vol<br />
important), lorsque le doute quant à l’identité du coupable subsiste après l’épreuve de<br />
l’enclume. Le mbondo est en effet réputé plus efficace que le motεndo, et son diagnostic est<br />
221 Je laisse de côté les ordalies secondaires, par l’huile bouillante (il faut attraper sans se brûler un objet<br />
métallique trempé dans de l’huile bouillante) et par la sagaie (une sagaie adhère ou non à la pierre sur laquelle on<br />
la pose).<br />
222 La description concorde : les azande des savanes du sud Soudan vont chercher jusqu’à l’orée de la forêt<br />
dense, de l’autre côté de la frontière nord du Congo, une liane rouge à base de strychnine (Evans-Pritchard<br />
1972). En revanche, le benge a un rôle oraculaire (prémonitoire), alors que le mbondo a un rôle ordalique<br />
(judiciaire).<br />
-156-
enommé infaillible 223 . Mais comme pour le motεndo, le pouvoir ordalique du mbondo est<br />
clairement lié au Mwiri : avant l’administration du poison, on tape au sol pour appeler le<br />
génie.<br />
Lorsqu’une affaire exige le recours au poison, tout le village se réunit au matin. Chez<br />
les mitsɔgɔ, la décoction de mbondo est administrée à des poules qui représentent les<br />
différentes personnes concernées. Si la poule survit, celui qu’elle représente est innocent.<br />
Mais si elle meurt, il est infailliblement coupable. Le fait que la volaille aille mourir aux pieds<br />
de la personne renforce encore la culpabilité. Si le coupable s’évertue à nier, on lui administre<br />
alors directement la décoction. L’administration directe a l’avantage de cumuler<br />
l’établissement de la culpabilité et la punition dans un raccourci imparable : la mort prouve<br />
définitivement la culpabilité du suspect 224 . Chez les bapunu, on administre toujours le poison<br />
aux hommes sans passer par les poules. Mais la dose ne semble pas léthale : le coupable est<br />
seulement plongé dans un état de grande confusion ; quant à l’innocent, évacuant rapidement<br />
le poison par voie urinaire, il reste indemne de tout symptôme. On raconte que celui qui<br />
réchappe ainsi de l’épreuve du poison en tire un pouvoir divinatoire 225 .<br />
4. Jurement, secret, serment<br />
Outre l’enclume et le poison, il existe une dernière façon de “taper le Mwiri” : il suffit<br />
de taper énergiquement sur ses propres scarifications initiatiques, au coude puis au poignet, en<br />
proférant avec emphase le jurement consacré “mangɔngɔ !”, “mwiri !” ou “kiivi !”. Ce geste<br />
ponctue abondamment les discours des initiés du Mwiri, c’est-à-dire théoriquement celui de<br />
tous les hommes. Quand un homme veut souligner emphatiquement ses paroles, pour en<br />
manifester l’importance et la véracité, et y engager sa responsabilité et celle des autres, il<br />
claque sur ses scarifications en jurant. Cela indique que les paroles énoncées “pèsent lourd”,<br />
qu’il ne s’agit plus de bavardages mais de paroles pouvant entraîner des conséquences graves.<br />
Claque et jurement sont ainsi une manière d’engager à la fois le locuteur et ses<br />
interlocuteurs dans leurs paroles et leurs actes. Une redescription linguistique adéquate<br />
consisterait à modaliser tous les énoncés par : “je jure sur le Mwiri que…”. Le geste tient<br />
223<br />
C’est pourquoi les nganga-a-Misɔkɔ disent que le mbondo est la première consultation, primauté à la fois<br />
chronologique et hiérarchique : l’ordalie du poison aurait précédée la divination par le miroir, et est de toute<br />
façon réputée plus fiable (car elle ne repose pas sur l’inspiration et la parole humaines).<br />
224<br />
Cette coïncidence – et même inversion – entre l’établissement de la preuve et la punition est une<br />
caractéristique générale des ordalies judiciaires.<br />
225<br />
Du Chaillu, qui a assisté à plusieurs reprises à l’ordalie du poison chez les nkɔmi, mentionne que le devin sans<br />
doute mithridatisé peut effectivement boire lui-même le poison. Dans un état convulsif, il se met alors à proférer<br />
des oracles inintelligibles (repris dans Merlet 1991 : 205-206).<br />
-157-
donc à la fois du serment et de la promesse. Du serment, puisqu’il atteste que ce que l’on dit<br />
est vrai. De la promesse, puisque cela implique que les actes évoqués dans les paroles seront<br />
effectivement accomplis. En effet, mentir ou ne pas faire ce à quoi l’on s’est engagé, ou<br />
même jurer pour des motifs trop futiles ou par colère, signifie s’exposer au châtiment<br />
magique du Mwiri. Et c’est pour éviter de tels engagements imprudents et impulsifs que le<br />
novice doit attendre jusqu’à un an avant de pouvoir jurer sur ses scarifications : il est encore<br />
incapable de contrôler ce pouvoir qui risquerait de se retourner contre lui et de le tuer. En<br />
définitive, le geste leste les paroles du poids du Mwiri afin de leur ajouter une force illocutoire<br />
décisive et de leur donner une valeur performative 226 .<br />
Ce jurement du Mwiri est réputé moins puissant que motεndo ou mbondo. Dans les<br />
circonstances les plus graves, jurer sur les scarifications peut être insuffisant ; on ira alors<br />
jurer sur le motεndo ; et si cela ne suffit pas, on recourra finalement au poison mbondo. Ces<br />
trois opérations rituelles n’ont de toute façon pas exactement les mêmes fonctions : attestation<br />
de vérité, promesse et obligation d’agir dans le cas du jurement ; ordalie judiciaire,<br />
identification et punition d’un coupable, dans le cas du motεndo et du mbondo. Mais elles<br />
tirent identiquement leur puissance du génie du Mwiri et concernent fondamentalement la<br />
véridicité, que cela soit celle du locuteur vérace ou de l’ordalie judiciaire.<br />
En définitive, le modèle de ces paroles jurées évoque une relation de communication<br />
idéale où les locuteurs sont responsables et véraces, où les promesses sont honorées et où les<br />
actes suivent effectivement les paroles. La pratique donne pourtant une image fort éloignée de<br />
ce modèle éthique de la communication : c’est en effet au cours des disputes que les hommes<br />
font le plus abondamment usage du jurement du Mwiri. Les situations réelles de jurement sont<br />
souvent plus proches de l’invective que du serment solennel. C’est donc paradoxalement<br />
lorsque la colère les emporte que les hommes ont recours à un acte illocutoire qui devrait<br />
normalement exiger calme et réflexion sous peine de représailles magiques. Le jurement<br />
s’infléchit en juron ou en malédiction que l’on pourrait paraphraser : “que le Mwiri t’avale !”.<br />
Il s’agit certes encore d’un énoncé performatif, mais sa signification diffère sensiblement du<br />
serment.<br />
Cette inflexion du serment vers la malédiction était déjà directement visible sur la<br />
scarification du coude qui dessine un sexe féminin stylisé. En effet, pour maudire, les femmes<br />
tapent ostensiblement sur leur sexe ou leurs fesses. Avec les marques du Mwiri, les hommes<br />
se donnent donc les moyens de maudire comme les femmes. Ce lien manifeste entre<br />
226 Les performatifs constituent une classe spécifique d’actes illocutoires : ceux pour lesquels la valeur illocutoire<br />
de l’énonciation est directement manifeste dans l’énoncé lui-même (Austin 1970, Searle 1972, Ducrot 1991).<br />
-158-
malédiction et sexe féminin est d’ailleurs pour eux la preuve que le Mwiri est bien le<br />
“mauvais côté” : côté gauche des femmes, et du même tenant, côté diabolique de pratiques<br />
dangereuses qui peuvent entraîner la mort. De là vient cette profonde ambivalence du Mwiri<br />
qui lui vaut ce surnom de “Diable”.<br />
Les initiés du Bwete qui évoquent ensemble les secrets initiatiques font également un<br />
usage abondant du jurement du Mwiri qui garde dans cette situation la valeur performative<br />
d’un serment. Le cas le plus typique est le jurement d’un aîné annonçant à un cadet qu’il va<br />
lui divulguer d’importants secrets. C’est moins une façon d’attester la vérité de ses propres<br />
dires que d’obliger son interlocuteur à ne pas trahir les secrets initiatiques : “si tu parles, le<br />
Mwiri t’avale !”. Ce type d’usage permet de saisir le lien essentiel qui unit Bwete et Mwiri<br />
autour des questions du secret, du serment et de la parole rituelle. L’initiation au Mwiri est en<br />
effet un préalable nécessaire pour accéder aux secrets les plus profonds du Bwete. Et les aînés<br />
savent bien mettre en scène les limites qu’ils doivent s’imposer avec un cadet du Bwete<br />
encore profane du Mwiri afin d’attiser sa frustration : “il faut se faire initier au Mwiri pour<br />
connaître les profondeurs du Bwete. Parce que là on est bloqué. […]Mais une fois initié dans<br />
le Mwiri, vous n’êtes pas libre de divulguer ça. Au contraire, c’est pire encore”. Cette<br />
frustration se fait même humiliation lorsque le garçon est publiquement assimilé à une<br />
femme.<br />
Si le profane du Mwiri est comme une femme et ne peut accéder aux secrets les plus<br />
importants, c’est parce que sa parole n’est pas encore fiable. Rien ne garantit en effet qu’il ne<br />
trahira pas, puisqu’il ne risque pas grand-chose : la sanction magique ricocherait du traître<br />
vers les aînés qui lui ont révélé ces informations et qui sont, eux, dans le Mwiri. Une fois<br />
initié, il ne peut en revanche plus trahir sous peine d’être lui-même avalé par le génie. Être<br />
initié au Mwiri signifie donc être pris dans les filets d’une justice magique, d’une sorte de<br />
police du secret qui garantit la non-divulgation des informations initiatiques aux profanes. Le<br />
Mwiri protège le Bwete.<br />
Cette caution du secret repose sur un épisode précis du rite de passage du Mwiri : le<br />
serment. Immédiatement après l’imposition des scarifications, on révèle aux mbuna que ce<br />
n’est pas un crocodile monstrueux qui leur a fait ces marques mais un simple initié. Les<br />
novices doivent alors faire aussitôt le serment solennel de ne jamais révéler ce secret aux<br />
profanes. S’ils trahissent sa nature humaine, ils mourront punis par le Mwiri. Cette menace de<br />
sanction repose donc encore sur le Mwiri, alors même que l’on vient de révéler que le génie<br />
n’existe pas. Mais les mbuna comprennent que les initiés se chargeraient eux-mêmes<br />
d’exécuter la sanction au nom du Mwiri. La démystification n’annule de toute façon pas la<br />
-159-
crainte : “même quand on sait que c’est telle personne qui imite le Mwiri, on a quand même<br />
peur”.<br />
Peu importe, en outre, que ce secret soit largement éventé et que les femmes sachent la<br />
vérité malgré leurs dénégations publiques. Le mythe de découverte du Mwiri ne raconte de<br />
toute façon pas autre chose : si ce sont les femmes qui les premières ont trouvé le Mwiri,<br />
avant que les hommes ne le leur arrachent, alors il est bien évident qu’elles savent depuis le<br />
début de quoi il retourne. Personne n’est dupe bien que les deux parties feignent de l’être :<br />
“les femmes connaissent le Mwiri car ce sont elles qui l’ont découvert en premier. Elles font<br />
juste semblant de l’ignorer” 227 .<br />
L’important réside plutôt dans le lien manifeste qui unit le serment initial, les<br />
scarifications, le secret initiatique et le jurement du Mwiri. En effet, le serment initial de ne<br />
pas dévoiler la nature humaine du Mwiri est bien ce qui fonde et assure l’interdit générique de<br />
divulgation de n’importe quel autre secret sous peine de sanction. L’expérience rituelle<br />
marquante des scarifications et du serment forme le prototype fondateur de la règle générale<br />
du secret initiatique. Il y a ainsi passage entre un secret particulier (la nature humaine du<br />
Mwiri) et le secret initiatique en tant que classe générique indéfinie. C’est pour cela qu’il<br />
importe finalement peu que le secret central du Mwiri soit éventé : il vaut moins par son<br />
contenu que par le fait qu’il instaure la configuration relationnelle nécessaire au respect de<br />
tous les secrets initiatiques, en liant serment, scarifications, jurement et sanction magique.<br />
Les cicatrices au bras gauche de l’initié sont en effet là pour rappeler ce lien<br />
constitutif. Les scarifications sont faites juste avant la révélation du secret et le serment. De<br />
plus, parce qu’elles le marquent irrémédiablement, l’initié est obligé de ne pas trahir les<br />
secrets. Enfin, c’est en tapant sur ces mêmes scarifications que l’on réitère pour soi et pour les<br />
autres l’obligation de la promesse. Les stigmates initiatiques du Mwiri sont donc une<br />
promesse inscrite dans la chair, cicatrices qui réactivent un engagement passé. Dans la<br />
seconde dissertation de la Généalogie de la morale, F. Nietzsche liait de façon similaire<br />
promesse, douleur, marque physique et dette (Nieztsche 1971) 228 . Ce qui permet de garantir au<br />
futur la promesse est cependant moins la pure sensation de douleur et son souvenir cuisant<br />
que les conditions rituelles de son imposition, avec sa configuration relationnelle novices-<br />
aînés-femmes (les aînés battent et scarifient les novices en faisant croire aux femmes que<br />
leurs enfants sont mis à mort). Il est toutefois patent que dans le Mwiri, la douleur joue<br />
également un rôle décisif, moins d’ailleurs par les scarifications elles-mêmes que par la<br />
227<br />
La situation inverse vaut pour les secrets initiatiques du Nyεmbε que les hommes ont, selon le mythe, laissé<br />
aux femmes en échange du Mwiri.<br />
228<br />
Sur la douleur dans le rituel, cf. également Houseman 1999.<br />
-160-
astonnade qui les précède. En tout cas, le Mwiri permet bien de “disposer à l’avance de<br />
l’avenir”, pour reprendre l’heureuse formule de Nietzsche, puisque par l’entremise des<br />
cicatrices et du jurement, sont liés le serment fait le jour du rite de passage et l’assurance de la<br />
non-divulgation future des secrets.<br />
On aboutit finalement à une situation paradoxale : l’initiation au Mwiri articule deux<br />
serments qui, sous un certain aspect, sont contradictoires. Le serment initial du rite de passage<br />
est un serment de silence : l’initié s’engage à ne pas trahir la nature humaine du Mwiri, c’est-<br />
à-dire à taire un secret. Or, ce secret repose sur un mensonge manifeste : on protège le secret<br />
de la nature humaine du Mwiri en racontant aux profanes qu’il est un génie. Il s’agit donc de<br />
ne pas dire la vérité, non par simple omission, mais bien par le recours délibéré au mensonge.<br />
Le serment de silence oblige à dire un mensonge pour taire la vérité. Ce serment initial rend<br />
ensuite possible un jurement qui revêt deux formes essentielles. D’une part, il contraint soi et<br />
les autres à taire continûment les secrets initiatiques. En cela, il reste un serment de silence.<br />
D’autre part, il permet de dire la vérité : obligation de dire le vrai sous peine de sanction, mais<br />
aussi, plus positivement, pouvoir de dire une vérité efficace. Il se fait alors serment de vérité.<br />
L’initiation au Mwiri constitue en définitive une procédure complexe d’assermentation<br />
de la parole de l’initié 229 . Les scarifications du Mwiri et les procédures rituelles qui lui sont<br />
associées scellent un lien entre secret et puissance de la parole. Elles permettent en effet<br />
d’établir que la parole masculine n’est une parole puissante et fiable, capable d’attester le vrai<br />
et de contraindre les autres, que pour autant qu’elle est capable de rétention, quitte à en passer<br />
par le mensonge. Dire et taire, vérité et mensonge sont mis en relation : pouvoir dire le vrai<br />
suppose de taire le secret en disant un mensonge.<br />
L’une des énigmes que posent parfois les initiateurs aux novices à leur entrée dans<br />
l’enclos initiatique dit :<br />
“Combien de cœurs l’homme possède-t-il ?<br />
– Deux : son cœur et sa pomme d’Adam !”<br />
Cette réponse énigmatique renferme l’une des principales raisons d’être du Mwiri. Le<br />
cœur est l’instance de la personne d’où proviennent les pensées, les désirs et les volitions 230 . Il<br />
s’agit d’une pulsion psychique plus que de la formation volontaire d’idées : un individu ne<br />
peut pas faire autrement que d’avoir ces pensées que son cœur lui envoie. Elles s’imposent à<br />
229 Une autre étape initiatique, appelée wanga obaka, s’inscrit dans ce même registre d’assermentation de la<br />
parole. L’initié doit piquer l’arbre obaka (Guibourtia tessmannii) d’un coup de sagaie. Ce rituel doit garantir que<br />
la parole de l’initié touchera toujours juste, aussi juste que son coup de sagaie.<br />
230 Le substantif “cœur” et le verbe “penser” sont d’ailleurs formés sur la même racine linguistique.<br />
-161-
lui avec une telle force qu’il se sent poussé à les exprimer en paroles. C’est là qu’intervient le<br />
second cœur : la pomme d’Adam agit comme un filtre, disposé entre le cœur et la bouche, qui<br />
retient ces paroles qui ne demandent qu’à sortir. Cette censure permet d’éviter de dire des<br />
paroles dangereuses : paroles d’emportement colérique et surtout secrets initiatiques. Le<br />
symbolisme de la plume de perroquet confirme cela. La plume rouge que les initiés du Bwete<br />
portent toujours au front symbolise la parole. Une aiguille est préalablement insérée dans son<br />
tuyau axial afin de pouvoir la ficher. Or, la tige de l’aiguille symbolise la trachée et son chas<br />
la pomme d’Adam. Ce montage rituel illustre que, tout comme seul un mince fil peut passer<br />
par le chas d’une aiguille, seules des paroles autorisées peuvent franchir le seuil de la pomme<br />
d’Adam d’un initié.<br />
La pomme d’Adam donne donc aux hommes une capacité de rétention verbale,<br />
capacité qui fait d’eux les maîtres de leur discours. Et c’est parce que les femmes n’ont pas de<br />
pomme d’Adam qu’elles sont censées ne pas pouvoir réfréner leurs bavardages et qu’on ne<br />
peut donc leur confier des secrets qu’elles ne sauraient garder. Ou plus exactement, depuis<br />
que les hommes se sont emparés du Mwiri féminin, les femmes n’ont plus de pomme<br />
d’Adam. En effet, dans le mythe d’origine, les hommes sacrifient les six femmes<br />
découvreuses du Mwiri dont l’une s’appelle justement la “femme qui a une pomme d’Adam”.<br />
On comprend finalement les véritables raisons du lien entre Bwete et Mwiri. On ne<br />
peut aller au bout du Bwete sans être un vrai homme, c’est-à-dire sans être initié au Mwiri.<br />
L’homme possède une pomme d’Adam, c’est-à-dire une capacité de rétention rituellement<br />
mise en forme par le jeu du serment et des scarifications du Mwiri. Il est alors suffisamment<br />
fiable pour qu’on lui confie les secrets initiatiques du Bwete. Cette parole assermentée est<br />
également une parole forte et efficace, parole qui promet, contraint et dit le vrai. La parole<br />
divinatoire du nganga-a-Misɔkɔ est donc elle aussi nécessairement adossée au Mwiri. D’où le<br />
fait que le motoba, auxiliaire principal de la divination, n’est normalement donné qu’à ceux<br />
qui sont déjà initiés au Mwiri.<br />
N’importe qui n’est donc pas apte à dire le vrai, promettre, maudire ou jurer. La force<br />
illocutoire des paroles exige une autorisation sociale. Chercher cette force illocutoire dans<br />
l’énoncé lui-même, c’est supposer à tort un pouvoir magique intrinsèque au verbe et<br />
corrélativement une égalité de tous devant la prise de parole – ce dont les performatifs<br />
donnent l’illusion, semblant contenir en eux-mêmes le principe de leur efficacité. Toute<br />
parole efficace suppose pourtant un porte-parole autorisé : les conditions de félicité de l’acte<br />
-162-
illocutoire ne sont pas linguistiques mais institutionnelles 231 . En effet, à travers un dispositif<br />
relationnel singulier, le rituel initiatique du Mwiri établit les conditions pragmatiques<br />
d’exercice de la parole des initiés masculins. Accomplir avec succès des actes illocutoires<br />
comme promesses, serments, jurements ou oracles suppose des conditions rituelles qui elles-<br />
mêmes présupposent tout un parcours initiatique.<br />
231 C’est le sens de l’objection de P. Bourdieu à J.L. Austin, lorsqu’il met en question l’autonomie linguistique de<br />
la théorie de l’illocutoire (Bourdieu 1982).<br />
-163-
Chapitre XI<br />
Le sexe du Bwete : l’appropriation rituelle du pouvoir féminin<br />
1. “Le Bwete, c’est la femme”<br />
Le chapitre précédent a révélé l’importance constitutive de la relation aux femmes et<br />
au féminin dans la mise en forme rituelle de la parole masculine opérée par le Mwiri. Le<br />
présent chapitre examine plus en détail comment s’organisent les relations entre les sexes<br />
dans le Bwete. Mettant en scène les différentes étapes de la procréation, une veillée de Bwete<br />
a logiquement besoin du concours, même purement symbolique, des femmes. Nous avons<br />
déjà relevé au chapitre VIII nombre d’éléments rituels associés au féminin (torche itsamanga,<br />
poudre de padouk tsingo, côté gauche du mbandja, etc.). Mais c’est en réalité le Bwete tout<br />
entier qui est placé sous le signe de la fécondité féminine. Comme pour le Mwiri, le mythe<br />
d’origine du Bwete raconte en effet une découverte féminine suivie d’une confiscation<br />
masculine.<br />
M 8 (origine du Bwete)<br />
“Un pygmée meurt en brousse. Son cadavre y pourrit. Un rat palmiste prend le<br />
crâne et l’emporte dans son terrier au bord d’une rivière. Plus tard, à la pêche au<br />
crabe, une femme déniche le crâne. Elle le ramène en secret au village. La nuit,<br />
le mort vient lui parler en rêve et lui demande d’allumer la torche et de lui parler<br />
afin qu’il ne reste pas dans le noir. Elle s’exécute et reçoit en échange des bons<br />
rêves et des révélations divinatoires. Cependant, au bout d’un temps, elle n’a<br />
plus le courage de continuer à s’occuper du crâne. Elle dévoile alors le secret à<br />
son mari qui lui confisque le crâne et s’empare ainsi du Bwete [dans une autre<br />
version, le mari espionne sa femme et l’assassine].”<br />
Ce type de scénario se retrouve en réalité dans la plupart des sociétés initiatiques<br />
masculines de l’aire gabonaise : “toutes les religions chez nous les Noirs ont été découvertes<br />
par les femmes. Mais par manque de courage [des femmes], les garçons ont arraché ça”.<br />
Outre le Mwiri et le Bwete, cela concerne au moins le Kɔnɔ (mitsɔgɔ), le Mongala (groupe<br />
kota-kele), le Nzεgo (masangu, bavove), le Ndjobi (Haut-Ogooué) et l’Okukwe (myεnε). Cette<br />
trame mythique se retrouve même dans des aires culturelles fort différentes (en Afrique,<br />
Mélanésie, Australie ou Amazonie, que la découverte concerne des flûtes, des rhombes, des<br />
masques, des génies ou tout autre ritualia). Cette large distribution témoigne d’une<br />
remarquable constance dans la structuration des sociétés initiatiques masculines : le secret des<br />
hommes concerne toujours les femmes, et cela à double titre. Comme forme relationnelle, le<br />
secret initiatique exclut les femmes, la frontière entre initiés et profanes reconduisant la<br />
-164-
division sexuelle. Mythe et rite servent ainsi à légitimer un ordre sexuel inégalitaire 232 . Et du<br />
point de vue de son contenu, le secret initiatique est explicitement ou implicitement lié au<br />
pouvoir procréateur féminin qui échappe au contrôle des hommes 233 .<br />
Selon un schéma similaire à celui du Mwiri, le Bwete découvert par les femmes est en<br />
effet déjà féminin par nature : “le Bwete, c’est la femme”. Pour les initiés, cette femme<br />
générique vaut d’abord par son sexe, c’est-à-dire par sa capacité à mettre au monde des<br />
enfants 234 . C’est pourquoi le Bwete revêt d’abord la figure de la mère aimante qui prend soin<br />
de tous les enfants initiés : ainsi en va-t-il de Disumba, Myɔbε ou Ngɔndε qui donnent leur<br />
nom aux diverses branches de la société initiatique. Lorsque les hommes s’emparent de la<br />
trouvaille de leurs femmes et les en excluent, il s’agit donc fondamentalement d’une<br />
appropriation masculine du pouvoir procréateur féminin.<br />
Mais cette focalisation rituelle sur le sexe féminin est en réalité profondément<br />
ambivalente : “le sexe de la femme, c’est mauvais, mais c’est bon. […] Là-dedans, il y a la<br />
chance ou la malédiction”. Le sexe féminin et plus encore le clitoris représentent le comble de<br />
l’impureté. C’est un endroit maudit, les femmes se frappant effectivement le sexe ou les<br />
fesses en signe de malédiction. C’est aussi un endroit maléfique, explicitement associé à la<br />
sorcellerie. Les initiés n’ont de cesse de clamer que le clitoris ou le vagin est le vampire de la<br />
femme. Le mythe fang de l’origine de l’organe de sorcellerie evus raconte d’ailleurs comment<br />
le monstre evus a quitté la forêt pour parvenir au village caché dans le sexe d’une femme qui<br />
l’avait recueilli (Bureau 1996 : 170-173) 235 . Si la lettre de ce mythe ne se retrouve pas plus au<br />
sud, son esprit y est bien présent. Selon un père initiateur, pour vérifier que toute femme est<br />
une sorcière, il suffit d’attendre son sommeil et de placer un miroir devant son sexe ouvert : le<br />
reflet la montrera sous sa vraie nature, avec des cornes comme un démon. Et les initiés<br />
ajoutent que ce vampire clitoridien surpasse en puissance leur propre vampire. Le sexe<br />
féminin recèle donc la même ambivalence que le vampire nzanga : dangereux car puissant.<br />
Ceci explique la prohibition du cunnilingus, interdit initiatique fondamental :<br />
“interdiction quand vous faites l’amour à une femme de mettre la langue dans son sexe. Cela<br />
pourrait anéantir tout le Bwete dans votre corps. Vous deviendriez plus faible qu’avant. Le<br />
232 Au Gabon, c’est sur les femmes que repose l’essentiel des travaux de plantation (hormis l’abattage à la saison<br />
sèche). Exploitées pour leur force productive, les femmes sont en outre exclues de la sphère politique, ne<br />
pouvant normalement prendre la parole en public. Les mécanismes rituels et les jugements de valeur au principe<br />
de cette exclusion ont été examinés au chapitre précédent.<br />
233 F. Héritier souligne bien la prégnance de cette “volonté de contrôle de la reproduction de la part de ceux qui<br />
ne disposent pas de ce pouvoir particulier” (Héritier 1996 : 25).<br />
234 Les représentations féminines qui abondent dans le rituel renvoient avant tout au vagin (cauris, losanges,<br />
couleur rouge) et à sa fécondité (sirènes, voyage en pirogue sur un lac).<br />
235 Le mythe est également présent plus au nord chez les bëti du sud Cameroun (Mallart-Guimera 1981 : chap. I).<br />
-165-
sexe de la femme, c’est le porte-malheur. Leur appareil-là [clitoris], c’est un dominateur,<br />
cela anéantit tout. C’est une place de malédiction”. D’une part, le cunnilingus constitue une<br />
remontée à contresens du chemin de la vie : “tu es sorti par là, tu ne peux pas encore lécher<br />
ça”. Il y a ainsi une nette inversion symbolique à propos du sexe féminin : le lieu d’où<br />
provient la vie est pour les hommes le lieu de la mort. D’autre part, le contact immédiat avec<br />
le puissant vampire féminin représente une menace de négation du pouvoir masculin. Outre<br />
l’anéantissement du pouvoir initiatique et le risque d’impuissance sexuelle, le cunnilingus<br />
entraînerait en effet le renversement de la domination masculine : “la femme te maudit avec le<br />
bwete-là [clitoris ou vagin]. Tu deviens fou. Tu lui obéis aveuglément, tu la suis comme un<br />
chien” 236 . Et ce n’est pas un hasard si les initiés disent du sexe féminin qu’il est un<br />
“dominateur”.<br />
Si le sexe féminin est dangereux pour les hommes, seul le cunnilingus fait pourtant<br />
l’objet d’une prohibition définitive, alors que d’autres pratiques sexuelles comme la<br />
masturbation de la partenaire ne nécessitent ensuite qu’une purification rituelle. Le<br />
cunnilingus n’est pas une pollution lavable mais une souillure définitive. Le danger est<br />
maximal car il y a contact direct entre le vagin et la bouche. Deux substances incompatibles<br />
sont alors mises en relation : les sécrétions vaginales et les maganga au fond du ventre de<br />
l’initié. En effet, l’acidité de la cyprine est analogue à l’acidité nocive des légumes<br />
temporairement prohibés : elle risque de détruire la puissance d’edika et motoba. Cela<br />
n’explique cependant pas tout, puisque la prohibition des légumes ou du citron est seulement<br />
temporaire, alors que l’interdit du cunnilingus est définitif.<br />
La nocivité réside en réalité dans la contiguïté néfaste entre le sexe féminin et la<br />
langue masculine. Cette menace s’exprime parfois sous forme d’une peur fantasmatique : dès<br />
que sa langue touche le sexe de sa partenaire, l’homme reste “collé”. La langue renvoie<br />
évidemment à la parole. Or, le pouvoir masculin repose essentiellement sur la parole dont<br />
l’emblème est le chasse-mouches brandi par tout orateur : pouvoir public des palabres<br />
(éloquence) et surtout pouvoir secret des invocations initiatiques (efficacité magique). Et sans<br />
la parole divinatoire, le nganga-a-Misɔkɔ n’est plus rien. De son côté, le vagin renvoie<br />
explicitement à la procréation, source essentielle du pouvoir féminin. Si la conjonction de la<br />
langue de l’homme et du sexe de la femme est si dangereuse, c’est donc parce que le pouvoir<br />
naturel de la procréation menace le pouvoir initiatique de la parole. Selon la déclaration d’un<br />
236 Dans cette citation, le signifiant flottant bwete sert ironiquement à désigner le sexe féminin.<br />
-166-
initié, le cunnilingus entraîne ainsi le risque que “ça ne parle plus comme avant” – ça<br />
désignant les fétiches et le Bwete. Le sexe des femmes annule la parole du Bwete 237 .<br />
Cette conjonction du sexe féminin et de la parole se retrouve dans les significations<br />
secrètes associées à la plume de perroquet. La plume représente, à un premier niveau, la<br />
langue et la parole du nganga, et à un niveau plus profond, le vagin dont l’intérieur est rouge<br />
comme la langue et la plume. Derrière la parole du nganga se dissimule le sexe de sa femme.<br />
Mais ce qui est conjoint dans le rituel doit être soigneusement disjoint dans le réel. D’où la<br />
prohibition du cunnilingus qui doit empêcher le redoublement de la conjonction : “si tu<br />
touches le sexe de la femme, tu vas encore toucher le Bwete. Ta puissance [sexuelle comme<br />
rituelle] s’anéantit”.<br />
Dans le rituel, parole du nganga et sexe féminin sont donc intimement liés, puisque le<br />
pouvoir de la première repose sur la captation de la puissance procréatrice du second. Le<br />
Mwiri avait déjà révélé une configuration similaire à travers le lien entre la scarification du<br />
coude en forme de sexe, le serment et le jurement. De là finalement la nature féminine du<br />
Bwete et du Mwiri et les histoires de confiscation masculine à leur origine. Cette<br />
appropriation rituelle du pouvoir procréateur féminin dans le Bwete et le Mwiri est fort<br />
classiquement au principe de la renaissance initiatique, procréation masculine sans le secours<br />
des femmes. Mais, à travers le nouage singulier entre langue et sexe, elle s’opère également<br />
au profit de la parole efficace des initiés.<br />
En définitive, Bwete et Mwiri sont en grande partie un ressassement de l’ambivalence<br />
du sexe féminin. Du point de vue des hommes, ce sexe est à la fois bénéfique et maléfique,<br />
puissant et dangereux, impur et convoité. Et ces poteaux mitan de mbandja du Bwete sur<br />
lesquels est peint un sexe féminin avec un écoulement bien apparent de sang menstruel fait<br />
sauter aux yeux cette ambivalence : le poteau central qui concentre toute la puissance<br />
bénéfique du corps de garde expose à la vue de tous des menstruations polluantes 238 . Tout se<br />
passe comme si les hommes tournaient en rond autour de cette ambivalence – ce que les<br />
danses autour du poteau central accomplissent d’une certaine façon. Mais ce ressassement est<br />
productif puisqu’il est au principe d’un long parcours rituel et d’une parole efficace au statut<br />
complexe.<br />
237 Les contacts cyprine-maganga et vagin-langue sont donc nocifs pour les mêmes raisons. Les sécrétions<br />
vaginales, gâtant l’intérieur du ventre, condamnent au silence ces auxiliaires incorporés de la parole divinatoire<br />
que sont edika et motoba.<br />
238 Une femme en période de menstruation ne peut ni cuisiner, ni puiser de l’eau, ni surtout pénétrer au corps de<br />
garde ou approcher les affaires rituelles de son mari. Autrefois, elle devait même rester recluse dans une case<br />
spéciale ou dans la cuisine.<br />
-167-
2. Les femmes, profanes du Disumba<br />
Poteau d’un mbandja<br />
Pommeau de canne rituelle<br />
Dans le Bwete Disumba, les femmes restent du côté des profanes. Elles doivent<br />
néanmoins être présentes aux veillées, à titre de spectatrices des séquences publiques. Les cas<br />
des danses de masques illustre bien le rôle que les femmes ont à tenir. Au cours des veillées<br />
-168-
de Disumba, les esprits migɔnzi (sing. mogɔnzi) se manifestent sous forme de masques qui<br />
dansent à tour de rôle. Ils appartiennent en majorité à la catégorie des masques blancs qui<br />
regroupe une multitude d’esprits plus ou moins différenciés et individualisés 239 . Les migɔnzi<br />
apparaissent nuitamment au bout du village, alors que les hommes sont massés à une<br />
vingtaine de mètres à côté du corps de garde. Les femmes et les enfants sont également<br />
présents mais un peu en retrait du groupe des initiés. Deux initiés portant des flambeaux<br />
courent jusqu’au bout du village pour y chercher le mogɔnzi. Ils l’éclairent ensuite le temps de<br />
sa danse. Puis, flambeaux éteints, l’esprit repart dans l’obscurité. L’apparition est donc à la<br />
fois tangible et ténue : le mogɔnzi n’apparaît que brièvement, au loin, faiblement éclairé par la<br />
lueur vacillante des flambeaux.<br />
Il importe que ces sorties de masques restent un spectacle éloigné. Lorsqu’un mogɔnzi<br />
fait mine de s’approcher des spectateurs, c’est la débandade. Les migɔnzi sont en effet censés<br />
être des ancêtres morts – plutôt féminins – qui reviennent visiter les vivants. Leur venue est<br />
bénéfique, mais leur contact direct est dangereux, étant réputé provoquer maladie ou folie.<br />
Les profanes doivent donc toujours se tenir à distance respectable, et les initiés eux-mêmes se<br />
gardent bien d’approcher de trop près 240 . Certains migɔnzi sont même si redoutables qu’ils<br />
imposent la claustration des profanes dans les habitations. Cette ambivalence des migɔnzi<br />
donne au spectacle son ton émotionnel si marqué – mélange de crainte, d’amusement et<br />
d’intense excitation –, qui en fait une occasion à ne pas rater.<br />
Mogonzi dansant<br />
239<br />
Ces masques anthropomorphes en bois badigeonnés au kaolin blanc relèvent d’un ensemble régional qui<br />
couvre en fait tout le bassin de l’Ogooué.<br />
240<br />
Et il faut toujours respecter la perspective frontale pour éviter que les profanes, arrivant par-derrière la scène,<br />
ne voient l’envers du décor. Toute position de biais est ainsi perçue comme une tentative d’effraction du secret<br />
initiatique.<br />
-169-
Mogonzi disparaissant<br />
L’assistance profane des femmes joue un rôle crucial, puisque c’est à elle qu’est<br />
directement destiné le spectacle des migɔnzi. Leur présence est en effet nécessaire pour que<br />
des masques en bois portés par des hommes de chair deviennent de dangereux fantômes. Ce<br />
n’est pas une question de crédulité. Malgré leurs dénégations publiques, les femmes savent<br />
que les migɔnzi cachent des hommes. Et les hommes ne sont eux-mêmes pas dupes que les<br />
femmes ne sont pas dupes, et le reconnaissent volontiers en privé. Malgré le savoir largement<br />
partagé qu’il s’agit d’une mascarade, tout le monde agit pourtant comme si les migɔnzi étaient<br />
réellement des revenants. Cela tient, non à la mauvaise foi ou au respect hypocrite de la<br />
tradition, mais aux comportements manifestes des femmes et des hommes les uns envers les<br />
autres, c’est-à-dire à une forme spécifique d’interaction entre initiés et profanes 241 .<br />
Les hommes savent que les migɔnzi sont des masques, mais agissent comme si les<br />
femmes ne le savaient pas : en les mettant en garde et en les tenant en retrait. De leur côté, les<br />
femmes savent également que les migɔnzi sont des masques, mais agissent comme si les<br />
hommes ne savaient pas qu’elles le savaient : en criant et s’enfuyant à l’approche des<br />
masques. Chaque partie agit ainsi en imputant à l’autre partie une crédulité imaginaire : les<br />
hommes imputent aux femmes une crédulité à l’égard des migɔnzi ; les femmes imputent aux<br />
hommes une crédulité à l’égard de leur propre croyance. Ce faisant, chacun dupe l’autre et est<br />
dupé en retour. De cette dynamique relationnelle en forme de renforcement symétrique résulte<br />
l’efficacité propre du spectacle. Les deux parties sont ainsi portées à y croire quand même un<br />
peu, en dépit de l’incrédulité partagée.<br />
Cette ambivalence réflexive concernant la nature véritable des migɔnzi touche autant<br />
les hommes que les femmes. La débandade des femmes conforte les hommes dans l’idée que<br />
le secret doit continuer de protéger la mascarade. Mais cela leur fait également penser sur le<br />
mode du “je sais bien mais quand même” (Mannoni 1969) que les migɔnzi doivent bien, d’une<br />
241 Sur les interactions entre hommes et femmes dans les mascarades, cf. Houseman 2002, Smith 1984.<br />
-170-
manière ou d’une autre, être un peu plus que de simples hommes masqués : après m’avoir<br />
dévoilé l’artifice des masques, les hommes trouvaient en effet toujours des arguments pour<br />
me prouver que les migɔnzi étaient réellement dangereux. C’est pourquoi l’implication des<br />
femmes comme spectatrices est si importante : les hommes ont besoin des femmes pour croire<br />
eux-mêmes un peu à leur propre pouvoir rituel. S’il semble au premier abord que ce soient les<br />
hommes qui dupent les femmes par le jeu des masques, c’est en réalité tout autant l’inverse<br />
qui est vrai.<br />
Il y a dans le Disumba une occasion où les femmes sont amenées à tenir un rôle non<br />
plus de spectatrices mais de figurantes dans la cérémonie. Lors d’une initiation ou d’un retrait<br />
de deuil, les hommes convoquent deux femmes du clan des banzi ou du mort. Ces femmes,<br />
appelées yombo, doivent s’asseoir de chaque côté du corps de garde, adossées aux poteaux<br />
latéraux. Maquillées de kaolin rouge, tressées, poitrine nue et plume de perroquet au front,<br />
elles râpent sur leurs cuisses la poudre rouge de padouk (tsingo). C’est la seule occasion où<br />
des femmes sont autorisées à s’asseoir au corps de garde à côté des initiés masculins. Les<br />
deux yombo sont là pour figurer que le Bwete est femme et mère. Les hommes demandent<br />
donc ironiquement aux femmes de figurer elles-mêmes le secret de l’origine féminine et de la<br />
confiscation masculine du Bwete. Ils ont besoin des femmes pour qu’elles exhibent elles-<br />
mêmes le secret de leur exclusion sur la scène rituelle. Le secret initiatique repose ainsi sur<br />
une forme relationnelle complexe : ce sont les interactions entre initiés et profanes – la<br />
débandade des femmes et la stature figée des yombo – qui font exister le secret 242 .<br />
3. Les femmes, initiées du Misɔkɔ<br />
Contrairement au Disumba, les femmes peuvent parfois être initiées au Misɔkɔ et<br />
prennent alors le nom de mabundi 243 . Cette innovation provient à l’origine des bavove ou des<br />
masangu et date sans doute d’une cinquantaine d’années au plus. La situation initiatique des<br />
Mabundi est doublement singulière : vis-à-vis des autres initiations féminines, vis-à-vis du<br />
Bwete masculin 244 . Les Mabundi sont clairement liées au Nyεmbε (ou Ndjεmbe), la principale<br />
société initiatique féminine largement répandue dans le sud du Gabon (groupes myεnε,<br />
mεmbε, mεryε, nzεbi). Équivalent féminin du Mwiri, le Nyεmbε est un rite de passage qui<br />
consacre l’intégration des jeunes filles à la communauté des femmes (Dupuis 1983). Or, les<br />
242 C’est l’intuition centrale de G. Simmel (1996) : le secret relie et sépare tout à la fois.<br />
243 Fréquemment dans le Ngɔndε ou le Sengedya, plus rarement dans le Myɔbε, branche la plus liée au Disumba.<br />
244 J’écris mabundi pour une initiée, mais Mabundi pour le collectif qui les subsume.<br />
-171-
éférences au Nyεmbε sont omniprésentes chez les Mabundi : colliers de perles, danse ou petit<br />
tambour à membrane mokiki sont en effet communs aux deux sociétés initiatiques. Pour avoir<br />
accès aux secrets les plus profonds, les mabundi doivent en outre être initiées au Nyεmbε. Il<br />
existe donc le même lien intime entre Mabundi et Nyεmbε qu’entre Bwete et Mwiri.<br />
Mabundi<br />
Les Mabundi constituent en outre la seule initiation féminine axée sur la vision et non<br />
sur la possession. La possession est en effet au centre de tous les cultes thérapeutiques<br />
féminins (Ombudi, Ombwiri, Abanzi, Elɔmbo, Mbumbayano, Olɔgɔ, Mugulu ou Abambo)<br />
largement répandus dans les groupes myεnε, mεmbε et mεryε. Un génie, souvent associé à un<br />
parent défunt, tourmente la malade qui va alors devoir accepter d’être possédée afin de<br />
retourner l’affliction en une protection bénéfique. L’initiation ouvre ainsi la voie à une<br />
possession institutionnalisée, permettant de se concilier le génie en apprenant à contrôler les<br />
crises de possession (Gollnhofer & Sillans 1974, Gollnhofer & Sillans 1979). Or, ces crises<br />
font l’objet d’une désapprobation unanime chez les Mabundi – ce qui ne les empêche pas de<br />
survenir régulièrement puisque les femmes ont souvent déjà été initiées à un culte de<br />
possession. A partir du moment où les femmes accompagnent les hommes dans le Bwete,<br />
elles doivent en effet accepter d’abandonner la possession pour endosser le modèle masculin<br />
de la vision 245 .<br />
Les Mabundi marquent ainsi l’inclusion des femmes dans le Bwete Misɔkɔ. Cette<br />
inclusion ne signifie toutefois pas mixité : hommes et femmes conservent des statuts<br />
différents et le travail rituel repose sur une stricte division sexuelle. Quel type d’interactions<br />
se noue entre hommes et femmes, dès lors qu’il ne s’agit plus d’un rapport entre initiés et<br />
245 Lorsqu’un homme est victime de crises de possession, il doit aller se faire initier chez les femmes (tous les<br />
cultes de possession, bien que majoritairement féminins, sont ouverts aux hommes).<br />
-172-
profanes mais entre deux catégories spécifiques d’initiés ? Au premier abord, les rapports<br />
entre nganga et mabundi semblent être de complémentarité symétrique. Ceci est bien marqué<br />
par l’alternance sexuelle des séquences rituelles ou par la division spatiale (hommes et<br />
femmes se font face de chaque côté du corps de garde). Tout se passe comme si nganga et<br />
mabundi constituaient les deux moitiés complémentaires du Bwete : “dans le Bwete, c’est<br />
toujours deux. S’il y a l’homme, il y a la femme”. L’inclusion des femmes serait venu combler<br />
un défaut originel, l’oubli des femmes amputant le rituel : le côté gauche du mbandja figurait<br />
abstraitement l’élément féminin, il est maintenant occupé par des femmes en chair et en os 246 .<br />
Cette complémentarité harmonieuse cache pourtant la réalité de la domination rituelle<br />
masculine : “s’il n’y a pas de femmes dans une veillée, c’est moche. C’est pourquoi elles sont<br />
là avec nous. Mais à une étape, elles sortent. Elles ne peuvent pas arriver à notre niveau.<br />
Jamais, ô grand jamais. Parce que c’est nous les suprêmes”. Cette subordination se vérifie<br />
partout dans l’organisation rituelle. Les mabundi ne sont pas autorisées à jouer de l’arc<br />
musical, souffler la corne d’appel ou battre les tambours. Pour prendre la parole, elles doivent<br />
s’accroupir, visage baissé, dans une position d’humilité soumise. Les hommes s’assoient à<br />
droite et les femmes à gauche du corps de garde ; mais seuls les aînés masculins ont le droit<br />
de se placer contre la paroi du fond auprès des mikuku. Les nganga peuvent veiller sans<br />
mabundi, mais l’inverse n’est pas vrai. Un père initiateur du Misɔkɔ peut initier des femmes,<br />
mais une mère initiatrice des Mabundi ne peut initier des hommes. Les femmes sont exclues<br />
des étapes initiatiques les plus importantes : elles peuvent manger edika, mais jamais avaler<br />
motoba ou traverser le Bwete ; elles ne peuvent assister ni à la préparation de leur propre<br />
edika, ni à la purification de leur propre corbeille rituelle. Elles n’ont pas accès aux derniers<br />
secrets initiatiques et doivent ignorer en définitive ce qu’est véritablement le Bwete.<br />
Ces interdits imposés aux femmes n’ont d’autre but que de perpétuer une domination<br />
masculine qui ne tient justement qu’à l’exclusion des secrets initiatiques : “si l’homme dit tout<br />
à sa femme, que lui reste-t-il pour la dominer ?”. Un nganga doit donc prendre garde de ne<br />
pas “vomir le secret sur l’oreiller”, même si sa compagne est comme lui initiée au Bwete. Les<br />
mabundi restent prises dans ce schéma d’exclusion du secret. Tout se passe comme si elles<br />
n’étaient acceptées dans les veillées de Misɔkɔ que pour y figurer l’origine féminine du Bwete,<br />
soigneusement soulignée par leur coiffure et leur maquillage. Les trois tresses “civils” des<br />
mabundi dessinent en effet un sexe féminin et leur maquillage de kaolin rouge figure le sang<br />
menstruel. Les mabundi arborent donc symboliquement leur sexe sur leur tête. Mais lorsque<br />
246 Dans la branche Ngɔndε (lune), la jumelle des mabundi s’appelle modanga (clair de lune). Les hommes de la<br />
lune sont donc naturellement appariés aux femmes du clair de lune.<br />
-173-
viennent les choses sérieuses, elles doivent laisser les hommes entre eux. Les mabundi sont<br />
dans une situation finalement assez proche des deux yombo du Disumba, les figurantes<br />
féminines ayant seulement réussi à obtenir un rôle plus étoffé, quelques tours de danse et de<br />
chant sur la scène rituelle. Les hommes demandent ironiquement aux femmes d’être présentes<br />
dans le rituel pour y manifester leur subordination. Les mabundi restent ainsi les destinataires<br />
et non les dépositaires des secrets du Bwete. Sauf que par un redoublement de la ruse rituelle,<br />
elles font maintenant partie de la société initiatique. L’inclusion des femmes dans le Bwete est<br />
donc moins une concession des hommes qu’un moyen subtil – presque pervers – de<br />
manifester autrement l’exclusion du secret.<br />
Ceci n’est toutefois pas la seule façon possible de concevoir la présence des femmes<br />
dans le Bwete. Le statut initiatique des Mabundi est en effet problématique : il n’est pas clair<br />
si elles forment ou non une branche autonome du Bwete 247 . Si ce n’est pas le cas, elles sont<br />
condamnées à rester subordonnées aux initiés masculins. Mais si c’est le cas, la nature des<br />
interactions rituelles entre hommes et femmes s’en trouve modifiée. Or, la constitution en<br />
branche autonome est ce vers quoi tendent activement les mabundi, du moins les plus<br />
ambitieuses d’entre elles. En effet, les femmes jouent souvent la différenciation afin de<br />
minimiser leur subordination : leurs fétiches diffèrent de ceux des hommes ; le parcours<br />
initiatique des Mabundi comprend des étapes spécifiques interdites aux hommes (en raison de<br />
l’intégration nécessaire au Nyεmbε).<br />
Il n’est ainsi pas rare que les mabundi tentent de créer une atmosphère de secret,<br />
symétrique de l’attitude masculine à leur égard. Habituellement, un edika féminin comporte<br />
une confection purement masculine, puis un repas commun réunissant hommes et femmes<br />
initiés. Mais certaines mabundi insistent parfois pour exclure les hommes du repas, voire pour<br />
se réserver la confection de leur paquet d’edika, n’y acceptant que le père initiateur. La<br />
réussite de telles tentatives dépend de l’état singulier des rapports de force dans la<br />
communauté locale : une mabundi entreprenante peut obtenir l’exclusion des hommes lors<br />
d’une veillée d’edika, mais devoir céder lors d’une autre cérémonie. Les rapports entre<br />
hommes et femmes au sein du Bwete sont donc pris dans des relations dynamiques instables.<br />
Il y apparaît clairement l’ébauche d’une schismogenèse symétrique tendant à ériger les<br />
Mabundi en branche autonome 248 .<br />
247 Cette incertitude se retrouve dans la terminologie : le terme mabundi désigne tantôt une initiée, tantôt le<br />
collectif des initiées, tantôt l’éventuelle branche qui les subsume.<br />
248 Pour G. Bateson, la schismogenèse est un processus de différenciation dans les normes comportementales<br />
résultant d’interactions cumulatives (Bateson 1971 : chap. 13, “Contact culturel et schismogenèse” in Bateson<br />
1977). Il distingue schismogenèse complémentaire (modèle de la soumission) et schismogenèse symétrique<br />
(modèle de la compétition).<br />
-174-
Cette tension schismogénétique se retrouve également dans la volonté des mabundi de<br />
se référer à une lignée initiatique féminine. Les femmes disent souvent “mes Mabundi me<br />
disent que…” plutôt que “mon Bwete me dit que…”, comme si leur pouvoir divinatoire<br />
provenait d’un génie spécifiquement féminin. En outre, dans une communauté où le père<br />
initiateur initiait lui-même les femmes, les mabundi faisaient pourtant constamment référence<br />
à la mère initiatrice décédée qui avait autrefois donné au père ce pouvoir d’initier les femmes.<br />
C’est cette mère qui dans leurs visions leur transmettait nom et pouvoir initiatiques. A côté du<br />
père initiateur réel, les initiées ont donc besoin d’une mère même absente. Enfin, les mabundi<br />
préfèrent prendre le savoir initiatique auprès d’aînées plutôt que de leur propre père initiateur.<br />
Tout cela contribue à créer au sein d’une même communauté un sous-groupe initiatique<br />
féminin séparé des nganga.<br />
Les Mabundi ont ainsi tendance à se constituer en branche autonome dotée de secrets<br />
propres, ce que montre bien l’image de la bifurcation des chemins : “vous, vous avez votre<br />
côté. Nous, on a notre côté. Quand tu t’es fait initier, tu as pris ton chemin, tu as laissé celui<br />
des Mabundi. Le côté des hommes, je ne connais pas. Mais du côté femme, je connais. Moimême<br />
j’ai vu. Si ta femmeétait là et était initiée, je devais lui dire, voilà les Mabundi, c’est<br />
ça”. Il y a d’un côté les secrets des hommes et de l’autre les secrets des femmes. Il ne s’agit<br />
plus ici de secrets provenant de deux sociétés initiatiques distinctes, comme c’est<br />
habituellement le cas. Les secrets masculins du Mwiri ne concernent pas directement les<br />
secrets féminins du Nyεmbε – même si les profanes des uns sont les initiés des autres –,<br />
puisqu’il n’existe aucun lieu de rencontre entre les deux. Mais dans le cas présent, la<br />
confrontation des secrets joue à l’intérieur d’une même société initiatique. Le secret ne<br />
concerne alors plus un profane mais un co-initié de l’autre sexe. C’est toute la structure<br />
relationnelle du secret qui s’en trouve bouleversée.<br />
La voie des nganga et la voie des mabundi, chacune jalonnée de secrets spécifiques,<br />
ne cessent en effet de se croiser sur le chemin du Bwete Misɔkɔ. Tous se retrouvent dans les<br />
mêmes veillées pour accomplir collectivement un travail rituel. Secrets des hommes et secrets<br />
des femmes trouvent là leur lieu d’articulation. Un même objet ou un même geste rituel peut<br />
en effet revêtir des significations différentes selon que l’on est un initié masculin ou féminin.<br />
Pour les mabundi, la grosse torche centrale figure le cadavre de leur mari qu’elles sont en<br />
train de pleurer. Pour les hommes, cette même torche figure le sexe féminin qu’ils sont en<br />
train de féconder. Pour chacun des deux sexes, la torche renvoie donc ironiquement au sexe<br />
opposé. Le même rituel peut ainsi être vu selon deux perspectives sexuellement orientées et<br />
non superposables. Hommes et femmes accomplissent de concert un travail rituel qui possède<br />
-175-
pourtant des sens secrets mutuellement exclusifs. Chaque secret masculin se double<br />
virtuellement d’un secret féminin. Peu importe que les deux faces du secret se recouvrent<br />
parfois. Peu importe également que les uns puissent extorquer quelques-uns de leurs secrets<br />
aux autres. La symétrie opaque des secrets est d’abord une question de forme relationnelle : la<br />
division sexuelle crée du secret à l’intérieur de la société initiatique. Du simple fait qu’il y a<br />
dans le corps de garde des hommes à droite et des femmes à gauche, le secret existe.<br />
Le rapport entre ces deux faces du secret est instable, dans la mesure où le mode<br />
d’inclusion des mabundi dans le Bwete n’est lui-même pas tranché (sans doute parce qu’il<br />
s’agit d’une innovation récente). L’évolution du processus schismogénétique dépend de la<br />
réaction des hommes face à cette tendance autonomiste des mabundi. La position maximaliste<br />
maintient autant que possible les mabundi à l’écart des secrets du Bwete 249 . Une subordination<br />
stricte en fait des initiées inférieures, en marge d’un secret qui reste masculin. L’exclusion<br />
unilatérale structure alors le secret. Cela correspond au modèle de la schismogenèse<br />
complémentaire (soumission). La position minimaliste consisterait à reconnaître que les<br />
Mabundi forment une branche initiatique totalement autonome et que leurs secrets, provenant<br />
du Nyεmbε, sont inaccessibles aux hommes. La symétrie opaque structure alors le secret :<br />
secrets des hommes versus secrets des femmes. Cela correspond au modèle de la<br />
schismogenèse symétrique (rivalité). La position intermédiaire, la plus courante, accepte que<br />
les mabundi aient leurs propres secrets tout en affirmant que ces secrets sont moins profonds<br />
que ceux des hommes. Cela revient donc à reconnaître l’autonomie des mabundi tout en<br />
essayant de la contenir dans le cadre d’une subordination des secrets. Les interactions entre<br />
hommes et femmes dans le Bwete dessinent finalement une dynamique relationnelle indécise,<br />
oscillant entre schismogenèse symétrique et schismogenèse complémentaire au gré des<br />
rapports de force au sein de chaque communauté locale.<br />
Les deux modèles d’inclusion des mabundi dans le Bwete<br />
En définitive, la construction du sujet initiatique passe par une relation ambivalente<br />
aux femmes et à leur capacité procréatrice. Dans ce contexte, l’irruption des mabundi sur la<br />
scène initiatique porte en germe un bouleversement de la logique relationnelle du Bwete<br />
249 La position intransigeante des communautés les plus conservatrices du Misɔkɔ consiste même à s’aligner sur<br />
le Disumba en refusant purement et simplement les mabundi.<br />
-176-
Misɔkɔ. Cette irruption, contemporaine de l’essor des yombo dans le Bwiti fang, participe de<br />
l’évolution d’ensemble du champ initiatique régional, notamment du champ de la guérison<br />
(Swiderski 1972, Fernandez 1982 : 595-599, Mary 1983). L’articulation globale entre<br />
initiations masculines et initiations féminines, traditionnellement régie par une logique<br />
d’opposition (Mwiri versus Nyεmbε), s’infléchit ainsi vers une logique de plus en plus<br />
concurrentielle (Misɔkɔ versus Ombwiri), rivalité qui joue parfois au sein d’une même société<br />
initiatique (nganga versus mabundi dans le Misɔkɔ).<br />
-177-
1. “Le Bwete, c’est le crâne”<br />
Chapitre XII<br />
Le Crâne : la traversée du Bwete<br />
Parallèlement à l’acquisition du savoir initiatique, l’initié remplit progressivement sa<br />
corbeille rituelle, mais aussi son ventre, de maganga de plus en plus puissants : nouveaux<br />
edika, motoba et tsombi, mais aussi nyimbi (fétiche manuel pour la danse et la consultation),<br />
bεnga-na-bεnga (fétiche placé dans une petite corbeille) et kombi-na-misingi (corne-fétiche<br />
ornée d’un miroir et d’une clochette, portée en bandoulière grâce à une chaîne, et qui sert aux<br />
coupures de corde et à la consultation). Plus le nganga possède de fétiches, plus le Bwete lui<br />
parle. Plus sa corbeille pèse lourd et plus lui-même pèse lourd dans le Bwete. Mais tant qu’il<br />
n’est pas initié au Mwiri, il est censé ignorer quel est le maître ingrédient de tous ces<br />
maganga. C’est là le secret central du Bwete, celui qu’il ne faut jamais livrer aux femmes et<br />
qui ne saurait donc être confié qu’à un initié dont la parole a été assermentée par le Mwiri. Ce<br />
secret tient en une courte phrase : “le Bwete, c’est le crâne”. Le pouvoir du Bwete repose en<br />
effet sur l’os humain incorporé sous forme de fragments ou de poudre dans les fétiches,<br />
ingrédient sans lequel ces derniers resteraient inertes. Et le mongonda du père initiateur,<br />
fétiche majeur disposé dans une corbeille surmontée d’une statuette de bois ou d’une coiffe de<br />
plumes, contient le crâne d’un de ses parents 250 .<br />
250<br />
Pour désigner ce fétiche, on peut aussi dire mbumba-a-bwete (chez les masangu) ou tout simplement bwete<br />
(dans le Disumba).<br />
-178-
Mongonda<br />
Cette révélation confirme que les mythes ne mentaient pas sur la nature véritable du<br />
Bwete : un orphelin reçoit un message onirique de ses parents défunts qui lui demandent<br />
d’aller prélever leur crâne pour en faire un fétiche porte-bonheur (M 5) ; au cours d’une partie<br />
de pêche, une femme trouve un crâne humain que son mari confisque pour fonder le Bwete<br />
(M 8). Mais s’il connaît désormais le secret central du Bwete, l’initié ne peut encore posséder<br />
un mongonda. Or, tous les autres bwete ne sont que des fétiches mineurs comparés au<br />
mongonda. Ils ne contiennent que de simples débris d’os qui, en outre, sont ceux d’un parent<br />
du père initiateur et non d’un ascendant lignager de l’initié. Loin d’être un aboutissement, la<br />
divulgation du secret ouvre la voie de la traversée du Bwete, dernière étape initiatique du<br />
Misɔkɔ au cours de laquelle l’initié voit le fond du Bwete, assiste à la confection d’un fétiche<br />
et reçoit lui-même un mongonda. Cette ultime étape rituelle confirme ainsi l’importance<br />
décisive de la relation aux ancêtres dans le processus initiatique.<br />
Le nganga qui a traversé le Bwete devient nyima (père initiateur). Il peut désormais<br />
exercer une pleine activité rituelle : initier, consulter, posséder un mbandja, monter des<br />
-179-
fétiches. Lors de cette traversée, l’initié reçoit le miroir qui lui permet de consulter, une racine<br />
d’eboga qui lui donne le droit d’initier, la canne mopango qui fait de lui un “vieux”, et surtout<br />
un mongonda fabriqué pour l’occasion à partir du crâne d’un ancêtre lignager 251 . Le rituel<br />
concerne avant tout la transformation du crâne en fétiche. Cette transformation comprend<br />
trois moments qui correspondent à trois lieux distincts : exhumation du cadavre au cimetière,<br />
préparation du crâne au bwεnzε, veillée pour ramener le bwete au corps de garde et le poser au<br />
mandaka 252 . Pour bien souligner la métamorphose progressive du crâne en fétiche, on dit que<br />
le bwete porte différents noms pendant la traversée : un nom au cimetière, un autre au bwεnzε,<br />
un dernier au mandaka. Mais on affirme aussi que le bwete n’a qu’un seul nom au bwεnzε,<br />
quelles que soient les branches initiatiques : il y revêt la figure d’un crâne nu, fondement<br />
commun de toutes les communautés du Bwete par-delà leurs variations de surface. Traverser<br />
le Bwete, c’est voir sa “nudité”. Or, dans sa nudité, le bwete est le même partout alors<br />
qu’habillé (c’est-à-dire transformé en fétiche, maquillé, couvert de plumes et de peaux), il<br />
diffère selon les communautés initiatiques.<br />
La première étape de la traversée consiste à aller récupérer au cimetière en forêt les<br />
ossements d’un parent lignager. Souvent, ce parent avait de son vivant déjà choisi le<br />
descendant qui hériterait de son crâne (ou l’a révélé post-mortem en rêve). Parfois, ses<br />
ossements ont même été prélevés lors du décès et réservés pour l’occasion. Il s’agit<br />
fréquemment d’un grand-parent (qui représente par synecdoque l’ensemble des aïeux<br />
bienveillants) ou d’un oncle utérin (dont hérite ego). La lignée maternelle est privilégiée, la<br />
logique lignagère sous-tendant encore largement la constitution des fétiches. Mais les avis<br />
divergent sur le sexe du mort. Cela ne doit en tout cas pas avoir été un parent hostile (de peur<br />
que le fétiche se retourne contre l’initié) ou mort d’une mauvaise mort (de peur de subir le<br />
même sort). L’exhumation se fait de nuit et en cachette, car il s’agit à la fois du cœur le plus<br />
secret du Bwete et d’une pratique aujourd’hui illégale. La tradition orale donne à penser que<br />
ce déterrement n’a de toute façon jamais été public et aisément accepté. Pour s’assurer de<br />
l’assentiment du mort, des offrandes (arachides, graines de courge, boisson) sont placées sur<br />
sa tombe, ainsi que la canne et le miroir afin qu’ils s’imprègnent du pouvoir des ancêtres 253 . Si<br />
la nourriture n’y est plus la nuit suivante, les ancêtres ont accepté et les initiés peuvent alors<br />
251 Une mabundi ne peut pas traverser le Bwete. Elle ne doit pas voir ni même savoir que le Bwete est un crâne.<br />
Elle ne peut non plus initier les hommes. Elle peut en revanche devenir mère Mabundi et initier les femmes. Il<br />
resterait à déterminer si le crâne joue encore un rôle dans l’étape rituelle permettant de devenir mère initiatrice.<br />
252 Le mandaka est la “maison des maganga”, petit appentis à l’arrière du corps de garde ou pièce réservée de la<br />
maison de l’initié où sont rangés tous les ritualia en dehors des veillées.<br />
253 Récupérer les ritualia au cimetière est le plus courant des modes de transmission initiatique au Gabon. C’est<br />
une manière de mettre en scène un don direct des ancêtres, plutôt qu’une transmission des aînés.<br />
-180-
prélever sur le cadavre les “parties essentielles” : au premier chef le crâne (équivalent de<br />
l’esprit), mais aussi tibia, phalanges, os du bras, et si possible viscères (équivalent du vampire<br />
nzanga) 254 .<br />
Ces ossements ne peuvent être emportés tels quels au village : ce serait conjoindre<br />
indûment les morts et les vivants, la forêt et le village. Le crâne doit d’abord subir un<br />
traitement au bwεnzε en forêt afin de “devenir bwete”. Il est purifié dans une marmite en terre<br />
cuite contenant kaolin, liqueur, parfum et diverses feuilles, rincé avec le savon végétal<br />
mukwisa, oint de kaolin rouge, d’huile de mwabi (Mimusops djave) et du sang d’un coq. Le<br />
père initiateur fait ensuite le partage du crâne (bongola mongonda) à l’aide de l’herminette<br />
kwεto. Chaque personne présente reçoit des fragments d’os. Le parent du mort reçoit la plus<br />
grande partie du crâne, au moins toute sa partie supérieure. Mais les dents sont retirées pour<br />
éviter que le fétiche ne se transforme en un monstre dévorateur 255 .<br />
Le récipiendaire ne récupère véritablement le fétiche que lors de la veillée rituelle. Il<br />
doit pour l’occasion prendre une dose d’eboga suffisamment importante pour être dans un état<br />
de confusion perceptive et voir en vision son maquillage personnel. Jusqu’à présent, il n’avait<br />
droit en effet qu’au badigeon de kaolin blanc avec un trait au kaolin rouge du nombril à la<br />
bouche pour figurer motoba. La traversée du Bwete l’autorise à arborer désormais un<br />
maquillage fait de mouchetures et de zébrures, à l’image d’une livrée animale. Ce maquillage<br />
figure le mokuku – esprit ancestral associé à un animal – auquel s’identifie l’initié. Ce passage<br />
de l’indifférenciation du kaolin blanc au maquillage individuel marque ainsi la singularisation<br />
rituelle de l’initié qui possède un mokuku personnel. Au milieu de la nuit, le récipiendaire doit<br />
aller jusqu’au bwεnzε pour y récupérer son bwete. L’obscurité et les effets de l’eboga aidant,<br />
il voit un mort lui remettre en main propre le crâne enveloppé dans une pièce de raphia, la<br />
canne mopango, le miroir de consultation et une racine d’eboga. Ce mort n’est autre que son<br />
mokuku qui lui tend finalement son propre crâne. Les aînés peuvent parfois redoubler<br />
l’ostension en ouvrant leurs propres fétiches pour en exhiber les crânes. Le récipiendaire<br />
retourne ensuite au corps de garde, son crâne dissimulé sous un pagne. Il se rassied à sa place<br />
et prononce le nom de son bwete, c’est-à-dire le nom de son mokuku.<br />
Après la veillée, le bwete reste assis au mandaka comme un chef coutumier sur son<br />
siège, et n’est déplacé que pour les cérémonies. De plus, si le bwete était nu au bwεnzε, il doit<br />
être habillé au mandaka. Il est enveloppé dans des pièces de raphia et de pagne, maquillé de<br />
kaolin, orné de plumes, perles, peaux, fragments de miroir ou cauris, et placé dans une<br />
254 La putréfaction rapide sous un climat équatorial fait douter de la possibilité de récupérer autre chose que des<br />
os. Mais des matières organiques issues de la décomposition sont sans doute prélevées.<br />
255 Les dents qui déchiquètent la viande sont associées au cannibalisme sorcellaire.<br />
-181-
corbeille de rotin parfois surmontée d’une statuette anthropomorphe en bois. A l’intérieur du<br />
paquet, d’autres fragments d’os, humains ou animaux, ainsi que des pièces de métal ou des<br />
écorces s’ajoutent au crâne afin d’en renforcer le pouvoir 256 . Cet habillement a autant pour<br />
fonction de donner à voir la valeur du fétiche que de dissimuler le crâne au fond de la<br />
corbeille. Il s’agit de cacher le secret en l’exhibant.<br />
Le statut de ces corbeilles reliquaires diffère dans le Misɔkɔ et le Disumba. Dans le<br />
Disumba tsɔgɔ, les reliques sont la propriété collective du village, du clan, voire de l’ethnie.<br />
Elles sont réparties dans plusieurs villages où elles sont secrètement gardées. Les reliques du<br />
fondateur du village restent généralement sur place et matérialisent ainsi l’appropriation<br />
clanique du territoire dans une situation où le clan ne forme pas un groupe local en raison du<br />
système dysharmonique. Ce lien entre reliques et autochtonie explique que les bwete ne<br />
peuvent être déplacés sans un rituel propitiatoire qui auraient autrefois exigé un sacrifice<br />
humain. Les bwete les plus importants ont une renommée qui dépasse largement le village<br />
pour atteindre la région (ebiya) et sans doute parfois l’ethnie 257 . Les aînés connaissent leur<br />
nom propre, leur origine clanique, leur lieu de résidence et leurs pouvoirs spécifiques. Ces<br />
reliques, supposément anciennes, sont en nombre limité. Seules les personnalités les plus<br />
respectées, comme un juge coutumier, peuvent servir à en fabriquer de nouvelles. Selon<br />
l’heureuse expression d’un initié, les bwete du Disumba sont des “reliques classées” que l’on<br />
ne fait qu’entretenir sans véritablement les renouveler.<br />
Dans le Misɔkɔ, la corbeille reliquaire est au contraire la propriété individuelle du père<br />
initiateur. La logique est moins clanique que lignagère. Le crâne est celui d’un ascendant<br />
direct. L’héritage se fait à l’intérieur du lignage, exemplairement de l’oncle maternel au<br />
neveu. La renommée et le pouvoir du bwete ne dépassent pas la communauté initiatique<br />
locale et le segment lignager minimal qui forme le groupe de résidence autour du père<br />
initiateur et de sa femme. Par comparaison au patrimoine classé du Disumba, ces reliques sont<br />
nombreuses et récentes, chaque père initiateur voulant son propre mongonda, preuve tangible<br />
de son pouvoir.<br />
Ce besoin permanent d’ossements humains dans le Misɔkɔ ne va pas sans problèmes.<br />
La conjonction d’une demande excédant l’offre et d’un affaiblissement de la logique<br />
lignagère fait qu’il devient possible de prendre le crâne d’un étranger du lignage pour<br />
confectionner un fétiche. Ce dévoiement ouvre la voie au pillage de cimetières et à une<br />
marchandisation des crânes (ceux des pygmées étant particulièrement recherchés). Il se crée<br />
256 Pour l’examen radioscopique du contenu de divers reliquaires gabonais, cf. Falgayrettes 1986: 62.<br />
257 Les mabiya correspondent au découpage du territoire traditionnel des mitsɔgɔ.<br />
-182-
ainsi un véritable marché où le crâne humain, sorti de la logique de reproduction lignagère,<br />
devient une sorte d’équivalent général du pouvoir (initiatique, économique, politique).<br />
L’usage initiatique des restes corporels humains se rapproche alors dangereusement de la<br />
sorcellerie 258 . Ce voisinage dangereux du Bwete avec la sorcellerie préexistait toutefois à son<br />
dévoiement marchand. Le Disumba maintient en effet une certaine ambiguïté quant à la<br />
provenance des ossements des bwete. La plupart sont ceux d’ancêtres. Toutefois, la puissance<br />
des reliques s’affaiblissant avec le temps, il fallait les recharger périodiquement par des<br />
sacrifices humains (pygmées ou jeunes filles du lignage). On devait également sacrifier<br />
lorsqu’un malheur rendait urgente la confection d’un fétiche ad hoc. Dans le Disumba comme<br />
le Misɔkɔ, la confection des fétiches hésite ainsi entre récupération post-mortem et sacrifice<br />
ad hoc. C’est cette proximité inquiétante avec le sacrifice sorcellaire qui conduit certaines<br />
communautés initiatiques réformées à abandonner délibérément l’usage de l’os humain, par<br />
exemple dans le Bwiti fang mais aussi dans quelques rares communautés urbaines du Misɔkɔ.<br />
2. Voir et savoir : l’ostension du Bwete<br />
La traversée du Bwete constitue le comble du dévoilement : selon les expressions<br />
consacrées, c’est voir le “fond”, la “nudité” et le “sexe” du Bwete. L’initié voit la vérité nue<br />
enfin dépouillée des innombrables travestissements mensongers des aînés. La traversée<br />
rituelle s’organise en effet autour d’une ostension du Bwete lui-même, révélation visuelle du<br />
secret central de la société initiatique. Il est essentiel qu’au-delà d’un savoir théorique déjà<br />
disponible depuis l’initiation au Mwiri, la divulgation passe par une saisie visuelle en<br />
première personne. Il y a ainsi un décalage crucial entre d’une part savoir que le Bwete est un<br />
crâne et d’autre part voir ce crâne et en posséder un. Seule la traversée du Bwete actualise ce<br />
savoir dans une ostension rituelle. C’est pourquoi le fait que nombre de cadets et même de<br />
profanes connaissent l’usage rituel de l’os humain ne met pas en péril la société initiatique.<br />
Tant qu’on n’a pas vu de ses propres yeux le crâne du Bwete, tant qu’on n’a pas assisté aux<br />
étapes de sa fabrication, on reste fondamentalement ignorant. Si la majorité du savoir<br />
258 D’innombrables affaires de trafic d’organes défraient ainsi la chronique, notamment en période électorale.<br />
C’est tout le folklore macabre de ce que les Gabonais appellent les “pièces détachées”. Sur les trafics de crânes<br />
et d’organes en Afrique australe, cf. White 1997.<br />
-183-
initiatique est reçue de la bouche des aînés, les deux extrêmes du parcours initiatique placent<br />
néanmoins l’impétrant en posture de témoin visuel : visions d’eboga au début et ostension du<br />
crâne à la fin.<br />
Il est fondamental que cette ostension rituelle coïncide avec la pleine compréhension<br />
du terme Bwete. Tant qu’on ne le lui a pas montré, l’initié ne sait pas exactement ce qu’est<br />
Bwete : “avant l’étape de la traversée, le Bwete, on ne sait pas vraiment ce que c’est. Ce<br />
qu’on fait jusqu’alors, c’est de la rigolade”. De même que pour l’acquisition de l’evur<br />
(organe de sorcellerie des fang), le processus d’acquisition du terme Bwete s’identifie avec le<br />
trajet rituel nécessaire pour devenir spécialiste (Boyer 1986). Pour les profanes, Bwete est<br />
avant tout un noyau de mystères initiatiques. Cette indétermination – tant sémantique que<br />
référentielle – persiste en bonne partie pour les initiés. Bwete ne dénote en effet aucun référent<br />
matériel précis. Certes, les fétiches font de bons candidats à la référence. Avant d’avoir<br />
franchi la dernière étape rituelle, l’initié ignore cependant leur ingrédient commun, caractère<br />
qui permettrait de les ranger tous comme autant d’exemplaires d’une même classe appelée<br />
Bwete, et donc d’en donner une véritable définition en compréhension et non pas simplement<br />
en extension.<br />
L’initié apprend néanmoins progressivement à employer le terme Bwete dans divers<br />
contextes rituels. Il a vu le Bwete le jour de son initiation, mais sans pouvoir l’identifier à un<br />
personnage bien défini. Selon les expressions en usage, il a “posé”, “secoué”, “soulevé”,<br />
“chauffé” ou “rentré le Bwete” lors de nombreuses veillées, mais sans pouvoir préciser où le<br />
Bwete intervenait dans ces gestes rituels. Tout au plus la densité expérientielle (esthétique,<br />
émotionnelle, relationnelle) du rituel parvient-elle à donner une certaine consistance à des<br />
entités invisibles, sans pour autant contribuer à leur détermination conceptuelle. L’initié<br />
apprend également les règles de déclinaison du terme au possessif (je fais mon Bwete), au<br />
pluriel (les fétiches bwete) ou au singulier abstrait (le Bwete me dit), sans bien comprendre la<br />
logique de cette grammaire. Il apprend même à détourner cette indétermination dans un usage<br />
ludique du terme. Tout au long du parcours initiatique, Bwete reste donc une notion mal<br />
définie alors même que ses contextes d’usage sont eux bien définis 259 .<br />
Ce n’est qu’à la fin du parcours rituel que l’initié acquiert une pleine compréhension<br />
du terme et que son indétermination sémantique se résorbe dans une ostension référentielle,<br />
lorsque le père initiateur lui montre le crâne en disant “voilà le Bwete !”. La signification de la<br />
notion n’est donc pas abstraite mais ostensive, puisqu’elle est irrémédiablement attachée à des<br />
259 De même que le discours rituel du chamane Cuna (Panama) parvient à générer du sens à partir d’une notion<br />
mal définie (purpa, habituellement traduit par âme) (Severi 1993).<br />
-184-
occurrences rituelles. La définition du terme se résume finalement à la méthode de fabrication<br />
de son référent : on ne peut parler convenablement du Bwete que lorsqu’on a assisté aux<br />
étapes rituelles de sa fabrication. Et puisque le fétiche bwete en question lui est destiné, ce<br />
n’est que lorsque l’initié possède effectivement un bwete qu’il en possède également le<br />
concept.<br />
Cet usage décisif de l’ostension rituelle se retrouve dans le Byeri des fang. Entre le<br />
Byeri du nord Gabon et le Bwete du sud Gabon, les homologies sont suffisamment fortes et<br />
les différences suffisamment marquées pour que les deux rituels initiatiques apparaissent<br />
comme les transformations d’un même patron. Quasiment éteint aujourd’hui, le Byeri est un<br />
culte des ancêtres lignagers (Tessmann 1991, Fernandez 1982 : 253-267). Les byeri désignent<br />
les crânes d’ascendants lignagers, hommes ou femmes du patrilignage (les fang étant<br />
patrilinéaires). Ces crânes sont dissimulés dans un grand reliquaire cylindrique que surplombe<br />
une statuette anthropomorphe. Réceptacles et statuettes sont parfois eux-mêmes appelés byeri,<br />
notamment chez les profanes qui n’ont jamais vu les crânes. Comme dans le Bwete, le terme<br />
désignant le crâne sert donc aussi par métonymie à nommer le fétiche qui le dissimule et la<br />
société initiatique qui en fait usage.<br />
La garde des byeri est transmise par le père à son fils aîné qui sera amené à lui<br />
succéder comme chef du segment lignager. Le rite de passage est appelé melan, du nom de la<br />
plante hallucinogène utilisée à des fins visionnaires, l’alan (Alchornea floribunda – l’eando<br />
des mitsɔgɔ, parfois mélangé à l’eboga pour l’initiation au Bwete). La cérémonie se tient en<br />
brousse dans un enclos divisé en deux compartiments. Dans l’un d’entre eux, ont été amenés<br />
les byeri du lignage. Dans l’autre, le néophyte doit manger l’alan qui lui “ouvre la tête en<br />
deux” et lui permet d’entrer en contact avec les bekon, fantômes des ancêtres.<br />
Après le récit des visions au lendemain de la manducation, vient le moment solennel<br />
de l’exhibition rituelle des crânes extraits des reliquaires et badigeonnés de poudre de padouk.<br />
Soit on retire brusquement la cloison de feuillage qui séparait les deux compartiments de<br />
l’enclos initiatique, de telle sorte que l’initié se retrouve nez à nez avec les crânes. Soit on fait<br />
danser crânes et statuettes au-dessus de la cloison. Soit encore on assied le novice dos aux<br />
crânes et face à un miroir, puis par pivotement du miroir, on fait apparaître les crânes à la<br />
place de son propre visage. Au spectacle des byeri, on associe toujours la récitation de leurs<br />
noms et leur filiation, généalogie que doit mémoriser le récipiendaire. Cette initiation<br />
constitue une double révélation : d’une part, la masse indistincte des fantômes bekon acquiert<br />
le statut défini d’ancêtres lignagers ; d’autre part, ces ancêtres prennent la figure visible des<br />
crânes (Boyer 1988 : 92-97). Certes, le novice pouvait déjà savoir que le byeri contenait des<br />
-185-
crânes, mais l’important est bien qu’il ne les avait jamais vus auparavant. Comme la traversée<br />
du Bwete, l’initiation au Byeri s’organise autour d’un rituel d’ostension de crânes lignagers<br />
qui constituent les référents exemplaires d’un terme jusque-là indéterminé et servant à<br />
désigner la société initiatique.<br />
Il y a cependant une différence essentielle entre Byeri et Bwete. Dans le Byeri,<br />
initiation et exhibition des crânes coïncident : le novice voit les crânes le jour où il mange<br />
l’alan. Dans le Bwete Misɔkɔ, ces deux moments sont dissociés. La disjonction est même<br />
maximale, puisque initiation et traversée rituelle constituent les deux extrémités du parcours<br />
initiatique, généralement séparées par plusieurs années 260 . Le Byeri reste un simple culte<br />
familial privé sans véritable carrière initiatique : une fois que l’on est initié, il n’y a plus rien<br />
d’autre à faire que d’entretenir les reliques dont on a la garde. Lorsqu’on se fait initier au<br />
Bwete, les choses sérieuses ne font au contraire que commencer. La temporalité initiatique est<br />
ainsi orientée par le décalage constitutif entre être initié et comprendre à quoi l’on est initié,<br />
puisque seule la traversée du Bwete permet une détermination ostensive du terme bwete,<br />
notion jusque-là indéterminée alors même qu’elle sert à désigner la société initiatique. L’initié<br />
du Byeri est depuis le début un initié savant, tandis que l’initié du Bwete reste jusqu’à la fin<br />
un initié ignorant.<br />
3. Mort et paradoxe<br />
La traversée rituelle semble mettre un terme aux incertitudes ouvertes par l’initiation.<br />
Elle s’accompagne pourtant d’un paradoxe qui remet en cause cette prétention. Traverser le<br />
Bwete, c’est aussi traverser le mandaka ou les maganga – formulations synonymes. Ces<br />
expressions évoquent l’enjambement des objets rituels (“traverser” au sens de “passer pardessus”),<br />
ce que la règle la plus élémentaire du rituel interdit pourtant de faire. Le nom même<br />
de l’étape initiatique est donc paradoxal dans la mesure où il désigne un geste transgressif 261 .<br />
En outre, pour souligner que le Bwete est interminable, les initiés emploient deux formules<br />
équivalentes : “la mer du Bwete ne se traverse jamais” et “on ne peut pas traverser le geliba”.<br />
Le geliba désigne littéralement une étendue d’eau et symboliquement l’espace des maganga<br />
posés au corps de garde. Le caractère infranchissable du geliba évoque donc à la fois<br />
l’impossibilité d’enjamber les objets rituels et d’en finir avec le Bwete. Ainsi, traverser le<br />
Bwete signifie finir quelque chose qui ne possède pourtant pas de fin. La traversée du Bwete<br />
260<br />
Il se peut même que l’initié ne franchisse jamais l’étape de la traversée rituelle.<br />
261<br />
Chez les douala du Cameroun, la dernière étape rituelle pour devenir nganga implique d’enjamber neuf fois<br />
les objets rituels (de Rosny 1981 : 377).<br />
-186-
se contredit elle-même : elle est l’étape ultime, mais, en tant que telle, elle est impossible, et<br />
donc n’est pas vraiment l’étape finale.<br />
Le fond de ce paradoxe a à voir avec la mort : “personne ne peut traverser le Bwete,<br />
c’est seulement une étape. Celui qui traverse le Bwete, c’est la mort”. Nous avons déjà vu le<br />
rôle constitutif que jouait la mort dans le paradoxe du secret (chapitre VI) : pour ne pas être<br />
dévalorisé, le secret ne doit être divulgué qu’à l’agonie. Dans la traversée du Bwete, le<br />
paradoxe est encore plus frappant : on ne peut voir le Bwete qu’à l’instant de mourir.<br />
“On ne va jamais finir. Tu n’arriveras jamais au fond au fond. Tant que tu vis, tu<br />
ne pourras pas vraiment définir le Bwete. C’est le jour de la mort où tu verras<br />
carrément toute la Bible du Bwete comme ça. Dès que tu vois ça, il faut que tu te<br />
dises que c’est fini. Tu vas voir vraiment le fond du Bwete. Personne ne peut voir<br />
ça vivant, au grand jamais. Signé par eux-mêmes les aïeux qui ont envoyé ça. Le<br />
vieux lui-même, il n’a pas fini le Bwete. Parce que finir le Bwete, c’est la mort.<br />
C’est significatif pourquoi on dit ça.”<br />
Le Bwete relève ainsi d’une appréhension impossible : il ne se dévoile que lorsqu’il<br />
n’est plus possible de le voir. Tout le paradoxe du Bwete se concentre dans cet éclair<br />
instantané de la mort. De son vivant, l’initié ne peut savoir ce qu’est véritablement le Bwete.<br />
Et la traversée du Bwete elle-même ne peut suffire à la détermination complète de la notion<br />
éponyme. La mort est bien le nœud du rituel, à la fois contenu du secret et raison pour<br />
laquelle sa divulgation reste incomplète. La traversée du Bwete est en effet une mise en scène<br />
autour de la mort : exhumation du cadavre, vision du mokuku, manipulation du crâne. Mais<br />
justement parce que, bien vivant, il ne se trouve pas à la place du mort, l’initié ne peut avoir<br />
qu’une appréhension irrémédiablement partielle du Bwete. C’est pourquoi la traversée du<br />
Bwete est une étape initiatique paradoxale : détenir un savoir total sur le Bwete exigerait<br />
d’occuper une place impossible, celle du mort. La traversée rituelle ne donne pas une<br />
compréhension pleine et entière du Bwete, mais fait plutôt comprendre l’impossibilité de cette<br />
compréhension. Trahissant la promesse de divulgation du dernier secret, elle reconduit<br />
ironiquement l’inachèvement déceptif du savoir initiatique. La traversée du Bwete n’en est<br />
donc pas une : le Bwete ne se traverse que le jour de sa propre mort.<br />
Selon une exégèse secrète, les initiés assis derrière le geliba au cours d’une veillée<br />
sont en train de pleurer un cadavre. Avec la traversée du Bwete, l’initié comprend finalement<br />
que ce cadavre est l’ancêtre présent sous forme d’ossements dans les fétiches qui forment le<br />
geliba. Mais ce cadavre, c’est aussi l’initié lui-même : “ce cadavre, c’est notre propre mort<br />
qu’on pleure. On demande aux mikuku, qui sont les morts qui travaillent pour nous, de nous<br />
garder une bonne place parmi eux”. L’initié occupe pendant le rituel une place paradoxale :<br />
-187-
assis devant son propre cadavre, il pleure par anticipation sa mort et s’identifie déjà aux<br />
ancêtres. Le seul initié omniscient, celui qui connaît le Bwete pour l’avoir vu de ses propres<br />
yeux, c’est en effet l’ancêtre lui-même. Traverser le Bwete pour de bon exige ainsi de mourir<br />
pour devenir un ancêtre. L’initié rejoint alors le village de ses aïeux et voit enfin<br />
véritablement ce qu’est le Bwete. Ancêtre parmi les ancêtres, il est lui-même devenu Bwete.<br />
C’est donc tout simplement le statut d’initié qui exige cette identification paradoxale au<br />
cadavre 262 . La mort est le terme véritable du parcours initiatique.<br />
Cette altération irréversible que constitue la mort joue ainsi un rôle décisif dans la<br />
définition du savoir initiatique et la construction du sujet initiatique. Le parcours initiatique<br />
tourne autour d’une place impossible à occuper et dont provient pourtant tout le savoir<br />
initiatique : il s’agit de la place du Bwete lui-même, place qui s’avère en définitive n’être pas<br />
autre chose que celle d’un mort, c’est-à-dire celle du crâne et de l’ancêtre. C’est pour cela que<br />
Bwete reste une entité flottante partiellement indéterminée : il occupe une place vide car<br />
fondamentalement inaccessible. La place paradoxale du mort, c’est donc la place paradoxale<br />
du maître, celui qui détient la vérité et la totalité de la tradition. Le discours de la tradition – la<br />
parole des ancêtres – est en définitive moins un corpus d’énoncés qu’un type de relation,<br />
relation singulière où la place de référence reste nécessairement inaccessible.<br />
Cette identification de la mort à la vérité se retrouve dans un récit initiatique. Un jour,<br />
un coq trouve le cadavre d’un pygmée aux abords du village. Il picore les asticots sur le<br />
cadavre puis retourne au village. Mais il ne peut parler aux hommes pour leur indiquer qu’il y<br />
a un mort en brousse. Un chien flaire l’odeur du cadavre. Il tourne autour des pieds de son<br />
maître en pointant du museau vers la brousse pour lui faire comprendre qu’il doit le suivre là-<br />
bas. Les hommes ont ainsi découvert le cadavre du pygmée grâce au chien. Ce court récit est<br />
au principe d’une série d’énigmes initiatiques. Le premier nganga qui a consulté, c’est le<br />
chien qui flaire un cadavre. Le premier nganga qui a mangé motoba, c’est le coq qui picore<br />
un asticot sur un cadavre. Le premier nganga qui a dit “base !”, c’est l’asticot d’un cadavre.<br />
Or, la formule “base !” indique la vérité et est fortement liée au contexte divinatoire dont<br />
motoba est le nécessaire auxiliaire. L’asticot, qui fut le premier motoba, constitue donc en<br />
quelque sorte la vérité du cadavre : “le premier qui a dit Base !, c’est l’asticot. L’homme<br />
meurt. C’est d’abord les asticots qui viennent. Quand tu dis Base !, c’est la vérité. Ce sont les<br />
262 Le cadavre est une entité paradoxale, violant nos attentes intuitives : la reconnaissance du cadavre comme<br />
étant toujours une personne contredit la perception d’un corps désormais inanimé. De là, selon P. Boyer,<br />
l’importance universelle des rites funéraires (2003 : 292-328). Le traitement du crâne et la place décisive du<br />
cadavre dans le rituel attestent que le Bwete repose fondamentalement sur la manipulation d’un tel paradoxe<br />
cognitif.<br />
-188-
asticots qui disent la vérité”. La vérité divinatoire repose donc elle aussi sur la mort, et<br />
derrière elle, sur le pouvoir des ancêtres.<br />
4. Nyima : le travail d’un père initiateur<br />
La traversée du Bwete fait du nganga un nyima, père initiateur désormais autorisé à<br />
posséder un corps de garde 263 . La fabrication de nouveaux fétiches est l’une des prérogatives<br />
du nyima qui doit donc réserver des fragments d’os de son propre bwete pour les incorporer<br />
dans chacun des maganga qu’il confectionne pour ses banzi. Le crâne humain est en effet<br />
l’ingrédient indispensable de tout travail rituel et par conséquent de tout pouvoir : “le crâne<br />
de ta mère, c’est ce qui fait ton bonheur, ta puissance. Il n’y a pas un puissant sur cette terre<br />
qui va te dire qu’il n’a pas le crâne de sa mère, de sa grand-mère ou de sa sœur”. Les initiés<br />
affirment d’ailleurs que le pouvoir des prêtres provient en réalité lui aussi d’une relique<br />
dissimulée sous l’autel 264 . Certains des maganga comprennent des débris indifférenciés d’os,<br />
d’autres des fragments d’une partie précise du corps : tibia dans la canne rituelle (pour<br />
suppléer les jambes fatiguées des anciens), phalange dans le fétiche manuel nyimbi, mâchoire<br />
dans la corne-fétiche kombi na misingi et sur le silure motoba (auxiliaires divinatoires qui<br />
parlent à leur possesseur), sanies du cadavre dans la lotion protectrice dwago 265 .<br />
Le père initiateur est également chargé de l’entretien des maganga, part proprement<br />
cultuelle du Bwete. Il faut en effet purifier et nourrir le Bwete par le sacrifice périodique d’un<br />
coq, afin qu’il puisse continuer de conjurer le malheur et attirer le bonheur. Cette cérémonie,<br />
appelée mugungu (du verbe “frotter”) ou “lavage de Bwete”, doit également être accomplie en<br />
cas de malheur (décès, accident sanglant, maladie grave) ou de naissance (car le sang coule<br />
lors de l’accouchement). La souillure risquerait en effet de contaminer le Bwete. Il faut en<br />
principe avoir déjà traversé le Bwete pour être autorisé à participer à une veillée de mugungu,<br />
puisqu’on doit vider les corbeilles et ouvrir les fétiches pour les purifier secrètement. Le<br />
nyima commence par frictionner nganga et maganga à l’aide d’une mixture de savon<br />
mukwisa, écorces, parfum, kaolin rouge, vin et autres boissons. Le mongonda est parfois<br />
ouvert afin d’oindre directement le crâne qui y est contenu. Le sacrifice du coq sert ensuite à<br />
transférer la souillure sur la volaille, mais aussi à payer la dette des hommes envers le Bwete<br />
263 La fondation d’un nouveau mbandja exige l’enterrement sous le poteau central d’un fragment du crâne. On<br />
comprend ainsi pourquoi le poteau mitan est bien l’axis mundi du mbandja.<br />
264 Les reliques ont effectivement joué un rôle déterminant dans le christianisme et continuent de le faire dans<br />
certaines régions (Brown 1984). Mais contrairement au Bwete, c’est la sainteté et non la parenté qui préside à la<br />
sélection des ossements.<br />
265 Lors des funérailles autrefois, on s’enduisait parfois des sanies du cadavre afin de s’attirer les bonnes grâces<br />
du défunt (Raponda-Walker & Sillans 1962 : 111-112).<br />
-189-
et les ancêtres. Le nyima frotte le coq contre chaque initié pour qu’il prenne sur lui l’impureté.<br />
Il arrache ensuite la langue de l’animal encore vif et la donne avec un peu de sang au<br />
mongonda afin de réactiver la parole du Bwete. Le coq est ensuite tué, cuit et consommé par<br />
les initiés – les abats étant comme à l’accoutumée réservés aux ancêtres 266 .<br />
Un nyima possède également le droit d’initier à son tour des banzi. Il est cependant<br />
fréquent qu’un initié attende la mort de son père initiateur pour se mettre à initier lui-même,<br />
se contentant jusque-là de le seconder humblement. Le nouveau nyima reçoit alors le pouvoir<br />
d’initier au cours d’une cérémonie de succession qui ressemble en plusieurs points à la<br />
traversée du Bwete. Le cadavre du père initiateur repose au bwεnzε, une racine d’eboga ayant<br />
été placée dans sa main droite. Au cours d’une veillée, l’héritier désigné doit alors aller<br />
“arracher” le bois sacré des mains du mort. Le défunt risque en effet d’emporter le Bwete dans<br />
la mort, laissant ses enfants démunis car privés de tout secours rituel. Il faut donc l’en<br />
empêcher en lui arrachant l’eboga : “tu vas arracher le bois sacré avec ton père pour qu’il ne<br />
t’emmène pas le Bwete”. Il s’agit par là de conjurer le péril d’une mort qui mettrait un terme à<br />
la transmission initiatique. L’héritier peut également récupérer les fétiches de son père<br />
initiateur dont les ossements seront d’ailleurs prélevés pour s’ajouter bientôt aux autres bwete.<br />
Ce thème de l’orphelin arrachant le bois sacré au cadavre d’un père répète le mythe de<br />
découverte de l’eboga : grâce au bois sacré, les parents peuvent continuer d’aider leurs<br />
enfants par-delà leur mort.<br />
M 9 (découverte de l’eboga)<br />
“Un couple pygmée et leur fils vivent seuls en forêt. A la mort des parents,<br />
l’orphelin se sent abandonné et pleure. La nuit, ses parents lui apparaissent en<br />
rêve et lui disent : ‘va sur notre tombe. Tu y trouveras un arbuste que tu<br />
arracheras et dont tu mangeras les racines’. Au matin, l’orphelin s’exécute et<br />
trouve l’eboga qui poussait sur la tombe de ses parents, juste au niveau de la<br />
vésicule biliaire [association entre le bois amer et la bile, mais aussi entre<br />
l’eboga et le vampire]. Il mange les racines et voit en vision les feuilles qui<br />
servent à soigner. Les gens accourent alors de toute part pour se faire soigner.<br />
Grâce à la compensation reçue en échange des soins et de la consultation, il peut<br />
désormais survivre sans le secours de ses parents.”<br />
Lors de la succession d’un père initiateur, le choix de l’héritier est fonction de la<br />
parenté. Tout comme pour les biens et le statut social, l’héritage se fait communément de<br />
l’oncle utérin au neveu. La transmission lignagère laisse quand même une relative liberté de<br />
266 Ce sacrifice, comme pour toutes les autres pratiques sacrificielles du Bwete, répète le sacrifice d’un membre<br />
du lignage, femme ou enfant. La rumeur dit que l’entretien des reliques les plus importantes imposerait encore<br />
un véritable sacrifice humain.<br />
-190-
choix, puisqu’un homme possède souvent plusieurs neveux et qu’il existe de toute façon de<br />
nombreuses façons de spécifier en termes de parenté la relation qui unit deux individus. Le<br />
décrochage partiel de la parenté initiatique par rapport à la parenté lignagère permet d’ouvrir<br />
davantage encore le choix de l’héritier : un fils initiatique respectueux et capable peut parfois<br />
succéder à son père initiateur sans pour autant être un véritable parent. Dans tous les cas, cette<br />
succession n’est possible que si le père initiateur a de son vivant effectivement initié et formé<br />
auprès de lui son héritier.<br />
Au cours de sa carrière, un père initiateur est amené à initier de très nombreux banzi. Il<br />
initie habituellement ses parents proches (enfants, épouse, neveux) afin qu’ils puissent l’aider<br />
à garder son Bwete et éventuellement lui succéder. Mais il initie également de nombreux<br />
étrangers qui, par le biais de la filiation initiatique, deviennent alors ses enfants. La<br />
transmission initiatique n’est donc pas exclusivement lignagère. Comme le révèlent nombre<br />
de mythes initiatiques (comme M 5 et M 6) mais aussi la pratique la plus courante, la<br />
transmission du Bwete obéit souvent à une logique matrimoniale : un homme initie un autre<br />
homme et lui donne ses fétiches afin de pouvoir obtenir sa sœur en mariage. Le Bwete<br />
équivaut ainsi à une compensation matrimoniale. Les initiés affirment d’ailleurs que c’est là<br />
une des causes de la naissance et de la diffusion du Bwete : “le Bwete est venu sur terre à<br />
cause du mariage”. Le Bwete a pu de la sorte échapper à l’appropriation par ses détenteurs<br />
originels pour se répandre à travers le pays, au gré des alliances matrimoniales qui unissent<br />
les lignages.<br />
Il existe donc deux modes de transmission du Bwete. Le premier mode de transmission<br />
se fonde sur la filiation lignagère : il est vertical et généalogique. Cette transmission est un<br />
héritage : le Bwete passe de l’oncle au neveu, du frère aîné au cadet, ou encore du grand-père<br />
au petit-fils. Cet héritage obéit à un principe de conservation : le Bwete doit rester dans le<br />
lignage maternel 267 . Le second mode de transmission se fonde sur l’alliance exogamique : il<br />
est horizontal et géographique. Cette transmission est une diffusion hors du groupe (au<br />
minimum hors du clan, souvent hors du village et même de l’ethnie) : le Bwete passe du mari<br />
au beau-frère en échange de la sœur de ce dernier. La diffusion obéit à un principe<br />
d’ouverture. Au premier abord, la transmission lignagère semble primer, tant l’idéologie de la<br />
filiation utérine est dominante : le Bwete est quelque chose que l’on hérite de ses ascendants<br />
lignagers et qui vient originellement des ancêtres. Mais le second mode de transmission est<br />
tout aussi important car lui seul assure la dynamique extensive de la société initiatique : le<br />
267 L’héritage du grand-père fait sortir le Bwete du lignage. Mais l’alliance préférentielle avec un grand-parent<br />
clanique permet de respecter l’exogamie tout en assurant idéalement le retour des biens dans le clan en quelques<br />
générations (les biens “tournent autour de la famille”). C’est l’avantage d’un tel mariage au plus proche.<br />
-191-
Bwete est quelque chose que l’on reçoit d’autrui et qui provient originellement d’ailleurs 268 .<br />
Entre neveux et beaux-frères, le Bwete peut ainsi trouver toujours plus loin les voies de sa<br />
perpétuation.<br />
Les deux modes de transmission du Bwete<br />
268 Conformément à cette double logique, on retient d’ailleurs les noms des initiés qui sont soit des fondateurs,<br />
soit des passeurs ayant permis la diffusion du Bwete : ainsi Mongo mwana ya Pindo qui fait passer le Bwete des<br />
masangu aux bavove.<br />
-192-
1. Objets, médiations, relations<br />
Conclusion<br />
L’ironie du Bwete<br />
Maintenant que nous avons parcouru ce long chemin rituel qui fait d’un profane un<br />
banzi puis un nganga et enfin un nyima, il ne nous reste plus qu’à ressaisir pour les nouer<br />
ensemble tous les fils relationnels de cet “homme compliqué” qu’est l’initié. Afin de dégager<br />
la cohérence d’ensemble du Bwete Misɔkɔ ainsi que sa spécificité par rapport au Bwete<br />
Disumba, nous reviendrons tout particulièrement sur la parole divinatoire. Tout cela nous<br />
conduira finalement à souligner la forme ironique de la relation initiatique.<br />
L’infortune sorcellaire représente une désorganisation du rapport à soi et à autrui.<br />
L’individu infortuné attribue la répétition du malheur à la persécution d’un parent, c’est-à-dire<br />
au fait d’occuper une position défavorable et contrainte au sein du réseau de parentèle : il est<br />
enfermé dans la position impuissante du patient par rapport à un agent qui est le parent<br />
sorcier. La sorcellerie traduit ainsi le décalage inévitable entre la réalité banale des conflits et<br />
des rivalités entre parents et le modèle tout idéal de l’ordre harmonieux du lignage : le lignage<br />
est autant un champ de bataille qu’un réseau de solidarité. L’initiation ne vise donc pas un<br />
improbable rétablissement homéostatique de l’ordre corporel et lignager. Le Misɔkɔ est moins<br />
un outil de réconciliation collective qu’un instrument de lutte individuelle. L’initiation donne<br />
à un individu infortuné la possibilité de modifier progressivement sa position au sein du<br />
réseau de parentèle à travers l’insertion dans une série de relations inédites. Il s’agit de le faire<br />
sortir de l’enfermement sorcellaire dans l’impuissance subie pour le faire entrer dans une<br />
position plus favorable. L’initiation au Misɔkɔ permet ainsi de réorganiser autrement le<br />
rapport à soi et à autrui. La dynamique actantielle des visions, l’appropriation ambivalente des<br />
pouvoirs agressifs du sorcier ou encore l’écart entre parenté initiatique et parenté lignagère<br />
sont autant d’exemples de cette reconfiguration positive. De même, tous les maganga<br />
qu’acquiert progressivement l’initié sont autant de prothèses rituelles qui font désormais<br />
partie de sa personne et assurent qu’il est un homme puissant.<br />
La construction du sujet initiatique est en effet placée sous le signe de la complication<br />
et de la multiplication maximales. Cette complication de soi passe par deux types<br />
complémentaires d’objets médiateurs : les maganga-fétiches et les maganga-médicaments. La<br />
première forme correspond à une projection et une fragmentation du soi dans des objets<br />
matériels. La seconde forme correspond à une adjonction d’instances à l’intériorité, une<br />
-193-
introjection de suppléments d’âme (d’esprits auxiliaires). Ces maganga ne sont donc pas des<br />
totalités individuelles mais des fragments qui renvoient analogiquement les uns aux autres et<br />
ultimement au sujet initié – et ce n’est pas un hasard si le terme maganga est un pluriel, le<br />
singulier ne s’employant jamais 269 . L’ensemble des rapports entre ces multiples entités<br />
médiatrices forme l’espace transitionnel où se construit l’identité relationnelle des initiés. Cet<br />
espace est matérialisé par le geliba, l’étendue du corps de garde où sont posés les maganga.<br />
Le geliba est en effet un espace de relations entre l’initié et les fétiches, mais aussi entre<br />
initiés. L’horizon de la personne est ainsi élargi au-delà des limites du corps propre jusqu’à la<br />
dimension du mbandja qui figure d’ailleurs un homme.<br />
Le parcours initiatique consiste alors à transformer une attitude de peur, d’incrédulité<br />
ou de crédulité à l’égard de ces fétiches en un rapport constitutif de projection et<br />
d’identification. En effet, les profanes expriment communément un sentiment de défiance –<br />
oscillant entre la peur et le scepticisme – envers les maganga : “quand je suis rentré au<br />
bwεnzε pour la première fois, j’avais vraiment peur de voir toutes ces choses. Si je regarde ça<br />
trop, est-ce que ces choses ne vont pas me prendre ?”. L’initiation marque alors une<br />
transformation du rapport aux fétiches. Il s’agit toujours de se faire ravir par des choses<br />
étranges, mais sur un tout autre mode que celui de l’ensorcellement et de la peur : par<br />
l’entremise des maganga, l’initié est happé dans un réseau de nouvelles relations lui<br />
permettant de reconfigurer positivement son rapport à soi et à autrui. Les fétiches ne sont plus<br />
une menace pour son intégrité personnelle mais au contraire une partie intégrante de sa<br />
personne. Ce que dit bien l’expression “les maganga sont mes parents” (les termes nganga et<br />
maganga étant effectivement apparentés linguistiquement). L’initiation procure en effet au<br />
nganga d’autres parents que ses parents lignagers, parents bricolés qui lui servent de soutien<br />
dans la lutte contre ses sorciers. Tel un père ou un oncle, le père nganga joue souvent le rôle<br />
d’un mentor pour ses initiés qu’il conseille jusque dans les affaires les plus quotidiennes,<br />
notamment les relations avec sa parentèle. De même, les maganga “parlent” à leur possesseur<br />
pour le guider dans ses actions, l’avertissant d’éviter tel parent suspect ou lui recommandant<br />
d’aller chercher la bénédiction auprès de tel autre parent 270 .<br />
269<br />
Le goût très “africain” pour les concrétions, agrégations et accumulations dans la composition des artefacts<br />
rituels doit ainsi être mis en rapport avec des conceptions pluralistes de la personne : ces objets composites sont à<br />
l’image d’un sujet pluriel qu’ils contribuent à façonner (Augé 1986).<br />
270<br />
C’est ainsi par le truchement des maganga que le traitement de l’infortune se déplace progressivement vers la<br />
maîtrise de la parole divinatoire.<br />
-194-
Maganga<br />
Si les maganga permettent ainsi de réorganiser conjointement le rapport à soi et le<br />
rapport à autrui, c’est qu’ils constituent en réalité eux-mêmes des véritables index matériels<br />
de relations (Gell 1998). On y retrouve en effet toutes les relations constitutives du Bwete<br />
Misɔkɔ : relation sorcier/victime avec le mbando (fétiche enterré qui soustrait le banzi aux<br />
sorciers), relation patient/devin avec le miroir divinatoire, relations homme/femme avec<br />
edika, relation mère-enfant avec le tsombi (fétiche de la renaissance initiatique), relation<br />
aîné/cadet à travers les tailles et poids respectifs des corbeilles rituelles, relation<br />
vivants/ancêtres à travers les ossements, relation initié/père initiateur à travers les ongles et<br />
cheveux incorporés dans tous les bwete. Mêlant inextricablement toutes les figures auxquelles<br />
l’initié est désormais lié, les fétiches donnent à voir des images de soi en tant qu’autre (Augé<br />
1986). Les maganga illustrent ainsi que subjectivation et assujettissement sont les deux faces<br />
d’un même processus. Le Misɔkɔ, malgré un caractère plus individualiste que le Disumba,<br />
-195-
n’est donc pas une marche vers l’autonomie personnelle : le banzi n’est rien sans son père<br />
initiateur, nul n’est rien sans les ancêtres.<br />
On comprend alors l’intérêt décisif des objets-fétiches pour la relation rituelle. Ces<br />
objets médiateurs structurent toutes les interactions entre initiés. Les interactions impliquant<br />
les maganga sont ainsi des relations à propos de relations. Manipuler un objet, c’est en réalité<br />
manipuler une ou des relations. Nous avons vu que le processus initiatique du Misɔkɔ repose<br />
sur la transformation d’une matrice de relations, parmi lesquelles il faut distinguer les<br />
relations internes qui n’ont pas d’existence hors du contexte rituel (comme initié/profane,<br />
père/fils initiatique, aîné/cadet initiatique, devin/patient) et les relations externes qui<br />
préexistent à l’initiation (comme sorcier/victime, homme/femme, ancêtres/vivants). Les<br />
relations internes au Misɔkɔ sont alors systématiquement mises en abyme dans le rituel. Par<br />
exemple, placer et orner les corbeilles rituelles au début d’une veillée, c’est manipuler la<br />
hiérarchie initiatique telle qu’elle se donne à voir dans l’espace cérémoniel du corps de garde.<br />
Les objets-fétiches compliquent ainsi les relations en leur donnant une dimension auto-<br />
référentielle concrète car directement agie : l’enjeu de l’interaction concerne le contexte<br />
d’interaction. Les interactions rituelles sont donc un jeu sur les relations : la réflexivité de la<br />
relation crée du jeu, au sens littéral d’un petit décalage, d’une petite liberté de mouvement. Et<br />
c’est cette manipulation ambiguë de son propre contexte qui donne à la relation rituelle son<br />
style propre, ce que confirmera l’analyse finale de l’ironie initiatique et divinatoire.<br />
Mais les maganga permettent une manipulation tout aussi décisive des relations<br />
externes qui sont impliquées et retravaillées dans le Misɔkɔ. Fabriquer un mbando, c’est<br />
chercher à transformer la relation sorcier/victime. De même, confectionner le paquet d’edika,<br />
c’est manipuler la relation homme/femme. Le jeu permis par le maniement des maganga rend<br />
ainsi possible la reconfiguration des relations externes dans lesquelles les initiés se trouvent<br />
également pris. Le parcours initiatique permet de mettre en scène, décomposer et recomposer<br />
l’ordre des relations sociales. L’opération de bascule au niveau des relations internes<br />
(changement de statut de profane à initié, déplacement progressif de cadet à aîné, de malade à<br />
guérisseur, de patient à devin) implique donc une transformation concomitante des relations<br />
externes. La relation père/fils est déplacée et redoublée dans la relation au père initiateur. La<br />
relation mère/fils est reprise à un niveau supérieur dans la figure maternelle du Bwete<br />
(Disumba, Myɔbε, Ngɔndε). La relation sorcier/victime est inversée ou du moins déplacée<br />
dans la relation antagoniste nganga/sorcier, relation qui passe l’appropriation ambivalente des<br />
pouvoirs sorciers par le nganga. La relation homme/femme est déplacée et redoublée dans la<br />
relation initié/profane, relation d’exclusion qui passe par l’appropriation ambivalente des<br />
-196-
pouvoirs du sexe féminin par les initiés 271 . La relation ancêtres/vivants est transposée à un<br />
autre niveau dans la relation mikuku/initiés, relation d’englobement qui passe par une<br />
identification paradoxale des initiés aux mikuku.<br />
L’initiation permet en définitive un autre type de rapport au lignage, notamment à<br />
travers la reconfiguration de ces trois relations essentielles que sont les relations aux sorciers,<br />
aux femmes et aux ancêtres. Les deux dernières d’entre elles se distinguent tout<br />
particulièrement du fait de leur statut singulier : ce sont en effet les seules pour lesquelles<br />
l’asymétrie forme un point de butée. Certaines relations dyadiques sont mobiles et se<br />
renversent facilement (aîné/cadet par exemple). En revanche, les dyades hommes/femmes et<br />
ancêtres/vivants sont plus rigides, dans la mesure où leurs pôles sont dans une relation<br />
d’opposition exclusive (on ne peut être l’un et l’autre à la fois). Se focalisant sur le cycle<br />
lignager, le rituel du Bwete bute ainsi sur les figures décisives de l’ancêtre et du sexe féminin.<br />
Tout le travail du rituel consiste alors à transformer ces deux relations d’opposition exclusive<br />
à travers une série de paradoxes.<br />
L’ancêtre occupe la place de référence du Bwete, place du maître de la tradition et de<br />
la divination qui reste pourtant fondamentalement inaccessible : le Bwete ne se traverse que le<br />
jour de mourir. L’identification paradoxale des initiés aux mikuku leur permet cependant de<br />
court-circuiter l’opposition exclusive en occupant dans le rituel simultanément la place des<br />
morts et des vivants : les initiés pleurent par anticipation leur propre cadavre. La relation<br />
initiatique au sexe féminin est tout aussi complexe. La différence des sexes est mise en scène<br />
dans le rituel sous la figure d’une opposition exclusive entre les hommes et les femmes qui se<br />
retrouve jusque dans la division latérale du mbandja. Mais tout le processus initiatique du<br />
Bwete (comme du Mwiri) vise en réalité à transformer cette opposition exclusive en une<br />
opposition englobante : les initiés masculins englobent le pôle féminin à travers<br />
l’appropriation rituelle du pouvoir procréateur détenu par les femmes. Les scarifications<br />
féminines des initiés du Mwiri rendent bien visible cet englobement. Mais l’insémination de<br />
l’esprit-embryon motoba ou la conjonction entre parole divinatoire et sexe féminin (qui se<br />
retrouve sous forme inversée dans la prohibition du cunnilingus) témoignent également de ce<br />
mouvement d’appropriation. En définitive, on fabrique des initiés autant avec du féminin<br />
qu’avec des ancêtres.<br />
271 Les relations aux femmes et aux sorciers reposent ainsi sur un même schéma d’ensemble : une relation<br />
d’opposition doublée d’une appropriation ambivalente. La relation aux femmes est cependant plus marquée dans<br />
la branche du Disumba qui met en jeu l’identité collective du groupe masculin, alors que la relation aux sorciers<br />
est décisive dans le Misɔkɔ centré sur l’infortune.<br />
-197-
Durkheim et ses continuateurs ont souligné que le rituel religieux procède de la<br />
délimitation d’un espace sacré qui lui confère une valeur transcendante (Durkheim 1968).<br />
Cette transcendance renvoie en réalité moins à la croyance en des entités surnaturelles qu’à<br />
une forme relationnelle spécifique : un point d’asymétrie maximale qui sert de terme<br />
organisateur, puisque toutes les autres relations rituelles se définissent par rapport à lui. Il n’y<br />
a ainsi pas besoin de “Dieu” dans le Bwete (la figure de Nzambe est quasiment absente du<br />
rituel) puisqu’il y a les femmes et surtout les ancêtres pour constituer un point de butée dans<br />
la relation. Et le Bwete, figure conjointement maternelle et ancestrale, représente lui-même ce<br />
point d’asymétrie maximale en surplomb de toutes les autres relations. Il est à la fois le point<br />
de référence et le point de fuite de toute la logique relationnelle du parcours initiatique.<br />
2. Voix et intentionnalité<br />
Les fétiches constituent ainsi des médiations matérielles érigées en quasi-sujets dans<br />
lesquelles le soi et l’intentionnalité des initiés se trouvent distribués. Parfois, le nganga<br />
s’efface totalement derrière les maganga, alors que c’est lui qui en réalité les manipule. C’est<br />
le cas avec les sorties de masques : il faut que les initiés disparaissent derrière les masques<br />
pour que les migɔnzi puissent apparaître. Le mogɔnzi danse : nous avons examiné le piège<br />
relationnel au fondement de cette formulation grammaticale où l’initié est destitué de sa<br />
position de sujet au profit de l’esprit. Ce même escamotage de l’intentionnalité humaine au<br />
profit de l’intentionnalité putative d’un artefact rituel se retrouve dans la musique de l’arc<br />
musical mongɔngɔ 272 . L’instrumentiste s’efface derrière son instrument pour laisser entendre<br />
une voix qui n’est pas vraiment la sienne – ce que l’analyse de la technique instrumentale<br />
permet de bien comprendre.<br />
Le joueur maintient l’arc musical de sa main gauche et le cale contre ses genoux et son<br />
visage de manière à placer la corde entre ses lèvres sans toutefois la pincer 273 . De sa main<br />
droite et à l’aide d’une baguette de bois, fine et souple, il frappe la corde afin de produire une<br />
vibration. Dans sa main gauche, une baguette plus courte et rigide (ou le revers de la lame<br />
d’un couteau) vient appuyer éventuellement en un point de la corde, pour en modifier la<br />
272<br />
L’arc musical est l’instrument majeur du Misɔkɔ, alors que la harpe à huit cordes ngɔmbi est celui du<br />
Disumba. Sur ces deux instruments, cf. Sallée 1985.<br />
273<br />
Le bois courbe est en kuta (Carpolobia alba), la corde vibrante est une liane séchée et amincie du palmierrotang<br />
geloko (Eremospatha).<br />
-198-
longueur vibrante. La seconde baguette étant toujours placée au même niveau de la corde, le<br />
joueur produit ainsi deux notes de base, espacées d’un ton environ. La cavité buccale sert de<br />
caisse de résonance : les mouvements de l’appareil phonatoire modifient la forme de la cavité<br />
buccale et donc sa fréquence propre de résonance, ce qui permet d’amplifier de manière<br />
sélective les harmoniques des deux notes fondamentales obtenues par frappement. Par cette<br />
technique de modulation, le joueur peut ainsi produire une musique complexe, répétition et<br />
variation à partir de courts motifs rythmiques et mélodiques. Cette musique est entrecoupée<br />
de brèves phrases chantées, le joueur continuant de frapper la corde vibrante mais cessant le<br />
jeu de résonance de sa bouche.<br />
L’arc musical est réputé posséder un pouvoir thérapeutique. Et pendant toute la veillée<br />
d’initiation, sa musique entêtante guide le banzi dans ses visions, tel un appel des esprits. Le<br />
mongɔngɔ est donc moins une simple musique qu’une véritable parole musicale, à destination<br />
ou en provenance des esprits. Cette parole émane de la voix propre de l’instrument : on dit<br />
ainsi que le mongɔngɔ parle ou chante. L’activité de l’instrumentiste est escamotée au profit<br />
de l’instrument lui-même. Selon une analogie secrète, le mongɔngɔ représente d’ailleurs un<br />
vieil homme : le bois flexible est sa colonne vertébrale courbée par les ans, la corde un de ses<br />
boyaux, les deux bâtonnets des os de ses avant-bras. Un récit initiatique justifie cette<br />
personnification.<br />
M 10 (origine de l’arc musical)<br />
“En forêt, un pygmée grimpe à un arbre musigu (Pachylobus buttneri) pour y<br />
cueillir des atanga sauvages. Par maladresse, il tombe. Dans sa chute, une<br />
branche lui transperce l’estomac, et il reste ainsi agonisant, suspendu dans les<br />
branchages. Ses boyaux s’écoulent lentement jusqu’au sol. Plus tard, sa femme<br />
le retrouve mort. Elle alerte les hommes du campement qui viennent récupérer<br />
les os et les boyaux du cadavre. Avec les ossements blanchis et les boyaux vidés<br />
et séchés, ils fabriquent le premier arc musical mongɔngɔ.”<br />
L’arc musical représente ainsi le corps du pygmée accidenté, tandis que la musique qui<br />
en sort exprime les pleurs de la veuve. Mais en deçà du symbolisme, la production même du<br />
phénomène acoustique légitime l’imputation à l’instrument d’une voix et d’une parole propre.<br />
La technique du résonateur buccal mobilise l’appareil phonatoire comme s’il s’agissait d’une<br />
parole articulée. L’instrumentiste donne ainsi l’impression qu’il est en train de parler et<br />
pourtant ce n’est pas sa voix qui se fait entendre. Le son ne provient pas à l’origine de la<br />
vibration des cordes vocales mais de la vibration de la corde de l’arc. De plus, en jouant sur<br />
les harmoniques des deux notes fondamentales grâce au résonateur buccal, l’exécutant donne<br />
à entendre un son qui était déjà virtuellement contenu dans la vibration de la corde frappée<br />
-199-
mais qui restait pourtant inaudible. Le mongɔngɔ fait donc entendre une sorte de voix cachée,<br />
qui n’est ni exactement celle de la corde frappée ni exactement celle du musicien 274 . Il utilise<br />
le support de l’appareil phonatoire humain sans être une parole articulée normale, et passe par<br />
un instrument de bois et de corde sans pourtant s’y réduire. Ce couplage de la bouche et de<br />
l’arc produit une voix à la fois humaine et inhumaine, qu’on peut effectivement penser<br />
comme une parole dissimulée à destination ou en provenance des esprits.<br />
Le musicien sert ainsi de porte-voix pour une voix étrange qui n’est pas la sienne. Ce<br />
dispositif se retrouve dans la parole divinatoire. Le nganga-a-Misɔkɔ modalise chacun de ses<br />
énoncés en utilisant la tournure : “le Bwete me dit que P”. L’initié récuse ainsi sa propre<br />
intentionnalité linguistique pour la déléguer au Bwete. Ce type d’artifice est un réquisit<br />
essentiel de toute divination : il faut mettre en scène l’élimination de l’intention du locuteur<br />
afin de donner à penser que ses énoncés sont vrais 275 . Il est notable que dans le Bwete, cette<br />
mise entre parenthèses du locuteur humain se fasse au profit d’une entité ambivalente. Le<br />
Bwete nous est en effet apparu comme une voix flottante lors de l’initiation, puis comme une<br />
figure englobante qui peut venir occuper toutes les places sur la scène rituelle (mère,<br />
nouveau-né, ancêtre, esprit, etc.). Le Bwete se définit donc moins par une identité stable que<br />
par une capacité de métamorphose, principe d’enchaînement de toutes les relations du cycle<br />
de la reproduction lignagère. Et il en va de même des esprits mikuku, auxiliaires de la<br />
consultation divinatoire. Pour O. Gollnhofer, les mikuku sont ainsi des “formes oniriques<br />
passant continuellement de l’une à l’autre, changeant constamment de nature” (Gollnhofer<br />
1973 : 17). Et il donne pour traduction “personne rusée, maligne”. Avec le Bwete et les<br />
mikuku, ce sont donc des tricksters qui se trouvent au fondement de la divination 276 . Le devin<br />
reporte ainsi son intentionnalité linguistique sur un énonciateur dont la caractéristique<br />
principale est l’équivocité. Le Bwete n’est là que pour condenser et résumer le jeu des renvois<br />
et des ambivalences de la parole divinatoire. La place éminente d’où provient la parole<br />
divinatoire est en réalité une place en forme de point d’interrogation, une place vide pour être<br />
trop pleine.<br />
L’étape de la traversée rituelle semble pourtant apporter enfin une réponse simple et<br />
définitive à l’énigme du Bwete. L’indétermination du Bwete se résorbe dans la révélation<br />
ostensive du crâne. Les profanes et la plupart des initiés croient que le motoba est un silure.<br />
274<br />
P. Boyer (1988) montre comment, dans le mvët des fang, la harpe-cithare fait également entendre une voix<br />
cachée, grâce à un rythme complexe résultant de la composition de deux rythmes différents joués par les deux<br />
mains de l’instrumentiste.<br />
275<br />
Cf. Boyer 1990 : chap. 4, Du Bois 1986.<br />
276<br />
C’est fréquemment le cas : ainsi le Renard pâle, figure emblématique des tricksters africains, est le patron de<br />
la divination chez les dogon.<br />
-200-
Mais un banal poisson ne saurait inspirer la parole divinatoire. Ce qui fait le pouvoir du<br />
motoba, c’est en réalité la poudre de mâchoire humaine que le père initiateur met discrètement<br />
sur l’alevin avant de le donner à avaler. C’est le crâne qui parle et non le silure. Le crâne est<br />
ainsi le fond secret de toutes les médiations rituelles de l’identité du nganga et de sa parole<br />
divinatoire. Mais derrière le crâne, il faut voir l’ancêtre. La parole du Bwete, parole vraie et<br />
efficace, tire tout son pouvoir des ancêtres lignagers, à travers leurs ossements, seuls éléments<br />
matériels qui subsistent après leur mort. Confectionner un bwete consiste à faire revenir<br />
l’esprit d’un mort dans le monde des vivants, par le biais du traitement rituel de son crâne,<br />
afin qu’il devienne le support d’une parole efficace.<br />
3. De l’art de mentir<br />
La traversée rituelle révèle ainsi que la multiplicité des voix des maganga au principe<br />
de la parole divinatoire n’est en réalité que la voix diffractée de l’ancêtre. Cette révélation ne<br />
suffit pourtant pas à mettre un terme aux renvois analogiques et aux médiations rituelles – le<br />
Bwete est trop rusé pour se laisser enfermer, même dans un crâne. La traversée du Bwete est<br />
en effet une étape paradoxale : on ne traverse pas vivant le Bwete puisque traverser, cela<br />
signifie devenir un ancêtre. L’ancêtre est donc à la fois la solution et l’échec de la solution –<br />
un piège de plus sur le chemin initiatique. Cette ultime ruse laisse la parole divinatoire<br />
suspendue dans l’ambivalence, comme le prouve cette confession ironique que m’a faite un<br />
père initiateur.<br />
“Je te divulgue le secret de la consultation. La consultation, c’est l’art de<br />
mentir. Mais c’est la vérité. On regarde le miroir quand on consulte. Cela, c’est<br />
seulement pour embrouiller les gens, les non-initiés ou même les initiés qui ne<br />
sont pas encore à ce niveau-là. Ils croient que tout ce qu’on dit, on le voit dans<br />
le miroir. Mais non. On ne voit rien dans le miroir. On ne voit que soi-même.<br />
Mais le miroir est en contact avec le motoba. Tu vois ta figure. C’est ta figure,<br />
bien sûr. Mais c’est le Bwete. C’est pourquoi on dit que le Bwete, c’est toimême.<br />
Donc ce que le cœur te dit, ce que le motoba te dit, tu le dis et c’est la<br />
vérité. […]<br />
Voici le secret de la consultation. Les autres nganga vont te demander : ‘Est-ce<br />
que ton père t’a donné le mukεmu pour la consultation ?’ – ce qu’on met aux<br />
yeux [un collyre irritant]. Mais le mukεmu, c’est pour fermer les yeux aux noninitiés<br />
et à ceux qui ne savent pas le secret de la consultation. Pour consulter, il<br />
faut le mukεmu, le bois sacré, bien sûr. Il y a des gens, je leur ai donné la<br />
consultation, mais je ne leur ai pas donné le secret. Je leur ai donné le miroir, le<br />
mukεmu. Mais c’est des mensonges. C’est l’art de mentir.<br />
Tout père spirituel va te dire que la consultation, c’est l’art de mentir. Mais on<br />
dit la vérité. Quand toi-même, tu consultes, tu vois que tu es en train de mentir,<br />
-201-
mais malgré cela tu n’es pas en train de mentir. Et ça tombe à pic. En même<br />
temps, c’est le mensonge, en même temps, c’est la vérité. Nous sentons quelque<br />
chose qui te dit ‘Dis ça’ et quand tu le dis, c’est la vérité. Quelle est cette<br />
chose ? C’est le Bwete, c’est ce que tu as dans ton ventre, le motoba. Si la<br />
personne se fait initier, elle va voir exactement ce que tu lui avais dit.<br />
Voici le secret de la consultation. Il n’y a plus autre chose. On peut monter,<br />
descendre, partir loin, loin, loin. Il n’y a que ça.”<br />
Dans cette vertigineuse révélation, le père initiateur confie que la divination, c’est l’art<br />
de mentir. La consultation repose en effet sur une série de subterfuges. Les patients profanes<br />
en sont les premiers dupes, lorsqu’ils croient que le devin voit des images dans son miroir ou<br />
entend des voix. Mais ces subterfuges concernent également les initiés. La plupart croient que<br />
le collyre que le père initiateur leur instille pour leur donner le pouvoir de consulter doit<br />
permettre de leur “ouvrir les yeux”. Cependant, ce collyre irritant aveugle plutôt qu’il ne<br />
dessille les yeux. Selon l’expression ironique du père initiateur, le collyre, “c’est pour fermer<br />
les yeux”. Les initiés sont donc abusés par leurs propres pratiques rituelles. Et le père<br />
initiateur souligne qu’il a fait franchir l’ultime étape de la consultation à bien des nganga sans<br />
leur en confier les ruses.<br />
Ces subterfuges reposent sur un jeu de renvois ironiques permettant de suspendre dans<br />
l’ambivalence l’origine des pensées inspirées et des images visionnaires du devin. Le nganga<br />
dit voir l’infortune du patient dans son miroir divinatoire. Il n’y voit pourtant bien<br />
évidemment que le reflet de son propre visage – évidence ironique similaire à la<br />
démystification du collyre aveuglant. Un jeu de renvois analogue concerne le silure motoba.<br />
Le motoba envoie au nganga des signaux divinatoires. Mais le silure n’est qu’un masque<br />
dissimulant la poudre de mâchoire humaine qui n’est elle-même rien d’autre qu’un masque de<br />
plus servant à dissimuler le cœur du nganga, inspirateur véritable de sa consultation : “ce que<br />
le cœur te dit, ce que le motoba te dit, tu le dis et c’est la vérité”. Un nganga doit toujours<br />
obéir à son cœur et dire ce qu’il lui enjoint de dire. Le cœur est intimement couplé au nzanga<br />
sans lequel il resterait impuissant : le vampire nzanga permet de transformer le désir en<br />
action, et dans le registre divinatoire, la pensée en parole efficace. Or, le revers du petit miroir<br />
de consultation est incrusté d’un fragment de nzanga (supposément un résidu de viscère<br />
humain, l’important étant de toute façon une présence symbolique). Le pouvoir divinatoire du<br />
miroir s’appuie ainsi sur le cœur ou le nzanga de l’initié.<br />
-202-
“On ne voit que soi-même”<br />
Le secret de la consultation révèle donc que derrière l’ensemble des artefacts rituels<br />
qui inspirent la divination se cache en réalité le cœur du devin. Ceci permet de saisir le sens<br />
de l’expression énigmatique : “le Bwete, c’est soi-même”. La parole du Bwete vient du cœur<br />
du nganga, c’est-à-dire de lui-même. La parole du nganga est bien sa propre parole, puisque<br />
affirmer “le Bwete me dit que P” s’avère n’être qu’une formulation synonyme de “je dis que<br />
P”. Le Bwete n’est donc rien d’autre que la figure de l’initié diffractée et réfléchie dans toutes<br />
les médiations rituelles. Le jeu des multiples projections et introjections au principe des<br />
maganga se boucle finalement en faisant retour sur lui-même. Si cette circularité ironique ne<br />
s’éclaircit véritablement que maintenant, la solution était pourtant là sous nos yeux dès le<br />
début du parcours rituel, dans la concentration obstinée du banzi sur sa propre figure réfléchie<br />
dans le miroir initiatique et dans la métamorphose progressive de son reflet.<br />
Les confidences d’un père initiateur nous permettent donc de boucler la boucle du<br />
Bwete sur l’image réfléchie de l’initié dans un miroir. Cette réflexivité ironique (Bwete =<br />
motoba = miroir = crâne = cœur = soi-même = Bwete), loin d’abolir l’ambivalence de la<br />
parole divinatoire, la perpétue au contraire dans une relance indéfinie. De là cette impression<br />
troublante que la confidence ne fait que tourner en rond : le Bwete, c’est le mensonge, donc<br />
c’est la vérité, donc c’est le mensonge… La divination repose sur une fort singulière mise<br />
entre parenthèses du sujet humain : il ne s’agit pas d’un simple escamotage du locuteur mais<br />
de la production d’un énonciateur équivoque. Prise dans le jeu interminable des délégations<br />
circulaires, l’origine de la parole divinatoire semble flotter en suspens entre ses diverses<br />
instances productives, entre le cœur du nganga et ses maganga. Et plus il y a de truchements<br />
-203-
ituels entre les paroles énoncées et l’intentionnalité au principe de l’énonciation, plus le<br />
nganga apparaît comme un devin accompli. Cette regressio ad infinitum se retrouve par<br />
ailleurs dans le savoir initiatique (inachèvement du secret, régression infinie vers l’origine,<br />
relance indéfinie des correspondances analogiques). Une seule et même cohérence formelle<br />
est donc à l’œuvre dans le Bwete, dans le champ du savoir initiatique comme dans celui de la<br />
divination.<br />
La divination s’appuie en définitive sur une relation de soi à soi qui, par un jeu<br />
circulaire de médiations rituelles, a perdu son évidence tautologique pour laisser la place à<br />
une réflexivité ironique. L’enjeu de l’initiation consiste à compliquer la relation d’identité<br />
pour en faire une relation réflexive d’ordre supérieur qui inclut toute une série d’autres<br />
relations. C’est ce que laissait entendre le titre de ce travail : “le <strong>Miroir</strong> et le Crâne”. Il ne<br />
s’agissait pas de placer une opposition dualiste au frontispice du Bwete, mais bien de suggérer<br />
la réflexivité au principe du parcours initiatique, à l’image du crâne réfléchi dans le miroir.<br />
C’est là sans doute la meilleure image qu’on puisse donner du Bwete et finalement de l’initié<br />
lui-même. L’épisode décisif des rites de passage du Byeri fang (qui pourrait tout aussi bien<br />
être celui du Bwete) place en effet le néophyte dos aux crânes lignagers face à un miroir ; puis<br />
par un pivotement habile du miroir, on fait apparaître les crânes à la place de son propre<br />
visage 277 .<br />
Depuis le début, dès la première consultation précédant l’initiation, les nganga ne<br />
cessent de clamer que “les nganga sont des menteurs”. Ces confidences ironiques permettent<br />
de prendre ce paradoxe très au sérieux. Tout le parcours initiatique – du miroir au crâne en<br />
passant par le collyre et le silure – repose en effet sur une série de mensonges. Mais cette<br />
démystification ne signifie pas qu’initiation et divination ne soient qu’une vaste supercherie<br />
reposant sur la crédulité des uns et l’hypocrisie des autres. S’arrêter là serait manquer<br />
l’essentiel du Bwete. Le père initiateur soutient que malgré ou plutôt grâce à la série des<br />
mensonges, le devin dit vrai : “en même temps, c’est le mensonge, en même temps, c’est la<br />
vérité”. Les énoncés du devin sont des mensonges et pourtant ils piquent le malade jusqu’à le<br />
faire pleurer : “ça tombe à pic”. Le Bwete repose sur un dispositif rituel mensonger qui<br />
produit ultimement une parole vraie. Si l’on veut prendre cette affirmation du père initiateur<br />
au sérieux, il reste donc à saisir comment des mensonges peuvent produire une vérité.<br />
4. La topique du cœur<br />
277 Les Grecs auraient employé un dispositif similaire dans les initiations dionysiaques : une fresque de la Maison<br />
Homérique à Pompéi montre un jeune homme scrutant le fond réfléchissant d’une coupe, tandis qu’un homme<br />
tient derrière lui le masque d’un satyre grimaçant (Delatte 1932).<br />
-204-
Les mensonges portent sur les véritables lieu et auteur des productions psychiques et<br />
verbales du devin. Le devin attribue à ses maganga des images et des pensées qui en réalité<br />
proviennent de son propre fond. Or, ce fond, c’est le cœur. Indépendamment même des<br />
complications rituelles, l’intentionnalité humaine est distribuée dans plusieurs instances qui<br />
sont les composantes ordinaires de toute personne : l’esprit gedidi, le cœur motema, le<br />
vampire nzanga. Le cœur est la source originaire de la pensée, du désir et de la volition. Le<br />
nzanga est l’organe de l’action qui permet d’accomplir ce que le cœur désire. L’esprit gedidi<br />
est également une instance de la pensée comme le cœur. Mais il est lié à une pensée<br />
consciente et contrôlée, alors que le cœur est la source irrépressible de la pensée et du désir.<br />
Le cœur a ainsi une dimension pulsionnelle, l’esprit une dimension plus réflexive.<br />
Les nganga décrivent l’activité divinatoire comme un flot d’images et de pensées<br />
qu’ils se sentent poussés à exprimer en mots : “nous sentons quelque chose qui te dit ‘Dis<br />
ça’”. Ce flux irrépressible provient du cœur. La divination s’appuie ainsi sur une véritable<br />
pulsion psychique plutôt que sur la formation volontaire d’idées. Les nganga disent en effet<br />
ressentir que ça parle à l’intérieur d’eux. L’usage régulier de petites doses d’eboga accentue<br />
encore ce phénomène. L’eboga est en effet un puissant psychostimulant qui déchaîne un flux<br />
irrépressible de pensées (et d’affects). Selon la dose et la maîtrise de chacun, cela va du<br />
sentiment de lucidité intense à la confusion psychique. Il y a en outre un net effet de<br />
dédoublement réflexif qui fait que l’on perçoit comme à distance le flux de pensées sans pour<br />
autant être capable de l’inhiber 278 . L’eboga fait donc ressentir de manière très concrète que ça<br />
pense en nous. Les initiés s’en servent comme d’un accélérateur ou d’un amplificateur de la<br />
pensée : grâce au bois sacré, le cœur, c’est-à-dire le Bwete, parle mieux et plus. Et c’est bien<br />
parce que l’eboga amplifie un phénomène préexistant que les devins accomplis peuvent<br />
aisément s’en passer. Le véritable principe de la divination, ce n’est pas l’eboga mais le cœur<br />
du devin d’où provient sa pensée.<br />
Lorsque son cœur lui envoie une pensée, le devin doit parler à haute voix sans honte ni<br />
timidité. Ses interlocuteurs ne pourront rien faire d’autre qu’y acquiescer par des “base !”.<br />
Soutenue par le nzanga, la parole du Bwete doit être une parole courageuse et assurée. La<br />
verbalisation des pensées du cœur est ainsi une obligation rituelle. Cet impératif renvoie sous<br />
une forme inversée au rôle de censure dévolu à la pomme d’Adam. Interposée entre le cœur et<br />
la bouche, la pomme d’Adam retient les pensées qui ne demandent qu’à s’exprimer. Cette<br />
278 H. Michaux notait le même phénomène dans ses expériences mescaliniennes : “une nouvelle vigilance<br />
inconnue auparavant est là, installée, observatrice, réfléchisseuse, à la fois en tiers et pourtant purement moi”<br />
(1972 : 173).<br />
-205-
capacité de rétention verbale correspond à l’intériorisation d’un interdit communautaire : il ne<br />
faut pas trahir les secrets initiatiques. La parole divinatoire repose sur une obligation inverse :<br />
il faut parler publiquement, car la vérité contenue dans la parole divinatoire n’appartient pas<br />
en propre au devin mais concerne toute la communauté.<br />
Les relations dynamiques entre cœur, pomme d’Adam et parole dessinent finalement<br />
une sorte de “métapsychologie indigène”. Il ne s’agit pas ici de plaquer une interprétation<br />
psychanalytique sur des données ethnographiques, mais de montrer en quoi le Misɔkɔ repose<br />
sur un noyau problématique qui fait la part de l’inconscient, élaboration justifiable d’une<br />
comparaison avec la métapsychologie freudienne 279 . La divination du Misɔkɔ mobilise en effet<br />
des instances psychiques différenciées, une relation dynamique entre ces instances et le<br />
postulat de phénomènes inconscients (un fond originaire de la pensée et du sentir qui échappe<br />
à notre contrôle). La seconde topique freudienne distingue le Ça, le Moi et le Surmoi : le Ça<br />
désigne le réservoir des pulsions inconscientes, tandis que le Surmoi (lui-même partiellement<br />
inconscient) est l’instance de la censure et renvoie d’abord aux interdits parentaux (Freud<br />
1981). Or, le cœur, comme fond inchoatif de la pensée, n’est pas sans ressemblance avec le<br />
Ça : les deux instances figurent le réservoir pulsionnel du psychisme. Et la pomme d’Adam,<br />
comme censeur, est analogue au Surmoi. Certes, la censure opère ici en aval au niveau de la<br />
verbalisation et non en amont dans la conscience. Mais cette censure correspond comme pour<br />
le Surmoi à l’intériorisation d’interdits (assumés ici par la communauté initiatique).<br />
Il serait assurément abusif d’ériger en véritable théorie de l’inconscient les<br />
commentaires allusifs de quelques nganga qui cherchent plus modestement à décrire leur<br />
expérience. Il est toutefois très net que, selon eux, la divination s’appuie sur un flux psychique<br />
inchoatif mêlant images et pensées. Expérience d’un affect de la pensée qui est bien de l’ordre<br />
du ressenti, la divination implique donc concrètement des états du corps et de l’esprit. Nous<br />
avions déjà noté cette base sensorielle de la divination à propos du motoba dont la parole<br />
repose sur des lapsus corporels (tressaillements, éternuements, faux-pas). Tant l’afflux des<br />
pensées du cœur que les lapsus corporels impliquent un ressenti immanent qui échappe<br />
cependant à tout contrôle. La divination doit donc être envisagée du point de vue de la<br />
personne incarnée, d’un sujet parlant qui est d’abord sentant et pensant 280 . Mais cœur et lapsus<br />
corporels prouvent qu’au principe du penser et du sentir de ce sujet incarné, il y a une sorte<br />
279 Sur les modes d’articulation entre anthropologie et psychanalyse, cf. Bidou & alii 1999, Galinier 1997.<br />
280 C’est toute la thématique de l’anthropologie de l’embodiment (Csordas 1994).<br />
-206-
d’altérité intime qui le travaille de l’intérieur. La divination semble en effet provenir d’un<br />
autre que soi qui agit pourtant à l’intérieur de soi 281 .<br />
C’est autour de ce rôle paradoxal du cœur que s’opère le pivot entre mensonge et<br />
vérité : “l’art de mentir, parce que nous sentons quelque chose qui te dit ‘Dis ça’ et quand tu<br />
le dis, c’est la vérité”. Quand le cœur du devin parle, c’est la vérité qui s’exprime. Ce que<br />
prouvent les réactions des patients qui se mettent à pleurer, piqués par la parole du devin. Les<br />
nganga ne peuvent cependant pas affirmer tout de go aux profanes que la divination ne repose<br />
que sur les pensées et images inspirées par leur propre cœur. Le miroir, les fétiches ou motoba<br />
sont alors des mensonges nécessaires, un peu comme ces faux dards empoisonnés que les<br />
chamanes américains extraient du corps de leurs patients afin de leur donner à voir la réalité<br />
de l’agression sorcière. Le chamane reconnaît volontiers qu’il avait préalablement caché un<br />
simulacre dans sa bouche. Mais comment faire comprendre à des ignorants la réalité de<br />
fléchettes invisibles autrement que par la mise en scène d’un leurre 282 ?<br />
Il y a quelque chose de semblable à l’œuvre dans le Bwete. La parole divinatoire<br />
s’appuie sur un ressenti à la fois immanent et irrépressible (lapsus corporels, afflux de<br />
pensées). Par une série de déplacements, cette altérité intime au cœur du soi est diffractée<br />
dans des objets rituels. Les divers artefacts mobilisés dans la divination sont en effet supposés<br />
parler au nganga ou lui montrer des images. La diffraction de l’intentionnalité humaine dans<br />
les maganga constitue ainsi une mise en scène du rôle du cœur dans la parole divinatoire. La<br />
topique de la parole divinatoire se trouve donc partiellement extériorisée : alors que la topique<br />
freudienne concerne un appareil psychique et des instances abstraites, la topique divinatoire<br />
est incarnée dans des organes (cœur, pomme d’Adam) et objectivée dans de multiples<br />
artefacts (maganga). Cette diffraction est une supercherie nécessaire : elle met en scène la<br />
vérité de la parole divinatoire en lui donnant une consistance matérielle. Le devin dit la vérité<br />
parce qu’il ne s’appuie pas sur son seul cœur mais qu’il est capable de mobiliser ces alliés<br />
mystérieux que sont les maganga. Ces subterfuges permettent à l’initié de se montrer et de se<br />
voir lui-même comme un autre. De ce fait, ils sont sans doute autant nécessaires aux initiés<br />
qu’aux profanes : les nganga ont besoin des maganga pour se laisser prendre au piège de leur<br />
propre parole.<br />
281<br />
Fait remarquable, Evans-Pritchard repérait le même rôle sensible du cœur dans la divination zande. Le devin<br />
danse “sur” le nom des personnes suspectes de sorcellerie, la révélation passant “par l’association de l’idée et du<br />
nom du sorcier avec un trouble physiologique, principalement avec une accélération soudaine des pulsations du<br />
cœur qui commence à battre violemment, toc-toc, toc-toc, toc-toc” (1972 : 219).<br />
282<br />
Sur la ruse des fléchettes du chamane achuar, cf. Descola 1993 : 364-365. Sur les artifices rituels, cf.<br />
également Lévi-Strauss 1958a.<br />
-207-
La parole du devin est donc vérace car elle a de son côté tous les mensonges du rituel.<br />
Le motoba et le miroir sont les plus efficaces de ces mensonges. Gober un alevin vivant met<br />
en scène l’incorporation d’un autre que soi à l’intérieur de soi, sorte d’homoncule auquel sont<br />
attribués l’afflux irrépressible des pensées et les lapsus corporels. Tout se passe donc comme<br />
si les initiés avaient besoin de cette supercherie pour s’approprier les pouvoirs intimes du<br />
cœur : ils doivent avaler ce qu’ils possèdent en réalité déjà. En outre, le motoba renvoie<br />
conjointement aux multiples registres de la parole divinatoire : l’ancêtre et son pouvoir (la<br />
poudre de mâchoire humaine déposée sur l’alevin), le Mwiri et sa parole assermentée (le génie<br />
Mwiri est le chef des silures), la procréation féminine et son appropriation rituelle (ce sont les<br />
femmes qui pêchent les mitoba ; gober l’alevin correspond à l’insémination d’un esprit).<br />
Avaler motoba, c’est incorporer au sujet initié la double relation à l’ancêtre et au féminin.<br />
Le miroir est un mensonge tout aussi efficace. Des rites de passage à la divination, le<br />
miroir donne à voir le dédoublement réflexif au principe de l’identité initiatique. Cette identité<br />
en miroir repose sur une relation de soi à soi diffractée dans une série d’images. Cette<br />
réflexivité se boucle ironiquement dans la reconnaissance finale que l’image spéculaire n’est<br />
rien d’autre que l’image de soi, c’est-à-dire dans une identification de l’autre et du soi.<br />
L’emploi bien visible du miroir pendant la séance de consultation reflète ainsi la position<br />
complexe de l’énonciateur à l’intérieur même du contexte d’énonciation. Le devin est mis en<br />
abyme dans la divination. Le miroir constitue une sorte de commentaire silencieux sur la<br />
situation de communication : en le brandissant aux yeux de tous, le devin donne à voir la<br />
singularité de la parole divinatoire. Le miroir ou l’emploi de formules telles que “le Bwete me<br />
dit que…” confèrent finalement à la divination une dimension sui-référentielle. Par ce biais, la<br />
situation d’énonciation produit et met en scène un énonciateur complexe et ambigu, conférant<br />
par là même à ses énoncés une valeur illocutoire singulière 283 .<br />
5. La relation ironique<br />
Les maganga constituent ainsi un pivot autour duquel basculent vérité et mensonge.<br />
Trait essentiel, ce pivot se fait sur le mode de l’ironie : le collyre qui ouvre les yeux sert en<br />
fait à fermer les yeux ; le miroir ne reflète en réalité que l’image de celui qui s’y mire. C’est<br />
sur l’ironie que repose en définitive la parole divinatoire et, plus largement, la relation<br />
initiatique : l’implication dans la communauté initiatique s’appuie sur une série d’interactions<br />
283 La sui-référentialité est la marque essentielle de l’acte illocutoire : l’énoncé fait allusion à sa propre<br />
énonciation. La force illocutoire est donc une question de positionnement de l’énonciateur par rapport à son<br />
énonciation (expression d’intentions et de prétentions) (Ducrot 1991 : 279-305).<br />
-208-
de type ironique. L’ironie est en effet moins une innocente figure de style qu’un mode de<br />
relation. En rhétorique, elle n’est pas classée parmi les figures de mots mais parmi les figures<br />
de pensée : non pas fait de signification relevant de la sémantique mais fait d’interprétation<br />
qui engage l’intentionnalité et le contexte d’énonciation, et relève donc de la pragmatique des<br />
actes illocutoires 284 . Toute ironie implique trois actants : un locuteur, un destinataire, une<br />
cible. Leur recouvrement possible permet d’obtenir les différentes espèces de l’ironie. Quand<br />
les trois sont distincts, le locuteur raille la cible aux oreilles du destinataire : le locuteur se<br />
place dans une relation sarcastique avec la cible afin d’engendrer une relation de complicité<br />
avec le destinataire. Si le destinataire est pris pour cible, la moquerie se fait plus agressive et<br />
la dimension complice s’amenuise. Si le locuteur est sa propre cible, c’est de l’auto-ironie.<br />
Or, l’ironie du Bwete n’est ni exactement ironie sarcastique ni exactement auto-ironie.<br />
Le locuteur initié fait habituellement porter l’ironie sur le contexte de sa propre énonciation :<br />
c’est par exemple le nganga qui déclare “les nganga sont des menteurs” 285 . Si toute ironie<br />
possède une dimension paradoxale, ce type-ci l’exploite systématiquement en remettant en<br />
cause sa propre énonciation. Appelée ironie instable (unstable irony) par W. Booth (1974), ce<br />
type correspond bien à la définition d’A. Berrendonner : “s’inscrire en faux contre sa propre<br />
énonciation, tout en l’accomplissant” (Berrendonner 1982 : 216). Cette ironie circulaire<br />
dépasse la simple raillerie pour redevenir sérieuse : elle met en péril la possibilité même d’une<br />
interprétation stable de l’énoncé car on ne peut plus assigner au locuteur un point de vue fixe.<br />
D’où l’usage typographique des guillemets ou des points de suspension pour marquer<br />
l’ironie : mise entre guillemets qui renvoie au niveau métacommunicatif de l’énonciation<br />
(énoncé en mention plutôt qu’en usage) ; points de suspension qui expriment le suspens de<br />
l’interprétation.<br />
En donnant ainsi un tour paradoxal à l’ironie, les initiés instaurent la singularité du<br />
cadre relationnel du rituel. La valeur illocutoire de cette ironie est en effet remarquable : elle<br />
engage le destinataire dans une coopération en faisant de lui un complice du locuteur. En<br />
effet, identifier l’ironie comme telle et savoir en saisir la portée implique de la part du<br />
destinataire une inférence complexe qui dépasse l’interprétation du seul contenu sémantique<br />
284 Sur l’ironie, cf. Kerbrat-Orecchioni & alii 1976, Booth 1974, Sperber & Wilson 1989, Perrin 1996.<br />
285 Ce n’est pas un hasard si les chanteurs du mvët fang au Cameroun (Boyer 1988 : 24) ou les aînés orang ulu de<br />
Bornéo central (Metcalf 2002) déclarent la même chose. Ce n’est pas non plus un hasard si l’on retrouve le<br />
même type de paradoxe dans la fiction : ainsi F. Fellini qui déclare “Je suis un grand menteur” ou encore F for<br />
fake (1973), le documenteur d’O. Welles sur un faussaire hongrois. Il s’agit à chaque fois d’instaurer un rapport<br />
à la réalité qui se situe au-delà de l’alternative du vrai et du faux, par le biais d’une relation de manipulation<br />
complice avec l’interlocuteur ou le spectateur.<br />
-209-
de l’énoncé et exige la prise en compte du contexte singulier de l’énonciation 286 . Le<br />
destinataire est amené à reconnaître avec le locuteur la validité du contexte de communication<br />
dans lequel ils se trouvent tous deux. L’ironie l’oblige à rentrer dans un cadre rituel qui repose<br />
sur des prémisses paradoxales. Les initiés parviennent ainsi à faire de leurs interlocuteurs des<br />
complices en décrivant la situation rituelle de manière ironique.<br />
L’ironie du Bwete<br />
Cette relation ironique permet de comprendre à la fois l’efficacité et l’ambivalence de<br />
la parole divinatoire. La divination fait l’objet de jugements de valeur divergents, y compris<br />
entre les devins prompts à dénigrer leurs rivaux ou louer leurs alliés. Mais tout le monde<br />
s’accorde à dire que s’il existe de nombreux imposteurs qui exploitent la détresse des gens à<br />
des fins lucratives, il existe aussi de vrais devins qui accomplissent des miracles. L’attitude la<br />
plus commune est donc celle d’une confiance relative ou d’un scepticisme tempéré par la<br />
nécessité du recours à la divination quand frappe l’infortune. Comme partout et toujours, on<br />
ne se situe pas dans une alternative tranchée entre adhésion crédule et rejet total, mais plutôt<br />
dans un entre-deux labile où croyance et incroyance peuvent s’échanger au gré des<br />
expériences et des engagements de chacun. Et ce scepticisme ordinaire n’est certainement pas<br />
le produit récent d’une modernisation de la société gabonaise qui tendrait au désenchantement<br />
du monde. En effet, loin d’être l’ennemi du rituel, le doute en est la ressource la plus<br />
féconde 287 . Le rôle constitutif de l’ironie dans la divination le montre bien : reposant sur une<br />
relation de type ironique entre nganga et patient, la divination entraîne moins l’adhésion<br />
crédule que l’ambivalence et le doute. L’ironie est en effet une sorte de mise en question faite<br />
pour être perçue dubitativement (et l’ironie socratique était bien un mode d’interrogation).<br />
286<br />
Ou de l’interaction, car il y a une communication ironique qui se passe de mots et repose simplement sur la<br />
posture et l’action (par exemple le jeu du miroir dans la divination).<br />
287<br />
C’est la thèse centrale de Religious reflexivity (n° spécial de Social Anthropology : Kordt Højbjerg 2002) qui<br />
réfute la trop simple opinion selon laquelle les “sociétés traditionnelles” ont la propriété d’être conservatrices et<br />
non réflexives (Horton 1993). Mais E.E. Evans-Pritchard (1972) avait déjà bien repéré ce rôle productif du<br />
scepticisme dans la divination zande, à travers la manipulation des oracles et les subterfuges des exorciseurs (cf.<br />
également Taussig 2003).<br />
-210-
La relation entre devin et patient s’articule autour d’une série de mensonges rusés :<br />
subterfuges du miroir, des signes corporels au kaolin ou de la consultation orale. Le mensonge<br />
n’est donc pas un échec de la consultation mais un aspect central de toute divination réussie :<br />
l’efficacité de ces supercheries divinatoires se vérifie dans les pleurs du malade. Ceci explique<br />
pourquoi le nganga doit “deviner” les symptômes de son patient, même si cela exige d’en<br />
passer par des mensonges. Il importe que le devin parle et que le patient se taise. C’est une<br />
affaire de piège relationnel et non d’efficacité diagnostique. La parole mensongère du devin<br />
pique le patient comme l’aiguille rituelle pique la langue : le devin parvient à saisir quelque<br />
chose de l’expérience du patient dans son discours. Ce saisissement est avant tout une affaire<br />
de place dans l’énonciation. Le patient écoute le discours d’un tiers qui objective crûment sa<br />
propre expérience du malheur. Il ne peut y répondre que par l’acquiescement “base !”, ce qui<br />
est une manière de valider non seulement les énoncés mais aussi le contexte d’énonciation lui-<br />
même. La vérité divinatoire repose ainsi sur une configuration relationnelle singulière, définie<br />
par le positionnement par rapport au miroir et à la prise de parole 288 . La consultation organise<br />
donc un véritable piège : selon une métaphore explicite, consulter, c’est “bien mentir” afin de<br />
piéger le patient comme un gibier. Qu’est-ce en effet qu’un piège de chasse sinon un leurre –<br />
un artefact mensonger – qui orchestre une relation entre piégeur et gibier (Gell 1999b) ?<br />
Dans la consultation, le mensonge n’est donc pas le contraire de la vérité mais son<br />
revers ironique. C’est le doute (quant à la nature et l’origine de son infortune) qui mène le<br />
patient désemparé à la consultation. Or, le devin s’attache subtilement à reconduire ce doute<br />
en laissant ironiquement entendre qu’il est un menteur. En effet, l’énoncé paradoxal “les<br />
nganga sont des menteurs” appelle directement l’initiation du patient qui apporte une<br />
vérification visionnaire de la divination. Mais cette initiation constitue moins une élucidation<br />
qu’une prolongation de l’ambivalence, puisqu’elle s’organise encore autour d’une interaction<br />
ironique entre banzi et initiateurs. Les ruses du miroir et des “base !” se retrouvent en effet<br />
sous une forme inversée : c’est maintenant le banzi qui scrute sa propre image dans le miroir,<br />
et l’assistance des initiés qui acquiesce à ses récits visionnaires. L’implication initiatique<br />
repose ainsi sur un jeu de permutation de places dans l’action et la parole, permutation qui<br />
s’opère autour du pivot du miroir.<br />
288 M. Détienne (1967) montre comment un régime de discours et de vérité ne se définit pas hors d’un espace<br />
relationnel. Il oppose ainsi l’asymétrie de la Grèce archaïque (perspective hiérarchique opposant l’oracle ou le<br />
roi de justice à la foule – ce qui correspond à une vérité assertorique s’exprimant par une parole efficace) à la<br />
symétrie de la Grèce classique (cercle de l’agora de la cité isonomique où chacun est par rapport aux autres dans<br />
une position réversible – ce qui correspond à une vérité-adéquation élaborée dans le dialogue). La transition<br />
entre les deux passe par l’assemblée circulaire des guerriers qui déposent leur butin au milieu du cercle pour le<br />
mettre en commun avant de le partager.<br />
-211-
Le terme “base !”, qui peut au premier abord paraître anodin, constitue donc en réalité<br />
un redoutable piège relationnel. Les “base !” des initiateurs face au banzi font écho aux<br />
“base !” du patient face au devin : cette circularité entre consultation et initiation permet aux<br />
différents protagonistes de se piéger réciproquement dans le Bwete. L’usage du terme s’étend<br />
même à toute situation rituelle : au cours d’une veillée, les initiés emploient constamment la<br />
formule de manière exclamative pour saluer une performance réussie (chants, danses, etc.). Le<br />
destinataire de ce “base !” doit toujours y répondre par un autre “base !” sous peine d’une<br />
immédiate réprimande collective. La formule sert donc autant à approuver la situation qu’à<br />
exiger d’autrui cette même approbation. De là cet usage du “base !” proféré par l’aîné puis<br />
extorqué au cadet afin de juguler une dispute et la réserver au bwεnzε du matin après la<br />
veillée. L’impératif de réciprocité dans l’approbation marque bien la nécessité de la<br />
reconnaissance mutuelle de la validité du contexte interactionnel spécifique d’une cérémonie<br />
de Bwete. Que cela soit au cours d’une séance divinatoire ou d’une veillée, la formule sert à<br />
exprimer l’acceptation réciproque de la pertinence de la relation rituelle. L’emploi généralisé<br />
du “base !” prouve ainsi que le piège relationnel qui se noue dans la consultation pour se<br />
poursuivre dans l’initiation continue encore tout au long du parcours rituel.<br />
La relation ironique vaut donc autant entre initiés qu’entre profanes et initiés. De<br />
manière fort révélatrice, les initiés usent souvent entre eux d’antiphrases – l’antiphrase étant<br />
justement l’un des procédés favoris de l’ironie. Un petit nombre d’énoncés paradoxaux<br />
reviennent même comme des modèles du genre. Un initié dit “je suis assis” alors qu’il se met<br />
debout. Il dit “je ne suis pas là” pour signifier “je suis ici”. Il dit “je suis parti” alors qu’il reste<br />
sur les lieux. Il affirme “ce n’est pas moi” pour dire “c’est moi”. Il dit “ce n’est pas moi qui<br />
parle” alors qu’il s’apprête à parler. Il dit “nous, les profanes” pour désigner les initiés, et<br />
“vous, les initiés” en montrant les spectateurs profanes. Il affirme “les nganga sont des<br />
menteurs” pour évoquer la véracité et la pertinence de leur divination. Il appelle “bois sucré”<br />
l’eboga dont l’épouvantable amertume est pourtant la principale qualité gustative 289 .<br />
Ces antiphrases se font toujours sur le ton de la plaisanterie, mais représentent pourtant<br />
bien plus que des boutades anecdotiques : leur fréquence élevée et leur extension restreinte<br />
aux initiés leur confèrent une valeur systématique plutôt qu’épisodique. Les plaisanteries<br />
antiphrastiques apparaissent ainsi comme des marqueurs distinctifs de l’appartenance au<br />
Bwete, au même titre que le “base !” quoique dans un autre registre de sens. Au-delà du rire,<br />
elles placent les initiés dans un contexte singulier d’énonciation qui joue sur le paradoxe. Il<br />
289 Cette dernière antiphrase se double d’un jeu de mots. L’eboga est appelé en français soit “bois amer” d’après<br />
son amertume, soit “bois sacré” d’après son utilisation rituelle. “Bois sucré” contredit donc “bois amer” tout en<br />
étant un paronyme de “bois sacré”.<br />
-212-
n’est d’ailleurs pas innocent que les principaux thèmes de ces antiphrases concernent<br />
justement la parole initiée : la vérité (“les nganga sont des menteurs”), l’énonciateur (“ce<br />
n’est pas moi qui parle”), le statut d’initié (“nous, les profanes”) ou le jeu sur le visible et<br />
l’invisible (“je ne suis pas là”). Les antiphrases révèlent donc – à qui peut l’entendre – la<br />
nature exacte de la parole du Bwete. Sur le ton anodin de la plaisanterie, des contrevérités<br />
flagrantes énoncent la vérité de la situation initiatique. Il est vrai que ce n’est pas l’initié qui<br />
parle lors de la consultation, puisque c’est le Bwete qui inspire ses dires. Il est également vrai<br />
que les nganga sont des menteurs, puisque initiation et consultation reposent sur des<br />
subterfuges. Et quoi mieux qu’une antiphrase pourrait aussi bien donner à entendre que la<br />
parole des initiés est une parole radicalement différente. Par ses plaisanteries en forme de<br />
paradoxe, le locuteur amène son auditoire à reconnaître avec lui la validité du contexte<br />
singulier de la parole du Bwete. Les antiphrases réactivent ainsi la complicité ironique au<br />
principe de la relation initiatique, leur interprétation présupposant le parcours rituel qui les a<br />
rendues possibles.<br />
Ce même type de complicité ironique se retrouve encore dans le Mwiri ou avec les<br />
mabundi. Dans le Mwiri, puisque le serment initiatique manifeste que la capacité à dire le vrai<br />
(la parole assermentée des initiés) repose en réalité sur l’aptitude à taire un mensonge (le<br />
Mwiri n’est pas un génie mais un homme). Avec les mabundi, puisque l’inclusion des femmes<br />
dans le Bwete est une façon subtile de donner encore à voir leur exclusion initiatique. En<br />
passant encore par les mensonges ambivalents du silure motoba, la relation ironique se<br />
poursuit enfin jusqu’à la traversée paradoxale du Bwete pour s’achever dans la révélation du<br />
secret de la consultation. Par un dernier clin d’œil complice, le père initiateur finit par confier<br />
que ce qu’il affirmait déjà lors de la consultation préalable, au début du parcours rituel (“les<br />
nganga sont des menteurs”, “le Bwete, c’est toi-même”) était la plus pure vérité. C’est ce que<br />
la stylistique appelle une implication rhétorique : formule ironique qui conduit le destinataire<br />
à comprendre autre chose que le contenu littéral, alors que tout était en fait déjà dit dans<br />
l’énoncé (Dupriez 1991 : 248-250). Il aura donc fallu parcourir tout un long chemin<br />
initiatique pour arriver à reconnaître la pertinence de ces énoncés paradoxaux.<br />
Au fondement de tout le parcours initiatique, il y a donc une relation ironique,<br />
médiatisée par des dispositifs rituels et des objets. Cette forme relationnelle constitue un<br />
redoutable piège à pensée, à croyance et à action, piège qui permet de rendre compte de la<br />
complicité effective tout en faisant l’économie de la coûteuse hypothèse d’une adhésion<br />
crédule des acteurs (ou de son symétrique, la mystification hypocrite). Cette ironie qui touche<br />
autant le rapport à soi que le rapport à autrui se trouve ainsi au principe même de la relation<br />
-213-
ituelle. En piégeant autrui dans le dispositif, on se piège soi-même. Chacun s’entre-capture<br />
dans le jeu rituel de la dépendance réciproque. Ces pièges ironiques maintiennent jusqu’au<br />
terme du parcours initiatique doute, ambivalence et scepticisme. Preuve que loin de constituer<br />
un danger de démystification destructrice, ils sont les meilleurs alliés du Bwete. L’ironie<br />
circulaire est en effet instable et finalement insoluble. La parole indécidable du Bwete repose<br />
donc sur la conjonction de deux prémisses contradictoires qui se répondent en écho : le Bwete,<br />
c’est le mensonge ; le Bwete, c’est la vérité. Et c’est finalement la reproduction initiatique –<br />
i.e. l’initiation éventuelle de la personne consultée – qui authentifiera a posteriori cette<br />
parole, mais, ce faisant, l’exposera de nouveau à un parcours rituel jonché de doutes.<br />
La relation ironique permet donc de rendre compte de l’implication des acteurs dans<br />
leurs actes sans avoir à tenir initiés et profanes pour des imposteurs ou des crédules. Il suffit<br />
de s’y laisser prendre soi-même pour en éprouver la redoutable efficacité. Cette confidence où<br />
le père initiateur me confiait les ruses du Bwete sur un ton ironique constituait d’ailleurs ellemême<br />
un piège dans lequel je me suis laissé prendre. La scène se tenait quelques semaines à<br />
peine avant le terme de mon second séjour gabonais. Nous étions seuls, le père initiateur et<br />
moi. Cela faisait déjà une année que je le fréquentais et une relation de confiance s’était<br />
établie entre nous. En réalité, cette confiance prenait souvent la forme d’un rapport de<br />
dépendance réciproque, rapport non exempt de tensions. Et à dire vrai, au moment de la<br />
confidence, notre relation était singulièrement troublée. Certains de ses comportements<br />
m’avaient profondément déçu et j’avais pris quelque distance au terme d’une discussion<br />
orageuse. Il craignait alors que je ne le délaisse au profit d’initiés rivaux. Mais il savait que<br />
j’attendais encore des précisions au sujet de la divination et m’a explicitement présenté sa<br />
confidence comme la levée des derniers secrets initiatiques avant mon départ. En me confiant<br />
ainsi ces secrets sur le mode de l’ironie, le père initiateur cherchait moins à m’instruire qu’à<br />
me faire entrer dans une relation de complicité avec lui, afin de recréer un lien initiatique<br />
quelque peu distendu. En effet, de mon côté, savoir entendre l’ironie et la reconnaître comme<br />
telle, c’était inévitablement accepter de me replacer de son côté en position de complice. Être<br />
le dépositaire des secrets ironiques du Bwete, c’était donc être de nouveau pris au piège de la<br />
relation initiatique. Et, preuve de l’efficacité relationnelle de l’ironie, cette confidence a<br />
effectivement permis une réconciliation durable.<br />
L’anthropologie du rituel est classiquement une anthropologie du symbolique : le<br />
rituel est une “forêt de symboles” que l’anthropologue s’attache à éclaircir en mettant au jour<br />
ses principaux tropes, enchevêtrement de métaphores et de métonymies. Métaphore et<br />
-214-
métonymie ont en effet été placées au rang de tropes majeurs du symbolisme, au moins depuis<br />
J. Frazer et son analyse de la magie sympathique (Frazer 1981 : 41-140) : similitude<br />
métaphorique de la magie homéopathique, contiguïté métonymique de la magie contagieuse.<br />
S’en est suivie une riche tradition à laquelle appartiennent des figures aussi prestigieuses que<br />
C. Lévi-Strauss ou V. Turner. L’analyse anthropologique du rite ou du mythe s’apparente<br />
alors la plupart du temps à un travail obstiné d’élucidation de métaphores insolites – ce dont<br />
témoignent bien les efforts déployés pour donner un sens à une formule aussi énigmatique que<br />
“les bororo sont des arara” 290 .<br />
Dans son travail sur le Bwiti fang, c’est encore la métaphore que J. Fernandez place au<br />
cœur du rituel (Fernandez 1977, 1982). Et ce sont toujours des métaphores et des métonymies<br />
que nous avons repérées à l’œuvre dans l’analogisme systématique du savoir initiatique. C’est<br />
pourtant l’ironie qui doit être placée au frontispice du Bwete à titre de trope principal. La<br />
chaîne infinie des métaphores et des métonymies s’insère en effet dans une relation initiatique<br />
ironique, qui constitue en quelque sorte sa vérité supérieure. Seule l’ironie permet de<br />
s’extraire de l’abstraction de l’analogisme et des correspondances symboliques pour pénétrer<br />
dans la logique concrète de leurs usages. Si la métaphore est un signifiant qui renvoie à un<br />
autre signifiant, l’ironie est un clin d’œil qui renvoie au contexte énonciatif : elle met en scène<br />
la relation de communication dans l’interaction 291 . L’ironie implique en effet une réflexivité<br />
relationnelle : chacun des acteurs doit se représenter la représentation que l’autre se fait de<br />
leur relation mutuelle. Au-delà de la singularité ethnographique du Bwete Misɔkɔ, ce<br />
déplacement de la métaphore vers l’ironie, du symbole vers la relation, entend contribuer à<br />
renouveler ou approfondir la théorie anthropologique du rituel 292 .<br />
Insister exclusivement sur la métaphore et la métonymie donne en effet une image<br />
abstraite et désincarnée du rituel, comme s’il s’agissait d’un système de signes flottant en<br />
apesanteur. Une telle approche nous fait perdre la spécificité de l’interaction rituelle. Elle<br />
mène alors tout droit aux problèmes insolubles de l’efficacité symbolique, écartelée par le<br />
hiatus qui sépare les signifiants des corps. Et elle fait finalement du rite une entreprise presque<br />
absurde dans laquelle il faudrait être crédule ou hypocrite pour vraiment s’engager. Échanger<br />
290<br />
La formule, rapportée par le baron Von den Steinen de son voyage en Amazonie brésilienne dans les années<br />
1890, aura excité la fibre herméneutique de nombre d’anthropologues depuis Durkheim, Mauss et Lévy-Bruhl<br />
(cf. récemment T. Turner 1991).<br />
291<br />
Des travaux en psychologie cognitive suggèrent que comprendre l’ironie exige des capacités inférentielles<br />
plus complexes que pour la métaphore, notamment des méta-représentations de second ordre : l’allocutaire doit<br />
envisager quelle interprétation le locuteur a sans doute jugé qu’il jugerait être la plus pertinente (Sperber 2000,<br />
notamment R.W. Gibbs Jr., “Metarepresentations in Staged Communicative Acts”, pp.389-410 et D. Wilson<br />
“Metarepresentation in Linguistic Communication”, pp.411-448).<br />
292<br />
Les travaux récents de J. Fernandez vont d’ailleurs dans cette même direction (Fernandez & Taylor Huber<br />
2001).<br />
-215-
la métaphore pour l’ironie permet alors de contourner ces écueils. L’ironie nous a en effet<br />
permis de sortir de la sémantique pour entrer dans la pragmatique. L’implication initiatique<br />
n’est pas d’abord une affaire de croyance et de symboles mais plutôt de contextes et de<br />
relations. Ce qui caractérise un rituel, c’est donc moins un univers symbolique qu’un style<br />
relationnel 293 .<br />
Dans le Bwete, ce style relationnel se caractérise par sa forme ironique. L’ironie<br />
circulaire (celle qui porte sur son propre contexte d’énonciation) est ainsi au fondement de<br />
l’efficacité pragmatique des configurations relationnelles du rituel. Mais cette propriété<br />
caractéristique du Bwete peut sans doute se retrouver dans de nombreux autres rituels,<br />
notamment dans le sous-ensemble des rites d’initiation. Les initiations de type rites de<br />
passage qui opèrent un changement de statut, tout comme celles de type rites d’affliction qui<br />
visent la guérison, reposent en effet sur la reconfiguration de l’espace relationnel dans lequel<br />
s’inscrit l’individu. Or, l’ironie, le paradoxe, l’ambivalence et même le mensonge constituent<br />
des moyens puissants pour instaurer un contexte singulier de communication et d’interaction<br />
(un contexte spécifiquement “rituel”) permettant de manipuler des relations. Les interactions<br />
de type ironique créent en effet une sorte de jeu complice, petit décalage qui permet par<br />
exemple – dans le cas des rites d’affliction – de sortir d’une situation d’impasse relationnelle<br />
en jouant ces relations à un autre niveau 294 . L’efficacité rituelle n’est donc pas symbolique<br />
mais relationnelle : elle tient moins à la croyance ou à la foi des acteurs qu’à des<br />
configurations relationnelles spécifiques (façons singulières de parler, d’agir et de manipuler<br />
des objets) fondées sur l’ironie, l’ambivalence et le paradoxe.<br />
Il faut bien voir que cette ironie rituelle n’est pas une forme de détachement. Elle se<br />
distingue ainsi de l’ironie mondaine ou intellectuelle, distance détachée au monde social<br />
réservée à ceux qui, socialement affranchis des urgences pratiques, peuvent se permettre<br />
d’aborder ce monde comme un jeu de rôles. Il ne s’agit donc pas d’imputer aux acteurs un<br />
“regard éloigné” qui est en réalité celui de l’anthropologue professionnellement formé à<br />
objectiver le monde social en le mettant à distance. Ce serait céder trop facilement à ce que<br />
P. Bourdieu appelle l’illusio scolastique (Bourdieu 1997). L’ironie du rituel engendre non la<br />
distanciation mais au contraire une forme tout à fait spécifique d’implication réciproque des<br />
acteurs dans leur activité, implication fondée sur une complicité paradoxale et ambiguë. Elle<br />
est ironie piégeante, ironie impliquée plutôt que détachée. Et c’est justement cette singulière<br />
implication ironique qui fait du rituel une parenthèse par rapport à la vie quotidienne, ou<br />
293<br />
Par “style”, j’entends une certaine redondance pragmatique : une même forme relationnelle se répétant dans<br />
plusieurs registres d’interactions.<br />
294<br />
Sur ironie et infortune, cf. Lambek 2003.<br />
-216-
plutôt une parenthèse au sein d’autres parenthèses. La mise entre parenthèses (ou entre<br />
guillemets) de l’ironie permet en effet de faire jouer les relations à un autre niveau, de les<br />
rejouer dans le miroir du Bwete.<br />
-217-
Épilogue : ce qu’il y a au fond d’un sac<br />
Deux scènes nous serviront d’épilogue. Toutes deux tournent autour du contenu<br />
mystérieux d’un sac. La première se passe au lendemain d’une double initiation, un homme et<br />
une femme. Les deux banzi, encore sous les effets de l’eboga, sont assis dans une petite case à<br />
proximité du corps de garde. A leurs côtés, épuisés de sommeil, le père initiateur, sa famille et<br />
les quelques initiés qui ne sont pas encore repartis chez eux. Le néophyte est maussade et<br />
silencieux, visiblement mal à l’aise et déçu par son initiation. Au cours de la nuit, il n’a pas pu<br />
révéler son kombo, nom initiatique pourtant nécessaire à la validation des rites de passage. A<br />
l’exact opposé, la novice est extrêmement agitée et loquace. Elle continue d’avoir des visions<br />
et fait des révélations oraculaires à la cantonade, annonçant à toutes les femmes la venue de<br />
maris blancs et de pirogues pleines de jumeaux. Elle rit, chante et est prise de crises de<br />
tremblements à la manière des initiées des sociétés féminines de possession. Atmosphère<br />
typique de fin de veillée.<br />
A un moment, la femme saisit le pεngε du père initiateur, le sac contenant ses<br />
maganga, et le tend au banzi. Elle veut que ce dernier l’ouvre et regarde à l’intérieur. Le père<br />
initiateur, déjà dans la torpeur de l’endormissement, laisse faire. Mais l’homme refuse avec<br />
véhémence. Comme pris de panique, il affirme que ce sac ne lui appartient pas, qu’il ne veut<br />
surtout pas savoir ce qu’il y a l’intérieur. La novice insiste, lui garantit que c’est une<br />
bénédiction qu’elle lui offre, que c’est son bwete qu’il doit lui-même chercher au fond du sac.<br />
Elle invente séance tenante une chanson, reprise en chœur par toute l’assistance, maintenant<br />
bien réveillée par l’incident : “ouvre le sac ! tu vas prendre !”. Dans la confusion de l’eboga,<br />
l’homme se braque, persuadé que tout le monde ici lui veut du mal. La novice, que l’eboga<br />
pousse également à l’obstination, ne comprend pas le désarroi du banzi et s’entête. Dans<br />
l’hilarité la plus complète, l’assemblée des initiés prend son parti, se moque du pauvre homme<br />
et l’exhorte à ouvrir le pεngε. Excédé, ce dernier empoigne brusquement le sac, l’ouvre et en<br />
répand violemment le contenu au sol. Le pεngε ne contenait évidemment rien d’autre qu’un<br />
fatras de boîtes à moitié vides et de morceaux d’écorces. La scène s’achève ici, la femme<br />
happée par une autre lubie et l’homme maugréant dans son coin. Quelques jours plus tard, à<br />
peine remis des effets de l’eboga, le banzi s’enfuira sans demander son reste. Son initiation<br />
aura été un échec.<br />
Loin d’être un simple incident anecdotique, cette scène tragi-comique révèle quelque<br />
chose d’essentiel à propos du Bwete et de la relation initiatique. Le banzi refuse le pεngε car,<br />
terrifié, il croit vraiment que le sac contient des choses dangereuses, le Bwete en personne<br />
-218-
qu’un simple banzi ne saurait regarder en face. Il est donc crédule, trop crédule car il prend les<br />
affirmations des initiés au premier degré. De son côté, la femme a tout de suite compris que<br />
l’implication initiatique reposait sur une relation ironique, jeu qui se focalise ici autour du sac<br />
et de son soi-disant contenu secret. Lorsqu’elle tend le pεngε à son jumeau d’initiation, c’est<br />
bien pour le faire entrer dans le jeu de la relation initiatique et le sortir de son mutisme<br />
obstiné. Il aurait alors suffi que le banzi accepte le pεngε pour être enrôlé dans le Bwete. Qu’il<br />
reçoive le sac comme on reçoit une bénédiction. Qu’il scrute au fond du sac la vacuité du<br />
Bwete. Peut-être même y aurait-il trouvé son propre kombo qui aurait enfin fait de lui un<br />
véritable initié.<br />
Mais l’homme est décidément trop sérieux, trop crédule et ne voit pas les clins d’œil<br />
complices des autres initiés. Refusant le sac, il refuse le jeu qui fonde la relation initiatique.<br />
Fort logiquement, l’assemblée des initiés se met du côté de la mabundi pour rire du banzi et<br />
humilier sa naïveté. Incapable de se laisser prendre au jeu du Bwete, il est accablé des<br />
moqueries les plus sarcastiques – il devient lui-même la cible de l’ironie. Impitoyable<br />
sanction qui l’exclut encore un peu plus de cette communauté initiatique à laquelle il<br />
souhaiterait appartenir mais dont il ne comprend pas les règles du jeu. Conséquence de cet<br />
échec cuisant, il ne lui reste effectivement plus qu’à fuir quelques jours après. La scène<br />
confirme donc que le véritable initié est celui qui, ne prenant plus les énoncés initiatiques au<br />
premier degré, est capable de s’impliquer dans une relation ironique, faite de coopérations<br />
rituelles ambiguës. Être un bon initié dans le Bwete, ce n’est pas croire naïvement à la toute-<br />
puissance des sacs fétiches. Mais ce n’est pas non plus n’y pas croire un seul instant. C’est<br />
plutôt accepter de suspendre son jugement pour se laisser un jour prendre dans le jeu singulier<br />
d’une relation avec d’autres initiés, et ne plus jamais en sortir.<br />
Autre scène, autre veillée. Nous sommes cette fois-ci au début d’un mayaya, une<br />
cérémonie de réjouissance. Deux pères initiateurs s’y rencontrent pour la première fois, assis<br />
côte à côte au fond du corps de garde. Alors que le premier est venu avec sa corbeille de<br />
Bwete, tous ses fétiches et son attirail rituel, le second n’a pour tout bagage qu’un petit pεngε<br />
porté à l’épaule. L’autre, curieux, lui demande avec insistance ce qu’il y a au fond de son sac.<br />
Quels profonds secrets, quels fétiches puissants s’y cachent précieusement ? Le nyima sourit<br />
et réserve sa réponse au lendemain. Tenant parole, il déballe au matin dans le secret du<br />
bwεnzε le contenu de son pεngε : une vieille pipe ébréchée et quelques têtes de tabac. Les<br />
deux nyima s’esclaffent de concert, puis se séparent en promettant de se revoir bientôt. Et<br />
derrière cet éclat de rire complice – celui que n’avait pas su comprendre le pauvre banzi de la<br />
-219-
scène précédente et qui s’était alors transformé à ses oreilles en moqueries humiliantes –, il<br />
fallait entendre résonner les échos assourdis du rire du Bwete, tapi là-bas, tout au fond de son<br />
sac…<br />
Sac rituel penge<br />
-220-
Bibliographie<br />
Adler, A., Zempléni A.<br />
1972 Le bâton de l’aveugle : divination, maladie et pouvoir chez les Moundang du Tchad, Paris,<br />
Hermann.<br />
Andersson, E.<br />
1953 Contribution à l’ethnographie des Kuta, Uppsala, Studia ethnographica Upsaliensia VI.<br />
Augé, M.<br />
1986 Le Dieu objet, Paris, Flammarion.<br />
Augé, M., Herzlich, C. (éds.)<br />
1984 Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie, Paris, Éditions des archives<br />
contemporaines.<br />
Austin, J.L.<br />
1970 Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil.<br />
Balandier, G.<br />
1963 Sociologie actuelle de l’Afrique noire, Paris, PUF.<br />
Barth, F.<br />
1975 Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea, New Haven, Yale University<br />
Press.<br />
1987 Cosmologies in the making. A generative approach to cultural variation in inner New Guinea,<br />
Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Bateson, G.<br />
1971 [1936] La cérémonie du Naven, Paris, Minuit.<br />
1977 Vers une écologie de l’esprit (t.1), Paris, Seuil.<br />
Berrendonner, A.<br />
1982 Eléments de pragmatique linguistique, Paris, Minuit.<br />
Berthoz, A.<br />
1997 Le sens du mouvement, Paris, Odile Jacob.<br />
Bidou, P., Galinier, J., Juillerat, B. (dir.)<br />
1999 Anthropologie psychanalytique, L’Homme, n°149.<br />
Bloch, M.<br />
1974 "Symbols, song, dance and features of articulation. Is religious an extreme form of traditional<br />
authority ?" European Journal of Sociology, vol.XV, n°1, pp.55-81.<br />
Bongoatsi-Eckata, W.<br />
2001 Ebwémà: "il est allé tuer". Le phénomène cynégétique et sa dynamique dans la société hòngwe<br />
(Gabon), mémoire de maîtrise en anthropologie, Université Omar Bongo, Libreville.<br />
Booth, W.<br />
1974 A rhetoric of irony, Chicago, University of Chicago Press.<br />
Bourdieu, P.<br />
1982 Ce que parler veut dire, Paris, Fayard.<br />
1997 Méditations pascaliennes, Paris, Seuil.<br />
Boyer, P.<br />
1980 "Les figures du savoir initiatique", Journal des Africanistes, n°50, pp.31-57.<br />
1986 "The empty concepts of traditional thinking: a semantic and pragmatic description", Man,<br />
vol.21, n°1, pp.50-64.<br />
1988 Barricades mystérieuses et pièges à pensée. Introduction à l’analyse des épopées fang, Paris,<br />
Société d’ethnologie.<br />
1990 Tradition as truth and communication, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
2003 Et l’homme créa les dieux, Paris, Gallimard.<br />
Boyer, P. (éd.)<br />
1993 Cognitive aspects of religious symbolism, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Brown, P.<br />
1984 Le culte des saints, Paris, Cerf.<br />
-221-
Bureau, R.<br />
1996 Bokayé! Essai sur le Bwiti fang du Gabon, Paris, L’Harmattan.<br />
du Chaillu, P.<br />
1868 L’Afrique sauvage. Nouvelles excursions au pays des Ashangos, Paris, Michel Lévy frères.<br />
1996 [1867] Voyages et aventures en Afrique équatoriale, Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
Cinnamon, J.M.<br />
2002 “Ambivalent Power: Anti-Sorcery and Occult Subjugation in Late Colonial Gabon”, Journal of<br />
Colonialism and Colonial History, 3(3).<br />
Clist, B.<br />
1995 Gabon, 100 000 ans d’histoire, Libreville/Paris, CCF Saint-Exupéry/Sépia.<br />
Collomb, G.<br />
1981 "Quelques aspects techniques de la forge dans le bassin de l’Ogooué", Anthropos, n°76, pp.50-<br />
66.<br />
Comaroff, J., Comaroff, J.L.<br />
1999 “Occult economies and the violence of abstraction: notes from the South African postcolony”,<br />
American Ethnologist, 26(2), pp.279-303.<br />
Comaroff, J., Comaroff, J.L. (éds.)<br />
1993 Modernity and its malcontents : ritual and power in postcolonial Africa, Chicago, University<br />
of Chicago Press.<br />
Csordas, T.J. (éd.)<br />
1994 Embodiment and experience. The existential ground of culture and self, Cambridge, Cambridge<br />
University Press.<br />
Delatte, A.<br />
1932 La catoptromancie grecque et ses dérivés, Paris, Droz.<br />
Descola, P.<br />
1993 Les Lances du crépuscule, Paris, Plon.<br />
Détienne, M.<br />
1967 Les maîtres de vérité en Grèce archaïque, Paris, François Maspéro.<br />
Devisch, R.<br />
1991 “Mediumistic divination among the northern yaka of Zaire” in P.M. Peek (éd.), African<br />
divination systems, Bloomington, Indiana University Press.<br />
Dobkin de Rios, M.<br />
1984 Hallucinogens: cross-cultural perspectives, Albuquerque, University of Mexico Press.<br />
Douglas, M. (éd.)<br />
1970 Witchcraft confessions and accusations, London, Tavistock Publications.<br />
Du Bois, J.W.<br />
1986 "Self-evidence and ritual speech" in W. Chafe & J. Nichols (éds.), Evidentiality : the linguistic<br />
coding of epistemology, Norwood N.J., Ablex Publishing Corporation, pp.313-336.<br />
Ducrot, O.<br />
1984 Le dire et le dit, Paris, Minuit.<br />
1991 Dire et ne pas dire, Paris, Hermann.<br />
Dupriez, B.<br />
1991 Gradus. Les procédés littéraires, Paris, UGE.<br />
Dupuis, A.<br />
1983 “Être ou ne pas être: Quelques sociétés de femme au Gabon”, Objets et Mondes, 23(1-2),<br />
pp.79-90.<br />
Duranti, A., Goodwin, C. (éds.)<br />
1992 Rethinking context. Language as an interactive phenomenon, Cambridge, Cambridge<br />
University Press.<br />
Durkheim, É.<br />
1968 Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF.<br />
Evans-Pritchard, E.E.<br />
1972 [1937] Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, Paris, Gallimard.<br />
Falgayrettes, C. (éd.)<br />
-222-
1986 The way of the ancestors, Paris, Éditions Dapper.<br />
Favret-Saada, J.<br />
1977 Les mots, la mort, les sorts, Paris, Gallimard.<br />
1990 "Être affecté", Gradhiva, n°8, pp.3-9.<br />
Favret-Saada, J., Contreras, J.<br />
1981 Corps pour corps. Enquête sur la sorcellerie dans le bocage, Paris, Gallimard.<br />
1985 "L’embrayeur de violence. Quelques mécanismes thérapeutiques du désorcèlement" in<br />
M. Mannoni (éd.), Le Moi et l’Autre, Paris, Denoël, pp.95-125.<br />
Fernandez, J.W.<br />
1977 "The performance of ritual metaphors" in J.D. Sapir & J.C. Crocker (éds.), The social use of<br />
metaphor. Essays on the anthropology of rhetoric, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp.100-131.<br />
1982 Bwiti. An ethnography of the religious imagination in Africa, Princeton, Princeton University<br />
Press.<br />
Fernandez, J.W. (éd.)<br />
1991 Beyond Metaphor: the theory of tropes in anthropology, Stanford, Stanford University Press.<br />
Fernandez, J.W., Taylor Huber, M. (éds.)<br />
2001 Irony in action : anthropology, practice, and the moral imagination, Chicago, University of<br />
Chicago Press.<br />
Frazer, J.<br />
1981 [1911] Le Rameau d’or (t.1). Le Roi magicien dans la société primitive, Paris, Robert Laffont.<br />
Freud, S.<br />
1981 [1923] “Le moi et le ça” in Essais de psychanalyse, Paris, Payot.<br />
1995a [1927] L’avenir d’une illusion, Paris, PUF.<br />
1995b [1930] Le malaise dans la culture, Paris, PUF.<br />
Furst, P.T. (éd.)<br />
1974 La chair des dieux: l’usage rituel des psychédéliques, Paris, Seuil.<br />
Galinier, J.<br />
1997 La moitié du monde. Le corps et le cosmos dans le rituel des Indiens otomi, Paris, PUF.<br />
Gell, A.<br />
1998 Art and Agency. An anthropological theory, Oxford, Oxford University Press.<br />
1999a “Strathernograms, or the semiotics of mixed metaphors”, in The art of anthropology. Essays<br />
and diagrams, London, The Athlone Press, pp.29-75.<br />
1999b “Vogel’s net. Traps as artworks and artworks as traps”, in The art of anthropology. Essays and<br />
diagrams, London, The Athlone Press, pp.187-214.<br />
Genette, G.<br />
1972 Figures III, Paris, Seuil.<br />
Geschiere, P.<br />
1995 Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres, Paris, Karthala.<br />
Goffman, E.<br />
1991 Les cadres de l’expérience, Paris, Minuit.<br />
Gollnhofer, O.<br />
1973 Les rites de passage de la société initiatique du Bwete chez les Mitsogho. La manducation de<br />
l’iboga, thèse de doctorat en Sciences humaines, Sorbonne, Paris.<br />
Gollnhofer, O., Sillans, R.<br />
1973 "Aspects du phénomène de consensus dans la psychothérapie ghetsogho" in G. Dieterlen, La<br />
notion de personne en Afrique noire, Paris, CNRS, pp.545-563.<br />
1974 "Phénoménologie de la possession chez les Mitsogho", Psychopathologie africaine, vol.X, n°2,<br />
pp.187-209.<br />
1976 "Aspects phénoménologiques et initiatiques de l’état de déstructuration temporaire de la<br />
conscience habituelle chez les Mitsogho du Gabon", Psychopathologie africaine, vol.XII, n°1, pp.45-75.<br />
1978 "Tsâmbo, texte rituel de guérison chez les Mitsogho", l’Ethnographie, n°1, pp.45-53.<br />
1979 "Phénoménologie de la possession chez les Mitsogho (Gabon). Rites et techniques",<br />
Anthropos, vol.74, n°5-6, pp.737-752.<br />
1981 "Le mythe de la découverte du génie de l’eau chez les Mitsogho", l’Ethnographie,<br />
vol.LXXVII, n°84, pp.37-46.<br />
1997 La mémoire d’un peuple. Ethno-histoire des Mitsogho, ethnie du Gabon central, Paris,<br />
-223-
Présence Africaine.<br />
Gollnhofer, O., Sillans, R., Sallée, P.<br />
1975 Art et artisanat tsogho, Paris, ORSTOM.<br />
Goutarel, R., Gollnhofer, O., Sillans, R.<br />
1992 Pharmacodynamique et applications thérapeutiques de l’iboga et de l’ibogaïne, Gif-sur-<br />
Yvette, CNRS.<br />
Griaule, M.<br />
1948 Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Paris, Les éditions du Chêne.<br />
Héritier, F.<br />
1996 Masculin / Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob.<br />
Horton, R.<br />
1993 Patterns of thought in Africa and the West, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Houseman, M.<br />
1984 "Les artifices de la logique initiatique", Journal des Africanistes, vol.54, n°1, pp.41-65.<br />
1999 "Quelques configurations relationnelles de la douleur" in F. Héritier (éd.), De la violence II,<br />
Paris, Odile Jacob, pp.77-112.<br />
2002 "Dissimulation and simulation as forms of religious reflexivity", Social Anthropology, vol.10,<br />
n°1-2, pp.77-89.<br />
Houseman, M., Severi, C.<br />
1994 Naven ou le donner à voir. Essai d’interprétation de l’action rituelle, Paris, CNRS Éditions.<br />
Humphrey, C., Laidlaw, J.<br />
1994 The archetypal actions of ritual. A theory of ritual illustrated by the Jain rite of worship,<br />
Oxford, Clarendon Press.<br />
Idiata, D.F.<br />
2002 Il était une fois les langues gabonaises, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
Jamin, J.<br />
1977 Les lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret, Paris, F. Maspéro.<br />
Jaulin, R.<br />
1967 La mort sara, Paris, Plon.<br />
Kerbrat-Orecchioni, C., Le Guern, M., Bange, P., Bony, A.<br />
1976 L’ironie, Linguistique et sémiologie n°2, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.<br />
Kordt Højbjerg, C. (dir.)<br />
2002 Religious reflexivity. Essays on attitudes to religious ideas and practice, Social Anthropology<br />
vol.10, n°1-2.<br />
Kwenzi Mikala, J.T.<br />
1997 Mumbwanga, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
Laboratoire Universitaire de la Tradition Orale<br />
2000 Le Bwiti du Gabon. Séminaire interdisciplinaire du 8 au 13 mai 2000, Université Omar Bongo,<br />
Libreville.<br />
Laburthe-Tolra, P.<br />
1985 Initiations et sociétés secrètes au Cameroun. Essai sur la religion bëti, Paris, Karthala.<br />
Lambek, M. (dir.)<br />
2003 Illness and irony: on the ambiguity of suffering in culture, Social Analysis, vol.47, n°2.<br />
Latour, B.<br />
1996 Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Le Plessis-Robinson, Synthélabo.<br />
Leenhardt, M.<br />
1971 [1947] Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Paris, Gallimard.<br />
Lévi-Strauss, C.<br />
1950 “Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss” in M. Mauss, Sociologie et anthropologie, Paris,<br />
PUF, pp.XLIV-L.<br />
1958a “Le sorcier et sa magie”, in Anthropologie structurale, Paris, Plon.<br />
1958b “L’efficacité symbolique”, in Anthropologie structurale, Paris, Plon.<br />
1971 Mythologiques. Vol. 4. L’Homme nu, Paris, Plon.<br />
Mabaza, G.<br />
-224-
1999 L’identité culturelle du groupe Hongwe, mémoire de maîtrise en anthropologie, Université<br />
Omar Bongo, Libreville.<br />
Malinowski, B.<br />
1974 [1935] Les jardins de corail, Paris, F. Maspero.<br />
Mallart Guimera, L.<br />
1981 Ni dos ni ventre. Religion, magie et sorcellerie Evuzok, Paris, Société d’ethnographie.<br />
Mannoni, O.<br />
1969 "Je sais bien mais quand même" in Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre scène, Paris, Seuil, pp.9-<br />
33.<br />
de Maret, P.<br />
1980 "Ceux qui jouent avec le feu: la place du forgeron en Afrique centrale", Africa, vol.50, n°3,<br />
pp.263-79.<br />
Marie, A.<br />
1997 L’Afrique des individus. Itinéraires citadins dans l'Afrique contemporaine ( Abidjan, Bamako,<br />
Dakar, Niamey), Paris, Karthala.<br />
Mary, A.<br />
1983a "L’alternative de la vision et de la possession dans les sociétés religieuses et thérapeutiques du<br />
Gabon", Cahiers d’études africaines, n°91, pp.281-310.<br />
1983b La naissance à l’envers, Paris, l’Harmattan.<br />
1999 Le défi du syncrétisme. Le travail symbolique de la religion d’eboga (Gabon), Paris, EHESS.<br />
Mary, A., Laurent, P.J.<br />
2001 Prophètes, visionnaires, et guérisseurs de l’Afrique subsaharienne contemporaine, Social<br />
Compass, vol.48, n°3.<br />
Mauss, M., Lévi-Strauss, C.<br />
1997 Sociologie et anthropologie, Paris, PUF.<br />
Mayer, R.<br />
1992 Histoire de la famille gabonaise, Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
Mba Bitome, J.<br />
1986 Influence de la religion iboga sur la médecine traditionnelle et les soins de santé au Gabon,<br />
thèse de doctorat en anthropologie, Université Lyon II, Lyon.<br />
Mbot, J.-É.<br />
1975 Ebughi bifia. "Démonter les expressions". Énonciation et situations sociales chez les Fang du<br />
Gabon, Paris, Institut d'ethnologie.<br />
Merlet, A.<br />
1990a Le pays des trois estuaires (1471-1900). Quatre siècles de relations extérieures dans les<br />
estuaires du Muni, de la Mondah et du Gabon, Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
1990b Légendes et histoire des Myene de l’Ogooué, Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
1990c Vers les plateaux de Masuku (1866-1890). Histoire des peuples du bassin de l’Ogooué, de<br />
Lambaréné au Congo, au temps de Brazza et des factoreries, Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
1991 Autour du Loango (XIV-XIX e siècle). Histoire des peuples du sud-ouest du Gabon au temps du<br />
royaume de Loango et du "Congo français", Libreville/Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
Metcalf, P.<br />
2002 They lie, we lie. Getting on with anthropology, London, Routledge.<br />
Michaux, H.<br />
1990 Misérable miracle, Paris, Gallimard.<br />
Mickala Manfoumbi, R.<br />
2004 Lexique Pové-Français Français-Pové, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
Ministère des Droits de l’Homme (République Gabonaise)<br />
2004 Le livre blanc des droits humains au Gabon, Libreville,<br />
Nietzsche, F.<br />
1971 [1887] La généalogie de la morale, Paris, Gallimard.<br />
Nzamba-Nzamba, T.P.<br />
2001 Bungang: pratiques de santé chez les Bapunu du Gabon. Pistes pour une recherche, mémoire<br />
de maîtrise en anthropologie, Université Omar Bongo, Libreville.<br />
Peek, P.M.<br />
-225-
1991 African divination systems, Bloomington, Indiana University Press.<br />
Perrin, L.<br />
1996 L’ironie mise en trope, Paris, Kimé.<br />
Perrois, L.<br />
1969 Le Bwete des Kota Mahongwe du Gabon. Note sur les figures funéraires des populations du<br />
bassin de l’Ivindo, Libreville, ORSTOM.<br />
Pinçon, B., Dupré, M.-C.<br />
1997 Métallurgie et politique en Afrique centrale, Paris, Karthala.<br />
Pouillon, J.<br />
1946 Temps et roman, Paris, Gallimard.<br />
Raponda-Walker, A.<br />
1967 Contes gabonais, Paris, Présence Africaine.<br />
1993 3000 proverbes du Gabon, Versailles, Classiques africains.<br />
1996 [1937] Éléments de grammaire ghetsöghö, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
1998a [1910] Au pays des tsogo, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
1998b [1937] Les langues du Gabon, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
2002 [1960] Notes d’histoire du Gabon, Libreville, Éditions Raponda-Walker.<br />
s.d. Dictionnaire Ghetsögö-Français Français- Ghetsögö, manuscrit non publié.<br />
Raponda-Walker, A., Sillans, R.<br />
1962 Rites et croyances des peuples du Gabon, Paris, Présence Africaine.<br />
1996 [1961] Les plantes utiles du Gabon, Libreville-Paris, CCF St-Exupéry/Sépia.<br />
Revue Gabonaise des Sciences de l’Homme (revue).<br />
1990 Actes du séminaire des experts "Alphabet scientifique des langues du Gabon" du 20 au 24<br />
février 1989, Libreville, Publications de l’Université Omar Bongo, n°2.<br />
Rosny (de), E.<br />
1981 Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun), Paris,<br />
Plon.<br />
Sallée, P.<br />
1985 L’arc et la harpe. Contribution à l’histoire de la musique du Gabon, thèse de doctorat, Paris X-<br />
Nanterre, Paris.<br />
Searle, J.R.<br />
1972 Les actes de langage, Paris, Hermann.<br />
Severi, C.<br />
1993 "Talking about souls: the pragmatic construction of meaning in Cuna ritual language" in<br />
P. Boyer (éd.), Cognitive aspects of religious symbolism, Cambridge, Cambridge University Press, pp.165-181.<br />
2002 "Memory, reflexivity and belief. Reflections on the ritual use of language", Social<br />
Anthropology, vol.10, n°1-2, pp.23-40.<br />
Sillans, R.<br />
1967 Motombi: récits et énigmes initiatiques des Mitsogho du Gabon central, thèse de doctorat,<br />
Paris Sorbonne, Paris.<br />
Simmel, G.<br />
1996 [1908] Secret et sociétés secrètes, Paris, Circé.<br />
Sindzingre, N.<br />
1990 Article “Rituel” in Encyclopædia Universalis, vol. 20, pp.68-71.<br />
Smith, P.<br />
1979 “Aspects de l’organisation des rites” in M. Izard & P. Smith (éds.), La fonction symbolique,<br />
Paris, Gallimard, pp.139-170.<br />
1984 “Le "mystère" et ses masques chez les Bedik”, L’Homme, vol.24, n°3-4, pp.5-33.<br />
1991 Article “Rite” in P. Bonte & M. Izard (éds.), Dictionnaire de l’ethnologie et de<br />
l’anthropologie, Paris, PUF.<br />
Sperber, D.<br />
1974 Le symbolisme en général, Paris, Hermann.<br />
1982 Le savoir des anthropologues, Paris, Hermann.<br />
Sperber, D. (éd.)<br />
2000 Metarepresentations. A multidisciplinary perspective, Oxford, Oxford University Press.<br />
-226-
Sperber, D., Wilson, D.<br />
1989 La pertinence, Paris, Minuit.<br />
Stewart P.J., Strathern, A.<br />
2004 Witchcraft, sorcery, rumors, and gossip, Cambridge, Cambridge University Press.<br />
Strathern, M.<br />
1988 The Gender of the Gift, Berkeley, University of California Press.<br />
Swiderski, S.<br />
1965 "Le Bwiti, société d’initiation chez les Apindji du Gabon", Anthropos, vol.60, pp.541-576.<br />
1972 "L’Ombwiri, société d’initiation et de guérison au Gabon", Studi e materiali di storia delle<br />
religioni, Bari, Dedalo libri, vol.1, pp.125-205.<br />
1981 "Les visions d’iboga", Anthropos, vol.76, pp.393-429.<br />
1990 La religion Bouiti. Volume 1. Histoire, Toronto, Legas.<br />
Tambiah, S.J.<br />
1968 "The Magical Power of Words", Man, vol.3, n°2, pp.175-208.<br />
Taussig, M.<br />
2003 "Viscerality, Faith, and Skepticism: Another Theory of Magic" in B. Meyer & P. Pels (éds.),<br />
Magic and modernity: Interfaces of revelation and concealment, Stanford, Stanford University Press, pp.272-<br />
306.<br />
Taylor, A.-C.<br />
1993 "Des fantômes stupéfiants. Langage et croyance dans la pensée achuar", L’Homme, n°126-128,<br />
pp.429-447.<br />
Tessmann, G.<br />
1991 [1913] Die Pangwe, republication partielle in P. Laburthe-Tolra (éd.), Fang, Paris, Éditions<br />
Dapper.<br />
Testart, A.<br />
1993 "Des rhombes et des tjurunga. La question des objets sacrés en Australie", L’Homme,<br />
vol.XXXIII, n°125, pp.31-65.<br />
Tonda, J.<br />
2002 La guérison divine en Afrique centrale (Congo, Gabon), Paris, Karthala.<br />
Turner, T.<br />
1991 “‘We are parrots’, ‘Twins are birds’ : Play of tropes as operational structure” in J. Fernandez<br />
(éd.), Beyond metaphor. The theory of tropes in anthropology, Stanford, Stanford University Press, pp.121-158.<br />
Turner, V.W.<br />
1967 The forest of symbols, Ithaca, Cornell University Press.<br />
1972 Les tambours d’affliction, Paris, Gallimard.<br />
1974 “Social Dramas and Ritual Metaphors” in Dramas, fields, and metaphors: symbolic action in<br />
human society, Ithaca, Cornell University Press, pp.23-59.<br />
1990 [1969] Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris, PUF.<br />
Van Gennep, A.<br />
1969 [1909] Les rites de passage, Paris, Mouton.<br />
Vansina, J.<br />
1990 Paths in the rainforests: toward a history of political tradition in equatorial Africa, Madison,<br />
University of Wisconsin Press.<br />
Veyne, P.<br />
1983 Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris, Seuil.<br />
West, H.G., Sanders, T. (éds.)<br />
2003 Transparency and conspiracy. Ethnographies of suspicion in the new world order, Durham,<br />
Duke University Press.<br />
White, L.<br />
1997 “The Traffic in Heads: Bodies, Borders and the Articulation of Regional Histories”, Journal of<br />
Southern African Studies, 23(2), pp.325-338.<br />
Winnicott, D.W.<br />
1975 Jeu et réalité. L’espace potentiel, Paris, Gallimard.<br />
Zempléni, A.<br />
1976 "La chaîne du secret", Nouvelle Revue de Psychanalyse, n° sur “le Secret”, pp.313-324.<br />
-227-
1985 "La maladie et ses causes", L’Ethnographie, Paris, vol.LXXXI, n°96-97, n° sur “Causes,<br />
origines et agents de la maladie chez les peuples sans écriture”, pp.13-44.<br />
1991 Article “Initiation” in P. Bonte & M. Izard (éds.), Dictionnaire de l’ethnologie et de<br />
l’anthropologie, Paris, PUF.<br />
-228-
Table des matières<br />
Remerciements ................................................................................................................................... 3<br />
Note sur l’orthographe ...................................................................................................................... 4<br />
Cartes du Gabon ................................................................................................................................ 5<br />
Introduction ........................................................................................................................................ 7<br />
PREMIERE PARTIE : BANZI<br />
I. Le <strong>Miroir</strong> : vision et initiation ..................................................................................................... 20<br />
1. Le chemin de l’infortune : la consultation du devin ................................................................................. 20<br />
2. Rituels préliminaires ................................................................................................................................. 25<br />
3. Visions initiatiques ................................................................................................................................... 29<br />
4. Visions et pouvoir de guérison ................................................................................................................. 39<br />
5. “Base !” ou la vérité visionnaire ............................................................................................................... 41<br />
6. Un sujet initiatique complexe ................................................................................................................... 43<br />
II. Une nuit de Bwete : l’organisation rituelle ............................................................................... 46<br />
III. Edika et son double .................................................................................................................... 62<br />
1. Edika ......................................................................................................................................................... 62<br />
2. Tsombi ...................................................................................................................................................... 67<br />
3. Interdits initiatiques .................................................................................................................................. 69<br />
IV. Motoba ou la parole du Bwete ................................................................................................... 71<br />
1. Le génie-silure motoba ............................................................................................................................. 71<br />
2. La parole de motoba ................................................................................................................................. 72<br />
3. Les maganga : entre fétiches et médicaments .......................................................................................... 76<br />
DEUXIEME PARTIE : NGANGA<br />
V. Le nganga devin-guérisseur ........................................................................................................ 79<br />
1. La séance divinatoire ................................................................................................................................ 79<br />
2. L’énonciation divinatoire ......................................................................................................................... 83<br />
3. Maux et soins ............................................................................................................................................ 86<br />
4. Schèmes opératoires et efficacité thérapeutique ....................................................................................... 92<br />
VI. Les secrets du bwεnzε : savoir et enseignement initiatiques ................................................. 97<br />
1. Gestes et paroles des ancêtres : le formalisme rituel ................................................................................ 97<br />
2. Le bwεnzε : l’enseignement initiatique ................................................................................................... 102<br />
3. Le bricolage du savoir initiatique ........................................................................................................... 106<br />
4. “Le Bwete ne finit jamais” ...................................................................................................................... 110<br />
VII. “Le premier qui…” : la forme des énoncés initiatiques ....................................................... 115<br />
-229-
1. Go ebando : les mythes d’origine ........................................................................................................... 115<br />
2. Énigmes et analogies .............................................................................................................................. 120<br />
TROISIEME PARTIE : NYIMA<br />
VIII. La scène des ancêtres : lignage et relations initiatiques .................................................... 127<br />
1. Le cycle de la vie et de la mort ............................................................................................................... 127<br />
2. L’englobement des ancêtres ................................................................................................................... 133<br />
IX. Le vampire du Bwete : sorcellerie et ambivalence ................................................................ 139<br />
1. Sorcellerie ............................................................................................................................................... 139<br />
2. Vampire .................................................................................................................................................. 141<br />
3. Sacrifice .................................................................................................................................................. 146<br />
X. Mwiri : l’assermentation de la parole ...................................................................................... 149<br />
1. L’initiation au Mwiri .............................................................................................................................. 149<br />
2. Jumeaux, femmes, fécondité .................................................................................................................. 152<br />
3. Ordalies : enclume et poison .................................................................................................................. 155<br />
4. Jurement, secret, serment ........................................................................................................................ 157<br />
XI. Le sexe du Bwete : l’appropriation rituelle du pouvoir féminin ......................................... 164<br />
1. “Le Bwete, c’est la femme” .................................................................................................................... 164<br />
2. Les femmes, profanes du Disumba ......................................................................................................... 168<br />
3. Les femmes, initiées du Misɔkɔ .............................................................................................................. 171<br />
XII. Le Crâne : la traversée du Bwete .......................................................................................... 178<br />
1. “Le Bwete, c’est le crâne” ....................................................................................................................... 178<br />
2. Voir et savoir : l’ostension du Bwete ...................................................................................................... 183<br />
3. Mort et paradoxe ..................................................................................................................................... 186<br />
4. Nyima : le travail d’un père initiateur ..................................................................................................... 189<br />
Conclusion : L’ironie du Bwete ..................................................................................................... 193<br />
1. Objets, médiations, relations .................................................................................................................. 193<br />
2. Voix et intentionnalité ............................................................................................................................ 198<br />
3. De l’art de mentir .................................................................................................................................... 201<br />
4. La topique du cœur ................................................................................................................................. 204<br />
5. La relation ironique ................................................................................................................................ 208<br />
Épilogue : ce qu’il y a au fond d’un sac ..................................................................................................... 218<br />
Bibliographie .................................................................................................................................. 221<br />
Table des matières .......................................................................................................................... 229<br />
-230-