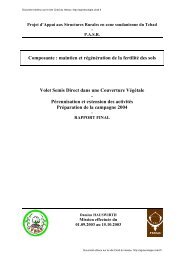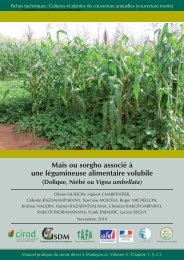Rapport FFEM Cameroun 2003 - Cirad
Rapport FFEM Cameroun 2003 - Cirad
Rapport FFEM Cameroun 2003 - Cirad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Document obtenu sur le site <strong>Cirad</strong> du réseau http://agroecologie.cirad.fr<br />
2.4. Conclusions<br />
L’ensemble des résultats est assez peu homogène, mais on peut dégager quelques<br />
résultats :<br />
1°) en première année, les rendements obtenus ne sont pas systématiquement en<br />
faveur des scv<br />
2°) en seconde année, les rendements en scv sont quasi-généralement supérieurs à<br />
ceux obtenus sur labour.<br />
3°) les rendements plus faibles en scv en première année sont fréquents quand on<br />
apporte de la paille de l’extérieur, quand on n’applique pas l’apport supplémentaire de N à la<br />
levée et plutôt dans la Province du Nord (bonne pluviométrie) que dans celle de l’Extrême-<br />
Nord.<br />
Les préconisations faites pour la conduite des cotonniers en Scv (passage du coutrier en<br />
sec, apport complémentaire de N à la levée, et labour en première année) sont nécessaires.<br />
Pour autant, elles ne permettent pas d’obtenir de façon systématique des rendements<br />
équivalents au labour. Il est important de trouver un précédent cultural apte à permettre une<br />
première année de scv plus performante.<br />
3. La biomasse produite<br />
3.1. Objectifs<br />
L’un des objectifs des scv est de produire de la biomasse pour constituer une couverture du<br />
sol qui devrait en principe être permanente et permettre un semis direct. A la vue de l’état de<br />
la biomasse résiduelle des champs traditionnels en saison sèche, cela apparaît être une<br />
gageure. En fait il faut à la fois techniquement produire davantage de biomasse que sur les<br />
champs traditionnels et mettre en place des systèmes de gestion (feux de brousse, contrôle<br />
du patûrage) permettant de laisser un minimum de paille sur le sol. L’objectif technique est<br />
d’obtenir avec une association de culture céréale/plante de couverture, une biomasse plus<br />
importante que celles obtenues avec le sorgho ou le maïs purs.<br />
3.2. Matériels et méthodes<br />
Deux essais permettent de sélectionner une association de culture permettant une<br />
production de biomasse optimale : la collection de plante à usages multiples (PLUM) et des<br />
essais comparant diverses associations de culture.<br />
La collection de PLUM permet de mesurer la quantité de biomasse produite par différentes<br />
espèces de PLUM en culture pure et d’effectuer certaines observations sur la qualité de<br />
cette biomasse (type de biomasse, vitesse de minéralisation) et sur quelques paramètres<br />
physiologiques des PLUM (cycle, caractère volubile, nodulation, type d’enracinement)<br />
permettant de prévoir leur comportement en association . Cet essai permet de sélectionner<br />
des PLUM aptes à être testées en association, ces associations pouvant être ensuite testées<br />
quant à la biomasse produite, l’absence de concurrence entre la céréale et la PLUM, leur<br />
qualité en tant que précédent cultural.<br />
3.2.1. Collections de plantes à usages multiples<br />
La collection de PLUM est divisée en deux essais : la collection A comparant 11 espèces<br />
susceptibles de se comporter correctement sur l’ensemble de la zone et mise en place sur 5<br />
sites : Poli, Fignolé, Sanguéré, Makébi et Guiring (voir carte de localisation en annexe) et la<br />
collection B regroupant 5 espèces plutôt adaptées aux zones sèches et mise en place à<br />
Sanguéré, Makébi et Kodek (tableau 1).<br />
11<br />
Document obtenu sur le site <strong>Cirad</strong> du réseau http://agroecologie.cirad.fr