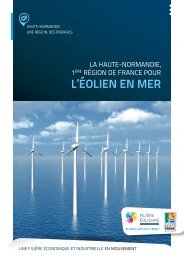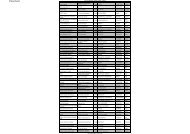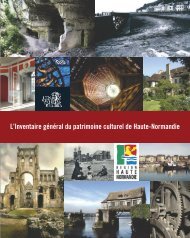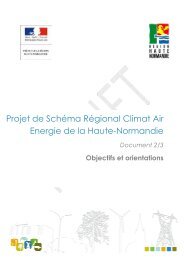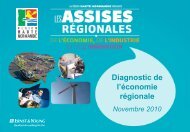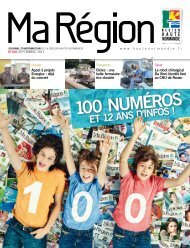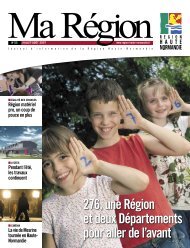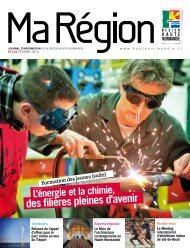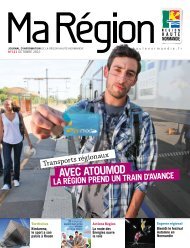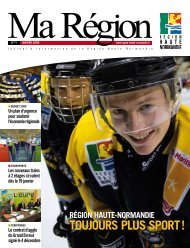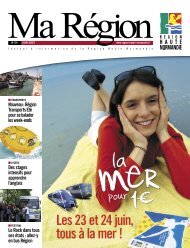Quel destin pour la Haute-Normandie en 2025 ?
quel destin pour la haute normandie en 2025 - Ceser - Région ...
quel destin pour la haute normandie en 2025 - Ceser - Région ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012<br />
Présid<strong>en</strong>te : Mme Nicole GOOSSENS<br />
Rapporteur : M. Gérard DUTHIL<br />
Chargée d’étude : Mme Laur<strong>en</strong>ce MONNET-LEPAGE<br />
Actualisation du rapport du CESER d’octobre 2004<br />
Octobre 2012 1
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 2
Sommaire<br />
Sommaire<br />
Composition de <strong>la</strong> Section Prospective.............................................. 5<br />
Avis ............................................................................................7<br />
Rapport ....................................................................................39<br />
Avant propos .............................................................................. 41<br />
Introduction................................................................................ 43<br />
Cadrage de l’étude....................................................................... 44<br />
I - Le temps d’un nouvel exercice prospectif .......................... 45<br />
II - Le cahier des charges ..................................................... 46<br />
Les choix méthodologiques ........................................................... 46<br />
I - La redéfinition du système étudié..................................... 46<br />
II - Phase I: prospective exploratoire ..................................... 47<br />
III - Phase II : prospective stratégique .................................... 49<br />
Partie I - Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables ....................51<br />
Introduction................................................................................ 53<br />
I - Définition et typologie des variables ret<strong>en</strong>ues .................... 53<br />
II - La redéfinition du système étudié..................................... 53<br />
Les fiches variables...................................................................... 59<br />
1. Fiche variable « Politique générale régionale » ............................... 61<br />
2. Fiche variable « Transports et Accessibilité régionale ».................... 69<br />
3. Fiche variable « Accessibilité immatérielle et organisationnelle » ...... 75<br />
4. Fiche variable « Démographie » ................................................... 79<br />
5. Fiche variable « Mondialisation de l’économie ».............................. 83<br />
6. Fiche variable « Croissance, emploi, chômage » ............................. 89<br />
7. Fiche variable « Filières économiques » ......................................... 95<br />
8. Fiche variable « Formation Insertion » .......................................... 99<br />
9. Fiche variable « Recherche et Innovation »...................................107<br />
10. Fiche variable « Offre de soins et Politique de Santé » ...............111<br />
11. Fiche variable « Environnem<strong>en</strong>t, Climat et Risques naturels et<br />
industriels » ...................................................................................117<br />
12. Fiche variable « Rayonnem<strong>en</strong>t culturel » ..................................123<br />
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par variable ............................ 131<br />
Partie II – Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles............................ 139<br />
Introduction.............................................................................. 141<br />
I - Définition d’un sc<strong>en</strong>ario : les futurs possibles <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ...... 141<br />
II - Choix des critères discriminants <strong>pour</strong> bâtir les sc<strong>en</strong>arii...... 141<br />
III - Synthèse des « chemins »............................................. 143<br />
Prés<strong>en</strong>tation synthetique des sc<strong>en</strong>arii........................................... 151<br />
Prés<strong>en</strong>tation détaillée des sc<strong>en</strong>arii ............................................... 153<br />
I - Sc<strong>en</strong>ario S1 : « La spirale du déclin dans un contexte<br />
europé<strong>en</strong> dégradé » ............................................................... 153<br />
II - Sc<strong>en</strong>ario 2 : « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> » ... 163<br />
III - Sc<strong>en</strong>ario 3 : « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus<br />
forte ! » ................................................................................. 171<br />
IV - Sc<strong>en</strong>ario S4 : « L'euphorie normande » .......................... 177<br />
Octobre 2012 3
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Partie III - Les préconisations à <strong>2025</strong> .................................... 185<br />
L’architecture des propostions :................................................... 187<br />
Les préconisations ..................................................................... 188<br />
1 - Les grands projets incontournables <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et au-delà........188<br />
• Accessibilité numérique..........................................................188<br />
• Energies ..............................................................................190<br />
• Autres grands projets d’infrastructures d’accessibilité – <strong>la</strong><br />
thématique portuaire .................................................................192<br />
• Infrastructures routières et ferroviaires....................................193<br />
2 – L’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong> croissance ...........................194<br />
• Formation ............................................................................194<br />
• Recherche ............................................................................196<br />
3 – Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u....................................197<br />
4 – L’Environnem<strong>en</strong>t, amélioration des bonnes pratiques ..................199<br />
5 - L’amélioration de l’accès aux soins, un passage indisp<strong>en</strong>sable <strong>pour</strong><br />
rompre avec <strong>la</strong> pénurie .................................................................200<br />
6 – Des flux migratoires inversés ...................................................202<br />
7 – Rayonnem<strong>en</strong>t culturel et tourisme comme vecteurs d’id<strong>en</strong>tité ......203<br />
8 - La gouvernance du développem<strong>en</strong>t durable ................................205<br />
Conclusion .............................................................................. 207<br />
Annexes.................................................................................. 211<br />
Cahier des charges .................................................................... 213<br />
Liste des personnes auditionnées et remerciem<strong>en</strong>ts ....................... 214<br />
Liste des variables de 2004......................................................... 216<br />
Sources docum<strong>en</strong>taires .............................................................. 217<br />
Liste des sigles utilisés ............................................................... 219<br />
Bref glossaire de <strong>la</strong> méthode des sc<strong>en</strong>arii ..................................... 222<br />
Octobre 2012 4
Composition de <strong>la</strong> Section prospective<br />
Composition de <strong>la</strong> Section Prospective<br />
Mme Nicole GOOSSENS, Présid<strong>en</strong>te<br />
M. Dominique PIEROTTI, Vice Présid<strong>en</strong>t<br />
M. Gérard DUTHIL, Rapporteur<br />
1. Membres du Conseil Economique Social et Environnem<strong>en</strong>tal (CESER)<br />
Mme Arlet ADAM<br />
au titre de l'Union régionale des organismes de formation de <strong>Normandie</strong> et de<br />
<strong>la</strong> Fédération de <strong>la</strong> formation professionnelle de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
M. Yves BLOCH<br />
au titre de <strong>la</strong> délégation régionale de <strong>la</strong> Fédération hospitalière de France<br />
M. Jean-Pierre CORLAY<br />
au titre de <strong>la</strong> fédération des offices de tourisme et des syndicats d'initiative de<br />
<strong>Normandie</strong><br />
M. Patrick DEVIS<br />
au titre des unions départem<strong>en</strong>tales des syndicats de Force Ouvrière de <strong>la</strong><br />
Seine-Maritime et de l'Eure<br />
M. Jean DUFROY<br />
au titre de l'Union Régionale de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> de <strong>la</strong> confédération<br />
française de l'<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t CGC<br />
Mme Catherine GARNIER-AMOUROUX<br />
au titre de l'accord <strong>en</strong>tre les <strong>en</strong>treprises : EDF, GDF SUEZ, SNCF, RFF, La<br />
Poste<br />
M. A<strong>la</strong>in GERBEAUD<br />
au titre du comité Régional CGT de <strong>Normandie</strong><br />
Mme Nicole GOOSSENS<br />
au titre de l'Union Régionale des syndicats CFDT de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
M. A<strong>la</strong>in GOUSSAULT<br />
au titre de l'Union régionale des <strong>en</strong>treprises d'insertion de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
M. Gérard GRANIER<br />
au titre du c<strong>en</strong>tre d'action régional <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t de l'éducation<br />
re<strong>la</strong>tive à l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
M. Michel JACOB<br />
au titre de <strong>la</strong> fédération régionale des coopératives agricoles de <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong><br />
M. Jean-Pierre LEGALLAND<br />
au titre du MEDEF et des branches professionnelles du secteur industriel,<br />
(UIMM, UIC/ARNIP, UFIP), représ<strong>en</strong>tant l’UFIP<br />
M. Jean-Luc LEGER<br />
au titre du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation<br />
popu<strong>la</strong>ire de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (CRAJEP)<br />
Octobre 2012 5
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Mme Régine LOISEL<br />
au titre de l'union régionale des syndicats CFTC de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
M. Jean-Luc MASURIER<br />
au titre de <strong>la</strong> chambre régionale de l’économie sociale<br />
M. Eric NEYME<br />
au titre de l'accord <strong>en</strong>tre les <strong>en</strong>treprises : EDF, GDF SUEZ, SNCF, RFF, La<br />
Poste<br />
M. Dominique PIEROTTI<br />
au titre du MEDEF et des branches professionnelles du secteur industriel<br />
(UIMM, UIC/ARNIP, UFIP), représ<strong>en</strong>tant l’UIC/ARNIP<br />
M. Jean-Dominique WAGRET<br />
au titre de RENAULT et du pôle de compétitivité MOV'EO<br />
2. Personnalités extérieures au CESER<br />
Mme Madeleine BROCARD, géographe à l’Université du Havre<br />
M. Daniel CORNET, Présid<strong>en</strong>t du groupe ELAN (<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs leaders <strong>pour</strong><br />
l'av<strong>en</strong>ir de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong>)<br />
M. Gérard DUTHIL, économiste à l’Université de Rou<strong>en</strong><br />
M. A<strong>la</strong>in MALMARTEL, directeur régional de l’INSEE<br />
M. Bernard PROUST, pratici<strong>en</strong> hospitalier<br />
M. Bertrand TIERCE, journaliste<br />
M. Richard TURCO, DGA ville de Rou<strong>en</strong>, anci<strong>en</strong> membre du CESR au titre des<br />
structures culturelles<br />
Octobre 2012 6
Avis<br />
Avis<br />
<strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Adopté à <strong>la</strong> majorité par :<br />
67 Pour<br />
5 Contre<br />
Octobre 2012 7
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 8
Avis<br />
Le CESER de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a réalisé <strong>en</strong> 2004 une étude prospective du<br />
positionnem<strong>en</strong>t géostratégique de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> intitulée « <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong><br />
<strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? », dans le cadre d’une auto saisine sur<br />
l’attractivité de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
L’année 2011 est apparue propice à une actualisation de l’exercice prospectif de<br />
2004. Il s’agit de réexaminer les hypothèses d’évolution des variables d’influ<strong>en</strong>ce<br />
du « dynamisme territorial régional » par rapport à de réc<strong>en</strong>tes évolutions<br />
(gouvernance r<strong>en</strong>ouvelée et facteurs d’incertitude) et de ba<strong>la</strong>yer de nouveau les<br />
<strong>en</strong>jeux et défis à relever dans ce contexte.<br />
L’annonce d’une déc<strong>en</strong>tralisation r<strong>en</strong>forcée <strong>en</strong> faveur des Régions ouvre <strong>la</strong><br />
perspective dès 2012 d’une plus grande maîtrise des ori<strong>en</strong>tations stratégiques,<br />
de leur coordination, de leur adaptation au territoire et des choix d’interv<strong>en</strong>tion.<br />
Ce contexte aussi mouvant et incertain a conduit à un exercice prospectif<br />
emprunt de réalisme, évitant les originalités provocatrices, mais ne s’interdisant<br />
pas quelques « paris » sur l’av<strong>en</strong>ir.<br />
A l’horizon <strong>2025</strong>, l’ess<strong>en</strong>tiel est de repérer et d’afficher quelles ambitions les<br />
acteurs, au premier rang desquels <strong>la</strong> Région, peuv<strong>en</strong>t porter <strong>pour</strong> être à <strong>la</strong><br />
hauteur des <strong>en</strong>jeux du dynamisme territorial défini comme le développem<strong>en</strong>t du<br />
territoire équilibré et respectueux de <strong>la</strong> qualité de vie.<br />
Le rapport prés<strong>en</strong>te 4 sc<strong>en</strong>arii décrivant une situation donnée <strong>en</strong> <strong>2025</strong> et<br />
id<strong>en</strong>tifie les conditions et propositions nécessaires <strong>pour</strong> aboutir à cette situation<br />
observée ou <strong>pour</strong> éviter les problèmes que génèrerait une situation <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
jugée moins favorable.<br />
Cette approche conduit à id<strong>en</strong>tifier les champs d’interv<strong>en</strong>tion possibles, à les<br />
hiérarchiser et à faire apparaître des priorités <strong>pour</strong> les acteurs de <strong>la</strong> région <strong>en</strong><br />
t<strong>en</strong>ant compte de l’état et de l’évolution des contraintes financières ainsi que des<br />
situations réglem<strong>en</strong>taires sur <strong>la</strong> période.<br />
La « méthode des sc<strong>en</strong>arii » a été utilisée et comporte 3 phases : <strong>la</strong> redéfinition<br />
du système étudié <strong>en</strong> 2004, l’analyse dynamique de chaque variable et <strong>la</strong><br />
construction des 4 sc<strong>en</strong>arii. 1<br />
La structure du p<strong>la</strong>n des sc<strong>en</strong>arii part des élém<strong>en</strong>ts de contexte général <strong>pour</strong><br />
aboutir à <strong>la</strong> situation régionale. Les programmes d’infrastructures dits<br />
« incontournables » autour du projet « Paris Seine <strong>Normandie</strong> », ainsi que le<br />
thème des énergies, sont p<strong>la</strong>cés <strong>en</strong> tête du cheminem<strong>en</strong>t de chacun des sc<strong>en</strong>arii.<br />
La « <strong>Normandie</strong> » évoquée dans les sc<strong>en</strong>arii S3 et S4 traduit <strong>la</strong> capacité des<br />
acteurs <strong>en</strong> région à s’inscrire dans une échelle de référ<strong>en</strong>ce territoriale dépassant<br />
celle des frontières administratives, <strong>en</strong> dehors de tout débat sur <strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce<br />
d’une frontière <strong>en</strong>tre <strong>Haute</strong> et Basse-<strong>Normandie</strong>.<br />
1 Annexe 1 – tableau croisant les hypothèses par variable<br />
Octobre 2012 9
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
PRESENTATION DES SCENARII<br />
…Nous sommes <strong>en</strong> <strong>2025</strong>…<br />
Sc<strong>en</strong>ario S1 : « La spirale du déclin dans un contexte europé<strong>en</strong><br />
dégradé »<br />
Dans un contexte de récession structurelle sans précéd<strong>en</strong>t, l’Europe a subi une<br />
récession continue jusqu’<strong>en</strong> <strong>2025</strong>. Les caractéristiques socio-économiques<br />
régionales sont telles que <strong>la</strong> région subit de plein fouet <strong>la</strong> crise comme les<br />
régions voisines. Bi<strong>en</strong> que <strong>la</strong> collectivité régionale disposait <strong>en</strong>core d’une marge<br />
de manœuvre <strong>en</strong> matière d’investissem<strong>en</strong>t, celle-ci est rapidem<strong>en</strong>t consommée.<br />
Il n’est pas possible de miser sur le ressort raisonné des acteurs économiques<br />
<strong>pour</strong> <strong>en</strong>trevoir des voies de résistance régionale à <strong>la</strong> récession. En l’abs<strong>en</strong>ce de<br />
ressort citoy<strong>en</strong>, c’est le règne du « chacun <strong>pour</strong> soi » et de <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre<br />
territoires. Les grands projets d’infrastructures régionaux ont été abandonnés ;<br />
l’accessibilité dégradée de <strong>la</strong> région et les faibles flux d’échanges l’isol<strong>en</strong>t. Les<br />
retards se creus<strong>en</strong>t dans les domaines de <strong>la</strong> formation et de <strong>la</strong> santé. Le<br />
rayonnem<strong>en</strong>t culturel se dégrade, <strong>la</strong> perte d’image et le peu d’attractivité de <strong>la</strong><br />
région pès<strong>en</strong>t sur le déficit migratoire.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario catastrophe…<br />
Sc<strong>en</strong>ario S2 : « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »<br />
Dans une situation de croissance retrouvée, l’amélioration du contexte<br />
économique est avérée au niveau national et mondial ; le souci de<br />
développem<strong>en</strong>t durable guide l’action. Dans ce contexte <strong>pour</strong>tant favorable, <strong>la</strong><br />
région, par excès de prud<strong>en</strong>ce, a insuffisamm<strong>en</strong>t anticipé cette embellie <strong>pour</strong> se<br />
mettre <strong>en</strong> situation de bénéficier de ses retombées. Elle ne tire pas les bénéfices<br />
de <strong>la</strong> croissance retrouvée. <strong>Quel</strong>ques grands équipem<strong>en</strong>ts structurants ont vu le<br />
jour, mais <strong>la</strong> situation et les indicateurs, bi<strong>en</strong> qu’évoluant <strong>en</strong> valeur absolue, ne<br />
se mainti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> valeur re<strong>la</strong>tive car les autres régions ont continué à<br />
progresser : <strong>la</strong> situation <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> se dégrade.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario qu’il faut éviter…<br />
Sc<strong>en</strong>ario S3 : « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus forte ! »<br />
Dans une situation de croissance retrouvée, l’amélioration du contexte<br />
économique est avérée au niveau national et mondial ; le souci de<br />
développem<strong>en</strong>t durable guide l’action, l’effort <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal est intégré et n’a<br />
pas de li<strong>en</strong> direct avec « l’aisance économique ». Dans ce contexte favorable, <strong>la</strong><br />
région a préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t anticipé l’embellie générale. Les choix <strong>en</strong> matière de<br />
grands projets structurants <strong>pour</strong> le territoire ont permis, grâce à <strong>la</strong> priorité<br />
donnée à l’accessibilité numérique, de créer les conditions d’un équilibre<br />
territorial et d’une capil<strong>la</strong>rité réussie du projet de développem<strong>en</strong>t Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>. S’inscrivant d’<strong>en</strong>trée dans un grand projet national, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong><br />
<strong>Normandie</strong> pr<strong>en</strong>d le devant sur les autres régions.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario audacieux mais néanmoins atteignable…<br />
Octobre 2012 10
Avis<br />
Sc<strong>en</strong>ario S4 : « La <strong>Normandie</strong> dans un contexte euphorique »<br />
Dans un contexte de redistribution des cartes au niveau mondial, <strong>la</strong> rationalité<br />
des acteurs économiques est retrouvée et leur confiance restaurée, le retour à <strong>la</strong><br />
croissance économique mondiale durant une déc<strong>en</strong>nie « glorieuse » a permis un<br />
assainissem<strong>en</strong>t du mouvem<strong>en</strong>t de mondialisation des économies et <strong>la</strong><br />
progression des échanges. Les flux irrigu<strong>en</strong>t tout le territoire régional grâce à <strong>la</strong><br />
réalisation de grands projets d’infrastructures, au mail<strong>la</strong>ge territorial et à <strong>la</strong><br />
multimodalité réussie. Le pot<strong>en</strong>tiel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur et<br />
re<strong>la</strong>yé par une stratégie off<strong>en</strong>sive à l’international, une prés<strong>en</strong>ce institutionnelle<br />
forte aux côtés des ag<strong>en</strong>ts économiques dans les champs des grands projets, de<br />
<strong>la</strong> formation, de l’innovation, de <strong>la</strong> santé, du développem<strong>en</strong>t durable.<br />
L’attractivité retrouvée permet d’inverser les flux migratoires. Le dynamisme<br />
territorial est porteur du développem<strong>en</strong>t équilibré du territoire et respectueux de<br />
<strong>la</strong> qualité de vie. La région réinv<strong>en</strong>te <strong>pour</strong> poser des bases et anticiper sur<br />
l’av<strong>en</strong>ir.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario euphorique et idéal… mais dont il faut craindre les pièges<br />
PRECONISATIONS<br />
Les 2 sc<strong>en</strong>arii S2 et S3 ont été jugés « réalistes » <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et<br />
amèn<strong>en</strong>t à des propositions de plusieurs ordres sur nos possibilités de<br />
développem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> réponse aux questions suivantes : quelles actions, quels<br />
leviers, quels acteurs. Il s’agit de t<strong>en</strong>dre vers <strong>la</strong> situation <strong>en</strong> <strong>2025</strong> décrite dans le<br />
sc<strong>en</strong>ario S3, ou d’éviter de subir, ou du moins de limiter, les problèmes<br />
r<strong>en</strong>contrés <strong>en</strong> <strong>2025</strong> et suggérés dans le sc<strong>en</strong>ario S2.<br />
1 - Les grands projets incontournables <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et au-delà<br />
La t<strong>en</strong>dance lourde <strong>en</strong> matière d’accessibilité numérique est « <strong>la</strong><br />
connexion » comme mode économique et social. Les collectivités au travers du<br />
contrat « 276 » passé <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> Région et les Départem<strong>en</strong>ts ont déjà affiché leur<br />
volontarisme. Ils ont pris des <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts à l’horizon de 15 ans <strong>pour</strong> faire<br />
progresser l’accessibilité au THD -Très Haut Débit- par paliers via le<br />
raccordem<strong>en</strong>t par <strong>la</strong> fibre optique, qui reste « LA » technologie du THD.<br />
Pour autant, il convi<strong>en</strong>t de rappeler que <strong>la</strong> fibre optique ne permettra pas de<br />
couvrir l’intégralité du territoire. Des technologies dites « palliatives » devront<br />
alors être mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. A cet égard, le satellite demeure le recours <strong>en</strong> cas<br />
d’impossibilité d’installer <strong>la</strong> fibre, même si le satellite induit des pertes <strong>en</strong> termes<br />
de flux et de qualité de réception.<br />
La priorité <strong>en</strong> région doit être accordée au déploiem<strong>en</strong>t du THD et à ses<br />
usages sur tout le territoire. Dans une dynamique de territoire proposée par le<br />
sc<strong>en</strong>ario S3, il faut contourner <strong>la</strong> phase de rattrapage de couverture <strong>en</strong> hautdébit<br />
<strong>pour</strong> privilégier le « bond direct » vers le Très Haut Débit.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de créer les conditions de l’aménagem<strong>en</strong>t numérique<br />
du territoire totalem<strong>en</strong>t abouti <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, garantissant son accessibilité<br />
immatérielle et organisationnelle. Il accompagne <strong>la</strong> croissance sur l’<strong>en</strong>semble de<br />
<strong>la</strong> région dans le respect de l’équilibre territorial <strong>en</strong>tre espaces urbains et ruraux.<br />
Octobre 2012 11
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Prioriser ce choix d’investissem<strong>en</strong>t sur les autres types d’infrastructures<br />
comparativem<strong>en</strong>t plus couteuses, plus longues à mettre <strong>en</strong> œuvre et dont <strong>la</strong><br />
réalisation est soumise à des financem<strong>en</strong>ts coordonnés avec des choix<br />
d’aménagem<strong>en</strong>t nationaux, est une décision à <strong>la</strong> portée des acteurs locaux qui<br />
établiss<strong>en</strong>t leur stratégie dès 2012.<br />
Nombre d’acteurs, publics et privés, sont directem<strong>en</strong>t concernés. Il revi<strong>en</strong>t à <strong>la</strong><br />
Région de porter cette stratégie <strong>pour</strong> leur faire partager <strong>la</strong> même ambition,<br />
ce qui r<strong>en</strong>forcera leur poids collectif face aux opérateurs privés de<br />
télécommunication.<br />
Partager est aussi une nécessité <strong>pour</strong> démystifier le coût d’un tel investissem<strong>en</strong>t<br />
qui reposera sur chaque interv<strong>en</strong>ant public sur le territoire. La r<strong>en</strong>tabilité peut<br />
être au r<strong>en</strong>dez vous des déploiem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> direction des zones peu ou pas<br />
couvertes susceptibles de générer des taux de raccordem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> meilleurs que<br />
sur les zones d<strong>en</strong>sifiées <strong>en</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>en</strong> activités disposant déjà du haut<br />
débit. Le THD est déterminant, d’une part, <strong>en</strong> raison des ressources que<br />
génèreront les acteurs économiques prés<strong>en</strong>ts sur le territoire et d’autre part, par<br />
l’effet de levier qu’il peut avoir sur les int<strong>en</strong>tions d’imp<strong>la</strong>ntation d’activités.<br />
La Région doit p<strong>la</strong>cer l’accessibilité numérique au cœur de sa communication<br />
<strong>pour</strong> valoriser <strong>la</strong> capacité de l’<strong>en</strong>semble du territoire auprès des investisseurs.<br />
Cette communication récurr<strong>en</strong>te portera sur les choix d’une stratégie régionale<br />
ambitieuse auprès des ag<strong>en</strong>ts économiques et au-delà des territoires, dans<br />
toutes les initiatives économiques à l’export et devra re<strong>la</strong>yer régulièrem<strong>en</strong>t<br />
toutes les avancées locales.<br />
La recherche de coopérations <strong>en</strong>tre opérateurs privés et collectivités <strong>pour</strong> le<br />
déploiem<strong>en</strong>t é<strong>la</strong>rgi doit privilégier les financem<strong>en</strong>ts mixtes <strong>pour</strong> ne pas recourir à<br />
des taxes supplém<strong>en</strong>taires. Le recours év<strong>en</strong>tuel à des part<strong>en</strong>ariats publics privés<br />
(PPP) doit être examiné avec <strong>la</strong> plus grande vigi<strong>la</strong>nce quant au respect des<br />
intérêts des collectivités et des opérateurs.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où les<br />
choix de couverture auront été réalisés par les seuls opérateurs, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est alors d’éviter que ces choix de couverture sélective ne pénalis<strong>en</strong>t<br />
trop fortem<strong>en</strong>t l’équilibre territorial. L’offre <strong>en</strong> THD, re<strong>la</strong>yée par les collectivités,<br />
doit alors être ciblée sur des territoires de projets où il y a lieu de ret<strong>en</strong>ir ou<br />
d’attirer de l’activité. La collectivité devra alors définir des priorités<br />
géographiques et temporelles de zones où flécher l’investissem<strong>en</strong>t public.<br />
Le second secteur sur lequel le CESER souhaite afficher des priorités est<br />
celui des énergies, dans lequel <strong>la</strong> hausse des coûts apparaît comme une<br />
t<strong>en</strong>dance lourde irréversible quel que soit leur mode de production.<br />
Le P<strong>la</strong>n Climat Energies « PCE » adopté par <strong>la</strong> Région dès 2007 et ses<br />
déclinaisons opérationnelles successives constitu<strong>en</strong>t une démarche de progrès<br />
visant à adapter l’<strong>en</strong>semble des politiques régionales aux priorités que<br />
constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> réduction des émissions de gaz à effet de serre, <strong>la</strong> maîtrise des<br />
consommations d’énergies et le développem<strong>en</strong>t des énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles. Avec<br />
<strong>la</strong> création de <strong>la</strong> filière énergie <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> 2009, <strong>la</strong> Région a su<br />
asseoir ses priorités contractuellem<strong>en</strong>t avec les opérateurs de <strong>la</strong> filière.<br />
Au sein d’un mix énergétique, <strong>la</strong> Région doit accorder <strong>en</strong> priorité ses moy<strong>en</strong>s à<br />
<strong>la</strong> structuration d’une filière éoli<strong>en</strong>ne. Elle doit être <strong>en</strong> capacité d’accompagner le<br />
développem<strong>en</strong>t de l’éoli<strong>en</strong> off-shore dans le cadre de l’appel à projet national.<br />
Octobre 2012 12
Avis<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de <strong>pour</strong>suivre <strong>en</strong> région le développem<strong>en</strong>t d’une offre<br />
d’énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles fondée sur un mix énergétique <strong>pour</strong> répondre aux<br />
demandes régionale et nationale. Cet <strong>en</strong>jeu vise égalem<strong>en</strong>t à améliorer<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> région.<br />
La réalisation des parcs éoli<strong>en</strong>s et de l’EPR de P<strong>en</strong>ly doit générer des retombées<br />
économiques <strong>en</strong> termes d’emplois directs et indirects <strong>en</strong> région, durant <strong>la</strong> phase<br />
de chantier et au-delà.<br />
La Région doit donc flécher prioritairem<strong>en</strong>t des moy<strong>en</strong>s sur cette filière au<br />
travers de ses dispositifs d’interv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> direction des acteurs économiques et<br />
valoriser ce choix <strong>pour</strong> peser dans l’interface avec les décideurs au p<strong>la</strong>n national.<br />
<strong>Quel</strong> que soit le grand projet d’infrastructure énergétique dont il s’agit, il est<br />
indisp<strong>en</strong>sable d’accompagner <strong>en</strong> amont <strong>la</strong> montée <strong>en</strong> qualification des sa<strong>la</strong>riés et<br />
demandeurs d’emploi du territoire, ainsi que des jeunes <strong>en</strong> formation initiale<br />
autour des besoins <strong>en</strong> qualification repérés.<br />
Les innovations techniques liées à <strong>la</strong> nouvelle forme de production et de stockage<br />
d’énergies nouvelles sont loin d’être abouties, que ce soit <strong>pour</strong> l’éoli<strong>en</strong> off-shore<br />
ou le photovoltaïque. Ce dernier représ<strong>en</strong>te une opportunité dans <strong>la</strong> région,<br />
particulièrem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> <strong>pour</strong>vue <strong>en</strong> surfaces exploitables, notamm<strong>en</strong>t dans toutes<br />
les zones industrielles et logistiques. La Région doit investir dans ce domaine une<br />
partie des moy<strong>en</strong>s qu’elle dédie à <strong>la</strong> recherche publique dans le cadre par<br />
exemple d’un appel à projet ciblé <strong>en</strong> invitant à coupler moy<strong>en</strong>s de recherche des<br />
<strong>la</strong>boratoires privés et moy<strong>en</strong>s universitaires et régionaux dédiés.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, l’<strong>en</strong>jeu<br />
a minima est de gagner <strong>en</strong> retombées locales <strong>en</strong> terme d’emplois <strong>en</strong> qualifiant<br />
<strong>la</strong> main-d’œuvre disponible au moins sur <strong>la</strong> phase chantier afin d’éviter le<br />
mécont<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t social <strong>la</strong>t<strong>en</strong>t lié à l’instal<strong>la</strong>tion de nouveaux sites éoli<strong>en</strong>s ou<br />
nucléaires sans bénéfice <strong>en</strong> retour.<br />
Les autres grands projets d’infrastructures <strong>en</strong> matière d’accessibilité<br />
régionale sont dominés par <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité de <strong>la</strong> « thématique<br />
portuaire » <strong>en</strong> raison de son li<strong>en</strong> avec le grand projet « Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong> ».<br />
Améliorer les positions respectives des ports du Havre et de Rou<strong>en</strong> suppose<br />
l’implication forte des milieux économiques avec, <strong>en</strong> re<strong>la</strong>is, des interv<strong>en</strong>tions<br />
publiques.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’importer et d’exporter des flux de marchandises <strong>en</strong><br />
phase avec <strong>la</strong> croissance de l’activité, notamm<strong>en</strong>t celle générée par les besoins<br />
de l’Ile de France, dans le cadre d’un projet global « gagnant-gagnant » <strong>pour</strong> les<br />
francili<strong>en</strong>s et les normands. C’est l’exist<strong>en</strong>ce d’un tel projet qui doit justifier le<br />
remode<strong>la</strong>ge des infrastructures.<br />
La tâche de <strong>la</strong> Région consiste dans un premier temps à capitaliser sur les<br />
re<strong>la</strong>tions ou coopérations qu’elle a développées avec <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong> et l’Ile<br />
de France. La finalité est de valoriser le débouché maritime du port du Havre et<br />
de rechercher des alliances hors des trois régions (Arc Manche). Elle doit inciter<br />
les acteurs portuaires à spécifier c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t les qualifications des ports :<br />
« cont<strong>en</strong>eurisation » au Havre et « groupage-dégroupage-logistique » à Rou<strong>en</strong>.<br />
En matière agricole, <strong>la</strong> notoriété de <strong>la</strong> « cotation Rou<strong>en</strong> » sur le fret céréales<br />
garantit <strong>la</strong> valeur ajoutée des « services » apportés au produit brut.<br />
Octobre 2012 13
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
La Région doit communiquer les atouts et les complém<strong>en</strong>tarités des deux ports<br />
aux investisseurs. Elle doit égalem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer ses aides à l’export et valoriser<br />
avec l’<strong>en</strong>semble des acteurs économiques sur le territoire <strong>la</strong> « porte maritime du<br />
Havre » auprès des exportateurs de produits fabriqués <strong>en</strong> France. Cette<br />
valorisation permettra de réduire le déséquilibre <strong>en</strong>tre l’import et l’export de nos<br />
ports tout <strong>en</strong> limitant les problèmes de sécurité maritime dans le corridor<br />
Manche.<br />
Les investisseurs doiv<strong>en</strong>t être incités à créer de <strong>la</strong> valeur ajoutée autour du<br />
transit dans les ports grâce à l’imp<strong>la</strong>ntation d’unités de transformation et<br />
d’assemb<strong>la</strong>ge <strong>en</strong> proximité. Ainsi <strong>la</strong> Région, <strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec les autres collectivités,<br />
doit aider à créer des réserves foncières <strong>pour</strong> imp<strong>la</strong>nter ces unités dans des zones<br />
d’activités, <strong>en</strong> offrant un accès « multimodal », le cas échéant sur des friches industrielles<br />
reconverties.<br />
Enfin, elle doit guider ses choix d’investissem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte des gains de<br />
compétitivité source de valeur ajoutée qu’ils sont susceptibles d’apporter dans <strong>la</strong><br />
chaîne logistique des transports de fret portuaire et fluvial.<br />
Dans l’hypothèse où, <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où<br />
l’amélioration de <strong>la</strong> position du Havre et de Rou<strong>en</strong> n’est pas atteinte, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est d’éviter sa dégradation. Il s’agit de pouvoir faire <strong>en</strong>trer et sortir des<br />
flux justifiant des infrastructures qui devront être alors priorisées : <strong>la</strong> chatière au<br />
Havre assurant un li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre port 2000 et le port de l’estuaire, <strong>la</strong> réalisation des<br />
infrastructures manquantes autour de l’axe fluvial Paris - Rou<strong>en</strong> - Le Havre <strong>pour</strong><br />
être prêt quand le Canal Seine Nord Europe « CSNE » sera opérationnel.<br />
Quant aux infrastructures routières et ferroviaires, l’<strong>en</strong>jeu stratégique<br />
est de mettre l’accessibilité au service du développem<strong>en</strong>t harmonieux du<br />
territoire <strong>en</strong> facilitant l’organisation des flux économiques et humains. Plusieurs<br />
projets d’investissem<strong>en</strong>t réalisés <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>en</strong> constitu<strong>en</strong>t l’ossature et facilit<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> multimodalité : <strong>la</strong> nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> compr<strong>en</strong>ant une<br />
offre de services tertiaires, <strong>la</strong> LNPN 2 <strong>en</strong> construction, le contournem<strong>en</strong>t Est de<br />
Rou<strong>en</strong>, le développem<strong>en</strong>t de l’aéroport de Deauville et <strong>la</strong> facilité d’accès accrue à<br />
Roissy. Il faut faire converger les moy<strong>en</strong>s financiers avec un échéancier<br />
concordant <strong>pour</strong> peser sur les choix immin<strong>en</strong>ts qui conditionn<strong>en</strong>t notre état <strong>en</strong><br />
<strong>2025</strong>.<br />
Si dans l’hypothèse du sc<strong>en</strong>ario S2, les grands projets d’infrastructure ne sont<br />
pas réalisés, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de lutter contre les effets néfastes de<br />
l’<strong>en</strong>gorgem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> région qui a accumulé des retards dans <strong>la</strong> réalisation de ses<br />
infrastructures.<br />
La Région doit alors cibler les efforts financiers sur le confort des lignes<br />
voyageurs infrarégionales, <strong>pour</strong> lesquelles elle a déjà fortem<strong>en</strong>t amélioré les<br />
liaisons. Les autres collectivités doiv<strong>en</strong>t aussi participer à l’effort sur l’<strong>en</strong>semble<br />
des transports collectifs. Les part<strong>en</strong>aires peuv<strong>en</strong>t s’organiser <strong>pour</strong> accompagner<br />
les initiatives associatives autour des modes « covoiturage », proposer des<br />
solutions organisées de stationnem<strong>en</strong>t autour des nœuds (covoiturage ou<br />
transports <strong>en</strong> commun), selon l’échelon de territoire concerné, avec une<br />
dynamique que <strong>la</strong> Région impulse.<br />
Enfin, <strong>la</strong> réalisation partielle du projet « gare de Rou<strong>en</strong> » doit intégrer une offre<br />
nouvelle de surfaces de bureaux. Le projet doit quant à lui comporter dès sa<br />
conception le p<strong>la</strong>n de développem<strong>en</strong>t et de raccordem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Gare. Les<br />
part<strong>en</strong>aires doiv<strong>en</strong>t s’<strong>en</strong>gager à constituer les réserves <strong>pour</strong> les raccordem<strong>en</strong>ts<br />
2 LNPN : Ligne Nouvelle Paris <strong>Normandie</strong><br />
Octobre 2012 14
Avis<br />
futurs dans le cadre des p<strong>la</strong>ns d’aménagem<strong>en</strong>ts. Les docum<strong>en</strong>ts d’urbanismes<br />
sont à construire.<br />
Dans le cadre des projets m<strong>en</strong>és hors région, le barreau mantois constitue un<br />
point s<strong>en</strong>sible sur <strong>la</strong> réalisation duquel l’<strong>en</strong>semble des part<strong>en</strong>aires régionaux<br />
doiv<strong>en</strong>t porter toute leur att<strong>en</strong>tion et peser fermem<strong>en</strong>t.<br />
2 - L’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong> croissance<br />
Si <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de cause à effet existe bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> croissance, d’une part, <strong>la</strong><br />
hausse de l’emploi et <strong>la</strong> baisse du chômage d’autre part, les effets de <strong>la</strong><br />
croissance sur <strong>la</strong> baisse du chômage dans <strong>la</strong> région sont moins efficaces qu’<strong>en</strong><br />
moy<strong>en</strong>ne, ce qui est révé<strong>la</strong>teur de <strong>la</strong> moindre capacité de notre région à profiter<br />
d’embellies sur l’emploi. Une des caractéristiques de <strong>la</strong> région est le retard<br />
récurr<strong>en</strong>t affiché par les indicateurs <strong>en</strong> matière de formation et d’élévation des<br />
niveaux de qualification des jeunes <strong>en</strong> formation initiale et des actifs et ce<br />
malgré les points gagnés au fil des ans.<br />
La région doit gagner du terrain <strong>en</strong> cons<strong>en</strong>tant les efforts nécessaires non<br />
seulem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> maint<strong>en</strong>ir sa situation mais <strong>pour</strong> rattraper ses retards <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
C’est un « coup d’accélérateur » nécessaire <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble de sa ressource<br />
humaine <strong>pour</strong> afficher des compét<strong>en</strong>ces d’égal à égal avec les autres régions.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est une réelle montée <strong>en</strong> gamme dans l’économie de <strong>la</strong><br />
connaissance <strong>pour</strong> accompagner les mutations de l’économie régionale, <strong>pour</strong><br />
offrir aux haut-normands de meilleures conditions d’insertion dans l’emploi,<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> les jeunes et les femmes, ainsi que davantage de sécurité dans<br />
leur parcours professionnel, <strong>en</strong>fin <strong>pour</strong> favoriser l’attractivité du territoire vis-àvis<br />
des jeunes ou des actifs.<br />
En matière de formation, <strong>la</strong> Région doit donner <strong>la</strong> priorité, dans le cadre<br />
de ses compét<strong>en</strong>ces actuelles, à l’adaptation des formations et des qualifications<br />
aux besoins ainsi qu’au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des outils de coordination <strong>en</strong>tre les acteurs<br />
de <strong>la</strong> formation. Après l’adoption concomitante du CRDE 3 et du CPRDFP 4 <strong>en</strong><br />
2011, une <strong>en</strong>vergure plus forte est à donner au CPRDFP, elle est requise <strong>pour</strong><br />
assurer <strong>la</strong> « montée <strong>en</strong> gamme » recherchée.<br />
A ce titre, le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t du CCREFP « comité de coordination régionale emploi<br />
formation professionnelle» apparaît nécessaire dans son rôle <strong>pour</strong> piloter,<br />
coordonner et mettre <strong>en</strong> synergie les acteurs de <strong>la</strong> formation dans les trois<br />
missions que sont l’anticipation des besoins, l’adaptation de l’offre et l’ori<strong>en</strong>tation<br />
de tous les publics. La Région, reconnue comme chef de file aux côtés de ses<br />
part<strong>en</strong>aires, doit y contribuer. Ce comité peut être doté du rôle de « Chancelier<br />
de <strong>la</strong> formation » <strong>en</strong> région.<br />
Tous les commanditaires de formation continue, <strong>en</strong> particulier <strong>la</strong> Région, doiv<strong>en</strong>t<br />
se soucier du mainti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> qualité des prestations des offreurs de formation<br />
continue <strong>en</strong> leur permettant d’anticiper et de faire évoluer parallèlem<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
professionnalisation de leurs formateurs. Il faut leur garantir davantage de<br />
lisibilité sur les stratégies d’évolution de <strong>la</strong> commande publique à moy<strong>en</strong> terme<br />
<strong>en</strong> région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et instaurer des temps de dialogue et de<br />
communication autour de ces stratégies.<br />
3 CRDE : Contrat Régional de Développem<strong>en</strong>t Economique<br />
4 CPRDEFP : Contrat de P<strong>la</strong>n Régional de Développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Formation Professionnelle<br />
Octobre 2012 15
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Enfin, le développem<strong>en</strong>t des formations supérieures <strong>en</strong> appr<strong>en</strong>tissage, le souti<strong>en</strong><br />
logistique des publics <strong>en</strong> formation, <strong>la</strong> lutte contre l’illettrisme sont des champs<br />
dans lesquels <strong>la</strong> Région et ses part<strong>en</strong>aires doiv<strong>en</strong>t s’impliquer davantage <strong>pour</strong><br />
faciliter l’accès aux formations <strong>pour</strong> tous sur l’<strong>en</strong>semble du territoire et accroître<br />
les niveaux de qualification des haut-normands.<br />
En matière de recherche, une nécessité urg<strong>en</strong>te est d’attirer des tal<strong>en</strong>ts et de<br />
stabiliser les chercheurs sur le territoire <strong>pour</strong> redynamiser <strong>la</strong> recherche régionale<br />
publique, de faire perdurer <strong>la</strong> notoriété de certains <strong>la</strong>boratoires <strong>en</strong> anticipant les<br />
r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>ts des chercheurs qui ont fait leur r<strong>en</strong>ommée, ainsi que de mettre<br />
les énergies au service du développem<strong>en</strong>t des activités nouvelles ou porteuses<br />
<strong>pour</strong> l’économie régionale.<br />
La Région doit être <strong>en</strong> capacité et s’autoriser à cibler des projets particulièrem<strong>en</strong>t<br />
prometteurs <strong>pour</strong> l’av<strong>en</strong>ir régional. A ce titre, <strong>la</strong> Région doit flécher une partie de<br />
ses <strong>en</strong>veloppes sur ces cibles qui <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t donner lieu à des appels d’offres<br />
<strong>la</strong>ncés <strong>en</strong> complém<strong>en</strong>t des fonds alloués aux projets portés par les GRR.<br />
Quant aux acteurs du PRES, ils doiv<strong>en</strong>t sans tarder mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce une stratégie<br />
commune de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> lisibilité de <strong>la</strong> recherche régionale avec une<br />
culture r<strong>en</strong>ouvelée d’ouverture, que ce soit <strong>en</strong> termes de part<strong>en</strong>ariat ou d’échelle<br />
territoriale, <strong>pour</strong> avoir gagné <strong>en</strong> lisibilité nationale et internationale d’ici <strong>2025</strong>.<br />
Le créneau particulier de <strong>la</strong> formation aux « métiers exercés <strong>en</strong> mer » doit être<br />
investi <strong>pour</strong> préparer <strong>la</strong> main-d’œuvre de demain, jeunes ou adultes, et<br />
accompagner les projets de nouvelles filières économiques : travail de repérage<br />
des compét<strong>en</strong>ces requises <strong>en</strong> matière de transport maritime, de maint<strong>en</strong>ance<br />
des matériels ou des ouvrages réalisés <strong>en</strong> milieu marin, de logistique à quai,<br />
id<strong>en</strong>tification des qualifications liées à <strong>la</strong> technicité de ces métiers, reconversion<br />
possible de main-d’œuvre des secteurs de <strong>la</strong> pêche… La Région peut concevoir<br />
un chantier grandeur réelle de gestion prévisionnelle des emplois et des<br />
compét<strong>en</strong>ces territoriales GPECT autour de ce thème.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où les<br />
retards <strong>en</strong> termes de formation et de recherche ne sont pas comblés, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est d’éviter qu’ils se creus<strong>en</strong>t ainsi que de ret<strong>en</strong>ir les jeunes diplômés.<br />
Il faut dès lors miser davantage auprès des jeunes sur <strong>la</strong> valorisation des filières<br />
nouvelles de spécialisation industrielle (énergies nouvelles ou maîtrise des<br />
risques) davantage connotées « industries <strong>en</strong> pointe ». Il faut maint<strong>en</strong>ir à un<br />
haut niveau les financem<strong>en</strong>ts publics locaux <strong>en</strong> matière de recherche et œuvrer<br />
<strong>pour</strong> attirer des financem<strong>en</strong>ts europé<strong>en</strong>s dans le cadre du programme<br />
opérationnel <strong>en</strong> cours de définition <strong>en</strong> poussant les acteurs du PRES à définir une<br />
stratégie de développem<strong>en</strong>t lisible basée sur l’ouverture au monde économique.<br />
Enfin, il faut <strong>en</strong>visager immédiatem<strong>en</strong>t une politique de lutte contre l’illettrisme,<br />
ciblée notamm<strong>en</strong>t sur l’illettrisme au travail <strong>pour</strong> limiter <strong>la</strong> précarisation des<br />
actifs et créer les conditions de leur retour <strong>en</strong> formation dès lors qu’ils sont<br />
touchés par une rupture dans l’emploi.<br />
3 - Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u<br />
La région rev<strong>en</strong>dique une forte id<strong>en</strong>tité industrielle et agricole qu’elle assume et<br />
sur <strong>la</strong>quelle elle doit appuyer son développem<strong>en</strong>t économique.<br />
Octobre 2012 16
Avis<br />
La région doit être <strong>en</strong> capacité de créer des produits ou services avec des<br />
débouchés correspondant au contexte des flux d’échanges de <strong>2025</strong>, c’est-à-dire<br />
qui se v<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t <strong>en</strong> raison d’un choix pertin<strong>en</strong>t de l’aire géographique de<br />
<strong>destin</strong>ation des produits et de leur caractère innovant.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de r<strong>en</strong>ouer avec <strong>la</strong> croissance de l’industrie <strong>en</strong> région.<br />
Avec tous les part<strong>en</strong>aires économiques du territoire, l’Etat, les experts du<br />
développem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> Région peut participer au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des aides à<br />
l’innovation, à <strong>la</strong> diffusion technologique et à l’exportation. Ces dim<strong>en</strong>sions sont<br />
intégrées dans ses interv<strong>en</strong>tions <strong>en</strong> direction des <strong>en</strong>treprises et <strong>la</strong> priorité doit<br />
être donnée à <strong>la</strong> coordination, voire parfois <strong>la</strong> converg<strong>en</strong>ce, des moy<strong>en</strong>s de tous<br />
les acteurs sur les mêmes cibles et dans le même temps <strong>pour</strong> des résultats<br />
amplifiés.<br />
En matière d’innovation, les acteurs doiv<strong>en</strong>t se rapprocher <strong>pour</strong> définir quel<br />
souti<strong>en</strong> complém<strong>en</strong>taire peut être accordé aux <strong>la</strong>boratoires publics de recherche<br />
et <strong>pour</strong> développer une culture de « brevets » là où l’évaluation académique<br />
accorde toute <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> culture de <strong>la</strong> publication. La Région peut <strong>en</strong>visager le<br />
fléchage d’une partie de ses financem<strong>en</strong>ts « recherche » au profit de projets<br />
m<strong>en</strong>és <strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec des <strong>en</strong>treprises et leurs <strong>la</strong>boratoires privés de<br />
recherche, ou avec des <strong>la</strong>boratoires étrangers, <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec une politique<br />
volontaire d’ouverture du PRES qui <strong>en</strong>gagera des actions structurantes et visibles<br />
par les part<strong>en</strong>aires.<br />
En ce qui concerne les thématiques de recherche, <strong>la</strong> Région doit valoriser l’intérêt<br />
qu’elle a déjà signifié <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> recherche dans le domaine de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. L’occasion doit être saisie de monter <strong>en</strong> puissance une filière<br />
d’excell<strong>en</strong>ce fondée sur une expéri<strong>en</strong>ce acquise p<strong>en</strong>dant plusieurs déc<strong>en</strong>nies <strong>en</strong><br />
matière de gestion des risques, <strong>en</strong> fléchant une partie des crédits <strong>en</strong> matière de<br />
recherche sur ce domaine particulier du réseau dédié à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. La<br />
région, dans son <strong>en</strong>semble, est prête à assumer cette spécificité liée à <strong>la</strong><br />
prés<strong>en</strong>ce d’industries à risque sur son territoire, que ce soi<strong>en</strong>t les collectivités,<br />
les part<strong>en</strong>aires sociaux, les universitaires. Elle peut <strong>en</strong> faire un atout avec l’aide<br />
des industriels <strong>pour</strong> lesquels les savoirs et les innovations <strong>en</strong> matière de gestion<br />
des risques majeurs sont de l’ordre du « non concurr<strong>en</strong>tiel » et où <strong>la</strong><br />
capitalisation bénéficie à toute <strong>la</strong> société.<br />
Les propositions concernant le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> position et de l’attractivité de<br />
ses deux grands ports de Rou<strong>en</strong> et du Havre (image, qualité des infrastructures,<br />
accessibilité et rapidité,…) doiv<strong>en</strong>t permettre d’affirmer <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> à l’international <strong>en</strong> favorisant l’exportation des produits (bi<strong>en</strong>s ou<br />
services) des <strong>en</strong>treprises haut-normandes et de développer des emplois<br />
industriels, logistiques et tertiaires. Elles doiv<strong>en</strong>t s’accompagner d’un<br />
r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des stratégies, notamm<strong>en</strong>t de communication, vers les <strong>en</strong>treprises<br />
nationales et internationales.<br />
Le rapport du CESR <strong>en</strong> 2008 sur les mutations économiques mettait déjà<br />
l’acc<strong>en</strong>t sur le poids des activités industrielles dans l’économie, évoquait les<br />
principales mutations prévisibles dans les 10 ans à v<strong>en</strong>ir et mettait <strong>en</strong> exergue 3<br />
points ess<strong>en</strong>tiels :<br />
quel que soit le secteur industriel, ce sont les secteurs d’excell<strong>en</strong>ce, de haute<br />
technicité et créateurs de forte valeur ajoutée qui se mainti<strong>en</strong>dront,<br />
l’interdép<strong>en</strong>dance des différ<strong>en</strong>ts secteurs industriels haut-normands doit être<br />
prise <strong>en</strong> compte dans <strong>la</strong> stratégie industrielle régionale,<br />
Octobre 2012 17
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
l’attractivité du territoire régional reste un facteur déterminant <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
pér<strong>en</strong>nisation des activités industrielles <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
Si <strong>la</strong> région souhaite conserver des activités industrielles fortes et performantes<br />
sur son territoire, l’implication des pouvoirs publics et leur souti<strong>en</strong> aux<br />
<strong>en</strong>treprises sont nécessaires et seront déterminants.<br />
Le Conseil Régional peut jouer un rôle moteur dans le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de<br />
l’attractivité de notre territoire. Compte t<strong>en</strong>u de <strong>la</strong> configuration de <strong>la</strong> taille des<br />
<strong>en</strong>treprises <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, <strong>la</strong> Région doit aider à structurer les re<strong>la</strong>tions<br />
<strong>en</strong>tre les PME et les grandes <strong>en</strong>treprises, ess<strong>en</strong>tielles <strong>pour</strong> l’équilibre des<br />
activités, <strong>en</strong> :<br />
- sout<strong>en</strong>ant les opérations d’investissem<strong>en</strong>t des PME répondant aux besoins<br />
exprimés par les donneurs d’ordres, malgré les risques parfois avérés de voir<br />
le donneur d’ordre se tourner vers d’autres sous-traitants ;<br />
- favorisant le dialogue <strong>en</strong>tre sous-traitants locaux et grands groupes<br />
notamm<strong>en</strong>t lorsque ceux-ci cess<strong>en</strong>t leur activité <strong>en</strong> région.<br />
La Région doit afficher c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t ses objectifs dans le cadre des contrats<br />
qu’elle passe avec les filières économiques et les branches professionnelles. Elle<br />
peut, par ce biais, aider à <strong>la</strong> consolidation des métiers de l’artisanat et de <strong>la</strong><br />
maint<strong>en</strong>ance, <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t représ<strong>en</strong>tés dans le tissu d<strong>en</strong>se de PME locales.<br />
Enfin dans le cadre de sa politique économique, elle doit établir des contacts<br />
réguliers avec les responsables et décideurs des grands groupes prés<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> dont les sièges sont basés à l’extérieur de notre région.<br />
Elle doit accompagner les mutations économiques et technologiques, plutôt<br />
qu’agir de manière curative avec des politiques de revitalisation. A cet effet, elle<br />
doit s’interroger sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, à l’échelle des bassins d’emploi de <strong>la</strong><br />
région, de réseaux d’anticipation, d’une gestion prévisionnelle des emplois et<br />
des compét<strong>en</strong>ces (GPEC) et de p<strong>la</strong>ns de formation concertés. Une structure<br />
perman<strong>en</strong>te <strong>pour</strong>ra être mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce à cet effet, regroupant par bassin<br />
d’emploi les grands acteurs économiques, les part<strong>en</strong>aires sociaux, les élus<br />
locaux…<br />
Cette démarche r<strong>en</strong>forcera par ailleurs l’id<strong>en</strong>tification des <strong>en</strong>treprises au<br />
territoire et <strong>la</strong> négociation, <strong>en</strong> amont des crises, <strong>en</strong>tre part<strong>en</strong>aires.<br />
Quant au financem<strong>en</strong>t des reprises d’<strong>en</strong>treprises, son inscription doit figurer au<br />
nombre des missions d’un pôle public financier qui reste à constituer, regroupant<br />
les institutions publiques et semi-publiques du crédit (<strong>la</strong> Banque de France, <strong>la</strong><br />
Caisse des dépôts et consignation, le Crédit foncier, Oséo <strong>pour</strong> le financem<strong>en</strong>t<br />
des PME…), chargé de promouvoir les financem<strong>en</strong>ts d’une croissance de qualité<br />
économique, sociale et écologique.<br />
L’<strong>en</strong>jeu de r<strong>en</strong>ouer avec <strong>la</strong> croissance de l’industrie ne doit pas occulter celui du<br />
développem<strong>en</strong>t des activités tertiaires notamm<strong>en</strong>t le tertiaire supérieur<br />
thématique sur <strong>la</strong>quelle le CESER a <strong>en</strong>tamé une réflexion et dont il faudra ret<strong>en</strong>ir<br />
les <strong>en</strong>jeux au terme de <strong>2025</strong>. La croissance de ces activités a un effet indirect<br />
sur l’économie résid<strong>en</strong>tielle et prés<strong>en</strong>tielle.<br />
Enfin, le caractère agricole de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, où les 2/3 du territoire sont<br />
couverts par les activités agricoles qui emploi<strong>en</strong>t 3% des actifs, <strong>en</strong> fait un<br />
secteur économique d’importance qui connait de fortes mutations avec des<br />
<strong>en</strong>jeux qui lui sont propres. La t<strong>en</strong>dance constante à <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration des<br />
activités pose l’<strong>en</strong>jeu de <strong>la</strong> productivité des services logistiques (dépôt,<br />
transport…) liés à l’agriculture, de <strong>la</strong> pér<strong>en</strong>nité sur le territoire d’industries de<br />
transformation agro-alim<strong>en</strong>taires « historiques » qui sauront muter vers des<br />
Octobre 2012 18
Avis<br />
activités innovantes et qui pès<strong>en</strong>t depuis toujours favorablem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce<br />
du commerce extérieur. C’est aussi celui de déterminer <strong>la</strong> part des surfaces à<br />
consacrer au déploiem<strong>en</strong>t d’autres modes de cultures, dans le but de limiter<br />
l’impact de l’agriculture int<strong>en</strong>sive sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, d’une part, et de<br />
permettre une ori<strong>en</strong>tation plus importante vers des cultures « bio », d’autre part,<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> le maraîchage.<br />
Compte t<strong>en</strong>u de l’importance de ce secteur, <strong>la</strong> Région doit veiller à apporter un<br />
souti<strong>en</strong> à l’aune de celui qu’elle apporte à l’<strong>en</strong>semble des activités économiques<br />
prés<strong>en</strong>tes sur le territoire comme elle l’a d’ailleurs évoqué dans le CRDE, <strong>en</strong><br />
valorisant l’<strong>en</strong>semble des ressources locales dans les activités agro industrielles<br />
(ressource bois, ressource halieutique…). Dans ce cadre, elle doit s’interroger sur<br />
<strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce et <strong>la</strong> faisabilité à <strong>2025</strong> d’un modèle économique qui reconc<strong>en</strong>tre sur<br />
le territoire l’<strong>en</strong>semble des activités de <strong>la</strong> filière lin, notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> transformation<br />
de <strong>la</strong> production actuellem<strong>en</strong>t délocalisée à l’étranger.<br />
Dans l’hypothèse où, <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2 où le<br />
manque d’efficacité économique est avéré, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de lutter<br />
contre <strong>la</strong> désindustrialisation de <strong>la</strong> région.<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer et communiquer autour des dispositifs de portage<br />
d’<strong>en</strong>treprise et d’aide au développem<strong>en</strong>t (couveuses, incubateurs, pépinières,<br />
usines re<strong>la</strong>is, …), progresser sur <strong>la</strong> spécialisation du territoire <strong>en</strong> matière de<br />
prév<strong>en</strong>tion et de gestion des risques industriels (industriels, chercheurs publics et<br />
privés, pouvoirs publics…).<br />
Enfin, il faut optimiser les retombées du fléchage des investissem<strong>en</strong>ts publics <strong>en</strong><br />
matière de THD <strong>en</strong> <strong>en</strong> faisant un facteur de dynamisme repérable et repéré par<br />
les <strong>en</strong>treprises, grâce à une politique de communication sout<strong>en</strong>ue autour de<br />
cette priorité régionale. Elle sera bénéfique à <strong>la</strong> fois au développem<strong>en</strong>t des<br />
activités de services mais égalem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> reprise et à <strong>la</strong> transmission des PME<br />
PMI régionales qui sont parfois m<strong>en</strong>acées faute de repr<strong>en</strong>eur.<br />
4 - L’Environnem<strong>en</strong>t, appropriation des bonnes pratiques<br />
La Région est au premier p<strong>la</strong>n dans l’é<strong>la</strong>boration des 2 schémas régionaux<br />
SRCAE (climat air énergie) -<strong>pour</strong> définir les ori<strong>en</strong>tations stratégiques de <strong>la</strong><br />
transition énergétique à l’échelle du territoire -et SRCE (cohér<strong>en</strong>ce écologique)-<br />
<strong>pour</strong> définir les stratégies de <strong>la</strong> conservation et de <strong>la</strong> gestion durable de <strong>la</strong><br />
biodiversité. Elle doit s’assurer que ces schémas sont bi<strong>en</strong> dotés d’outils<br />
d’évaluation <strong>pour</strong> que les objectifs fixés soi<strong>en</strong>t effectivem<strong>en</strong>t mesurés et atteints.<br />
L’animation régulière des acteurs doit être impulsée par <strong>la</strong> Région avec, <strong>en</strong><br />
ligne de mire, <strong>la</strong> priorité à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre l’homme et son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’ancrer le développem<strong>en</strong>t durable dans les pratiques<br />
de consommation et de production, de conservation des ressources naturelles et<br />
de <strong>la</strong> biodiversité, ainsi que d’« <strong>en</strong>granger » autour des progrès énergétiques.<br />
Outre les actions de s<strong>en</strong>sibilisation et d’éducation à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t qu’elle mène<br />
dans son champ de compét<strong>en</strong>ce « éducation et formation », elle doit s’<strong>en</strong>gager<br />
avec les collectivités compét<strong>en</strong>tes <strong>pour</strong> couvrir le domaine de l’habitat et de <strong>la</strong><br />
construction et atteindre les ménages et les bailleurs (privés ou sociaux). Les<br />
progrès à faire <strong>pour</strong> atteindre les normes d’efficacité énergétique sur les<br />
bâtim<strong>en</strong>ts anci<strong>en</strong>s (99% du parc) sont <strong>en</strong>core très importants.<br />
Octobre 2012 19
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
La Région doit favoriser et amplifier le dialogue <strong>en</strong>tre tous les interv<strong>en</strong>ants sur<br />
les espaces naturels dans les instances ad hoc de pilotage des schémas <strong>pour</strong><br />
faire converger les visions complém<strong>en</strong>taires qu’ont les uns et les autres d’une<br />
seule et même logique qui les anime, à savoir <strong>la</strong> gestion des ressources<br />
naturelles respectueuse de <strong>la</strong> biodiversité.<br />
La Région doit veiller à <strong>la</strong> déf<strong>en</strong>se de nouveaux <strong>en</strong>jeux : déploiem<strong>en</strong>t de son<br />
expertise, ses études et conseils auprès des communautés de communes ou des<br />
communes <strong>pour</strong> accompagner les politiques locales de développem<strong>en</strong>t durable,<br />
de protection de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, d’aménagem<strong>en</strong>t des espaces, de gestion de <strong>la</strong><br />
distribution d’eau (syndicats) et de <strong>la</strong> qualité de l’eau potable.<br />
Elle doit aussi s’assurer que le développem<strong>en</strong>t industriel ou l’imp<strong>la</strong>ntation de<br />
nouvelles activités n’empièt<strong>en</strong>t plus sur les terres agricoles et ne déséquilibr<strong>en</strong>t<br />
pas l’espace et <strong>la</strong> biodiversité. Un chantier à part <strong>en</strong>tière autour de <strong>la</strong><br />
réutilisation de friches industrielles doit s’ouvrir. Il s’agit de déterminer dans<br />
quelles conditions et <strong>pour</strong> quel type d’activité ces friches peuv<strong>en</strong>t être réutilisées<br />
avant l’exploitation de nouveaux espaces naturels. Cette réflexion doit impliquer<br />
l’<strong>en</strong>semble des part<strong>en</strong>aires et notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> Région au titre de sa compét<strong>en</strong>ce<br />
économique et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale.<br />
Elle doit égalem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tifier des moy<strong>en</strong>s de recherche <strong>pour</strong> améliorer <strong>la</strong><br />
connaissance sci<strong>en</strong>tifique <strong>en</strong> matière de mesure de <strong>la</strong> biodiversité (observatoire<br />
régional de <strong>la</strong> biodiversité étoffé dans ses missions). A minima, le SRCE doit<br />
prévoir <strong>la</strong> création d’un lieu répertoriant et rassemb<strong>la</strong>nt les données <strong>en</strong> matière<br />
de biodiversité <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec les schémas d’urbanisme.<br />
Enfin, <strong>en</strong> termes de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts, tous les part<strong>en</strong>aires <strong>en</strong> charges des<br />
infrastructures doiv<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer les moy<strong>en</strong>s <strong>pour</strong> accroître l’éco mobilité,<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> réalisation de pistes cyc<strong>la</strong>bles.<br />
5 - L’amélioration de l’accès aux soins, un passage indisp<strong>en</strong>sable <strong>pour</strong><br />
rompre avec <strong>la</strong> pénurie<br />
La raréfaction des ressources dans le domaine des politiques de santé <strong>la</strong>isse à<br />
p<strong>en</strong>ser que <strong>la</strong> redéfinition des politiques sociales est une nécessité.<br />
En réponse aux besoins cruciaux liés au déficit de professionnels de santé <strong>en</strong><br />
région et à <strong>la</strong> situation socio-sanitaire préoccupante, <strong>la</strong> région ne peut « se<br />
<strong>la</strong>isser vivre » <strong>en</strong> matière de santé et doit repr<strong>en</strong>dre un pas d’avance et gagner<br />
<strong>en</strong> attractivité.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de permettre un accès aux soins équilibré et de rompre<br />
avec <strong>la</strong> situation de pénurie régionale dans l’offre de soins.<br />
Dans les champs d’interv<strong>en</strong>tion qui sont les si<strong>en</strong>s ou dans lesquels elle a souhaité<br />
s’investir <strong>en</strong> matière de santé et d’offre de soins, <strong>la</strong> Région doit prioriser le<br />
déploiem<strong>en</strong>t des nouvelles pratiques de <strong>la</strong> télémédecine et de <strong>la</strong> télésanté, <strong>en</strong><br />
s’appuyant sur l’avance acquise grâce aux efforts cons<strong>en</strong>tis <strong>en</strong> matière de<br />
développem<strong>en</strong>t du numérique sur son territoire.<br />
Elle doit inciter à mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce ces technologies lors de <strong>la</strong> définition des<br />
conv<strong>en</strong>tions de part<strong>en</strong>ariat <strong>pour</strong> installer des maisons médicales, mobiliser une<br />
partie de ses aides à <strong>la</strong> recherche sur ce secteur, pousser à <strong>la</strong><br />
professionnalisation de tous les acteurs de <strong>la</strong> chaîne de prise <strong>en</strong> charge médicale<br />
et paramédicale sur ces nouvelles techniques.<br />
Par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce des acteurs politiques locaux, représ<strong>en</strong>tants à l’Assemblée<br />
Nationale, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> doit être <strong>en</strong> mesure de peser <strong>pour</strong> influer et faire<br />
évoluer favorablem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> démographie médicale et paramédicale <strong>en</strong> région.<br />
Octobre 2012 20
Avis<br />
Dans tous les cas de figure, le meilleur accès aux soins <strong>pour</strong> tous sera aussi<br />
facilité par une meilleure prév<strong>en</strong>tion qui diminue les risques de pathologies<br />
lourdes. Dans ce domaine, <strong>la</strong> Région doit utiliser les li<strong>en</strong>s qu’elle a instaurés<br />
avec les <strong>en</strong>treprises au sein des contrats d’objectif de branches, publiques et<br />
privées, <strong>pour</strong> inciter à faire de <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et de <strong>la</strong> santé au travail une priorité.<br />
Sur les territoires, dans le cadre des représ<strong>en</strong>tations qu’elle occupe au sein des<br />
instances réunissant les acteurs de <strong>la</strong> formation ou dans le champ de l’éducation<br />
popu<strong>la</strong>ire, dans le cadre de ses re<strong>la</strong>tions avec les différ<strong>en</strong>tes collectivités, elle<br />
doit re<strong>la</strong>yer ce message sur l’importance à agir sur les risques épidémiologiques<br />
avérés <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et accompagner, au titre de ses différ<strong>en</strong>tes<br />
interv<strong>en</strong>tions, <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et l’éducation à <strong>la</strong> santé, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> direction des<br />
jeunes et des familles.<br />
6 - Des flux migratoires inversés<br />
La caractéristique des flux migratoires <strong>en</strong> région jusqu’aux années 70-80 est <strong>la</strong><br />
forte corré<strong>la</strong>tion de sa croissance démographique avec les opportunités<br />
économiques impulsées de l’extérieur et non pas par <strong>la</strong> volonté des hautnormands<br />
eux-mêmes.<br />
La prise <strong>en</strong> main de cette composante est donc difficile, mais un<br />
développem<strong>en</strong>t sout<strong>en</strong>u d’activités dans <strong>la</strong> région peut attirer des popu<strong>la</strong>tions<br />
d’autres régions avoisinantes, tout comme c’est déjà le cas <strong>pour</strong> les actifs de l’Ile<br />
de France.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’attirer des popu<strong>la</strong>tions tout <strong>en</strong> gardant un équilibre<br />
sur le territoire <strong>en</strong>tre jeunes, actifs, s<strong>en</strong>iors et 3 ème âge <strong>pour</strong> minimiser les<br />
conséqu<strong>en</strong>ces négatives d’une trop forte spécificité de c<strong>la</strong>sses d’âge sur un<br />
territoire donné.<br />
L’attractivité des popu<strong>la</strong>tions est, dans bi<strong>en</strong> des cas, une résultante des actions<br />
qui seront <strong>en</strong>treprises dans les domaines précédemm<strong>en</strong>t cités : <strong>la</strong> couverture<br />
numérique <strong>en</strong> THD, les facilités d’accessibilité, les parcours de formation et<br />
l’insertion dans l’emploi, l’accès aux qualifications supérieures <strong>en</strong> région, le<br />
r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des activités nouvelles et innovantes porteuses d’emplois, <strong>la</strong><br />
dynamique régionale au sein du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>, l’accès aux soins<br />
de qualité, le respect des espaces naturels et les pratiques partagées de<br />
développem<strong>en</strong>t durable…<br />
Des priorités sont toutefois id<strong>en</strong>tifiées <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> qui doit veiller<br />
plus particulièrem<strong>en</strong>t au r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de main-d’œuvre dans certains<br />
secteurs, dans <strong>la</strong> mesure où les actifs de plus de 55 ans seront<br />
proportionnellem<strong>en</strong>t plus nombreux dès 2020. La cible est donc les jeunes et les<br />
politiques d’accompagnem<strong>en</strong>t social, notamm<strong>en</strong>t celles tournées plus<br />
spécifiquem<strong>en</strong>t vers les étudiants. Il ne s’agit pas de limiter <strong>la</strong> mobilité des<br />
jeunes, y compris ceux qui part<strong>en</strong>t étudier ailleurs, cette démarche étant<br />
éminemm<strong>en</strong>t formatrice, mais bi<strong>en</strong> d’inciter des jeunes à v<strong>en</strong>ir ou à rev<strong>en</strong>ir <strong>en</strong><br />
région grâce aux actions <strong>en</strong>treprises <strong>pour</strong> faciliter les conditions de leur <strong>en</strong>trée<br />
dans <strong>la</strong> vie active.<br />
Il ne revi<strong>en</strong>t pas à <strong>la</strong> Région seule de les mettre <strong>en</strong> œuvre mais à tous les<br />
part<strong>en</strong>aires concernés selon les niveaux de formation ou selon le type d’aide<br />
<strong>en</strong>visagée (aide à caractère social, logem<strong>en</strong>t, culture, …). Elle doit néanmoins<br />
convaincre que l’attrait des jeunes est un facteur-clé <strong>pour</strong> l’av<strong>en</strong>ir, indisp<strong>en</strong>sable<br />
<strong>pour</strong> conduire au dynamisme régional.<br />
Octobre 2012 21
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Enfin, des offres de services aux popu<strong>la</strong>tions susceptibles de s’imp<strong>la</strong>nter dans <strong>la</strong><br />
région avec l’arrivée de nouvelles activités économiques ou le développem<strong>en</strong>t<br />
d’<strong>en</strong>treprises régionales doiv<strong>en</strong>t pouvoir être proposées dans le cadre de<br />
programmes concertés <strong>en</strong>tre collectivités à l’échelle infra territoriale.<br />
7 - Rayonnem<strong>en</strong>t culturel et tourisme comme vecteurs d’id<strong>en</strong>tité<br />
La culture et le tourisme sont les atouts d’un territoire. La <strong>Normandie</strong> fait partie<br />
des 3 ou 4 régions françaises id<strong>en</strong>tifiées dans le monde <strong>en</strong>tier. Mais, les réc<strong>en</strong>tes<br />
études du CESER ont mis <strong>en</strong> lumière un constat paradoxal, celui d’une offre<br />
culturelle abondante et riche, d’acteurs impliqués, mais d’un manque de lisibilité<br />
de cette offre et des politiques. Elles ont pointé une abs<strong>en</strong>ce de culture de réseau<br />
et d’un évènem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>vergure qui donn<strong>en</strong>t un véritable s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t<br />
d’appart<strong>en</strong>ance construit dans <strong>la</strong> durée. Dans un cadre financier de plus <strong>en</strong> plus<br />
contraint, les choix opérés par les décideurs dans ce domaine sont d’autant plus<br />
cruciaux.<br />
Il convi<strong>en</strong>t d’aller vers <strong>la</strong> conquête d’une id<strong>en</strong>tité territoriale porteuse de<br />
dynamisme et d’attractivité à <strong>la</strong> fois <strong>en</strong> matière culturelle et touristique.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de faire évoluer rapidem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vision du dynamisme<br />
culturel et touristique comme un véritable outil d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire.<br />
Le CESER r<strong>en</strong>voie à ses réc<strong>en</strong>ts rapports sur <strong>la</strong> culture où, parmi les propositions<br />
déjà émises, on peut citer <strong>la</strong> création d’un observatoire des pratiques culturelles<br />
et d’un Comité Régional de <strong>la</strong> Culture, l’établissem<strong>en</strong>t d’un schéma régional de<br />
développem<strong>en</strong>t culturel avec un chef de file id<strong>en</strong>tifié et une stratégie commune<br />
d’interv<strong>en</strong>tion autour d’un axe stratégique c<strong>la</strong>ir. L’idée déf<strong>en</strong>due est celle d’une<br />
vision « intégrée » de <strong>la</strong> culture comme une composante naturelle de chaque<br />
acte de <strong>la</strong> société qui imprègne les politiques de cohésion sociale, l’économie,<br />
l’aménagem<strong>en</strong>t du territoire, l’éducation, l’international, le handicap et<br />
l’accessibilité, le développem<strong>en</strong>t durable…, et comme élém<strong>en</strong>t d’attractivité au<br />
même titre qu’un service public. Cette vision présuppose de nouveaux modes de<br />
gouvernance, plus participatifs et un part<strong>en</strong>ariat r<strong>en</strong>ouvelé <strong>en</strong>tre Etat,<br />
collectivités et acteurs culturels, dans le cadre d’un fonctionnem<strong>en</strong>t décloisonné.<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t s’approprier une id<strong>en</strong>tité de territoire é<strong>la</strong>rgi <strong>en</strong> <strong>2025</strong> à<br />
l’échelle de l’axe Paris Seine <strong>Normandie</strong>, qui s’appuie sur les cohér<strong>en</strong>ces<br />
d’id<strong>en</strong>tités historiques, économiques, sociales et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales de Paris,<br />
Rou<strong>en</strong>, le Havre, Ca<strong>en</strong> et Cherbourg, et qui ti<strong>en</strong>t compte de <strong>la</strong> proximité de <strong>la</strong><br />
région parisi<strong>en</strong>ne très prégnante <strong>pour</strong> <strong>la</strong> fréqu<strong>en</strong>tation touristique de <strong>la</strong> région.<br />
C’est l’échelle à <strong>la</strong>quelle il faut consolider deux événem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>vergure<br />
nationale et internationale qui fonctionn<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> leur donnant un rythme lisible <strong>en</strong><br />
alternance au moins tous les deux ans : d’une part l’Armada et l’id<strong>en</strong>tité de <strong>la</strong><br />
mer, du fleuve, du voyage, et d’autre part <strong>Normandie</strong> Impressionniste et le<br />
li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre les paysages, le développem<strong>en</strong>t industriel de <strong>la</strong> Seine, le chemin de<br />
fer. C’est aussi l’échelle à <strong>la</strong>quelle il faut valoriser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce des établissem<strong>en</strong>ts<br />
culturels et d’éducation artistique régionaux (les musées, les conservatoires, les<br />
écoles d’arts…). Une offre complém<strong>en</strong>taire, notamm<strong>en</strong>t dans le domaine des<br />
<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts artistiques supérieurs, attractive <strong>pour</strong> les francili<strong>en</strong>s doit être<br />
proposée à partir de l’évaluation préa<strong>la</strong>ble des points de saturation de ces<br />
structures <strong>en</strong> Ile de France. C’est <strong>en</strong>fin l’échelle à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> Région doit<br />
consolider les réseaux des professionnels dans les différ<strong>en</strong>ts secteurs (Réseau<br />
Octobre 2012 22
Avis<br />
des Musiques Actuelles de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Pôles régionaux, musique, arts<br />
visuels).<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t aussi dépasser l’échelle territoriale de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
afin de créer une ouverture internationale dans les créations, les diffusions, <strong>la</strong><br />
communication : <strong>la</strong> Grande-Bretagne, voire les Etats-Unis, font partie intégrante<br />
de l’id<strong>en</strong>tité historique de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> et permettrai<strong>en</strong>t de « v<strong>en</strong>dre l’id<strong>en</strong>tité<br />
culturelle normande à l’étranger ». La recherche de lisibilité internationale doit<br />
<strong>en</strong>fin s’appuyer sur <strong>la</strong> <strong>pour</strong>suite des politiques de c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t au patrimoine<br />
mondial de l’Unesco et des <strong>la</strong>bels internationaux ainsi que sur <strong>la</strong> réflexion autour<br />
d’une « capitale europé<strong>en</strong>ne » de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong> région.<br />
Enfin, <strong>pour</strong> accompagner une vision « intégrée » de <strong>la</strong> culture comme une<br />
composante naturelle de chaque acte de <strong>la</strong> société, il faut inciter les acteurs à<br />
s’ouvrir et à rep<strong>en</strong>ser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du privé dans le financem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong><br />
favorisant des stratégies de mécénat cohér<strong>en</strong>tes (création de fondations<br />
territoriales), articulées sur les intérêts communs des <strong>en</strong>treprises (recherche<br />
d’image <strong>en</strong> interne ou de notoriété à l’externe) et de <strong>la</strong> région.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où<br />
seuls les territoires parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à se mobiliser <strong>pour</strong> développer une offre<br />
culturelle de proximité, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de conjuguer les initiatives<br />
infrarégionales <strong>pour</strong> maint<strong>en</strong>ir les positions actuelles <strong>en</strong> matière de pratique, de<br />
création, de fréqu<strong>en</strong>tation culturelle et touristique et de valorisation du<br />
patrimoine, sachant qu’il n’y a pas forcém<strong>en</strong>t de « réconciliation » à opérer <strong>en</strong>tre<br />
le public et les arts.<br />
La Région doit alors mettre <strong>en</strong> œuvre les moy<strong>en</strong>s <strong>pour</strong> conjuguer le<br />
développem<strong>en</strong>t culturel des territoires avec un projet culturel régional, inciter les<br />
professionnels à combiner l’offre culturelle et l’offre touristique (ce qui est facilité<br />
par le développem<strong>en</strong>t du THD), maint<strong>en</strong>ir un évènem<strong>en</strong>t annuel fédérateur<br />
autour de <strong>la</strong> richesse aquatique et a minima consolider l’id<strong>en</strong>tité de l’Armada et<br />
de <strong>Normandie</strong> Impressionniste, développer des résid<strong>en</strong>ces d’écritures <strong>pour</strong><br />
scénaristes ou des résid<strong>en</strong>ces d’artistes, notamm<strong>en</strong>t dans l’Eure, des vil<strong>la</strong>ges<br />
animés le long de l’axe « Paris Seine <strong>Normandie</strong> » autour des jardins, des<br />
écrivains, de <strong>la</strong> culture industrielle de <strong>la</strong> vallée, <strong>en</strong> exploitant <strong>la</strong> thématique du<br />
développem<strong>en</strong>t durable.<br />
Les souti<strong>en</strong>s des différ<strong>en</strong>ts financeurs doiv<strong>en</strong>t être maint<strong>en</strong>us <strong>pour</strong> conserver le<br />
niveau de nos établissem<strong>en</strong>ts culturels et d’éducation artistique d’exception, mais<br />
ils devront être augm<strong>en</strong>tés <strong>pour</strong> développer les pratiques amateurs qui<br />
contribu<strong>en</strong>t à l’appét<strong>en</strong>ce <strong>pour</strong> <strong>la</strong> culture et sont un gage du dynamisme des<br />
initiatives locales sur les territoires.<br />
La Région doit <strong>en</strong>fin inciter au développem<strong>en</strong>t d’initiatives autour du couple<br />
« patrimoine historique» / « modernité ». Le patrimoine est un véhicule de<br />
modernité et <strong>la</strong> richesse de <strong>la</strong> région doit être un support lui permettant de<br />
pr<strong>en</strong>dre un temps d’avance.<br />
8 - La gouvernance du développem<strong>en</strong>t durable<br />
Les différ<strong>en</strong>tes propositions ci-dessus évoqu<strong>en</strong>t <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t le part<strong>en</strong>ariat <strong>en</strong>tre<br />
acteurs du développem<strong>en</strong>t du territoire, qu’ils soi<strong>en</strong>t publics ou privés, ainsi que<br />
le part<strong>en</strong>ariat avec les acteurs <strong>en</strong> dehors du territoire.<br />
Octobre 2012 23
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Cette question d’échelle territoriale et de gouvernance est au cœur de <strong>la</strong><br />
réussite des initiatives qui seront prises <strong>pour</strong> aller « vers une <strong>Normandie</strong><br />
audacieuse et plus forte »<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de changer <strong>la</strong> culture de territoire <strong>pour</strong> positionner <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dans un <strong>en</strong>semble plus <strong>la</strong>rge (Paris Seine <strong>Normandie</strong> … et moi,<br />
… et lui, le francili<strong>en</strong>), et de faire converger et concorder dans le temps les<br />
moy<strong>en</strong>s financiers de tous les acteurs, de convaincre que <strong>la</strong> région ne doit plus<br />
« att<strong>en</strong>dre » ce qui ne vi<strong>en</strong>dra plus de l’extérieur…<br />
Si <strong>la</strong> Région n’a pas des moy<strong>en</strong>s d’action dans tous les domaines, elle reste<br />
l’échelon territorial pertin<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> impulser les choix prioritaires, décider les<br />
acteurs à adopter un p<strong>la</strong>n stratégique de développem<strong>en</strong>t, à adhérer et à se<br />
mettre <strong>en</strong> mouvem<strong>en</strong>t. Elle le sera probablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core davantage par <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
qui lui sera dévolue à l’issue du nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation <strong>en</strong> chantier.<br />
Aussi <strong>la</strong> prospective <strong>2025</strong> proposée doit reposer sur les moy<strong>en</strong>s d’actions<br />
spécifiques qui sont ceux des schémas de développem<strong>en</strong>t dans tous les<br />
domaines concernés auxquels <strong>la</strong> Région participe, qu’ils <strong>en</strong> soi<strong>en</strong>t au stade de <strong>la</strong><br />
définition ou de <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre. Leur infléchissem<strong>en</strong>t peut interv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> cours<br />
de réalisation, dès lors qu’ils peuv<strong>en</strong>t être évalués.<br />
Elle doit ainsi développer et valoriser sa participation à des réflexions sur <strong>la</strong> mise<br />
<strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce et <strong>la</strong> redéfinition à v<strong>en</strong>ir de schémas (voire de nouvelles compét<strong>en</strong>ces<br />
issues du nouvel acte de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>tralisation) - SCORAN 5 , SRIT 6 , aménagem<strong>en</strong>t<br />
du territoire, SRCAE, SRCE, éoli<strong>en</strong>…, - saisir les opportunités des « révisions» de<br />
politiques contractuelles à v<strong>en</strong>ir – programmes europé<strong>en</strong>s, C8, CPER, contrats de<br />
territoires, Contrat 276…<br />
De même que chaque acteur doit être <strong>en</strong> capacité d’évaluer ses propres<br />
politiques d’interv<strong>en</strong>tion, avec des moy<strong>en</strong>s dédiés et précisés dès <strong>la</strong> définition<br />
d’une interv<strong>en</strong>tion ou d’un <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t contractuel, <strong>la</strong> question de<br />
l’é<strong>la</strong>rgissem<strong>en</strong>t de l’évaluation des politiques publiques aux différ<strong>en</strong>ts schémas<br />
régionaux est incontournable. Elle requiert une animation régulière par le chef de<br />
file ou par <strong>la</strong> Région qui peut s’emparer de cette prérogative. Le croisem<strong>en</strong>t<br />
d’analyse de tous les interv<strong>en</strong>ants à un schéma redouble son efficacité<br />
puisqu’elle donne lieu à des constats partagés par les acteurs. L’anticipation, les<br />
ambitions et les choix à opérer <strong>en</strong> sont d’autant plus facilem<strong>en</strong>t partagés eux<br />
aussi.<br />
Les différ<strong>en</strong>ts acteurs doiv<strong>en</strong>t saisir toutes les opportunités et préconisations qui<br />
sortiront des études du CESER à l’horizon de fin 2013 : le numérique <strong>en</strong> région,<br />
le projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>, les flux portuaires, le PRES, le tertiaire<br />
supérieur, l’éducation popu<strong>la</strong>ire, l’illettrisme.<br />
La Région doit par ailleurs pousser à faire partager des nouveaux indicateurs de<br />
mesure de <strong>la</strong> richesse régionale, complém<strong>en</strong>taires à celui du PIB <strong>en</strong> incluant les<br />
deux autres piliers du développem<strong>en</strong>t durable que sont le social et<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal <strong>pour</strong> faire pr<strong>en</strong>dre toute son importance à <strong>la</strong> mesure de <strong>la</strong><br />
qualité de vie sur le territoire lorsqu’il est question de qualifier <strong>la</strong> croissance<br />
régionale. Il s’agit notamm<strong>en</strong>t de l’indicateur de développem<strong>en</strong>t humain IDH,<br />
utilisé depuis les années 1990 par le Programme des Nations Unies <strong>pour</strong> le<br />
Développem<strong>en</strong>t, qui établit une moy<strong>en</strong>ne de trois indicateurs reflétant le niveau<br />
de vie, l’éducation et <strong>la</strong> santé. Une adaptation des données sources permet aussi<br />
5 SCORAN : Stratégie de Cohér<strong>en</strong>ce Régionale d’Aménagem<strong>en</strong>t Numérique <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
6 SRIT : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports<br />
Octobre 2012 24
Avis<br />
de comparer les territoires infrarégionaux <strong>en</strong>tre eux avec cette vision é<strong>la</strong>rgie de<br />
<strong>la</strong> « richesse », et montre que <strong>la</strong> région arrive au 18 ème rang sur les 22 régions<br />
alors qu’elle se situe au 6 ème rang <strong>pour</strong> le PIB par habitant <strong>en</strong> 2008 7 .<br />
Enfin, l’<strong>en</strong>semble des acteurs locaux doit assurer l’association <strong>en</strong> amont des<br />
popu<strong>la</strong>tions au déploiem<strong>en</strong>t de projets de territoires régionaux qui est souv<strong>en</strong>t<br />
gage de réussite.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où <strong>la</strong><br />
gouvernance se situe plutôt au niveau des territoires métropolitains, des<br />
agglomérations, des bassins de vie, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de réussir à agir de<br />
« concert <strong>en</strong>tre acteurs » du territoire <strong>pour</strong> limiter son appauvrissem<strong>en</strong>t et<br />
« maint<strong>en</strong>ir sa position re<strong>la</strong>tive ».<br />
Dans ce contexte, il convi<strong>en</strong>t de miser sur un « leadership régional » <strong>pour</strong><br />
conduire quelques projets de grande ampleur qui nécessiterai<strong>en</strong>t de mutualiser<br />
les ambitions. La collectivité régionale doit montrer une volonté accrue.<br />
Par ailleurs, « le chef de filât » unique est souv<strong>en</strong>t posé comme un postu<strong>la</strong>t. Mais<br />
il doit t<strong>en</strong>ir compte <strong>pour</strong> <strong>la</strong> réussite des projets des différ<strong>en</strong>ts acteurs concernés<br />
et de leurs échéances, qui ne sont pas forcém<strong>en</strong>t les mêmes. Le recul <strong>pour</strong><br />
assurer une vision globale est néanmoins nécessaire à l’échelle régionale et c’est<br />
ce rôle a minima qui doit être investi par <strong>la</strong> collectivité.<br />
7 Réf : ARF Janvier 2012 - Conseil Régional Nord–Pas de Ca<strong>la</strong>is « Développem<strong>en</strong>t durable : <strong>la</strong><br />
révolution des nouveaux indicateurs »<br />
Octobre 2012 25
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
ANNEXE : TABLEAU CROISANT LES HYPOTHESES PAR VARIABLE<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Politique<br />
générale<br />
régionale<br />
Transports et<br />
accessibilité<br />
régionale<br />
Accessibilité<br />
matérielle<br />
Accessibilité<br />
immatérielle<br />
Concurr<strong>en</strong>ce des<br />
territoires et règle<br />
du chacun <strong>pour</strong><br />
soi<br />
Accessibilité<br />
dégradée et<br />
mobilité réduite<br />
Territoire non<br />
couvert par le<br />
haut débit HD<br />
Gouvernance des<br />
villes et<br />
coopérations de<br />
proximité<br />
Accessibilité<br />
difficile faute de<br />
réalisation des<br />
grands projets<br />
Inégalités<br />
territoriales des<br />
couvertures <strong>en</strong> HD<br />
et THD<br />
Pouvoirs publics forts et coopérations<br />
régionales à l’échelle europé<strong>en</strong>ne<br />
Accessibilité<br />
améliorée et<br />
multimodalité.<br />
Flux innervant le<br />
territoire<br />
Equipem<strong>en</strong>t et<br />
usage du THD<br />
répandus sur tour<br />
le territoire<br />
Mobilité optimale,<br />
multimodalité<br />
réussie.<br />
Flux irrigant tout<br />
le territoire<br />
Avantage du THD<br />
et spécialisation<br />
régionale dans les<br />
e-services<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ECONOMIQUE<br />
SOCIAL<br />
Insertion Flux<br />
SOCIAL<br />
Formation<br />
Recherche<br />
Innovation<br />
Réduction des<br />
échanges.<br />
Poursuite désindustrialisations<br />
/délocalisations<br />
Insertion difficile.<br />
Précarisation et<br />
fuite de <strong>la</strong> main<br />
d’œuvre qualifiée<br />
Retards creusés<br />
et recul<br />
attractivité du<br />
supérieur<br />
Désindustrialisation<br />
et économie<br />
régionale<br />
traditionnelle <strong>en</strong><br />
souffrance<br />
Insertion difficile et<br />
fuite des jeunes<br />
diplômés<br />
Rattrapage des<br />
retards <strong>en</strong><br />
formation et<br />
recherche<br />
Mutation des<br />
secteurs<br />
traditionnels vers<br />
des activités <strong>en</strong><br />
émerg<strong>en</strong>ce<br />
Attractivité du<br />
territoire <strong>pour</strong> les<br />
actifs des régions<br />
voisines<br />
Réidustrialisation.<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
des secteurs clés<br />
porteurs.<br />
Attractivité<br />
internationale<br />
Flux <strong>en</strong>trant de<br />
main-d’oeuvre<br />
Attractivité r<strong>en</strong>forcée de l’offre de<br />
formation /recherche. Elévation des<br />
niveaux<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel<br />
SOCIAL<br />
Offre de soins<br />
ENVIRONNE-<br />
MENTAL<br />
Energies<br />
Environn<strong>en</strong>t<br />
Climat Risques<br />
Situation sanitaire<br />
dégradée.<br />
Aggravation des<br />
inégalités d’accès<br />
aux soins<br />
Repli sur habitudes<br />
de consommation<br />
énergétique,<br />
cloisonnem<strong>en</strong>t<br />
milieux naturels<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel <strong>en</strong> déclin<br />
retards régionaux<br />
importants se<br />
creus<strong>en</strong>t<br />
Emerg<strong>en</strong>ce d’une<br />
croissance verte,<br />
pas de restauration<br />
des équilibres des<br />
écosystèmes<br />
Initiatives portées<br />
par les territoires<br />
<strong>pour</strong> les publics de<br />
proximité<br />
Retards <strong>en</strong> cours de<br />
rattrapage, baisse<br />
des inégalités<br />
d’accès aux soins.<br />
E-médecine<br />
Innovation favorise<br />
<strong>la</strong> croissance verte.<br />
Biodiversité<br />
améliorée.<br />
Prév<strong>en</strong>tion<br />
généralisée. Recul<br />
des pathologies<br />
lourdes régionales<br />
Le durable est<br />
ancré dans les<br />
modes de consommation<br />
et les<br />
process industriels<br />
Id<strong>en</strong>tité du territoire et attractivité<br />
culturelle r<strong>en</strong>forcée<br />
La spirale<br />
du déclin<br />
Affaiblissem<strong>en</strong>t<br />
de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong><br />
Vers une <strong>Normandie</strong><br />
audacieuse et plus forte !<br />
La <strong>Normandie</strong> dans un<br />
contexte euphorique<br />
Octobre 2012 26
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
Octobre 2012 27
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
DÉCLARATION DE MESSIEURS PATRICK BARBOSA ET FRÉDÉRIC<br />
MALVAUD<br />
AU TITRE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS POUR LA PROTECTION DE LA<br />
NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT AYANT UN CHAMP D’ACTION<br />
DÉPARTEMENTAL OU RÉGIONAL SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Si le projet d’avis compte seize pages, nous nous cont<strong>en</strong>terons de réagir au<br />
cont<strong>en</strong>u des pages 5 et 6, qui symbolis<strong>en</strong>t <strong>la</strong> philosophie du docum<strong>en</strong>t.<br />
On comm<strong>en</strong>ce par nous dire que l’EPR de P<strong>en</strong>ly doit « générer des<br />
retombées économiques ». Effectivem<strong>en</strong>t, les sites nucléaires génèr<strong>en</strong>t des<br />
retombées. On le sait bi<strong>en</strong> à Fukushima et à Tchernobyl ; l’<strong>en</strong>nui est que ces<br />
retombées ne sont pas vraim<strong>en</strong>t économiques.<br />
Mais le plus problématique dans ce texte, on le trouve à <strong>la</strong> ligne 31 de <strong>la</strong> page<br />
5 où on lit : « L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’importer et d’exporter des flux de<br />
marchandises». Ainsi, on accompagne une politique de fuite <strong>en</strong> avant dans <strong>la</strong><br />
circu<strong>la</strong>tion folle des marchandises, politique qui a <strong>pour</strong> conséqu<strong>en</strong>ce une<br />
surexploitation de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète, avec surtout l’<strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t des plus riches, qui<br />
est <strong>en</strong> fait le vrai objectif, l’<strong>en</strong>jeu caché au mom<strong>en</strong>t où le véritable <strong>en</strong>jeu serait<br />
de relocaliser l’économie <strong>pour</strong> <strong>la</strong> mettre au service de tous.<br />
Et on continue dans <strong>la</strong> logique <strong>en</strong> écrivant quelques paragraphes plus loin : « Il<br />
s’agit de pouvoir faire <strong>en</strong>trer et sortir des flux justifiant des infrastructures qui<br />
devront alors être priorisées ». La boucle est bouclée, on passe d’une politique<br />
soit disant d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire <strong>pour</strong> faire <strong>en</strong> réalité une politique de<br />
« déménagem<strong>en</strong>t » du territoire, avec des infrastructures destructrices de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t.<br />
La suite est effectivem<strong>en</strong>t cohér<strong>en</strong>te lorsque l’on met <strong>en</strong> valeur « une offre de<br />
services tertiaires, <strong>la</strong> LNPN <strong>en</strong> construction, le contournem<strong>en</strong>t Est de Rou<strong>en</strong>, le<br />
développem<strong>en</strong>t de l’aéroport de Deauville et <strong>la</strong> facilité d’accès accrue à Roissy ».<br />
Ainsi, ce serait ce<strong>la</strong> le <strong>destin</strong> de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, rouler droit dans le<br />
mur <strong>en</strong> appuyant le plus fort possible sur l’accélérateur ? On peut ainsi garder le<br />
D et le D, mais ce ne sera pas <strong>pour</strong> Développem<strong>en</strong>t Durable, mais bi<strong>en</strong> <strong>pour</strong><br />
Destruction Durable.<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> mérite mieux que ce <strong>destin</strong>, qui du reste n’est pas un<br />
<strong>destin</strong>, mais bi<strong>en</strong> un choix délibéré que nous désapprouvons.<br />
En conséqu<strong>en</strong>ce, nous voterons contre ce projet d’avis.<br />
Octobre 2012 28
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
DÉCLARATION DE MADAME KATIA PLANQUOIS AU TITRE DE L’UNION<br />
RÉGIONALE DES SYNDICATS CFDT DE HAUTE-NORMANDIE SUR LE<br />
PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
A LA CFDT <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, nous avons fait le choix de créer une commission<br />
prospective car nous trouvons ess<strong>en</strong>tiel de savoir anticiper <strong>pour</strong> ne pas subir,<br />
nous faisons les mêmes préconisations que ce projet d’avis et nous avons défini<br />
des priorités et des axes de travail, et notre première priorité reste <strong>la</strong><br />
réindustrialisation de notre région <strong>en</strong> intégrant <strong>la</strong> qualité <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale et<br />
nous p<strong>en</strong>sons que le développem<strong>en</strong>t économique autour de l’Axe Seine sera au<br />
service de cette priorité.<br />
Nous devons veiller à ne pas <strong>la</strong>isser <strong>la</strong> recherche et le développem<strong>en</strong>t se<br />
délocaliser.<br />
A <strong>la</strong> CFDT nous p<strong>en</strong>sons égalem<strong>en</strong>t que <strong>la</strong> re<strong>la</strong>nce économique de notre région,<br />
ne se fera pas sans dialogue social, les sa<strong>la</strong>riés des <strong>en</strong>treprises ont des<br />
propositions à faire dans ce s<strong>en</strong>s et <strong>la</strong> CFDT r<strong>en</strong>ouvelle sa demande d’avoir une<br />
p<strong>la</strong>ce dans les pôles de compétitivité et de participer et pas seulem<strong>en</strong>t d’être<br />
consulter dans les différ<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>droits où l’on définit les stratégies industrielles.<br />
Octobre 2012 29
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR ALAIN GERBEAUD AU TITRE DU COMITE<br />
RÉGIONAL<br />
CGT DE NORMANDIE SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
L’av<strong>en</strong>ir ne se prévoit pas, il se prépare.<br />
Fondée sur des valeurs humanistes, <strong>la</strong> prospective territoriale a <strong>pour</strong> ambition<br />
d’explorer et d’interroger collectivem<strong>en</strong>t le futur des territoires.<br />
Elle ne cherche pas à prédire l’av<strong>en</strong>ir mais à le préparer, <strong>en</strong> offrant une p<strong>la</strong>ce,<br />
des marques et des responsabilités à ceux qui habit<strong>en</strong>t <strong>en</strong> territoire.<br />
Cette actualisation de l’étude prospective de 2004 « quel <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? » a été réalisée dans un contexte de crise de nos modèles<br />
(financiers, économiques et de gouvernances) avec des répercutions <strong>en</strong> région<br />
et <strong>en</strong> particulier sur <strong>la</strong> dégradation de l’emploi.<br />
Préparer l’av<strong>en</strong>ir c’est corriger ce qui a conduit à cette situation et d’apporter<br />
collectivem<strong>en</strong>t des propositions afin d’y remédier.<br />
Le scénario S3 reti<strong>en</strong>t plus particulièrem<strong>en</strong>t notre att<strong>en</strong>tion et apparaît réalisable,<br />
à <strong>la</strong> condition que tous les acteurs de notre région s’<strong>en</strong> saisiss<strong>en</strong>t.<br />
Si nous voulons « une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus forte » il faudra aller <strong>la</strong><br />
chercher <strong>en</strong> y associant sans discrimination les acteurs politiques, économiques,<br />
sociaux et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux.<br />
Le rapport repris dans l’avis développe des préconisations <strong>pour</strong> notre région <strong>en</strong><br />
ayant consci<strong>en</strong>ce qu’il ne faut pas att<strong>en</strong>dre une reprise mais agir dés maint<strong>en</strong>ant.<br />
La Région se doit d’anticiper et d’accélérer son action dans les secteurs qui sont<br />
de ses compét<strong>en</strong>ces et même au delà.<br />
Les hésitations sur certains grands projets et l’acte 3 de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>tralisation ne<br />
favoris<strong>en</strong>t pas <strong>la</strong> visibilité et ral<strong>en</strong>tiss<strong>en</strong>t les prises de décision.<br />
La réindustrialisassions de <strong>la</strong> région doit être au cœur d’une « <strong>Normandie</strong><br />
audacieuse et plus forte ». Ce<strong>la</strong> ne doit pas être un slogan mais se concrétiser<br />
par des investissem<strong>en</strong>ts, des emplois et du progrès social.<br />
Comm<strong>en</strong>t faire adhérer les Hauts Normands à cette ambition si comme ce<strong>la</strong> a été<br />
le cas ces dernières années les suppressions d’emplois et les fermetures de site<br />
de production se <strong>pour</strong>suiv<strong>en</strong>t ?<br />
Octobre 2012 30
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
Nous ne comm<strong>en</strong>terons pas l’avis ligne par ligne, il reflète dans son <strong>en</strong>semble les<br />
débats que nous avons eus dans <strong>la</strong> section. Si nous avions une tête de chapitre<br />
de l’avis à repr<strong>en</strong>dre ce serait « L’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong><br />
croissance » (page 7)<br />
Ce rapport a le mérite de porter au débat l’av<strong>en</strong>ir de notre territoire, nous<br />
adhérons à cette démarche.<br />
Le Groupe CGT émettra un avis favorable.<br />
Nous remercions tous ceux qui on contribué à ce rapport et <strong>en</strong> particulier <strong>la</strong><br />
présid<strong>en</strong>te, le rapporteur et <strong>la</strong> chargée de mission.<br />
Octobre 2012 31
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR ALAIN GOUSSAULT AU TTRE DE L’UNION<br />
RÉGIONALE DES ENTREPRISES D’INSERTION DE HAUTE-NORMANDIE<br />
SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Je ti<strong>en</strong>s ,tout d’abord, à souligner <strong>la</strong> qualité du raport et de l’Avis qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de<br />
nous être prés<strong>en</strong>tés.<br />
Le 2éme chapitre des préconisations de cet Avis a <strong>pour</strong> titre : « L’Humain, pilier<br />
du progrés et de <strong>la</strong> croissance ».Il propose à <strong>la</strong> Région d’<strong>en</strong>gager des actions<br />
fortes <strong>en</strong> terme d’insertion, de formation et de recherche. Au-delà de ces<br />
préconisations que je partage, je voudrais attirer votre att<strong>en</strong>tion sur le fait que<br />
l’Humain est une ressource éss<strong>en</strong>tielle <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble des chapitres suivants<br />
concernant le développem<strong>en</strong>t économique,l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> santé et <strong>la</strong><br />
culture,car Pilier du progrés et de <strong>la</strong> croissance dans tous ces domaines<br />
Le rapport sur l’éducation popu<strong>la</strong>ires apportera sa contribution <strong>pour</strong> rappeler <strong>la</strong><br />
nécessité d’activer, dans tous ces domaines des dynamiques d’éducation<br />
popu<strong>la</strong>ire <strong>pour</strong> permettre aux hauts-normands d’apporter, eux aussi, leur<br />
contribution à <strong>la</strong> question : <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> 2015 ?<br />
Dans le champs de l’économie sociale et solidaire, je suis témoin de <strong>la</strong> capacité<br />
« d’innovation sociale » des citoy<strong>en</strong>s quand on mobilise leur capital humain et<br />
social <strong>pour</strong> œuvrer à l’accés de tous aux droits de tous par <strong>la</strong> mobilisation de<br />
tous.<br />
De ce fait, je ne peux que partager <strong>la</strong> demande formulée dans le dernier chapître<br />
de cet Avis invitant <strong>la</strong> Région à mesurer l’évolution de <strong>la</strong> richesse de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong><br />
<strong>Normandie</strong> par les indicateurs du Développem<strong>en</strong>t<br />
Humain(IDH),complém<strong>en</strong>tairem<strong>en</strong>t à celui du Produit Intérieur Brut(PIB).<br />
Le CESER doit non seulem<strong>en</strong>t inviter <strong>la</strong> Région, mais il doit être actif <strong>pour</strong> que<br />
l’IDH devi<strong>en</strong>ne une mesure de <strong>la</strong> croissance régionale.<br />
Pour ce faire, d’une part je réitére ma proposition que le CESER organise une<br />
confér<strong>en</strong>ce sur les nouveaux indicateurs de richesse <strong>pour</strong> s<strong>en</strong>sibiliser et informer<br />
les m<strong>en</strong>bres du CESER, les élus régionaux et les responsables administratifs de <strong>la</strong><br />
Région. D’autre part, le CESER doit faires des propositions concrétes à <strong>la</strong> Région<br />
<strong>pour</strong> qu’elle <strong>en</strong>gage, à l’exemple de <strong>la</strong> Région Nord Pas de Ca<strong>la</strong>is et Pays de<br />
Loire, <strong>la</strong> démarche de construction d’indicateurs de Développem<strong>en</strong>t Humain <strong>pour</strong><br />
mesurer <strong>la</strong> croissance régionale<br />
Nous ne devons pas seulem<strong>en</strong>t être force de propositions, mais être pro-actif sur<br />
cette question.<br />
Octobre 2012 32
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR DIDIER PATTE AU TITRE DES<br />
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Monsieur le Présid<strong>en</strong>t,<br />
Je ne voterai pas ce projet d’avis.<br />
Pour deux raisons :<br />
L’une, fondam<strong>en</strong>tale, et que j’ai déjà exprimée dans cette <strong>en</strong>ceinte…. L’autre <strong>en</strong><br />
raison de son inopportunité.<br />
1. Je ne voterai jamais un avis partant du présupposé du mainti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> division<br />
normande. Soit que l’exercice <strong>en</strong> soit vain si les déc<strong>en</strong>nies à v<strong>en</strong>ir voit se<br />
réaliser <strong>la</strong> réunification de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong>. Soit que <strong>la</strong> division normande<br />
perdure et, dans ce cas, le <strong>destin</strong> de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> est compromis et on ne<br />
fait que tirer des p<strong>la</strong>ns sur <strong>la</strong> comète.<br />
2. Cette étude est inopportune –et ce n’est pas <strong>la</strong> faute des membres de <strong>la</strong> 6 ème<br />
commission et de <strong>la</strong> section. En effet, depuis quelques mois, <strong>la</strong> stratégie<br />
développée par <strong>la</strong> Région est obscure, inaudible, incohér<strong>en</strong>te.<br />
La remise <strong>en</strong> cause, plus ou moins masquée, du développem<strong>en</strong>t de l’Axe Seine et<br />
de son projet structurant de <strong>la</strong> Ligne Nouvelle Paris <strong>Normandie</strong>, n’aboutit <strong>en</strong><br />
réalité, qu’à une perspective de développem<strong>en</strong>t anémiée au fil de l’eau. Je ne<br />
crois pas que le <strong>destin</strong> des rats crevés soit une perspective structurante.<br />
Je regrette que le travail –remarquable <strong>en</strong> demeurant- de nos collègues, avec les<br />
différ<strong>en</strong>ts scénarii évoqués soit ainsi annihilé. Il méritait mieux.<br />
Je voterai contre ce texte, dont les prémisses sont ainsi faussés et fre<strong>la</strong>tés.<br />
Octobre 2012 33
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR JACQUES BRIFAULT AU TITRE DES<br />
PERSONNALITÉS QUALIFÉES SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Mr le Présid<strong>en</strong>t,<br />
Je ti<strong>en</strong>s à saluer le formidable travail qui a été réalisé et je voudrais insister sur<br />
deux des conditions de <strong>la</strong> réussite des 2 sc<strong>en</strong>arii prés<strong>en</strong>tés.<br />
La première est <strong>la</strong> puissance de l'innovation et de <strong>la</strong> recherche dans les filières<br />
<strong>pour</strong> permettre le développem<strong>en</strong>t des projets porteurs et différ<strong>en</strong>ciant, d'où <strong>la</strong><br />
nécessité d'un PRES Normand qui serait <strong>en</strong> quelque sorte <strong>la</strong> vitrine de cette<br />
puissance innovante. Je parle bi<strong>en</strong> d'un PRES vitrine.<br />
La deuxième est le développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> mobilité. Tant de projet sont inscrit dans<br />
cette thématique ! La Région doit se doter des moy<strong>en</strong>s lui permettant de ne pas<br />
risquer le déclin <strong>en</strong> <strong>la</strong> matière.<br />
Le gros risque est une Région prud<strong>en</strong>te qui aurait insuffisamm<strong>en</strong>t anticipé le<br />
retour de <strong>la</strong> stabilité et de <strong>la</strong> croissance même si ce<strong>la</strong> se produit d'ici à 10 ans.<br />
En l'occurr<strong>en</strong>ce, le bon choix dont a parlé <strong>la</strong> Présid<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> Section ne serait<br />
sûrem<strong>en</strong>t pas <strong>la</strong> prud<strong>en</strong>ce...<br />
Octobre 2012 34
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR DANIEL MARIE AU TITRE DE L’UNION<br />
SYNDICALE SOLIDAIRE DE HAUTE-NORMANDIE SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Nous respectons le bon travail qui a été effectué, on y voit une grande difficulté à<br />
s'extraire du matraquage à pousser certains projets et mettre <strong>en</strong> avant certaines<br />
choses sur <strong>la</strong> région.<br />
Je rejoins l'analyse <strong>en</strong> partie de mes amis <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>talistes et je ne voterai<br />
pas cet avis.<br />
Octobre 2012 35
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR PATRICK DEVIS AU TITRE DES UNIONS<br />
DÉPARTEMENTALES DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DE LA SEINE-<br />
MARITIME ET DE L’EURE SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Dans un contexte de crise financière, il faut plus que jamais regarder le prés<strong>en</strong>t,<br />
sans concession et savoir utiliser ces observations.<br />
Chercher les chemins du possible ? C’est faire de <strong>la</strong> prospective.<br />
Certes, mais ce peut être insuffisant….<br />
Il faut oser les solutions de l’impossible, oser le dépassem<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> un mot, il faut<br />
oser l’av<strong>en</strong>ir !<br />
Ne jamais perdre de vue que l’économie doit être au service de l’homme et non<br />
l’inverse.<br />
Il est grand temps de remettre l’humain au cœur de l’av<strong>en</strong>ir de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>, d’affirmer ses valeurs, notre attachem<strong>en</strong>t au progrès et à <strong>la</strong> justice<br />
sociale.<br />
Cet avis reflète nos longs débats <strong>en</strong> section prospective.<br />
En conclusion, Force Ouvrière, votera ce projet d’avis.<br />
Octobre 2012 36
Déc<strong>la</strong>rations des groupes<br />
DÉCLARATION DE MONSIEUR DOMINIQUE PIEROTTI AU TITRE DU<br />
MEDEF ET DES BRANCHES PROFESSIONNELLES DU SECTEUR<br />
INDUSTRIEL (UIMM, UIC/ARNIP, UFIP) SUR LE PROJET D’AVIS<br />
« QUEL DESTIN POUR LA HAUTE-NORMANDIE EN <strong>2025</strong> ? »<br />
Je revi<strong>en</strong>s sur ce qui a été dit tout à l'heure par certains de nos collègues, à<br />
propos d'un retour à une économie qui serait ce que j'appellerais une « économie<br />
de voisinage ».<br />
Pour moi, c'est un repli complet sur une forme d'autarcie à une époque où on a<br />
une crise majeure de l'emploi <strong>en</strong> France et <strong>en</strong> Europe, ce sont des pans <strong>en</strong>tiers<br />
d'activité qui disparaîtrai<strong>en</strong>t si on arrivait à ce g<strong>en</strong>re de société rivée par<br />
certains de nos collègues.<br />
Je suis très inquiet qu'il y ait des g<strong>en</strong>s <strong>en</strong>core qui p<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t qu'on puisse vivre de<br />
cette façon-là avec un circuit court d'une manière généralisée.<br />
Bi<strong>en</strong> sûr, que <strong>pour</strong> certains circuits courts de produits, produits de <strong>la</strong> terre<br />
notamm<strong>en</strong>t, il y a des tas de démarches très intéressantes, mais ram<strong>en</strong>er une<br />
économie générale et mondiale à ce type de société, att<strong>en</strong>dez, on marche sur <strong>la</strong><br />
tête !<br />
Je ne peux pas m'empêcher d'interv<strong>en</strong>ir là-dessus, parce que je suis très inquiet<br />
qu'il y ait des g<strong>en</strong>s qui p<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core comme ce<strong>la</strong>.<br />
Octobre 2012 37
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 38
Rapport<br />
Rapport<br />
<strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 39
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 40
Avant propos<br />
Avant propos<br />
C’est une véritable gageure de persister dans une <strong>en</strong>treprise de réflexion<br />
prospective. C’est avant tout un exercice intellectuel qui ne doit pas t<strong>en</strong>ir compte<br />
de tout ce qui est organisé, conv<strong>en</strong>u, radical ou modélisé. Avec le temps,<br />
l’<strong>en</strong>trainem<strong>en</strong>t acquis lors les précéd<strong>en</strong>ts travaux, <strong>la</strong> section s’y est livré avec<br />
<strong>en</strong>thousiasme.<br />
Comm<strong>en</strong>t s<strong>en</strong>tir ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui <strong>pour</strong>rait se passer ?<br />
Comm<strong>en</strong>t séparer notre histoire régionale de celle des autres ? Comm<strong>en</strong>t<br />
pr<strong>en</strong>dre de <strong>la</strong> hauteur, du recul, de <strong>la</strong> distance ? Comm<strong>en</strong>t changer notre<br />
regard ? Comm<strong>en</strong>t ne pas se <strong>la</strong>isser emporter par l’immédiat ou le quotidi<strong>en</strong> ?<br />
Dans un monde où tout va de plus <strong>en</strong> plus vite, nos interprétations, nos<br />
conclusions, notre jugem<strong>en</strong>t ont t<strong>en</strong>dance à aller vers une simplification alors<br />
qu’il peut y avoir plusieurs interprétations possibles, même celles qui sont<br />
complexes et celles que l’on n’apprécie pas. Nous avons t<strong>en</strong>té de pr<strong>en</strong>dre du<br />
recul <strong>pour</strong> ouvrir des possibilités et notre horizon afin de ne pas être surpris <strong>pour</strong><br />
moins subir.<br />
Ces travaux ont été m<strong>en</strong>és dans le contexte particulièrem<strong>en</strong>t instable d’une crise<br />
systémique à plusieurs épisodes, d’une campagne électorale nationale et d’une<br />
réforme territoriale annoncée.<br />
Cette crise a c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce un problème ess<strong>en</strong>tiel qui se pose <strong>pour</strong><br />
<strong>la</strong> survie du projet europé<strong>en</strong> lui-même: "qui dicte les lois et qui a le dernier<br />
mot?" La société civile europé<strong>en</strong>ne a c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t compris le risque que ce ne soit<br />
plus les gouvernem<strong>en</strong>ts élus qui ai<strong>en</strong>t le contrôle de <strong>la</strong> situation, mais des <strong>en</strong>tités<br />
non élues qui se substitu<strong>en</strong>t à eux. Ainsi, il existe une m<strong>en</strong>ace non seulem<strong>en</strong>t<br />
<strong>pour</strong> <strong>la</strong> légitimité des gouvernem<strong>en</strong>ts, mais aussi <strong>pour</strong> <strong>la</strong> survie du processus<br />
démocratique.<br />
Avec cette conjoncture <strong>en</strong> toile de fond, <strong>la</strong> section prospective s’est astreinte à<br />
repérer et à afficher quelles ambitions peuv<strong>en</strong>t porter les acteurs, au premier<br />
rang desquels <strong>la</strong> Région, <strong>pour</strong> être, à l’horizon <strong>2025</strong>, à <strong>la</strong> hauteur des <strong>en</strong>jeux du<br />
dynamisme territorial défini comme le développem<strong>en</strong>t du territoire équilibré et<br />
respectueux de <strong>la</strong> qualité de vie.<br />
C’est au travers de docum<strong>en</strong>ts stratégiques dont dispose déjà <strong>la</strong> collectivité<br />
régionale, de l’é<strong>la</strong>boration de différ<strong>en</strong>ts schémas auxquels elle participe sur<br />
nombre de ses compét<strong>en</strong>ces propres et dans des domaines de compét<strong>en</strong>ces<br />
partagées qu’elle peut dégager les moy<strong>en</strong>s d’action qui nécessiteront d’infléchir,<br />
le cas échéant, le déroulem<strong>en</strong>t de certains schémas ou de peser sur les<br />
ori<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> cours d’é<strong>la</strong>boration.<br />
Les différ<strong>en</strong>ts travaux m<strong>en</strong>és dans le cadre des avis r<strong>en</strong>dus précédemm<strong>en</strong>t,<br />
notamm<strong>en</strong>t sur « les infrastructures », sur « <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce de l’aménagem<strong>en</strong>t<br />
des territoires », sur « <strong>la</strong> mobilité généralisée <strong>en</strong> 2050 », sur « les <strong>en</strong>jeux de <strong>la</strong><br />
LNPN », ont été d’un apport précieux. Mais c’est surtout l’expertise interne, <strong>la</strong><br />
pertin<strong>en</strong>ce des réflexions des membres de <strong>la</strong> section et les apports des<br />
personnalités extérieures qui se sont avérés ess<strong>en</strong>tiels.<br />
Plus qu’un exercice d’actualisation des rapports de 2004 et 2006, <strong>la</strong> section<br />
prospective propose dans ce rapport une refonte dans l’approche de <strong>la</strong> question<br />
« quel <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? ».<br />
Octobre 2012 41
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 42
Introduction<br />
Introduction<br />
CADRAGE DE L’ETUDE<br />
I - Le temps d’un nouvel exercice prospectif<br />
II - Le cahier des charges<br />
LES CHOIX METHODOLOGIQUES<br />
I - La redéfinition du système étudié<br />
II - Phase I : prospective exploratoire<br />
III - Phase II : prospective stratégique<br />
SCHEMA METHODOLOGIQUE RESUME<br />
Octobre 2012 43
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
CADRAGE DE L’ETUDE<br />
La commission du CESER <strong>en</strong> charge de <strong>la</strong> prospective a réalisé <strong>en</strong> 2004 une<br />
étude prospective du positionnem<strong>en</strong>t géostratégique de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
intitulée « <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? », dans le cadre d’une<br />
auto saisine sur l’attractivité de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
Le sc<strong>en</strong>ario dit du « dynamisme conquérant » 8 avait été ret<strong>en</strong>u comme le plus<br />
souhaitable, proposant des objectifs ambitieux à long terme mais néanmoins<br />
accessibles par une volonté forte et perman<strong>en</strong>te de tous les acteurs de <strong>la</strong> vie<br />
régionale.<br />
Les propositions du CESER consistai<strong>en</strong>t à id<strong>en</strong>tifier les conditions de réalisation<br />
de ce sc<strong>en</strong>ario, ainsi que les écueils à éviter <strong>pour</strong> limiter les conséqu<strong>en</strong>ces<br />
négatives des autres sc<strong>en</strong>arii.<br />
Ces propositions ont été actualisées une première fois <strong>en</strong> 2006 <strong>pour</strong> 2 raisons :<br />
• il était press<strong>en</strong>ti des signes d’évolution suffisamm<strong>en</strong>t significatifs et favorables<br />
sur <strong>la</strong> majorité des variables étudiées <strong>en</strong> 2004, ce qui s’est avéré à l’exam<strong>en</strong><br />
malgré le faible recul. Toutefois, des points de nécessaire vigi<strong>la</strong>nce sont<br />
apparus <strong>en</strong> matière d’accessibilité régionale dégradée et de démographie<br />
critique <strong>en</strong> raison de flux migratoires défavorables.<br />
• les coopérations s’étai<strong>en</strong>t int<strong>en</strong>sifiées à une <strong>la</strong>rge échelle, europé<strong>en</strong>ne<br />
(Manche-Mer du Nord –Baltique et au sein de l’espace Arc Manche), <strong>en</strong>tre les<br />
deux Conseils régionaux ; <strong>la</strong> gouvernance avait progressé avec les différ<strong>en</strong>ts<br />
schémas é<strong>la</strong>borés par <strong>la</strong> Région, les coopérations dans le cadre du « 276 »,<br />
l’essor des Pays et des intercommunalités.<br />
Avec le SRADT qui al<strong>la</strong>it voir le jour fin 2006, les conditions étai<strong>en</strong>t réunies <strong>pour</strong><br />
aller vers un projet régional qui serait partagé du fait de <strong>la</strong> <strong>la</strong>rge consultation<br />
<strong>la</strong>ncée.<br />
La région était <strong>en</strong> mesure de s’acheminer d’un sc<strong>en</strong>ario t<strong>en</strong>danciel «Au fil de<br />
l’eau », vers des sc<strong>en</strong>arios plus ambitieux <strong>pour</strong> le territoire haut-normand :<br />
sc<strong>en</strong>ario de «l’Audace raisonnée», <strong>en</strong> étape intermédiaire, <strong>la</strong> cible à l’horizon<br />
<strong>2025</strong> étant plus que jamais celle du «Dynamisme conquérant».<br />
8 Résumé du sc<strong>en</strong>ario « dynamisme conquérant » de 2004 :<br />
Le prés<strong>en</strong>t <strong>2025</strong> haut-normand le plus favorable s’é<strong>la</strong>borera à partir d’une vision à long terme, par<br />
<strong>la</strong> volonté, <strong>la</strong> gouvernance, l’innovation et l’esprit de réseau<br />
Les facteurs déterminants du « dynamisme conquérant » sont l’ouverture stratégique et le<br />
développem<strong>en</strong>t durable, avec deux étapes-clés: d’une part, <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d’une réflexion<br />
stratégique globale sur le long terme; d’autre part, <strong>la</strong> transformation de l’outil Port 2000 <strong>en</strong> un<br />
projet d’aménagem<strong>en</strong>t et de développem<strong>en</strong>t régional.<br />
Ce sc<strong>en</strong>ario recoupe des élém<strong>en</strong>ts de <strong>la</strong> situation régionale <strong>en</strong> 2004 : début d’ouverture stratégique<br />
sur l’Arc Manche, exam<strong>en</strong> des opportunités de rapprochem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>Haute</strong> et Basse-<strong>Normandie</strong> et<br />
ouverture sur les deux départem<strong>en</strong>ts 76 et 27 ; mise <strong>en</strong> œuvre de Port 2000 et réflexion sur <strong>la</strong><br />
logistique ; amorce d’un projet régional articulé sur les pays et les agglomérations ; souci du<br />
rayonnem<strong>en</strong>t régional et du développem<strong>en</strong>t durable avec <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre de l’Ag<strong>en</strong>da 21 au<br />
niveau régional ; aspiration des acteurs économiques et sociaux à <strong>la</strong> définition d’un projet régional<br />
global et partagé.<br />
Octobre 2012 44
Introduction<br />
I -<br />
Le temps d’un nouvel exercice prospectif<br />
La courte période 2004-2011 a été jalonnée de faits marquants qui impact<strong>en</strong>t<br />
l’av<strong>en</strong>ir de <strong>la</strong> région. Ils nécessit<strong>en</strong>t de se p<strong>en</strong>cher à nouveau sur les hypothèses<br />
d’une prise <strong>en</strong> main de son « <strong>destin</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> » et sur les capacités à <strong>la</strong><br />
disposition des acteurs régionaux, compte t<strong>en</strong>u des variables influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong><br />
position géostratégique de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> actuellem<strong>en</strong>t. Le temps d’un<br />
nouvel exercice prospectif est v<strong>en</strong>u.<br />
La période 2004-2011 s’est caractérisée par une gouvernance r<strong>en</strong>ouvelée :<br />
• <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre de <strong>la</strong> stratégie d’aménagem<strong>en</strong>t et de développem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> à l’horizon 2015, décidée <strong>en</strong> 2006 dans le cadre du SRADT ;<br />
• le poids des ori<strong>en</strong>tations définissant les négociations des différ<strong>en</strong>ts contrats<br />
passés par <strong>la</strong> collectivité régionale <strong>en</strong> son nom, ou <strong>en</strong> tant que chef de file,<br />
avec ses part<strong>en</strong>aires (l’État, Union Europé<strong>en</strong>ne) ou avec l’<strong>en</strong>semble des<br />
territoires (Départem<strong>en</strong>ts 276, pays, agglomérations, régions voisines, Basse-<br />
<strong>Normandie</strong> ou régions du bassin parisi<strong>en</strong>…) et dont certains vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong>tôt à<br />
échéance ;<br />
• des schémas opérationnels déclinés à partir des objectifs stratégiques du<br />
SRADT et r<strong>en</strong>ouvelés <strong>pour</strong> certains dans un cadre part<strong>en</strong>arial rénové très<br />
récemm<strong>en</strong>t (SRDE puis CRDE, PRDF puis CPRDF, éoli<strong>en</strong>, dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts,<br />
infrastructures et transports) ;<br />
• l’émerg<strong>en</strong>ce du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong> d’<strong>en</strong>vergure nationale et<br />
internationale,<br />
mais aussi par des élém<strong>en</strong>ts de contexte impactant les politiques publiques et <strong>la</strong><br />
situation des ag<strong>en</strong>ts économiques :<br />
• un contexte de crise économique majeure qui, s’il n’est pas propre à <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>, affecte différemm<strong>en</strong>t chaque territoire selon les spécificités<br />
propres de ses caractéristiques économiques, sociales, démographiques,<br />
culturelles…<br />
• <strong>en</strong>fin un contexte institutionnel caractérisé par des incertitudes liées aux<br />
réformes de l’organisation institutionnelle territoriale et à une nouvelle<br />
répartition possible des compét<strong>en</strong>ces.<br />
L’année 2011 est donc apparue propice à une actualisation de l’exercice<br />
prospectif de 2004. Il s’agit de réexaminer les hypothèses d’évolutions des<br />
variables d’influ<strong>en</strong>ce du « dynamisme territorial régional » par rapport à ces<br />
réc<strong>en</strong>tes évolutions et de ba<strong>la</strong>yer de nouveau les <strong>en</strong>jeux et défis à relever.<br />
Cet exercice intervi<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t au mom<strong>en</strong>t où les grandes ori<strong>en</strong>tations et les<br />
axes de <strong>la</strong> stratégie de développem<strong>en</strong>t du territoire vont devoir être réinterrogés,<br />
à l’aube d’une nouvelle période de contractualisation europé<strong>en</strong>ne, nationale et<br />
infrarégionale empreinte elle-même des effets de <strong>la</strong> nouvelle donne économique<br />
internationale.<br />
Cet exercice porte les grandes interrogations qui sont celles de <strong>la</strong> société civile<br />
même si le cons<strong>en</strong>sus sur <strong>la</strong> vision d’av<strong>en</strong>ir du territoire n’est pas chose acquise.<br />
Il contribue à apporter des éc<strong>la</strong>irages et à attirer l’att<strong>en</strong>tion sur <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce à<br />
avoir sur certains sujets dont les points de rupture peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>traîner des<br />
« av<strong>en</strong>irs » différ<strong>en</strong>ts.<br />
Octobre 2012 45
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
II - Le cahier des charges 9<br />
Avec un horizon temporel inchangé, <strong>2025</strong>, l’exercice consiste à actualiser les<br />
propositions de 2004 :<br />
o<br />
o<br />
o<br />
<strong>en</strong> se livrant à un nouvel exercice de prospective exploratoire, autour d’un<br />
système dont les variables sont repositionnées, quant à leur degré<br />
d’influ<strong>en</strong>ce et <strong>en</strong>richies par de nouvelles occurr<strong>en</strong>ces ;<br />
<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tifiant les principaux traits d’un sc<strong>en</strong>ario réaliste, atteignable <strong>en</strong><br />
<strong>2025</strong>, qui affirme au mieux dans le contexte qui l’<strong>en</strong>toure les pot<strong>en</strong>tialités<br />
de développem<strong>en</strong>t du territoire équilibré et respectueux de <strong>la</strong> qualité de<br />
vie ;<br />
<strong>en</strong> l’accompagnant d’une prospective stratégique visant à asseoir les<br />
préconisations sur les axes opérationnels ou contractuels d’interv<strong>en</strong>tion de<br />
<strong>la</strong> Région.<br />
LES CHOIX METHODOLOGIQUES<br />
I -<br />
La redéfinition du système étudié<br />
Le système étudié- <strong>la</strong> position géostratégique de <strong>la</strong> région à l’horizon <strong>2025</strong> - est<br />
sous l’influ<strong>en</strong>ce de variables qui <strong>en</strong> constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> base prospective.<br />
La construction de <strong>la</strong> base prospective, consistant à déterminer le système étudié<br />
et à repérer les variables clés, a été réalisée <strong>en</strong> 2004. Mais, il est apparu<br />
ess<strong>en</strong>tiel de redéfinir cette base dans le contexte de 2012 <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>richir et <strong>pour</strong><br />
<strong>en</strong> id<strong>en</strong>tifier les « variables clés ».<br />
I.1. – Le positionnem<strong>en</strong>t des variables de 2004<br />
Les variables id<strong>en</strong>tifiées <strong>en</strong> 2004 sont réinterrogées quant à leur niveau d’impact<br />
et leur degré d’incertitude à l’horizon <strong>2025</strong> sur <strong>la</strong> position géostratégique de <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>. Lorsque l’impact est moy<strong>en</strong> à fort et l’incertitude sur leur<br />
évolution moy<strong>en</strong>ne à élevée (<strong>en</strong> orange sur le schéma) ou lorsque l’impact et<br />
l’incertitude sont élevés (<strong>en</strong> rouge), les hypothèses d’évolutions seront<br />
contrastées et <strong>pour</strong>ront donner lieu à des sc<strong>en</strong>arii différ<strong>en</strong>ciés.<br />
Impact sur <strong>la</strong> position géostratégique<br />
de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
fort<br />
moy<strong>en</strong><br />
faible<br />
T<strong>en</strong>dance<br />
lourde<br />
Incertitude<br />
Rupture<br />
critique<br />
majeure<br />
Toile de fond<br />
Germe de changem<strong>en</strong>t<br />
secondaire<br />
faible moy<strong>en</strong>ne élevée<br />
Incertitude sur leur évolution<br />
9 Le cahier des charges de l’étude validé par le Bureau du CESER le 24 mai 2011 est annexé au<br />
prés<strong>en</strong>t docum<strong>en</strong>t.<br />
Octobre 2012 46
Introduction<br />
II.2. – Le « système à étudier » <strong>en</strong> 2012<br />
des sous variables<br />
ou<br />
de nouvelles variables<br />
sont id<strong>en</strong>tifiées le cas échéant, rec<strong>la</strong>ssées.<br />
Le système à étudier<br />
tel qu’il apparaît<br />
<strong>en</strong> 2012<br />
est redéfini<br />
Environnem<strong>en</strong>t global<br />
Eco système – Système intermédiaire<br />
La position<br />
géostratégique de <strong>la</strong><br />
région <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
(Modèle de schéma : travaux de N. Bassaler, consultante experte <strong>en</strong> prospective, conseillère<br />
sci<strong>en</strong>tifique à Futuribles et F. Bourse, directeur d’études au GERPA-groupe d’études ressources<br />
prospective aménagem<strong>en</strong>t- et <strong>en</strong>seignant chercheur au Lipsor(CNAM)<br />
Les « variables clés de 2012 » sont id<strong>en</strong>tifiées. Après positionnem<strong>en</strong>t des<br />
nouvelles variables selon le même principe d’incertitude et d’impact, celles qui<br />
port<strong>en</strong>t <strong>en</strong> elles des incertitudes majeures ou qui jou<strong>en</strong>t le plus grand rôle sont<br />
mises <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce.<br />
II -<br />
Phase I: prospective exploratoire<br />
Il s’agit de répondre aux deux questions suivantes : Où <strong>en</strong> est-on ? Que<br />
peut-il adv<strong>en</strong>ir ?<br />
II.1. – Analyse dynamique de chaque variable 10<br />
Une « fiche variable » permet de définir <strong>la</strong> variable, d’<strong>en</strong> donner les indicateurs<br />
de mesure pertin<strong>en</strong>ts. Elle caractérise <strong>en</strong>suite <strong>la</strong> situation actuelle de <strong>la</strong> variable<br />
à partir d’une analyse rétrospective. Cette phase permet de dresser le constat<br />
sur l’évolution de <strong>la</strong> variable, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre 2004 et 2012.<br />
10 Ce corpus d’hypothèses a été bâti à <strong>la</strong> suite de l’audition par <strong>la</strong> section d’un <strong>en</strong>semble d’experts<br />
choisis <strong>en</strong> fonction de leur domaine d’exercice et de compét<strong>en</strong>ces et de l’éc<strong>la</strong>irage dont <strong>la</strong> section<br />
avait le plus besoin sur telle ou telle variable. Le recueil des avis des experts auditionnés a porté<br />
sur leur appréh<strong>en</strong>sion de l’évolution des variables et leur projection à <strong>2025</strong>.<br />
La liste des personnes auditionnées est jointe <strong>en</strong> annexe.<br />
Octobre 2012 47
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
La grille de questionnem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> fabriquer les hypothèses, ou « filtre à<br />
hypothèses » :<br />
Ces évolutions ont-elles été subies ou voulues ? La réponse à cette question<br />
indique ou valide s’il y a des leviers d’action sur les variables.<br />
La référ<strong>en</strong>ce aux propositions émises <strong>en</strong> 2004 et <strong>en</strong> 2006 et leur comparaison a<br />
servi, dans ce questionnem<strong>en</strong>t, <strong>pour</strong> évaluer <strong>en</strong> quoi les évolutions étai<strong>en</strong>t le<br />
résultat d’une action.<br />
Que peut-il adv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? Comm<strong>en</strong>t peut évoluer <strong>la</strong> variable ? La réponse<br />
à cette question permet d’id<strong>en</strong>tifier les principaux élém<strong>en</strong>ts de rupture propres à<br />
<strong>la</strong> variable <strong>en</strong> fonction de l’analyse rétrospective et des t<strong>en</strong>dances fortes qui s’<strong>en</strong><br />
dégag<strong>en</strong>t.<br />
<strong>Quel</strong>les hypothèses « probables » doit-on formuler <strong>en</strong> 2012 <strong>pour</strong> <strong>2025</strong> ? La<br />
réponse à cette question permet de dresser une grille d’hypothèses d’évolutions<br />
<strong>pour</strong> chaque variable.<br />
La section a « interrogé » chacune des variables à l’aide d’un questionnem<strong>en</strong>t<br />
autour de 2 axes discriminants :<br />
o l’int<strong>en</strong>sité de <strong>la</strong> « qualité de vie », dont le bi<strong>en</strong>-être est une des<br />
composantes,<br />
o l’int<strong>en</strong>sité du dynamisme du territoire.<br />
Dans chacun des quadrants,<br />
le croisem<strong>en</strong>t de ces 2 critères<br />
s’apprécie :<br />
o du point de vue de l’individu<br />
o du point de vue collectif<br />
Décroissance éco<br />
Cocooning – <strong>en</strong>tre soi<br />
Qualité de vie<br />
croissance éco<br />
Attractivité<br />
Immobilisme Le collectif Dynamisme<br />
Récession<br />
Fuite – répulsion<br />
L’individu<br />
tyrannie des marchés<br />
consumérisme<br />
Octobre 2012 48
Introduction<br />
Ce questionnem<strong>en</strong>t aboutit à des hypothèses qui coll<strong>en</strong>t autant que faire se peut<br />
à <strong>la</strong> réalité régionale <strong>pour</strong> garder comme objectif de corriger les retards ou les<br />
manques de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, a minima de réduire les déséquilibres actuels<br />
et de proposer des options ambitieuses <strong>pour</strong> un dynamisme et une qualité de vie<br />
<strong>pour</strong> tous sur tout le territoire.<br />
II.2. – Les futurs possibles <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
Les hypothèses d’évolutions de chacune des variables ont été croisées et ont<br />
alim<strong>en</strong>té <strong>la</strong> construction de quatre sc<strong>en</strong>arii. Deux d’<strong>en</strong>tre eux ont été ret<strong>en</strong>us <strong>en</strong><br />
raison de leur caractère probable ou souhaitable <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
Les principaux <strong>en</strong>jeux ou les points de rupture qu’ils comport<strong>en</strong>t sont id<strong>en</strong>tifiés<br />
de même que le degré de marge de manœuvre, <strong>pour</strong> servir d’appui à <strong>la</strong> phase de<br />
prospective stratégique qui suit.<br />
III - Phase II : prospective stratégique<br />
Il s’agit de répondre à <strong>la</strong> question : Que puis-je faire ?<br />
…<strong>pour</strong> suivre le chemin « possible » <strong>pour</strong> <strong>2025</strong> du <strong>destin</strong> souhaitable <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
La prolongation de l’étude <strong>en</strong> 2012 vise à formuler des propositions ou<br />
préconisations ou pistes d’action <strong>pour</strong> <strong>la</strong> Région, <strong>pour</strong> atteindre le sc<strong>en</strong>ario choisi,<br />
avec une approche opérationnelle des actions à mettre <strong>en</strong> œuvre.<br />
Octobre 2012 49
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
SCHEMA METHODOLOGIQUE RESUME<br />
« <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
<strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? »<br />
Phase I<br />
2004<br />
Où <strong>en</strong> est-on ? Que peut-il adv<strong>en</strong>ir ?<br />
2012<br />
Etape 1 Positionnem<strong>en</strong>t des variables 2004<br />
V1 à V6 sur un axe d’incertitude et d’impact<br />
Etape 2<br />
Les nouvelles variables à explorer<br />
« les variables clés <strong>en</strong> 2012» et le système étudié :<br />
V1<br />
La position géostratégique<br />
de <strong>la</strong> région <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
Vn<br />
V6<br />
Etape 3<br />
Analyse dynamique de chaque variable<br />
3.1 - Bi<strong>la</strong>n 2004 – 2011 : V1 V6 Vn<br />
Où <strong>en</strong> est-on aujourd’hui ?<br />
Evolution subie ou voulue ?<br />
3.2 – Prospection<br />
Que peut-il adv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Comm<strong>en</strong>t peut évoluer <strong>la</strong> variable ?<br />
Sur quoi a-t-on prise ?<br />
Etape 4 Stratégie des futurs possibles <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
4.1 – hypothèses probables à formuler <strong>en</strong> 2012<br />
<strong>pour</strong> <strong>2025</strong><br />
4.2 – stabilisation des hypothèses à <strong>la</strong> fin des auditions<br />
AUDITIONS<br />
AUDITIONS<br />
4.3 - Construction d’un (ou de) chemin(s) de<br />
développem<strong>en</strong>t possible <strong>pour</strong> <strong>2025</strong><br />
Phase II<br />
Prolongation du rapport: Que puis-je faire ?<br />
Etape 1 Où sont positionnés les <strong>en</strong>jeux ?<br />
Marges de manœuvre<br />
Etape 2<br />
Stratégie<br />
« Actions »<br />
<strong>2025</strong><br />
Octobre 2012 50
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
Partie I<br />
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
INTRODUCTION<br />
Description du système, le choix des variables, <strong>la</strong> définition ou typologie des variables,<br />
leur c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t…<br />
LES FICHES VARIABLES<br />
1. Politique générale régionale<br />
2. Transport et accessibilité régionale<br />
3. Accessibilité immatérielle et organisationnelle<br />
4. Démographie<br />
5. Mondialisation et Europe<br />
6. Croissance emploi chômage<br />
7. Filières économiques<br />
8. Formation insertion<br />
9. Recherche et innovation<br />
10. Offre de soins et politique de santé<br />
11. Environnem<strong>en</strong>t climat et risques<br />
12. Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
SYNTHESE DES HYPOTHESES RETENUES PAR VARIABLE<br />
Octobre 2012 51
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 52
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
INTRODUCTION<br />
I -<br />
Définition et typologie des variables ret<strong>en</strong>ues<br />
On distingue habituellem<strong>en</strong>t trois types de variables :<br />
• les Variables exogènes sont des données <strong>pour</strong> le système considéré, c'està-dire<br />
qui ne sont pas susceptibles de changer sous l'effet de l'action<br />
publique.<br />
• les Variables instrum<strong>en</strong>tales sont des variables dont <strong>la</strong> valeur peut être<br />
modifiée par les décideurs publics.<br />
On peut alors retrouver <strong>la</strong> décomposition <strong>en</strong> variables clés (les variables, aux<br />
mains des pouvoirs publics, les plus influ<strong>en</strong>tes sur le système considéré) ou<br />
variables internes (facteurs sur lesquels les ag<strong>en</strong>ts publics ont un pouvoir de<br />
décision ou de maîtrise).<br />
• les Variables <strong>en</strong>dogènes sont des valeurs pouvant être atteintes résultant<br />
des niveaux et des interactions pouvant exister <strong>en</strong>tre les variables exogènes<br />
et instrum<strong>en</strong>tales.<br />
II -<br />
La redéfinition du système étudié<br />
II.1. – L’évaluation des variables de 2004<br />
Les variables id<strong>en</strong>tifiées <strong>en</strong> 2004 11 étai<strong>en</strong>t au nombre de six :<br />
- stratégie d’alliance<br />
- démographie<br />
- accessibilité<br />
- développem<strong>en</strong>t durable<br />
- rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
- dynamisme territorial<br />
Parmi ces variables de 2004, les quatre premières sont considérées aujourd’hui<br />
comme des variables instrum<strong>en</strong>tales, elles sont conservées et rebaptisées le cas<br />
échéant. Elles comport<strong>en</strong>t des sous-variables qui ont été <strong>en</strong>richies ou<br />
diversifiées. Nous n’avons pas isolé de variables totalem<strong>en</strong>t exogènes.<br />
Quant aux variables « rayonnem<strong>en</strong>t culturel » et « dynamisme territorial »<br />
ret<strong>en</strong>ues <strong>en</strong> 2004, elles ne sont pas considérées comme variables instrum<strong>en</strong>tales<br />
dans le prés<strong>en</strong>t rapport mais comme variables <strong>en</strong>dogènes ou « objectifs » : elles<br />
se caractéris<strong>en</strong>t ici comme étant <strong>la</strong> résultante de l’action conjuguée des autres<br />
variables.<br />
Le « dynamisme territorial » <strong>en</strong> particulier est assimilé à l’objectif final<br />
à atteindre si on le définit comme le développem<strong>en</strong>t du territoire<br />
équilibré et respectueux de <strong>la</strong> qualité de vie. C’est <strong>la</strong> finalité sous-t<strong>en</strong>due<br />
par <strong>la</strong> question « <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? »<br />
11 La liste des variables de 2004 est jointe <strong>en</strong> annexe<br />
Octobre 2012 53
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les variables de 2004 ont été réinterrogées <strong>en</strong> 2012 quant à leur niveau<br />
d’impact et leur degré d’incertitude à l’horizon <strong>2025</strong> sur <strong>la</strong> position<br />
géostratégique de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
La section prospective a abouti au c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>té dans le schéma cidessous<br />
dans lequel les cinq variables instrum<strong>en</strong>tales sont matérialisées de <strong>la</strong><br />
façon suivante :<br />
- stratégie d’alliance<br />
- démographie<br />
- accessibilité<br />
- développem<strong>en</strong>t durable<br />
- rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
Le chiffre à l’intérieur indique le nombre de participants partageant le même<br />
positionnem<strong>en</strong>t.<br />
Impact sur <strong>la</strong> position géostratégique<br />
de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
faible moy<strong>en</strong> fort<br />
9<br />
1<br />
5 6<br />
6 4 5<br />
5 6<br />
5<br />
A1 A2 A3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
B1 B2 B3<br />
2<br />
3<br />
1<br />
C1 C2 C3<br />
faible moy<strong>en</strong> élevé Degré d’incertitude<br />
sur leur évolution<br />
(d’après le diagramme établi <strong>en</strong> Section le 26 mai 2011)<br />
Octobre 2012 54
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
• Les variables « stratégie d’alliance » et « accessibilité » prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t toutes<br />
deux des points de rupture critique ou d’incertitude majeure qui leur donn<strong>en</strong>t<br />
une p<strong>la</strong>ce particulièrem<strong>en</strong>t importante dans le système à étudier.<br />
• La variable « démographie » a toute son importance mais prés<strong>en</strong>te des<br />
t<strong>en</strong>dances lourdes. L’action est possible avec des marges de manœuvre<br />
limitées.<br />
• L’appréciation sur le c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t de l’importance et de l’incertitude de <strong>la</strong><br />
variable « développem<strong>en</strong>t durable » est particulièrem<strong>en</strong>t diffuse et nous invite<br />
à reconsidérer son contour.<br />
• Quant au « rayonnem<strong>en</strong>t culturel », malgré l’importance qu’il a sur le<br />
dynamisme du territoire, une sorte de résignation semble être installée<br />
autour de l’abs<strong>en</strong>ce de volonté à imprimer des changem<strong>en</strong>ts dans ce<br />
domaine, ce qui a conduit à son c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dominante dans <strong>la</strong> catégorie<br />
des variables prés<strong>en</strong>tant « peu » d’incertitude de changem<strong>en</strong>t.<br />
II.2. – La redéfinition des variables : <strong>la</strong> base prospective de 2012<br />
Elle est guidée par l’analyse de leurs principales interfér<strong>en</strong>ces. Quatre variables<br />
sont dites « instrum<strong>en</strong>tales » :<br />
Politique générale régionale :<br />
Il s’agit d’une reformu<strong>la</strong>tion de l’anci<strong>en</strong>ne variable « stratégies d’alliance »<br />
r<strong>en</strong>ommée « politique générale régionale » <strong>pour</strong> aller au-delà de <strong>la</strong> notion de<br />
coopération avec les part<strong>en</strong>aires.<br />
Elle inclut deux nouvelles sous variables :<br />
• le « contexte global » des politiques générales régionales permet d’intégrer<br />
des élém<strong>en</strong>ts exogènes liés à <strong>la</strong> situation internationale, europé<strong>en</strong>ne et<br />
nationale,<br />
• <strong>la</strong> « gouvernance régionale » qui caractérise les re<strong>la</strong>tions et le poids<br />
déterminant des acteurs de <strong>la</strong> vie régionale les uns par rapport aux autres ;<br />
elle se différ<strong>en</strong>cie du concept de « Gouvernance » employé parfois <strong>pour</strong><br />
caractériser un des quatre piliers du développem<strong>en</strong>t durable.<br />
La réflexion autour du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong> a é<strong>la</strong>rgi les échelles de<br />
référ<strong>en</strong>ce au-delà du territoire normand et impacte <strong>la</strong> gouvernance régionale. Le<br />
rapprochem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> et <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong> n’est plus id<strong>en</strong>tifié comme<br />
une sous variable mais inséré dans les coopérations interrégionales.<br />
Les hypothèses faites sur cette variable donn<strong>en</strong>t le cadre global du déroulem<strong>en</strong>t<br />
des différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii.<br />
Transports et accessibilité régionale :<br />
Elle remp<strong>la</strong>ce l’anci<strong>en</strong>ne variable « accessibilité ».<br />
Une nouvelle sous variable est introduite : les transports <strong>en</strong> commun<br />
L’exam<strong>en</strong> de cette variable a été considérablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>richi par les réflexions et<br />
les hypothèses datant de 2010 émises à l’occasion du rapport du CESER sur <strong>la</strong><br />
« mobilité généralisée <strong>en</strong> 2050 ».<br />
Octobre 2012 55
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Par ailleurs, les sous variables portant sur l’accessibilité matérielle (routière,<br />
ferroviaire, fluviale, maritime, aéri<strong>en</strong>ne) ont un li<strong>en</strong> très étroit avec nombre de<br />
grands projets structurants d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire qui ont été id<strong>en</strong>tifiés<br />
comme des points c<strong>en</strong>traux des sc<strong>en</strong>arii de développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> :<br />
• <strong>la</strong> LNPN, Ligne Nouvelle Paris <strong>Normandie</strong><br />
• le contournem<strong>en</strong>t- Est de Rou<strong>en</strong><br />
• le développem<strong>en</strong>t des infrastructures portuaires, fluviales, logistiques<br />
Enfin, <strong>la</strong> sous variable « accessibilité immatérielle » est <strong>en</strong> li<strong>en</strong> étroit avec le<br />
grand projet structurant d’aménagem<strong>en</strong>t numérique du territoire et d’accès au<br />
THD Très Haut Débit et, à cet égard, considérée comme primordiale.<br />
La variable « transport et accessibilité régionale » est donc une variable<br />
d’influ<strong>en</strong>ce id<strong>en</strong>tifiée comme un point c<strong>en</strong>tral du déroulem<strong>en</strong>t des sc<strong>en</strong>arii dans<br />
<strong>la</strong> mesure où il est considéré que le chemin emprunté ici aura une influ<strong>en</strong>ce<br />
notoire sur le comportem<strong>en</strong>t des autres variables du système.<br />
Développem<strong>en</strong>t durable :<br />
Le contour de cette variable a été reconsidéré et a conduit à un rec<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t des<br />
thématiques abordées <strong>en</strong> 2004. Il a été opéré autour des 3 piliers du<br />
développem<strong>en</strong>t durable avec toutefois <strong>la</strong> volonté de ne pas introduire de<br />
hiérarchie <strong>en</strong>tre eux et de privilégier l’interdép<strong>en</strong>dance <strong>en</strong>tre les variables :<br />
• l’économique<br />
• le social<br />
• l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal<br />
Le caractère « moteur » de l’économique sur le comportem<strong>en</strong>t des autres<br />
variables du développem<strong>en</strong>t durable est plus ou moins fortem<strong>en</strong>t marqué selon<br />
les sc<strong>en</strong>arii. Par exemple, <strong>la</strong> construction cohér<strong>en</strong>te d’un sc<strong>en</strong>ario de récession<br />
économique limitera fortem<strong>en</strong>t le degré de <strong>la</strong>titude du comportem<strong>en</strong>t de<br />
certaines autres variables, ce qui peut être moins prégnant dans un sc<strong>en</strong>ario de<br />
croissance.<br />
Le c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t des sous variables du développem<strong>en</strong>t durable est le suivant :<br />
Pour l’économique :<br />
• mondialisation et Europe<br />
• croissance, emploi, chômage<br />
• filières économiques<br />
Pour le social :<br />
• l’insertion, les flux migratoires<br />
• <strong>la</strong> société de <strong>la</strong> connaissance (formation, recherche et innovation)<br />
• l’offre de soins<br />
Pour l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal :<br />
• les énergies et, à ce titre, les grands projets régionaux énergétiques (EPR,<br />
éoli<strong>en</strong>, é<strong>la</strong>rgissem<strong>en</strong>t du bouquet énergétique)<br />
• l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (changem<strong>en</strong>ts climatiques et risques, ressources et<br />
biodiversité)<br />
Octobre 2012 56
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
Démographie :<br />
Les sous variables du système de 2004 sont conservées, sachant que le solde<br />
naturel, appuyé sur le taux de mortalité et le taux de natalité, apparaissant à<br />
l’horizon <strong>2025</strong> peut être considéré comme une variable exogène aux t<strong>en</strong>dances<br />
lourdes sur <strong>la</strong>quelle il y a peu de prise, alors que le solde migratoire est<br />
considéré comme une variable instrum<strong>en</strong>tale.<br />
LE SYSTEME ET SES VARIABLES<br />
Solde migratoire<br />
Taux de natalité<br />
et de fécondité<br />
Taux de mortalité<br />
Mondialisation<br />
Climat et risques<br />
Croissance,<br />
chômage, emploi<br />
Filières<br />
économiques<br />
Formation insertion<br />
Offre de soin<br />
Acceptation sociale des<br />
changem<strong>en</strong>ts<br />
LA POSITION<br />
GEOSTRATEGIQUE<br />
DE LA HAUTE-NORMANDIE<br />
EN <strong>2025</strong><br />
Gouvernance<br />
Coopérations<br />
interrégionales<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
internationales<br />
intracommunautaires<br />
Extracommunautaires<br />
Organisationnelle et<br />
immatérielle<br />
Ferroviaire<br />
Aéri<strong>en</strong>ne<br />
Routière<br />
Fluviale<br />
Maritime<br />
Patrimoine<br />
Animation<br />
et évènem<strong>en</strong>ts<br />
Communication<br />
extérieure<br />
Deux variables sont dites <strong>en</strong>dogènes<br />
Le rayonnem<strong>en</strong>t culturel :<br />
Le choix a été fait de ne pas intégrer le rayonnem<strong>en</strong>t culturel comme une sous<br />
variable du développem<strong>en</strong>t durable. Cette variable <strong>en</strong>tre dans <strong>la</strong> catégorie des<br />
variables prés<strong>en</strong>tant peu d’incertitudes. Elle est à <strong>la</strong> fois l’ess<strong>en</strong>ce et le résultat<br />
de <strong>la</strong> notoriété de <strong>la</strong> région.<br />
Le dynamisme territorial :<br />
Il n’est pas assimilé à une variable comme <strong>en</strong> 2004 mais, à l’objectif ultime à<br />
atteindre si on le définit comme le développem<strong>en</strong>t du territoire équilibré et<br />
respectueux de <strong>la</strong> qualité de vie.<br />
C’est le but sous-t<strong>en</strong>du par <strong>la</strong> question « <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ? ».<br />
Il ne fait donc pas l’objet d’une fiche variable à proprem<strong>en</strong>t parler.<br />
En filigrane, le thème de l’acceptation sociale des changem<strong>en</strong>ts est interrogé<br />
dans chacune des sous variables considérées. Le degré d’acceptation des<br />
changem<strong>en</strong>ts peut influer <strong>en</strong> effet sur <strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce des hypothèses formulées.<br />
Octobre 2012 57
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Tableau résumé<br />
Liste des variables et sous variables 2012<br />
Variables<br />
Politique générale<br />
régionale<br />
Transport et accessibilité<br />
régionale<br />
Sous-variables<br />
Contexte global<br />
Gouvernance régionale<br />
Coopérations interrégionales<br />
Re<strong>la</strong>tions internationales intracommunautaires<br />
Re<strong>la</strong>tions internationales extracommunautaires<br />
Accessibilité routière<br />
Transports <strong>en</strong> commun<br />
Accessibilité ferroviaire<br />
Accessibilité fluviale<br />
Accessibilité maritime<br />
Accessibilité aéri<strong>en</strong>ne<br />
Accessibilité immatérielle<br />
Taux de natalité<br />
Démographie<br />
Taux de mortalité<br />
Soldes migratoires<br />
Développem<strong>en</strong>t durable<br />
Économique<br />
o Mondialisation et Europe<br />
o Croissance, emploi, chômage<br />
o Filières économiques<br />
Social<br />
o L’insertion, les flux migratoires<br />
o La société de <strong>la</strong> connaissance (formation,<br />
recherche et innovation)<br />
o L’offre de soin<br />
Environnem<strong>en</strong>tal<br />
o Les énergies<br />
o L’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (changem<strong>en</strong>ts climatiques et<br />
risques, ressources et biodiversité)<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
Dynamisme territorial<br />
Octobre 2012 58
Définition et prés<strong>en</strong>tation des variables<br />
LES FICHES VARIABLES<br />
1. Politique générale régionale<br />
2. Transport et accessibilité régionale<br />
3. Accessibilité immatérielle et organisationnelle<br />
4. Démographie<br />
5. Mondialisation et Europe<br />
6. Croissance emploi chômage<br />
7. Filières économiques<br />
8. Formation insertion<br />
9. Recherche et innovation<br />
10. Offre de soins et politique de santé<br />
11. Environnem<strong>en</strong>t climat et risques<br />
12. Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
Intitulé de <strong>la</strong> variable<br />
Définition de <strong>la</strong> variable<br />
La fiche variable « type »<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
Elém<strong>en</strong>ts de mesure - sources<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
Retrace l’évolution passée des indicateurs de <strong>la</strong> variable (recherche de données<br />
quantitatives) ou de son comportem<strong>en</strong>t (données qualitatives)<br />
Propose un état des lieux <strong>en</strong> 2012<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution sur les 15 prochaines années<br />
Retrace les t<strong>en</strong>dances perceptibles<br />
Les ruptures possibles<br />
Liste les élém<strong>en</strong>ts susceptibles d’affecter le comportem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> variable<br />
Les hypothèses<br />
Liste les hypothèses d’évolution press<strong>en</strong>ties (de 1 à 4 selon les variables<br />
• Hypothèse résumée<br />
• Description fine<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
Octobre 2012 59
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 60
Variable Politique générale régionale<br />
1. Fiche variable « Politique générale régionale »<br />
Définitions<br />
Ensemble complexe décrivant les re<strong>la</strong>tions de <strong>la</strong> région avec son<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t :<br />
- <strong>la</strong> région dans son contexte global : cette approche permet d’intégrer des<br />
élém<strong>en</strong>ts exogènes liés à <strong>la</strong> situation internationale, europé<strong>en</strong>ne et nationale, et<br />
au rapport de force <strong>en</strong>tre les Etats et <strong>en</strong>tre les régions ;<br />
- <strong>la</strong> gouvernance régionale : elle caractérise les re<strong>la</strong>tions et le poids déterminant<br />
des acteurs de <strong>la</strong> vie régionale, politiques et institutionnels, société civile,<br />
citoy<strong>en</strong>s, les uns par rapport aux autres ; elle se différ<strong>en</strong>cie du concept de<br />
« Gouvernance » employé parfois <strong>pour</strong> caractériser un des quatre piliers du<br />
développem<strong>en</strong>t durable ;<br />
- l’organisation et <strong>la</strong> répartition des compét<strong>en</strong>ces <strong>en</strong>tre institutions ;<br />
- les coopérations avec les part<strong>en</strong>aires à tous les niveaux : infrarégional,<br />
régional, interrégional, national, intra-communautaire, extra-communautaire ;<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse rétrospective<br />
A l’échelle du territoire régional<br />
Le Schéma Régional d'Aménagem<strong>en</strong>t et de Développem<strong>en</strong>t du Territoire, a été<br />
institué <strong>en</strong> 1995 et repris dans <strong>la</strong> loi d'ori<strong>en</strong>tation <strong>pour</strong> l'aménagem<strong>en</strong>t et le<br />
développem<strong>en</strong>t durable du territoire du 25 juin 1999 (LOADDT).<br />
Fixant les ori<strong>en</strong>tations fondam<strong>en</strong>tales à horizon 2015 <strong>en</strong> termes<br />
d’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, d’infrastructures de transport, de grands équipem<strong>en</strong>ts et de<br />
services, ce docum<strong>en</strong>t stratégique <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Région constitue<br />
tout à <strong>la</strong> fois :<br />
- un docum<strong>en</strong>t de mise <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce de nombreux schémas sectoriels comme le<br />
Schéma régional de développem<strong>en</strong>t économique (SRDE), le P<strong>la</strong>n régional de<br />
développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Formation (PRDF) ou le P<strong>la</strong>n de Dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t Régional<br />
(PDR) ;<br />
- le cadre des politiques et interv<strong>en</strong>tions propres de <strong>la</strong> Région et de dialogue avec<br />
l’Etat ;<br />
- une référ<strong>en</strong>ce <strong>pour</strong> les autres collectivités et les acteurs haut-normands<br />
impliqués dans l’aménagem<strong>en</strong>t et le développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Région ;<br />
- <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d'une logique de développem<strong>en</strong>t durable.<br />
Pour le financem<strong>en</strong>t des projets inscrits dans les contrats, des fonds sont<br />
expressém<strong>en</strong>t prévus : le Fonds régional d’aménagem<strong>en</strong>t et de développem<strong>en</strong>t<br />
du territoire (FRADT) et le Fonds national d’aménagem<strong>en</strong>t et de développem<strong>en</strong>t<br />
du territoire (FNADT) <strong>pour</strong> le Départem<strong>en</strong>t de Seine-Maritime et <strong>la</strong> FAT <strong>pour</strong> le<br />
Départem<strong>en</strong>t de l'Eure).<br />
Ces crédits peuv<strong>en</strong>t être complétés par des financem<strong>en</strong>ts des politiques<br />
habituelles de <strong>la</strong> Région, des départem<strong>en</strong>ts, des programmes europé<strong>en</strong>s (FEDER,<br />
FEADER) etc.<br />
Le Contrat de Projet Etat-Région (CPER) 2007 - 2013 ne prévoit pas de volet<br />
territorial. La contractualisation avec les agglomérations et les pays de <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> est <strong>en</strong> cours dans le cadre du contrat « 276 » réunissant <strong>la</strong> Région et<br />
les deux Départem<strong>en</strong>ts.<br />
Octobre 2012 61
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Engagé depuis septembre 2004, le contrat 276 permet aux 3 collectivités de<br />
mutualiser leurs moy<strong>en</strong>s afin de r<strong>en</strong>forcer l'action publique au service des<br />
citoy<strong>en</strong>s. Elle comporte de nombreux avantages car les politiques <strong>en</strong>gagées au<br />
niveau de l'emploi, de l'action sociale, de l'éducation, de <strong>la</strong> formation, du<br />
développem<strong>en</strong>t économique, de l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t…sont plus efficaces et plus<br />
cohér<strong>en</strong>tes. De plus, le « 276 » permet de garantir une équité de traitem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>tre les habitants.<br />
L’intérêt du contrat est de rassembler, dans une même négociation, les<br />
financem<strong>en</strong>ts des acteurs locaux (communes, communautés de communes,<br />
communautés d’agglomération, associations), de <strong>la</strong> Région et des Départem<strong>en</strong>ts<br />
dans le cadre du contrat 276, mais aussi d’autres part<strong>en</strong>aires Etat (Ademe,<br />
Ag<strong>en</strong>ce de l’eau, EPF) <strong>en</strong> faveur d’un programme d’actions partagé et <strong>destin</strong>é à<br />
atteindre les objectifs du projet de développem<strong>en</strong>t.<br />
Les <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts financiers (<strong>en</strong> millions d’euros) :<br />
CPER et<br />
CPER 2007-2013<br />
contrat 276<br />
part Etat 431,4 Etat : 431,4<br />
part Région 441,7 Région : 1032,7<br />
part CG76 293,3 CG76 : 746,14<br />
part CG27 45,7 CG27: 234,04<br />
TOTAL CPER 1212,1 Total : 2444,28<br />
CONTRAT 276<br />
dont volet territorial<br />
Région 591 250<br />
CG76 452,84 250<br />
CG27 188,34 50<br />
TOTAL 276 1232,18 550<br />
Programmes et fonds europé<strong>en</strong>s <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> 2007-2013<br />
Objectif compétitivité régionale et emploi<br />
(innovation, recherche, TIC, <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t,<br />
FEDER<br />
219,3 transports, …)<br />
FSE<br />
156,6 (emploi et formation)<br />
Interreg IV / FEDER<br />
173,5 objectif coopération territoriale europé<strong>en</strong>ne<br />
Total - politique de cohésion 549,4<br />
PAC - second volet<br />
FEADER<br />
36,2 (agriculture et développem<strong>en</strong>t rural)<br />
Politique commune de <strong>la</strong><br />
pêche 2,45<br />
TOTAL des programmes<br />
et fonds europé<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> 588,05<br />
En matière d’implication dans <strong>la</strong> vie publique, <strong>la</strong> parité femmes-hommes dans <strong>la</strong><br />
vie publique est <strong>en</strong>core loin d’être atteinte <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>. Parmi les<br />
personnes <strong>en</strong> mandat politique ou syndical <strong>en</strong> 2007, 27 % sont des femmes<br />
contre 35 % <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale. De même, <strong>la</strong> région n’a que 11 % de<br />
sénatrices <strong>en</strong> 2008 contre 22 % au p<strong>la</strong>n national.<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> se distingue assez peu <strong>pour</strong> le taux d’abst<strong>en</strong>tion aux<br />
différ<strong>en</strong>tes élections.<br />
Octobre 2012 62
Variable Politique générale régionale<br />
La part de sa popu<strong>la</strong>tion couverte par un Ag<strong>en</strong>da 21 de proximité (reconnu par le<br />
Ministère <strong>en</strong> charge du développem<strong>en</strong>t durable) est de 16 % <strong>en</strong> 2010 <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> contre 15 % <strong>en</strong> Métropole.<br />
A l’échelle interrégionale<br />
La Région travaille égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec d'autres Régions. Ainsi, <strong>la</strong><br />
Basse-<strong>Normandie</strong>, <strong>la</strong> Picardie, l'Ile-de-France, le C<strong>en</strong>tre se sont <strong>en</strong>gagés<br />
<strong>en</strong>semble sur de nombreuses actions, comme <strong>la</strong> modernisation de <strong>la</strong> liaison<br />
ferroviaire Rou<strong>en</strong>-Ca<strong>en</strong>, <strong>la</strong> création de réseaux de recherche <strong>en</strong> neurosci<strong>en</strong>ces<br />
(Lille, Ami<strong>en</strong>s, Ca<strong>en</strong>, Rou<strong>en</strong>), les différ<strong>en</strong>ts pôles de compétitivité ou bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>core<br />
<strong>la</strong> liaison des régions au réseau à grande vitesse et le contournem<strong>en</strong>t fret de <strong>la</strong><br />
région parisi<strong>en</strong>ne. L'aéroport interrégional de Deauville Saint Gati<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />
coopération avec <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>, constitue <strong>en</strong>fin un autre exemple de cette<br />
coopération fructueuse.<br />
La réflexion autour du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong> a é<strong>la</strong>rgi les échelles de<br />
référ<strong>en</strong>ce au-delà du territoire normand et impacte <strong>la</strong> gouvernance régionale, audelà<br />
du simple rapprochem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> et <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>.<br />
Comme beaucoup d’autres projets structurants <strong>pour</strong> l’aménagem<strong>en</strong>t du<br />
territoire, ce projet d’intérêt national mobilise à l’heure actuelle l’<strong>en</strong>semble des<br />
part<strong>en</strong>aires régionaux.<br />
A l’échelle nationale<br />
Depuis les premières lois de déc<strong>en</strong>tralisation de 1981-1982, les compét<strong>en</strong>ces<br />
dévolues aux Régions et aux autres collectivités territoriales n’ont cessé<br />
d’évoluer. Les Régions ont pris une part croissante dans l’interv<strong>en</strong>tion publique.<br />
Les compét<strong>en</strong>ces propres sont accompagnées de compét<strong>en</strong>ces partagées avec<br />
les autres part<strong>en</strong>aires publics. Une nouvelle étape de déc<strong>en</strong>tralisation se dessine<br />
à l’heure actuelle qui devrait conférer à <strong>la</strong> Région un rôle primordial <strong>en</strong> matières<br />
d’économie, d’emploi et de formation.<br />
A l’échelle europé<strong>en</strong>ne et internationale<br />
La Région est une <strong>en</strong>tité id<strong>en</strong>tifiée dans les programmes d’interv<strong>en</strong>tion<br />
communautaires (cf. programmes et fonds europé<strong>en</strong>s consacrés à <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>).<br />
Si le dialogue Europe-Région est installé, les Régions sont de plus <strong>en</strong> plus<br />
soumises aux effets des turbul<strong>en</strong>ces ress<strong>en</strong>ties à l’échelon europé<strong>en</strong>.<br />
Les mesures prises <strong>pour</strong> mettre un terme à <strong>la</strong> crise, après 2007-2008, ont eu un<br />
coût sévère <strong>pour</strong> les citoy<strong>en</strong>s europé<strong>en</strong>s et ont provoqué une hausse de <strong>la</strong> dette<br />
publique. Après une augm<strong>en</strong>tation sur le court terme <strong>en</strong> raison du sauvetage des<br />
banques, <strong>la</strong> dette publique est incriminée. L'attaque portée aux pays jugés les<br />
plus vulnérables a montré toute <strong>la</strong> fragilité de <strong>la</strong> zone euro, alors que sa dette<br />
nationale cumulée, même si elle doit être réduite et maîtrisée, est inférieure à <strong>la</strong><br />
dette américaine. Les mesures adoptées, bi<strong>en</strong> qu'elles ai<strong>en</strong>t été mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
tardivem<strong>en</strong>t, représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t un grand pas <strong>en</strong> avant. C’est toutefois insuffisant,<br />
étant donné qu'il s'agit d'une crise systémique, qui ne dép<strong>en</strong>d donc pas de <strong>la</strong><br />
dette de tel ou tel pays.<br />
Octobre 2012 63
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Jusqu'<strong>en</strong> 2008, l'euro n'avait pas ress<strong>en</strong>ti de turbul<strong>en</strong>ces monétaires, et s'était<br />
apprécié par rapport au dol<strong>la</strong>r, <strong>en</strong> dev<strong>en</strong>ant <strong>la</strong> deuxième monnaie de réserve<br />
mondiale. Une des raisons expliquant ce revirem<strong>en</strong>t de situation et les attaques<br />
spécu<strong>la</strong>tives qui ont touché l’euro est que, jusqu'à <strong>la</strong> crise grecque, les ag<strong>en</strong>ces<br />
de notation partai<strong>en</strong>t du principe que l'Union ne <strong>la</strong>isserait jamais un État membre<br />
faire faillite. Or, comme aucune solution rapide n'est apparue face à <strong>la</strong> crise<br />
grecque, les spreads des nouvelles obligations ont monté <strong>en</strong> flèche. C'est le<br />
manque de volonté politique et l'incapacité, p<strong>en</strong>dant deux ans, à s'accorder sur<br />
une solution <strong>pour</strong> résoudre <strong>la</strong> crise de <strong>la</strong> dette souveraine <strong>en</strong> Europe qui a<br />
<strong>en</strong>couragé les ag<strong>en</strong>ces de notation à dégrader <strong>la</strong> note de <strong>la</strong> dette de toute une<br />
série d'États membres de <strong>la</strong> zone euro, cette dégradation touchant désormais<br />
une grande partie des Etats membres.<br />
Enfin, <strong>en</strong> ce qui concerne <strong>la</strong> vision du développem<strong>en</strong>t et de <strong>la</strong> coopération,<br />
durant ces dix dernières années, l'Union europé<strong>en</strong>ne s'est montrée de plus <strong>en</strong><br />
plus att<strong>en</strong>tive au dialogue avec les Organisations de <strong>la</strong> Société Civile (OSC). Avec<br />
le cons<strong>en</strong>sus europé<strong>en</strong> <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t, l'instrum<strong>en</strong>t de coopération au<br />
développem<strong>en</strong>t, le rapport de <strong>la</strong> Cour des comptes europé<strong>en</strong>ne et, <strong>en</strong>fin, le<br />
dialogue structuré, <strong>la</strong> t<strong>en</strong>eur et <strong>la</strong> portée de cette concertation se sont <strong>en</strong>richies<br />
au point qu'à prés<strong>en</strong>t, elle compte notamm<strong>en</strong>t parmi ses participants :<br />
- <strong>la</strong> Commission europé<strong>en</strong>ne,<br />
- le Parlem<strong>en</strong>t europé<strong>en</strong>,<br />
- le Comité des régions d’Europe<br />
- le CESE Conseil Economique et Social Europé<strong>en</strong>,<br />
- les États membres<br />
- les groupem<strong>en</strong>ts de <strong>la</strong> société civile (les organisations syndicales, les<br />
coopératives et les organisations de l'économie sociale, d'agriculteurs, de<br />
consommateurs ou d'employeurs),<br />
- les p<strong>la</strong>tes-formes d'ONG,<br />
- les instances sociales des pays part<strong>en</strong>aires.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
• volume des fonds de <strong>la</strong> politique de cohésion communautaire attribués <strong>en</strong><br />
région<br />
• impact de ces financem<strong>en</strong>ts europé<strong>en</strong>s sur les projets<br />
• participation des femmes aux instances de gouvernance<br />
• taux de participation aux élections (comparaison avec élections antérieures)<br />
• participation à <strong>la</strong> vie associative ; nombre d’associations rapporté à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion ; part de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion régionale participant à des activités de<br />
volontariat dans des associations<br />
Prospective : hypothèses d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
Dans le contexte économique incertain, nombre de projets d’<strong>en</strong>vergure nationale<br />
ne peuv<strong>en</strong>t être considérés comme définitivem<strong>en</strong>t acquis et nécessit<strong>en</strong>t le<br />
mainti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> mobilisation des acteurs socio économiques du territoire.<br />
Les institutions publiques vont devoir mettre <strong>en</strong> œuvre de nouvelles<br />
compét<strong>en</strong>ces au terme du projet de nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation annoncé<br />
comme immin<strong>en</strong>t. Elles seront am<strong>en</strong>ées à repositionner leurs coopérations ou<br />
part<strong>en</strong>ariats, dans un souci d’optimisation des ressources publiques et<br />
d’effici<strong>en</strong>ce des politiques.<br />
Octobre 2012 64
Variable Politique générale régionale<br />
Les Organisations de <strong>la</strong> Société Civile sont de plus <strong>en</strong> plus une composante à<br />
part <strong>en</strong>tière de <strong>la</strong> gouvernance au niveau europé<strong>en</strong>, des interv<strong>en</strong>antes majeures<br />
du développem<strong>en</strong>t.<br />
A ce titre, elles <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t être davantage associées au niveau stratégique aux<br />
politiques et programmes de coopération et à <strong>la</strong> répartition de leurs ressources,<br />
au stade de leur définition, de leur mise <strong>en</strong> œuvre et de leur suivi.<br />
A <strong>la</strong> lueur de <strong>la</strong> crise traversée par les Etats membres, les réflexions au sein de<br />
l’Union s’articul<strong>en</strong>t autour d’un p<strong>la</strong>n de re<strong>la</strong>nce économique, sociale et culturelle,<br />
afin de leur permettre « de profiter d'un développem<strong>en</strong>t solide et durable, fondé<br />
sur <strong>la</strong> compétitivité, <strong>la</strong> productivité, l'emploi, le bi<strong>en</strong>-être, <strong>la</strong> prospérité et,<br />
surtout, le cons<strong>en</strong>sus démocratique. » 12<br />
Les ruptures possibles<br />
• Rec<strong>en</strong>tralisation des pouvoirs, les régions perd<strong>en</strong>t <strong>la</strong> main, par <strong>la</strong> même, leur<br />
rôle de régu<strong>la</strong>teur. Dans un tel cas de figure, <strong>la</strong> société civile perdrait elleaussi<br />
un vecteur d’expression.<br />
• La <strong>pour</strong>suite du processus de métropolisation peut gommer les frontières des<br />
régions. Les métropoles tiss<strong>en</strong>t un réseau <strong>en</strong>tre elles, évinçant ainsi les<br />
Régions d’un leadership possible. Dans chaque région, le poids<br />
démographique et économique des métropoles domine les politiques<br />
d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire.<br />
• A contrario, un nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation <strong>pour</strong>rait offrir aux régions de<br />
nouvelles compét<strong>en</strong>ces et conforter leur rôle de chef de file de locomotive<br />
régionale. La Région <strong>pour</strong>rait alors fédérer les acteurs politiques,<br />
économiques, culturels et touristiques haut-normands.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 : Concurr<strong>en</strong>ce des territoires et règle du chacun <strong>pour</strong> soi.<br />
Dans un contexte économique extrêmem<strong>en</strong>t défavorable, <strong>la</strong> règle du chacun <strong>pour</strong><br />
soi est de mise. Les coupes sombres budgétaires au niveau de l’Etat ont eu <strong>pour</strong><br />
conséqu<strong>en</strong>ce directe une diminution des dotations de l’Etat aux collectivités<br />
territoriales. Alors que le mot d’ordre est « <strong>pour</strong> dép<strong>en</strong>ser moins, mutualisons »,<br />
les collectivités territoriales n’ont plus ri<strong>en</strong> à mutualiser. Les projets territoriaux<br />
s’annu<strong>la</strong>nt, il n’y a plus de gouvernance des territoires. Les grands projets sont<br />
rangés au rayon des souv<strong>en</strong>irs. C’est le règne de <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre<br />
les territoires. Les inégalités s’acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t. La région « capitale » est<br />
prédominante. Il n’y a plus matière à coopération.<br />
La règle du chacun <strong>pour</strong> soi s’applique égalem<strong>en</strong>t au niveau europé<strong>en</strong>. Les Etats<br />
membres, après avoir rev<strong>en</strong>diqué un retour au principe de l’Etat souverain, ont<br />
diminué leurs contributions communautaires. La zone euro est réduite aux Etats<br />
les plus riches. Chacun <strong>en</strong>t<strong>en</strong>d recevoir autant que ce qu’il a versé.<br />
Le libre échange économique est universel. La puissance publique n’a aucun<br />
moy<strong>en</strong> de réguler les conséqu<strong>en</strong>ces négatives des marchés. La gouvernance<br />
mondiale se réduit à des déc<strong>la</strong>rations sans effets.<br />
12 Extrait avis CESE - 474/2012<br />
Octobre 2012 65
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
→ H2 : Gouvernance des villes et coopérations de proximité.<br />
Dans un contexte économique de décroissance, le « Small is beautiful » devi<strong>en</strong>t<br />
un dogme. En contrepartie, les circuits courts se développ<strong>en</strong>t. Les coupes<br />
sombres budgétaires au niveau de l’Etat ont eu <strong>pour</strong> conséqu<strong>en</strong>ce directe une<br />
diminution des dotations de l’état aux collectivités territoriales.<br />
La décision publique est au local et notamm<strong>en</strong>t à partir des villes. La Région a un<br />
rôle d’animation des initiatives y compris d’initiatives non monétaires, son<br />
« leadership » est contrôlé par les villes et tout particulièrem<strong>en</strong>t les plus<br />
grandes : Rou<strong>en</strong>, Le Havre, Evreux.<br />
Les projets d’économie solidaire sont <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t. L’initiative privée<br />
change de nature. Face à l’inconnu, l’innovation est <strong>en</strong>couragée. Sous l’impulsion<br />
des applications des doctrines de l’économie solidaire, les acteurs privés<br />
recherch<strong>en</strong>t les spécificités, les niches locales. Ainsi, des spécialités régionales se<br />
développ<strong>en</strong>t et sont l’objet de débuts de coopérations. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> tire<br />
sa notoriété de son pot<strong>en</strong>tiel agricole. Sur cette base, des alliances de logistiques<br />
avec <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong> permett<strong>en</strong>t un transport régulier vers l’Ile de France.<br />
La décroissance, l’utilisation toujours plus restreinte des carburants, r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t<br />
les re<strong>la</strong>tions transnationales de proximité. Les échanges <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>, le B<strong>en</strong>elux et l’Allemagne se r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> y<br />
exporte son agriculture. C’est l’Europe de villes.<br />
Un processus simi<strong>la</strong>ire s’est <strong>en</strong>gagé dans les principaux Etats de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète et<br />
tout particulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Chine, aux Etats-Unis et au Brésil. Les re<strong>la</strong>tions<br />
internationales se font de port à port, de ville à ville. La masse des villes est<br />
simi<strong>la</strong>ire à leur puissance.<br />
→ H3 : Pouvoirs publics forts et coopérations régionales à l’échelle<br />
europé<strong>en</strong>ne.<br />
Les pays occid<strong>en</strong>taux ont retrouvé <strong>la</strong> croissance. Croissance et développem<strong>en</strong>t<br />
durable sont compatibles. Pour maint<strong>en</strong>ir une politique de développem<strong>en</strong>t<br />
durable, les pouvoirs publics sont très prés<strong>en</strong>ts. Ils tir<strong>en</strong>t leurs ressources de <strong>la</strong><br />
croissance. Le pot<strong>en</strong>tiel industriel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur. La<br />
Région est l’interlocutrice de l’Etat au nom des autres collectivités territoriales<br />
Haut Normandes. Le projet Paris Seine <strong>Normandie</strong> a fini par s’imposer. Adossée<br />
aux infrastructures éoli<strong>en</strong>nes et à <strong>la</strong> LNPN, <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> connaît une nouvelle<br />
notoriété qu’elle a su accompagner d’évènem<strong>en</strong>ts culturels de portée<br />
internationale. Ces nouvelles infrastructures sont aussi bénéfiques <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong><br />
que <strong>pour</strong> <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>. De fait, <strong>la</strong> coopération devi<strong>en</strong>t une évid<strong>en</strong>ce. La<br />
recherche Normande s’organise est devi<strong>en</strong>t ainsi une des 6 premières <strong>en</strong> France.<br />
L’Europe des Etats est aussi l’Europe des Régions. Grâce à une forme appropriée<br />
de l’utilisation des crédits, les projets à long terme ont re<strong>la</strong>ncé une économie<br />
plus interv<strong>en</strong>tionniste. Les projets stimu<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce et <strong>la</strong><br />
coopération <strong>en</strong>tre les régions à l’échelle de l’Europe sont <strong>en</strong>couragés par l’Union<br />
Europé<strong>en</strong>ne. Le pot<strong>en</strong>tiel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur. La<br />
massification des transports internationaux et singulièrem<strong>en</strong>t les transports<br />
maritimes, font du Havre, <strong>la</strong> porte maritime de l’Europe occid<strong>en</strong>tale. L’Etat avec<br />
l’adhésion de <strong>la</strong> Région Ile de France fait du Havre, le principal port de l’Ile de<br />
France.<br />
Octobre 2012 66
Variable Politique générale régionale<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
- Citoy<strong>en</strong>s – Associations<br />
- Entreprises<br />
- Collectivités territoriales<br />
- Etat<br />
- Union Europé<strong>en</strong>ne<br />
Sources :<br />
- INSEE, L’année économique et sociale <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Cahier d’aval 2001 n°93,<br />
juin 2012.<br />
- Avis du CESE - ECO/307 – CESE 474/2012 – croissance et dette souveraine dans<br />
l’Union Europé<strong>en</strong>ne<br />
- Avis du CESE - REX/349 – CESE 839/2012<br />
Octobre 2012 67
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 68
Variable Transports et Accessibilité régionale<br />
2. Fiche variable « Transports et Accessibilité régionale »<br />
Définitions<br />
→ Définition 1 :<br />
«L’accessibilité peut être définie comme étant <strong>la</strong> quantité de bi<strong>en</strong>s, d’emplois ou<br />
<strong>en</strong>core le volume de popu<strong>la</strong>tion qu’un individu peut joindre à partir d’un point<br />
donné, compte t<strong>en</strong>u du niveau d’offre d’infrastructures, de son comportem<strong>en</strong>t de<br />
dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t et de l’attractivité des <strong>destin</strong>ations possibles. »<br />
→ Définition 2 :<br />
«Mesurer l’accessibilité d’un lieu revi<strong>en</strong>t à quantifier <strong>la</strong> plus ou moins grande<br />
facilité avec <strong>la</strong>quelle ce lieu peut être atteint à partir d’un ou de plusieurs autres<br />
lieux». 13<br />
Un exemple d’utilisation: <strong>la</strong> mesure est donnée par <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne du rapport <strong>en</strong>tre<br />
temps de parcours et distance à vol d’oiseau <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble des liaisons <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />
préfecture du départem<strong>en</strong>t concerné et le panel de villes considéré 14 .<br />
Intérêt : différ<strong>en</strong>tes échelles sont considérées: Intra régionale, Inter régionale,<br />
Nationale, Europé<strong>en</strong>ne<br />
Critiques :<br />
• Critère unique : <strong>la</strong> vitesse des liaisons<br />
• Non prise <strong>en</strong> compte de <strong>la</strong> temporalité dans <strong>la</strong> journée et aussi dans l’année<br />
• Analyse unimodale<br />
• Choix des lieux de référ<strong>en</strong>ce sans prise <strong>en</strong> compte des services et<br />
équipem<strong>en</strong>ts: « L’objectif à rechercher n’est pas d’avoir un bon niveau d’accès<br />
aux villes quelles qu’elles soi<strong>en</strong>t, mais plutôt d’avoir accès à des zones qui<br />
offr<strong>en</strong>t les équipem<strong>en</strong>ts et services dont on a effectivem<strong>en</strong>t besoin. » 15<br />
Remarque : Dans <strong>la</strong> notion d’accessibilité au service, il faut intégrer le problème<br />
de <strong>la</strong> file d’att<strong>en</strong>te : <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, il n’y a pas de zone <strong>en</strong>c<strong>la</strong>vée et <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion est vite sur le « lieu » du service, mais y accéder ne veut pas dire<br />
qu’on peut <strong>en</strong> bénéficier 16 .<br />
Les opportunités qu’offre le territoire ne pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de s<strong>en</strong>s qu’à travers les<br />
conditions de transport qui permett<strong>en</strong>t d’y accéder et, inversem<strong>en</strong>t, les conditions<br />
de transport offertes par le réseau n’ont d’intérêt qu’<strong>en</strong> fonction des <strong>destin</strong>ations<br />
desservies» 17 .<br />
13 CHAPELON L., Évaluation des chaînes intermodales de transport: l’agrégation des mesures dans<br />
l’espace et le temps, Actes du colloque « Technological Innovation for Land Transportation » (TILT)<br />
t<strong>en</strong>u à Lille du 2 au 4 décembre 2003<br />
14 Ministère de l’Equipem<strong>en</strong>t, Service Economie, Statistiques et Prospective, 2008, Rapport<br />
d'études.<br />
15 J.ALQUIER et C. BIWER, Rapport d’information fait au nom de <strong>la</strong> délégation à l’aménagem<strong>en</strong>t et<br />
au développem<strong>en</strong>t durable du territoire sur le niveau d’équipem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> France <strong>en</strong> infrastructures<br />
de transports et ses conséqu<strong>en</strong>ces sur le dés<strong>en</strong>c<strong>la</strong>vem<strong>en</strong>t des régions françaises, Sénat - juin 2008<br />
16 A<strong>la</strong>in MALMARTEL, directeur de l’Insee de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
17 SETRA, Accessibilité des territoires et des services – Notions et représ<strong>en</strong>tation, juin 2008,<br />
rapport d’études.<br />
Octobre 2012 69
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Remarque : Les notions de desserte, d’<strong>en</strong>c<strong>la</strong>vem<strong>en</strong>t, d’attractivité et de mobilité<br />
sont souv<strong>en</strong>t évoquées <strong>en</strong> parallèle à l’accessibilité.<br />
Comm<strong>en</strong>taires : cette définition a le mérite d’introduire un plus grand nombre de<br />
critères. Mais il manque toujours les contraintes propres des individus (ex de<br />
l’éloignem<strong>en</strong>t des cabinets de gérontologie, qui pose problème <strong>pour</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
âgée mais par <strong>pour</strong> les jeunes…)<br />
La question de l’accessibilité numérique via les nouvelles technologies n’est<br />
volontairem<strong>en</strong>t pas traitée ici et fait l’objet d’une fiche variable spécifique<br />
« accessibilité immatérielle et organisationnelle »<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
On peut considérer « deux c<strong>la</strong>sses d'indicateurs 18 :<br />
• les indicateurs re<strong>la</strong>tifs aux comportem<strong>en</strong>ts individuels permett<strong>en</strong>t d'analyser <strong>la</strong><br />
formation de <strong>la</strong> demande de mobilité <strong>en</strong> mettant <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce le jeu des<br />
systèmes de contraintes individuelles, spatiales ou monétaires ;<br />
• les indicateurs re<strong>la</strong>tifs au marché des dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts qui « qualifi<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
résultante des comportem<strong>en</strong>ts individuels sur un territoire donné, caractérisé<br />
notamm<strong>en</strong>t par un mode d'occupation de l'espace et une offre de transport : il<br />
s'agit alors d'analyser le fonctionnem<strong>en</strong>t des différ<strong>en</strong>ts segm<strong>en</strong>ts du marché,<br />
définis <strong>en</strong> fonction des catégories de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts (modes, motifs, types de<br />
liaison) ou des catégories d'usagers (catégories sociales et localisations<br />
résid<strong>en</strong>tielles).»<br />
• Exemples d’indicateurs simples :<br />
Distance = degré de connexion d’un nœud au reste du réseau /<br />
caractéristiques fonctionnelles du réseau<br />
Temps de parcours = <strong>en</strong> cas de multimodalité, il faut intégrer le temps<br />
d’accès, d’att<strong>en</strong>te, de trajet et de rabattem<strong>en</strong>t.<br />
18 Caroline GALLEZ, Indicateurs d'évaluation de sc<strong>en</strong>arii d'évolution de <strong>la</strong> mobilité urbaine, INRETS-<br />
DEST- PREDIT, 1996-2000, Recherches stratégiques - Séminaire du groupe "Prospective".<br />
Octobre 2012 70
Variable Transports et Accessibilité régionale<br />
Coût généralisé = intègre le coût du temps passé, le coût du trajet et<br />
év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t les notions d’inconfort, de « malus » dues aux conditions<br />
r<strong>en</strong>contrées.<br />
• Indicateurs composés combinant plusieurs données :<br />
Accessibilité à un panel de bi<strong>en</strong>s = croise le coût généralisé et <strong>la</strong> quantité de<br />
bi<strong>en</strong>s et de services accessibles<br />
Accessibilité gravitaire = donne une mesure de <strong>la</strong> distribution spatiale des<br />
activités autour d’un point, <strong>en</strong> fonction de l’attractivité de <strong>la</strong> <strong>destin</strong>ation et du<br />
coût <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dré par le dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t<br />
Qualitatif = « qualité du service » qui pr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> compte vitesse moy<strong>en</strong>ne,<br />
nombre de dessertes et amplitude de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ge horaire ; fiabilité, ponctualité et<br />
sécurité; confort<br />
Economique = coût / utilité …<br />
Environnem<strong>en</strong>tal = exig<strong>en</strong>ces énergétiques et climatiques ; diminution des<br />
congestions …<br />
Social = disparité sociale de l'accessibilité à un type d'équipem<strong>en</strong>t ou à une<br />
zone donnée …<br />
Qu’ils soi<strong>en</strong>t simples ou composés, c’est <strong>la</strong> mesure « re<strong>la</strong>tive » qui est plus<br />
intéressante que <strong>la</strong> mesure absolue de l’accessibilité.<br />
De nombreux modèles sont développés : les outils de calculs s’appui<strong>en</strong>t sur les<br />
Bases de Données et les SIG, avec les limites de disponibilités des données et de<br />
leur actualisation.<br />
Les représ<strong>en</strong>tations utilisables sont les tableaux, les cartes, les courbes<br />
isochrones (accessible <strong>en</strong> moins de x minutes), iso distance (<strong>en</strong> moins de x km),<br />
isocoût (<strong>en</strong> moins de x euros) et les anamorphoses.<br />
<strong>Quel</strong>s que soi<strong>en</strong>t les indicateurs à ret<strong>en</strong>ir, il parait souhaitable de les organiser<br />
sur un schéma qui pr<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> compte le développem<strong>en</strong>t durable <strong>en</strong> transposant<br />
l’exemple suivant d’organisation des indicateurs de mobilité.<br />
19<br />
19 Jean‐Philippe Antoni - Gilles Vuidel - Pierre Frankhauser Avec <strong>la</strong> participation de Yann Fléty et<br />
Caroline Molherat, « Appropriation et développem<strong>en</strong>t », ThéMA - Vers une modélisation multi<br />
sca<strong>la</strong>ire (fractale) du développem<strong>en</strong>t urbain par système multi-ag<strong>en</strong>ts, Avril 2009.<br />
Octobre 2012 71
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
• Retard dans <strong>la</strong> réalisation d’infrastructures (exemple : Contournem<strong>en</strong>t Est)<br />
• Prédominance des dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts par <strong>la</strong> route<br />
• Amélioration des liaisons infra régionale (<strong>en</strong> particulier TER)<br />
• Difficultés persistantes des liaisons infrarégionales dans l’Eure<br />
• Difficultés de liaisons interrégionale, nationale et mondiale qui impacte<br />
directem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> possibilité d’attirer des décideurs (cf. débat sur <strong>la</strong> LNPN).<br />
Prospective : hypothèses d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes 20<br />
6 grands domaines<br />
• Evolution technologiques : TIC, bio et nano technologies ;<br />
• Modes de vie : croissance de <strong>la</strong> mobilité ral<strong>en</strong>tie ; prédominance de <strong>la</strong> route<br />
maint<strong>en</strong>ue ;<br />
• Habitat et services de proximité : impact de <strong>la</strong> vitesse sur <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sité ;<br />
périurbanisation ;<br />
• Loisir, tourisme<br />
• Evolution des organisations : rôle des AOT ; opérateurs de flux ;<br />
• Sureté-sécurité : gestion des risques<br />
Remarque :<br />
• Il parait certain que les schémas d’urbanisation vont se modifier dans les<br />
années qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t car on doit protéger les espaces naturels <strong>pour</strong> faire face<br />
avec <strong>la</strong> montée de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion et l’habitat va se p<strong>en</strong>ser davantage <strong>en</strong><br />
verticalité.<br />
• Le modèle haut normand est un modèle déjà assez po<strong>la</strong>risé où on voit que<br />
95% de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est sous l’emprise d’une aire urbaine. La ville c<strong>en</strong>tre<br />
(Rou<strong>en</strong>) regroupe dans sa périphérie 50% de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>. Sur ce p<strong>la</strong>n là, on peut considérer que <strong>la</strong> région est certainem<strong>en</strong>t<br />
« <strong>en</strong> avance » sur les schémas d’urbanisation qui vont muter ailleurs.<br />
Les ruptures possibles<br />
Croissance de <strong>la</strong> mobilité ral<strong>en</strong>tie <strong>en</strong>visagée dans de nombreux docum<strong>en</strong>ts.<br />
21<br />
20<br />
DÉMARCHE PROSPECTIVE TRANSPORTS 2050- ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION Ministère des<br />
Transports, de l’Équipem<strong>en</strong>t, du Tourisme et de <strong>la</strong> Mer- Conseil Général des Ponts et Chaussées-<br />
Mars 2006<br />
21 Ministère des Transports, de l’Équipem<strong>en</strong>t, du Tourisme et de <strong>la</strong> Mer- Conseil Général des Ponts<br />
et Chaussées, Démarche prospective transports 2050- élém<strong>en</strong>ts de réflexion, mars 2006.<br />
Octobre 2012 72
Variable Transports et Accessibilité régionale<br />
Quatre champs de rupture :<br />
1 - Energie-effet de serre : défail<strong>la</strong>nce des approvisionnem<strong>en</strong>ts ; panne des<br />
progrès technologiques ;<br />
2 - Démographie-économie : migrations ; déséquilibre monétaire ; effondrem<strong>en</strong>t<br />
du PIB ;<br />
3 - Changem<strong>en</strong>t des comportem<strong>en</strong>ts : retour au local ;<br />
4 - Modes de transports.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 : Accessibilité dégradée et mobilité réduite<br />
La t<strong>en</strong>dance générale est à <strong>la</strong> dégradation des infrastructures, les flux<br />
contourn<strong>en</strong>t le territoire. Les contournem<strong>en</strong>ts et les raccordem<strong>en</strong>ts autoroutiers<br />
ne sont pas réalisés. Engorgem<strong>en</strong>ts et bouchons s’int<strong>en</strong>sifi<strong>en</strong>t malgré une<br />
diminution du trafic dû au manque d’activité. On assiste à une dégradation des<br />
transports collectifs faute d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong>. Le mix transport individuel / collectif est<br />
inversé et le service aux usagers dégradé. Les accid<strong>en</strong>ts ferroviaires se<br />
multipli<strong>en</strong>t sur des lignes saturées et obsolètes et les dessertes fret sont<br />
abandonnées. La nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> n'est pas faite. Les travaux de mise à<br />
niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine ne sont pas réalisés, le Canal Seine Nord est<br />
opérationnel. Les parts de marché sont prises par les ports du Nord. Port 2000 ne<br />
se développe pas. Les ports secondaires ne développ<strong>en</strong>t pas le cabotage. Les<br />
liaisons transmanche se font désormais par Ca<strong>la</strong>is et Saint Malo. On n’a pas<br />
trouvé d’accord <strong>pour</strong> développer un aéroport unique. Les liaisons nécessaires à <strong>la</strong><br />
survie de Deauville ne sont pas réalisées et l’accessibilité à Roissy est de plus <strong>en</strong><br />
plus difficile.<br />
→ H2 : Accessibilité difficile faute de réalisation des grands projets<br />
Les grands projets ne sont pas réalisés <strong>en</strong> totalité. La mobilité imposée souffre<br />
des congestions aggravées par <strong>la</strong> non réalisation des infrastructures nécessaires.<br />
Les flux se raréfi<strong>en</strong>t et ne bénéfici<strong>en</strong>t pas au territoire sauf sur quelques<br />
segm<strong>en</strong>ts très étroits. Faute de mise <strong>en</strong> service des contournem<strong>en</strong>ts et des<br />
raccordem<strong>en</strong>ts autoroutiers, le réseau secondaire peine à absorber les trafics. Il y<br />
a une généralisation des nouvelles formes de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts collectifs<br />
(covoiturage) et les transports <strong>en</strong> commun sont maint<strong>en</strong>us <strong>en</strong> l'état. Des lignes<br />
ferroviaires voyageurs infrarégionales « r<strong>en</strong>tables » sont rouvertes et leur<br />
sécurité mise à niveau mais le fret reste à l’état embryonnaire. Les travaux de<br />
mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine ne sont pas réalisés. Seul reste le<br />
transport de matériaux. Le Havre n’arrive pas à « décoller ». Les ports<br />
secondaires se développ<strong>en</strong>t autour du nautisme, de <strong>la</strong> pêche et de quelques<br />
trafics de niches. Aucun aéroport international ne se développe sur le territoire<br />
normand et aucune liaison rapide vers Roissy ou Orly n’est mise <strong>en</strong> œuvre.<br />
→ H3 : Accessibilité améliorée et multimodalité. Flux innervant le<br />
territoire<br />
Les grands projets sont réalisés ainsi que le mail<strong>la</strong>ge territorial et <strong>la</strong> multimodalité<br />
se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. La mobilité s’organise dans <strong>la</strong> complém<strong>en</strong>tarité des modes.<br />
Octobre 2012 73
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les flux augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t et comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à innerver et à bénéficier à l’<strong>en</strong>semble du<br />
territoire. Les contournem<strong>en</strong>ts et raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. La part de<br />
l'automobile est réduite <strong>en</strong> ville au profit du développem<strong>en</strong>t des réseaux urbains<br />
de transport et cyc<strong>la</strong>bles. Les p<strong>la</strong>teformes multimodales sont des lieux de gestion<br />
des flux et de services aux usagers. Les raccordem<strong>en</strong>ts ferroviaires aux réseaux à<br />
grande vitesse europé<strong>en</strong> profit<strong>en</strong>t à tous grâce au développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales. Le fret au départ du Havre vers <strong>la</strong> région parisi<strong>en</strong>ne se<br />
développe.<br />
Les travaux de mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine sont réalisés. Gros<br />
développem<strong>en</strong>t du transport de déchets. Port 2000 réussit à capter des tonnages<br />
jusqu’alors <strong>destin</strong>és aux ports du Nord grâce au développem<strong>en</strong>t des liaisons vers<br />
son hinter<strong>la</strong>nd et aux ports secondaires. L’accès à Roissy est amélioré.<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t Deauville pr<strong>en</strong>d son essor.<br />
→ H4 : Mobilité optimale, multimodalité réussie. Flux irrigant tout le<br />
territoire<br />
Les grands projets sont réalisés ainsi que le mail<strong>la</strong>ge territorial et <strong>la</strong> multimodalité<br />
est réussie. La mobilité est optimale. Les flux irrigu<strong>en</strong>t tout le territoire. Les<br />
contournem<strong>en</strong>ts et raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. La sécurité est augm<strong>en</strong>tée. Les<br />
connexions aux modes doux font l’objet de toutes les att<strong>en</strong>tions. La part de<br />
l'automobile est réduite <strong>en</strong> ville au profit du développem<strong>en</strong>t des réseaux urbains<br />
de transport et cyc<strong>la</strong>bles. Les raccordem<strong>en</strong>ts ferroviaires aux réseaux à grande<br />
vitesse europé<strong>en</strong> profit<strong>en</strong>t à tous grâce au développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales et le trafic fret est optimisé grâce à l’imp<strong>la</strong>ntation d’un terminal de<br />
transport combiné <strong>en</strong> région et <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> service de <strong>la</strong> LNPN. Un véritable<br />
« hub » régional se développe autour de <strong>la</strong> gare de Rou<strong>en</strong>. Les travaux de mise à<br />
niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine sont réalisés, le Canal Seine Nord ne se fait pas<br />
aussi vite que prévu. Les parts de marché augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t. Port 2000 réussit à capter<br />
des tonnages jusqu’alors <strong>destin</strong>és aux ports du Nord grâce au développem<strong>en</strong>t des<br />
liaisons vers son hinter<strong>la</strong>nd et aux ports secondaires qui jou<strong>en</strong>t leur rôle dans le<br />
cabotage le long d’une autoroute de <strong>la</strong> Mer vers l’Espagne. Le trafic passager<br />
s’int<strong>en</strong>sifie <strong>pour</strong> le transmanche et le Transat<strong>la</strong>ntique se développe. Les accès<br />
ferroviaires et routiers à l’aéroport de Deauville sont réalisés. Il devi<strong>en</strong>t l’aéroport<br />
international utilisé par les décideurs de l’Axe Paris Seine <strong>Normandie</strong> qui lou<strong>en</strong>t<br />
son accès fluide. Boos garde et développe sa p<strong>la</strong>teforme médicale <strong>pour</strong> les greffes<br />
pratiquées au CHU.<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable 22<br />
• Citoy<strong>en</strong>s – Associations<br />
• Entreprises<br />
• Collectivités locales<br />
• Etat<br />
• Recherche<br />
22 Pascal BAIN, Sébasti<strong>en</strong> MAUJEAN, Jacques THEYS, AGORA 2020 - Vivre, habiter, se dép<strong>la</strong>cer <strong>en</strong><br />
2020 : quelles priorités de recherche?, Ministère de l'Écologie, du Développem<strong>en</strong>t et de<br />
l'Aménagem<strong>en</strong>t durables - Direction de <strong>la</strong> recherche et de l'animation sci<strong>en</strong>tifique et technique -<br />
C<strong>en</strong>tre de prospective et de veille sci<strong>en</strong>tifique et technologique.<br />
Octobre 2012 74
Variable Accessibilité immatérielle et organisationnelle<br />
3. Fiche variable « Accessibilité immatérielle et<br />
organisationnelle »<br />
Définitions<br />
Le haut débit (HD) consiste <strong>en</strong> un transfert de données à hauteur de 512 Kbit/s<br />
– le bit étant l’unité de mesure du débit d’information transmis sur un réseau<br />
(soit le nombre de caractères reçus ou émis par seconde).<br />
Le très haut débit (THD) consiste <strong>en</strong> une vitesse de transmission al<strong>la</strong>nt de 20<br />
Mbit/s à 100 Mbit/s. Il permet d’accéder à Internet avec plus de débit numérique<br />
tout <strong>en</strong> diversifiant les usages que l’on peut <strong>en</strong> faire.<br />
Le très haut débit fixe : les technologies de type FTTB, utilisées dans les<br />
réseaux câblés avec un câble optique arrivant <strong>en</strong> pied d’immeuble (sur certains<br />
réseaux câblés un peu moins performants, <strong>la</strong> fibre optique s’arrête au dernier<br />
amplificateur, avec <strong>la</strong> technologie FTTLA) ; les technologies FTTH, avec un réseau<br />
optique de bout <strong>en</strong> bout, déployé jusqu’au logem<strong>en</strong>t des abonnés.<br />
La quatrième génération de téléphonie mobile : 4G est <strong>la</strong> 4 e génération<br />
des standards <strong>pour</strong> <strong>la</strong> téléphonie mobile Elle est le successeur de <strong>la</strong> 3G et de <strong>la</strong><br />
2G. Elle permet le « très haut débit mobile », soit des transmissions de données<br />
à des débits théoriques supérieurs à 100 Mb/s. Ces débits serai<strong>en</strong>t <strong>en</strong> pratique<br />
de l'ordre de quelques dizaines de Mb/s, suivant le nombre d'utilisateurs puisque<br />
<strong>la</strong> bande passante est partagée <strong>en</strong>tre les terminaux actifs des utilisateurs<br />
prés<strong>en</strong>ts dans une même cellule radio.<br />
Le futur standard LTE (Long Term Evolution) <strong>en</strong>core appelé 4G permettra l’accès<br />
au très haut débit sur mobile et s’appuiera <strong>pour</strong> partie sur les fréqu<strong>en</strong>ces libérées<br />
par le divid<strong>en</strong>de numérique suite à l’extinction de <strong>la</strong> diffusion de <strong>la</strong> télévision<br />
analogique.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
• Nombre de zones b<strong>la</strong>nches 23<br />
• Pourc<strong>en</strong>tage du territoire couvert par <strong>la</strong> fibre optique<br />
• Débit et tarif moy<strong>en</strong> des connexions haut et très haut débit, avec et sans fil,<br />
selon les zones (urbaine d<strong>en</strong>se, périurbain, zones rurales)<br />
• Nombre d'<strong>en</strong>treprises / de foyers connectés à <strong>la</strong> fibre optique<br />
• Nombre d'utilisateurs d'accès internet sans fil : 3G et au-delà ; Wi-Fi, Wi MAX<br />
• Nombre de foyers raccordés <strong>en</strong> FTTH (Fiber To The Home)<br />
• Nombre et ampleur des initiatives publiques : mise <strong>en</strong> œuvre d’une politique<br />
<strong>en</strong> faveur du déploiem<strong>en</strong>t des nouvelles infrastructures numériques (réseaux<br />
d’initiatives publics, boucles locales, …), initiatives de promotion, politique<br />
d’accueil, mutualisation du génie civil ou des infrastructures passives ou<br />
actives, mise à disposition facilitée de points hauts…<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
En 2010 <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (SCORAN, source IDATE/France télécom - octobre 2010),<br />
- 8,2 % des lignes téléphoniques n’étai<strong>en</strong>t pas éligibles à l’ADSL supérieure à<br />
2Mbps et 1% des lignes téléphoniques étai<strong>en</strong>t totalem<strong>en</strong>t inéligibles.<br />
- <strong>en</strong> revanche, 64,2% des lignes étai<strong>en</strong>t éligibles à l’offre triple p<strong>la</strong>y (TV +<br />
internet + téléphonie), ce qui est supérieur à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale.<br />
23 Une zone b<strong>la</strong>nche est définie comme telle <strong>en</strong> cas d’abs<strong>en</strong>ce totale du haut débit sur le territoire.<br />
Octobre 2012 75
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
- les répartiteurs téléphoniques (NRA) non-dégroupés étai<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
prés<strong>en</strong>ts sur des zones rurales et étai<strong>en</strong>t de petite capacité.<br />
- 49 zones d’activités étai<strong>en</strong>t raccordées à <strong>la</strong> fibre optique via le réseau SFR.<br />
De plus, il existait :<br />
- plusieurs réseaux d’initiative publique (RIP) dans le départem<strong>en</strong>t de l’Eure<br />
(Net 27) et dans quelques agglomérations (CREA, Euraseine)<br />
- des projets de RIP à différ<strong>en</strong>ts stades d’avancem<strong>en</strong>t sur d’autres territoires<br />
(CC du Pays de Conches, <strong>la</strong> CODAH, <strong>la</strong> CC Caux Vallée de Seine…)<br />
- <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> Seine-Maritime d’un réseau privé opéré par Infosat.<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
L’objectif fixé par l’Etat est que 100% de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion soit couverte <strong>en</strong> THD <strong>en</strong><br />
<strong>2025</strong>. Les investissem<strong>en</strong>ts devront être p<strong>la</strong>nifiés <strong>en</strong> complém<strong>en</strong>tarité par les<br />
opérateurs privés et les collectivités locales. Ainsi, ces dernières ne devront<br />
investir que dans les <strong>en</strong>droits non-r<strong>en</strong>tables <strong>pour</strong> les opérateurs privés et ce, <strong>en</strong><br />
fonction de l’appel à manifestations d’int<strong>en</strong>tions d’investissem<strong>en</strong>t clôturé le 31<br />
janvier dernier. Reste donc <strong>en</strong> susp<strong>en</strong>d <strong>la</strong> question de l’organisation des<br />
collectivités territoriales <strong>pour</strong> apporter le très haut débit dans les zones dites<br />
b<strong>la</strong>nches.<br />
Chaque région a donc é<strong>la</strong>boré une Stratégie de Cohér<strong>en</strong>ce Régionale<br />
d’Aménagem<strong>en</strong>t Numérique (SCORAN).<br />
La SCORAN <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>pour</strong>suit un triple objectif :<br />
• le premier objectif, lié à un horizon à 5 ans, vise à assurer une couverture<br />
haut débit <strong>pour</strong> tous ;<br />
• le deuxième objectif, lié à un horizon à 5 ans, vise à assurer un accès à des<br />
services très haut débit <strong>pour</strong> les <strong>en</strong>treprises régionales localisées dans les<br />
zones d’activités d’intérêt départem<strong>en</strong>tal et régional ;<br />
• le troisième objectif, lié à un horizon à 15 ans, répond à l’ambition nationale<br />
de proposer un accès très haut débit à l’<strong>en</strong>semble des foyers, selon les<br />
technologies les plus adaptées aux territoires.<br />
Sur <strong>la</strong> base de l’interprétation des int<strong>en</strong>tions de déploiem<strong>en</strong>t des opérateurs<br />
privés et <strong>en</strong> pr<strong>en</strong>ant l’hypothèse d’une couverture THD de 90 % des communes<br />
concernées à 2020 (soit 5 ans après le démarrage des travaux), <strong>la</strong> part des<br />
foyers pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t raccordés au THD par les opérateurs serait de : 47,0% <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> ; 20,6% dans l’Eure et 58,4% <strong>en</strong> Seine-Maritime.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> traduction des int<strong>en</strong>tions de déploiem<strong>en</strong>t des opérateurs fait apparaître<br />
que 47% des foyers sont pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t concernés, soit un peu moins d’un<br />
foyer sur deux.<br />
Octobre 2012 76
Des sites prioritaires ont été id<strong>en</strong>tifiés :<br />
Variable Accessibilité immatérielle et organisationnelle<br />
Les principales ori<strong>en</strong>tations ret<strong>en</strong>ues (SCORAN – 2012) concern<strong>en</strong>t :<br />
• l’équité et <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce du déploiem<strong>en</strong>t très haut débit :<br />
- <strong>en</strong> veil<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce dans <strong>la</strong> conduite et <strong>la</strong> réalisation des schémas<br />
d’ingénierie<br />
- <strong>en</strong> s’assurant de <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> compte des sites prioritaires dans le cadre des<br />
SDAN : Les communes disposant d’un site prioritaire d’intérêt<br />
départem<strong>en</strong>tal ou régional tel que validé dans les SDAN seront traitées de<br />
manière prioritaire dans le déploiem<strong>en</strong>t du THD<br />
- <strong>en</strong> réservant aux collectivités <strong>la</strong> possibilité d’interv<strong>en</strong>ir sur les communes<br />
visées par les int<strong>en</strong>tions de déploiem<strong>en</strong>t des opérateurs privés<br />
- <strong>en</strong> <strong>en</strong>visageant <strong>la</strong> montée <strong>en</strong> débit <strong>pour</strong> les territoires ne disposant pas de<br />
sites prioritaires par des technologies alternatives à <strong>la</strong> fibre<br />
- <strong>en</strong> constituant une p<strong>la</strong>teforme régionale SIG permettant d’effectuer un<br />
suivi du déploiem<strong>en</strong>t très haut débit fi<strong>la</strong>ire et hertzi<strong>en</strong>.<br />
• <strong>la</strong> valorisation des atouts, des compét<strong>en</strong>ces et des savoir-faire régionaux :<br />
- <strong>en</strong> accompagnant les initiatives <strong>en</strong> matière de déploiem<strong>en</strong>t des<br />
infrastructures très haut débit par un souti<strong>en</strong> et un accompagnem<strong>en</strong>t des<br />
projets d’usages et services numériques relevant notamm<strong>en</strong>t des atouts<br />
régionaux<br />
- <strong>en</strong> é<strong>la</strong>borant un p<strong>la</strong>n de formation ciblé sur <strong>la</strong> filière régionale des<br />
instal<strong>la</strong>teurs réseaux afin de s’assurer de <strong>la</strong> montée <strong>en</strong> compét<strong>en</strong>ce des<br />
professionnels et de les préparer aux marchés de travaux qui vont être<br />
<strong>la</strong>ncés dans les 15 prochaines années<br />
• <strong>la</strong> gouvernance part<strong>en</strong>ariale et mise <strong>en</strong> œuvre :<br />
- <strong>en</strong> veil<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce des SDAN <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
- <strong>en</strong> établissant un dispositif de gouvernance régional d’ici fin 2012<br />
- <strong>en</strong> affectant des ressources à <strong>la</strong> s<strong>en</strong>sibilisation des collectivités, des<br />
maîtres d’ouvrage, des bailleurs sociaux aux <strong>en</strong>jeux du très haut débit<br />
- <strong>en</strong> assurant un suivi précis des modalités d’accès aux financem<strong>en</strong>ts publics<br />
mobilisables, notamm<strong>en</strong>t ceux du niveau Etat et Europe<br />
- <strong>en</strong> veil<strong>la</strong>nt à ce que l’<strong>en</strong>semble des collectivités s’implique <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce<br />
dans les futurs déploiem<strong>en</strong>ts du THD <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et participe<br />
selon leurs capacités au p<strong>la</strong>n de financem<strong>en</strong>t.<br />
Octobre 2012 77
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les ruptures possibles<br />
• La rupture sociale : l'ext<strong>en</strong>sion de <strong>la</strong> connectivité se heurte soit aux normes<br />
sociales <strong>en</strong> matière de vie privée, soit à l’insécurité (multiplication des<br />
arnaques, erreurs, …), soit à l’inf<strong>la</strong>tion des coûts (reprise <strong>en</strong> mains par un<br />
petit nombre de grands opérateurs multiservices qui appliqu<strong>en</strong>t de nouveaux<br />
péages sur le réseau). De plus <strong>en</strong> plus de personnes rev<strong>en</strong>diqu<strong>en</strong>t un « droit<br />
à <strong>la</strong> déconnexion ».<br />
• La rupture technique : face à l’ext<strong>en</strong>sion des usages, les technologies<br />
actuelles ne satisfont plus les exig<strong>en</strong>ces toujours croissantes des usagers.<br />
Faute de moy<strong>en</strong>s <strong>la</strong> recherche peine à trouver d’autres solutions.<br />
• Autre rupture technique : une nouvelle technologie apparait, elle devi<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
norme et r<strong>en</strong>d obsolètes celles <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce.<br />
• L’appropriation citoy<strong>en</strong>ne : « les réseaux sans opérateurs », <strong>pour</strong> échapper au<br />
pouvoir des grands opérateurs et assurer le r<strong>en</strong>ouveau de <strong>la</strong> vie locale du<br />
territoire, des réseaux locaux se multipli<strong>en</strong>t.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 - Le développem<strong>en</strong>t du Haut débit ne se fait pas par manque de<br />
moy<strong>en</strong>s financiers et faute de r<strong>en</strong>tabilité <strong>pour</strong> les opérateurs. Les zones<br />
b<strong>la</strong>nches ne sont pas résorbées.<br />
→ H2 - Le Haut Débit ne couvre pas l’<strong>en</strong>semble du territoire et le THD ne<br />
se développe que sur les zones économiquem<strong>en</strong>t ciblées par les opérateurs.<br />
→ H3 - Le Très Haut Débit est opérationnel et son usage se développe sur<br />
l’<strong>en</strong>semble du territoire.<br />
→ H4 - Développem<strong>en</strong>t du Très Haut Débit et des dernières recherches sur<br />
tout le territoire grâce à l’innovation portée <strong>en</strong>tre autres par le CRIHAN. La<br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> devi<strong>en</strong>t région pilote et tire un avantage du développem<strong>en</strong>t<br />
du THD <strong>en</strong> se spécialisant dans les e-services<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
- les collectivités locales via le 276 – acteurs politiques – acteurs consu<strong>la</strong>ires<br />
- les opérateurs privés positionnés AMII<br />
- Acteurs économiques : <strong>la</strong> SAPN, ERDF, SNCF (tous trois au titre de leur accès<br />
privilégié à <strong>la</strong> fibre optique dans le cadre de leurs activités respectives)<br />
Sources :<br />
- « ProspecTIC 2010 - T<strong>en</strong>dances et <strong>en</strong>jeux technologiques », publication Fing - Irepp,<br />
(rapport au format PDF) : www.fing.org/prospectic<br />
- « Technologies clés 2010 », Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,<br />
Rapport au format PDF : www.industrie.gouv.fr/techno_cles_2010/html/sommaire.html<br />
- « P<strong>la</strong>n d’action <strong>en</strong> faveur du très haut débit » (novembre 2006) :<br />
www.industrie.gouv.fr/portail/secteurs/p<strong>la</strong>nTHD.pdf<br />
- « Article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales » (CGCT) :<br />
http://www.art-telecom.fr/fileadmin/reprise/dossiers/d07-tabcgct-1204.pdf<br />
- « SCORAN – Stratégie de cohér<strong>en</strong>ce régionale d’aménagem<strong>en</strong>t numérique <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> » – Préfecture et Région de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> - Cabinets Idate /Setics<br />
/Pixelius<br />
Octobre 2012 78
Variable Démographie<br />
4. Fiche variable « Démographie »<br />
Définitions<br />
Deux définitions (du grec "demos" signifiant peuple) :<br />
• une Sci<strong>en</strong>ce : <strong>en</strong>semble des méthodes propres à l'étude et à l'analyse<br />
quantitative et qualitative des popu<strong>la</strong>tions et de leurs dynamiques à partir de<br />
données repérables.<br />
• un <strong>en</strong>semble de données numériques caractérisant les évolutions de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion dans un espace p<strong>en</strong>dant une période<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
• L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) mesure le nombre d'<strong>en</strong>fants<br />
qu'aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés<br />
l’année considérée à chaque âge demeurai<strong>en</strong>t inchangés.<br />
• Le taux de natalité d’une année est le nombre des naissances vivantes au<br />
cours d'une année divisé par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale moy<strong>en</strong>ne de l’année.<br />
• L'espérance de vie est le nombre moy<strong>en</strong> d'années qu'une personne peut<br />
s'att<strong>en</strong>dre à vivre si elle est soumise aux conditions de mortalité de l’année.<br />
• Le taux de mortalité d’une année est le nombre de décès au cours d'une<br />
année divisé par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion totale moy<strong>en</strong>ne de l’année.<br />
Deux soldes sont intéressants <strong>en</strong> démographie :<br />
• Le solde naturel est <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre le nombre de naissances et le nombre<br />
de décès domiciliés dans un espace p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> période considérée.<br />
• Le solde migratoire est <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre le nombre de personnes qui sont<br />
<strong>en</strong>trées sur le territoire et le nombre de personnes qui <strong>en</strong> sont sorties d'un<br />
territoire p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> période considérée.<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
Sur un siècle d’évolution de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, <strong>la</strong> courbe de <strong>la</strong> démographie hautnormande<br />
« constatée » suit des évolutions contrastées, diverg<strong>en</strong>tes parfois de<br />
celles observables <strong>en</strong> France métropolitaine (FM) à certaines périodes du XXème<br />
siècle, mais on aboutit à un accroissem<strong>en</strong>t de popu<strong>la</strong>tion régionale depuis 1900<br />
équival<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale.<br />
La popu<strong>la</strong>tion atteint au 1 er janvier 2010<br />
(donnée provisoire) 1 837 000 hab.<br />
En 2009 :<br />
• l'âge moy<strong>en</strong> de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion normande<br />
est de 38,5 ans, ce qui <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse parmi<br />
les régions les plus jeunes (après l'Ile<br />
de France, <strong>la</strong> Picardie et le Nord Pas de<br />
Ca<strong>la</strong>is)<br />
• <strong>la</strong> fécondité est plus élevée qu’<strong>en</strong> FM :<br />
ICF= 205 <strong>en</strong>fants <strong>pour</strong> 100 femmes contre 198 <strong>en</strong>fants <strong>pour</strong> 100 femmes<br />
Octobre 2012 79
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• l'espérance de vie y est plus faible qu’<strong>en</strong> FM : Femmes : 83,7 ans contre 84,3<br />
ans / Hommes : 76,0 ans contre 77,8 ans.<br />
Le solde migratoire est négatif. Même si l'Ile de France procure à <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> un solde fortem<strong>en</strong>t positif (+13000 <strong>en</strong>tre 2007 et 2012); des flux<br />
migratoires de sorties sont importants vers <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>, Bretagne, Pays<br />
de Loire).<br />
Ainsi, <strong>en</strong>tre 1990 et 2010, <strong>la</strong> croissance annuelle moy<strong>en</strong>ne de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion hautnormande<br />
de 0,28% est le résultat d'une contribution du solde naturel de 0,45 %<br />
et d'une contribution du déficit migratoire de -0,17%.<br />
Répartition géographique :<br />
Une popu<strong>la</strong>tion assez bi<strong>en</strong> répartie sur le territoire, avec une d<strong>en</strong>sité de 149,2<br />
hab. /km² contre 115,4 hab. /km² <strong>en</strong> 2010.<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
L’INSEE a procédé à une projection de popu<strong>la</strong>tion qui fournit une image de ce<br />
que <strong>pour</strong>rait être <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à v<strong>en</strong>ir, à partir de <strong>la</strong> connaissance du passé et <strong>en</strong><br />
pr<strong>en</strong>ant <strong>pour</strong> le futur des hypothèses sur certains paramètres. La projection est<br />
donc une simu<strong>la</strong>tion et non pas une prévision et s’établit ainsi :<br />
∆ popu<strong>la</strong>tion = naissances – décès + arrivées – départs<br />
Ainsi autour d’un sc<strong>en</strong>ario c<strong>en</strong>tral qui <strong>pour</strong>suit les t<strong>en</strong>dances observées sur <strong>la</strong><br />
première moitié du XXIe siècle, dans l'hypothèse du mainti<strong>en</strong> des<br />
comportem<strong>en</strong>ts démographiques réc<strong>en</strong>ts, les perspectives font apparaître :<br />
Une croissance de plus <strong>en</strong> plus ral<strong>en</strong>tie et une popu<strong>la</strong>tion totale de<br />
2 millions d'habitants <strong>en</strong> 2040.<br />
Une cassure <strong>en</strong> 2020 de <strong>la</strong> courbe démographique :<br />
• <strong>en</strong>tre 2007 et 2020, mainti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> croissance de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion normande<br />
(0,29 %/an)<br />
• <strong>en</strong>tre 2020 et 2040, fléchissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> croissance démographique à 0,16 %<br />
/ an.<br />
Vers un solde naturel nul :<br />
• l'excéd<strong>en</strong>t du nombre de naissances sur les décès contribuerait à<br />
l'augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre 2007 et 2040<br />
• le nombre annuel de naissances qui était de 24000 sur <strong>la</strong> période 1990 –1994<br />
fléchirait <strong>pour</strong> atteindre 22000 sur <strong>la</strong> période 2035 - 2040<br />
• le nombre annuel de décès augm<strong>en</strong>terait notablem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> passer de 15 000<br />
Octobre 2012 80
Variable Démographie<br />
à 20 000 sur les mêmes périodes. De ce fait, le solde naturel diminuerait de<br />
manière t<strong>en</strong>dancielle.<br />
Une déformation de <strong>la</strong> pyramide des âges, avec un poids de plus <strong>en</strong> plus<br />
important du nombre de personnes de plus de 60 ans (issus du « baby<br />
boom »).Cette t<strong>en</strong>dance apparaît irréversible et ce vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
a un double effet :<br />
- <strong>la</strong> baisse de <strong>la</strong> natalité par diminution re<strong>la</strong>tive du nombre de femmes <strong>en</strong> âge de<br />
procréer<br />
- une hausse de <strong>la</strong> mortalité par une croissance du nombre de personnes âgées<br />
issues du « baby boom » des années1950 – 1970.<br />
Ainsi, <strong>en</strong> 2040, les ratios :<br />
• « nombre de personnes de plus de<br />
80 ans/ nombre des moins de 20<br />
ans » passerait de 0,17 <strong>en</strong> 2007 à<br />
0,42.<br />
• « nombre des plus de 60 ans /<br />
nombre des moins de 20 ans »<br />
serait légèrem<strong>en</strong>t supérieur à<br />
l'unité.<br />
Le solde migratoire :<br />
Négatif aujourd'hui, il <strong>pour</strong>rait s'améliorer, voire dev<strong>en</strong>ir légèrem<strong>en</strong>t positif vers<br />
2040. Même si nos jeunes continu<strong>en</strong>t à migrer vers des régions plus<br />
prometteuses (Ile de France, Bretagne), d'autres régions <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t permettre à<br />
<strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> une croissance de sa popu<strong>la</strong>tion (Picardie, Nord-Pas-de-<br />
Ca<strong>la</strong>is, Champagne-Ard<strong>en</strong>ne, C<strong>en</strong>tre...).<br />
Les ruptures possibles<br />
Les ruptures possibles influ<strong>en</strong>çant le solde naturel :<br />
• une forte augm<strong>en</strong>tation du taux de natalité : peu probable, même s’il peut<br />
s'élever légèrem<strong>en</strong>t compte t<strong>en</strong>u de <strong>la</strong> jeunesse re<strong>la</strong>tive de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
normande (âge moy<strong>en</strong> 38,2 ans contre 39,3 ans <strong>en</strong> France métropolitaine <strong>en</strong><br />
2010).<br />
• une forte hausse du taux de mortalité : possible, due à divers élém<strong>en</strong>ts<br />
comme <strong>la</strong> détérioration des conditions climatiques (canicule), des conditions<br />
de vie (épidémies, stress au travail), des conditions <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales<br />
(pollution, incid<strong>en</strong>t nucléaire,...)<br />
Les ruptures possibles influ<strong>en</strong>çant le solde migratoire :<br />
• un fort accroissem<strong>en</strong>t du solde dû à une croissance économique sout<strong>en</strong>ue<br />
dans <strong>la</strong> région, par le développem<strong>en</strong>t des échanges avec l'extérieur via les<br />
ports, à une croissance de l'emploi, notamm<strong>en</strong>t qualifié et stable, à des<br />
conditions de vie et de logem<strong>en</strong>t favorables.<br />
• Une forte détérioration du solde migratoire <strong>en</strong> raison des élém<strong>en</strong>ts inverses.<br />
Le départ des jeunes, notamm<strong>en</strong>t 20 / 30 ans, aurait alors un impact négatif<br />
sur <strong>la</strong> natalité au sein de <strong>la</strong> région.<br />
Les hypothèses<br />
Il ne sera pas établi d’hypothèses contrastées sur cette variable à l’horizon <strong>2025</strong><br />
(15 ans) car elle est soumise à des t<strong>en</strong>dances « lourdes » difficiles à infléchir sur<br />
une si courte période.<br />
Octobre 2012 81
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
A l’horizon 2040, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion haut-normande est estimée dans le sc<strong>en</strong>ario<br />
c<strong>en</strong>tral à 1 950 000 habitants. Les hypothèses les plus optimistes (fécondité,<br />
espérance de vie et migrations haute) conduirai<strong>en</strong>t à 2 060 000 habitants et<br />
24,6 % de moins de 20 ans tandis que, par dualité, les plus pessimistes<br />
conduirai<strong>en</strong>t à 1 830 000 habitants et 22,3 % de moins de 20 ans. La proportion<br />
de 65 ans ou plus est re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t indép<strong>en</strong>dante des ces hypothèses.<br />
Au-delà de ces hypothèses, on peut relever quelques <strong>en</strong>jeux mis <strong>en</strong> exergue<br />
par <strong>la</strong> combinaison des t<strong>en</strong>dances et des ruptures possibles <strong>pour</strong> les déc<strong>en</strong>nies à<br />
v<strong>en</strong>ir dont il faut t<strong>en</strong>ir compte dans les hypothèses posées sur les autres<br />
variables:<br />
- l’attractivité du territoire<br />
Sans migration, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion haut-normande augm<strong>en</strong>terait beaucoup plus vite.<br />
À l'horizon 2040, on compterait 60 000 habitants supplém<strong>en</strong>taires par rapport au<br />
sc<strong>en</strong>ario précéd<strong>en</strong>t. Le «coût» des migrations s'élèverait à <strong>en</strong>viron 2 000<br />
personnes par an et près de <strong>la</strong> moitié d'<strong>en</strong>tre elles serai<strong>en</strong>t des jeunes âgés de<br />
moins de 30 ans. Ce<strong>la</strong> soulève toute <strong>la</strong> problématique de l’accueil et de l’apport<br />
des immigrants.<br />
- le vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
L’exemple le plus emblématique est celui du nombre de c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aires qui passerait<br />
de 600 à 2 700. Ce<strong>la</strong> soulève un certain nombre de problèmes dans le domaine<br />
de <strong>la</strong> dép<strong>en</strong>dance notamm<strong>en</strong>t mais ouvre aussi des opportunités <strong>en</strong> <strong>en</strong> termes de<br />
gisem<strong>en</strong>ts d’emplois. Enfin, les structures de consommation et de rev<strong>en</strong>u s’<strong>en</strong><br />
trouveront modifiées.<br />
- l’équilibre des popu<strong>la</strong>tions sur le territoire<br />
Les évolutions ne seront pas uniformes et <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t conduire à des<br />
recompositions spatiales, de plus <strong>en</strong> plus étroitem<strong>en</strong>t liées aux axes de<br />
circu<strong>la</strong>tion et de communication (<strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec <strong>la</strong> problématique de l’accès aux<br />
soins).<br />
- l’impact sur les évolutions de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active<br />
Au vu des t<strong>en</strong>dances démographiques et, <strong>en</strong> particulier, du phénomène de<br />
vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, les actifs de plus de 55 ans serai<strong>en</strong>t davantage<br />
représ<strong>en</strong>tés au sein de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion régionale à l'horizon 2020. Le phénomène<br />
du vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ayant déjà pris son essor, certains secteurs<br />
sont d'ores et déjà concernés. Tout ce<strong>la</strong> soulève, <strong>en</strong>tre autres, les défis du<br />
r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de main-d’œuvre, du transfert des compét<strong>en</strong>ces aux plus jeunes<br />
et de <strong>la</strong> productivité.<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
La démographie concerne par définition l’<strong>en</strong>semble des acteurs dans <strong>la</strong> mesure<br />
où elle porte sur l’aspect quantitatif et qualitatif des êtres humains.<br />
Plus spécifiquem<strong>en</strong>t, quelques activités économiques sont plus <strong>en</strong> prise que<br />
d’autres avec le niveau et <strong>la</strong> nature de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion : le commerce, <strong>la</strong><br />
construction, les services aux particuliers (notamm<strong>en</strong>t de soins ou de proximité).<br />
Sources :<br />
- Prévisions de l'INSEE suivant un sc<strong>en</strong>ario c<strong>en</strong>tral supposant l'<strong>en</strong>semble des variables<br />
démographiques constantes par rapport à 2007.<br />
- Revue Aval, n° 100, décembre 2010<br />
- Revue Insee, n° 1326, décembre 2010<br />
- Rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion INSEE 2006<br />
Octobre 2012 82
Variable Mondialisation de l’économie<br />
5. Fiche variable « Mondialisation de l’économie »<br />
Définitions<br />
Parler de mondialisation, c'est évoquer l'emprise d'un système économique, les<br />
marchés, sur l'espace mondial. Ainsi, il est possible de définir <strong>la</strong> mondialisation<br />
comme « un processus de contournem<strong>en</strong>t, voire de démantèlem<strong>en</strong>t des frontières<br />
physiques et règlem<strong>en</strong>taires faisant obstacle à l'accumu<strong>la</strong>tion du capital à<br />
l'échelle mondiale » (J. Adda, 1996).<br />
Deux phénomènes caractéris<strong>en</strong>t <strong>la</strong> mondialisation : <strong>la</strong> préémin<strong>en</strong>ce des marchés<br />
et les investissem<strong>en</strong>ts directs à l'étranger.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
Volume d’importations et d’exportations des différ<strong>en</strong>ts pays<br />
Investissem<strong>en</strong>ts directs à l’étranger (IDE)<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
1. La préémin<strong>en</strong>ce des marchés<br />
L'effondrem<strong>en</strong>t du bloc soviétique et son difficile passage à l'économie de marché<br />
ont déverrouillé les principaux obstacles à <strong>la</strong> mondialisation de l'économie qui<br />
avait réellem<strong>en</strong>t comm<strong>en</strong>cé dans les années 1960/70. Même là où des régimes<br />
communistes subsist<strong>en</strong>t (Chine), l'ouverture à l'économie de marché s'est<br />
progressivem<strong>en</strong>t imposée à <strong>la</strong> fois par l'intérieur sous l'influ<strong>en</strong>ce d'une élite et des<br />
gouvernants et, par l'étranger du fait d'un afflux de capitaux et de technologies.<br />
Le reste de l'Asie, l'Amérique <strong>la</strong>tine et, dans une moindre mesure, l'Afrique ont<br />
subi cette ouverture des marchés par les préconisations des institutions<br />
internationales (Fonds monétaire international et Banque mondiale). Celles-ci ont<br />
forcé ces différ<strong>en</strong>tes régions, prises dans <strong>la</strong> crise de <strong>la</strong> dette, à réformer <strong>en</strong><br />
profondeur leurs structures économiques et leurs politiques économiques <strong>pour</strong><br />
introduire plus de « libéralisme ». Ces réformes ont conduit notamm<strong>en</strong>t à <strong>la</strong><br />
privatisation des grands secteurs économiques et à <strong>la</strong> fin des situations de<br />
monopole sur les marchés internes (mouvem<strong>en</strong>t de dérégu<strong>la</strong>tion des marchés<br />
nationaux). La finalité de ces impulsions était de faire r<strong>en</strong>trer ces économies dans<br />
une logique concurr<strong>en</strong>tielle <strong>en</strong>tre les productions locales et les productions des<br />
pays les plus développés. Mais, cette concurr<strong>en</strong>ce a été et reste <strong>en</strong>core déloyale,<br />
compte t<strong>en</strong>u des écarts de productivité <strong>en</strong>tre les pays et de qualité <strong>en</strong>tre les<br />
produits et égalem<strong>en</strong>t des diverses protections (brevets, lic<strong>en</strong>ces, normes,...)<br />
mises <strong>en</strong> œuvre par les pays à haut niveau de rev<strong>en</strong>u.<br />
La mondialisation a égalem<strong>en</strong>t transformé l'organisation de <strong>la</strong> production qui<br />
passe d'un niveau national à une dim<strong>en</strong>sion transnationale, tout <strong>en</strong> lissant les<br />
normes de consommation. Aux complém<strong>en</strong>tarités de production qui existai<strong>en</strong>t<br />
jusque dans les années 60/70 et justifiai<strong>en</strong>t les échanges internationaux de bi<strong>en</strong>s<br />
et de capitaux, ont succédé des substituabilités dans l'origine des échanges,<br />
créant de nouvelles sources de trafics commerciaux (à l’instar des<br />
développem<strong>en</strong>ts des échanges <strong>en</strong>tre l’Est et l’Ouest), mais aussi des<br />
détournem<strong>en</strong>ts de trafics de marchandises, de facteurs de production et de<br />
services (au profit des échanges Europe/Asie et au détrim<strong>en</strong>t des échanges<br />
Europe/Afrique).<br />
Octobre 2012 83
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Ainsi, chaque économie est r<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>ce avec le reste du monde aussi<br />
bi<strong>en</strong> sur les marchés <strong>en</strong> amont (matières premières, main-d' œuvre notamm<strong>en</strong>t<br />
qualifiée, techniques de production, épargne,...) que sur les marchés <strong>en</strong> aval<br />
(bi<strong>en</strong>s et services, savoir-faire, informations,...).<br />
Cep<strong>en</strong>dant, l'intégration croissante d'économies à niveau de développem<strong>en</strong>t<br />
différ<strong>en</strong>t donne à l'économie mondiale une dynamique propre échappant de plus<br />
<strong>en</strong> plus au contrôle des États, même les plus puissants. Dans ce cadre de<br />
fonctionnem<strong>en</strong>t de l'économie mondiale, <strong>la</strong> position de l'État national semble<br />
reculer. Les logiques intégratrices privées dépass<strong>en</strong>t les logiques protectrices des<br />
États nationaux, dont le rôle et <strong>la</strong> puissance sont dilués. La mondialisation les<br />
prive, partiellem<strong>en</strong>t ou totalem<strong>en</strong>t, des instrum<strong>en</strong>ts traditionnels de politique<br />
économique que sont les politiques monétaire et budgétaire 24 . La mondialisation<br />
remet égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cause les fondem<strong>en</strong>ts de certaines politiques comme les<br />
politiques sociales (santé, retraite,..), les politiques de rev<strong>en</strong>us et de l'emploi, les<br />
politiques de développem<strong>en</strong>t durable industriel, agricole, ou <strong>en</strong>core de transport,<br />
... Ainsi, il apparaît de plus <strong>en</strong> plus difficile <strong>pour</strong> les États :<br />
- de mettre <strong>en</strong> œuvre des politiques économiques cohér<strong>en</strong>tes avec <strong>la</strong><br />
mondialisation et ayant des effets spécifiques sur l'économie nationale ;<br />
- de maint<strong>en</strong>ir les systèmes sociaux établis et coûteux ;<br />
- de maint<strong>en</strong>ir les structures productives et de faire face à une concurr<strong>en</strong>ce<br />
exacerbée de pays à bas coût sa<strong>la</strong>riaux et à leur modification de plus <strong>en</strong> plus<br />
rapide due au progrès technologique ;<br />
- de faire face à une plus grande « vo<strong>la</strong>tilité » des marchés.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> mondialisation a accru l'incertitude dans les trajectoires économiques de<br />
chaque pays et les t<strong>en</strong>sions internes pouvant <strong>en</strong>traîner <strong>la</strong> chute de pouvoirs<br />
nationaux, à l’exemple du « printemps arabe ». Il reste qu'un moy<strong>en</strong> d'atténuer<br />
les externalités négatives de <strong>la</strong> mondialisation est de r<strong>en</strong>forcer le pouvoir des<br />
États par une intégration économique et politique dans une zone plus <strong>la</strong>rge.<br />
Le commerce mondial s'est fortem<strong>en</strong>t développé sous l'effet, dans un premier<br />
temps, d'une croissance sout<strong>en</strong>ue des échanges de matières premières et de<br />
bi<strong>en</strong>s industriels et, dans un deuxième temps, des services.<br />
Ce développem<strong>en</strong>t des échanges de services donne aux pays à haut rev<strong>en</strong>u une<br />
part non négligeable du commerce international.<br />
Tableau 1 : Exportations et importations<br />
Mondiales des pays à bas rev<strong>en</strong>u,<br />
à rev<strong>en</strong>u intermédiaire<br />
ou à haut rev<strong>en</strong>u <strong>en</strong> 2008<br />
Exports % Imports %<br />
Bas rev<strong>en</strong>u 167.3 1.1 239.4 1.5<br />
Rev<strong>en</strong>u moy<strong>en</strong> 4905.1 30.4 4547.2 27.9<br />
Haut rev<strong>en</strong>u 11060.2 68.5 11522.7 70.6<br />
Ainsi, c’est quasim<strong>en</strong>t 70% du commerce international qui s’effectue <strong>en</strong>tre les<br />
pays à haut rev<strong>en</strong>u dont <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion globale dépasse à peine un milliard<br />
d’individus (15% de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion mondiale) et le rev<strong>en</strong>u global représ<strong>en</strong>te 42050<br />
milliards de $ sur les 57 000 milliards de $ <strong>pour</strong> le monde (soit <strong>en</strong>viron 75%).<br />
2. Les investissem<strong>en</strong>ts directs à l'étranger (IDE)<br />
16132.6 100 16309.5 100<br />
La période de croissance de 1945 à 1973 a permis <strong>la</strong> formation dans les<br />
économies les plus avancées de grands groupes industriels, issus de vagues<br />
successives de conc<strong>en</strong>tration et de restructuration. Poursuivant leur expansion à<br />
24 Cf. fiche variable sur <strong>la</strong> politique générale régionale - <strong>la</strong> crise de <strong>la</strong> dette <strong>en</strong> Europe due à sa<br />
mondialisation.<br />
Octobre 2012 84
Variable Mondialisation de l’économie<br />
l'étranger, ces groupes acquièr<strong>en</strong>t une dim<strong>en</strong>sion internationale (FMN firme multi<br />
nationale). Leur activité se déploie ainsi dans tous les pays industrialisés et les<br />
flux d'investissem<strong>en</strong>t sont symétriques (investissem<strong>en</strong>ts croisés).<br />
Les IDE vis<strong>en</strong>t <strong>la</strong> création ou le développem<strong>en</strong>t ou <strong>la</strong> prise de contrôle<br />
d'<strong>en</strong>treprises exerçant leur activité dans un autre pays. La croissance des IDE<br />
faible, dans les années 60, à l'exception des États-Unis qui investissai<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
Europe et Amérique <strong>la</strong>tine, s'int<strong>en</strong>sifie dans les années 70 avec un rythme de<br />
croissance qui suit celui du commerce mondial (5%/an). Alors que face à <strong>la</strong> crise,<br />
les États t<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t de multiplier les obstacles aux importations (normes, quotas,..),<br />
l’IDE suit le processus d’internationalisation de <strong>la</strong> production. L’essor des marchés<br />
internationaux de capitaux offre de nouvelles possibilités de financem<strong>en</strong>t aux très<br />
grandes firmes à <strong>la</strong> fin des années 80. En 1992, 37000 FMN possédai<strong>en</strong>t des<br />
actifs estimés à 5000 milliards de $ et faisai<strong>en</strong>t travailler 73 millions de<br />
personnes dans le monde. Les 100 firmes les plus importantes dét<strong>en</strong>ai<strong>en</strong>t 3400<br />
milliards de $ d’actifs, soit un sixième des actifs mondiaux. Un tiers du commerce<br />
mondial de bi<strong>en</strong>s et de services correspondait à des échanges intra-firmes.<br />
Dans les années 80, les IDE rest<strong>en</strong>t fixés sur <strong>la</strong> triade (États-Unis, Japon, Europe<br />
de l’ouest). Les firmes europé<strong>en</strong>nes voi<strong>en</strong>t leur IDE quadrupler et l’Europe<br />
devi<strong>en</strong>t le premier espace d’investissem<strong>en</strong>t international dans le monde avec un<br />
stock d’IDE deux fois plus important que les États-Unis (52% - dont 27% <strong>en</strong><br />
Europe de l’ouest - du stock mondial d’IDE contre 25% <strong>pour</strong> les États-Unis et<br />
12% <strong>pour</strong> le Japon).<br />
Cette prépondérance des investissem<strong>en</strong>ts croisés au sein de <strong>la</strong> triade reflète<br />
l’homogénéisation et l’intégration croissante de l’espace économique des pays<br />
industrialisés. Les années 80 sont marquées par une réduction massive des coûts<br />
de communication et de transport, par une libéralisation généralisée des marchés<br />
financiers et par une vague importante de déréglem<strong>en</strong>tations et de<br />
privatisations,... permettant aux grands groupes internationaux de pénétrer de<br />
nombreux marchés par simple acquisition d’actifs.<br />
Les politiques de déréglem<strong>en</strong>tation des marchés ont permis l’essor des IDE dans<br />
les services des pays industrialisés. Les services sont <strong>en</strong> effet exploitables sur<br />
p<strong>la</strong>ce et donc incit<strong>en</strong>t à l’IDE <strong>pour</strong> une firme qui a un avantage dans le domaine.<br />
Ainsi <strong>la</strong> part des services dans le stock mondial d’IDE a dépassé les 50% au début<br />
des années 90 (1/3 dans l’industrie, 1/6 dans les activités primaires).<br />
La conséqu<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> po<strong>la</strong>risation des investissem<strong>en</strong>ts au sein de <strong>la</strong> Triade est<br />
que <strong>la</strong> part de ces IDE vers les économies <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t devi<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong><br />
plus faible. 20% des IDE <strong>en</strong> 1990 avai<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> <strong>destin</strong>ation les pays <strong>en</strong><br />
développem<strong>en</strong>t, dont <strong>la</strong> moitié vers l’Amérique <strong>la</strong>tine et un tiers vers l’Asie ; alors<br />
que 2/3 du stock des IDE <strong>en</strong> 1913 étai<strong>en</strong>t dirigés vers ces mêmes zones <strong>en</strong><br />
développem<strong>en</strong>t (conséqu<strong>en</strong>ce du colonialisme).<br />
Cep<strong>en</strong>dant, <strong>la</strong> croissance des IDE dans les années 80/90 a été forte avec une<br />
nette conc<strong>en</strong>tration des IDE <strong>en</strong> Extrême Ori<strong>en</strong>t et <strong>en</strong> Amérique <strong>la</strong>tine. La Chine<br />
devi<strong>en</strong>t le deuxième pays d’accueil des IDE dans le monde après les États-Unis –<br />
dont une grande partie des IDE vi<strong>en</strong>t des pays émerg<strong>en</strong>ts asiatiques (Hong-Kong,<br />
Taïwan, Corée du sud, Singa<strong>pour</strong>). Cette dynamique d’intégration régionale<br />
s’appuie sur ces flux intra-régionaux d’investissem<strong>en</strong>ts.<br />
Durant les deux dernières déc<strong>en</strong>nies, il est apparu une forte progression des IDE<br />
<strong>en</strong> direction des pays du sud. Les deux tiers de ces flux sont conc<strong>en</strong>trés <strong>en</strong> Asie<br />
de l’est (Chine, Inde, Ma<strong>la</strong>isie, Thaï<strong>la</strong>nde,.. où les coûts de main-d’œuvre sont<br />
faibles), et <strong>en</strong> Amérique <strong>la</strong>tine (Brésil, Arg<strong>en</strong>tine, Mexique, Colombie,.. où les<br />
États ont procédé à un processus d’assainissem<strong>en</strong>t des économies dans les<br />
années 80).<br />
Octobre 2012 85
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Ainsi, le volume des IDE a considérablem<strong>en</strong>t chuté <strong>en</strong>tre 2007 et 2009, passant<br />
de 1617 à 1114 milliards de $. Les trois pays qui ont bénéficié le plus des IDE<br />
mondiaux sont respectivem<strong>en</strong>t les États-Unis (129.9 milliards de $), <strong>la</strong> Chine (95)<br />
et <strong>la</strong> France (59.6). En contrepartie, les États-Unis (248.1 milliards de $), <strong>la</strong><br />
France (147.2) et le Japon (74.7) sont les premiers investisseurs au monde.<br />
Toutefois, les pays émerg<strong>en</strong>ts devi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t d’importants<br />
investisseurs, ce qui a stimulé <strong>la</strong> croissance mondiale, certes faible par rapport au<br />
milieu de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie précéd<strong>en</strong>te.<br />
De plus, <strong>la</strong> baisse re<strong>la</strong>tive du volume des IDE vers les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t,<br />
par rapport aux pays à haut rev<strong>en</strong>u, est beaucoup plus s<strong>en</strong>sible au manque de<br />
confiance <strong>en</strong> l’av<strong>en</strong>ir et à une augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> prime de risque. Par exemple,<br />
l’Amérique <strong>la</strong>tine (notamm<strong>en</strong>t l’Arg<strong>en</strong>tine) a pâti, au début des années 2000, de<br />
son instabilité politique et sociale. L’assainissem<strong>en</strong>t de certaines économies a<br />
conduit à un retour massif des IDE au milieu de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie. Enfin, il faut noter<br />
que ces investissem<strong>en</strong>ts sont extrêmem<strong>en</strong>t vo<strong>la</strong>tiles passant d’une région à une<br />
autre du monde <strong>en</strong> fonction d’élém<strong>en</strong>ts économiques, politiques et sociaux.<br />
Il reste que les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t ne bénéfici<strong>en</strong>t que d’une part minoritaire<br />
des flux d’IDE, même si ces flux se sont accrus <strong>en</strong> volume. Les IDE qui<br />
concour<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> croissance, aux gains de productivité et à l’augm<strong>en</strong>tation des<br />
exportations, concern<strong>en</strong>t avant tout les régions ayant un tissu industriel existant<br />
et, comme <strong>en</strong> Asie, une culture d’exportation assez marquée.<br />
Tableau 2 : Afflux d’IDE<br />
par zone géographique <strong>en</strong> 2007<br />
Tableau 3 : Les IDE par niveau<br />
de rev<strong>en</strong>u national<br />
Zone géographique<br />
Volume d’IDE<br />
<strong>en</strong>trants<br />
Part des IDE<br />
(%)<br />
Europe et CEI 1 042 340 53.7%<br />
Amérique du nord 349 313 18.0%<br />
Amérique <strong>la</strong>tine et<br />
Caraïbes<br />
105 630 5.5%<br />
Pays<br />
Volume d’IDE<br />
<strong>en</strong>trants <strong>en</strong><br />
millions de $<br />
Part des IDE<br />
(%)<br />
à bas rev<strong>en</strong>u 19 975 0.9%<br />
à rev<strong>en</strong>u<br />
moy<strong>en</strong><br />
inférieur<br />
232 806 10.9%<br />
Océanie 42 445 2.2%<br />
Asie 305 482 15.7%<br />
à rev<strong>en</strong>u<br />
moy<strong>en</strong><br />
supérieur<br />
268 916 12.6%<br />
dont Chine 192 778 9.9%<br />
à haut rev<strong>en</strong>u 1 617 642 75.6%<br />
Proche et Moy<strong>en</strong><br />
Ori<strong>en</strong>t<br />
57 064 2.9%<br />
Afrique 37 923 2.0%<br />
(Tableaux établis à partir des statistiques CNUCED, World Developm<strong>en</strong>t report, 2010)<br />
Malgré <strong>la</strong> reprise de 2004, les IDE ne doiv<strong>en</strong>t plus être considérés comme une<br />
panacée <strong>pour</strong> les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t car les investisseurs internationaux<br />
(pays à haut rev<strong>en</strong>u) pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> compte les problèmes de taille de marché,<br />
l’instabilité économique et politique, <strong>la</strong> gouvernance plus ou moins défail<strong>la</strong>nte, <strong>la</strong><br />
faible capacité d’absorption, <strong>la</strong> corruption, <strong>la</strong> faible compétitivité globale du<br />
système.<br />
Octobre 2012 86
Variable Mondialisation de l’économie<br />
Cette exig<strong>en</strong>ce globale des investisseurs exacerbe davantage <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce que<br />
se font les pays du sud <strong>pour</strong> attirer les IDE. Ces flux concern<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel<br />
les pays ayant une activité industrielle d’<strong>en</strong>vergure mondiale. De ce fait, les pays<br />
développés sont à <strong>la</strong> fois les premiers investisseurs et les premiers pays d’accueil.<br />
Les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t <strong>destin</strong>erai<strong>en</strong>t leurs investissem<strong>en</strong>ts à l’étranger à <strong>la</strong><br />
fois vers les pays développés mais aussi vers les autres pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t,<br />
<strong>pour</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel les plus proches géographiquem<strong>en</strong>t.<br />
La grande <strong>en</strong>treprise s’est donc progressivem<strong>en</strong>t mondialisée <strong>en</strong> organisant ses<br />
opérations tout au long de <strong>la</strong> chaine al<strong>la</strong>nt de <strong>la</strong> recherche et développem<strong>en</strong>t et<br />
de l’innovation au financem<strong>en</strong>t de son activité, de <strong>la</strong> production à <strong>la</strong> distribution<br />
de façon à pér<strong>en</strong>niser son activité ou à maximiser sa r<strong>en</strong>tabilité à l’échelle<br />
mondiale.<br />
Ainsi, le phénomène de mondialisation porte les germes de <strong>la</strong> disparition de <strong>la</strong><br />
nationalité des firmes (R. Reich, 1991) qui devi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t des structures mondiales<br />
organisées <strong>en</strong> formes de réseau, capables de mobiliser et de combiner les<br />
compét<strong>en</strong>ces de toutes nationalités <strong>en</strong> vue de réaliser des projets complexes. La<br />
multiplication des alliances stratégiques <strong>en</strong>tre FMN montre ce phénomène.<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
La mondialisation des marchés devrait continuer sur <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie à v<strong>en</strong>ir<br />
impliquant une interdép<strong>en</strong>dance croissante des pays et des zones d’échanges. Les<br />
IDE sont à <strong>la</strong> base de ce processus et r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le pouvoir des pays riches dans<br />
le monde. Seule <strong>la</strong> Chine semble pouvoir rattraper, dans ce domaine, les pays<br />
riches à condition qu’elle puisse maint<strong>en</strong>ir les conditions économiques et sociales<br />
à l’intérieur de son économie.<br />
Les ruptures possibles<br />
• Un affrontem<strong>en</strong>t militaire <strong>en</strong>tre les contin<strong>en</strong>ts ruinant les processus<br />
économiques.<br />
• Un cloisonnem<strong>en</strong>t des contin<strong>en</strong>ts qui n'échang<strong>en</strong>t plus ou moins <strong>en</strong>tre eux.<br />
• Une faillite généralisée du système économique.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 : Une récession mondiale <strong>en</strong>traine une réduction significative des<br />
échanges internationaux. Un repli vers les part<strong>en</strong>aires les plus proches permet de<br />
consolider <strong>la</strong> situation.<br />
→ H2 : Le modèle économique s'est assaini et l'économie financière est au<br />
service de l'économie réelle. La <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> n'a pas su profiter de cette<br />
situation et reste à <strong>la</strong> traîne. Les infrastructures nécessaires n'ont pas été<br />
réalisées et les échanges internationaux stagn<strong>en</strong>t, voire régress<strong>en</strong>t.<br />
→ H3 : On assiste à un développem<strong>en</strong>t harmonieux des échanges<br />
internationaux et <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> s'impose <strong>en</strong> tant que porte maritime vers le<br />
Monde.<br />
→ H4 : On assiste à un développem<strong>en</strong>t harmonieux des échanges<br />
internationaux et des interdép<strong>en</strong>dances <strong>en</strong>tre les contin<strong>en</strong>ts. La <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong><br />
profite pleinem<strong>en</strong>t de cette croissance.<br />
Octobre 2012 87
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
Sources :<br />
- J. Adda (1996), La mondialisation de l'économie, La découverte, Paris<br />
- R. Reich (1991), L'économie mondialisée, Dunod, 1993<br />
- G. Duthil, à paraître<br />
Octobre 2012 88
Variable Croissance, Emploi, Chômage<br />
6. Fiche variable « Croissance, emploi, chômage »<br />
Définitions et indicateurs<br />
La re<strong>la</strong>tion croissance emploi chômage<br />
A.Okun a mis <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce à <strong>la</strong> fin des années 1950 une loi sur longue période,<br />
qui reste re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t stable <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> croissance d’une part et, le chômage et<br />
l’emploi d’autre part : <strong>la</strong> « loi d’Okun »<br />
La loi définit une re<strong>la</strong>tion inverse (négative) <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> production et le<br />
chômage :<br />
Tcho = - 1/k *dPIB<br />
En testant cette re<strong>la</strong>tion, Okun démontre l’exist<strong>en</strong>ce d’une re<strong>la</strong>tion négative <strong>en</strong>tre<br />
<strong>la</strong> croissance et le chômage. Il note que <strong>la</strong> croissance du produit national était <strong>en</strong><br />
général plus rapide que <strong>la</strong> baisse du chômage.<br />
Ainsi, le coeffici<strong>en</strong>t k est égal à 3, <strong>pour</strong> un taux de chômage compris <strong>en</strong>tre 3% et<br />
7.5%. Le taux de croissance devait donc être égal à 3% <strong>pour</strong> <strong>en</strong>traîner<br />
une diminution d’un point du taux de chômage.<br />
Le corol<strong>la</strong>ire de cette re<strong>la</strong>tion est une re<strong>la</strong>tion positive <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> croissance et<br />
<strong>la</strong> variation de l’emploi. La re<strong>la</strong>tion testée est alors :<br />
dE = e. dPIB<br />
La re<strong>la</strong>tion est alors positive : plus <strong>la</strong> croissance est forte et plus <strong>la</strong> variation de<br />
l’emploi sera ample.<br />
Toutefois, même si cette re<strong>la</strong>tion est pertin<strong>en</strong>te et stable à long terme, elle<br />
s’am<strong>en</strong>uise du fait de l’impact d’autres variables que celle du PIB:<br />
• dP : <strong>la</strong> variation de <strong>la</strong> productivité appar<strong>en</strong>te du travail,<br />
• dDhT : <strong>la</strong> durée hebdomadaire de travail,<br />
• dW : <strong>la</strong> variation du sa<strong>la</strong>ire moy<strong>en</strong><br />
Si nous raisonnons sur une seule variable <strong>en</strong> supposant les n-1 autres variables<br />
constantes (toute chose égale par ailleurs) :<br />
dE = f (dPIB) La causalité que privilégie <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion d’Okun est<br />
conforme au principe de <strong>la</strong> demande effective de Keynes. Le niveau de production<br />
va déterminer le niveau d’emploi.<br />
dE = f (dP) L’évolution de l’emploi est fortem<strong>en</strong>t soumise à <strong>la</strong><br />
variation de <strong>la</strong> productivité du travail.<br />
Ainsi, si les investissem<strong>en</strong>ts des <strong>en</strong>treprises sont plus tournés vers <strong>la</strong> productivité<br />
que vers l’augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> capacité de production, l’impact sur l’emploi sera<br />
d’autant plus faible, notamm<strong>en</strong>t à court terme.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, à long terme, l’accroissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> productivité du travail r<strong>en</strong>force <strong>la</strong><br />
compétitivité des <strong>en</strong>treprises sur les marchés. La baisse des coûts et des prix<br />
leurs permet de conquérir des marchés. Les <strong>en</strong>treprises peuv<strong>en</strong>t alors accroître<br />
leur production et, donc finalem<strong>en</strong>t l’emploi.<br />
Mais, cet emploi nécessite une qualification supérieure et est accompagné d’une<br />
croissance des sa<strong>la</strong>ires versés<br />
dE = f (dDhT) L’impact de <strong>la</strong> DhT est négatif sur l’emploi puisque <strong>la</strong><br />
baisse de <strong>la</strong> durée accroît automatiquem<strong>en</strong>t l’emploi nécessaire. A l’inverse, <strong>la</strong><br />
Octobre 2012 89
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
hausse de <strong>la</strong> durée <strong>en</strong>traîne une diminution de l’emploi nécessaire à <strong>la</strong><br />
production.<br />
La RTT (1982) et l’ARTT (2000) ont eu des impacts discutables sur l’emploi.<br />
Les re<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre ces différ<strong>en</strong>tes variables sont égalem<strong>en</strong>t importantes puisque<br />
<strong>la</strong> baisse du temps de travail se traduit systématiquem<strong>en</strong>t par une hausse de <strong>la</strong><br />
productivité du travail. L’impact quasi nul de <strong>la</strong> RTT <strong>en</strong> 1982 s’explique <strong>en</strong> partie.<br />
De même, <strong>la</strong> baisse du temps de travail se traduit par une augm<strong>en</strong>tation du coût<br />
du travail.<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
La vérification de cette loi a été testée sur <strong>la</strong> période 1990-2010, à partir de<br />
données annuelles régionales établies par l’INSEE. Les données concern<strong>en</strong>t<br />
diverses variables expliquées prises <strong>en</strong> variation (taux de chômage- noté dTCHOet<br />
niveau d’emploi-noté dE- et variables explicatives prises égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
variation (taux de croissance économique- noté dPIB- taux de croissance du<br />
sa<strong>la</strong>ire minimal- noté dSmic- et taux de variation de <strong>la</strong> productivité appar<strong>en</strong>te du<br />
travail- noté dP).<br />
En ce qui concerne le PIB, <strong>la</strong> région haut-normande est c<strong>la</strong>ssée <strong>en</strong> 13ème p<strong>la</strong>ce<br />
<strong>en</strong> 2009 (48555 millions d’euros), mais ne représ<strong>en</strong>te que 8% du PIB de l’Ile de<br />
France et 2.5% du PIB de <strong>la</strong> France métropolitaine. Le taux de croissance moy<strong>en</strong><br />
annuel du PIB a été sout<strong>en</strong>u (2.66%) sur <strong>la</strong> période 1990-2009 ; ce qui p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong><br />
région à un niveau intermédiaire des régions qui avai<strong>en</strong>t à peu près le même PIB<br />
<strong>en</strong> 1990 (Picardie, 2.37% ; Bourgogne, 2.53% ; Alsace, 2.68% ; Poitou<br />
Char<strong>en</strong>te, 3.14% ; Languedoc Roussillon, 3.64%). Le PIB par habitant p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong><br />
région haut-normande <strong>en</strong> 10ème position (26555 euros) et le PIB par emploi <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>sse <strong>en</strong> 8ème p<strong>la</strong>ce (69364 euros).<br />
Le secteur industriel reste important (20% de l’emploi total, soit 4 ème rang<br />
régional). Le secteur est <strong>pour</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel composé de grands établissem<strong>en</strong>ts dont<br />
les sièges sociaux sont situés hors de <strong>la</strong> région (Paris et étrangers). Ainsi, un peu<br />
moins de <strong>la</strong> moitié de l’emploi industriel régional dép<strong>en</strong>d d’un siège hors région<br />
(1 er rang <strong>en</strong> France). Ce qui est <strong>en</strong> fait un élém<strong>en</strong>t de fragilité de <strong>la</strong> région ! Les<br />
services ont une importance plus faible (contrepartie directe de <strong>la</strong> position<br />
industrielle), mais rest<strong>en</strong>t <strong>pour</strong>voyeurs et créateurs d’emplois. L’agriculture, qui<br />
représ<strong>en</strong>te une forte activité de production, est peu <strong>pour</strong>vue d’emplois.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, <strong>la</strong> région souffre d’une part d’un taux de chômage supérieur à <strong>la</strong><br />
moy<strong>en</strong>ne nationale (structurellem<strong>en</strong>t supérieur d'un point à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne<br />
nationale) et le taux de destruction d’emplois est supérieur de 50% à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne<br />
nationale. Le taux qui est le rapport <strong>en</strong>tre le nombre d’emplois détruits et le<br />
nombre total d’emplois, est de 3.3% <strong>en</strong> 2009 contre 2.1% <strong>en</strong> France. Ce taux<br />
s’explique par de multiples facteurs :<br />
- l’importance de l’industrie, très s<strong>en</strong>sible aux retournem<strong>en</strong>ts de conjoncture,<br />
- l’int<strong>en</strong>sification des gains de productivité dans l’industrie ces 2 dernières<br />
déc<strong>en</strong>nies,<br />
- le poids de <strong>la</strong> sous-traitance d’activités des grandes <strong>en</strong>treprises vers les<br />
PME,<br />
- le poids des CDD et de l’intérim dans l’emploi global,<br />
- <strong>la</strong> faiblesse du niveau moy<strong>en</strong> de qualification, celle-ci étant une protection<br />
contre le chômage.<br />
Octobre 2012 90
Variable Croissance, Emploi, Chômage<br />
D’ailleurs, les jeunes sont plus au chômage <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (25% des<br />
jeunes actifs contre 20% à l’échelle nationale). Tous ces élém<strong>en</strong>ts font que le<br />
taux de création d’<strong>en</strong>treprises rapporté au nombre d’habitants, est faible (3%),<br />
p<strong>la</strong>çant <strong>la</strong> région au 19 ème rang national. La région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> représ<strong>en</strong>te<br />
3% de l’emploi national. Elle est peu créatrice d’emplois sur <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie 2000 par<br />
rapport au niveau national (+0.7% <strong>en</strong> emplois sa<strong>la</strong>riés de 2002 à 2008 contre +<br />
4.2% <strong>en</strong> France.<br />
Les li<strong>en</strong>s chômage, emploi et croissance <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Il apparaît, au vu des régressions linéaires simples, que <strong>la</strong> variable « croissance<br />
économique » explique significativem<strong>en</strong>t les évolutions négatives du taux de<br />
chômage et positive du niveau d’emploi. Les variations du sa<strong>la</strong>ire minimal ont un<br />
effet plus faible sur les deux variables expliquées et les variations de <strong>la</strong><br />
productivité du travail n’ont aucun impact significatif.<br />
En résumé :<br />
• Une croissance de 3% n'a qu'une influ<strong>en</strong>ce très faible sur le taux de<br />
chômage alors qu'elle a une forte influ<strong>en</strong>ce sur l'emploi.<br />
• Une croissance de 2% du Smic a une influ<strong>en</strong>ce forte sur <strong>la</strong> diminution<br />
d’emplois alors qu'elle a une faible influ<strong>en</strong>ce sur le chômage.<br />
En ce qui concerne le taux de chômage et <strong>en</strong> raisonnant toutes choses égales par<br />
ailleurs (<strong>en</strong> posant constantes deux des trois variables explicatives), il convi<strong>en</strong>t<br />
de noter que :<br />
si le taux de croissance est de 2.8%, le taux de chômage ne varie pas<br />
(dTCHO = 0).<br />
Ainsi, <strong>en</strong> faisant des hypothèses basse et haute sur le taux de croissance du PIB,<br />
il <strong>en</strong> ressort que :<br />
<strong>pour</strong> 2% de croissance économique, le taux de chômage (hypothèses<br />
<strong>pour</strong> un taux de chômage initial de 10%) s’accroît de 0.18 point (soit<br />
1614 chômeurs de plus dans <strong>la</strong> région).<br />
à l’opposé, si le taux de croissance est de 3.5%, alors le taux de<br />
chômage baisse de 0.16 point, c’est-à-dire une diminution du nombre de<br />
chômeurs de 1291.<br />
Pourquoi cet écart d'ajustem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les deux variations ?<br />
- L'exist<strong>en</strong>ce de chômeurs « désespérés » qui font à nouveau des démarches<br />
administratives lors d'une reprise économique.<br />
- L'augm<strong>en</strong>tation des taux d'activité, notamm<strong>en</strong>t féminin, qui <strong>en</strong>traîne le passage<br />
de l'inactivité à l'activité.<br />
- Une amélioration économique <strong>en</strong>traîne un assouplissem<strong>en</strong>t des règles de<br />
radiation<br />
- La création immédiate d'emplois à temps partiel qui pousse les offreurs de<br />
travail à <strong>en</strong> rechercher un autre.<br />
De même, une croissance du smic faible (2%) <strong>en</strong>traînerait une baisse du taux de<br />
chômage de 0.27 point, soit 2177 chômeurs <strong>en</strong> moins, alors que une hausse plus<br />
forte du sa<strong>la</strong>ire minimal (5%) impliquerait une variation forte du taux de<br />
chômage (+0.82 point), ce qui conduirait à un accroissem<strong>en</strong>t du nombre de<br />
chômeurs de 6614.<br />
Les variations de <strong>la</strong> productivité appar<strong>en</strong>te du travail ou <strong>la</strong> réduction du temps de<br />
travail hebdomadaire (variable dummy [0,1]) n’ont aucune influ<strong>en</strong>ce sur<br />
l’évolution du taux de chômage.<br />
Octobre 2012 91
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Tableau 1 : La re<strong>la</strong>tion croissance / chômage<br />
dTCHO a b R2<br />
dPIB<br />
-0.225<br />
(1.98)<br />
0.629<br />
(1.58)<br />
0.26<br />
dSmic<br />
0.164<br />
(1.66)<br />
-0.60<br />
(1.54)<br />
0.09<br />
dP<br />
-0.053<br />
(0.34)<br />
0.081<br />
(0.17)<br />
0.01<br />
dTCHO Valeur min* Impact/hyp<br />
dPIB 2.80%<br />
Si 2%<br />
+0.18 point<br />
Si 3.5%<br />
-0.16 point<br />
dSmic 3.65%<br />
Si 2%<br />
-0.27 point<br />
Si 5%<br />
+0.82 point<br />
* La valeur d’inversion de t<strong>en</strong>dance est <strong>la</strong> valeur de <strong>la</strong> variable explicative qui annule <strong>la</strong> variable<br />
expliquée.<br />
En raisonnant de <strong>la</strong> même façon <strong>pour</strong> les variations de l’emploi, <strong>la</strong> croissance<br />
économique reste bi<strong>en</strong> une variable pertin<strong>en</strong>te dans l’explication du niveau<br />
d’emploi sa<strong>la</strong>rié régional. Avec une valeur re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t basse du taux de<br />
croissance économique (1.6%), le niveau d’emploi serait maint<strong>en</strong>u. Si le taux de<br />
croissance s’affaiblit (1%), le niveau d’emploi diminue de -0.18 point, soit une<br />
perte de 1307 emplois. A l’opposé, si le taux de croissance se mainti<strong>en</strong>t 2.6%,<br />
l’emploi progresse de +0.27 point, soit 1960 emplois nouveaux créés. Dans le cas<br />
d’une croissance sout<strong>en</strong>ue (3.5%), l’emploi progresserait fortem<strong>en</strong>t (+0.6 point,<br />
soit +4355 emplois). La croissance reste un <strong>en</strong>jeu stratégique <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région <strong>en</strong><br />
termes d’emploi. Dans le cas d'une croissance nulle, l'emploi diminue d'<strong>en</strong>viron<br />
3630 postes<br />
Les variations du smic rest<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t une variable explicative intéressante,<br />
mais moins contraignante que sur l’évolution du taux de chômage. Ainsi, si le<br />
smic augm<strong>en</strong>te de 3%, l’emploi continue de croître ; il ne baisse de manière<br />
notable<br />
(- 0.38 point) que <strong>pour</strong> un taux de croissance du sa<strong>la</strong>ire minimal de 6%. Les<br />
variations de <strong>la</strong> productivité du travail rest<strong>en</strong>t non significatives de l’évolution de<br />
l’emploi.<br />
Tableau 2 : La re<strong>la</strong>tion croissance / emploi<br />
dE a b R2<br />
dPIB 0.311<br />
(1.98)<br />
dSmic -0.308<br />
(2.50)<br />
dP -0.053<br />
(0.34)<br />
-0.495<br />
(1.36)<br />
1.472<br />
(2.85)<br />
0.081<br />
(0.17)<br />
0.25<br />
0.15<br />
0.01<br />
dE Valeur min* Impact/hyp<br />
dPIB 1.60% Si 1%<br />
-0.18 point<br />
dSmic 4.78% Si 3%<br />
0.55 point<br />
Si 2.5%<br />
+0.28<br />
point<br />
Si 6%<br />
-0.38 point<br />
Octobre 2012 92
Variable Croissance, Emploi, Chômage<br />
Pour conclure, il apparaît qu'après sélection des variables, seules deux variables<br />
sont explicatives des variations de l'emploi et du taux de chômage, à savoir <strong>la</strong><br />
croissance et <strong>la</strong> variation de <strong>la</strong> productivité du travail, les variations du<br />
Smic n'expliqu<strong>en</strong>t plus les variations des deux variables expliquées. Les<br />
<strong>en</strong>treprises comp<strong>en</strong>s<strong>en</strong>t l'augm<strong>en</strong>tation des sa<strong>la</strong>ires par des gains de<br />
productivité, ce qui a un effet indirect négatif sur l'emploi. L'évolution de <strong>la</strong> durée<br />
hebdomadaire du temps de travail, intégrée au modèle sous forme d'une variable<br />
dummy, n'est pas significative et détériore son r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t.<br />
Source statistiques régionales de l'INSEE - Période 1990 – 2009<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
Les prospectives d’évolution peuv<strong>en</strong>t être calculées sur <strong>la</strong> base du modèle établi à<br />
partir des résultats de <strong>la</strong> vérification de <strong>la</strong> loi sur <strong>la</strong> période 1990-2009.<br />
Tableau 3 : Résultats sur <strong>la</strong> période 1990-2009<br />
dTCHO = - 0,493.dPIB + 0,427.dP +0,315 R2 = 0,484<br />
(3,72) (2,59) (1,01)<br />
dE = 0,646. dPIB – 0,534 dP – 0,102 R2 = 0,417<br />
(3,21) (2,13) (0,22)<br />
Pour exemple, si <strong>la</strong> croissance est faible (0,5%) et que <strong>la</strong> croissance de <strong>la</strong><br />
productivité reste stable (+2%), le taux de chômage progresse nettem<strong>en</strong>t de<br />
0,16 point (soit 1500 chômeurs de plus) et le niveau d'emploi progresse peu de<br />
0,10 point (soit 800 emplois de plus).<br />
<strong>Quel</strong>le stratégie de développem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région ?<br />
• La région doit favoriser <strong>la</strong> mutation des secteurs économiques, <strong>en</strong> crise ou les<br />
plus exposés, vers des activités <strong>en</strong> émerg<strong>en</strong>ce. Il faut promouvoir les secteurs<br />
porteurs à <strong>la</strong> fois de croissance et d’emplois (logistique, santé pharmacie,<br />
biotechnologies, énergies nouvelles,…) et r<strong>en</strong>forcer <strong>la</strong> structuration des filières<br />
autour des produits innovants (recherches appliquées, innovation de produits /<br />
technologies, formation).<br />
• La région doit diversifier les activités de production à <strong>la</strong> fois industrielles et<br />
tertiaires. Il faut <strong>en</strong>courager l’imp<strong>la</strong>ntation ou <strong>la</strong> reprises des petites et moy<strong>en</strong>nes<br />
<strong>en</strong>treprises, concourir à leur développem<strong>en</strong>t, aider à structurer les re<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre<br />
les PME et les grandes <strong>en</strong>treprises. Les métiers de l’artisanat et de <strong>la</strong><br />
maint<strong>en</strong>ance doiv<strong>en</strong>t se consolider.<br />
• Il serait important de reconsidérer le problème de <strong>la</strong> taille optimale d’influ<strong>en</strong>ce<br />
de <strong>la</strong> région, afin de mettre <strong>en</strong> valeur les complém<strong>en</strong>tarités au sein de l’espace<br />
Paris Seine <strong>Normandie</strong>, de r<strong>en</strong>forcer le pouvoir économique et politique face à l’île<br />
de France. La région <strong>pour</strong>ra ainsi attirer des <strong>en</strong>treprises nationales performantes<br />
(sièges sociaux ou seulem<strong>en</strong>t imp<strong>la</strong>ntation) de façon à réduire sa dép<strong>en</strong>dance<br />
vis-à-vis de l’étranger (ex : pétro+). Il faut donc valoriser notre région par une<br />
communication sur les atouts régionaux.<br />
• La région doit égalem<strong>en</strong>t monter <strong>en</strong> gamme, notamm<strong>en</strong>t dans l’économie de<br />
<strong>la</strong> connaissance. Il faut donc adapter l’offre de formation aux besoins des<br />
<strong>en</strong>treprises <strong>en</strong> ayant des filières de formation plus professionnalisées tant dans<br />
les hautes qualifications que dans les formations plus basiques (appr<strong>en</strong>tissages à<br />
tous les niveaux). Ce<strong>la</strong> nécessite une volonté régionale d’accroître les re<strong>la</strong>tions<br />
<strong>en</strong>tre les <strong>en</strong>treprises, les offreurs de travail et les organismes de formation.<br />
Octobre 2012 93
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Il faut améliorer l’attractivité des métiers issus des secteurs clés tout <strong>en</strong><br />
r<strong>en</strong>forçant l’innovation technique, organisationnelle, commerciale,…<br />
• La région doit r<strong>en</strong>forcer sa prés<strong>en</strong>ce à l’international <strong>en</strong> favorisant<br />
l’imp<strong>la</strong>ntation des <strong>en</strong>treprises haut normandes à l’étranger, l’exportation de ses<br />
produits (bi<strong>en</strong>s ou services), <strong>en</strong> r<strong>en</strong>forçant <strong>la</strong> position de ses deux grands ports<br />
(image, qualité des infrastructures, accessibilité et rapidité,…).<br />
Les ruptures possibles<br />
• Une défail<strong>la</strong>nce généralisée de toutes les économies qui sombr<strong>en</strong>t dans un<br />
chaos économique sans précéd<strong>en</strong>t.<br />
• Des t<strong>en</strong>sions sociales, voire une révolution, remettant <strong>en</strong> cause le système<br />
établi.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 : La crise se <strong>pour</strong>suit, voire s'acc<strong>en</strong>tue. Elle provoque une montée du<br />
chômage dans tous les secteurs et une très forte précarisation du travail. Les<br />
effets sociaux négatifs sont importants dans les domaines de vie, de formation,<br />
de santé,...<br />
→ H2 : Malgré <strong>la</strong> reprise économique <strong>en</strong> France, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong><br />
stagne, voire régresse. Le chômage ne diminue pas et l'emploi est soumis à<br />
une forte précarité. L'intérim s'accroit et on note une forte vulnérabilité des<br />
jeunes et des femmes.<br />
→ H3 : La <strong>Haute</strong> <strong>Normandie</strong> a su anticiper <strong>la</strong> reprise économique et a<br />
connu une longue déc<strong>en</strong>nie de croissance, avec une forte baisse du chômage, une<br />
diminution de <strong>la</strong> précarité du travail et une amélioration du pouvoir d'achat des<br />
ménages. Les effets sociaux positifs sont importants dans les domaines de vie, de<br />
formation, de santé,...<br />
→ H4 : La France et l'Europe se retrouv<strong>en</strong>t dans un cycle long de<br />
croissance. La situation sociale est améliorée sur tous ses territoires, des<br />
pénuries de main-d’œuvre apparaiss<strong>en</strong>t dans certains secteurs économiques<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
Sources :<br />
- G. Duthil, à paraître<br />
Octobre 2012 94
Variable Filières économiques<br />
7. Fiche variable « Filières économiques »<br />
Définitions<br />
« Ensemble des activités économiques qui conduis<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> mise sur le marché<br />
d’un bi<strong>en</strong> ou d’un service déterminé, c'est-à-dire <strong>en</strong> al<strong>la</strong>nt de l’amont vers l’aval,<br />
jusqu’au consommateur final, ménage ou <strong>en</strong>treprise » 25<br />
Distinguer <strong>en</strong>tre filière verticale (supra) et filière horizontale (qui ne regroupe que<br />
les acteurs situés dans <strong>la</strong> même phase du process (ex. filière automobile réunit<br />
les acteurs industriels, à l’exclusion des fournisseurs de matières premières ou<br />
des distributeurs).<br />
Principales filières <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> : Automobile, Aéronautique/spatial,<br />
Energie, CBS, Verre, Agroalim<strong>en</strong>taire, Agriculture, Pêche, Logistique, Tourisme<br />
(certaines bi régionales), Risques (pôle Valmaris)<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts 26 <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
• Croissance de <strong>la</strong> valeur ajoutée (dynamisme économique)<br />
• Part dans <strong>la</strong> valeur ajoutée régionale (contribution à <strong>la</strong> richesse régionale)<br />
• Capacité d’investissem<strong>en</strong>t<br />
• Valeur ajoutée par sa<strong>la</strong>rié<br />
• Coûts de production (rémunération par sa<strong>la</strong>rié)<br />
• Capacité exportatrice<br />
• Evolution de l’emploi sa<strong>la</strong>rié<br />
• Spécialisation sectorielle (poids du secteur dans l’emploi régional)<br />
• Taux de création d’<strong>en</strong>treprises<br />
• Besoin de r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t (taux de sa<strong>la</strong>riés de plus de 50ans)<br />
• Rotation de <strong>la</strong> main d’œuvre<br />
• T<strong>en</strong>sion du marché du travail (taux de recours à l’intérim)<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective 27<br />
- Forte id<strong>en</strong>tité industrielle dominante ori<strong>en</strong>tée vers <strong>la</strong> production autour des<br />
grandes filières traditionnelles<br />
• Mutation <strong>en</strong> cours <strong>pour</strong> ces filières, condition ess<strong>en</strong>tielle de leur pér<strong>en</strong>nité<br />
favorisée par l’apparition de nouvelles technologies : combustion propre, moteur<br />
électrique, nouveaux process, s<strong>en</strong>sibilité à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t…<br />
• Part très importante du territoire (les 2/3) occupé par l’agriculture <strong>en</strong> dépit du<br />
caractère fortem<strong>en</strong>t urbanisé de <strong>la</strong> région : <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est une région de<br />
grandes cultures et d’élevage.<br />
• Les moy<strong>en</strong>nes et grandes exploitations (de taille supérieure à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne<br />
nationale) exploit<strong>en</strong>t 96% de <strong>la</strong> surface agricole et sont spécialisées dans les<br />
grandes cultures (blé, colza, orge, lin, betteraves industrielles, pomme de terre),<br />
puis dans <strong>la</strong> polyculture-polyélevage, l’élevage <strong>la</strong>itier spécialisé et les élevages<br />
25 Selon l’Insee.<br />
26 D’après ORECO, Observatoire REgional de <strong>la</strong> COmpétitivité, piloté par <strong>la</strong> Chambre de Commerce<br />
et d'Industrie de Région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (CCIR HN) qui suit 22 indicateurs stratégiques.<br />
27 Région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Diagnostic de l’Economie régionale, préa<strong>la</strong>ble au CRDE, novembre<br />
2010 et CREFOR, cahiers sectoriels<br />
Octobre 2012 95
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
mixtes (<strong>la</strong>it viande). Ces grandes exploitations sont conc<strong>en</strong>trées sur les terres<br />
riches, les mieux <strong>pour</strong>vues <strong>en</strong> industrie de transformation agroalim<strong>en</strong>taire et <strong>en</strong><br />
infrastructures de stockage et d’exportation.<br />
• Les petites exploitations sont ori<strong>en</strong>tées vers l’élevage. Le maraîchage est très<br />
peu représ<strong>en</strong>té.<br />
• Les principaux débouchés sont l’exportation <strong>pour</strong> les céréales (p<strong>la</strong>ce portuaire<br />
de Rou<strong>en</strong>) et l’industrie agroalim<strong>en</strong>taire <strong>pour</strong> les autres productions.<br />
• A contrario, faiblesse du secteur tertiaire (71% de l’emploi contre 76% <strong>en</strong><br />
France) , y compris tertiaire supérieur (« à haute valeur ajoutée »).<br />
• Cloisonnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core fort des acteurs et esprit réseau peu développé<br />
• Prédominance de PME fragiles: manque de capacité novatrice (culture R&D,<br />
esprit d’anticipation) et de réflexion stratégique long terme, ori<strong>en</strong>tation vers <strong>la</strong><br />
production (sous-traitants) et l’action à court terme, capitalisation insuffisante,<br />
prés<strong>en</strong>ce à l’international peu développée, peu de li<strong>en</strong>s avec <strong>la</strong> recherche amont<br />
• Prés<strong>en</strong>ce d’une main d’œuvre qualifiée mais peu évolutive et vieillissante<br />
• Prés<strong>en</strong>ce de fortes expertises sur des créneaux pointus mais peu valorisées<br />
• Opportunités à saisir lors de <strong>la</strong> transmission à v<strong>en</strong>ir d’un grand nombre<br />
d’<strong>en</strong>treprises compte t<strong>en</strong>u de l’âge des dirigeants : nouvelle culture d’<strong>en</strong>treprise<br />
(compét<strong>en</strong>ces, ouverture), regroupem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>treprises (taille critique),<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
T<strong>en</strong>dance lourde<br />
• Rôle déterminant de l’énergie : coût, disponibilité, nature des sources<br />
énergétiques<br />
Autres t<strong>en</strong>dances<br />
• Besoin confirmé de mobilité des individus<br />
• Accélération technologique (TIC…)<br />
• Impact économique lié au vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion (services à <strong>la</strong><br />
personne <strong>en</strong> tant que filière, risques assuranciels, formation tout au long de <strong>la</strong><br />
vie, transformation des emplois…)<br />
• Croissance structurelle de <strong>la</strong> demande mondiale alim<strong>en</strong>taire<br />
• Mutation/Evolution de filières traditionnelles : automobile, pétrochimie,<br />
• Progression continue de <strong>la</strong> filière aéronautique et spatiale<br />
• Emerg<strong>en</strong>ce de nouvelles filières : éoli<strong>en</strong> off shore, déconstruction (non<br />
seulem<strong>en</strong>t automobile…), déchets<br />
• Poursuite de <strong>la</strong> mutation du monde agricole : conc<strong>en</strong>tration des moy<strong>en</strong>s de<br />
production au rythme des restructurations, multiplication des « sociétés », ce qui<br />
accroît le contraste <strong>en</strong>tre petites exploitations, héritage d’une culture<br />
traditionnelle et grandes exploitations, véritables sociétés de production à grande<br />
échelle. La baisse du travail familial est continue au profit de l’emploi de sa<strong>la</strong>riés,<br />
de plus <strong>en</strong> plus qualifié. 80% des agriculteurs de moins de 40 ans ont le<br />
bacca<strong>la</strong>uréat (multiplication par 2 des bacheliers <strong>en</strong> 10 ans).<br />
• Adaptation nécessaire des moy<strong>en</strong>nes exploitations à de nouveaux marchés au<br />
risque de disparaître (variétés plus productives, traitem<strong>en</strong>ts plus efficaces)<br />
Octobre 2012 96
Variable Filières économiques<br />
• Regroupem<strong>en</strong>t de PME leur permettant d’atteindre <strong>la</strong> taille critique europé<strong>en</strong>ne<br />
(de <strong>la</strong> PME à l’ETI – <strong>en</strong>treprise de taille intermédiaire <strong>en</strong>tre 250 et 5000).<br />
Les ruptures possibles 28<br />
Préliminaire : exist<strong>en</strong>ce de facteurs exogènes sur lesquels le territoire n’a aucune<br />
prise mais qui peuv<strong>en</strong>t être extrêmem<strong>en</strong>t impactants : économie financière<br />
mondiale, montée <strong>en</strong> puissance des pays émerg<strong>en</strong>ts et incid<strong>en</strong>ce sur les<br />
économies europé<strong>en</strong>nes, apparition de nouvelles technologies et acceptabilité<br />
sociétale du changem<strong>en</strong>t,…<br />
Ruptures « négatives » :<br />
• coût de l’énergie dissuasif freinant l’activité économique ;<br />
• incapacité des acteurs politiques et économiques à juguler <strong>la</strong>/les crise(s)<br />
actuelle(s), abs<strong>en</strong>ce d’alternative efficace, persistance d’un <strong>en</strong>chainem<strong>en</strong>t<br />
crise/reprise ;<br />
• <strong>pour</strong>suite de <strong>la</strong> désindustrialisation de l’Europe sous l’effet de <strong>la</strong> performance<br />
globale de l’industrie des pays émerg<strong>en</strong>ts (qualité, coût, technologie,<br />
réactivité…) ;<br />
• disparition d’<strong>en</strong>treprises par l’abs<strong>en</strong>ce de repr<strong>en</strong>eurs : perte de savoir faire et<br />
disparitions de compét<strong>en</strong>ces ;<br />
• répétition du caractère exceptionnel des évènem<strong>en</strong>ts climatiques et<br />
répercussions sur le cours des productions agricoles.<br />
Ruptures « positives » :<br />
• production de l’énergie à un coût supérieur générant des produits <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
région et obligeant à innover <strong>pour</strong> trouver des alternatives<br />
• les acteurs ayant tiré <strong>la</strong> leçon des crises 2008-2011 ; un modèle économique<br />
performant s’impose mettant l’économie financière au service de l’économie<br />
réelle.<br />
• relocalisation <strong>en</strong> Europe suite au manque de performance des pays émerg<strong>en</strong>ts<br />
Les hypothèses :<br />
→ H1 - Réduction des échanges. Poursuite du mouvem<strong>en</strong>t<br />
désindustrialisation / délocalisations<br />
Les délocalisations massives touch<strong>en</strong>t le secteur industriel. Parmi les services, les<br />
activités tertiaires de proximité sont les seules à pouvoir se développer.<br />
→ H2 – Désindustrialisation et économie régionale traditionnelle <strong>en</strong><br />
souffrance<br />
Les délocalisations diminu<strong>en</strong>t mais les secteurs traditionnels vieillissants et les<br />
PME souffr<strong>en</strong>t et <strong>la</strong> désindustrialisation du territoire se <strong>pour</strong>suit. Certaines<br />
activités de service se réimp<strong>la</strong>nt<strong>en</strong>t tout de même <strong>en</strong> région.<br />
→ H3 – Mutation des secteurs traditionnels vers des activités <strong>en</strong><br />
émerg<strong>en</strong>ce<br />
Des relocalisations profit<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> région. Certains secteurs traditionnels mut<strong>en</strong>t<br />
vers des activités émerg<strong>en</strong>tes ; les PME bénéfici<strong>en</strong>t de nouvelles opportunités.<br />
28 CESER Rhône-Alpes, <strong>2025</strong> : Visions <strong>pour</strong> Rhône-Alpes, novembre 2008.<br />
Octobre 2012 97
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
→ H4 – Réindustrialisation du territoire. Développem<strong>en</strong>t des secteurs<br />
clés porteurs. Attractivité internationale.<br />
On assiste à une ré industrialisation de <strong>la</strong> région autour de secteurs clé <strong>pour</strong><br />
l’économie régionale (Energie, logistique, portuaire), qui <strong>en</strong>train<strong>en</strong>t <strong>la</strong> croissance<br />
et bénéfici<strong>en</strong>t <strong>en</strong> retour du regain général de l’activité.<br />
Les services de logistique liée à l’agriculture se r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t et amélior<strong>en</strong>t leur<br />
productivité via l’optimisation des voies d’eau et <strong>la</strong> massification des transports.<br />
De nouvelles filières porteuses se structur<strong>en</strong>t et le territoire devi<strong>en</strong>t attractif <strong>pour</strong><br />
les <strong>en</strong>treprises étrangères.<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
- Institutions bancaires (y compris sociétés de capital risque)<br />
- Collectivités territoriales (souti<strong>en</strong> favorisant l’ancrage <strong>en</strong> région)<br />
- Organismes professionnels et consu<strong>la</strong>ires<br />
- Structures filières<br />
- Organismes de formation<br />
De nombreux acteurs sont <strong>en</strong> dehors du territoire…<br />
Sources :<br />
- Région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Diagnostic de l’Economie régionale, préa<strong>la</strong>ble au CRDE,<br />
novembre 2010<br />
- CREFOR, cahiers sectoriels<br />
- CESER Rhône-Alpes, <strong>2025</strong> : Visions <strong>pour</strong> Rhône-Alpes, novembre 2008.<br />
Octobre 2012 98
Variable Formation Insertion<br />
8. Fiche variable « Formation Insertion »<br />
Définitions<br />
Formation : « Ensemble des activités visant à assurer l’acquisition de<br />
connaissances, de savoirs de base ou disciplinaires et de compét<strong>en</strong>ces <strong>pour</strong><br />
exercer un métier ».<br />
On distingue d’une part, <strong>la</strong> formation initiale avec ses différ<strong>en</strong>ts niveaux primaire<br />
(dont <strong>la</strong> maternelle), secondaire, supérieur, disp<strong>en</strong>sée auprès des jeunes,<br />
sanctionnée le plus souv<strong>en</strong>t par un diplôme correspondant à un niveau de<br />
formation (de V à I) 29 et d’autre part, <strong>la</strong> formation continue disp<strong>en</strong>sée auprès des<br />
individus ayant quitté leur parcours de formation initiale ; celle-ci est dite<br />
qualifiante lorsqu’elle est sanctionnée par un diplôme, un titre professionnel…<br />
La formation initiale peut se dérouler « sous statut sco<strong>la</strong>ire », avec<br />
év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t alternance de périodes de formation <strong>en</strong> école et <strong>en</strong> <strong>en</strong>treprise, ou<br />
« <strong>en</strong> appr<strong>en</strong>tissage » lorsqu’un contrat de travail est passé <strong>en</strong>tre un jeune et un<br />
employeur.<br />
Le droit à <strong>la</strong> formation continue sur le temps de travail est reconnu aux sa<strong>la</strong>riés<br />
et l’obligation de formation est faite aux employeurs. Les financeurs publics et<br />
pôle emploi dédi<strong>en</strong>t principalem<strong>en</strong>t leurs moy<strong>en</strong>s à <strong>la</strong> formation des demandeurs<br />
d’emploi, mais peuv<strong>en</strong>t aussi accompagner les actifs <strong>en</strong> emploi.<br />
Les objectifs de <strong>la</strong> formation sont multiples, mê<strong>la</strong>nt l’appr<strong>en</strong>tissage de <strong>la</strong><br />
citoy<strong>en</strong>neté, <strong>la</strong> transmission des savoirs et des connaissances, l’acquisition de<br />
compét<strong>en</strong>ces pratiques <strong>pour</strong> exercer une activité professionnelle, <strong>en</strong>fin l’insertion<br />
professionnelle et l’évolution dans un parcours professionnel.<br />
La notion de formation tout au long de <strong>la</strong> vie (FTLV) recouvre l’<strong>en</strong>semble de<br />
ces objectifs qui se r<strong>en</strong>contr<strong>en</strong>t à différ<strong>en</strong>ts mom<strong>en</strong>ts du parcours de vie d’un<br />
individu, de sa formation initiale à son insertion et son évolution professionnelle,<br />
avec les temps d’ori<strong>en</strong>tation intermédiaires, de reconversion, avec <strong>la</strong> possibilité<br />
de valider ses acquis et ses compét<strong>en</strong>ces professionnelles et faire valoir ses<br />
qualifications. Elle est de nature à favoriser un certain équilibre dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion<br />
emploi-formation au cœur des <strong>en</strong>jeux du dynamisme socioéconomique d’un<br />
territoire.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
Certains concern<strong>en</strong>t <strong>la</strong> formation <strong>en</strong> elle-même et les niveaux de diplômes,<br />
d’autres le niveau de qualification <strong>en</strong> emploi et éc<strong>la</strong>ir<strong>en</strong>t une partie de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion<br />
« emploi-formation » <strong>en</strong> région. (N .b. La majorité des indicateurs est sexuée)<br />
• Effectifs sco<strong>la</strong>risés par niveau (y compris supérieur)<br />
• Taux de sco<strong>la</strong>risation des 16-25 ans<br />
• Taux de réussite aux principaux exam<strong>en</strong>s, notamm<strong>en</strong>t bac<br />
29 Organisation des niveaux de formation :<br />
o niveau VI : sans diplôme<br />
o niveau V bis : sans diplôme mais niveau d’étude CAP BEP<br />
o niveau V : diplômé d’un CAP ou BEP<br />
o niveau IV : diplômé bacca<strong>la</strong>uréat<br />
o niveau III : diplômé bac + 2<br />
o niveau II : diplômé bac + 3<br />
o niveau I : diplômé bac + 5 et plus.<br />
Octobre 2012 99
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• Taux de bacheliers dans une génération<br />
• Poids des bacs généraux, technologiques, professionnels<br />
• Taux de <strong>pour</strong>suite d’étude dans l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur<br />
• Poids des 3 voies de formation (initial statut sco<strong>la</strong>ire, appr<strong>en</strong>tissage, formation<br />
continue) – <strong>en</strong> volume et par niveau de diplôme<br />
• Nombre et niveaux de formés <strong>en</strong> appr<strong>en</strong>tissage<br />
• Nombre de diplômés de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur<br />
• Nombre de doctorants et poids de <strong>la</strong> région<br />
• Popu<strong>la</strong>tion totale par niveau de diplôme<br />
• Popu<strong>la</strong>tion sans diplôme (niveau VI et V bis) chez les 15-24 ans non sco<strong>la</strong>risés<br />
• Niveau de qualification des actifs (<strong>en</strong> emploi et demandeurs d’emploi)<br />
• Nombre et nature des bénéficiaires d’une action de formation continue<br />
• Nombre de VAE délivrées par un certificateur<br />
• Insertion à 7mois (suivi de cohortes par <strong>en</strong>quête – SEINE - IVA)<br />
• Taux d’activité des 16-25 ans<br />
• Taux de chômage par âge<br />
• Pourc<strong>en</strong>tage de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> situation d’illettrisme (données nationales<br />
jusqu’à <strong>la</strong> sortie de l’ext<strong>en</strong>sion d’<strong>en</strong>quête IVQ INSEE <strong>en</strong> 2013)<br />
La mise <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce territoriale de l’offre de formation <strong>pour</strong>ra être évaluée dans<br />
le cadre de l’évaluation du CPRDFP 30 prévue au sein du CCREFP 31 . Les modalités<br />
et les indicateurs de suivi n’<strong>en</strong> sont pas précisés à ce jour.<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> se p<strong>la</strong>ce (<strong>en</strong> 2008) au 3ème rang des régions françaises les<br />
plus jeunes (France Métropolitaine (FM)). Le rev<strong>en</strong>u moy<strong>en</strong> des Haut-Normands<br />
est dans le premier tiers des régions de France.<br />
Son histoire industrielle a imprimé des spécificités marquantes <strong>pour</strong> <strong>la</strong> structure<br />
des qualifications régionales au fil des générations. Au dernier rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t 20%<br />
des actifs occup<strong>en</strong>t un emploi industriel (contre 15,2% <strong>en</strong> FM).<br />
Dans ces secteurs industriels, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ouvrière représ<strong>en</strong>te 57% des actifs<br />
(contre 53% <strong>en</strong> FM) et le déficit de cadres est important (11% contre 15%). Les<br />
emplois de services sont peu qualifiés et les emplois temporaires plus nombreux<br />
avec un fort recours à l’intérim.<br />
→ Les qualifications <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
La popu<strong>la</strong>tion ouvrière est plus qualifiée 32 qu’ailleurs (63,5% d’ouvriers qualifiés<br />
contre 62% <strong>en</strong> FM), avec toutefois de fortes variations d’un secteur à l’autre : de<br />
54% dans les industries agricoles et alim<strong>en</strong>taires à 84% dans le secteur de<br />
l’énergie.<br />
Toutefois, dans l’<strong>en</strong>semble de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion régionale, le niveau de formation<br />
initiale est le plus faible des régions (FM). On rec<strong>en</strong>se (<strong>en</strong> 2007):<br />
- 21% de sans diplômes (contre 17% <strong>en</strong> FM)<br />
- 9,6% de titu<strong>la</strong>ires d’un diplôme de niveau bac + 2 (contre 11,1%)<br />
- 8,2% de titu<strong>la</strong>ires d’un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (contre 12%)<br />
Parmi les actifs, le taux de sans diplôme au rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t de 2006 atteignait 26%<br />
et 57% possédai<strong>en</strong>t seulem<strong>en</strong>t un 1er diplôme de niveau V (CAP/BEP).<br />
30 CPRDFP - Contrat de p<strong>la</strong>n régional de développem<strong>en</strong>t des formations professionnelles<br />
31 CCREFP – Comité de coordination régional emploi formation professionnelle<br />
32 Qualification mesurée à partir du type d’emploi occupé<br />
Octobre 2012 100
Variable Formation Insertion<br />
La qualification ouvrière s’est donc acquise principalem<strong>en</strong>t à travers l’<strong>en</strong>treprise<br />
et pas à l’école.<br />
→ Les progrès sur les niveaux de diplôme<br />
En <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, <strong>en</strong> 2007, le taux de sco<strong>la</strong>risation des 15-17 ans et 18-24<br />
ans est légèrem<strong>en</strong>t inférieur au taux national (95,8% contre 96,3% et 47,3%<br />
contre 51,7%).<br />
Par cycle d’étude <strong>en</strong> 2008, il est plus élevé <strong>pour</strong> le secondaire (30,4% contre<br />
28,9%) et moins <strong>pour</strong> le supérieur (19,06% contre 24,8%). Il diminue fortem<strong>en</strong>t<br />
sur longue période depuis 1999 (-5,08% contre -3,34% dans le secondaire et<br />
- 0,93% contre - 0,46% dans le supérieur) sous le double effet de <strong>la</strong> plus grande<br />
rapidité des parcours sco<strong>la</strong>ires (moins de redoublem<strong>en</strong>ts) et de <strong>la</strong> baisse de <strong>la</strong><br />
durée des études ; <strong>en</strong> effet, les haut-normands s’ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t davantage dans des<br />
parcours d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t professionnel ou technologiques moins longs et<br />
<strong>pour</strong>suiv<strong>en</strong>t moins dans l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur.<br />
Globalem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> région se caractérise par un taux d’accès d’une génération au bac<br />
conforme à <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale (65,6%). Les taux de réussite sont <strong>en</strong><br />
augm<strong>en</strong>tation significative sur <strong>la</strong> région depuis 2008 : session 2011 : taux moy<strong>en</strong><br />
de 84,3%, (86,1% contre 88,2% <strong>en</strong> FM <strong>en</strong> bac général - 79,8% contre 82,3% <strong>en</strong><br />
FM <strong>en</strong> bac technologique - 84,2% contre 83,6% <strong>en</strong> FM <strong>en</strong> bac professionnel),<br />
mais <strong>la</strong> proportion d’une génération obt<strong>en</strong>ant le bac reste <strong>en</strong> deçà de <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne.<br />
Le taux de bacheliers <strong>pour</strong>suivant des études supérieures reste loin derrière <strong>la</strong><br />
moy<strong>en</strong>ne nationale (71,2% contre 74,9% <strong>en</strong> FM r<strong>en</strong>trée 2011) <strong>en</strong> raison de <strong>la</strong><br />
plus forte proportion de bacheliers professionnels.<br />
Malgré un déficit de formation des actifs, leur niveau de diplôme n’a cessé<br />
d’augm<strong>en</strong>ter : dès les années 2000, le rapport <strong>en</strong>tre actifs non diplômés et<br />
diplômés de niveau V s’est inversé <strong>pour</strong> <strong>la</strong> première fois et ce, quelle que soit <strong>la</strong><br />
zone d’emploi considérée sur le territoire haut-normand.<br />
Par ailleurs, les jeunes <strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t sur le marché du travail de plus <strong>en</strong> plus diplômés<br />
et les écarts intergénérationnels se creus<strong>en</strong>t :<br />
Sans diplôme <strong>en</strong> 2006<br />
actifs de + de 50 ans 40%<br />
actifs de – de 30 ans 17%<br />
La majorité, soit 57%, des diplômés de – de 30 ans possède un diplôme de<br />
niveau IV ou plus contre seulem<strong>en</strong>t 48% <strong>en</strong> 1999 et 40% des jeunes femmes ont<br />
un diplôme de niveau III ou supérieur, contre 24% des hommes.<br />
Même quand elles sont diplômées de niveau V, les femmes sont employées<br />
proportionnellem<strong>en</strong>t plus que les hommes à des postes d’ouvriers non qualifiés.<br />
Malgré ces progrès, le déficit de formation initiale constaté perdure même si les<br />
écarts se réduis<strong>en</strong>t : les indicateurs des autres régions progress<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t et<br />
le « rang » de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> ne s’améliore pas significativem<strong>en</strong>t malgré<br />
les efforts.<br />
→ Les besoins spécifiques à <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
La question des niveaux de formation constitue un <strong>en</strong>jeu de premier ordre<br />
puisque il est estimé que 73 % des recrutem<strong>en</strong>ts de jeunes de <strong>la</strong> période 2002-<br />
2015 ont été ou seront de niveau bac minimum, contre 65% au cours de <strong>la</strong><br />
période 1990-2002<br />
Octobre 2012 101
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les activités économiques prés<strong>en</strong>tes sur le territoire régional appell<strong>en</strong>t à une<br />
élévation des niveaux de formation et à des évolutions des « capacités<br />
professionnelles » et non exclusivem<strong>en</strong>t des savoirs techniques.<br />
Les mutations des activités et les besoins d’innovation accélèr<strong>en</strong>t les<br />
changem<strong>en</strong>ts dans les emplois : technicité, é<strong>la</strong>rgissem<strong>en</strong>t des compét<strong>en</strong>ces, prérequis<br />
de plus <strong>en</strong> plus complets,…<br />
Le diplôme de niveau V de plus <strong>en</strong> plus nécessaire <strong>pour</strong> accéder à l’emploi dans<br />
des activités industrielles traditionnellem<strong>en</strong>t peu demandeuses de col<strong>la</strong>borateurs<br />
diplômés devi<strong>en</strong>t insuffisant avec l’automatisation des process industriels, <strong>la</strong><br />
nécessité de travailler <strong>en</strong> autonomie sur une ligne de production ou d’exercer des<br />
contrôles et une maint<strong>en</strong>ance de premier niveau<br />
Le niveau IV devi<strong>en</strong>t le niveau minimum de formation requis <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>trée dans<br />
l’emploi à des postes de production sur profil de technici<strong>en</strong>s, même s’il reste des<br />
besoins localisés <strong>en</strong> savoir-faire traditionnels.<br />
Le niveau III (bac+2) t<strong>en</strong>d même à se substituer au niveau IV comme premier<br />
niveau d’accès à l’emploi dans certains secteurs : exemple de <strong>la</strong> Chimie, où <strong>la</strong><br />
maîtrise de <strong>la</strong> sécurité est un élém<strong>en</strong>t du quotidi<strong>en</strong>. Ailleurs c’est l’usage des<br />
<strong>la</strong>ngues, de l’informatique, le bon niveau de culture générale, <strong>la</strong> capacité à<br />
travailler avec d’autres corps de métiers… qui seront recherchés <strong>pour</strong> répondre<br />
aux exig<strong>en</strong>ces d’adaptabilité dans l’emploi, d’intégration des évolutions<br />
technologiques ou les normes qualité…<br />
La région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> cumule donc 2 handicaps : elle a moins de bagage<br />
« formation » alors qu’il lui <strong>en</strong> faudrait plus. La popu<strong>la</strong>tion active et, tout<br />
particulièrem<strong>en</strong>t, les jeunes qui cherch<strong>en</strong>t à s’insérer n’ont pas les qualifications<br />
nécessaires. Or, compte t<strong>en</strong>u des mutations nécessaires de son économie, <strong>la</strong><br />
région a besoin d’une popu<strong>la</strong>tion davantage formée.<br />
→ La synergie <strong>en</strong>tre acteurs <strong>pour</strong> répondre aux défis :<br />
L’offre d’éducation dép<strong>en</strong>d très <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t de l’Etat mais le rôle des collectivités<br />
territoriales s’est ét<strong>en</strong>du au fil du temps <strong>en</strong> matière de formation initiale mais<br />
surtout de formation continue, champ dans lequel les part<strong>en</strong>aires sociaux jou<strong>en</strong>t<br />
égalem<strong>en</strong>t un rôle important. La stratégie de Lisbonne au niveau europé<strong>en</strong> a fixé<br />
des objectifs à 2010 et à 2020 <strong>pour</strong> <strong>en</strong>trer dans « <strong>la</strong> société de <strong>la</strong> connaissance ».<br />
Les niveaux d’interv<strong>en</strong>tion et les acteurs sont multiples, nécessitant davantage de<br />
coordination.<br />
Parmi les réc<strong>en</strong>ts élém<strong>en</strong>ts de contexte structurants <strong>en</strong> matière de formation, on<br />
peut citer <strong>la</strong> réforme de <strong>la</strong> voie professionnelle, introduisant un diplôme de niveau<br />
IV (bac professionnel) <strong>en</strong> complém<strong>en</strong>t du niveau V (CAP), <strong>la</strong> réforme du lycée, <strong>la</strong><br />
loi sur l’autonomie des universités, <strong>la</strong> loi de 2009 re<strong>la</strong>tive à l’ori<strong>en</strong>tation et à <strong>la</strong><br />
formation professionnelle tout au long de <strong>la</strong> vie…<br />
En <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, l’adoption conjointe du CPRDFP et du CRDE 33 par <strong>la</strong> Région<br />
et ses part<strong>en</strong>aires met l’acc<strong>en</strong>t sur les objectifs communs, partagés par les<br />
signataires 34 du CPRDFP <strong>en</strong> matière :<br />
- d’observation des besoins des <strong>en</strong>treprises,<br />
- d’ori<strong>en</strong>tation des publics vers les formations et les métiers porteurs, d’élévation<br />
générale des qualifications,<br />
33 CRDE – Contrat régional de développem<strong>en</strong>t économique<br />
34 Préfet, Autorités académiques, Présid<strong>en</strong>t de Région<br />
Octobre 2012 102
Variable Formation Insertion<br />
- d’atteinte du niveau V minimum <strong>pour</strong> tous et de lutte contre le décrochage<br />
sco<strong>la</strong>ire,<br />
- d’offre de solution formation adaptées à toutes les situations.<br />
Les diagnostics réalisés tant <strong>pour</strong> le CRDE que <strong>pour</strong> le CPRDF ont permis une<br />
lecture partagée de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion emploi formation sur l’<strong>en</strong>semble des territoires et<br />
des grands secteurs d’activité.<br />
Ils constitu<strong>en</strong>t donc une base commune <strong>pour</strong> une approche concrète et<br />
méthodologique de concertation et d’animation des acteurs de <strong>la</strong> formation, de<br />
l’ori<strong>en</strong>tation, de l’emploi. Le CCREFP doit être l’instance d’évaluation du CPRDFP<br />
s’il est vrai que l’on manque de recul <strong>en</strong> raison de son adoption réc<strong>en</strong>te (mai<br />
2011), les dispositions exist<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> faire <strong>en</strong> sorte d’organiser l’action des<br />
part<strong>en</strong>aires régionaux autour des ambitions.<br />
Enfin <strong>en</strong> matière d’ori<strong>en</strong>tation, <strong>la</strong> refonte <strong>en</strong> cours du service public de<br />
l’ori<strong>en</strong>tation est <strong>en</strong>core trop réc<strong>en</strong>te <strong>pour</strong> id<strong>en</strong>tifier les réels changem<strong>en</strong>ts opérés,<br />
mais elle p<strong>la</strong>ce l’ori<strong>en</strong>tation au cœur des problématiques de réussite des parcours<br />
de formation et d’insertion dans l’emploi à terme.<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
D'ici 2040, <strong>la</strong> démographie des c<strong>la</strong>sses d’âge devrait connaître, à t<strong>en</strong>dance<br />
constante, une évolution structurelle avec davantage de personnes âgées de 60<br />
ans ou plus, un doublem<strong>en</strong>t des 80 ans ou plus et inversem<strong>en</strong>t, une diminution<br />
des tranches d'âge plus jeunes, <strong>en</strong> particulier les 30 - 60 ans. Ces modifications<br />
s’accompagn<strong>en</strong>t d’un allongem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> durée d’activité liée aux réc<strong>en</strong>tes<br />
réformes des retraites dont les effets seront à absorber d’ici <strong>2025</strong>.<br />
Les <strong>en</strong>treprises confrontées au phénomène de vieillissem<strong>en</strong>t de leurs actifs<br />
doiv<strong>en</strong>t anticiper leur remp<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t, voire innover dans l’organisation du<br />
travail <strong>pour</strong> conserver et transmettre les compét<strong>en</strong>ces et savoirs faire aux plus<br />
jeunes.<br />
Cette question est d’autant plus cruciale <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> que <strong>la</strong> région<br />
compte deux fois plus de secteurs d’activité qu’au niveau national où <strong>la</strong><br />
proportion d’actifs âgés de 45 à 54 ans est supérieure à 30%.<br />
Néanmoins, les r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>ts d’actifs ne se feront pas à l’id<strong>en</strong>tique sur les<br />
secteurs concernés, <strong>en</strong> termes ni de qualification, ni de typologie de métier et les<br />
mutations affecteront aussi le poids des secteurs <strong>en</strong>tre eux.<br />
La t<strong>en</strong>dance à <strong>2025</strong> met donc <strong>en</strong> exergue deux notions qui s’impos<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong><br />
plus comme une nécessité face à des parcours professionnels de moins <strong>en</strong> moins<br />
linéaires :<br />
- d’une part, l’acquisition d’un « socle » de compét<strong>en</strong>ces de base et de<br />
compét<strong>en</strong>ces transversales <strong>pour</strong> garantir une certaine adaptabilité dans l’emploi<br />
- d’autre part, <strong>la</strong> « formation tout au long de <strong>la</strong> vie » <strong>pour</strong> accompagner <strong>la</strong> fluidité<br />
et <strong>la</strong> sécurisation des parcours. La FTLV répond aussi tout simplem<strong>en</strong>t aux<br />
aspirations des individus à changer de voie ou à évoluer professionnellem<strong>en</strong>t.<br />
Les articu<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre formation initiale et perman<strong>en</strong>te vont se complexifier.<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> diversité des publics <strong>en</strong> formation initiale va perdurer et avec<br />
elle <strong>la</strong> difficulté d’assurer <strong>la</strong> réussite <strong>pour</strong> tous dans un cadre qui n’ouvrirait pas<br />
davantage de possibilités d’individualiser des parcours<br />
Octobre 2012 103
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les appr<strong>en</strong>tissages « informels » 35 vont se développer avec les technologies de<br />
l’information et continuer à réinterroger les fondem<strong>en</strong>ts mêmes des modalités des<br />
appr<strong>en</strong>tissages et de l’évaluation des acquis<br />
Les ruptures possibles<br />
Nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation avec nouveaux transferts de compét<strong>en</strong>ces, dans<br />
des domaines de <strong>la</strong> formation initiale (secondaire et <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur), de<br />
<strong>la</strong> formation continue et notamm<strong>en</strong>t des demandeurs d’emploi, <strong>la</strong> régionalisation<br />
du SPO…<br />
Les hypothèses :<br />
→ H1 - Retards creusés et recul attractivité du supérieur<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs n’a pas<br />
été à <strong>la</strong> mesure des retards à rattraper <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région. Ces retards se sont<br />
creusés. Le retard <strong>en</strong> nombre de sortants non diplômés de <strong>la</strong> formation initiale,<br />
ou dans l’accès à l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur n’est pas rattrapé.<br />
Les acteurs de <strong>la</strong> formation et de l’économie régionale ne sont pas <strong>en</strong> capacité de<br />
mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce les adaptations nécessaires des formations et des qualifications<br />
aux besoins des secteurs <strong>en</strong> forte mutation et se trouv<strong>en</strong>t davantage fragilisés.<br />
La synergie <strong>en</strong>tre les acteurs de <strong>la</strong> formation initiale et continue, de l’information<br />
et de l’ori<strong>en</strong>tation, les part<strong>en</strong>aires sociaux et les <strong>en</strong>treprises, n’est pas au niveau<br />
des <strong>en</strong>jeux <strong>pour</strong> rattraper les retards régionaux.<br />
→ H2 – Rattrapage des retards <strong>en</strong> formation et recherche<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs a permis<br />
de rattraper les retards de <strong>la</strong> région. Les adaptations nécessaires des<br />
qualifications aux besoins de quelques secteurs <strong>en</strong> forte mutation sont mises <strong>en</strong><br />
p<strong>la</strong>ce. Les acteurs de <strong>la</strong> formation initiale et continue ont r<strong>en</strong>forcé les li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre<br />
eux et les habitudes de travail <strong>en</strong> commun.<br />
→ H3 – Attractivité r<strong>en</strong>forcée de l’offre formation/recherche. Elévation<br />
des niveaux<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs a été<br />
significative et les opportunités structurelles qu’offrait l’économie régionale ont<br />
permis, grâce à <strong>la</strong> coordination de tous les acteurs de l’ori<strong>en</strong>tation, de <strong>la</strong><br />
formation, de l’emploi, de pr<strong>en</strong>dre de l’avance sur <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne des régions qui ne<br />
disposai<strong>en</strong>t pas des mêmes ressources. La formation est un des piliers qui<br />
permettra à <strong>la</strong> région de relever le défi de <strong>la</strong> société de <strong>la</strong> connaissance.<br />
L’élévation des qualifications est significative tant <strong>en</strong> niveaux de sortie de<br />
formation initiale qu’<strong>en</strong> volume de formés par niveau. Les qualifications sont<br />
adaptées aux besoins des secteurs <strong>en</strong> forte mutation et pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> compte les<br />
nouvelles exig<strong>en</strong>ces du développem<strong>en</strong>t durable. Une évaluation des politiques<br />
publiques de formation est systématique <strong>pour</strong> répondre aux objectifs de moy<strong>en</strong><br />
long terme partagés par les différ<strong>en</strong>ts acteurs dans les lieux de concertation<br />
instaurés grâce aux différ<strong>en</strong>ts contrats régionaux. Le CPRDFP est l’outil de <strong>la</strong><br />
démarche stratégique suivie et évaluée par le CCREFP.<br />
35 À l’initiative des individus, hors des temps organisés par les systèmes c<strong>la</strong>ssiques de formation<br />
initiale et continue<br />
Octobre 2012 104
Variable Formation Insertion<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
Etat, Région, part<strong>en</strong>aires sociaux, établissem<strong>en</strong>ts de formation, organismes de<br />
formation, <strong>en</strong>treprises, acteurs de l’AIO, CREFOR, pôle emploi<br />
Sources :<br />
- Diagnostic CPRDFP - janvier 2011– CREFOR<br />
- Diagnostic CRDE - novembre 2011 – Ernst & Young<br />
- Géographie de l’école – DEPP Ministère – mai 2011<br />
- Géographie emploi-formation – CREFOR – 2011<br />
- Dossier de r<strong>en</strong>trée 2011 – académie de Rou<strong>en</strong> – septembre 2011<br />
- Diagnostic STRATER – ministère de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur et de <strong>la</strong> recherche – avril<br />
2011<br />
- At<strong>la</strong>s régional des effectif d’étudiants 2010-2011 – DGESIP – Ministère de<br />
l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur et de <strong>la</strong> recherche – janvier 2012<br />
- Prospective emploi-formation <strong>en</strong> 2015 : une nouvelle approche- Les dossiers n°175,<br />
Ministère de l’Éducation Nationale<br />
Octobre 2012 105
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 106
Variable Recherche Innovation<br />
9. Fiche variable « Recherche et Innovation »<br />
Définitions<br />
Recherche : « Ensemble des activités intellectuelles ayant <strong>pour</strong> objet <strong>la</strong><br />
production ou <strong>la</strong> progression des connaissances ».<br />
Activités m<strong>en</strong>ées au sein de structures dédiées, publiques ou privées.<br />
Distinction <strong>en</strong>tre recherche fondam<strong>en</strong>tale et recherche appliquée, mais évolution<br />
vers un continuum qui t<strong>en</strong>d à lisser le passage de l’une à l’autre ;<br />
Innovation : «Processus par lequel on cherche à apporter une réponse nouvelle à<br />
un besoin formulé de façon plus ou moins explicite ».<br />
Distinction <strong>en</strong>tre innovation de produit et innovation de process.<br />
L’innovation se traduit <strong>en</strong> applications sur le p<strong>la</strong>n économique (notion d’avantage<br />
concurr<strong>en</strong>tiel).<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable 36<br />
• Dép<strong>en</strong>ses de R&D publiques / privées<br />
• Int<strong>en</strong>sité de R&D (ratio dép<strong>en</strong>ses R&D/PIB régional)<br />
• Part du PIB régional consacré à <strong>la</strong> recherche<br />
• Somme investie par habitant dans une région<br />
• Nombre de chercheurs et d’<strong>en</strong>seignants chercheurs<br />
• Effectifs étudiants dans filières dont les filières sci<strong>en</strong>tifiques<br />
• Nombre de thèses de doctorat sout<strong>en</strong>ues<br />
• Nombre de brevets déposés<br />
• Nombre de publications diffusées<br />
• Nombre de bourses CIFRE <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (conv<strong>en</strong>tions industrielles de<br />
formation par <strong>la</strong> recherche)<br />
• Nombre de <strong>la</strong>boratoires <strong>la</strong>bellisés (CNRS, INSERM, INRA, IFREMER, Education<br />
nationale)<br />
• Nombre de contrats compétitifs (ERC – European Research Council)<br />
• Résultats aux appels à projets d’investissem<strong>en</strong>ts d’av<strong>en</strong>irs<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
• Forte prés<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> recherche privée émanant de grands groupes: automobile,<br />
aéronautique, CBS<br />
• A contrario peu de culture R&D dans les PME<br />
• Recherche publique peu développée (ratio 20/80% - l’écart <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> est aux extrémités)<br />
• Abs<strong>en</strong>ce de structures de pilotage administratif de <strong>la</strong> recherche publique <strong>en</strong><br />
région (CNRS à Ca<strong>en</strong>, INSERM à Lille)<br />
• Nombre limité de <strong>la</strong>boratoires INSERM et CNRS<br />
• Abs<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong>boratoires <strong>la</strong>bellisés INRA ou IFREMER<br />
•<br />
•<br />
36 Observatoire des sci<strong>en</strong>ces et des techniques, publication annuelle.<br />
Octobre 2012 107
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• Emerg<strong>en</strong>ce réc<strong>en</strong>te d’une dynamique de réseau, <strong>en</strong> rupture avec<br />
l’individualisme culturel, aussi bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre organisations de même nature, qu’<strong>en</strong>tre<br />
secteur privé et secteur public, grandes et petites <strong>en</strong>treprises, y compris au<br />
niveau interrégional, favorisant le montage de projets col<strong>la</strong>boratifs plus<br />
performants<br />
• Souti<strong>en</strong> financier insuffisant aux jeunes <strong>en</strong>treprises innovantes handicapant<br />
leur performance et leur pér<strong>en</strong>nité<br />
• Peu d’allocations CIFRE<br />
• Faiblesse du nombre de projets ret<strong>en</strong>us dans le cadre des Investissem<strong>en</strong>ts<br />
d’Av<strong>en</strong>ir et conc<strong>en</strong>tration dans le domaine des Sci<strong>en</strong>ces de l’ingénieur<br />
• Lourdeur de <strong>la</strong> réglem<strong>en</strong>tation des dépôts de brevets<br />
La situation a beaucoup évolué depuis 2004 : favorablem<strong>en</strong>t sur le territoire avec<br />
<strong>la</strong> création de pôles de compétitivité et le volontarisme de <strong>la</strong> Région qui se traduit<br />
dans les GRR (structurant et donnant de <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce), néanmoins moins<br />
favorablem<strong>en</strong>t au niveau national avec l’économie affectée par <strong>la</strong> crise.<br />
Les indicateurs observés dans le temps (observatoire des sci<strong>en</strong>ces et techniques<br />
depuis 12 ans) montr<strong>en</strong>t qu’<strong>en</strong> situation re<strong>la</strong>tive par rapport aux autres régions,<br />
les 2 <strong>Normandie</strong> sont toujours dans le peloton de queue. Le handicap n’est pas<br />
levé et il faut des facteurs d’accélération <strong>pour</strong> faire décoller <strong>la</strong> région.<br />
Prospective : t<strong>en</strong>dances d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
• La moitié des technologies utilisées à grande échelle dans 10 ans sont <strong>en</strong>core<br />
inconnues aujourd’hui, <strong>en</strong> particulier celles concernant l’accessibilité numérique.<br />
• Impact incontournable de <strong>la</strong> globalisation : l’accroissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> mobilité des<br />
chercheurs et leur conc<strong>en</strong>tration autour de grandes équipes internationales r<strong>en</strong>d<br />
plus que jamais nécessaire l’excell<strong>en</strong>ce comme critère de lisibilité et de pér<strong>en</strong>nité<br />
<strong>pour</strong> nos structures <strong>en</strong> région.<br />
• La t<strong>en</strong>dance lourde est une politique nationale de conc<strong>en</strong>tration et donc au<br />
regroupem<strong>en</strong>t des c<strong>en</strong>tres de recherche qui ne joue pas <strong>en</strong> faveur des régions où<br />
<strong>la</strong> recherche est réc<strong>en</strong>te comme <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
• La politique initiée par le Traité de Lisbonne (l’Europe de <strong>la</strong> connaissance)<br />
produit ses effets sur le long terme et capitalise ses premiers acquis dans des<br />
réseaux europé<strong>en</strong>s (clusters europé<strong>en</strong>s, pôles de compétitivité français).<br />
• Les contraintes pesant sur les financem<strong>en</strong>ts publics vont conduire à une plus<br />
grande sélectivité <strong>en</strong> matière de souti<strong>en</strong> aux programmes de recherche.<br />
• Le salut est dans l’excell<strong>en</strong>ce.<br />
• Les financem<strong>en</strong>ts publics, notamm<strong>en</strong>t europé<strong>en</strong>s dans le cadre de <strong>la</strong> vague<br />
2014-2020, vont s’inscrire dans <strong>la</strong> nouvelle logique de <strong>la</strong> « smart<br />
specialisation » : chaque territoire ne peut être excell<strong>en</strong>t partout, il faut<br />
effectivem<strong>en</strong>t viser l'excell<strong>en</strong>ce là où on <strong>en</strong> a les compét<strong>en</strong>ces et jouer <strong>la</strong><br />
complém<strong>en</strong>tarité avec les territoires voisins.<br />
Octobre 2012 108
Variable Recherche Innovation<br />
Les ruptures possibles<br />
Ruptures « négatives » :<br />
• délocalisation de <strong>la</strong> recherche vers les pays émerg<strong>en</strong>ts ou à coût plus faible ;<br />
• obsolesc<strong>en</strong>ce ou échec des technologies sur lesquels le territoire a conc<strong>en</strong>tré<br />
ses efforts ;<br />
• <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre territoires voisins pénalise <strong>la</strong> région normande au profit de<br />
l’Ile de France, qui attire de plus <strong>en</strong> plus les chercheurs ;<br />
• manque d’acceptabilité sociétale des technologies nouvelles ;<br />
• conc<strong>en</strong>tration de <strong>la</strong> recherche sur quelques hyper campus, PRES ou quelques<br />
grands pôles au niveau national, au détrim<strong>en</strong>t de notre territoire où <strong>la</strong> recherche<br />
est réc<strong>en</strong>te.<br />
Ruptures « positives » :<br />
• le projet Paris Seine <strong>Normandie</strong> fédère les énergies ;<br />
• <strong>la</strong> proximité de l’Ile de France voisine permet l’expansion des activités de<br />
recherche, favorisée par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce de grands équipem<strong>en</strong>ts structurants et des<br />
infrastructures de transports performantes ;<br />
• <strong>la</strong> région réussit sa spécialisation sur différ<strong>en</strong>ts secteurs de pointe et<br />
devi<strong>en</strong>t <strong>la</strong> référ<strong>en</strong>ce incontournable sur ces secteurs de R&D : ex. peptides, CBS,<br />
éoli<strong>en</strong>, matériaux, énergie ;<br />
• grâce à l’influ<strong>en</strong>ce d’acteurs locaux, leaders d’<strong>en</strong>vergure nationale, <strong>la</strong><br />
région bénéficie d’une imp<strong>la</strong>ntation d’un <strong>la</strong>boratoire d’excell<strong>en</strong>ce.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 - Dilution et recul de <strong>la</strong> recherche régionale.<br />
Concurr<strong>en</strong>ce exacerbée <strong>en</strong>tre les « campus » (au s<strong>en</strong>s d’un grand site sci<strong>en</strong>tifique<br />
à visibilité international), générant une dilution et un recul de <strong>la</strong> recherche<br />
régionale dans un contexte de mondialisation de <strong>la</strong> recherche. Défici<strong>en</strong>ce des<br />
financem<strong>en</strong>ts publics et déréglem<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> recherche. L’action du PRES est<br />
limitée. Le défaut d'attractivité de l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur s'est acc<strong>en</strong>tué.<br />
→ H2 : La ré industrialisation et <strong>la</strong> relocalisation favoris<strong>en</strong>t le mainti<strong>en</strong><br />
des activités de recherche.<br />
Le PRES jouit d’une visibilité nationale et internationale lui permettant ainsi<br />
d’<strong>en</strong>gager des actions structurantes. Mise <strong>en</strong> réseau efficace des acteurs de <strong>la</strong><br />
recherche dans un contexte europé<strong>en</strong> dynamique, à l’échelle du projet Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>.<br />
→ H3 – Structuration et attractivité r<strong>en</strong>forcée de l'offre de formation<br />
supérieure et de <strong>la</strong> recherche régionale<br />
Le PRES est piloté à l’échelle interrégionale dans le cadre du projet fédérateur<br />
Paris Seine <strong>Normandie</strong>. Les bourses doctorales régionales sont r<strong>en</strong>forcées,<br />
certaines sont fléchées sur des thèmes <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec les problématiques du<br />
territoire haut-normand. Les chercheurs bénéfici<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> part des part<strong>en</strong>aires<br />
locaux de mesures d’accompagnem<strong>en</strong>t social à <strong>la</strong> formation doctorale. La<br />
structuration et l’attractivité sont r<strong>en</strong>forcées par l’offre de formation supérieure et<br />
<strong>la</strong> recherche régionale.<br />
Octobre 2012 109
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
- Monde universitaire, à titre individuel ou collectif<br />
- PRES<br />
- Organismes de recherche<br />
- Filières et autres structures part<strong>en</strong>ariales (pôles, grappes, clusters…)<br />
- Acteurs économiques<br />
- Acteurs politiques<br />
- Collectivités territoriales et consu<strong>la</strong>ires<br />
Sources:<br />
- Diagnostic CRDE 2011 - Ernst & Young - Novembre 2011<br />
- Géographie emploi-formation 2011– CREFOR - 2011<br />
- Diagnostic STRATER – ministère de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur et de <strong>la</strong> recherche – avril<br />
2011<br />
- At<strong>la</strong>s régional des effectif d’étudiants 2010-2011 – DGESIP – Ministère de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
supérieur et de <strong>la</strong> recherche – janvier 2012<br />
- Publication annuelle, Observatoire des sci<strong>en</strong>ces et des techniques.<br />
Octobre 2012 110
Variable Offre de soins et Politique de Santé<br />
10. Fiche variable « Offre de soins et Politique de Santé 37 »<br />
Définitions<br />
« L’offre de soins dans une région contribue à garantir un état sanitaire<br />
satisfaisant à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Elle s’articule autour du secteur public (hôpitaux), du<br />
secteur privé (cliniques) et de <strong>la</strong> santé libérale (médecins, infirmiers, kinés, etc.).<br />
Au niveau d’un territoire, les différ<strong>en</strong>ts élém<strong>en</strong>ts constitutifs de l’offre de soins<br />
devrai<strong>en</strong>t donc former un mail<strong>la</strong>ge complém<strong>en</strong>taire <strong>pour</strong> répondre au mieux aux<br />
besoins de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. 38 .<br />
Plusieurs principes importants conditionn<strong>en</strong>t néanmoins cette offre : <strong>la</strong> liberté<br />
d’instal<strong>la</strong>tion des médecins libéraux, <strong>la</strong> liberté du choix du médecin par le pati<strong>en</strong>t<br />
ainsi que le conv<strong>en</strong>tionnem<strong>en</strong>t. Ils sont néanmoins à <strong>la</strong> source d’une inégalité<br />
face à l’accès aux soins. Les politiques nationales de santé publique sont<br />
égalem<strong>en</strong>t déterminantes sur l’offre et l’accès aux soins.<br />
Si l’offre de soins est une condition nécessaire au bon état sanitaire d’une<br />
popu<strong>la</strong>tion, elle n’est pas suffisante <strong>en</strong> tant que telle. Les pratiques d’une<br />
popu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> matière d’alim<strong>en</strong>tation, de consommation d’alcool, de tabagie ou de<br />
sport, les conditions de travail, les facteurs <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux, etc., mais aussi le<br />
mode de recours au système de soins ou à <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion sont autant de facteurs<br />
indép<strong>en</strong>dants de l’offre de soins qui peuv<strong>en</strong>t affecter l’état de santé de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion »<br />
Organisation régionale de l’offre de soins :<br />
Au niveau régional, les ag<strong>en</strong>ces régionales de santé (ARS) assur<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
coordination des soins prodigués, veill<strong>en</strong>t à une gestion cohér<strong>en</strong>te des ressources<br />
et garantiss<strong>en</strong>t un accès égal à une prise <strong>en</strong> charge de qualité. Elles adapt<strong>en</strong>t les<br />
politiques nationales à leurs contextes régionaux, par le biais de programmes<br />
régionaux de santé (PRS), composés de schémas régionaux de prév<strong>en</strong>tion, de<br />
schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) de ville et hospitaliers, ainsi<br />
que de schémas médico-sociaux <strong>pour</strong> les personnes âgées ou dép<strong>en</strong>dantes.<br />
Au niveau local, les structures et les professionnels de santé s’organis<strong>en</strong>t, sous <strong>la</strong><br />
supervision des ARS, <strong>pour</strong> permettre une prise <strong>en</strong> charge graduée des pati<strong>en</strong>ts<br />
selon leur état : des soins de 1er recours c<strong>en</strong>trés autour du médecin généraliste,<br />
qui assure l’ori<strong>en</strong>tation du pati<strong>en</strong>t, des soins de 2nd recours disp<strong>en</strong>sés par les<br />
médecins spécialistes et les établissem<strong>en</strong>ts de santé, voire des structures<br />
adaptées comme les c<strong>en</strong>tres hospitaliers universitaires (CHU). Cette organisation<br />
est conditionnée par une coordination des soins <strong>en</strong>tre les établissem<strong>en</strong>ts de santé<br />
et <strong>la</strong> médecine de ville d’une part, un r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> perman<strong>en</strong>ce des soins,<br />
ambu<strong>la</strong>toire et hospitalière, d’autre part.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
• d<strong>en</strong>sité de professionnels médicaux et paramédicaux par spécialité et par zone<br />
géographique ; pyramide des âges des professionnels de santé ; offre de<br />
formation médicale et paramédicale et répartition des quotas nationaux et<br />
régionaux dans les formations ;<br />
37 Sources : Stratégie nationale de développem<strong>en</strong>t durable 2010-2013, juillet 2010.<br />
Insee, Les territoires de santé <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> situation socio-sanitaire actuelle et<br />
perspectives démographiques, AVAL <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, mars 2012, n°114.,<br />
38 Définition INSEE<br />
Octobre 2012 111
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• données re<strong>la</strong>tives à <strong>la</strong> mortalité et à <strong>la</strong> morbidité par cause, par tranche d’âge,<br />
prématurée (0-64 ans), admission <strong>en</strong> ALD (affections longue durée)<br />
• vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
• dép<strong>en</strong>dance / vieillissem<strong>en</strong>t<br />
• données générales de démographie (naissance, décès, structure par âge …)<br />
• nombre d’établissem<strong>en</strong>ts de santé publics / privés ; répartition sur le<br />
territoire ;<br />
• recours à l’hospitalisation à domicile ;<br />
• taux d’équipem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> lits et p<strong>la</strong>ces ;<br />
• activités de court séjour (alternative à l’hospitalisation) ;<br />
• caractéristiques des séjours <strong>en</strong> soins de suite et de réadaptation, <strong>en</strong><br />
psychiatrie ;<br />
• espérance de vie et espérance de vie <strong>en</strong> bonne santé, à <strong>la</strong> naissance <strong>en</strong> France<br />
• accid<strong>en</strong>ts de travail ; ma<strong>la</strong>dies professionnelles ;<br />
• besoins de santé non satisfaits 39 ;<br />
• taux de suicide.<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> prés<strong>en</strong>te une situation socio-sanitaire actuelle préoccupante<br />
et très contrastée selon les territoires de santé que ce soit <strong>en</strong> termes<br />
d'indicateurs démographiques, sociaux, d'offre de soins ou bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>core d'état de<br />
santé. Ces informations, reflet des années précéd<strong>en</strong>tes notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> termes<br />
d'indicateurs de santé, doiv<strong>en</strong>t être mises <strong>en</strong> regard des perspectives<br />
démographiques. À l'horizon 2040, près de 10 % de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion haut-normande<br />
aura plus de 80 ans contre moins de 5 % <strong>en</strong> 2010. Ce vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion concernera l'<strong>en</strong>semble des territoires et pose d'ores et déjà <strong>la</strong> question<br />
de <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge de cette nouvelle composante de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> termes de<br />
mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce de politiques de santé adaptées.<br />
Le taux de mortalité prématurée (c’est à dire <strong>pour</strong> les personnes âgées de moins<br />
de 65 ans) de <strong>la</strong> région est élevé : 2,3 décès <strong>pour</strong> 1 000 personnes de moins de<br />
65 ans <strong>en</strong> 2007 contre 2,0 <strong>en</strong> France. Ce<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> au 8ème<br />
rang des régions les plus touchées. Cette «surmortalité» est deux fois plus élevée<br />
<strong>pour</strong> les hommes (3,2 <strong>pour</strong> 1 000 dans <strong>la</strong> région contre 2,8 <strong>en</strong> France) que <strong>pour</strong><br />
les femmes (1,4 <strong>pour</strong> 1 000 dans <strong>la</strong> région contre 1,3 <strong>en</strong> France).<br />
La région dispose d’un accès correct aux équipem<strong>en</strong>ts de santé de proximité<br />
(pharmaci<strong>en</strong>s, médecins généralistes, kinésithérapeutes, d<strong>en</strong>tistes et infirmiers)<br />
par rapport au temps de trajet <strong>en</strong> voiture. En 2007, seules 4,2 % des personnes<br />
<strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> (contre 2,9 %) sont situées à plus de 20 minutes <strong>en</strong> voiture<br />
d’un de ces services de soin de proximité, ce<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> région au 13ème rang<br />
<strong>pour</strong> cet indicateur.<br />
Mais le nombre de professionnels de santé rapporté à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion est faible, ce<br />
qui pose <strong>la</strong> question de l’accessibilité réelle aux soins. En particulier <strong>pour</strong> les<br />
médecins généralistes, <strong>la</strong> région est 20ème avec une d<strong>en</strong>sité de 141 médecins<br />
<strong>pour</strong> 100 000 habitants <strong>en</strong> 2008 (163 <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne). Ceci est aussi vrai <strong>pour</strong> les<br />
psychiatres, les ophtalmologues, les chirurgi<strong>en</strong>s d<strong>en</strong>tistes…<br />
Les urg<strong>en</strong>ces du CHU déti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t le 3ème rang <strong>en</strong> France et <strong>la</strong> région ne peut s’<strong>en</strong><br />
vanter, cette afflu<strong>en</strong>ce est un signe de mauvaise santé de notre système d’accès<br />
au soin primaire.<br />
39 Tableau de bord des indicateurs de <strong>la</strong> SNDD 2010-2013, cet indicateur bi<strong>en</strong>nal mesure le<br />
r<strong>en</strong>oncem<strong>en</strong>t aux soins <strong>pour</strong> raisons financières selon le type de couverture médicale.<br />
Octobre 2012 112
Variable Offre de soins et Politique de Santé<br />
Les lobbies ont su faire pression <strong>pour</strong> supprimer <strong>la</strong> réglem<strong>en</strong>tation sur les<br />
instal<strong>la</strong>tions, avec le risque <strong>en</strong> région de voir perdurer les déserts médicaux<br />
d‘étudiants, de professionnels.<br />
La portée pratique de <strong>la</strong> réforme de <strong>la</strong> 1ère année est un échec : il y a toujours<br />
autant de sélection au concours et très peu s’inscriv<strong>en</strong>t dans plusieurs filières.<br />
L’augm<strong>en</strong>tation régulière du numérus c<strong>la</strong>usus <strong>en</strong> 1 ère année de médecine ne<br />
permet pas <strong>en</strong>core de ré<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>cer <strong>la</strong> région <strong>en</strong> professionnels de santé. Après<br />
<strong>la</strong> reconnaissance du grade lic<strong>en</strong>ce accordé par l’Université aux infirmières, des<br />
masters sont mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>pour</strong> créer des nouveaux métiers et dynamiser les<br />
réseaux de soins.<br />
Les étrangers ne peuv<strong>en</strong>t pratiquer que dans le public, on les retrouve dans les<br />
hôpitaux publics (où ils sont 4000 au total). Les modalités de validation de leur<br />
diplôme sont difficiles et le retour dans leur pays d’origine a été reporté <strong>en</strong><br />
2016…le système public ne peut guère se passer d’eux et les modalités de<br />
validation devront être aménagées.<br />
Une « prime à <strong>la</strong> qualité » vi<strong>en</strong>t d’être réintroduite <strong>pour</strong> moduler les effets<br />
déshumanisants de <strong>la</strong> seule TAA (Tarification à l’acte) sur <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge des<br />
pati<strong>en</strong>ts.<br />
Le contexte est celui d’un profond r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de l’organisation régionale de<br />
santé, suite à <strong>la</strong> loi HPST (Hôpital, Pati<strong>en</strong>ts, Santé, Territoires) et à <strong>la</strong> création de<br />
l’ag<strong>en</strong>ce régionale de santé (ARS).<br />
Le taux d’évolution de l’objectif national de dép<strong>en</strong>ses d’assurance ma<strong>la</strong>die a été<br />
fixé à 3% <strong>en</strong> 2010, 2,9% <strong>en</strong> 2011 et 2,8% <strong>pour</strong> 2012. Cet objectif suppose une<br />
vigi<strong>la</strong>nce particulière dans tous les secteurs de dép<strong>en</strong>ses. La gestion optimale des<br />
ressources collectives <strong>en</strong> matière de santé (l’effici<strong>en</strong>ce) doit être recherchée. Et<br />
ce d’autant plus qu’une croissance des dép<strong>en</strong>ses totales de santé supérieure au<br />
taux de l’ONDAM (Objectif national des dép<strong>en</strong>ses d’assurance ma<strong>la</strong>die), se<br />
traduirait inéluctablem<strong>en</strong>t par un accroissem<strong>en</strong>t des inégalités dans l’accès aux<br />
soins.<br />
Prospective : hypothèses d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
Les ressources financières sont de plus <strong>en</strong> plus limitées. La redéfinition des<br />
politiques sociales est une nécessité mais aucun levier local / régional n’est<br />
possible <strong>pour</strong> influer ces choix.<br />
Inéluctable adaptation de l’offre de soins à l’évolution de <strong>la</strong> morbidité et des<br />
demandes de prise <strong>en</strong> charge : développem<strong>en</strong>ts de l’ambu<strong>la</strong>toire, des alternatives<br />
à l’hospitalisation, des réseaux ville – hôpital.<br />
Néanmoins, cette évolution demeure limitée parce que le cadre de p<strong>la</strong>nification<br />
des soins est rigide.<br />
C’est un <strong>en</strong>jeu stratégique, car il faut désormais conjuguer l’hyperspécialisation<br />
des acteurs et des structures (qui va de pair avec l’explosion des connaissances<br />
et des techniques) avec <strong>la</strong> nécessaire coordination des soins et ce, afin d’assurer<br />
une prise <strong>en</strong> charge globale des pati<strong>en</strong>ts. Il s’agit donc de faire travailler<br />
<strong>en</strong>semble des acteurs qui ont une culture de l’indép<strong>en</strong>dance, de l’autonomie et/ou<br />
de <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce.<br />
Toutes les t<strong>en</strong>dances <strong>en</strong> matière d’offre de soins impact<strong>en</strong>t l’aménagem<strong>en</strong>t du<br />
territoire, <strong>la</strong> cohésion sociale et l’organisation du système de santé.<br />
Octobre 2012 113
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les ruptures possibles<br />
La <strong>pour</strong>suite du progrès technique est un élém<strong>en</strong>t porteur de l’av<strong>en</strong>ir : <strong>pour</strong><br />
certaines ma<strong>la</strong>dies (schizophrénie, Alzheimer…), on est passé de <strong>la</strong> théorie<br />
freudi<strong>en</strong>ne, à <strong>la</strong> génétique, demain à <strong>la</strong> microbiologie ou aux virus… Les variables<br />
influ<strong>en</strong>çant ce progrès sont parallèlem<strong>en</strong>t très nombreuses (démographie,<br />
épidémiologie, transformations sociales, financem<strong>en</strong>ts, notions d’usagers / cli<strong>en</strong>ts<br />
/ consommateurs / cotisants…)<br />
L’offre de soin <strong>en</strong> <strong>2025</strong> est un système de variables à lui tout seul, mais sera très<br />
éloigné du système actuel, un véritable nouveau « système so<strong>la</strong>ire »…<br />
La création de l’ANS ag<strong>en</strong>ce nationale de santé est souhaitée <strong>pour</strong> qu’il n’y ait<br />
plus cloisonnem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre ceux qui organis<strong>en</strong>t les soins et ceux qui les financ<strong>en</strong>t.<br />
Les coopérations <strong>en</strong>tre les professionnels de santé et, notamm<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> création<br />
d’un diplôme d’infirmer clinici<strong>en</strong> <strong>en</strong> 1 ère ligne <strong>pour</strong> donner les soins courants et<br />
assurer <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge des pathologies chroniques. Une interv<strong>en</strong>tion du<br />
légis<strong>la</strong>teur est nécessaire <strong>pour</strong> arrêter une liste définie où les diagnostics,<br />
prescriptions, actes techniques <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t être pratiqués par ces infirmiers<br />
clinici<strong>en</strong>s, de même qu’une acceptation sociale…<br />
Ruptures possibles liées aux biotechnologies et à <strong>la</strong> bio-ingénierie :<br />
Les biotechnologies et <strong>la</strong> bio-ingénierie peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t générer des ruptures.<br />
En effet, l’innovation sci<strong>en</strong>tifique et son exploitation industrielle se sont<br />
structurées autour du vivant, de sa compréh<strong>en</strong>sion et de sa manipu<strong>la</strong>tion <strong>en</strong> vue<br />
de nouvelles découvertes dans les domaines du diagnostic, de <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et du<br />
traitem<strong>en</strong>t des ma<strong>la</strong>dies humaines. Si l'innovation sci<strong>en</strong>tifique est bi<strong>en</strong> le moteur<br />
du secteur des biotechnologies et de <strong>la</strong> bio-ingénierie, celles-ci sont néanmoins<br />
très s<strong>en</strong>sibles à des facteurs financiers, réglem<strong>en</strong>taires, politiques, éthiques et<br />
culturels.<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 – Situation sanitaire dégradée. Aggravation des inégalités d’accès<br />
aux soins.<br />
La situation est irrémédiablem<strong>en</strong>t dégradée : les déserts médicaux se<br />
développ<strong>en</strong>t et r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t l’iniquité dans l’accès aux soins. La prév<strong>en</strong>tion et<br />
l’éducation à <strong>la</strong> santé n’exist<strong>en</strong>t plus. Les pathologies régionales sont de plus <strong>en</strong><br />
plus lourdes. La morbidité augm<strong>en</strong>te avec l’âge. Les aides attribuées à <strong>la</strong><br />
recherche dans les secteurs de pointe du CHUR sont réduites. Les recherches<br />
abouties ne sont plus valorisées. Les déserts médicaux se développ<strong>en</strong>t.<br />
L’<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services d’urg<strong>en</strong>ces est un signe de « mauvaise santé » et<br />
d’accès aux soins déséquilibrés.<br />
→ H2 –Les retards régionaux importants se creus<strong>en</strong>t.<br />
La solvabilité du système de santé s’est maint<strong>en</strong>ue mais les retards sont tels que<br />
les écarts se creus<strong>en</strong>t. Aucun changem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière de prév<strong>en</strong>tion n’est à noter,<br />
ce qui acc<strong>en</strong>tue les déséquilibres déjà prégnants <strong>en</strong>tre actifs des différ<strong>en</strong>ts<br />
secteurs professionnels. Les aides attribuées à <strong>la</strong> recherche dans les secteurs de<br />
pointe du CHUR sont réduites. Les recherches abouties ne sont plus valorisées. La<br />
morbidité augm<strong>en</strong>te avec l’âge. La d<strong>en</strong>sité médicale des généralistes a régressé<br />
d’un point. En revanche, <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sité des spécialistes est toujours aussi faible.<br />
L’<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services d’urg<strong>en</strong>ces est un signe de « mauvaise santé » et<br />
d’accès aux soins déséquilibrés.<br />
Octobre 2012 114
Variable Offre de soins et Politique de Santé<br />
→ H3 – Retards <strong>en</strong> cours de rattrapage, baisse des inégalités d’accès aux<br />
soins. E-médecine.<br />
Une prise <strong>en</strong> charge du vieillissem<strong>en</strong>t au niveau national permet de flécher les<br />
moy<strong>en</strong>s sur les priorités régionales (prév<strong>en</strong>tion, démographie médicale …). Les<br />
retards s’estomp<strong>en</strong>t. On assiste à <strong>la</strong> régénération du système de médecine<br />
prév<strong>en</strong>tive. On id<strong>en</strong>tifie et on priorise des secteurs professionnels ou des zones<br />
sco<strong>la</strong>ires prioritaires : les écarts de réduis<strong>en</strong>t. Les aides locales sont attribuées à<br />
<strong>la</strong> recherche de pointe du CHUR : on <strong>en</strong> constate les bénéfices sur les<br />
découvertes médicales. L’âge et <strong>la</strong> morbidité recul<strong>en</strong>t au même rythme.<br />
L’amélioration de <strong>la</strong> démographie médicale est réelle. La région est attractive<br />
<strong>pour</strong> les professionnels de santé dans le cadre de réseaux de soins interactifs. Les<br />
inégalités territoriales dans l’offre de soins sont limitées. Les maisons de santé,<br />
qui ont été généralisées à l’échelle régionale, sont maint<strong>en</strong>ant les lieux d’accès au<br />
soin primaire. La télémédecine et <strong>la</strong> télésanté se sont développées permettant<br />
une meilleure coopération <strong>en</strong>tre les professionnels de santé.<br />
→ H4 – Prév<strong>en</strong>tion généralisée. Recul des pathologies lourdes régionales.<br />
Une prise <strong>en</strong> charge du vieillissem<strong>en</strong>t au niveau national permet de flécher les<br />
moy<strong>en</strong>s sur les priorités régionales (prév<strong>en</strong>tion, démographie médicale …). Les<br />
retards s’estomp<strong>en</strong>t. La médecine prév<strong>en</strong>tive est généralisée. On assiste à un<br />
recul significatif de certaines pathologies régionales lourdes. La télémédecine et <strong>la</strong><br />
télésanté (mais aussi e-exam<strong>en</strong>s et télé prescription), bénéficiant de l’adhésion<br />
des popu<strong>la</strong>tions, se généralis<strong>en</strong>t. L’accès aux soins est plus fluide. L’âge<br />
d’apparition de certaines pathologies recule. La morbidité recule égalem<strong>en</strong>t avec<br />
l’âge. L’amélioration de <strong>la</strong> démographie médicale est réelle. La région est<br />
attractive <strong>pour</strong> les professionnels de santé. Les inégalités territoriales dans l’offre<br />
de soins sont limitées.<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
• Région (formations / professions paramédicales + incitation attractivité /<br />
démographie médicale) ;<br />
• Collectivités territoriales ;<br />
• Ag<strong>en</strong>ce Régionale de Santé (ARS) ;<br />
• Université (<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t et recherche)<br />
• INSERM ;<br />
• Laboratoires de recherche publique / privée ;<br />
• Acteurs économiques ;<br />
• Acteurs politiques;<br />
• Ordres professionnels ;<br />
• CNAM –Caisse Nationale d’Assurance Ma<strong>la</strong>die<br />
Sources :<br />
- « Les nouveaux pati<strong>en</strong>ts… <strong>en</strong> <strong>2025</strong> » - Office de prospective <strong>en</strong> Santé - Rapport 2011.-.<br />
Sci<strong>en</strong>ces Po. Les Presses<br />
- « Les ag<strong>en</strong>ces régionales de santé <strong>en</strong> <strong>2025</strong> » - Office de prospective <strong>en</strong> Santé - Rapport<br />
2011 - C<strong>la</strong>ude Evin - Sci<strong>en</strong>ces Po. Les Presses<br />
- « Histoire de <strong>la</strong> Médecine. <strong>Quel</strong> av<strong>en</strong>ir ? » Philippe Hecketsweiler - Ellipses 2010<br />
- « Médecines – objectifs 203 »5 – éd. l’Archipel – sous <strong>la</strong> direction de Paul B<strong>en</strong>kimoun<br />
- « Le cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t au financem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> santé » - C<strong>en</strong>tre d’analyse stratégique –<br />
Séminaire du 7 avril 2010<br />
- C<strong>en</strong>tre d’analyse stratégique - Note d'analyse n° 254 et 255 - décembre 2011<br />
Octobre 2012 115
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
- « Données statistiques générales sur <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> » - CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> –<br />
octobre 2010 (démographie)<br />
- Fichier du Conseil national de l'Ordre des médecins <strong>pour</strong> l'année 2006 - Traitem<strong>en</strong>t<br />
DREES - projections de popu<strong>la</strong>tion INSEE, projections DREES<br />
- At<strong>la</strong>s de <strong>la</strong> démographie médicale – Situation au 1er janvier 2011 - Conseil National de<br />
l’Ordre des Médecins<br />
- Bulletin d’information - Ordre national des médecins n°21 janv.-fév. 2012<br />
http://www.s<strong>en</strong>at.fr/seances : séance du 12 juillet 2011<br />
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/Contexte-regional<br />
Octobre 2012 116
Variable Environnem<strong>en</strong>t, Climat et Risques naturels et industriels<br />
11. Fiche variable « Environnem<strong>en</strong>t, Climat et Risques naturels et<br />
industriels 40 »<br />
Définitions<br />
Définition 1 :<br />
L’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t peut être défini comme « l’<strong>en</strong>semble, à un mom<strong>en</strong>t donné,<br />
des aspects physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux et<br />
économiques susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à<br />
terme, sur les êtres vivants et les activités humaines » (circu<strong>la</strong>ire n° 77-300 du<br />
29 août 1977 du Ministère de l’Education Nationale). D’une façon plus générale,<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t est constitué de « l’<strong>en</strong>semble des élém<strong>en</strong>ts qui, dans <strong>la</strong><br />
complexité de leurs re<strong>la</strong>tions, constitue le cadre, le milieu, les conditions de vie<br />
<strong>pour</strong> l’homme » (Pierre George, géographe).<br />
Définition 2 :<br />
Les risques naturels : Le phénomène de changem<strong>en</strong>t climatique, apparu depuis<br />
une tr<strong>en</strong>taine d'années et id<strong>en</strong>tifié lors du sommet de <strong>la</strong> terre de Stockholm<br />
(1972), a montré qu'il existe un risque d'origine anthropique sur l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t,<br />
qui peut avoir des impacts sur <strong>la</strong> société. Lors du sommet de <strong>la</strong> terre de Rio de<br />
Janeiro (1992), puis de Johannesburg (2002), des démarches dites de<br />
développem<strong>en</strong>t durable ont été formalisées, dont l'application dans les<br />
<strong>en</strong>treprises relève de <strong>la</strong> responsabilité sociétale des <strong>en</strong>treprises. Beaucoup de<br />
phénomènes naturels (séismes, tsunamis) n'ont pas d'origine anthropique 41 .<br />
C'est <strong>la</strong> superposition spatiale <strong>en</strong>tre l'ext<strong>en</strong>sion d'un aléa et un territoire habité<br />
qui crée le risque. Un séisme dans le désert ne prés<strong>en</strong>te presque pas de<br />
conséqu<strong>en</strong>ce, alors qu'il peut être très grave dans un territoire d<strong>en</strong>sém<strong>en</strong>t<br />
peuplé.<br />
Dans les dernières déc<strong>en</strong>nies, l'émerg<strong>en</strong>ce de nouveaux acteurs comme les ONG,<br />
a montré qu'il était nécessaire d'intégrer des ag<strong>en</strong>ts de <strong>la</strong> société civile dans les<br />
méthodes de managem<strong>en</strong>t. On a ainsi vu apparaître le concept de partie pr<strong>en</strong>ante<br />
(stakeholder <strong>en</strong> ang<strong>la</strong>is ) dans certains modèles économiques, afin de satisfaire à<br />
certaines exig<strong>en</strong>ces de développem<strong>en</strong>t durable et de responsabilité sociétale<br />
(<strong>pour</strong> les <strong>en</strong>treprises).<br />
Le risque dans l’industrie :<br />
Les méthodes normées de gestion du risque sont <strong>en</strong> grande partie apparues dans<br />
le secteur industriel (En 2010, <strong>la</strong> loi sur les ICPE était bic<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aire) : transport<br />
maritime et ferroviaire, exploitations minières, industrie automobile, industrie<br />
nucléaire, aérospatiale, militaire, pétrolière et chimique. Ces méthodes ont été<br />
adaptées au secteur de <strong>la</strong> santé, médecine, pharmacie...<br />
C'est sans doute dans l'industrie nucléaire et de l'armem<strong>en</strong>t que les<br />
conséqu<strong>en</strong>ces visibles et possibles des accid<strong>en</strong>ts sont les plus importantes, mais<br />
aussi les mesures <strong>pour</strong> les prév<strong>en</strong>ir sont les plus sophistiquées. Dans ce secteur,<br />
on parle donc de sûreté, plus que de sécurité.<br />
D'autre part, l'industrie nucléaire comporte une spécificité par rapport aux autres<br />
types d'industrie, qui est <strong>la</strong> durée du cycle.<br />
40 Sources : Insee, Les indicateurs de développem<strong>en</strong>t durable <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Cahier d’aval<br />
n°9, juin 2011<br />
41 www.wikipedia.fr<br />
Octobre 2012 117
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les applications les plus évid<strong>en</strong>tes de <strong>la</strong> gestion des risques industriels<br />
concern<strong>en</strong>t <strong>la</strong> zonation (ex : études de zones <strong>pour</strong> Fos-sur-Mer, Ca<strong>la</strong>is-<br />
Dunkerque,...), <strong>la</strong> cartographie du risque et les régimes d’<strong>en</strong>registrem<strong>en</strong>t (ex :<br />
instal<strong>la</strong>tions c<strong>la</strong>ssées <strong>pour</strong> <strong>la</strong> protection de l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, sites SEVESO ou<br />
ICPE, soumises à une règlem<strong>en</strong>tation plus stricte), <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification (PPRT, études<br />
de risques, études de dangers) et les exercices et formations <strong>pour</strong> <strong>la</strong> sécurité et<br />
<strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
Il existe une multiplicité d’indicateurs, distincts selon les sources.<br />
En France, <strong>la</strong> stratégie nationale de développem<strong>en</strong>t durable a été adoptée par le<br />
Gouvernem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> <strong>la</strong> période 2010-2013 dans le cadre de <strong>la</strong> loi de<br />
programmation du Gr<strong>en</strong>elle de l’Environnem<strong>en</strong>t.<br />
Des indicateurs ont été définis et répartis dans 9 défis sur les thèmes<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>taux, économiques et sociaux propres au développem<strong>en</strong>t durable :<br />
- défi 1 – consommation et production durables<br />
- défi 2 – société de <strong>la</strong> connaissance<br />
- défi 3 – gouvernance<br />
- défi 4 – changem<strong>en</strong>ts climatiques et énergies<br />
- défi 5 – transport et mobilité durables<br />
- défi 6 – conservation et gestion durable de <strong>la</strong> biodiversité et des ressources<br />
naturelles<br />
- défi 7 – santé publique, prév<strong>en</strong>tion et gestion des risques<br />
- défi 8 – démographie, immigration, inclusion sociale<br />
- défi 9 – défis internationaux et développem<strong>en</strong>t durable<br />
Ils permett<strong>en</strong>t des comparaisons au niveau europé<strong>en</strong> sur le développem<strong>en</strong>t<br />
durable. Cette c<strong>la</strong>ssification <strong>en</strong> 9 défis a été reprise par l’Insee et permet ainsi de<br />
comparer <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> avec les autres régions françaises.<br />
Parmi ces indicateurs, on peut ret<strong>en</strong>ir notamm<strong>en</strong>t les suivants qui relèv<strong>en</strong>t de <strong>la</strong><br />
variable « Environnem<strong>en</strong>t, Climat, Risques »<br />
- Changem<strong>en</strong>t climatique et maîtrise de l’énergie<br />
- Evolution des températures hivernales<br />
- Emissions de gaz à effet de serre, hors puits de carbone<br />
- Evolution des consommations finales d’énergie<br />
- Production d’électricité r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>ble rapportée à <strong>la</strong> consommation finale<br />
d’électricité<br />
- Conservation et gestion durable de <strong>la</strong> biodiversité et des ressources<br />
naturelles<br />
- Logem<strong>en</strong>ts non raccordés à un système d’assainissem<strong>en</strong>t des eaux usées<br />
- Nitrates dans les cours d’eau<br />
- Etat des peuplem<strong>en</strong>ts piscicoles<br />
- Abondance des popu<strong>la</strong>tions d’oiseaux communs<br />
- Fragm<strong>en</strong>tation des milieux naturels<br />
- Evolution des surfaces <strong>en</strong> espaces artificialisés<br />
- Part de superficie <strong>en</strong> sites Natura 2000<br />
- Consommation et production durables<br />
- Evolution de <strong>la</strong> quantité de déchets ménagers collectés par habitant<br />
- Prélèvem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> eau par usage<br />
- Surfaces <strong>en</strong> agriculture biologique<br />
Octobre 2012 118
Variable Environnem<strong>en</strong>t, Climat et Risques naturels et industriels<br />
- Valorisation des déchets ménagers et assimilés<br />
- Production de granu<strong>la</strong>ts<br />
- Prév<strong>en</strong>tion et gestion des risques<br />
- D<strong>en</strong>sité d’établissem<strong>en</strong>ts industriels à risque<br />
- Popu<strong>la</strong>tion exposée à des risques d’inondation<br />
- Indice Atmo de <strong>la</strong> qualité de l’air dans les grandes agglomérations<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
Le Schéma régional d’aménagem<strong>en</strong>t et de développem<strong>en</strong>t du territoire (SRADT),<br />
le Contrat de Projets État-Région 2007-2013, le Programme opérationnel régional<br />
FEDER, le Fonds social europé<strong>en</strong> (FSE) sont les principaux outils au service du<br />
développem<strong>en</strong>t durable du territoire haut-normand. Les collectivités hautnormandes<br />
ont égalem<strong>en</strong>t un rôle important à jouer <strong>en</strong> s’<strong>en</strong>gageant dans des<br />
démarches territoriales de développem<strong>en</strong>t durable. C’est dans cet objectif qu’une<br />
vingtaine de collectivités a choisi, ces dernières années, d’é<strong>la</strong>borer un «Ag<strong>en</strong>da<br />
21 local». Cette nouvelle approche stratégique, à <strong>la</strong> fois participative, volontariste<br />
et pragmatique, connait <strong>en</strong> effet un développem<strong>en</strong>t positif dans notre région,<br />
prouvant ainsi qu’il est possible de mettre <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce les politiques publiques<br />
locales avec les ori<strong>en</strong>tations internationales et nationales <strong>en</strong> faveur d’un<br />
développem<strong>en</strong>t durable de nos sociétés.<br />
Le poids important de l’industrie dans l’économie de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> exerce<br />
un fort impact <strong>en</strong> matière d’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t : impact sur le climat, consommation<br />
énergétique, risques industriels, production de déchets. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est<br />
ainsi <strong>la</strong> 1ere région qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant et <strong>la</strong><br />
2ème par rapport à son PIB : presque deux fois plus que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne de <strong>la</strong><br />
Métropole. La région est égalem<strong>en</strong>t une grosse productrice de déchets par<br />
habitant. Les <strong>en</strong>treprises haut-normandes produis<strong>en</strong>t le plus de déchets<br />
dangereux par habitant : 3 fois plus que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne de <strong>la</strong> Métropole <strong>en</strong> 2008.<br />
Consci<strong>en</strong>ts de cette situation, les <strong>en</strong>treprises haut-normandes ont fait un gros<br />
effort <strong>en</strong> consacrant <strong>la</strong> part plus importante de l’investissem<strong>en</strong>t industriel hautnormand<br />
à <strong>la</strong> protection de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t : 8 %, soit <strong>la</strong> 4ème région de<br />
Métropole. Le secteur des éco-<strong>en</strong>treprises est dynamique, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
compte <strong>la</strong> plus forte part d’emplois dans ce domaine.<br />
L’agriculture biologique est peu développée : 0,5 % de <strong>la</strong> surface agricole <strong>en</strong><br />
2008 contre 2,1 % <strong>en</strong> Métropole. D’une façon générale, le territoire hautnormand<br />
se caractérise par une faible part de sa surface couverte par des sols<br />
naturels : 23 % contre 39 % du territoire métropolitain <strong>en</strong> 2008. Ce<strong>la</strong> s’explique<br />
par <strong>la</strong> géographie de <strong>la</strong> région : il y a moins de zones non habitables ou non<br />
cultivables que dans d’autres régions. Les zones artificialisées couvr<strong>en</strong>t 12 % du<br />
territoire. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est une région ou l’urbanisation et <strong>la</strong><br />
périurbanisation sont plus fortes qu’ailleurs.<br />
Avec 6 établissem<strong>en</strong>ts Seveso <strong>pour</strong> 1 000 km2 <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> 2008<br />
contre 2 <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est <strong>la</strong> 2ème région ayant <strong>la</strong> plus forte<br />
conc<strong>en</strong>tration de sites Seveso après l’Ile-de-France. Il y a 31 sites Seveso «seuil<br />
bas» et 44 sites Seveso «seuil haut» dans <strong>la</strong> région. Ces sites se conc<strong>en</strong>tr<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
vallée de Seine dans les zones industrielles du Havre, de Port-Jérôme et de<br />
Rou<strong>en</strong>-Elbeuf dans le secteur chimique ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t.<br />
Octobre 2012 119
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les communes haut-normandes sont beaucoup moins soumises à un risque de<br />
mouvem<strong>en</strong>t de terrain dû à <strong>la</strong> sécheresse et autant à une inondation intérieure<br />
que l’<strong>en</strong>semble de <strong>la</strong> métropole. En revanche, elles risqu<strong>en</strong>t plus d’être<br />
confrontées à un mouvem<strong>en</strong>t de terrain hors sécheresse que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne. Les<br />
communes du littoral haut-normand ont le plus faible risque, après <strong>la</strong> Picardie, de<br />
subir une inondation marine.<br />
Au 17ème rang <strong>pour</strong> <strong>la</strong> part de sa surface couverte par des sols naturels (23 %<br />
contre 39 %) <strong>en</strong> 2008, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dispose ainsi, toutes proportions<br />
gardées, davantage de surfaces agricoles ou artificialisées (respectivem<strong>en</strong>t 65 %<br />
et 12 % contre 51 % et 9 %). En 2010, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> se situe au 18ème<br />
rang <strong>pour</strong> <strong>la</strong> part de son territoire <strong>en</strong> parc naturel régional : 6,5 % contre 13,2 %<br />
Elle est 21ème <strong>pour</strong> <strong>la</strong> part de <strong>la</strong> surface terrestre <strong>en</strong> Natura 2000 (3,4 % <strong>pour</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> contre 13 %).<br />
Entre 2000 et 2006, les espaces artificialisés gagn<strong>en</strong>t du terrain sur les espaces<br />
naturels et surtout sur les espaces agricoles : solde de + 1 800 hectares (0,14 %<br />
du territoire contre 0,15 %).<br />
La part de <strong>la</strong> surface toujours <strong>en</strong> herbe (zone de biodiversité) par rapport à <strong>la</strong><br />
surface agricole utile totale <strong>en</strong> 2008 est plus faible avec 28 % <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> contre 34 %. Cette part est <strong>en</strong> baisse <strong>pour</strong> presque toutes les régions.<br />
La part de <strong>la</strong> surface toujours <strong>en</strong> herbe par rapport à <strong>la</strong> surface totale du territoire<br />
<strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, supérieure à celle de <strong>la</strong> Métropole <strong>en</strong> 1990 (24,6 % contre<br />
20,9 %), t<strong>en</strong>d à <strong>la</strong> rejoindre (<strong>en</strong> 2008 : 18,6 % contre 18,1 %).<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est au 16ème rang sur les 21 régions de France contin<strong>en</strong>tale<br />
<strong>pour</strong> <strong>la</strong> variation de l’indice d’abondance des oiseaux communs, toutes espèces<br />
confondues <strong>en</strong>tre 2001 et 2009. Cet indice a diminué de 7,6 % <strong>en</strong>tre 2001 et<br />
2009.<br />
Prospective : hypothèses d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
Le cadre général de l’évolution dép<strong>en</strong>dra d’abord des conditions concrètes de<br />
mise <strong>en</strong> œuvre des schémas et p<strong>la</strong>ns régionaux déjà é<strong>la</strong>borés ou <strong>en</strong> cours<br />
d’é<strong>la</strong>boration <strong>en</strong> 2012 :<br />
- PCET (P<strong>la</strong>ns Climat-Energie territoriaux)<br />
- P<strong>la</strong>ns de prév<strong>en</strong>tion des risques<br />
- SRCAE (Schéma régional Climat-Air-Energie)<br />
- SRCE (Schéma régional de cohér<strong>en</strong>ce écologique)<br />
Les ruptures possibles<br />
• Accélération du changem<strong>en</strong>t climatique au-delà des prévisions du GIEC 42 (dont<br />
un nouveau rapport est att<strong>en</strong>du <strong>pour</strong> 2014)<br />
• Catastrophe naturelle ou technologique majeure provoquant un changem<strong>en</strong>t<br />
radical de l’opinion publique (du type Fukushima)<br />
• Progrès inatt<strong>en</strong>dus dans une gouvernance mondiale et/ou europé<strong>en</strong>ne<br />
permettant <strong>la</strong> mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d’une politique beaucoup plus volontariste <strong>en</strong> matière<br />
de changem<strong>en</strong>t climatique et de préservation de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
42 Groupe d’experts internationaux sur l’évolution du climat<br />
Octobre 2012 120
Variable Environnem<strong>en</strong>t, Climat et Risques naturels et industriels<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 – Repli sur habitudes de consommation énergétique, cloisonnem<strong>en</strong>t<br />
des milieux naturels.<br />
On assiste au repli sur les habitudes : le stock de ressources naturelles s’épuise.<br />
Les émissions nocives stagn<strong>en</strong>t car l’activité est fortem<strong>en</strong>t réduite. Parallèlem<strong>en</strong>t,<br />
le coût des énergies ne cesse d’augm<strong>en</strong>ter. Ce<strong>la</strong> a un effet dissuasif induisant une<br />
baisse de <strong>la</strong> consommation. L’innovation n’est plus une priorité et est <strong>en</strong> recul.<br />
L’EPR de P<strong>en</strong>ly n’est pas réalisé faute de financem<strong>en</strong>t. Les champs d’éoli<strong>en</strong>nes<br />
offshore ne tourn<strong>en</strong>t pas à <strong>la</strong> puissance escomptée.<br />
L’artificialisation des sols est croissante et contribue au cloisonnem<strong>en</strong>t des milieux<br />
naturels. La <strong>pour</strong>suite du réchauffem<strong>en</strong>t climatique int<strong>en</strong>sifie les risques naturels<br />
et <strong>la</strong> morbidité.<br />
→ H2 – Emerg<strong>en</strong>ce d’une croissance verte, pas de restauration des<br />
équilibres des écosystèmes<br />
Le déploiem<strong>en</strong>t des énergies propres n’est pas assez r<strong>en</strong>table. Les émissions<br />
nocives s’acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t. La hausse de du coût de l’énergie est toujours une réalité.<br />
Les parcs éoli<strong>en</strong>s offshore sont réalisés mais génèr<strong>en</strong>t très peu de retombées<br />
<strong>pour</strong> l’emploi régional. De plus, ces parcs ne sont pas <strong>en</strong> capacité de re<strong>la</strong>yer les<br />
énergies fossiles dans les usages. Pour autant, une croissance verte émerge<br />
progressivem<strong>en</strong>t mais le tissu industriel haut-normand n’est pas <strong>en</strong> capacité de<br />
saisir cette opportunité.<br />
La <strong>pour</strong>suite du réchauffem<strong>en</strong>t climatique int<strong>en</strong>sifie les risques naturels et <strong>la</strong><br />
morbidité. En raison de <strong>la</strong> forte prés<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> nombre de sites c<strong>la</strong>ssés Seveso (75),<br />
une filière de prév<strong>en</strong>tion et de gestion des risques industriels se développe.<br />
L’artificialisation des sols se <strong>pour</strong>suit favorisant ainsi le cloisonnem<strong>en</strong>t des sols.<br />
→ H3 – l’innovation favorise <strong>la</strong> croissance verte. La biodiversité est<br />
améliorée.<br />
Le coût des énergies est toujours <strong>en</strong> hausse. Les émissions nocives, toujours<br />
importantes, sont pondérées par le développem<strong>en</strong>t des énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles<br />
grâce aux innovations. L’EPR de P<strong>en</strong>ly et les fermes éoli<strong>en</strong>nes <strong>en</strong> mer sont<br />
réalisés générant de réelles retombées <strong>en</strong> termes d’emploi et de qualification.<br />
L’innovation favorise le développem<strong>en</strong>t d’une « croissance verte ». La région<br />
saisit cette opportunité. L’érosion de <strong>la</strong> biodiversité est stoppée. Un SRCE est<br />
appliqué mais ne permet pas <strong>la</strong> restauration des écosystèmes. Le réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique est freiné. Les PPRT sont généralisés.<br />
→ H4 – Le durable est ancré dans les modes de consommation et les<br />
process industriels.<br />
Le long terme est privilégié ; le durable est ancré dans les modes de<br />
consommation et intégré au process industriels. L’objectif du Gr<strong>en</strong>elle de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t est atteint (23% des énergies sont issues de sources<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles) ; les émissions de GEF sont réduites par 2 (le facteur 4 prévoyant<br />
une réduction par 4 à échéance 2050 semble atteignable). Le réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique est freiné.<br />
La hausse des énergies conduit les pouvoirs publics à faire des choix : L'EPR est<br />
réalisé, les innovations rapides ont permis de développer des sources d'énergies à<br />
<strong>la</strong> fois propres et durables. Les énergies sont produites <strong>en</strong> quantité suffisante<br />
<strong>pour</strong> répondre aux besoins économiques régionaux, nationaux et internationaux.<br />
L’amélioration de <strong>la</strong> qualité paysagère et de <strong>la</strong> biodiversité est une réalité<br />
s’appuyant sur un SRCE ambitieux.<br />
Les PPRT sont généralisés. Un volet littoral est introduit dans les SCOT.<br />
Octobre 2012 121
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
• Services de l’Etat <strong>en</strong> Région<br />
• Collectivités territoriales (é<strong>la</strong>boration de schémas régionaux ou locaux)<br />
• Entreprises (concernées par les pot<strong>en</strong>tialités d’une « croissance verte)<br />
• Ménages (changem<strong>en</strong>t de modes de consommation)<br />
Sources :<br />
- Les indicateurs du développem<strong>en</strong>t durable <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> - Cahier d’Aval n°91,<br />
juin 2010, INSEE-AREHN<br />
- http://www.statistiques.developpem<strong>en</strong>t-durable.gouv.fr/ - Données statistiques du<br />
ministère de l’écologie, du développem<strong>en</strong>t durable et de l’énergie<br />
- http://www.orddhn.fr/ Observatoire régional du développem<strong>en</strong>t durable <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>. AREHN<br />
- circu<strong>la</strong>ire n° 77-300 du 29 août 1977 du Ministère de l’Education Nationale<br />
Octobre 2012 122
Variable Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
12. Fiche variable « Rayonnem<strong>en</strong>t culturel »<br />
Définitions<br />
Le rayonnem<strong>en</strong>t culturel d’une société ou d’un territoire témoigne de l'influ<strong>en</strong>ce<br />
qu’elle/il a sur d’autres sociétés ou à l’extérieur de ses frontières.<br />
Pour une région, le rayonnem<strong>en</strong>t culturel est un élém<strong>en</strong>t important de<br />
développem<strong>en</strong>t comme vecteur d’une image positive, de notoriété et d'attractivité<br />
culturelle, avec des impacts économiques visibles notamm<strong>en</strong>t au travers des<br />
retombées touristiques sur le territoire.<br />
Il passe par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> valeur des atouts culturels de <strong>la</strong> région ; ce<strong>la</strong> va au-delà<br />
de <strong>la</strong> simple valorisation du patrimoine ou de l’existant et <strong>en</strong>globe <strong>la</strong> valorisation<br />
de <strong>la</strong> nouveauté.<br />
Il se mesure par <strong>la</strong> capacité à donner une « signature de vie perman<strong>en</strong>te » qui<br />
soit :<br />
- porteuse d’image, d’<strong>en</strong>vie, de curiosité au niveau national ou international<br />
ET<br />
- génératrice de fierté au niveau régional, d’appart<strong>en</strong>ance à un territoire,<br />
d’id<strong>en</strong>tité.<br />
La célébration du 11ème c<strong>en</strong>t<strong>en</strong>aire de <strong>la</strong> création de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> a donné lieu à<br />
plusieurs c<strong>en</strong>taines de manifestations homologuées par le Comité Régional de<br />
Tourisme (CRT). Si ces évènem<strong>en</strong>ts n'ont pas eu le ret<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t de <strong>Normandie</strong><br />
Impressionnisme (porté par des élus "majeurs") ils ont permis, selon le bi<strong>la</strong>n<br />
effectué par le CRT, de r<strong>en</strong>forcer le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d'appart<strong>en</strong>ance des normands à<br />
leur territoire. Cette évolution n'est <strong>en</strong> général visible que sur de longues<br />
périodes.<br />
Ces s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts partagés constitu<strong>en</strong>t un « capital social », véritable levier <strong>pour</strong><br />
l’action chez les individus et garant d’un dynamisme collectif au travers de<br />
l’adhésion à une communauté d’intérêt.<br />
Indicateurs pertin<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> décrire <strong>la</strong> variable<br />
On peut distinguer plusieurs types d’indicateurs :<br />
Ceux qui mesur<strong>en</strong>t l’offre culturelle :<br />
1 - de par sa localisation :<br />
La richesse du patrimoine, les équipem<strong>en</strong>ts culturels… au travers du nombre de<br />
structures <strong>en</strong> valeur absolue ou rapportées au nombre d’habitant (chiffres du<br />
DEPS les plus anci<strong>en</strong>s dat<strong>en</strong>t de 2005, les plus réc<strong>en</strong>ts de 2009):<br />
Musées, « musées de France », structures de diffusion de spectacles vivant,<br />
scènes nationales, théâtres, conservatoires, écoles d’art, bibliothèques, salles de<br />
cinéma…<br />
2 - de par son poids économique mesuré par les emplois culturels :<br />
La part des établissem<strong>en</strong>ts dans l’activité selon l’INSEE, ou <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne de 3<br />
indices (le sectoriel (code NAF) – <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sité d’établissem<strong>en</strong>ts <strong>pour</strong> 1000hab – les<br />
professions (PCS) qui mesure l’importance du secteur culturel <strong>en</strong> région.<br />
(réf. INSEE nov. 2011 lettre analyses n°155 – Valérie V<strong>en</strong>elle étude Rhône Alpes)<br />
Octobre 2012 123
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Ceux qui mesur<strong>en</strong>t l’offre touristique (accueil, hébergem<strong>en</strong>t)<br />
Offre d'hébergem<strong>en</strong>t :<br />
1- hôtellerie: les grands groupes et chaînes hôtelières ne s'imp<strong>la</strong>nt<strong>en</strong>t que dans<br />
des zones "r<strong>en</strong>tables" le climat et <strong>la</strong> saisonnalité a fortem<strong>en</strong>t restreint ce type<br />
d'hôtellerie, à part les spots s<strong>en</strong>sibles (Deauville, Mont Saint Michel et zones<br />
urbaines). L'hôtellerie indép<strong>en</strong>dante est dans une situation précaire (cf. rapport<br />
du Conseil National du Tourisme " <strong>Quel</strong> av<strong>en</strong>ir <strong>pour</strong> l’hôtellerie indép<strong>en</strong>dante»),<br />
établissem<strong>en</strong>ts anci<strong>en</strong>s, nouvelles règles de c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t exigeantes et nouvelles<br />
normes d'accès handicap ne permett<strong>en</strong>t pas aux propriétaires de rénover leurs<br />
établissem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité déjà délicate.<br />
2 - gîtes et chambre d'hôtes se port<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et sont <strong>en</strong><br />
progression constante, cep<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> demande est plus forte que l'offre et il y a<br />
peu de nouvelles offres (les fermetures équilibrant les nouvelles créations)<br />
3 - hébergem<strong>en</strong>t de plein air, <strong>la</strong> région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est sous équipée, <strong>la</strong><br />
demande est forte et <strong>la</strong> crise aidant de nombreux touristes se report<strong>en</strong>t sur ce<br />
type d'hébergem<strong>en</strong>t. Il faut noter que <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est particulièrem<strong>en</strong>t<br />
dé<strong>pour</strong>vue d'établissem<strong>en</strong>t de qualité (offrant piscine et animations).<br />
Ceux qui mesur<strong>en</strong>t le dynamisme culturel :<br />
Les évènem<strong>en</strong>ts, les festivals, <strong>la</strong> programmation artistique, les créations, <strong>la</strong><br />
diffusion, les pratiques du public, l’attractivité de l’offre régionale à l’échelle de <strong>la</strong><br />
région et au-delà du territoire au travers de l’accueil de visiteurs extérieurs<br />
nationaux ou étrangers et leur fréqu<strong>en</strong>tation des structures culturelles et<br />
touristiques (chiffres du DEPS). A ce titre, les chiffres de <strong>la</strong> fréqu<strong>en</strong>tation des<br />
évènem<strong>en</strong>ts phares de <strong>la</strong> région (Armada, <strong>Normandie</strong> Impressionniste, etc.) sont<br />
particulièrem<strong>en</strong>t révé<strong>la</strong>teurs, ainsi que le dynamisme de l’Opéra de Rou<strong>en</strong> –<br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> qui se p<strong>la</strong>ce <strong>en</strong> 2 ème position nationale <strong>en</strong> termes de richesse<br />
des programmations.<br />
En termes d’attractivité, on reti<strong>en</strong>dra particulièrem<strong>en</strong>t le nombre de festivals et<br />
d’évènem<strong>en</strong>ts selon leur <strong>en</strong>vergure régionale ou nationale.<br />
Cette série d’indicateurs caractérise le développem<strong>en</strong>t culturel <strong>en</strong> contribuant à<br />
cerner les élém<strong>en</strong>ts de <strong>la</strong> dynamique culturelle, mais ne mesure pas directem<strong>en</strong>t<br />
le rayonnem<strong>en</strong>t culturel, soit :<br />
- <strong>la</strong> portée de l’image de <strong>la</strong> région, l’<strong>en</strong>vie ou <strong>la</strong> curiosité véhiculée à l’extérieur,<br />
qui ne peut être réduite à l’accueil de visiteurs<br />
- ni même le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de fierté, d’id<strong>en</strong>tité, d’appart<strong>en</strong>ance des habitants.<br />
On mesure ici toutes les limites de l’analyse quantitative.<br />
Caractérisation de <strong>la</strong> situation actuelle à partir d’une analyse<br />
rétrospective<br />
Le rapport du CESER de 2009 Rayonnem<strong>en</strong>t national et international de <strong>la</strong> culture<br />
<strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> fait un état des lieux de <strong>la</strong> richesse culturelle et de son<br />
attractivité<br />
Le rapport du CESER 2010 Vers un schéma régional de développem<strong>en</strong>t culturel<br />
prés<strong>en</strong>te une comparaison des statistiques régionales avec celles des régions<br />
proches géographiquem<strong>en</strong>t ou ayant le même poids<br />
« démographico/économique ». Il pointe :<br />
- des « forces et opportunités » autour de <strong>la</strong> diffusion du spectacle vivant, des<br />
<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts artistiques et de <strong>la</strong> lecture,<br />
- des « faiblesses et des m<strong>en</strong>aces » autour de <strong>la</strong> diffusion des œuvres d’art et de<br />
<strong>la</strong> création artistique.<br />
Octobre 2012 124
Variable Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
Il est complété d’une <strong>en</strong>quête sur l’emploi culturel <strong>en</strong> région.<br />
Selon l’état des lieux <strong>en</strong> 2009, <strong>la</strong> Région se caractérise par un nombre de<br />
structures de diffusion du spectacle vivant et de scènes nationales supérieur à <strong>la</strong><br />
moy<strong>en</strong>ne nationale.<br />
En termes d’activités économiques, selon le RP 2006, le poids du secteur culturel<br />
dans l’activité reste très moy<strong>en</strong> ; il représ<strong>en</strong>te 2,7% et p<strong>la</strong>ce <strong>la</strong> région au 15ème<br />
rang des régions, avec une spécificité <strong>pour</strong> le secteur de <strong>la</strong> fabrication des<br />
instrum<strong>en</strong>ts de musique (1er rang). L’importance du secteur culturel mesuré <strong>en</strong><br />
2008 par <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne de 3 indices « sectoriel », de « d<strong>en</strong>sité » et des<br />
« professions », <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce au 17ème rang des régions hors Ile de France (indice<br />
87,2).<br />
Concernant les évolutions des indicateurs quantitatifs de l’offre depuis 2004, le<br />
nombre de structures qui compos<strong>en</strong>t l’offre culturelle n’a pas connu d’évolutions<br />
significatives. Des points positifs concern<strong>en</strong>t le dynamisme du FRAC, le 1er rang<br />
<strong>pour</strong> le nombre de conservatoires par habitants, <strong>la</strong> région qui rattrape son retard<br />
et s’ouvre davantage à <strong>la</strong> création contemporaine avec l’ouverture d’une nouvelle<br />
scène de musiques actuelles à Rou<strong>en</strong> <strong>en</strong> 2010 et <strong>la</strong> programmation de danse<br />
contemporaine à l’Opéra de Rou<strong>en</strong>-<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
On note l’abandon <strong>en</strong> 2008 du projet de médiathèque par <strong>la</strong> ville de Rou<strong>en</strong>,<br />
considéré <strong>en</strong> 2006 comme indisp<strong>en</strong>sable à son rayonnem<strong>en</strong>t culture, au profit<br />
d’une bibliothèque de proximité et d’un nouveau site d’accès aux archives<br />
départem<strong>en</strong>tales, <strong>la</strong> reconnaissance de <strong>la</strong> ville du Havre au patrimoine mondial de<br />
l’humanité et, début 2012, le regroupem<strong>en</strong>t des associations et des pôles<br />
régionaux de ressources culturelles au sein du Pôle Régional des Savoirs, de<br />
nature à créer davantage de synergie et de visibilité.<br />
A noter égalem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> création du « Portail des musées haut-normands » et <strong>la</strong><br />
création de l’Ag<strong>en</strong>ce du Livre.<br />
Les fréqu<strong>en</strong>tations des lieux culturels stagn<strong>en</strong>t dans un contexte national de<br />
baisse de fréqu<strong>en</strong>tation et de resserrem<strong>en</strong>t sur les « lieux phares » ou les «<br />
manifestations d’<strong>en</strong>vergure » (<strong>en</strong>quête ODIT France sur <strong>la</strong> fréqu<strong>en</strong>tation des<br />
3000 sites et manifestations culturelles et touristiques sur 10 ans)<br />
Parmi ces festivals et animations d’<strong>en</strong>vergure, plusieurs ont une certaine<br />
anci<strong>en</strong>neté et ont acquis une notoriété et une dim<strong>en</strong>sion nationale voire<br />
internationale : le festival « Octobre <strong>en</strong> <strong>Normandie</strong> » a été refondu <strong>en</strong> 2006<br />
désormais « Automne <strong>en</strong> <strong>Normandie</strong> » avec une diffusion plus é<strong>la</strong>rgie sur le<br />
territoire ; le festival du Cinéma nordique, <strong>Normandie</strong> Bulles (BD Darnétal),<br />
Archéo Jazz, Viva Cité, le Rock dans tous ses états, attir<strong>en</strong>t au-delà des frontières<br />
régionales. En matière d’évènem<strong>en</strong>ts phares, on doit noter :<br />
- <strong>la</strong> pér<strong>en</strong>nisation de l’Armada qui est de loin le plus connu et rassemble au-delà<br />
des frontières.<br />
- <strong>Normandie</strong> Impressionniste qui a créé <strong>en</strong> 2010 l’évènem<strong>en</strong>t et les retombées<br />
sont <strong>en</strong>core perceptibles selon les professionnels sur les int<strong>en</strong>tions de<br />
découvertes de <strong>la</strong> Région. Associée à ce thème de l’impressionnisme, qui avait<br />
connu à un échelon plus modeste un succès popu<strong>la</strong>ire avec les premières<br />
illuminations de <strong>la</strong> Cathédrale de Rou<strong>en</strong>, une reconduite de l’exposition est<br />
<strong>en</strong>visagée autour du thème de l’eau <strong>pour</strong> 2013.<br />
La situation est donc celle d’une région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> disposant d’une offre<br />
culturelle riche, d’un ratio équipem<strong>en</strong>ts-nombre d’habitants plus que satisfaisant,<br />
d’acteurs culturels nombreux et créatifs, que <strong>la</strong> Région a contribué à promouvoir.<br />
Octobre 2012 125
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les pouvoirs publics, à travers des organismes ressources divers, dispos<strong>en</strong>t<br />
d’informations multiples et d’une bonne connaissance de <strong>la</strong> vie culturelle dans les<br />
territoires, mais ces données sont sectorisées et partielles.<br />
Le constat paradoxal dressé <strong>en</strong> 2010 est celui d’une abondance et d’un manque<br />
de lisibilité à <strong>la</strong> fois de l’offre, des acteurs et des politiques culturelles qui<br />
nécessiterai<strong>en</strong>t une meilleure structuration à <strong>la</strong> fois des lieux, des acteurs et des<br />
politiques elles-mêmes.<br />
Il y a peu de manques pointés, mais des faiblesses dans certains domaines qui<br />
peuv<strong>en</strong>t être germes de changem<strong>en</strong>t OU source d’inertie : parmi celles-ci,<br />
l’abs<strong>en</strong>ce d’un grand évènem<strong>en</strong>t national, faiblesse ou abs<strong>en</strong>ce de culture de «<br />
réseaux » d’acteurs, abs<strong>en</strong>ce de volonté de les aider à se mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce,<br />
difficulté à faire connaître l’existant et les richesses, pratiques amateurs très peu<br />
accompagnées.<br />
Le contexte a par ailleurs <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t évolué depuis 2004 :<br />
On relève un contexte financier et institutionnel difficile et incertain aujourd’hui:<br />
les effets des dernières lois de déc<strong>en</strong>tralisation (2004), <strong>la</strong> crise financière (2008),<br />
les conséqu<strong>en</strong>ces de <strong>la</strong> RGPP, l’annonce de <strong>la</strong> réforme territoriale et l’incertitude<br />
sur l’av<strong>en</strong>ir des Régions (voir si on garde <strong>la</strong> réforme comme une hypothèse ou<br />
bi<strong>en</strong> comme acquise), le gel des dotations de l’Etat…sont autant de facteurs qui<br />
ont paupérisé le secteur culturel, qui ont poussé les collectivités à se rec<strong>en</strong>trer<br />
sur leurs compét<strong>en</strong>ces obligatoires. La culture ne fait pas partie de « l’ess<strong>en</strong>tiel »<br />
La répartition est mal aboutie <strong>en</strong>tre Etat et Collectivités : on a assisté au niveau<br />
de l’Etat à un phénomène de conc<strong>en</strong>tration (les grands circuits dans le secteur<br />
cinématographique, de grands C<strong>en</strong>tre Dramatiques Nationaux dans le spectacle<br />
vivant qui coproduis<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre eux les mêmes spectacles…) et <strong>la</strong> montée <strong>en</strong><br />
puissance des collectivités qui aurai<strong>en</strong>t pu garantir l’émerg<strong>en</strong>ce et le mainti<strong>en</strong><br />
d’une certaine diversité culturelle sur leur territoire n’est pas possible avec <strong>la</strong><br />
crise des financem<strong>en</strong>ts.<br />
Quant à <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>tralisation, toujours pas de c<strong>la</strong>rification sur le transfert des<br />
moy<strong>en</strong>s et des charges aux régions dans le cadre des <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts artistiques<br />
et notamm<strong>en</strong>t du supérieur, qui a empêché <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> toute initiative<br />
forte et collective malgré <strong>la</strong> carte à jouer face à <strong>la</strong> saturation des structures<br />
d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur de l’le De France.<br />
La Région a pris <strong>la</strong> décision de faire une évaluation de sa politique culturelle, à<br />
l’intérieur de son périmètre territorial et sur des thèmes transversaux <strong>en</strong><br />
privilégiant un état des lieux. Le budget a triplé depuis 1998, le périmètre de<br />
l’interv<strong>en</strong>tion régionale a été é<strong>la</strong>rgi, se posait alors <strong>la</strong> question de savoir si les<br />
choix sont les bons et vers quoi il faut aller. Cette évaluation est <strong>la</strong>ncée dans un<br />
contexte de crise majeure des ressources publiques, qui pose <strong>la</strong> question des<br />
priorités dans les dép<strong>en</strong>ses publiques, d’autant plus aigüe sur les compét<strong>en</strong>ces<br />
comme <strong>la</strong> culture qui ne sont pas des compét<strong>en</strong>ces institutionnelles <strong>pour</strong> les<br />
collectivités, mais qu’elles ne peuv<strong>en</strong>t pas <strong>la</strong>isser tomber <strong>pour</strong> autant.<br />
Prospective : hypothèses d’évolution à court et moy<strong>en</strong> termes<br />
Contexte de détermination des hypothèses :<br />
- <strong>la</strong> réforme territoriale sera un facteur de changem<strong>en</strong>t avec <strong>la</strong> possibilité<br />
d’optimisation des ressources et de l’efficacité de <strong>la</strong> puissance publique ;<br />
- le risque de diminution des subv<strong>en</strong>tions publiques, raréfaction des ressources,<br />
est un invariant ;<br />
Octobre 2012 126
Variable Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
- les nouveaux moy<strong>en</strong>s de communication, les nouvelles technologies, sont une<br />
t<strong>en</strong>dance lourde avec incertitude forte: <strong>la</strong> rapidité des flux et les techniques<br />
numériques vont changer le rapport à <strong>la</strong> culture.<br />
Il s’agira probablem<strong>en</strong>t d’accompagner les évolutions des techniques <strong>pour</strong><br />
répondre « prés<strong>en</strong>t » par les moy<strong>en</strong>s de diffusion et assurer qu’elle touche tout le<br />
territoire. Le tout numérique ne doit pas l’emporter sur <strong>la</strong> diffusion et les<br />
r<strong>en</strong>contres, mais doit être utilisé <strong>pour</strong> les produits difficiles à dép<strong>la</strong>cer. La culture<br />
se vit, il faut « une int<strong>en</strong>tion qui r<strong>en</strong>contre une att<strong>en</strong>tion ».<br />
Le tourisme constitue une activité économique majeure <strong>pour</strong> le pays et <strong>la</strong> région,<br />
tous les élus et décideurs le dis<strong>en</strong>t mais tous ne font pas les investissem<strong>en</strong>ts<br />
nécessaires à toute activité économique.<br />
Certains élus considèr<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core le tourisme comme une activité annexe, or elle<br />
créera, dans les années à v<strong>en</strong>ir, plus d'emplois que les activités économiques<br />
traditionnelles.<br />
Les ruptures possibles<br />
Les ruptures possibles serai<strong>en</strong>t :<br />
1 - <strong>la</strong> création du « comité régional de <strong>la</strong> culture » CRC : appel à un changem<strong>en</strong>t<br />
de gouvernance<br />
La culture a toujours été un <strong>en</strong>jeu de pouvoir, un <strong>en</strong>jeu politique : le grand<br />
élém<strong>en</strong>t de rupture serait de sortir les choix culturels et <strong>la</strong> détermination des<br />
moy<strong>en</strong>s alloués du champ de <strong>la</strong> seule décision politique <strong>en</strong> l’é<strong>la</strong>rgissant à <strong>la</strong><br />
société civile, à l’<strong>en</strong>semble des acteurs culturels (c’est le s<strong>en</strong>s de <strong>la</strong> proposition du<br />
rapport du CESER sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce du CRC) = Une nouvelle politique<br />
d’animation des acteurs<br />
2 – <strong>la</strong> remise <strong>en</strong> cause de <strong>la</strong> c<strong>la</strong>use de compét<strong>en</strong>ce générale des collectivités :<br />
En 2010, jugée fondam<strong>en</strong>tale <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t de projets régionaux<br />
structurants, elle brouille <strong>la</strong> lisibilité des interv<strong>en</strong>tions de chacune et r<strong>en</strong>d<br />
nécessaire une concertation et une mise <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce des politiques culturelles<br />
aux différ<strong>en</strong>ts échelons<br />
3 - <strong>la</strong> dim<strong>en</strong>sion du territoire : <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> ou <strong>Normandie</strong> ? Ou…axe Paris<br />
Seine <strong>Normandie</strong> ?<br />
Les hypothèses<br />
→ H1 – rayonnem<strong>en</strong>t culturel <strong>en</strong> déclin<br />
Les décideurs politiques et acteurs culturels ne parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas à dépasser leurs<br />
intérêts locaux ou disciplinaires. La raréfaction des moy<strong>en</strong>s <strong>en</strong>traine bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> fin de<br />
« l’exception culturelle à <strong>la</strong> Française » La paupérisation l’emporte par manque<br />
d’ambition des pouvoirs publics qui n’ont pas déployé une « vision d’av<strong>en</strong>ir » <strong>pour</strong><br />
le territoire suffisamm<strong>en</strong>t tôt, au mom<strong>en</strong>t où les tournants majeurs<br />
s‘esquissai<strong>en</strong>t : besoin de rationalisation, besoin d’adaptation à l’évolution des<br />
pratiques et des att<strong>en</strong>tes des publics liées au développem<strong>en</strong>t du numérique. La<br />
créativité s’essouffle<br />
Il est illusoire de croire que les choses chang<strong>en</strong>t un jour, <strong>la</strong> culture n’est pas<br />
reconnue comme outil d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire. Le rayonnem<strong>en</strong>t culturel se<br />
dégrade.<br />
Octobre 2012 127
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
→ H2 - Hypothèse t<strong>en</strong>dancielle - Les territoires développ<strong>en</strong>t des<br />
initiatives <strong>pour</strong> les publics de proximité<br />
Une coordination <strong>en</strong>tre décideurs politiques et acteurs culturels se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
sous l’effet de <strong>la</strong> réforme territoriale, mais l’ambition des décideurs politiques et<br />
acteurs culturels est trop contrainte par <strong>la</strong> faiblesse des moy<strong>en</strong>s qui se raréfi<strong>en</strong>t.<br />
On assiste à une « cantonalisation » des politiques, source d’inertie <strong>pour</strong> le<br />
rayonnem<strong>en</strong>t culturel de <strong>la</strong> région.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des pratiques de recours au numérique s’opèr<strong>en</strong>t mais pas au<br />
profit de <strong>la</strong> région, les produits proposés sont le reflet d’une offre qui reste<br />
segm<strong>en</strong>tée et qui n’attire pas par <strong>la</strong> nouveauté, ni par l’ouverture vers les<br />
territoires voisins qui sont porteurs de visibilité et d’id<strong>en</strong>tité au-delà des<br />
frontières. Faute d’investir sur les atouts de <strong>la</strong> perception de <strong>la</strong> « <strong>Normandie</strong> », de<br />
<strong>la</strong> proximité de l’Ile de France, le rayonnem<strong>en</strong>t « vivote » porté par un ou deux<br />
évènem<strong>en</strong>ts éphémères et insuffisants <strong>pour</strong> porter une id<strong>en</strong>tité des territoires et<br />
du Territoire.<br />
→ H3 - Id<strong>en</strong>tité du territoire et attractivité culturelle r<strong>en</strong>forcée -<br />
Concertation et mise <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce à tous les échelons<br />
Une coordination <strong>en</strong>tre décideurs politiques et acteurs culturels se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
sous l’effet de <strong>la</strong> réforme territoriale, une capacité politique de changem<strong>en</strong>t est<br />
avérée chez les acteurs qui se concert<strong>en</strong>t, mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce des politiques<br />
culturelles aux différ<strong>en</strong>ts échelons. Ils optimis<strong>en</strong>t les ressources rares et les<br />
financem<strong>en</strong>ts, rationalis<strong>en</strong>t leurs interv<strong>en</strong>tions et opèr<strong>en</strong>t des choix forts.<br />
Les coopérations dépass<strong>en</strong>t le territoire régional, à l’image du tourisme <strong>la</strong> culture<br />
est portée à l’échelle interrégionale, voire à l’échelle de l’Axe Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>.<br />
La raréfaction des moy<strong>en</strong>s <strong>en</strong>traine bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> fin de « l’exception culturelle à <strong>la</strong><br />
Française » et l’ouverture du secteur sur <strong>la</strong> sphère économique <strong>en</strong>traine un cercle<br />
vertueux dans lequel les intérêts sont partagés et compris par tous les acteurs<br />
quant aux retombées <strong>en</strong> terme d’attractivité <strong>pour</strong> le territoire.<br />
La culture ne reste pas isolée, elle est considérée comme une exception plutôt<br />
bi<strong>en</strong> sout<strong>en</strong>ue par les élus et intégrée comme une composante naturelle de<br />
chaque acte de <strong>la</strong> société, comme élém<strong>en</strong>t d’attractivité au même titre qu’un<br />
service public comme une crèche ou une école.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des pratiques de recours au numérique véhicul<strong>en</strong>t l’image<br />
d’une région dynamique, accompagn<strong>en</strong>t les efforts des professionnels et<br />
répond<strong>en</strong>t aux att<strong>en</strong>tes des publics friands de découverte et d’une offre de<br />
services coordonnée. Evènem<strong>en</strong>ts régionaux et nationaux s’<strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t l’un<br />
l’autre, les retombées extérieures r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’id<strong>en</strong>tité des (hauts)<br />
normands.<br />
Avec 1.6 milliard d'arrivées internationales, <strong>la</strong> France occupe <strong>la</strong> deuxième p<strong>la</strong>ce<br />
<strong>en</strong> nombre de visiteurs, derrière <strong>la</strong> Chine, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dont le bassin<br />
émetteur ess<strong>en</strong>tiel est l'Ile de France, profite de cette proximité. La <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> est <strong>la</strong> 2ème région de France <strong>pour</strong> les courts séjours (4ème <strong>en</strong> 2011).<br />
L'augm<strong>en</strong>tation moy<strong>en</strong>ne de 2 degrés de <strong>la</strong> température fait de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> une <strong>destin</strong>ation recherchée fac aux températures excessives du sud<br />
de l'Europe.<br />
Octobre 2012 128
Variable Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
La voie verte Paris Londres est achevée et génère une activité touristique<br />
importante. Paris Le Havre est égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> voie d'achèvem<strong>en</strong>t. Grâce à l'effort<br />
financier des Collectivités locales et au travail des animateurs numériques de<br />
territoires, tous les prestataires dispos<strong>en</strong>t du très haut débit et sont prés<strong>en</strong>ts et<br />
accessibles sur tous les réseaux sociaux. Le tourisme durable est une donnée<br />
incontournable, <strong>la</strong> plupart des prestataires offr<strong>en</strong>t des hébergem<strong>en</strong>ts intégrant les<br />
économies d'énergie. Ils propos<strong>en</strong>t des actions de s<strong>en</strong>sibilisation à <strong>la</strong> préservation<br />
des milieux naturels s<strong>en</strong>sibles de leurs territoires. Les fermes "bio" Accueil Paysan<br />
et les Gîtes Panda se multipli<strong>en</strong>t. Les croisières fluviales <strong>en</strong>tre Paris et Le Havre<br />
attir<strong>en</strong>t toujours plus de participants. Rou<strong>en</strong> et Le Havre sont <strong>en</strong> pointe <strong>pour</strong> le<br />
tourisme urbain qui constitue <strong>pour</strong> les francili<strong>en</strong>s une rupture appréciable à moins<br />
de 2 heures de train rapide. Le deuxième C<strong>en</strong>tre International de Congrès vi<strong>en</strong>t<br />
d'ouvrir à Rou<strong>en</strong> sur les quais de Seine, les réservations sont complètes <strong>pour</strong> les<br />
3 années à v<strong>en</strong>ir.<br />
Principaux acteurs concernés, notamm<strong>en</strong>t par les hypothèses de<br />
changem<strong>en</strong>ts internes, externes, institutionnels influ<strong>en</strong>çant <strong>la</strong> variable<br />
- Les professionnels de <strong>la</strong> culture et du tourisme<br />
- Les élus<br />
- Les grands acteurs économiques régionaux<br />
Sources :<br />
- « Rayonnem<strong>en</strong>t national et international de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> » - rapport<br />
du CESER - 2009<br />
- « Vers un schéma régional de développem<strong>en</strong>t culturel » - rapport du CESER - 2010<br />
- Lettre analyses - INSEE nov. 2011 n°155 – Valérie V<strong>en</strong>elle - étude Rhône Alpes<br />
- Chiffres du DEPS<br />
Octobre 2012 129
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 130
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par variable<br />
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par<br />
variable<br />
Octobre 2012 131
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Contexte global<br />
Règle du chacun <strong>pour</strong> soi dans<br />
un contexte économique<br />
défavorable<br />
Développem<strong>en</strong>t des circuits<br />
courts dans un contexte<br />
économique de décroissance<br />
Ext<strong>en</strong>sion du développem<strong>en</strong>t<br />
durable dans un contexte de<br />
croissance<br />
Politique<br />
générale<br />
régionale<br />
Gouvernance<br />
Coopérations<br />
interrégionales<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
internationales<br />
intracommunautaires<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
internationales<br />
extracommunautaires<br />
Il n'y a plus de gouvernance des<br />
territoires<br />
Concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre<br />
les territoires<br />
Concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre<br />
les territoires. Une zone euro<br />
réduite aux pays « les plus<br />
riches »<br />
Les marchés ne sont plus<br />
régulés<br />
La gouvernance se situe au<br />
niveau des villes et tout<br />
particulièrem<strong>en</strong>t des grandes<br />
villes (Rou<strong>en</strong> et Le Havre<br />
Evreux)<br />
Emerg<strong>en</strong>ce de coopérations,<br />
basées sur des spécialités<br />
régionales (agriculture,<br />
logistique)<br />
R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des re<strong>la</strong>tions<br />
transnationales de proximité.<br />
Concurr<strong>en</strong>ce et coopération<br />
<strong>en</strong>tre les régions à l'échelle de<br />
l'Europe<br />
Rou<strong>en</strong> et Le Havre, à l’échelle<br />
internationale, ne sont qu’une<br />
seule et même ville. Elles sont<br />
<strong>en</strong> re<strong>la</strong>tion directe avec les ports<br />
et les villes du monde<br />
Omniprés<strong>en</strong>ce des pouvoirs<br />
publics<br />
Coopération poussée<br />
(notamm<strong>en</strong>t au niveau de <strong>la</strong><br />
recherche)<br />
L’Europe des Etats est aussi<br />
l’Europe des Régions. Les<br />
grands projets se développ<strong>en</strong>t<br />
grâce à une forme de crédit<br />
gérée à l’échelle europé<strong>en</strong>ne<br />
Le Havre, porte maritime de<br />
l’Europe occid<strong>en</strong>tale et principal<br />
port de l'Ile de France<br />
Octobre 2012 132
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par variable<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Transports et<br />
accessibilité<br />
régionale<br />
T<strong>en</strong>dance générale<br />
Accessibilité<br />
routière<br />
Transports <strong>en</strong><br />
commun<br />
Accessibilité<br />
ferroviaire<br />
Accessibilité<br />
fluviale<br />
Dégradation des infrastructures<br />
et mobilité réduite<br />
Les conditions de circu<strong>la</strong>tion<br />
routière se dégrad<strong>en</strong>t fortem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> raison de <strong>la</strong> non-réalisation<br />
des contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts<br />
Dégradation des transports<br />
collectifs faute d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong><br />
Mix transport individuel / collectif<br />
inversé<br />
Service aux usagers dégradé<br />
Les lignes sont saturées et<br />
obsolètes.<br />
Des dessertes fret sont<br />
abandonnées.<br />
La nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> n'est<br />
pas faite<br />
Le Canal Seine Nord est<br />
opérationnel et <strong>la</strong> région perd des<br />
parts de marché <strong>en</strong> raison de <strong>la</strong><br />
non-réalisation des travaux de<br />
mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong><br />
Seine<br />
Les grands projets ne sont pas<br />
tous réalisés et cette situation<br />
génère des congestions<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts ne sont pas<br />
réalisés<br />
Généralisation des nouvelles<br />
formes de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t:<br />
covoiturage et transports<br />
collectifs maint<strong>en</strong>us <strong>en</strong> l'état<br />
Lignes voyageurs infrarégionales<br />
mises à niveau.<br />
Fret est à l'état embryonnaire; Il<br />
est desserré à Rou<strong>en</strong> où <strong>la</strong><br />
nouvelle gare vi<strong>en</strong>t d'être mise <strong>en</strong><br />
service mais pas <strong>en</strong>core<br />
raccordée au réseau<br />
Non-réalisation des travaux de<br />
mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong><br />
Seine<br />
Les grands projets sont réalisés<br />
et <strong>la</strong> multimodalité se met <strong>en</strong><br />
p<strong>la</strong>ce. Les flux innerv<strong>en</strong>t peu à<br />
peu le territoire<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés<br />
Part de l'auto réduite <strong>en</strong> ville<br />
Développem<strong>en</strong>t des réseaux<br />
urbains de transport et cyc<strong>la</strong>bles<br />
P<strong>la</strong>teformes multimodales = lieux<br />
de flux et de services aux<br />
usagers"<br />
Raccordem<strong>en</strong>t aux réseaux à<br />
grande vitesse europé<strong>en</strong>,<br />
développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales et du fret grâce<br />
aux lignes de contournem<strong>en</strong>t de<br />
l'anci<strong>en</strong>ne gare de Rou<strong>en</strong>.<br />
La nouvelle Gare de Rou<strong>en</strong> offre<br />
des services tertiaires à l'échelle<br />
de l'agglomération"<br />
Le transport de déchets se<br />
développe fortem<strong>en</strong>t grâce à <strong>la</strong><br />
réalisation des travaux de mise à<br />
niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine<br />
Les grands projets sont réalisés,<br />
<strong>la</strong> multimodalité est réussie et <strong>la</strong><br />
mobilité est optimale. Les flux<br />
irrigu<strong>en</strong>t le territoire<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. Les<br />
connexions aux modes doux sont<br />
à l'étude<br />
Raccordem<strong>en</strong>t aux réseaux à<br />
grande vitesse europé<strong>en</strong>,<br />
développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales et optimisation du<br />
fret grâce à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> service de<br />
<strong>la</strong> LNPN<br />
Véritable hub régional autour de<br />
<strong>la</strong> gare de Rou<strong>en</strong><br />
Les parts de marché augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
grâce à <strong>la</strong> réalisation des travaux<br />
de mise à niveau des ouvrages<br />
de <strong>la</strong> Seine et au retard pris par<br />
le Canal Seine Nord<br />
Accessibilité<br />
maritime<br />
La faible accessibilité pénalise <strong>la</strong><br />
région<br />
Les ports secondaires se<br />
diversifi<strong>en</strong>t<br />
Amélioration de l'accessibilité<br />
grâce au développem<strong>en</strong>t de Port<br />
2000<br />
R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> sécurité<br />
maritime <strong>en</strong> Manche<br />
Amélioration de l'accessibilité<br />
grâce au développem<strong>en</strong>t de Port<br />
2000 et du cabotage dans les<br />
ports secondaires. Int<strong>en</strong>sification<br />
du trafic passager transmanche<br />
et transat<br />
Octobre 2012 133
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Accessibilité<br />
aéri<strong>en</strong>ne<br />
L'accessibilité aéri<strong>en</strong>ne est de<br />
plus <strong>en</strong> plus difficile. La survie de<br />
Deauville est m<strong>en</strong>acée<br />
L'accessibilité aéri<strong>en</strong>ne est de<br />
plus <strong>en</strong> plus difficile<br />
Le trafic s'améliore grâce à un<br />
accès facilité à Roissy et au<br />
développem<strong>en</strong>t de Deauville<br />
Le trafic au départ de <strong>la</strong><br />
<strong>Normandie</strong> est <strong>en</strong> croissance<br />
grâce à l'aéroport international de<br />
Deauville<br />
Accessibilité<br />
immatérielle<br />
Le développem<strong>en</strong>t du HD ne se<br />
fait pas par manque de moy<strong>en</strong>s<br />
financiers et de r<strong>en</strong>tabilité <strong>pour</strong><br />
les opérateurs<br />
Le HD ne couvre pas l'<strong>en</strong>semble<br />
du territoire et le THD ne se<br />
développe que sur des zones<br />
économiques ciblées par les<br />
opérateurs<br />
Le THD et son usage se<br />
développ<strong>en</strong>t sur tout le territoire<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> tire un<br />
avantage du développem<strong>en</strong>t du<br />
THD <strong>en</strong> se spécialisant dans le e-<br />
services<br />
Mondialisation et<br />
Europe<br />
Récession mondiale <strong>en</strong>trainant<br />
une réduction des échanges<br />
commerciaux<br />
Modification du modèle<br />
économique, l'économie<br />
financière est au service de<br />
l'économie réelle<br />
Développem<strong>en</strong>t harmonieux des<br />
échanges mondiaux<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ECONOMIQUE<br />
Croissanceemploi-chômage<br />
Filières<br />
économiques<br />
Poursuite de <strong>la</strong> crise, forte<br />
croissance du chômage dans<br />
tous les secteurs et très forte<br />
précarisation du travail.<br />
Cette situation <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre des<br />
désordres sociaux<br />
Poursuite de <strong>la</strong><br />
désindustrialisation.<br />
Délocalisation dans le secteur<br />
industriel et développem<strong>en</strong>t du<br />
tertiaire résid<strong>en</strong>tiel<br />
Abs<strong>en</strong>ce de croissance <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> malgré une<br />
reprise nationale faute<br />
d'investissem<strong>en</strong>ts.<br />
Chômage structurel installé et<br />
forte précarisation du travail.<br />
Intérim inexistant et vulnérabilité<br />
des femmes et des jeunes<br />
Poursuite de <strong>la</strong><br />
désindustrialisation mais<br />
ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t des<br />
délocalisations. Les secteurs<br />
traditionnels vieillissants et les<br />
PME souffr<strong>en</strong>t<br />
Processus long de croissance,<br />
forte baisse du chômage,<br />
diminution de <strong>la</strong> précarisation du<br />
travail et amélioration du pouvoir<br />
d'achat<br />
Des relocalisations bénéfici<strong>en</strong>t à<br />
<strong>la</strong> région. Mutation de certains<br />
secteurs traditionnels vers des<br />
activités <strong>en</strong> émerg<strong>en</strong>ce et<br />
opportunité <strong>pour</strong> les PME<br />
Pénurie de main d'œuvre dans<br />
certains secteurs<br />
Réindustrialisation de <strong>la</strong> HN.<br />
Développem<strong>en</strong>t des secteurs<br />
clés (énergie, logistique,<br />
portuaire, etc.) tirant les autres<br />
secteurs. Structuration de<br />
nouvelles filières porteuses.<br />
Attractivité <strong>pour</strong> les <strong>en</strong>treprises<br />
étrangères<br />
Octobre 2012 134
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par variable<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Insertion - Flux<br />
migratoires<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Formation<br />
Recherche<br />
Innovation<br />
Elévation du<br />
niveau de<br />
qualification<br />
(initiale - continue<br />
tout au long de <strong>la</strong><br />
vie)<br />
Adaptation des<br />
qualifications aux<br />
mutations<br />
économiques<br />
Synergie <strong>en</strong>tre les<br />
acteurs et pilotage<br />
de <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle<br />
Recherche et<br />
innovation<br />
Pas d'accès à l'emploi des<br />
femmes et des jeunes.<br />
La main d'œuvre très qualifiée<br />
mobile s'expatrie<br />
Les retards se creus<strong>en</strong>t<br />
Pas d'adaptations nécessaires<br />
<strong>pour</strong> accompagner les<br />
secteurs <strong>en</strong> mutation<br />
Pilotage cloisonné de <strong>la</strong><br />
formation professionnelle.<br />
Abs<strong>en</strong>ce de synergie <strong>en</strong>tre<br />
acteurs.<br />
Pas de prise <strong>en</strong> compte de<br />
l'accompagnem<strong>en</strong>t social des<br />
formations<br />
Dilution et recul de <strong>la</strong><br />
recherche régionale.<br />
Défici<strong>en</strong>ce des financem<strong>en</strong>ts<br />
publics et déréglem<strong>en</strong>tation de<br />
<strong>la</strong> recherche. Action limitée du<br />
PRES et défaut d'attractivité de<br />
l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur s'est<br />
acc<strong>en</strong>tué<br />
Intérim inexistant et vulnérabilité<br />
des femmes et des jeunes.<br />
Accès à l'emploi des jeunes<br />
même diplômés reste difficile,<br />
ils quitt<strong>en</strong>t le territoire et<br />
contribu<strong>en</strong>t au déficit migratoire<br />
régional<br />
Elévation des niveaux et<br />
rattrapage des retards<br />
Adaptations des compét<strong>en</strong>ces<br />
professionnelles dictées par<br />
exig<strong>en</strong>ces d'employabilité des<br />
secteurs <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t.<br />
Les secteurs/branches/filières<br />
se décloisonn<strong>en</strong>t favorisant <strong>la</strong><br />
GPEC et <strong>la</strong> GPEC Territoriale<br />
Emerg<strong>en</strong>ce d'une dynamique<br />
d'échanges et de concertation<br />
La ré industrialisation et <strong>la</strong><br />
relocalisation favoris<strong>en</strong>t le<br />
mainti<strong>en</strong> des activités de<br />
recherche. Visibilité nationale et<br />
internationale du PRES qui a<br />
<strong>en</strong>gagé des actions<br />
structurantes<br />
L'intérim et l'emploi des jeunes rest<strong>en</strong>t<br />
des variables d'ajustem<strong>en</strong>t, le territoire<br />
devi<strong>en</strong>t "attractif" <strong>pour</strong> les actifs des<br />
régions voisines<br />
Elévation des niveaux de qualification et<br />
avance sur les autres régions grâce aux<br />
opportunités structurelles qu'offrait<br />
l'économie régionale<br />
Adaptation des qualifications aux besoins<br />
des secteurs reconvertis et nouveaux<br />
(autour de l'Axe Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>/mer/fleuve/logistique/énergie).<br />
Individu acteur de ses choix et intégration<br />
des exig<strong>en</strong>ces du développem<strong>en</strong>t durable<br />
Pilotage régionalisé de <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle via les contrats régionaux<br />
et au sein du PRES, adaptation de l'offre<br />
de formation aux nouveaux usages -<br />
Structuration et attractivité r<strong>en</strong>forcée de<br />
l'offre de formation régionale<br />
Pilotage du PRES à l'échelle<br />
interrégionale du projet Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>, Structuration et attractivité<br />
r<strong>en</strong>forcée de l'offre de formation<br />
supérieure et de <strong>la</strong> recherche régionale<br />
Les femmes font valoir leurs<br />
compét<strong>en</strong>ces d'<strong>en</strong>trée de jeu<br />
dans les secteurs porteurs.<br />
Certains secteurs attir<strong>en</strong>t des<br />
flux <strong>en</strong>trants de main d'œuvre<br />
<strong>pour</strong> pallier <strong>la</strong> pénurie<br />
Octobre 2012 135
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Offre de soins<br />
Sousvariables<br />
Solvabilité des<br />
politiques de<br />
santé et<br />
Financem<strong>en</strong>t<br />
des risques<br />
dép<strong>en</strong>dance<br />
Prév<strong>en</strong>tion et<br />
Education à <strong>la</strong><br />
santé<br />
Poursuite du<br />
progrès<br />
technique<br />
Démographie<br />
et morbidité<br />
Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Les ressources sont limitées: <strong>la</strong> redéfinition des politiques sociales est une nécessité mais on n’a pas prise localem<strong>en</strong>t sur ces choix<br />
La situation s'est<br />
irrémédiablem<strong>en</strong>t dégradée:<br />
développem<strong>en</strong>t des déserts<br />
médicaux et r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de<br />
l'iniquité dans l'accès aux soins<br />
La prév<strong>en</strong>tion et l'éducation à <strong>la</strong><br />
santé n'exist<strong>en</strong>t plus. Les<br />
pathologies régionales sont de<br />
plus <strong>en</strong> plus lourdes<br />
Réduction des aides à <strong>la</strong><br />
recherche des secteurs <strong>en</strong> pointe<br />
du CHUR. Abs<strong>en</strong>ce de<br />
valorisation des recherches<br />
abouties<br />
Augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> morbidité<br />
avec l’âge<br />
La solvabilité du système de<br />
santé s'est maint<strong>en</strong>ue mais les<br />
retards régionaux sont tels que<br />
les écarts se creus<strong>en</strong>t<br />
Aucun changem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière<br />
de prév<strong>en</strong>tion ce qui creuse les<br />
déséquilibres déjà existant <strong>en</strong>tre<br />
actifs des différ<strong>en</strong>ts secteurs<br />
professionnels<br />
Fléchages des aides locales sur<br />
<strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> pointe du CHUR:<br />
retombées positives des<br />
découvertes<br />
Age et morbidité recul<strong>en</strong>t au<br />
même rythme<br />
Une prise <strong>en</strong> charge du<br />
vieillissem<strong>en</strong>t au niveau national<br />
permet de flécher les moy<strong>en</strong>s sur<br />
les priorités régionales<br />
(prév<strong>en</strong>tion, démographie<br />
médicale…) et les retards<br />
comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à être rattrapés<br />
Régénération des systèmes de<br />
médecine prév<strong>en</strong>tive.<br />
Id<strong>en</strong>tification de secteurs<br />
professionnels ou zones<br />
sco<strong>la</strong>ires prioritaires: les écarts<br />
se réduis<strong>en</strong>t<br />
Généralisation de <strong>la</strong><br />
télémédecine et de <strong>la</strong> télésanté,<br />
recul de l'âge d'apparition des<br />
pathologies<br />
Recul de <strong>la</strong> morbidité avec l'âge<br />
Généralisation de <strong>la</strong> médecine<br />
prév<strong>en</strong>tive. Recul significatif de<br />
certaines pathologies régionales<br />
lourdes<br />
Démographie<br />
médicale<br />
Les déserts médicaux se<br />
développ<strong>en</strong>t<br />
La d<strong>en</strong>sité médicale des<br />
généralistes a régressé d'un<br />
point. Aucune évolution favorable<br />
de <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sité des spécialistes<br />
Amélioration de <strong>la</strong> démographie<br />
médicale et contexte d'attractivité<br />
retrouvée. Les inégalités<br />
territoriales dans l'offre de soin<br />
sont limitées<br />
Accès au soin<br />
primaire<br />
L'<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services<br />
d'urg<strong>en</strong>ce est un signe de<br />
"mauvaise santé" d'accès au soin<br />
primaire<br />
Les maisons de santé<br />
développées sont le lieu habituel<br />
d'accès au soin primaire<br />
Adhésion de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
acquise <strong>en</strong> matière de télésanté,<br />
télémédecine, télé exam<strong>en</strong>, e-<br />
prescription: l'accès au soin est<br />
fluide<br />
Octobre 2012 136
Synthèse des hypothèses ret<strong>en</strong>ues par variable<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ENVIRONNEMENTAL<br />
Environn<strong>en</strong>t / Climat<br />
/ Risques<br />
Changem<strong>en</strong>ts<br />
climatiques<br />
Energies<br />
Consommation<br />
et production<br />
durable<br />
Conservation<br />
et gestion<br />
durable de <strong>la</strong><br />
biodiversité et<br />
des<br />
ressources<br />
naturelles<br />
Repli sur les habitudes : on<br />
puise dans le stock des<br />
ressources naturelles<br />
épuisables. Les émissions<br />
nocives stagn<strong>en</strong>t car l'activité<br />
est fortem<strong>en</strong>t réduite<br />
L'EPR de P<strong>en</strong>ly n'est pas<br />
réalisé faute de financem<strong>en</strong>t.<br />
Les parcs éoli<strong>en</strong>s sont <strong>en</strong><br />
dessous des prévisions<br />
Les coûts dissuasifs de<br />
l'énergie font baisser <strong>la</strong><br />
consommation. L'innovation<br />
n'est plus une priorité et recule<br />
Artificialisation croissante des<br />
sols.<br />
Cloisonnem<strong>en</strong>t des milieux<br />
naturels<br />
Le déploiem<strong>en</strong>t des énergies<br />
propres n'est pas assez<br />
r<strong>en</strong>table.<br />
Les émissions nocives<br />
s'acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t<br />
La décision de faire l’EPR n’est<br />
pas prise. Les parcs éoli<strong>en</strong>s<br />
sont réalisés avec très peu de<br />
retombées <strong>en</strong> termes d'emploi<br />
régional. Ils ne sont pas <strong>en</strong><br />
proportion suffisante <strong>pour</strong><br />
re<strong>la</strong>yer l'usage des énergies<br />
fossiles<br />
"Une croissance verte"<br />
comm<strong>en</strong>ce à émerger mais le<br />
tissu industriel <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> ne sait pas saisir<br />
cette opportunité<br />
Arrêt de l'érosion de <strong>la</strong><br />
biodiversité mais le SRCE bi<strong>en</strong><br />
qu'appliqué ne permet pas une<br />
restauration des écosystèmes<br />
Hausse du coût de l'énergie<br />
Les émissions nocives toujours<br />
importantes sont pondérées par<br />
le développem<strong>en</strong>t des énergies<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles grâce aux<br />
innovations<br />
La décision de faire l’'EPR de<br />
P<strong>en</strong>ly a été tardive et il est <strong>en</strong><br />
chantier. Les parcs éoli<strong>en</strong>s sont<br />
réalisés et les retombées <strong>en</strong><br />
termes d'emploi régional et de<br />
qualification sont fortes<br />
Le long terme est privilégié. Le<br />
durable est ancré dans les<br />
modes de consommation et<br />
intégré aux process industriels<br />
Amélioration de <strong>la</strong> qualité<br />
paysagère et de <strong>la</strong> biodiversité<br />
<strong>en</strong> s'appuyant sur un SRCE<br />
ambitieux<br />
L'objectif du Gr<strong>en</strong>elle de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (23%<br />
d'énergies de sources<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles) est atteint grâce<br />
aux modifications de<br />
consommation bi<strong>en</strong> intégrées et<br />
à l'accès facile aux énergies<br />
propres.<br />
L'EPR est réalisé, les<br />
innovations rapides ont permis<br />
de développer des sources<br />
d'énergies à <strong>la</strong> fois propres et<br />
durables. Les énergies sont<br />
produites <strong>en</strong> quantité suffisante<br />
<strong>pour</strong> répondre aux besoins<br />
économiques régionaux,<br />
nationaux et internationaux<br />
Climat et<br />
risques<br />
naturels et/ou<br />
industriels<br />
Poursuite du réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique qui int<strong>en</strong>sifie les<br />
risques naturels et <strong>la</strong> morbidité<br />
Poursuite du réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique qui int<strong>en</strong>sifie les<br />
risques naturels et <strong>la</strong> morbidité.<br />
Développem<strong>en</strong>t d'une filière de<br />
gestion et prév<strong>en</strong>tion des<br />
risques industriels<br />
Frein au réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique.<br />
Généralisation des PPRT<br />
Octobre 2012 137
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel<br />
La culture n'est pas une priorité.<br />
Elle n'est pas perçue comme un<br />
outil de développem<strong>en</strong>t du<br />
territoire. Le rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel est <strong>en</strong> déclin<br />
Les territoires développ<strong>en</strong>t des<br />
initiatives <strong>pour</strong> les publics de<br />
proximité. Le rayonnem<strong>en</strong>t est<br />
trop faible <strong>pour</strong> porter l'id<strong>en</strong>tité<br />
du territoire<br />
Concertation et mise <strong>en</strong><br />
cohér<strong>en</strong>ce de tous les échelons.<br />
Les retombées r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le<br />
s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d'appart<strong>en</strong>ance des<br />
(hauts) normands<br />
Octobre 2012 138
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
Partie II<br />
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
INTRODUCTION<br />
I -<br />
II -<br />
III -<br />
Définition d’un sc<strong>en</strong>ario : les futurs possibles<br />
Choix des critères discriminants <strong>pour</strong> bâtir les sc<strong>en</strong>arii<br />
Synthèse des « chemins » : croisem<strong>en</strong>t des hypothèses/sc<strong>en</strong>arii<br />
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES SCENARII<br />
PRESENTATION DETAILLEE DES SCENARII<br />
I - Sc<strong>en</strong>ario S1 « La spirale du déclin dans un contexte europé<strong>en</strong> dégradé »<br />
II - Sc<strong>en</strong>ario S2 « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »<br />
III - Sc<strong>en</strong>ario S3 « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus forte ! »<br />
IV - Sc<strong>en</strong>ario S4 « La <strong>Normandie</strong> dans un contexte euphorique »<br />
Octobre 2012 139
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 140
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
INTRODUCTION<br />
I - Définition d’un sc<strong>en</strong>ario : les futurs possibles <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
Sc<strong>en</strong>ario : Jeu cohér<strong>en</strong>t d’hypothèses conduisant d’une situation d’origine à une<br />
situation future. Un sc<strong>en</strong>ario est une description du système à un horizon donné<br />
et du cheminem<strong>en</strong>t conduisant à son état final.<br />
On se p<strong>la</strong>ce dans le futur <strong>en</strong> <strong>2025</strong> : le temps de <strong>la</strong> narration employé <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
rédaction des sc<strong>en</strong>arios est donc le prés<strong>en</strong>t, avec emploi du passé composé <strong>pour</strong><br />
<strong>la</strong> lecture du passé.<br />
II -<br />
Choix des critères discriminants <strong>pour</strong> bâtir les sc<strong>en</strong>arii<br />
II.1. - L’importance du contexte économique mondial, facteur exogène :<br />
La situation de crise économique internationale durable et l’apparition de dettes<br />
souveraines au niveau de nombreuses nations développées sont des facteurs clés<br />
du contexte dans lequel les variables du système vont se comporter.<br />
Le choix a été fait de ret<strong>en</strong>ir trois situations de départ contrastées, face<br />
auxquelles les marges de manœuvre de <strong>la</strong> Région <strong>pour</strong>ront permettre d’activer<br />
les leviers pertin<strong>en</strong>ts grâce aux bons indicateurs de santé financière qu’elle a su<br />
préserver par sa gestion rigoureuse. Ces trois situations conduis<strong>en</strong>t à quatre<br />
sc<strong>en</strong>arii.<br />
• P<strong>en</strong>dant plus d'une déc<strong>en</strong>nie, les pays ont connu une baisse quasi-continue du<br />
PIB. Cette récession, sans précéd<strong>en</strong>t du fait de son caractère de longue<br />
période, a été non pas accid<strong>en</strong>telle, mais structurelle. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a<br />
subi cette récession continue d’aujourd’hui à <strong>2025</strong>.<br />
→ Sc<strong>en</strong>ario S1 : « La spirale du déclin dans un contexte europé<strong>en</strong><br />
dégradé»<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario catastrophe…<br />
• Amélioration du contexte économique national et mondial, le souci de<br />
développem<strong>en</strong>t durable guide l’action. Dans cette hypothèse, <strong>la</strong> région peut<br />
pr<strong>en</strong>dre 2 voies différ<strong>en</strong>tes :<br />
- Elle n’anticipe pas suffisamm<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> se mettre <strong>en</strong> situation de bénéficier<br />
des retombées de cette embellie<br />
→ Sc<strong>en</strong>ario S2 : « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario qu’il faut éviter…<br />
- Elle anticipe l'amélioration de <strong>la</strong> conjoncture économique nationale et<br />
mondiale.<br />
→ Sc<strong>en</strong>ario S3 : « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus forte ! »<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario audacieux… mais néanmoins atteignable<br />
• Prise de consci<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> nécessité d’une solidarité <strong>en</strong>tre nations et<br />
redistribution des cartes au niveau mondial, épuration des dettes et<br />
redémarrage sur une économie vertueuse. C’est le sc<strong>en</strong>ario dans lequel La<br />
région réinv<strong>en</strong>te avec les ressources financières dont elle dispose <strong>pour</strong> poser<br />
des bases et anticiper sur l’av<strong>en</strong>ir.<br />
Octobre 2012 141
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
→ Sc<strong>en</strong>ario S4 : « La <strong>Normandie</strong> dans un contexte euphorique »<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario qui peut paraître idéal mais dont il faut craindre les<br />
pièges…<br />
Le choix est fait de ret<strong>en</strong>ir :<br />
• un seul sc<strong>en</strong>ario dans le contexte de récession (et non pas deux avec une<br />
alternative optimiste <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et un rebond de croissance régionale),<br />
• deux sc<strong>en</strong>arii dans un contexte de croissance retrouvée : ils dispos<strong>en</strong>t d’un<br />
chapeau commun, mais décriv<strong>en</strong>t deux situations diverg<strong>en</strong>tes <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région<br />
(elle s’<strong>en</strong>fonce ou elle progresse),<br />
• un sc<strong>en</strong>ario de croissance accélérée.<br />
A l’horizon <strong>2025</strong>, toute forme de « révolution » économique ou sociale,<br />
produisant une vraie rupture a été exclue.<br />
La « <strong>Normandie</strong> » invoquée dans les sc<strong>en</strong>arii S3 et S4 traduit <strong>la</strong> capacité des<br />
acteurs <strong>en</strong> région à s’inscrire dans une échelle de référ<strong>en</strong>ce territoriale dépassant<br />
celle des frontières administratives, <strong>en</strong> dehors de tout débat sur <strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce de<br />
cette frontière <strong>en</strong>tre <strong>Haute</strong> et Basse-<strong>Normandie</strong>.<br />
II.2. - L’importance de <strong>la</strong> réalisation des grands projets régionaux<br />
d’infrastructure et <strong>en</strong> matière d’énergies<br />
L’objectif recherché est d’ancrer localem<strong>en</strong>t les sc<strong>en</strong>arii et de donner toute leur<br />
p<strong>la</strong>ce aux hypothèses émises <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble des variables étudiées.<br />
La réorganisation des variables et des sous variables telle que prés<strong>en</strong>tée dans <strong>la</strong><br />
partie précéd<strong>en</strong>te répond <strong>en</strong> partie à cet objectif.<br />
Il <strong>en</strong> est de même de <strong>la</strong> structure du p<strong>la</strong>n des sc<strong>en</strong>arii qui part des élém<strong>en</strong>ts de<br />
contexte général <strong>pour</strong> aboutir à <strong>la</strong> situation régionale.<br />
Enfin et surtout, il a été décidé de p<strong>la</strong>cer <strong>en</strong> tête du cheminem<strong>en</strong>t, dans<br />
l’<strong>en</strong>chaînem<strong>en</strong>t des hypothèses sur <strong>la</strong> situation régionale, les 4 axes forts dits<br />
« incontournables » liés aux infrastructures autour du projet Axe Seine dénommé<br />
« Paris Seine <strong>Normandie</strong> », ainsi que le thème des énergies, <strong>pour</strong> lesquels les<br />
choix opérés conditionn<strong>en</strong>t <strong>en</strong> partie <strong>la</strong> combinaison des hypothèses des autres<br />
variables.<br />
Pour mémoire,<br />
• le rapport du Commissaire général du gouvernem<strong>en</strong>t au développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong><br />
vallée de <strong>la</strong> Seine, dans son rapport remis au 1 er ministre <strong>en</strong> février 2012,<br />
estime à un coût de 18 milliards d’€, à l’horizon 10 à 15 ans, les seuls<br />
équipem<strong>en</strong>ts lourds d’infrastructures routière, ferroviaire, fluviomaritime<br />
incontournables ;<br />
• un vo<strong>la</strong>nt de l’ordre de 400 Millions d’€ représ<strong>en</strong>terait le coût probable de<br />
déploiem<strong>en</strong>t du THD sur le territoire, estimé selon les conclusions du rapport<br />
parlem<strong>en</strong>taire remis au Premier Ministre égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> février 2012 émanant<br />
de <strong>la</strong> commission du Sénat présidée par M. Le Sénateur Hervé Maurey,<br />
auditionné par <strong>la</strong> section ;<br />
• le maître d’ouvrage EDF estime <strong>la</strong> coût de réalisation de l’EPR de P<strong>en</strong>ly à 4<br />
milliards d’euros (avant appel d’offres) dans son dossier de synthèse du débat<br />
public (2010) repris par <strong>la</strong> Commission Nationale du Débat Public dans son<br />
compte r<strong>en</strong>du du débat de septembre 2010 ;<br />
• le coût du projet d’imp<strong>la</strong>ntation du parc éoli<strong>en</strong> des 2 côtes avait été estimé<br />
par <strong>la</strong> Compagnie du V<strong>en</strong>t-GDF Suez à <strong>en</strong>viron 1,8 milliards d’euros lors du<br />
débat public.<br />
Octobre 2012 142
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
III - Synthèse des « chemins »<br />
Tableau synthétique de croisem<strong>en</strong>t des hypothèses/sc<strong>en</strong>arii<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Politique<br />
générale<br />
régionale<br />
Concurr<strong>en</strong>ce des<br />
territoires et règle<br />
du chacun <strong>pour</strong><br />
soi<br />
Gouvernance des<br />
villes et<br />
coopérations de<br />
proximité<br />
Pouvoirs publics forts et coopérations<br />
régionales à l’échelle europé<strong>en</strong>ne<br />
Transports et<br />
accessibilité<br />
régionale<br />
Accessibilité<br />
matérielle<br />
Accessibilité<br />
immatérielle<br />
Accessibilité<br />
dégradée et<br />
mobilité réduite<br />
Territoire non<br />
couvert par le<br />
haut débit HD<br />
Accessibilité<br />
difficile faute de<br />
réalisation des<br />
grands projets<br />
Inégalités<br />
territoriales des<br />
couvertures <strong>en</strong> HD<br />
et THD<br />
Accessibilité<br />
améliorée et<br />
multimodalité.<br />
Flux innervant le<br />
territoire<br />
Equipem<strong>en</strong>t et<br />
usage du THD<br />
répandus sur tour<br />
le territoire<br />
Mobilité optimale,<br />
multimodalité<br />
réussie.<br />
Flux irrigant tout<br />
le territoire<br />
Avantage du THD<br />
et spécialisation<br />
régionale dans les<br />
e-services<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ECONOMIQUE<br />
SOCIAL<br />
Insertion Flux<br />
SOCIAL<br />
Formation<br />
Recherche<br />
Innovation<br />
Réduction des<br />
échanges.<br />
Poursuite désindustrialisations<br />
/délocalisations<br />
Insertion difficile.<br />
Précarisation et<br />
fuite de <strong>la</strong> main<br />
d’œuvre qualifiée<br />
Retards creusés<br />
et recul<br />
attractivité du<br />
supérieur<br />
Désindustrialisation<br />
et économie<br />
régionale<br />
traditionnelle <strong>en</strong><br />
souffrance<br />
Insertion difficile et<br />
fuite des jeunes<br />
diplômés<br />
Rattrapage des<br />
retards <strong>en</strong><br />
formation et<br />
recherche<br />
Mutation des<br />
secteurs<br />
traditionnels vers<br />
des activités <strong>en</strong><br />
émerg<strong>en</strong>ce<br />
Attractivité du<br />
territoire <strong>pour</strong> les<br />
actifs des régions<br />
voisines<br />
Réidustrialisation.<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
des secteurs clés<br />
porteurs.<br />
Attractivité<br />
internationale<br />
Flux <strong>en</strong>trant de<br />
main-d’oeuvre<br />
Attractivité r<strong>en</strong>forcée de l’offre de<br />
formation /recherche. Elévation des<br />
niveaux<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel<br />
SOCIAL<br />
Offre de soins<br />
ENVIRONNE-<br />
MENTAL<br />
Energies<br />
Environn<strong>en</strong>t<br />
Climat Risques<br />
Situation sanitaire<br />
dégradée.<br />
Aggravation des<br />
inégalités d’accès<br />
aux soins<br />
Repli sur habitudes<br />
de consommation<br />
énergétique,<br />
cloisonnem<strong>en</strong>t<br />
milieux naturels<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel <strong>en</strong> déclin<br />
retards régionaux<br />
importants se<br />
creus<strong>en</strong>t<br />
Emerg<strong>en</strong>ce d’une<br />
croissance verte,<br />
pas de restauration<br />
des équilibres des<br />
écosystèmes<br />
Initiatives portées<br />
par les territoires<br />
<strong>pour</strong> les publics de<br />
proximité<br />
Retards <strong>en</strong> cours de<br />
rattrapage, baisse<br />
des inégalités<br />
d’accès aux soins.<br />
E-médecine<br />
Innovation favorise<br />
<strong>la</strong> croissance verte.<br />
Biodiversité<br />
améliorée.<br />
Prév<strong>en</strong>tion<br />
généralisée. Recul<br />
des pathologies<br />
lourdes régionales<br />
Le durable est<br />
ancré dans les<br />
modes de consommation<br />
et les<br />
process industriels<br />
Id<strong>en</strong>tité du territoire et attractivité<br />
culturelle r<strong>en</strong>forcée<br />
La spirale<br />
du déclin<br />
Affaiblissem<strong>en</strong>t<br />
de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong><br />
Vers une <strong>Normandie</strong><br />
audacieuse et plus forte !<br />
La <strong>Normandie</strong> dans un<br />
contexte euphorique<br />
Octobre 2012 143
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
S1<br />
S2<br />
S3<br />
S4<br />
Politique<br />
générale<br />
régionale<br />
Contexte global<br />
Gouvernance<br />
Coopérations<br />
interrégionales<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
internationales<br />
intracommunautaires<br />
Re<strong>la</strong>tions<br />
internationales<br />
extracommunautaires<br />
Règle du chacun <strong>pour</strong> soi dans<br />
un contexte économique<br />
défavorable<br />
Il n'y a plus de gouvernance des<br />
territoires<br />
Concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre<br />
les territoires<br />
Concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre<br />
les territoires. Une zone euro<br />
réduite aux pays « les plus<br />
riches<br />
Les marchés ne sont plus<br />
régulés<br />
Développem<strong>en</strong>t des circuits<br />
courts dans un contexte<br />
économique de décroissance<br />
La gouvernance se situe au<br />
niveau des villes et tout<br />
particulièrem<strong>en</strong>t des grandes<br />
villes (Rou<strong>en</strong> et Le Havre<br />
Evreux)<br />
Emerg<strong>en</strong>ce de coopérations,<br />
basées sur des spécialités<br />
régionales (agriculture,<br />
logistique)<br />
R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des re<strong>la</strong>tions<br />
transnationales de proximité<br />
Concurr<strong>en</strong>ce et coopération<br />
<strong>en</strong>tre les régions à l'échelle de<br />
l'Europe<br />
Rou<strong>en</strong> et Le Havre, à l’échelle<br />
internationale, ne sont qu’une<br />
seule et même ville. Elles sont<br />
<strong>en</strong> re<strong>la</strong>tion directe avec les ports<br />
et les villes du monde<br />
Ext<strong>en</strong>sion du développem<strong>en</strong>t<br />
durable dans un contexte de<br />
croissance<br />
Omniprés<strong>en</strong>ce des pouvoirs<br />
publics<br />
Coopération poussée<br />
(notamm<strong>en</strong>t au niveau de <strong>la</strong><br />
recherche)<br />
L’Europe des Etats est aussi<br />
l’Europe des Régions. Les<br />
grands projets se développ<strong>en</strong>t<br />
grâce à une forme de crédit<br />
gérée à l’échelle europé<strong>en</strong>ne<br />
Le Havre, porte maritime de<br />
l’Europe occid<strong>en</strong>tale et principal<br />
port de l'Ile de France<br />
Octobre 2012 144
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
Variables<br />
Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Transports et<br />
accessibilité<br />
régionale<br />
T<strong>en</strong>dance générale<br />
Accessibilité<br />
routière<br />
Transports <strong>en</strong><br />
commun<br />
Accessibilité<br />
ferroviaire<br />
Accessibilité<br />
fluviale<br />
Accessibilité<br />
maritime<br />
Dégradation des infrastructures<br />
et mobilité réduite<br />
Les conditions de circu<strong>la</strong>tion<br />
routière se dégrad<strong>en</strong>t fortem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> raison de <strong>la</strong> non-réalisation<br />
des contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts<br />
Dégradation des transports<br />
collectifs faute d'<strong>en</strong>treti<strong>en</strong><br />
Mix transport individuel / collectif<br />
inversé<br />
Service aux usagers dégradé<br />
Les lignes sont saturées et<br />
obsolètes.<br />
Des dessertes fret sont<br />
abandonnées.<br />
La nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> n'est<br />
pas faite<br />
Le Canal Seine Nord est<br />
opérationnel et <strong>la</strong> région perd des<br />
parts de marché <strong>en</strong> raison de <strong>la</strong><br />
non-réalisation des travaux de<br />
mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong><br />
Seine<br />
La faible accessibilité pénalise <strong>la</strong><br />
région<br />
Les grands projets ne sont pas<br />
tous réalisés et cette situation<br />
génère des congestions<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts ne sont pas<br />
réalisés<br />
Généralisation des nouvelles<br />
formes de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t:<br />
covoiturage et transports<br />
collectifs maint<strong>en</strong>us <strong>en</strong> l'état<br />
Lignes voyageurs infrarégionales<br />
mises à niveau.<br />
Fret est à l'état embryonnaire; Il<br />
est desserré à Rou<strong>en</strong> où <strong>la</strong><br />
nouvelle gare vi<strong>en</strong>t d'être mise <strong>en</strong><br />
service mais pas <strong>en</strong>core<br />
raccordée au réseau<br />
Non-réalisation des travaux de<br />
mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong><br />
Seine<br />
Les ports secondaires se<br />
diversifi<strong>en</strong>t<br />
Les grands projets sont réalisés<br />
et <strong>la</strong> multimodalité se met <strong>en</strong><br />
p<strong>la</strong>ce. Les flux innerv<strong>en</strong>t peu à<br />
peu le territoire<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés<br />
Part de l'auto réduite <strong>en</strong> ville<br />
Développem<strong>en</strong>t des réseaux<br />
urbains de transport et cyc<strong>la</strong>bles<br />
P<strong>la</strong>teformes multimodales = lieux<br />
de flux et de services aux<br />
usagers"<br />
Raccordem<strong>en</strong>t aux réseaux à<br />
grande vitesse europé<strong>en</strong>,<br />
développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales et du fret grâce<br />
aux lignes de contournem<strong>en</strong>t de<br />
l'anci<strong>en</strong>ne gare de Rou<strong>en</strong>.<br />
La nouvelle Gare de Rou<strong>en</strong> offre<br />
des services tertiaires à l'échelle<br />
de l'agglomération"<br />
Le transport de déchets se<br />
développe fortem<strong>en</strong>t grâce à <strong>la</strong><br />
réalisation des travaux de mise à<br />
niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine<br />
Amélioration de l'accessibilité<br />
grâce au développem<strong>en</strong>t de Port<br />
2000<br />
R<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> sécurité<br />
maritime <strong>en</strong> Manche<br />
Les grands projets sont réalisés,<br />
<strong>la</strong> multimodalité est réussie et <strong>la</strong><br />
mobilité est optimale. Les flux<br />
irrigu<strong>en</strong>t le territoire<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et<br />
raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. Les<br />
connexions aux modes doux sont<br />
à l'étude<br />
Raccordem<strong>en</strong>t aux réseaux à<br />
grande vitesse europé<strong>en</strong>,<br />
développem<strong>en</strong>t des lignes<br />
infrarégionales et optimisation du<br />
fret grâce à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> service de<br />
<strong>la</strong> LNPN<br />
Véritable hub régional autour de<br />
<strong>la</strong> gare de Rou<strong>en</strong><br />
Les parts de marché augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
grâce à <strong>la</strong> réalisation des travaux<br />
de mise à niveau des ouvrages<br />
de <strong>la</strong> Seine et au retard pris par<br />
le Canal Seine Nord<br />
Amélioration de l'accessibilité<br />
grâce au développem<strong>en</strong>t de Port<br />
2000 et du cabotage dans les<br />
ports secondaires. Int<strong>en</strong>sification<br />
du trafic passager transmanche<br />
et transat<br />
Octobre 2012 145
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Accessibilité<br />
aéri<strong>en</strong>ne<br />
L'accessibilité aéri<strong>en</strong>ne est de<br />
plus <strong>en</strong> plus difficile. La survie de<br />
Deauville est m<strong>en</strong>acée<br />
L'accessibilité aéri<strong>en</strong>ne est de<br />
plus <strong>en</strong> plus difficile<br />
Le trafic s'améliore grâce à un<br />
accès facilité à Roissy et au<br />
développem<strong>en</strong>t de Deauville<br />
Le trafic au départ de <strong>la</strong><br />
<strong>Normandie</strong> est <strong>en</strong> croissance<br />
grâce à l'aéroport international de<br />
Deauville<br />
Accessibilité<br />
immatérielle<br />
Le développem<strong>en</strong>t du HD ne se<br />
fait pas par manque de moy<strong>en</strong>s<br />
financiers et de r<strong>en</strong>tabilité <strong>pour</strong><br />
les opérateurs<br />
Le HD ne couvre pas l'<strong>en</strong>semble<br />
du territoire et le THD ne se<br />
développe que sur des zones<br />
économiques ciblées par les<br />
opérateurs<br />
Le THD et son usage se<br />
développ<strong>en</strong>t sur tout le territoire<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> tire un<br />
avantage du développem<strong>en</strong>t du<br />
THD <strong>en</strong> se spécialisant dans le e-<br />
services<br />
Mondialisation et<br />
Europe<br />
Récession mondiale <strong>en</strong>trainant<br />
une réduction des échanges<br />
commerciaux<br />
Modification du modèle<br />
économique, l'économie<br />
financière est au service de<br />
l'économie réelle<br />
Développem<strong>en</strong>t harmonieux des<br />
échanges mondiaux<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ECONOMIQUE<br />
Croissanceemploi-chômage<br />
Filières<br />
économiques<br />
Poursuite de <strong>la</strong> crise, forte<br />
croissance du chômage dans<br />
tous les secteurs et très forte<br />
précarisation du travail.<br />
Cette situation <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre des<br />
désordres sociaux<br />
Poursuite de <strong>la</strong><br />
désindustrialisation.<br />
Délocalisation dans le secteur<br />
industriel et développem<strong>en</strong>t du<br />
tertiaire résid<strong>en</strong>tiel<br />
Abs<strong>en</strong>ce de croissance <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> malgré une<br />
reprise nationale faute<br />
d'investissem<strong>en</strong>ts.<br />
Chômage structurel installé et<br />
forte précarisation du travail.<br />
Intérim inexistant et vulnérabilité<br />
des femmes et des jeunes<br />
Poursuite de <strong>la</strong><br />
désindustrialisation mais<br />
ral<strong>en</strong>tissem<strong>en</strong>t des<br />
délocalisations. Les secteurs<br />
traditionnels vieillissants et les<br />
PME souffr<strong>en</strong>t<br />
Processus long de croissance,<br />
forte baisse du chômage,<br />
diminution de <strong>la</strong> précarisation du<br />
travail et amélioration du pouvoir<br />
d'achat<br />
Des relocalisations bénéfici<strong>en</strong>t à<br />
<strong>la</strong> région. Mutation de certains<br />
secteurs traditionnels vers des<br />
activités <strong>en</strong> émerg<strong>en</strong>ce et<br />
opportunité <strong>pour</strong> les PME<br />
Pénurie de main d'œuvre dans<br />
certains secteurs<br />
Réindustrialisation de <strong>la</strong> HN.<br />
Développem<strong>en</strong>t des secteurs<br />
clés (énergie, logistique,<br />
portuaire, etc.) tirant les autres<br />
secteurs. Structuration de<br />
nouvelles filières porteuses.<br />
Attractivité <strong>pour</strong> les <strong>en</strong>treprises<br />
étrangères<br />
Octobre 2012 146
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2<br />
Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Insertion - Flux<br />
migratoires<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Formation<br />
Recherche<br />
Innovation<br />
Elévation du<br />
niveau de<br />
qualification<br />
(initiale - continue<br />
tout au long de <strong>la</strong><br />
vie)<br />
Adaptation des<br />
qualifications aux<br />
mutations<br />
économiques<br />
Synergie <strong>en</strong>tre les<br />
acteurs et pilotage<br />
de <strong>la</strong> formation<br />
professionnelle<br />
Recherche et<br />
innovation<br />
Pas d'accès à l'emploi des<br />
femmes et des jeunes.<br />
La main d'œuvre très qualifiée<br />
mobile s'expatrie<br />
Les retards se creus<strong>en</strong>t<br />
Pas d'adaptations nécessaires<br />
<strong>pour</strong> accompagner les secteurs<br />
<strong>en</strong> mutation<br />
Pilotage cloisonné de <strong>la</strong><br />
formation professionnelle.<br />
Abs<strong>en</strong>ce de synergie <strong>en</strong>tre<br />
acteurs.<br />
Pas de prise <strong>en</strong> compte de<br />
l'accompagnem<strong>en</strong>t social des<br />
formations<br />
Dilution et recul de <strong>la</strong> recherche<br />
régionale. Défici<strong>en</strong>ce des<br />
financem<strong>en</strong>ts publics et<br />
déréglem<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong><br />
recherche. Action limitée du<br />
PRES et défaut d'attractivité de<br />
l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur s'est<br />
acc<strong>en</strong>tué<br />
Intérim inexistant et vulnérabilité<br />
des femmes et des jeunes.<br />
Accès à l'emploi des jeunes<br />
même diplômés reste difficile, ils<br />
quitt<strong>en</strong>t le territoire et contribu<strong>en</strong>t<br />
au déficit migratoire régional<br />
Elévation des niveaux et<br />
rattrapage des retards<br />
Adaptations des compét<strong>en</strong>ces<br />
professionnelles dictées par<br />
exig<strong>en</strong>ces d'employabilité des<br />
secteurs <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t. Les<br />
secteurs/branches/filières se<br />
décloisonn<strong>en</strong>t favorisant <strong>la</strong> GPEC<br />
et <strong>la</strong> GPEC Territoriale<br />
Emerg<strong>en</strong>ce d'une dynamique<br />
d'échanges et de concertation<br />
La ré industrialisation et <strong>la</strong><br />
relocalisation favoris<strong>en</strong>t le<br />
mainti<strong>en</strong> des activités de<br />
recherche. Visibilité nationale et<br />
internationale du PRES qui a<br />
<strong>en</strong>gagé des actions structurantes<br />
L’intérim et l'emploi des jeunes<br />
rest<strong>en</strong>t des variables<br />
d'ajustem<strong>en</strong>t, le territoire devi<strong>en</strong>t<br />
"attractif" <strong>pour</strong> les actifs des<br />
régions voisines<br />
Elévation des niveaux de<br />
qualification et avance sur les<br />
autres régions grâce aux<br />
opportunités structurelles<br />
qu'offrait l'économie régionale<br />
Adaptation des qualifications aux<br />
besoins des secteurs reconvertis<br />
et nouveaux (autour de l'Axe<br />
Paris Seine <strong>Normandie</strong><br />
/mer/fleuve/logistique/énergie).<br />
Individu acteur de ses choix et<br />
intégration des exig<strong>en</strong>ces du<br />
développem<strong>en</strong>t durable<br />
Pilotage régionalisé de <strong>la</strong><br />
formation professionnelle via les<br />
contrats régionaux et au sein du<br />
PRES, adaptation de l'offre de<br />
formation aux nouveaux usages -<br />
Structuration et attractivité<br />
r<strong>en</strong>forcée de l'offre de formation<br />
régionale<br />
Pilotage du PRES à l'échelle<br />
interrégionale du projet Paris<br />
Seine <strong>Normandie</strong>, Structuration<br />
et attractivité r<strong>en</strong>forcée de l'offre<br />
de formation supérieure et de <strong>la</strong><br />
recherche régionale<br />
Les femmes font valoir leurs<br />
compét<strong>en</strong>ces d'<strong>en</strong>trée de jeu<br />
dans les secteurs porteurs.<br />
Certains secteurs attir<strong>en</strong>t des flux<br />
<strong>en</strong>trants de main d'œuvre <strong>pour</strong><br />
pallier <strong>la</strong> pénurie<br />
Octobre 2012 147
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
SOCIAL<br />
Offre de soins<br />
Sousvariables<br />
Solvabilité des<br />
politiques de<br />
santé et<br />
Financem<strong>en</strong>t<br />
des risques<br />
dép<strong>en</strong>dance<br />
Prév<strong>en</strong>tion et<br />
Education à <strong>la</strong><br />
santé<br />
Poursuite du<br />
progrès<br />
technique<br />
Démographie<br />
et morbidité<br />
Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Les ressources sont limitées: <strong>la</strong> redéfinition des politiques sociales est une nécessité mais on n’a pas prise localem<strong>en</strong>t sur ces choix<br />
La situation s'est<br />
irrémédiablem<strong>en</strong>t dégradée:<br />
développem<strong>en</strong>t des déserts<br />
médicaux et r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de<br />
l'iniquité dans l'accès aux soins<br />
La prév<strong>en</strong>tion et l'éducation à <strong>la</strong><br />
santé n'exist<strong>en</strong>t plus. Les<br />
pathologies régionales sont de<br />
plus <strong>en</strong> plus lourdes<br />
Réduction des aides à <strong>la</strong><br />
recherche des secteurs <strong>en</strong> pointe<br />
du CHUR. Abs<strong>en</strong>ce de<br />
valorisation des recherches<br />
abouties<br />
Augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> morbidité<br />
avec l’âge<br />
La solvabilité du système de<br />
santé s'est maint<strong>en</strong>ue mais les<br />
retards régionaux sont tels que<br />
les écarts se creus<strong>en</strong>t<br />
Aucun changem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière<br />
de prév<strong>en</strong>tion ce qui creuse les<br />
déséquilibres déjà existant <strong>en</strong>tre<br />
actifs des différ<strong>en</strong>ts secteurs<br />
professionnels<br />
Fléchages des aides locales sur<br />
<strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> pointe du CHUR:<br />
retombées positives des<br />
découvertes<br />
Age et morbidité recul<strong>en</strong>t au<br />
même rythme<br />
Une prise <strong>en</strong> charge du<br />
vieillissem<strong>en</strong>t au niveau national<br />
permet de flécher les moy<strong>en</strong>s sur<br />
les priorités régionales<br />
(prév<strong>en</strong>tion, démographie<br />
médicale…) et les retards<br />
comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à être rattrapés<br />
Régénération des systèmes de<br />
médecine prév<strong>en</strong>tive.<br />
Id<strong>en</strong>tification de secteurs<br />
professionnels ou zones<br />
sco<strong>la</strong>ires prioritaires: les écarts<br />
se réduis<strong>en</strong>t<br />
Généralisation de <strong>la</strong><br />
télémédecine et de <strong>la</strong> télésanté,<br />
recul de l'âge d'apparition des<br />
pathologies<br />
Recul de <strong>la</strong> morbidité avec l'âge<br />
Généralisation de <strong>la</strong> médecine<br />
prév<strong>en</strong>tive. Recul significatif de<br />
certaines pathologies régionales<br />
lourdes<br />
Démographie<br />
médicale<br />
Les déserts médicaux se<br />
développ<strong>en</strong>t<br />
La d<strong>en</strong>sité médicale des<br />
généralistes a régressé d'un<br />
point. Aucune évolution favorable<br />
de <strong>la</strong> d<strong>en</strong>sité des spécialistes<br />
Amélioration de <strong>la</strong> démographie<br />
médicale et contexte d'attractivité<br />
retrouvée. Les inégalités<br />
territoriales dans l'offre de soin<br />
sont limitées<br />
Accès au soin<br />
primaire<br />
L'<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services<br />
d'urg<strong>en</strong>ce est un signe de<br />
"mauvaise santé" d'accès au soin<br />
primaire<br />
Les maisons de santé<br />
développées sont le lieu habituel<br />
d'accès au soin primaire<br />
Adhésion de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
acquise <strong>en</strong> matière de télésanté,<br />
télémédecine, télé exam<strong>en</strong>, e-<br />
prescription: l'accès au soin est<br />
fluide<br />
Octobre 2012 148
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
Variables<br />
Développem<strong>en</strong>t<br />
durable<br />
ENVIRONNEMENTAL<br />
Environn<strong>en</strong>t / Climat<br />
/ Risques<br />
Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Changem<strong>en</strong>ts<br />
climatiques<br />
Energies<br />
Consommation<br />
et production<br />
durable<br />
Conservation<br />
et gestion<br />
durable de <strong>la</strong><br />
biodiversité et<br />
des<br />
ressources<br />
naturelles<br />
Climat et<br />
risques<br />
naturels et/ou<br />
industriels<br />
Repli sur les habitudes : on<br />
puise dans le stock des<br />
ressources naturelles<br />
épuisables. Les émissions<br />
nocives stagn<strong>en</strong>t car l'activité<br />
est fortem<strong>en</strong>t réduite<br />
L'EPR de P<strong>en</strong>ly n'est pas<br />
réalisé faute de financem<strong>en</strong>t.<br />
Les parcs éoli<strong>en</strong>s sont <strong>en</strong><br />
dessous des prévisions<br />
Les coûts dissuasifs de<br />
l'énergie font baisser <strong>la</strong><br />
consommation. L'innovation<br />
n'est plus une priorité et recule<br />
Artificialisation croissante des<br />
sols.<br />
Cloisonnem<strong>en</strong>t des milieux<br />
naturels<br />
Poursuite du réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique qui int<strong>en</strong>sifie les<br />
risques naturels et <strong>la</strong> morbidité<br />
Le déploiem<strong>en</strong>t des énergies<br />
propres n'est pas assez<br />
r<strong>en</strong>table.<br />
Les émissions nocives<br />
s'acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t<br />
La décision de faire l’EPR n’est<br />
pas prise. Les parcs éoli<strong>en</strong>s<br />
sont réalisés avec très peu de<br />
retombées <strong>en</strong> termes d'emploi<br />
régional. Ils ne sont pas <strong>en</strong><br />
proportion suffisante <strong>pour</strong><br />
re<strong>la</strong>yer l'usage des énergies<br />
fossiles<br />
"Une croissance verte"<br />
comm<strong>en</strong>ce à émerger mais le<br />
tissu industriel <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> ne sait pas saisir<br />
cette opportunité<br />
Arrêt de l'érosion de <strong>la</strong><br />
biodiversité mais le SRCE bi<strong>en</strong><br />
qu'appliqué ne permet pas une<br />
restauration des écosystèmes<br />
Poursuite du réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique qui int<strong>en</strong>sifie les<br />
risques naturels et <strong>la</strong> morbidité.<br />
Développem<strong>en</strong>t d'une filière de<br />
gestion et prév<strong>en</strong>tion des<br />
risques industriels<br />
Hausse du coût de l'énergie<br />
Les émissions nocives toujours<br />
importantes sont pondérées par<br />
le développem<strong>en</strong>t des énergies<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles grâce aux<br />
innovations<br />
La décision de faire l’'EPR de<br />
P<strong>en</strong>ly a été tardive et il est <strong>en</strong><br />
chantier. Les parcs éoli<strong>en</strong>s sont<br />
réalisés et les retombées <strong>en</strong><br />
termes d'emploi régional et de<br />
qualification sont fortes<br />
L’innovation favorise le<br />
développem<strong>en</strong>t d’une<br />
« croissance verte ». La <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> comm<strong>en</strong>ce à se<br />
positionner sur e créneau<br />
Amélioration de <strong>la</strong> qualité<br />
paysagère et de <strong>la</strong> biodiversité<br />
<strong>en</strong> s'appuyant sur un SRCE<br />
ambitieux<br />
Frein au réchauffem<strong>en</strong>t<br />
climatique.<br />
Généralisation des PPRT<br />
L'objectif du Gr<strong>en</strong>elle de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (23%<br />
d'énergies de sources<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles) est atteint grâce<br />
aux modifications de<br />
consommation bi<strong>en</strong> intégrées et<br />
à l'accès facile aux énergies<br />
propres<br />
L'EPR est réalisé, les<br />
innovations rapides ont permis<br />
de développer des sources<br />
d'énergies à <strong>la</strong> fois propres et<br />
durables. Les énergies sont<br />
produites <strong>en</strong> quantité suffisante<br />
<strong>pour</strong> répondre aux besoins<br />
économiques régionaux,<br />
nationaux et internationaux<br />
Le long terme est privilégié. Le<br />
durable est ancré dans les<br />
modes de consommation et<br />
intégré aux process industriels<br />
Octobre 2012 149
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Variables Sous-variables Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3 Hypothèse 4<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel<br />
La culture n'est pas une priorité.<br />
Elle n'est pas perçue comme un<br />
outil de développem<strong>en</strong>t du<br />
territoire. Le rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel est <strong>en</strong> déclin<br />
Les territoires développ<strong>en</strong>t des<br />
initiatives <strong>pour</strong> les publics de<br />
proximité. Le rayonnem<strong>en</strong>t est<br />
trop faible <strong>pour</strong> porter l'id<strong>en</strong>tité<br />
du territoire<br />
Concertation et mise <strong>en</strong><br />
cohér<strong>en</strong>ce de tous les échelons.<br />
Les retombées r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le<br />
s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d'appart<strong>en</strong>ance des<br />
(hauts) normands<br />
S1 S2 S3 S4<br />
Octobre 2012 150
Les différ<strong>en</strong>ts sc<strong>en</strong>arii possibles<br />
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES SCENARII<br />
…Nous sommes <strong>en</strong> <strong>2025</strong>…<br />
Résumé du Sc<strong>en</strong>ario S1 : « La spirale du déclin dans un contexte<br />
europé<strong>en</strong> dégradé »<br />
Dans un contexte de récession mondiale et de longue durée, l’Europe a subi une<br />
récession continue jusqu’<strong>en</strong> <strong>2025</strong>. Les caractéristiques socio-économiques<br />
régionales sont telles que <strong>la</strong> région subit de plein fouet <strong>la</strong> crise comme les<br />
régions voisines. Bi<strong>en</strong> que <strong>la</strong> collectivité régionale dispose <strong>en</strong>core d’une marge de<br />
manœuvre <strong>en</strong> matière d’investissem<strong>en</strong>t, celle-ci est rapidem<strong>en</strong>t consommée. Il<br />
n’est pas possible de miser sur le ressort raisonné des acteurs économiques <strong>pour</strong><br />
<strong>en</strong>trevoir des voies de résistance régionale à <strong>la</strong> récession. En l’abs<strong>en</strong>ce de ressort<br />
citoy<strong>en</strong>, c’est le règne du « chacun <strong>pour</strong> soi » et de <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong>tre<br />
territoires. Les grands projets d’infrastructures régionaux ont été abandonnés ;<br />
l’accessibilité dégradée de <strong>la</strong> région et les faibles flux d’échanges l’isol<strong>en</strong>t. Les<br />
retards se creus<strong>en</strong>t dans les domaines de <strong>la</strong> formation et de <strong>la</strong> santé. Le<br />
rayonnem<strong>en</strong>t culturel se dégrade, <strong>la</strong> perte d’image et le peu d’attractivité de <strong>la</strong><br />
région pès<strong>en</strong>t sur le déficit migratoire.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario catastrophe…<br />
Résumé du Sc<strong>en</strong>ario S2 : « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »<br />
Dans une situation de croissance retrouvée, l’amélioration du contexte<br />
économique est avérée au niveau national et mondial. Le souci de<br />
développem<strong>en</strong>t durable guide l’action. Dans ce contexte <strong>pour</strong>tant favorable, <strong>la</strong><br />
région, par excès de prud<strong>en</strong>ce, a insuffisamm<strong>en</strong>t anticipé cette embellie <strong>pour</strong> se<br />
mettre <strong>en</strong> situation de bénéficier de ses retombées. Elle ne tire pas les bénéfices<br />
de <strong>la</strong> croissance retrouvée. <strong>Quel</strong>ques grands équipem<strong>en</strong>ts structurants ont vu le<br />
jour, mais <strong>la</strong> situation et les indicateurs, bi<strong>en</strong> qu’évoluant <strong>en</strong> valeur absolue, ne<br />
se mainti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> valeur re<strong>la</strong>tive car les autres régions ont continué à<br />
progresser : <strong>la</strong> situation <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> se dégrade.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario qu’il faut éviter…<br />
Résumé du Sc<strong>en</strong>ario S3 : « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus<br />
forte ! »<br />
Dans une situation de croissance retrouvée, l’amélioration du contexte<br />
économique est avérée au niveau national et mondial. Le souci de<br />
développem<strong>en</strong>t durable guide l’action, l’effort <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal est intégré et n’a<br />
pas de li<strong>en</strong> direct avec « l’aisance économique ». Dans ce contexte favorable, <strong>la</strong><br />
région a préa<strong>la</strong>blem<strong>en</strong>t anticipé l’embellie générale. Les choix <strong>en</strong> matière de<br />
grands projets structurants <strong>pour</strong> le territoire ont permis, grâce à <strong>la</strong> priorité<br />
donnée à l’accessibilité numérique, de créer les conditions d’un équilibre<br />
territorial et d’une capil<strong>la</strong>rité réussie du projet de développem<strong>en</strong>t Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>. S’inscrivant d’<strong>en</strong>trée dans un grand projet national, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> pr<strong>en</strong>d le devant sur les autres régions.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario audacieux mais néanmoins atteignable…<br />
Octobre 2012 151
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Résumé du Sc<strong>en</strong>ario S4 : « La <strong>Normandie</strong> dans un contexte euphorique »<br />
Dans un contexte de redistribution des cartes au niveau mondial, <strong>la</strong> rationalité<br />
des acteurs économiques est retrouvée et leur confiance restaurée. Le retour à <strong>la</strong><br />
croissance économique mondiale durant une déc<strong>en</strong>nie « glorieuse » a permis un<br />
assainissem<strong>en</strong>t du mouvem<strong>en</strong>t de mondialisation des économies et <strong>la</strong><br />
progression des échanges. Les flux irrigu<strong>en</strong>t tout le territoire régional grâce à <strong>la</strong><br />
réalisation de grands projets d’infrastructures, au mail<strong>la</strong>ge territorial et à <strong>la</strong><br />
multimodalité réussie. Le pot<strong>en</strong>tiel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur et<br />
re<strong>la</strong>yé par une stratégie off<strong>en</strong>sive à l’international, une prés<strong>en</strong>ce institutionnelle<br />
forte aux côtés des ag<strong>en</strong>ts économiques dans les champs des grands projets, de<br />
<strong>la</strong> formation, de l’innovation, de <strong>la</strong> santé, du développem<strong>en</strong>t durable.<br />
L’attractivité retrouvée permet d’inverser les flux migratoires. Le dynamisme<br />
territorial est porteur du développem<strong>en</strong>t équilibré du territoire et respectueux de<br />
<strong>la</strong> qualité de vie. La région réinv<strong>en</strong>te <strong>pour</strong> poser des bases et anticiper sur<br />
l’av<strong>en</strong>ir.<br />
C’est le sc<strong>en</strong>ario euphorique et idéal … mais dont il faut craindre les pièges<br />
Octobre 2012 152
Sc<strong>en</strong>ario 1<br />
PRESENTATION DETAILLEE DES SCENARII<br />
I -<br />
Sc<strong>en</strong>ario S1 : « La spirale du déclin dans un contexte europé<strong>en</strong><br />
dégradé »<br />
P<strong>en</strong>dant plus d'une déc<strong>en</strong>nie, les pays ont connu une baisse quasi-continue du<br />
PIB. Cette récession, sans précéd<strong>en</strong>t du fait de son caractère de longue période,<br />
a été structurelle suite aux crises financières mondiales et de <strong>la</strong> dette<br />
europé<strong>en</strong>ne.<br />
Dans l'analyse qui suit, <strong>la</strong> récession s'est installée après <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d'une<br />
politique budgétaire et économique très restrictive dans le seul but de diminuer<br />
<strong>la</strong> dette de l'État et des différ<strong>en</strong>tes collectivités territoriales, <strong>en</strong>traînant des<br />
coupes sombres dans les secteurs d'actions des pouvoirs publics et, notamm<strong>en</strong>t,<br />
dans les politiques sociales. Ce but est affirmé égalem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> les autres ag<strong>en</strong>ts<br />
économiques privés (<strong>en</strong>treprises non financières et ménages).<br />
Cette récession aurait pu avoir <strong>pour</strong> origine d'autres facteurs ou une<br />
accumu<strong>la</strong>tion d'élém<strong>en</strong>ts défavorables ou d'aléas : L'implosion de l'Europe, avec<br />
une très forte baisse des re<strong>la</strong>tions économiques internes et un retour aux<br />
monnaies nationales fortem<strong>en</strong>t soumises aux marchés.<br />
Ce changem<strong>en</strong>t radical aurait pu se produire via les échanges commerciaux et<br />
aurai<strong>en</strong>t eu les mêmes effets :<br />
• soit une mondialisation sans contrôle conduisant à une concurr<strong>en</strong>ce sauvage<br />
<strong>en</strong>tre les zones et les pays reposant sur <strong>la</strong> minimisation des coûts,<br />
notamm<strong>en</strong>t sociaux ;<br />
• soit une rupture brutale dans le mouvem<strong>en</strong>t de mondialisation des économies<br />
avec un retour rapide au protectionnisme (droits de douanes, quotas,<br />
normes,...) ;<br />
• une guerre, plus ou moins localisée, nécessitant des interv<strong>en</strong>tions des pays<br />
les plus riches ou des t<strong>en</strong>sions politiques mondiales réduisant le commerce<br />
<strong>en</strong>tre les pays.<br />
Dans cette analyse, les échanges commerciaux internationaux se réduis<strong>en</strong>t sous<br />
l’effet de <strong>la</strong> récession mondiale touchant davantage les pays les moins<br />
développés que les plus avancés. L'Europe, <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
subiss<strong>en</strong>t, sans pouvoir les atténuer, les effets socioéconomiques de <strong>la</strong> crise.<br />
Dans un contexte économique extrêmem<strong>en</strong>t défavorable, <strong>la</strong> règle du chacun <strong>pour</strong><br />
soi est de mise. Les coupes sombres budgétaires au niveau le plus c<strong>en</strong>tralisé ont<br />
eu <strong>pour</strong> conséqu<strong>en</strong>ce directe une diminution des dotations de l’Etat aux<br />
collectivités territoriales.<br />
Alors que le mot d’ordre est « <strong>pour</strong> dép<strong>en</strong>ser moins, mutualisons », les<br />
collectivités territoriales n’ont plus ri<strong>en</strong> à mutualiser. Les projets territoriaux<br />
s’annu<strong>la</strong>nt, il n’y a plus de gouvernance des territoires. Les grands projets sont<br />
rangés au rayon des souv<strong>en</strong>irs.<br />
C’est le règne de <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce à outrance <strong>en</strong>tre les territoires. Les inégalités<br />
<strong>en</strong>tre régions s’acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t. Il n’y a plus de solidarités territoriales.<br />
Octobre 2012 153
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
1/ Les grands projets d'infrastructure<br />
Les grands projets d'infrastructure haut-normands – modernisation des ports,<br />
couverture numérique, contournem<strong>en</strong>t Rou<strong>en</strong>-est, LNPN - n'ont pas été réalisés.<br />
Globalem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> région haut-normande subit une dégradation de ses<br />
infrastructures, provoquant une réduction de <strong>la</strong> mobilité et des flux, notamm<strong>en</strong>t<br />
de marchandises, qui contourn<strong>en</strong>t le territoire.<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et les raccordem<strong>en</strong>ts autoroutiers n'ont pas été réalisés,<br />
provoquant des <strong>en</strong>gorgem<strong>en</strong>ts et des bouchons malgré une diminution du trafic<br />
dû au manque d’activités. Les accid<strong>en</strong>ts se multipli<strong>en</strong>t sur des lignes saturées et<br />
obsolètes. Les dessertes fret sont quasi inexistantes.<br />
Les travaux de mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine ne sont pas réalisés, le<br />
Canal Seine Nord est opérationnel. Les parts de marché sont prises par les ports<br />
du Nord. Port 2000 ne se développe pas et les ports secondaires ont r<strong>en</strong>oncé au<br />
cabotage. Les liaisons transmanche se font désormais par Ca<strong>la</strong>is et Saint Malo<br />
Il n'y a pas eu d’accord <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t d'un aéroport unique. Ainsi, les<br />
liaisons nécessaires à <strong>la</strong> survie de Deauville n'ont pas été réalisées. L’accessibilité<br />
à Roissy est de plus <strong>en</strong> plus difficile.<br />
Le développem<strong>en</strong>t du Haut débit ne se fait pas. Les zones b<strong>la</strong>nches ne sont pas<br />
résorbées faute de r<strong>en</strong>tabilité <strong>pour</strong> les opérateurs.<br />
La construction de l’EPR à P<strong>en</strong>ly ne s'est pas faite <strong>en</strong> <strong>2025</strong>. Il n’y a eu aucune<br />
retombée positive <strong>en</strong> termes d'emplois ou de qualification de ce grand projet et<br />
un site <strong>en</strong> moins <strong>pour</strong> les capacités de <strong>la</strong> région à s'approvisionner <strong>en</strong> énergie. En<br />
contrepartie, on a gagné une "paix" <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale!<br />
Dans une période de rareté des financem<strong>en</strong>ts, les investissem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
infrastructures sont limités et soumis à des évaluations comptables strictes. Les<br />
grands projets régionaux ont été <strong>en</strong> partie abandonnés <strong>pour</strong> des questions<br />
budgétaires. Si le projet portuaire a été <strong>en</strong> partie réalisé, de façon à maint<strong>en</strong>ir<br />
notre prés<strong>en</strong>ce dans les échanges économiques, les autres projets<br />
d’infrastructure de transport ferroviaire et d’équipem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> haut débit de notre<br />
territoire n’ont pas été concrétisés.<br />
2/ Le déclin économique<br />
Les acteurs politiques et économiques ont été dans l'incapacité de juguler <strong>la</strong> (les)<br />
crise(s), par l'abs<strong>en</strong>ce d’alternatives efficaces et par <strong>la</strong> persistance d’un<br />
<strong>en</strong>chainem<strong>en</strong>t crise/légère reprise.<br />
Les délocalisations dans le secteur industriel se <strong>pour</strong>suiv<strong>en</strong>t et affect<strong>en</strong>t <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> dans tous ses secteurs traditionnels, seul se développe le tertiaire<br />
résid<strong>en</strong>tiel (à l’instar des situations grecque et espagnole depuis 2008).<br />
Il est évid<strong>en</strong>t qu'une récession sur longue période s'accompagne de<br />
restructurations massives dans les activités du secteur industriel traditionnel<br />
(automobile, métallurgie, pétrochimie,...) et le bâtim<strong>en</strong>t, mais aussi les activités<br />
nouvelles (aéronautique, chimie fine, équipem<strong>en</strong>ts de transport, énergies<br />
r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles) n'ont pas été suffisamm<strong>en</strong>t développées, voire se sont affaiblies<br />
par manque d'investissem<strong>en</strong>t public <strong>en</strong> infrastructures.<br />
Dans ce contexte, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> qui prés<strong>en</strong>te une situation atypique au<br />
niveau de <strong>la</strong> qualification des hommes et de ses caractéristiques industrielles et<br />
agricoles <strong>pour</strong> l’ess<strong>en</strong>tiel tournées vers les échanges extérieurs, décroît plus vite<br />
que d’autres régions.<br />
Octobre 2012 154
Sc<strong>en</strong>ario 1<br />
Ces restructurations conduis<strong>en</strong>t donc à une forte croissance du chômage par des<br />
destructions massives d'emplois qualifiés et non qualifiés. 43<br />
La croissance d'un chômage « industriel » se propage au secteur tertiaire<br />
marchand dans les secteurs de <strong>la</strong> logistique industrielle (activités portuaires,<br />
transport de marchandises,...) mais aussi dans les activités de proximité (aide<br />
ménagère, jardinier, petits boulots,...) <strong>en</strong> passant égalem<strong>en</strong>t par le commerce.<br />
De plus, le coût élevé de l’énergie freine l’activité économique. Les filières<br />
traditionnelles qui compos<strong>en</strong>t l’id<strong>en</strong>tité industrielle dominante de notre région :<br />
secteur automobile, pièces détachées aéronautique et spatial, verre, pétrochimie,<br />
pharmacie, n’ont pas <strong>en</strong>tamé les mutations nécessaires faute d’investissem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> recherches et développem<strong>en</strong>t, d’abs<strong>en</strong>ce de repr<strong>en</strong>eurs pot<strong>en</strong>tiels<br />
d'<strong>en</strong>treprises, de perte de savoirs faire et de compét<strong>en</strong>ces, d’abs<strong>en</strong>ce de<br />
qualification de <strong>la</strong> main-d’œuvre vieillissante. Les PME et PMI régionales fragiles,<br />
manquant de capacité novatrice, ont progressivem<strong>en</strong>t disparu et les moins<br />
fragiles qui rest<strong>en</strong>t prés<strong>en</strong>tes sur le territoire, fonctionn<strong>en</strong>t de façon cloisonnée,<br />
celles qui sont sur des créneaux pointus sont peu accompagnées dans <strong>la</strong><br />
valorisation de leurs activités.<br />
L’introduction des nouvelles technologies s’est heurtée au manque de moy<strong>en</strong>s et<br />
aux difficultés d’acceptation sociale des changem<strong>en</strong>ts. Les services sous<br />
représ<strong>en</strong>tés dans <strong>la</strong> région, y compris le tertiaire supérieur, ne se sont pas<br />
développés mis à part le tertiaire de proximité.<br />
La baisse de l'emploi dans l'économie se traduit par des pressions fortes à <strong>la</strong><br />
baisse des sa<strong>la</strong>ires et de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital. La baisse des sa<strong>la</strong>ires freine<br />
fortem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> consommation des ménages amplifiant le processus récessionniste.<br />
Certaines consommations de base ne peuv<strong>en</strong>t plus être achetées par les plus<br />
démunis. 20% à 25% des ménages français peuv<strong>en</strong>t être considérés comme<br />
vivant au seuil de pauvreté ou <strong>en</strong> dessous (13% des ménages <strong>en</strong> 2012). Ils sont<br />
confrontés aux problèmes de logem<strong>en</strong>t, des coûts de l'eau et de l’accès à<br />
l’énergie.<br />
La montée du chômage se traduit par un allongem<strong>en</strong>t de sa durée mais aussi par<br />
une nécessaire diminution de l'indemnisation <strong>en</strong> niveau et dans le temps. La<br />
précarisation du travail se r<strong>en</strong>force <strong>pour</strong> l'<strong>en</strong>semble de <strong>la</strong> société, tous secteurs<br />
et toutes qualifications confondus (exemple des économies grecque, espagnole et<br />
itali<strong>en</strong>ne).<br />
La baisse de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital productif freine l'investissem<strong>en</strong>t des<br />
<strong>en</strong>treprises qui pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t du retard dans de multiples domaines (R&D,<br />
innovations, compétitivité,...). Ce mouvem<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t fort dans les<br />
grandes <strong>en</strong>treprises se propage égalem<strong>en</strong>t aux PMI, notamm<strong>en</strong>t les soustraitantes.<br />
Le tissus artisanal, bi<strong>en</strong> que touché par <strong>la</strong> crise, semble mieux résister<br />
du fait d'une « relocalisation » de certaines activités. Cep<strong>en</strong>dant, cette baisse de<br />
r<strong>en</strong>tabilité du capital fait que les firmes multinationales réori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t leurs capitaux<br />
vers des zones d'investissem<strong>en</strong>t plus r<strong>en</strong>tables, ce qui pénalise davantage notre<br />
système manufacturier manquant de capitaux.<br />
3/ Formation et société de <strong>la</strong> connaissance<br />
Le pilotage de <strong>la</strong> formation professionnelle reste cloisonné <strong>en</strong>tre acteurs<br />
interv<strong>en</strong>ants (Etat, Région Pôle emploi, Entreprises et part<strong>en</strong>aires sociaux…) et <strong>la</strong><br />
formation souffre de moy<strong>en</strong>s restreints.<br />
43 Cf. Fiche variable sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion croissance / chômage <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Octobre 2012 155
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
L’accès à des formations spécialisées est dev<strong>en</strong>u plus difficile. Le retour sur un<br />
investissem<strong>en</strong>t individuel de formation étant plus faible et peu probable sur<br />
longue période, les jeunes sort<strong>en</strong>t plus tôt du système de formation r<strong>en</strong>forçant <strong>la</strong><br />
dichotomie de <strong>la</strong> société. Le travail « non officiel » (hors de <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />
officielle) s'accroît fortem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> permettant à certains actifs, d’une part, de<br />
pallier l'urg<strong>en</strong>ce pécuniaire ou de compléter les sa<strong>la</strong>ires perçus dans leur emploi<br />
et aux <strong>en</strong>treprises, d’autre part, de limiter leurs coûts de production.<br />
On assiste à une concurr<strong>en</strong>ce exacerbée <strong>en</strong>tre les « campus » (au s<strong>en</strong>s d’un<br />
grand site sci<strong>en</strong>tifique à visibilité internationale), générant une dilution et un<br />
recul de <strong>la</strong> recherche régionale dans un contexte de mondialisation de <strong>la</strong><br />
recherche. La déréglem<strong>en</strong>tation sauvage du marché de <strong>la</strong> recherche est <strong>la</strong><br />
conséqu<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> défici<strong>en</strong>ce des financem<strong>en</strong>ts publics. Les financem<strong>en</strong>ts<br />
vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de l’Europe, dessaisissant les Etats de leurs compét<strong>en</strong>ces « recherche »<br />
(fin du secteur public de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur et de <strong>la</strong> recherche) et<br />
favorisant fortem<strong>en</strong>t les chercheurs et <strong>la</strong>boratoires anglo-saxons.<br />
L’aptitude à p<strong>en</strong>ser qu’on doit se former <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce Tout au Long de <strong>la</strong> Vie<br />
(TLV) n’est pas développée. La notion de contrat de travail « TLV » n’est<br />
certainem<strong>en</strong>t pas d’actualité. Le travail des s<strong>en</strong>iors n’est pas <strong>la</strong> priorité (ils<br />
pâtiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong> premier lieu des difficultés économiques).<br />
Les citoy<strong>en</strong>s subiss<strong>en</strong>t de plein fouet, sans solution alternative, <strong>la</strong> réduction de<br />
l’offre de services publics aux citoy<strong>en</strong>s sur le territoire. Il n'y a pas de dialogue<br />
citoy<strong>en</strong> et peu de dialogue social, dans une situation de repli sur soi et<br />
d’individualisme.<br />
On assiste à une accélération du mouvem<strong>en</strong>t de « ghettoïsation » dans certaines<br />
villes avec une montée des incivilités (dégradation des bi<strong>en</strong>s publics et privés),<br />
des viol<strong>en</strong>ces (crimes, vols, viol<strong>en</strong>ces conjugales,...), des externalités négatives<br />
(drogues, prostitution, alcoolisme,...) à l’instar des situations les pays de l'est<br />
dans <strong>la</strong> « perestroïka », notamm<strong>en</strong>t Russie 1990-1999.<br />
L’état et les régions subiss<strong>en</strong>t les contrecoups de cette évolution économique.<br />
L'État a vu ses recettes fiscales diminuer (baisse des rev<strong>en</strong>us des ménages,<br />
baisse de <strong>la</strong> consommation, une évolution de l’épargne dép<strong>en</strong>dant à <strong>la</strong> fois d’un<br />
motif de précaution et d’un épuisem<strong>en</strong>t du bas de <strong>la</strong>ine <strong>pour</strong> certaines catégories<br />
les plus défavorisées) et s’est retrouvé, de façon plus prégnante face à <strong>la</strong> crise<br />
de <strong>la</strong> dette (déficit budgétaire, accroissem<strong>en</strong>t du rapport dette/PIB). Par<br />
conséqu<strong>en</strong>t, il a dû alors diminuer très fortem<strong>en</strong>t ses dép<strong>en</strong>ses, notamm<strong>en</strong>t<br />
sociales, ce qui a exacerbé les effets de <strong>la</strong> crise.<br />
Les régions et les collectivités territoriales ont subi les mêmes évolutions,<br />
obligées de réduire leurs charges (personnel, consommation, investissem<strong>en</strong>ts et<br />
transferts), ce qui a conduit à une détérioration de l'<strong>en</strong>semble de l'offre régionale<br />
vis-à-vis des citoy<strong>en</strong>s (exemple des dégradation des structures et des services<br />
publics <strong>en</strong> Angleterre et aux États-Unis)<br />
En ce qui concerne les politiques sociales, les ressources sont limitées et leur<br />
redéfinition est dev<strong>en</strong>ue une nécessité. Le système social est mis à mal puisque<br />
les cotisations sont à <strong>la</strong> baisse due à une diminution des cotisants, des sa<strong>la</strong>ires et<br />
aussi à des non paiem<strong>en</strong>ts de cotisations (<strong>en</strong>treprises et ménages) ou à des<br />
exonérations de charges permettant de maint<strong>en</strong>ir mom<strong>en</strong>taném<strong>en</strong>t <strong>en</strong> survie<br />
certaines <strong>en</strong>treprises ou certains secteurs. La prise <strong>en</strong> charge devi<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong><br />
plus difficile <strong>pour</strong> les régions malgré une réduction drastique des dép<strong>en</strong>ses<br />
sociales (santé, famille, handicapés et troisième âge dép<strong>en</strong>dant, pauvreté,<br />
formation). Dans ce contexte économique tellem<strong>en</strong>t dégradé, <strong>la</strong> Région <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> est dev<strong>en</strong>ue un désert médical car les évolutions nécessaires n’ont pu<br />
être mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce.<br />
Octobre 2012 156
Sc<strong>en</strong>ario 1<br />
Il n’y a pas suffisamm<strong>en</strong>t de ressources, y compris <strong>pour</strong> <strong>la</strong> « prév<strong>en</strong>tion », elle<br />
est <strong>en</strong> baisse, amplifiée par <strong>la</strong> précarité des ménages qui rogn<strong>en</strong>t sur les<br />
dép<strong>en</strong>ses de santé.<br />
Les contraintes exercées sur l’offre et <strong>la</strong> demande de soins n’ont pas abouti et <strong>la</strong><br />
réduction des dép<strong>en</strong>ses s’opère par une discrimination dans l’accès aux soins<br />
<strong>en</strong>tre les popu<strong>la</strong>tions et les territoires haut normands. L’offre de soins se<br />
détériore sous l’effet d’une réduction des financem<strong>en</strong>ts. L’accès aux soins est à<br />
deux vitesses du fait qu’une partie de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion finance d’elle-même son<br />
accès aux soins et qu’une autre partie r<strong>en</strong>once, partiellem<strong>en</strong>t ou totalem<strong>en</strong>t, aux<br />
soins. 44<br />
En matière de prév<strong>en</strong>tion, <strong>la</strong> médecine du travail et <strong>la</strong> médecine sco<strong>la</strong>ire<br />
(fortem<strong>en</strong>t déficitaires <strong>en</strong> France), de même que l’éducation à <strong>la</strong> santé ont<br />
disparu totalem<strong>en</strong>t, ce qui a conduit à une amplification déjà perceptible <strong>en</strong> <strong>2025</strong><br />
des pathologies dans <strong>la</strong> région.<br />
Les progrès techniques dans le domaine de <strong>la</strong> santé s’opèr<strong>en</strong>t au rythme des<br />
possibilités dont dispos<strong>en</strong>t les chercheurs, y compris ceux des secteurs <strong>en</strong> pointe<br />
au CHUR qui dispos<strong>en</strong>t de moy<strong>en</strong>s limités et de peu d’aide à <strong>la</strong> valorisation de<br />
leurs recherches.<br />
Les années gagnées <strong>en</strong> âge sont des années qui voi<strong>en</strong>t apparaître des<br />
pathologies. Ainsi, <strong>la</strong> morbidité augm<strong>en</strong>te.<br />
En matière de démographie médicale, sous l’effet conjugué :<br />
• de <strong>la</strong> pyramide des âges peu favorable des professionnels de santé,<br />
• des lobbies qui ont continué d’agir <strong>pour</strong> empêcher <strong>la</strong> règlem<strong>en</strong>tation des<br />
instal<strong>la</strong>tions,<br />
• d’un système dichotomique d’accès aux soins qui s’est installé avec <strong>la</strong><br />
récession.<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, déjà pauvre <strong>en</strong> pratici<strong>en</strong>s, n’a plus aucune attractivité <strong>pour</strong><br />
les professionnels de santé. Les déserts médicaux d’étudiants et de<br />
professionnels se sont amplifiés <strong>en</strong> France et particulièrem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> région.<br />
Le système continue de fonctionner avec un nombre croissant de médecins<br />
étrangers dont il ne peut se passer. L’<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services des urg<strong>en</strong>ces<br />
reste un élém<strong>en</strong>t significatif de <strong>la</strong> dégradation du système et un signe de<br />
mauvaise santé limitant l’accès aux soins primaires.<br />
4/ Les évolutions <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales et l'offre énergétique<br />
Sur le p<strong>la</strong>n <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal, les effets peuv<strong>en</strong>t se contreba<strong>la</strong>ncer. D'un côté, <strong>la</strong><br />
diminution de <strong>la</strong> production et des services liés a conduit à une réduction des<br />
nuisances (pollution de l'air, de l'eau, nuisances sonores,...). Cep<strong>en</strong>dant, les<br />
<strong>en</strong>treprises cherch<strong>en</strong>t à minimiser les coûts de production <strong>pour</strong> être plus<br />
compétitives sur les marchés, ce qui <strong>en</strong>traîne un r<strong>en</strong>oncem<strong>en</strong>t aux bonnes<br />
pratiques de protection de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (baisse de l’investissem<strong>en</strong>t dans des<br />
démarches de développem<strong>en</strong>t durable).<br />
La crise conduit <strong>en</strong> effet à s’affranchir des considérations <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales et à<br />
puiser dans le plus simple : le stock de ressources naturelles épuisables plutôt<br />
que d’investir dans les énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles. On assiste au repli sur les<br />
habitudes acquises le déclin économique favorisant les stratégies à court terme<br />
au détrim<strong>en</strong>t du long terme.<br />
44 Cf. fiche variable Offre de Soins (politiques sociales et leurs problèmes de financem<strong>en</strong>t)<br />
Octobre 2012 157
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
La crise économique fait que les coûts de consommation d’énergies sont<br />
difficiles, voire impossibles, à supporter par les ménages. Ils réduis<strong>en</strong>t ainsi leur<br />
consommation d’énergies.<br />
La baisse de <strong>la</strong> production limite les nuisances et le recours aux ressources<br />
naturelles et matières premières, mais <strong>la</strong> préoccupation <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale n’est<br />
plus prioritaire face à l’exig<strong>en</strong>ce de survie de l’<strong>en</strong>treprise. Le court terme est<br />
privilégié.<br />
Toutefois, plus <strong>la</strong> crise économique dure, plus <strong>la</strong> production industrielle décline<br />
et, par conséqu<strong>en</strong>t, plus <strong>la</strong> consommation d’énergies fossiles et les nuisances qui<br />
<strong>en</strong> découl<strong>en</strong>t déclin<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t.<br />
Il est à noter égalem<strong>en</strong>t que l’innovation recule <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> puisque les<br />
ressources économiques sont conc<strong>en</strong>trées sur le mainti<strong>en</strong> du tissu industriel. Le<br />
déca<strong>la</strong>ge <strong>en</strong>tre les régions qui ont misées sur l’innovation (Rhône-Alpes par<br />
exemple) et celles qui n’ont pu assumer financièrem<strong>en</strong>t le coût de l’innovation,<br />
s’acc<strong>en</strong>tue.<br />
L’artificialisation du territoire se <strong>pour</strong>suit, les ménages habitants de plus <strong>en</strong> plus<br />
loin <strong>pour</strong> des raisons de coût du foncier. Ce<strong>la</strong> <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dre une perte de ressources<br />
naturelles et agricoles et une imperméabilisation des sols, généralem<strong>en</strong>t<br />
irréversible. Elle s’accompagne d’une fragm<strong>en</strong>tation et d’un cloisonnem<strong>en</strong>t des<br />
milieux naturels défavorables à de nombreuses espèces. C’est <strong>la</strong> conséqu<strong>en</strong>ce<br />
écologique de <strong>la</strong> périurbanisation.<br />
Le réchauffem<strong>en</strong>t climatique se <strong>pour</strong>suit avec une augm<strong>en</strong>tation supérieure à 2°<br />
des températures (schéma t<strong>en</strong>danciel). Il est dû principalem<strong>en</strong>t à l'accroissem<strong>en</strong>t<br />
des émissions de GES (croissance démographique des pays les moins développés<br />
et pas de réduction des émissions américaines). Il est constaté égalem<strong>en</strong>t<br />
l’augm<strong>en</strong>tation du niveau de <strong>la</strong> mer (inondations et sécheresses).<br />
Les constructions <strong>en</strong> zone à risques sont maint<strong>en</strong>ues et toujours habitées. On<br />
att<strong>en</strong>d <strong>la</strong> catastrophe climatique … Les zones côtières sont particulièrem<strong>en</strong>t<br />
touchées par <strong>la</strong> dégradation naturelle.<br />
La vision à court terme ne permet pas de dépolluer ou transformer les sites de<br />
productions c<strong>la</strong>ssés. Les coûts d’assurance des risques ne font que croître<br />
contraignant certains pans de l’économie à <strong>la</strong> fermeture. La morbidité (par<br />
ma<strong>la</strong>dies infectieuses) des habitants est accrue, voire amplifiée, par <strong>la</strong> pollution.<br />
5/ Les flux migratoires<br />
Dans cette période de rareté des financem<strong>en</strong>ts, faute de réalisation des grands<br />
projets régionaux, <strong>la</strong> Région apparait comme moins dynamique par rapport à<br />
d’autres, notamm<strong>en</strong>t l’Ile de France : elle subit une perte d’image et une<br />
émigration territoriale des jeunes les plus qualifiés.<br />
Les conditions de vie se sont dégradées et <strong>la</strong> mortalité est <strong>en</strong> hausse, le solde<br />
naturel de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion décroît ; le solde migratoire négatif s’est acc<strong>en</strong>tué faute<br />
d’attractivité suffisante de <strong>la</strong> région, les jeunes <strong>en</strong> partant. On connaît les<br />
prémices d’une accélération de <strong>la</strong> baisse de <strong>la</strong> natalité qui s’acc<strong>en</strong>tuera dans les<br />
années ultérieures. La cassure de <strong>la</strong> croissance de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion normande<br />
annoncée <strong>pour</strong> 2020 s’est produite et <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> connaît un<br />
fléchissem<strong>en</strong>t de sa croissance démographique.<br />
Au sein du territoire, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion peut soit se conc<strong>en</strong>trer autour des grands<br />
bassins d’emplois et favoriser une périurbanisation massive et mal maîtrisée<br />
(détérioration du bi<strong>en</strong> être individuel et global), soit un repli sur les zones rurales<br />
où des circuits courts sont recréés permettant d’éviter un niveau de pauvreté<br />
absolue.<br />
Octobre 2012 158
Sc<strong>en</strong>ario 1<br />
6/ le rayonnem<strong>en</strong>t culturel et <strong>la</strong> « gouvernance » régionale<br />
La culture n’est pas reconnue comme outil d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire. Le<br />
rayonnem<strong>en</strong>t culturel se dégrade. Les décideurs politiques et acteurs culturels ne<br />
parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas à dépasser leurs intérêts locaux ou disciplinaires. La raréfaction<br />
des moy<strong>en</strong>s <strong>en</strong>traîne bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> fin de « l’exception culturelle à <strong>la</strong> Française ». La<br />
paupérisation l’emporte par manque d’ambition des pouvoirs publics qui n’ont<br />
pas déployé une « vision d’av<strong>en</strong>ir » <strong>pour</strong> le territoire suffisamm<strong>en</strong>t tôt, au<br />
mom<strong>en</strong>t où les tournants majeurs s’esquissai<strong>en</strong>t : besoin de rationalisation,<br />
besoin d’adaptation à l’évolution des pratiques et des att<strong>en</strong>tes des publics liées<br />
au développem<strong>en</strong>t du numérique. Cep<strong>en</strong>dant, les habitants du territoire se<br />
réorganis<strong>en</strong>t et mobilis<strong>en</strong>t leur capacité de création.<br />
Octobre 2012 159
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 160
Sc<strong>en</strong>arii S2 et S3<br />
Contexte global des sc<strong>en</strong>arii c<strong>en</strong>traux S2 et S3<br />
1/ Situation internationale<br />
Dés<strong>en</strong>dettem<strong>en</strong>t et croissance retrouvée<br />
Après une période de crise financière et économique (2007 – 2014), les Etats ont<br />
pris consci<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> nécessité d'une certaine solidarité <strong>en</strong>tre les grandes zones<br />
économiques et <strong>en</strong>tre les nations.<br />
Les dettes des Etats à hauts rev<strong>en</strong>us (Etats-Unis, Europe) ont été « épongées »<br />
partiellem<strong>en</strong>t par les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t qui avai<strong>en</strong>t constitué des stocks de<br />
dol<strong>la</strong>rs et d'euros (« trésors de guerre ») avant et p<strong>en</strong>dant <strong>la</strong> période de crise,<br />
mais égalem<strong>en</strong>t par l'inf<strong>la</strong>tion du fait d'un desserrem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> politique de<br />
création monétaire, notamm<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> part de <strong>la</strong> Banque C<strong>en</strong>trale europé<strong>en</strong>ne.<br />
Les pays europé<strong>en</strong>s ont égalem<strong>en</strong>t « internalisé » une partie de leurs dettes à<br />
long terme, par un financem<strong>en</strong>t direct auprès des ag<strong>en</strong>ts économiques privés<br />
(<strong>en</strong>treprises non financières et ménages) qui ont repris confiance dans l'av<strong>en</strong>ir.<br />
2/ Situation <strong>en</strong> Europe et situation nationale<br />
Pour éviter de fortes t<strong>en</strong>sions sociales, l'Union europé<strong>en</strong>ne a mis <strong>en</strong> œuvre un<br />
pacte de croissance, permettant de lutter efficacem<strong>en</strong>t contre le chômage, sur <strong>la</strong><br />
zone économique. La croissance économique mondiale permet une croissance<br />
des rev<strong>en</strong>us du travail et du capital re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t homogène et plus rapide dans<br />
les pays <strong>en</strong> développem<strong>en</strong>t à niveau de rev<strong>en</strong>u moy<strong>en</strong>, ce qui améliore <strong>la</strong><br />
compétitivité de l'Europe sur les marchés étrangers. De plus, les progrès<br />
techniques, <strong>en</strong>registrés dans nos économies, permett<strong>en</strong>t une croissance des<br />
échanges à forte valeur ajoutée non seulem<strong>en</strong>t dans l'Union europé<strong>en</strong>ne mais<br />
aussi dans le monde <strong>en</strong>tier. Ces échanges sont de moins <strong>en</strong> moins freinés par<br />
des mesures protectionnistes.<br />
L'Europe s'est r<strong>en</strong>forcée p<strong>en</strong>dant toute cette période, s'étant considérablem<strong>en</strong>t<br />
dés<strong>en</strong>dettée du moins <strong>en</strong> valeur re<strong>la</strong>tive (dette / PIB). Elle apparaît beaucoup<br />
moins s<strong>en</strong>sible aux évolutions des marchés financiers dont l'activité a été plus<br />
<strong>en</strong>cadrée et contrôlée. Des pays (Grèce, Espagne,..) sort<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t de<br />
<strong>la</strong> crise, même si des difficultés économiques et sociales subsist<strong>en</strong>t (chômage<br />
<strong>en</strong>core élevé). De nombreux pays de <strong>la</strong> zone euro ont pu stabiliser, voire<br />
augm<strong>en</strong>ter, leurs dép<strong>en</strong>ses étatiques dans le domaine social et <strong>la</strong> formation.<br />
Cette période de croissance économique mondiale, retrouvée mais modérée, a<br />
conduit à une réduction des t<strong>en</strong>sions politiques aussi bi<strong>en</strong> mondiales qu'internes<br />
aux différ<strong>en</strong>ts zones et pays. Les pays les moins riches au début de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie<br />
2010 ont connu égalem<strong>en</strong>t une amélioration de leur situation respective, ce qui a<br />
permis de r<strong>en</strong>forcer <strong>la</strong> demande mondiale. Le progrès technique et l’exploitation<br />
de nouveaux facteurs de production et de sources d'énergies, respectueuses des<br />
problématiques <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales, ont permis de limiter les t<strong>en</strong>sions sur les prix<br />
et ainsi, favoriser le développem<strong>en</strong>t harmonieux de <strong>la</strong> production mondiale.<br />
L'Europe et <strong>la</strong> France tir<strong>en</strong>t leur épingle du jeu de ce contexte économique<br />
favorable.<br />
Dans cette conjoncture, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> peut pr<strong>en</strong>dre deux chemins de<br />
croissance différ<strong>en</strong>ts :<br />
- le premier chemin (sc<strong>en</strong>ario S2) correspond à une faible anticipation de<br />
l'évolution globale. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a été très hésitante dans son<br />
Octobre 2012 161
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
anticipation des évolutions des marchés tant dans les activités traditionnelles<br />
que nouvelles et porteuses de croissance. Elle a donc vu son poids économique<br />
et son positionnem<strong>en</strong>t s'affaiblir par rapport aux régions voisines et notamm<strong>en</strong>t<br />
par rapport à l'Ile de France. Sa situation re<strong>la</strong>tive se détériore ;<br />
- le deuxième chemin (sc<strong>en</strong>ario S3) correspond à une bonne anticipation de<br />
l'évolution globale. Par exemple, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a été extrêmem<strong>en</strong>t<br />
réactive et a anticipé les évolutions des marchés tant dans les activités<br />
traditionnelles que nouvelles et porteuses de croissance. Elle a donc r<strong>en</strong>forcé<br />
son poids économique et son positionnem<strong>en</strong>t par rapport aux régions voisines<br />
et à l'Ile de France. Sa situation re<strong>la</strong>tive s'améliore.<br />
Octobre 2012 162
Sc<strong>en</strong>ario S2<br />
II - Sc<strong>en</strong>ario 2 : « Affaiblissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a peu anticipé l'amélioration de <strong>la</strong> conjoncture économique<br />
nationale et mondiale et les évolutions des marchés. Le contexte de <strong>la</strong> politique<br />
régionale s'est détérioré. Même si <strong>la</strong> politique étatique dans <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie<br />
précéd<strong>en</strong>te a t<strong>en</strong>té de contribuer au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t du poids des régions, <strong>la</strong><br />
décision publique est prise à un niveau inférieur et notamm<strong>en</strong>t dans les<br />
communautés d'agglomération. La Région n'a qu'un rôle d’animation des<br />
initiatives ; son « leadership » est remis <strong>en</strong> cause et contrôlé par les<br />
communautés, tout particulièrem<strong>en</strong>t les plus grandes : Rou<strong>en</strong>, Le Havre et<br />
Evreux.<br />
Des processus simi<strong>la</strong>ires de « métropolisation » dans les principaux Etats du<br />
monde et tout particulièrem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Chine, <strong>en</strong> Inde, aux Etats-Unis et au Brésil se<br />
sont développés.<br />
La position de notre région s'est égalem<strong>en</strong>t détériorée par rapport aux autres<br />
régions. La faible anticipation de l'évolution et le peu de dynamisme régional ont<br />
conduit à une détérioration de notre tissu industriel, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> n'a pas<br />
fait les choix importants <strong>en</strong> temps voulu, notamm<strong>en</strong>t le développem<strong>en</strong>t de ses<br />
infrastructures portuaires, ferroviaires et routières.<br />
1/ Les grands projets d'infrastructure<br />
Les grands projets d'infrastructure – modernisation des ports, couverture<br />
numérique, contournem<strong>en</strong>t Rou<strong>en</strong>-est, LNPN - ne sont pas réalisés <strong>en</strong> totalité. La<br />
mobilité imposée souffre des congestions aggravées par <strong>la</strong> non réalisation des<br />
infrastructures nécessaires. Les flux, notamm<strong>en</strong>t de marchandises, stagn<strong>en</strong>t et,<br />
<strong>en</strong> tout cas, ne bénéfici<strong>en</strong>t pas au territoire, sauf sur quelques segm<strong>en</strong>ts très<br />
étroits.<br />
Les contournem<strong>en</strong>ts et les raccordem<strong>en</strong>ts autoroutiers ne sont pas réalisés. Le<br />
réseau secondaire peine à absorber les trafics.<br />
Il a été privilégié <strong>la</strong> réouverture et <strong>la</strong> mise à niveau de sécurité des lignes<br />
voyageurs infrarégionales « r<strong>en</strong>tables », tandis que le fret reste à l’état<br />
embryonnaire.<br />
Les infrastructures routières et ferroviaires n’ont pas été développées car elles<br />
aurai<strong>en</strong>t pu constituer un coût non amortissable <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et l’aurai<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>dettée sur du long terme.<br />
La nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> est <strong>en</strong> service rive gauche mais les raccordem<strong>en</strong>ts au<br />
réseau vers Le Havre ne sont pas faits. Ce nouveau terminus depuis Paris<br />
dés<strong>en</strong>gorge <strong>la</strong> gare actuelle qui voit ses contraintes desserrées <strong>pour</strong> le fret<br />
marchandises. Une partie des usagers ayant besoin d’utiliser des<br />
correspondances subiss<strong>en</strong>t cette situation.<br />
Les travaux de mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine ne sont pas réalisés. Le<br />
trafic fluvial ne s'est pas assez développé et reste figé sur les cont<strong>en</strong>eurs et le<br />
transport de vrac solides et liquides. Le port du Havre n’arrive pas à « décoller »<br />
et à combler une partie de son retard par rapport à ses concurr<strong>en</strong>ts. Les ports<br />
secondaires se développ<strong>en</strong>t autour du nautisme, de <strong>la</strong> pêche et de quelques<br />
trafics de niches.<br />
Les infrastructures portuaires, ne répondant pas efficacem<strong>en</strong>t aux besoins des<br />
<strong>en</strong>treprises exportatrices et importatrices, n’ont pas permis le développem<strong>en</strong>t<br />
d’activités nouvelles et sont restées spécialisées sur des produits traditionnels et<br />
primaires, à faible valeur ajoutée. Cette faible r<strong>en</strong>tabilité n’a pas permis de<br />
Octobre 2012 163
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
développer les activités annexes au port. Aucune activité de transformation et<br />
d’apport de valeur ajoutée n’est réalisée à l’occasion du transit des cont<strong>en</strong>eurs<br />
sur <strong>la</strong> zone portuaire et le long de <strong>la</strong> Seine. Le trafic de marchandises a été dirigé<br />
vers les ports du nord de l’Europe et les marchandises sont <strong>en</strong>suite redistribuées<br />
par le Canal Seine Nord qui est dev<strong>en</strong>u une voie de transport efficace vers Paris<br />
et les autres régions françaises.<br />
Aucun aéroport international n'a été développé sur le territoire normand. Aucune<br />
liaison rapide vers les aéroports francili<strong>en</strong>s n’a été mise <strong>en</strong> œuvre. L'<strong>en</strong>semble<br />
des infrastructures, existantes auparavant, ont de plus été frappées<br />
d’obsolesc<strong>en</strong>ce assez rapidem<strong>en</strong>t.<br />
Le Haut Débit peine à couvrir le territoire. Le Très Haut Débit n’est opérationnel<br />
que sur des zones économiques ciblées et r<strong>en</strong>tables <strong>pour</strong> les opérateurs.<br />
L’abs<strong>en</strong>ce de très haut débit a conduit les moy<strong>en</strong>nes et grandes <strong>en</strong>treprises à<br />
installer leurs activités de services <strong>en</strong> dehors de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>.<br />
La décision de réaliser l’EPR de P<strong>en</strong>ly n’a pas été prise et les parcs éoli<strong>en</strong>s ont été<br />
faits mais les retombées économiques locales, sur le bassin dieppois et sur <strong>la</strong><br />
région, n'ont été ni durables ni à <strong>la</strong> hauteur des espérances. Sans l’EPR et avec<br />
le seul chantier éoli<strong>en</strong>, les bassins d'emploi concernés n’ont pas connu de<br />
requalification de <strong>la</strong> main-d'œuvre au chômage et d'appel des jeunes sur les<br />
métiers dont les chantiers avai<strong>en</strong>t besoin, ni de préparation des qualifications<br />
"post chantier" une fois <strong>en</strong> phase d’exploitation. Les retombées n'ont duré que le<br />
temps du projet éoli<strong>en</strong> <strong>pour</strong> les activités de "services" al<strong>en</strong>tours (hébergem<strong>en</strong>t,<br />
restauration…) dont <strong>la</strong> reconversion s'avère difficile. On constate un<br />
mécont<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t social <strong>la</strong>t<strong>en</strong>t du fait du rapport coûts / avantages peu élevé.<br />
2/ Le manque d'efficacité économique <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
La <strong>pour</strong>suite de <strong>la</strong> désindustrialisation de l’Europe sous l’effet de <strong>la</strong> performance<br />
globale de l’industrie des pays émerg<strong>en</strong>ts (qualité, coût, technologie,<br />
réactivité…), a des effets néfastes sur <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> où le sort de<br />
beaucoup d’<strong>en</strong>treprises est lié à l’économie europé<strong>en</strong>ne.<br />
Dans ce contexte, <strong>la</strong> position de notre région s'est détériorée. Les activités du<br />
secteur industriel traditionnel (automobile, métallurgie, pétrochimie,...) et le<br />
bâtim<strong>en</strong>t, mais aussi les activités nouvelles (aéronautique, chimie fine,<br />
équipem<strong>en</strong>ts de transport, énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles) n'ont pas été suffisamm<strong>en</strong>t<br />
développées, voire se sont affaiblies par manque d'investissem<strong>en</strong>t public <strong>en</strong><br />
infrastructures.<br />
Par ailleurs, <strong>la</strong> hausse du coût de l’énergie fossile reste supportable <strong>pour</strong> les<br />
ag<strong>en</strong>ts économiques privés (ménages et <strong>en</strong>treprises - dont les comportem<strong>en</strong>ts<br />
de consommation se sont progressivem<strong>en</strong>t transformés -) et empêche <strong>la</strong><br />
r<strong>en</strong>tabilité du déploiem<strong>en</strong>t d’énergies non fossiles sur le territoire qui aurait pu,<br />
de par sa spécificité, diversifier son bouquet énergétique.<br />
Même si les délocalisations se ral<strong>en</strong>tiss<strong>en</strong>t, le manque d'infrastructures n'a pas<br />
permis des créations d'activités qui sont allées se conc<strong>en</strong>trer dans d'autres<br />
régions plus dynamiques (Nord, Bretagne,..) ou <strong>en</strong> Ile de France. Le chômage <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> n'a pas été réduit de manière notable du fait de faibles<br />
créations d'emplois qualifiés et égalem<strong>en</strong>t non qualifiés dû ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong><br />
relocalisation de certaines activités de service. Ce chômage a pris une dim<strong>en</strong>sion<br />
structurelle et a conduit à une précarisation de <strong>la</strong> situation d'un nombre<br />
important de ménages normands. 45<br />
45 Cf. <strong>la</strong> fiche variable sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion croissance / chômage <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Octobre 2012 164
Sc<strong>en</strong>ario S2<br />
Les secteurs vieillissants de l’économie régionale ont subi de plein fouet des<br />
départs massifs <strong>en</strong> retraite, faute d’avoir pu développer des activités à haute<br />
valeur ajoutée, <strong>en</strong> raison du faible investissem<strong>en</strong>t sur les élévations<br />
technologiques (faible culture R&D, manque d’esprit d’anticipation). La<br />
revalorisation des métiers de ces secteurs industriels (exemple de <strong>la</strong> métallurgie)<br />
n’a pas permis d’attirer des publics <strong>en</strong> formation. Les compét<strong>en</strong>ces et les savoirs<br />
faire se sont effrités dans <strong>la</strong> région qui ne peut <strong>en</strong>visager de re<strong>la</strong>nce sur ces<br />
voies.<br />
Le tissu local reste composé d’une majorité de PME peu armées face aux<br />
stratégies de grands groupes. Celles qui déti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de fortes expertises sur des<br />
créneaux pointus, n’ont pas <strong>la</strong> ressource <strong>pour</strong> valoriser et développer leurs<br />
activités à une échelle d’ETI (<strong>en</strong>treprise de taille intermédiaire). Le problème de<br />
<strong>la</strong> transmission et de <strong>la</strong> reprise d'<strong>en</strong>treprise est, dans ce contexte peu<br />
dynamique, exacerbé.<br />
La faible croissance, voire un re<strong>la</strong>tif déclin de l'emploi « industriel » a des<br />
externalités négatives sur le secteur tertiaire marchand et, notamm<strong>en</strong>t, dans les<br />
secteurs de logistique industrielle (activités portuaires, transport de<br />
marchandises,...), mais aussi dans les secteurs commerciaux et de proximité<br />
(économie prés<strong>en</strong>tielle et résid<strong>en</strong>tielle).<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> voit sa position re<strong>la</strong>tive se détériorer du fait qu'elle était<br />
traditionnellem<strong>en</strong>t plus industrialisée que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne des régions françaises. Ces<br />
structures sont <strong>en</strong> déclin, moins performantes, ce qui a acc<strong>en</strong>tué l'effet de<br />
stagnation économique dans diverses activités industrielles.<br />
La stagnation de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital dans notre région est suffisante <strong>pour</strong><br />
dissuader de nouvelles <strong>en</strong>treprises à s’installer sur le territoire. L’image peu<br />
dynamique, voire vieillissante de <strong>la</strong> région, apparaît comme une contrainte à son<br />
développem<strong>en</strong>t.<br />
Cep<strong>en</strong>dant, des secteurs tertiaires importants (hôtellerie, restauration, aide à <strong>la</strong><br />
personne liée à l’allongem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> durée de vie, sécurité des bi<strong>en</strong>s) se sont<br />
développés, mais <strong>la</strong> modernisation des infrastructures, notamm<strong>en</strong>t d’accueil,<br />
s'est effectuée l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t ce qui a freiné le tourisme d’affaires.<br />
3/ Formation et société de <strong>la</strong> connaissance<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs n’a pas<br />
été à <strong>la</strong> mesure des retards à rattraper <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région. Ces retards se sont<br />
creusés. Le retard <strong>en</strong> nombre de sortants non diplômés de <strong>la</strong> formation initiale<br />
ou dans l’accès à l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur n’est pas comblé.<br />
L’accès à l’emploi des jeunes, même diplômés, reste préoccupant <strong>en</strong> région : <strong>la</strong><br />
part des jeunes non insérés reste forte dans une région caractérisée par sa<br />
jeunesse.<br />
La proportion des non diplômés dans <strong>la</strong> structure de <strong>la</strong> qualification des actifs n’a<br />
pas diminué sur <strong>la</strong> dernière déc<strong>en</strong>nie : le volume de qualifiés (diplôme de<br />
niveau V au minimum) reste à peine supérieur <strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne dans tous les<br />
secteurs au volume de non qualifiés.<br />
La notion de formation tout au long de <strong>la</strong> vie (FTLV) peine à s’imposer. Les<br />
efforts déployés <strong>pour</strong> les acquisitions du socle commun des connaissances n’ont<br />
pas <strong>en</strong>core permis de sceller <strong>la</strong> capacité d’acquisition de l'appr<strong>en</strong>tissage, alors<br />
que cette compét<strong>en</strong>ce est fondam<strong>en</strong>tale dès lors que le développem<strong>en</strong>t<br />
d’Internet a généré l’accès à une profusion d’informations : le retour vers <strong>la</strong><br />
formation reste souv<strong>en</strong>t assimilé à un retour à l’école. Il n'y a pas eu un véritable<br />
Octobre 2012 165
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
investissem<strong>en</strong>t dans le travail des s<strong>en</strong>iors qui n’a pas été considéré comme une<br />
priorité (ils pâtiss<strong>en</strong>t <strong>en</strong> premier des difficultés économiques).<br />
Les dispositifs de formation individuelle des personnes <strong>en</strong> emploi qui souhait<strong>en</strong>t<br />
changer de voie, rest<strong>en</strong>t peu sollicités (VAE, CIF, …) ; <strong>la</strong> priorité étant de garder<br />
son emploi plutôt que de progresser ou de changer de parcours.<br />
Les acteurs de <strong>la</strong> formation et de l’économie régionale ne sont pas <strong>en</strong> capacité de<br />
mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce les adaptations nécessaires des formations et des qualifications<br />
aux besoins des secteurs <strong>en</strong> forte mutation. L’économie régionale s’<strong>en</strong> trouve<br />
davantage fragilisée.<br />
Le tissu régional important de PME est touché par les difficultés et les <strong>en</strong>treprises<br />
ont peu de moy<strong>en</strong>s <strong>pour</strong> investir dans <strong>la</strong> formation, d’autant que <strong>la</strong> proportion<br />
des actifs à faible niveau de qualification est élevée. Elles ne peuv<strong>en</strong>t anticiper<br />
sur des démarches de GPEC, malgré <strong>la</strong> structuration et les incitations des<br />
branches qui organis<strong>en</strong>t <strong>la</strong> collecte des fonds de <strong>la</strong> formation et les accords<br />
existants. Dans ce contexte, <strong>la</strong> GPEC Territoriale reste balbutiante.<br />
Les secteurs de l’économie régionale qui connaiss<strong>en</strong>t des besoins de<br />
structuration des formations, notamm<strong>en</strong>t ceux des activités de service, de <strong>la</strong><br />
logistique, ou <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec les activités économiques liées à <strong>la</strong> façade maritime<br />
ou à l’énergie, pein<strong>en</strong>t à se développer faute de structuration des spécialités<br />
professionnelles secondaires ou supérieures.<br />
Les acteurs de l’ori<strong>en</strong>tation des publics, jeunes et adultes, se sont<br />
professionnalisés, mais les cloisonnem<strong>en</strong>ts demeur<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> Cité des métiers n’a<br />
pas eu les moy<strong>en</strong>s de jouer un rôle fédérateur <strong>pour</strong> impulser une dynamique de<br />
service de l’ori<strong>en</strong>tation à l’échelle du territoire régional. Par ailleurs, le li<strong>en</strong> de ces<br />
acteurs au monde de l’<strong>en</strong>treprise a eu du mal à se r<strong>en</strong>forcer <strong>en</strong> cette période<br />
difficile et <strong>la</strong> vision à court terme l’emporte sur <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> compte des besoins<br />
avec une vision de moy<strong>en</strong> ou de long terme.<br />
Il n’y a pas à l’évid<strong>en</strong>ce de li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre les acteurs de <strong>la</strong> formation initiale et<br />
continue, de l’information et de l’ori<strong>en</strong>tation, les part<strong>en</strong>aires sociaux et les<br />
<strong>en</strong>treprises ; <strong>la</strong> synergie n’est pas au niveau des <strong>en</strong>jeux <strong>pour</strong> rattraper les<br />
retards régionaux. La coordination <strong>en</strong>tre les grands schémas d’interv<strong>en</strong>tion dans<br />
le domaine de <strong>la</strong> formation professionnelle (CPRDFP) et de l’économie (CRDE) est<br />
actionnée au cas par cas lorsque des difficultés ponctuelles et majeures<br />
survi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t dans certains secteurs. Il n’y a pas de volonté <strong>pour</strong> définir les<br />
modalités et procéder <strong>en</strong>suite régulièrem<strong>en</strong>t à l’évaluation des politiques <strong>en</strong> ce<br />
domaine. L’évolution des modalités d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t et de formation ainsi que les<br />
nouveaux outils d’appr<strong>en</strong>tissage pein<strong>en</strong>t à de développer : les pratiques<br />
d’individualisation des formations et <strong>la</strong> formation à distance ne vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong><br />
appui de <strong>la</strong> formation des individus sur l’<strong>en</strong>semble du territoire et les inégalités<br />
d’accès à <strong>la</strong> formation perdur<strong>en</strong>t.<br />
Au sein du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>, le PRES, après une bonne déc<strong>en</strong>nie<br />
d’exist<strong>en</strong>ce, a limité son action à <strong>en</strong>gager des opérations de communication sans<br />
portée et l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur n’a pas gagné <strong>en</strong> attractivité. Les acteurs<br />
locaux n’ont pas investi dans l’accompagnem<strong>en</strong>t social des formations,<br />
notamm<strong>en</strong>t au niveau supérieur <strong>pour</strong> <strong>en</strong>rayer les retards de <strong>la</strong> région ; les<br />
bourses doctorales malgré leur mainti<strong>en</strong> <strong>en</strong> volume ne sont pas suffisamm<strong>en</strong>t<br />
incitatives <strong>pour</strong> attirer <strong>en</strong> région les jeunes chercheurs, voire conserver les<br />
doctorants dans les <strong>la</strong>boratoires.<br />
L’investissem<strong>en</strong>t cons<strong>en</strong>ti par les familles dans <strong>la</strong> formation étant peu<br />
rémunérateur à court et moy<strong>en</strong> termes localem<strong>en</strong>t, les jeunes ne se form<strong>en</strong>t pas<br />
davantage dans les systèmes de formation initiale et continue, ce qui accroît <strong>la</strong><br />
dichotomie du tissu social du territoire. Les jeunes les moins qualifiés étant peu<br />
mobiles, gonfl<strong>en</strong>t le nombre de demandeurs d’emploi ou n’assur<strong>en</strong>t que des<br />
Octobre 2012 166
Sc<strong>en</strong>ario S2<br />
emplois peu qualifiés et à fort taux de rotation. Les jeunes les plus qualifiés<br />
émigr<strong>en</strong>t vers d’autres régions plus dynamiques. Le travail non officiel s’est<br />
développé puisque le marché du travail n’a pas permis une insertion des<br />
demandeurs d'emploi.<br />
La stagnation de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital productif n’a pas conduit de nouvelles<br />
<strong>en</strong>treprises à s’installer ni les <strong>en</strong>treprises existantes à investir dans <strong>la</strong> région,<br />
celles-ci diminu<strong>en</strong>t progressivem<strong>en</strong>t leurs activités (R&D, innovations,<br />
production,...). Ce mouvem<strong>en</strong>t particulièrem<strong>en</strong>t fort dans les grandes <strong>en</strong>treprises<br />
se propage égalem<strong>en</strong>t aux PMI, notamm<strong>en</strong>t les sous-traitantes qui voi<strong>en</strong>t leurs<br />
activités baisser. Le tissu artisanal n’est que légèrem<strong>en</strong>t plus dynamique <strong>en</strong> se<br />
développant sur des secteurs porteurs sur le p<strong>la</strong>n technologique et plus<br />
traditionnels, mais ne permet pas dégager une valeur ajoutée stimu<strong>la</strong>nt <strong>la</strong><br />
croissance locale.<br />
4/ Les effets sociaux du faible dynamisme économique<br />
La stabilité de l'emploi dans l'économie se traduit par une augm<strong>en</strong>tation du taux<br />
d'inactivité des haut-normands. Cep<strong>en</strong>dant, les pressions à <strong>la</strong> hausse des sa<strong>la</strong>ires<br />
ont été moins ress<strong>en</strong>ties qu'ailleurs du fait d'un taux de chômage initial plus<br />
élevé que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale. Ce fait a r<strong>en</strong>forcé <strong>la</strong> compétitivité de <strong>la</strong> région.<br />
L’emploi étant stagnant, les sa<strong>la</strong>ires évolu<strong>en</strong>t peu et <strong>la</strong> masse sa<strong>la</strong>riale est<br />
constante <strong>en</strong> terme réel. La consommation des ménages n’est pas un facteur de<br />
croissance <strong>pour</strong> le territoire normand. L’accroissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> consommation n’est<br />
du qu’à un comportem<strong>en</strong>t de désépargne <strong>pour</strong> les c<strong>la</strong>sses moy<strong>en</strong>nes. Le nombre<br />
des ménages, pouvant être considérés comme vivants au seuil de pauvreté ou<br />
<strong>en</strong> dessous, est resté constant (12% depuis plus d’une déc<strong>en</strong>nie). Ce taux n’a<br />
été maint<strong>en</strong>u constant que grâce à une politique sociale coûteuse. La pauvreté<br />
atteint majoritairem<strong>en</strong>t des jeunes, notamm<strong>en</strong>t des <strong>en</strong>fants et des femmes <strong>en</strong><br />
situation précaire. Les coûts de logem<strong>en</strong>t, de l'eau, du gaz et de l’électricité se<br />
sont accrus sous l’effet d'une forte concurr<strong>en</strong>ce mondiale sur <strong>la</strong> demande<br />
énergétique et de <strong>la</strong> plus grande rareté de ces ressources énergétiques. De ce<br />
fait, les contraintes financières s’aggrav<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> cette popu<strong>la</strong>tion.<br />
La stabilité du chômage sur longue période s'est traduite par une stabilisation de<br />
sa durée, conduisant à une augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> précarité du travail et une<br />
détérioration des conditions de travail, tous secteurs et toutes qualifications<br />
confondus. Cep<strong>en</strong>dant, les groupes les plus fragiles subiss<strong>en</strong>t plus fortem<strong>en</strong>t ce<br />
faible dynamisme du marché du travail. Les travailleurs <strong>en</strong> intérim, très prés<strong>en</strong>ts<br />
<strong>en</strong> région, <strong>en</strong> sont les premières victimes ; les jeunes subiss<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> fois un<br />
chômage récur<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> les moins qualifiés et un chômage d’insertion <strong>pour</strong> les<br />
plus qualifiés. Les s<strong>en</strong>iors voi<strong>en</strong>t leur taux de chômage s’accroître car les<br />
<strong>en</strong>treprises arbitr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> faveur des plus jeunes 46 , ce qui <strong>en</strong>traîne un<br />
déc<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t rapide des s<strong>en</strong>iors <strong>en</strong> augm<strong>en</strong>tant les problèmes de couverture<br />
sociale et de retraite. L’allongem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> durée du travail ne s’est donc pas<br />
traduit par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce accrue de s<strong>en</strong>iors, à l’exception des <strong>en</strong>treprises qui<br />
risquai<strong>en</strong>t de perdre des savoir-faire indisp<strong>en</strong>sables.<br />
Un certain mouvem<strong>en</strong>t de ghettoïsation, subi par certaines villes au début du<br />
siècle, se <strong>pour</strong>suit sans s’int<strong>en</strong>sifier. On ne note pas une baisse s<strong>en</strong>sible des<br />
incivilités (dégradation des bi<strong>en</strong>s publics et privés), des viol<strong>en</strong>ces (crimes, vols,<br />
viol<strong>en</strong>ces conjugales,...), des externalités négatives (drogues, prostitution,<br />
alcoolisme,...).<br />
46 adultes <strong>en</strong>tre 25 et 50 ans au s<strong>en</strong>s de l’INSEE<br />
Octobre 2012 167
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
La région n’a pas vu sa situation évoluer sur longue période. Ses recettes fiscales<br />
sont stables <strong>en</strong> termes réels du fait de <strong>la</strong> stabilité des rev<strong>en</strong>us des ménages et<br />
des sociétés et de <strong>la</strong> stabilité de <strong>la</strong> consommation. Les collectivités locales<br />
rest<strong>en</strong>t soumises au problème de <strong>la</strong> dette (équilibre budgétaire sans<br />
investissem<strong>en</strong>t, constance du rapport dette/PRB 47 ). De ce fait, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> ne peut pas desserrer ses contraintes financières ; ses charges<br />
(personnel, consommation, investissem<strong>en</strong>ts et transferts) doiv<strong>en</strong>t être<br />
strictem<strong>en</strong>t gérées du fait de recettes constantes, ce qui ne permet pas une<br />
amélioration de l'<strong>en</strong>semble de l'offre régionale vis-à-vis des citoy<strong>en</strong>s.<br />
En ce qui concerne les politiques sociales, les ressources sont limitées et leur<br />
redéfinition est une nécessité même si l'action régionale est <strong>en</strong> partie soumise à<br />
<strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion nationale et europé<strong>en</strong>ne. Toutefois, les dép<strong>en</strong>ses sociales sont<br />
croissantes (obligation d’une couverture minimale de santé et de retraite,<br />
difficultés d'accès aux soins <strong>pour</strong> une partie de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, investissem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
capital humain non r<strong>en</strong>tables <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région,...). La contrainte sur le système<br />
social, notamm<strong>en</strong>t de santé, reste forte puisque les prélèvem<strong>en</strong>ts locaux<br />
demeur<strong>en</strong>t quasim<strong>en</strong>t constants <strong>en</strong> termes réels. Ce<strong>la</strong> suppose des arbitrages<br />
financiers <strong>en</strong>tre le domaine social pur et l’éducation par exemple (plus de<br />
dép<strong>en</strong>ses sociales et donc moins d’investissem<strong>en</strong>ts publics <strong>en</strong> formation). La<br />
prise <strong>en</strong> charge de certaines popu<strong>la</strong>tions devi<strong>en</strong>t plus difficile <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région dans<br />
les différ<strong>en</strong>ts domaines de l’offre de services publics (santé, famille, handicap,<br />
troisième âge dép<strong>en</strong>dant, pauvreté, formation), d'autant plus qu'elle devi<strong>en</strong>t une<br />
région vieillissante. 48<br />
Aussi, malgré les mesures nationales qui ont été prises <strong>pour</strong> adapter les<br />
modalités de financem<strong>en</strong>t des dép<strong>en</strong>ses de santé (quelle que soit celle des 3<br />
visions adoptées : <strong>la</strong> vision libérale (interv<strong>en</strong>tion de <strong>la</strong> famille, franchises) / <strong>la</strong><br />
vision collective mutualiste / <strong>la</strong> vision solidaire (fiscalisation, impôt d’Etat), il n’y<br />
a donc pas de possibilité de dégager au niveau régional des marges de<br />
manœuvre suffisantes <strong>pour</strong> peser efficacem<strong>en</strong>t sur <strong>la</strong> situation sanitaire.<br />
En matière de prév<strong>en</strong>tion, <strong>la</strong> médecine du travail et <strong>la</strong> médecine sco<strong>la</strong>ire<br />
(fortem<strong>en</strong>t déficitaires <strong>en</strong> France), de même que l’éducation à <strong>la</strong> santé se sont<br />
maint<strong>en</strong>ues à l’id<strong>en</strong>tique, notamm<strong>en</strong>t avec les déséquilibres importants qui<br />
existai<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre les actifs des différ<strong>en</strong>ts secteurs.<br />
Les progrès techniques dans le domaine de <strong>la</strong> santé s’opèr<strong>en</strong>t au rythme des<br />
possibilités dont dispos<strong>en</strong>t les chercheurs, y compris ceux des secteurs <strong>en</strong> pointe<br />
au CHUR qui dispos<strong>en</strong>t de moy<strong>en</strong>s limités et du peu d’aide à <strong>la</strong> valorisation de<br />
leurs recherches. L’âge et <strong>la</strong> morbidité recul<strong>en</strong>t de façon équilibrée.<br />
La démographie médicale ne s’améliore pas <strong>pour</strong> les généralistes. Leur d<strong>en</strong>sité<br />
<strong>pour</strong> 100 000 habitants régresse <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>en</strong> perdant presque 1 point par rapport<br />
à 2010. Les autres professions sont <strong>en</strong> bas de c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t malgré un besoin plus<br />
marqué qu’ailleurs (ex : santé m<strong>en</strong>tale, addictions, nutrition, odontologie...) Les<br />
médecins étrangers rest<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> même proportion et <strong>la</strong> validation de leur<br />
diplôme s’organise au fil de l’eau. L’<strong>en</strong>combrem<strong>en</strong>t des services des urg<strong>en</strong>ces a<br />
continué et reste un signe de « mauvaise santé » d’accès aux soins primaires.<br />
Les citoy<strong>en</strong>s les plus éloignés des c<strong>en</strong>tres urbains subiss<strong>en</strong>t de plein fouet sans<br />
solution alternative <strong>la</strong> réduction de l’offre de services publics.<br />
47 PRB Produit régional brut<br />
48 Cf. fiches variable offre de soin (les politiques sociales) et démographie.<br />
Octobre 2012 168
Sc<strong>en</strong>ario S2<br />
5/ Les évolutions <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales et l'offre énergétique<br />
Sur le p<strong>la</strong>n <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal, les effets sont mitigés. D'un côté, <strong>la</strong> faiblesse de<br />
<strong>la</strong> production et des services liés a conduit à une diminution des nuisances<br />
(pollution de l'air, de l'eau, nuisances sonores,...), associée à une<br />
rationalisation des techniques de production. Cep<strong>en</strong>dant, les <strong>en</strong>treprises<br />
investiss<strong>en</strong>t peu dans des combinaisons de production <strong>en</strong>traînant moins<br />
d'externalités négatives sur l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. Faute de r<strong>en</strong>tabilité suffisante, les<br />
démarches de développem<strong>en</strong>t durable sont re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t peu intégrées dans les<br />
stratégies des firmes qui ont une attitude passive.<br />
Les indicateurs négatifs s’acc<strong>en</strong>tu<strong>en</strong>t. La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> conserve et amplifie<br />
les mauvais critères. Il n’y a pas de prise de consci<strong>en</strong>ce. Les quelques avancées<br />
ou progrès énergétiques sont « rongés » par <strong>la</strong> <strong>pour</strong>suite de l’étalem<strong>en</strong>t<br />
périurbain, de l’artificialisation des espaces.<br />
6/ Les flux migratoires<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> ne réussit pas à inverser les flux migratoires (plus de<br />
sorties et moins d'<strong>en</strong>trées de jeunes qualifiés sur le territoire normand,<br />
impliquant un vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion active). Les jeunes les plus qualifiés<br />
émigr<strong>en</strong>t vers d’autres régions plus dynamiques.<br />
7/ Le rayonnem<strong>en</strong>t culturel et <strong>la</strong> « gouvernance » au s<strong>en</strong>s de<br />
l’appropriation de l’id<strong>en</strong>tité<br />
Les territoires développ<strong>en</strong>t des initiatives <strong>pour</strong> les publics de proximité. Une<br />
coordination <strong>en</strong>tre décideurs politiques et acteurs culturels se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce sous<br />
l’effet de <strong>la</strong> réforme territoriale, mais l’ambition des décideurs politiques et<br />
acteurs culturels est trop contrainte par <strong>la</strong> faiblesse des moy<strong>en</strong>s qui se raréfi<strong>en</strong>t.<br />
Une « cantonalisation » des politiques, source d’inertie <strong>pour</strong> le rayonnem<strong>en</strong>t<br />
culturel de <strong>la</strong> région, s'est progressivem<strong>en</strong>t installée.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des pratiques de recours au numérique s’opère mais pas au<br />
profit de <strong>la</strong> région. Les produits proposés sont le reflet d’une offre qui reste<br />
segm<strong>en</strong>tée et qui n’attire pas par <strong>la</strong> nouveauté, ni par l’ouverture vers les<br />
territoires voisins qui sont porteurs de visibilité et d’id<strong>en</strong>tité au-delà des<br />
frontières. Faute d’investir sur les atouts de <strong>la</strong> perception de <strong>la</strong> «<strong>Normandie</strong>», de<br />
<strong>la</strong> proximité de l’Ile de France, le rayonnem<strong>en</strong>t « vivote » porté par un ou deux<br />
évènem<strong>en</strong>ts éphémères et insuffisants <strong>pour</strong> porter une id<strong>en</strong>tité des territoires et<br />
du Territoire.<br />
Octobre 2012 169
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 170
Sc<strong>en</strong>ario S3<br />
III - Sc<strong>en</strong>ario 3 : « Vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et plus forte ! »<br />
Les pays occid<strong>en</strong>taux ont retrouvé <strong>la</strong> croissance et se retrouv<strong>en</strong>t sur un s<strong>en</strong>tier<br />
d'expansion reposant à <strong>la</strong> fois sur une croissance de <strong>la</strong> demande intérieure et un<br />
développem<strong>en</strong>t des échanges. Dans le même temps, ils r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t compatibles une<br />
croissance sout<strong>en</strong>ue et le concept de développem<strong>en</strong>t durable.<br />
L’Europe des Etats est aussi l’Europe des Régions. Grâce à une forme appropriée<br />
de l’utilisation des crédits, les projets à long terme ont re<strong>la</strong>ncé une politique<br />
économique plus interv<strong>en</strong>tionniste. Les projets stimu<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce<br />
et <strong>la</strong> coopération <strong>en</strong>tre les régions à l’échelle de l’Europe sont <strong>en</strong>couragés par<br />
l’Union Europé<strong>en</strong>ne. Le pot<strong>en</strong>tiel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur.<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a anticipé l'amélioration de <strong>la</strong> conjoncture économique<br />
nationale et mondiale. La position de notre région s'est r<strong>en</strong>forcée.<br />
1/ Les grands projets d'infrastructure<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> a fait le choix et a su convaincre, dans un premier temps et<br />
dans un contexte <strong>en</strong>core difficile, de développer son réseau numérique THD très<br />
haut débit <strong>pour</strong> un développem<strong>en</strong>t équilibré sur tout le territoire. C’est ce<br />
développem<strong>en</strong>t qui a contribué à r<strong>en</strong>forcer sa structure de production et qui lui a<br />
permis d’investir dans les grands projets d’infrastructures portuaires, ferroviaires<br />
(LNPN) et routières, ainsi qu’à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce de services dématérialisés <strong>pour</strong><br />
les accès aux procédures administratives, à <strong>la</strong> télémédecine et à <strong>la</strong> formation.<br />
Les projets « Paris Seine <strong>Normandie</strong> » ont fini par s’imposer. Adossée aux<br />
infrastructures éoli<strong>en</strong>nes et à <strong>la</strong> LNPN, grâce au mail<strong>la</strong>ge territorial et à <strong>la</strong><br />
multimodalité qui se mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> connaît une nouvelle<br />
notoriété qu’elle a su accompagner d’évènem<strong>en</strong>ts culturels de portée<br />
internationale. Ces nouvelles infrastructures sont aussi bénéfiques <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong><br />
que <strong>pour</strong> <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>. La recherche privée et publique normande<br />
s’organise et devi<strong>en</strong>t l’une des six premières <strong>en</strong> France. De fait, <strong>la</strong> coopération<br />
devi<strong>en</strong>t une évid<strong>en</strong>ce y compris avec l’Ile de France.<br />
La mobilité s’organise dans <strong>la</strong> complém<strong>en</strong>tarité des modes. Les flux, notamm<strong>en</strong>t<br />
de marchandises, augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t et comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à innerver et à bénéficier à<br />
l’<strong>en</strong>semble du territoire.<br />
L'<strong>en</strong>semble des contournem<strong>en</strong>ts et raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. Le raccordem<strong>en</strong>t<br />
aux réseaux à grande vitesse europé<strong>en</strong> profite à tous grâce au développem<strong>en</strong>t<br />
des lignes infrarégionales. Le fret au départ du Havre vers <strong>la</strong> région parisi<strong>en</strong>ne se<br />
développe.<br />
Les travaux de mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong> Seine sont réalisés. Le<br />
transport de déchets a connu un fort développem<strong>en</strong>t. Port 2000 a réussi à capter<br />
des tonnages jusqu’alors <strong>destin</strong>és aux ports du Nord grâce au développem<strong>en</strong>t<br />
des liaisons vers son hinter<strong>la</strong>nd et aux ports secondaires.<br />
La massification des transports internationaux et particulièrem<strong>en</strong>t des transports<br />
maritimes, font du Havre une des portes maritimes importantes de l’Europe<br />
occid<strong>en</strong>tale. L’Etat et les régions périphériques font du Havre le principal port de<br />
l’Ile de France.<br />
L’accès à Roissy est amélioré. Toutefois, parallèlem<strong>en</strong>t Deauville pr<strong>en</strong>d un réel<br />
essor dans l'activité de transport de passagers, notamm<strong>en</strong>t d'affaires.<br />
L’EPR de P<strong>en</strong>ly est <strong>en</strong> cours de réalisation et <strong>la</strong> Région a anticipé et accompagné<br />
ce grand projet. Les retombées régionales, <strong>en</strong> termes de travail et de<br />
qualification, sont importantes : formation des jeunes et des actifs <strong>en</strong> recherche<br />
Octobre 2012 171
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
d'emploi sur le bassin dieppois et au niveau régional <strong>pour</strong> <strong>la</strong> phase chantier,<br />
formation <strong>en</strong> amont de personnels qualifiés <strong>pour</strong> l'exploitation du site post<br />
chantier, anticipation des reconversions post chantier par id<strong>en</strong>tification des<br />
compét<strong>en</strong>ces acquises <strong>pour</strong> permettre à terme le report sur d'autres "grands<br />
chantiers" régionaux ou hors région... De ce fait, ce grand projet est bi<strong>en</strong><br />
accepté du fait de ses retombées à court, moy<strong>en</strong> et long termes.<br />
2/ Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u<br />
Tous les acteurs ayant tiré <strong>la</strong> leçon des crises 2008-2012, un modèle économique<br />
plus performant s’impose mettant l’économie financière au service de l’économie<br />
réelle.<br />
L’emploi s'est développé depuis une déc<strong>en</strong>nie, du fait de fortes créations<br />
d'emplois dans les activités industrielles et tertiaires porteuses et de moindres<br />
pertes dans les secteurs plus traditionnels.<br />
Les « relocalisations » <strong>en</strong> Europe, suite au manque de performance des pays<br />
émerg<strong>en</strong>ts, bénéfici<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> région. La hausse du coût de l’énergie génère des<br />
produits <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et permet d'innover <strong>pour</strong> trouver des alternatives<br />
énergétiques.<br />
La position de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> s’est r<strong>en</strong>forcée sur le p<strong>la</strong>n économique dans<br />
des activités historiques du secteur industriel et des activités nouvelles ont été<br />
progressivem<strong>en</strong>t développées dans plusieurs secteurs grâce aux innovations et<br />
avec une amélioration de <strong>la</strong> compétitivité de notre région.<br />
Ainsi, les secteurs traditionnels les plus exposés ont pu <strong>en</strong>tamer leur mutation<br />
vers des activités <strong>en</strong> émerg<strong>en</strong>ce : éoli<strong>en</strong> off shore, « déconstruction » (pas<br />
seulem<strong>en</strong>t automobile…), retraitem<strong>en</strong>t des déchets...<br />
Le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> structuration des filières autour des produits innovants a<br />
permis de sout<strong>en</strong>ir les PME/PMI, de les aider à passer le cap des départs massifs<br />
<strong>en</strong> retraite <strong>en</strong> rajeunissant <strong>la</strong> main-d’œuvre par des effectifs davantage qualifiés.<br />
Ces filières souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce à l’international d’<strong>en</strong>treprises qui<br />
seules n’ont pas les moy<strong>en</strong>s d’organiser cette visibilité et leur permet d’intégrer<br />
une culture d’anticipation et une vision à plus long terme dans un esprit<br />
« réseau ».<br />
Ces habitudes ont permis le regroupem<strong>en</strong>t de PME et ouvert de nouvelles<br />
opportunités lors de <strong>la</strong> transmission ou reprise d’<strong>en</strong>treprise.<br />
Ce tissu économique bi<strong>en</strong> valorisé par une communication ciblée sur les atouts<br />
régionaux est dev<strong>en</strong>u attractif <strong>pour</strong> des <strong>en</strong>treprises nationales performantes,<br />
<strong>en</strong>visageant favorablem<strong>en</strong>t l’imp<strong>la</strong>ntation de leurs sièges sociaux.<br />
Ces créations d'activité conduis<strong>en</strong>t donc à une baisse du chômage du fait de<br />
créations d'emplois qualifiés et, <strong>en</strong> proportion moindre, d’emplois non qualifiés. 49<br />
La croissance de l’emploi « industriel » a des effets positifs sur le secteur tertiaire<br />
marchand et, notamm<strong>en</strong>t, dans les secteurs de logistique industrielle (activités<br />
portuaires, transport de marchandises...), mais aussi dans les secteurs<br />
commerciaux. Les emplois de proximité ont été professionnalisés grâce à un<br />
effort de formation et d’insertion (exemple : économie prés<strong>en</strong>tielle et<br />
résid<strong>en</strong>tielle).<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> tire profit de cette situation puisqu'elle était<br />
traditionnellem<strong>en</strong>t plus industrialisée que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne des régions françaises. Ces<br />
49 Cf. fiche variable sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion croissance / chômage <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Octobre 2012 172
Sc<strong>en</strong>ario S3<br />
structures étai<strong>en</strong>t performantes ce qui a acc<strong>en</strong>tué l'effet de reprise économique<br />
dans diverses activités industrielles.<br />
La hausse de l'emploi dans l'économie locale se traduit par une augm<strong>en</strong>tation du<br />
taux d'activité des haut-normands. Cep<strong>en</strong>dant, les pressions à <strong>la</strong> hausse des<br />
sa<strong>la</strong>ires ont été moins ress<strong>en</strong>ties qu'ailleurs du fait d'un taux de chômage initial<br />
plus élevé que <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne nationale. Ce fait a r<strong>en</strong>forcé <strong>la</strong> compétitivité de <strong>la</strong><br />
région.<br />
Dans ce contexte dynamique et grâce à ses atouts majeurs, à ses infrastructures<br />
développées, à sa façade maritime et sa proximité de l'Ile de France, des firmes<br />
se sont relocalisées <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et d'autres sont v<strong>en</strong>ues s’y imp<strong>la</strong>nter<br />
(les firmes multinationales s'imp<strong>la</strong>nt<strong>en</strong>t dans des zones d'investissem<strong>en</strong>t où le<br />
travail, bi<strong>en</strong> que plus cher, est qualifié et donc plus effici<strong>en</strong>t). Une amélioration<br />
de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital a été constatée sur l'<strong>en</strong>semble de <strong>la</strong> période, ce qui a<br />
r<strong>en</strong>forcé l'image « dynamique » de <strong>la</strong> région.<br />
La hausse de <strong>la</strong> masse sa<strong>la</strong>riale accroît fortem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> consommation des ménages<br />
sur le territoire normand, amplifiant le processus de croissance. Le nombre des<br />
ménages, pouvant être considérés comme vivants au seuil de pauvreté ou <strong>en</strong><br />
dessous (12% <strong>en</strong> 2012), a nettem<strong>en</strong>t diminué (8%). Même si les coûts du<br />
logem<strong>en</strong>t, de l'eau, gaz et électricité se sont accrus du fait d'une forte<br />
concurr<strong>en</strong>ce mondiale sur les énergies et de <strong>la</strong> plus grande rareté de ces<br />
ressources énergétiques, les contraintes financières apparaiss<strong>en</strong>t moins fortes.<br />
La baisse du chômage s'est traduite par une diminution de sa durée, conduisant<br />
à une diminution de <strong>la</strong> précarité du travail et une amélioration des conditions de<br />
travail, tous secteurs et toutes qualifications confondus.<br />
La hausse de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital productif permet d'accélérer<br />
l'investissem<strong>en</strong>t des <strong>en</strong>treprises qui amélior<strong>en</strong>t leur compétitivité dans de<br />
multiples domaines (R&D, innovations, production,...). Ce mouvem<strong>en</strong>t<br />
particulièrem<strong>en</strong>t fort dans les grandes <strong>en</strong>treprises se propage égalem<strong>en</strong>t aux<br />
PMI, notamm<strong>en</strong>t les sous-traitantes qui voi<strong>en</strong>t leurs activités progresser à un<br />
rythme sout<strong>en</strong>u. Le tissus artisanal se développe sur des secteurs porteurs sur le<br />
p<strong>la</strong>n technologique et plus traditionnels et à forte valeur ajoutée.<br />
3/ Formation et Société de <strong>la</strong> connaissance<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs a<br />
permis de rattraper les retards de <strong>la</strong> région. La région est dans <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne<br />
nationale <strong>en</strong> termes de sortie de jeunes diplômés, le taux de sco<strong>la</strong>risation<br />
augm<strong>en</strong>te au niveau supérieur mais, les <strong>pour</strong>suites d’études rest<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant<br />
<strong>en</strong> retrait dans <strong>la</strong> région.<br />
L’insertion des jeunes diplômés s’est améliorée sur le territoire car ils répond<strong>en</strong>t<br />
davantage aux besoins de qualification des secteurs économiques qui emploi<strong>en</strong>t.<br />
La capacité d’acquisition des appr<strong>en</strong>tissages fait partie des objectifs de<br />
l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t initial, mais l’acquisition des savoirs de base <strong>pour</strong> tous reste un<br />
<strong>en</strong>jeu au niveau régional.<br />
La notion de FTLV a réellem<strong>en</strong>t pris corps, les <strong>en</strong>treprises ont gardé les s<strong>en</strong>iors<br />
qui transmett<strong>en</strong>t leurs savoir-faire professionnels aux jeunes moins<br />
expérim<strong>en</strong>tés et peuv<strong>en</strong>t investir dans les montées <strong>en</strong> qualification. Ainsi <strong>la</strong><br />
structuration de <strong>la</strong> qualification des actifs progresse vers le haut, les actifs <strong>en</strong><br />
emploi qui accèd<strong>en</strong>t à un niveau de qualification supérieure, sont plus nombreux<br />
et les situations d’illettrisme au travail dé-stigmatisées sont plus facilem<strong>en</strong>t<br />
repérées et accompagnées par des formations. L’aptitude à p<strong>en</strong>ser qu’on doit se<br />
former <strong>en</strong> perman<strong>en</strong>ce Tout au Long de <strong>la</strong> Vie (FTLV) est installée chez les<br />
individus et <strong>en</strong> <strong>en</strong>treprise. Le travail des s<strong>en</strong>iors est valorisé.<br />
Octobre 2012 173
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Parmi les formations des demandeurs d’emploi, celles ciblées sur les plus<br />
éloignés de <strong>la</strong> formation, sont développées <strong>en</strong> priorité <strong>en</strong> concertation <strong>en</strong>tre <strong>la</strong><br />
région et pôle emploi, ce qui concourt à l’objectif de lutte contre les exclusions <strong>en</strong><br />
pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong> compte les spécificités des territoires.<br />
Les adaptations nécessaires des qualifications aux besoins de quelques secteurs<br />
<strong>en</strong> forte mutation sont mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. Des spécialités liées à l'énergie et au<br />
transport <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dans le secondaire et dans le supérieur ont été<br />
développées <strong>en</strong> s’appuyant sur <strong>la</strong> valeur ajoutée qu’elles apport<strong>en</strong>t localem<strong>en</strong>t.<br />
Dans les <strong>en</strong>treprises, <strong>la</strong> GPEC s’est développée grâce à davantage de lisibilité sur<br />
les secteurs porteurs et aux travaux sur <strong>la</strong> valorisation des compét<strong>en</strong>ces acquises<br />
<strong>en</strong> emploi. Elle est portée par les branches et les filières qui les accompagn<strong>en</strong>t,<br />
qui travaill<strong>en</strong>t <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec le conseil régional dans le cadre de contrats<br />
d’objectifs é<strong>la</strong>rgis à de nouveaux secteurs et avec une dim<strong>en</strong>sion inter branches<br />
et filières.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des compét<strong>en</strong>ces professionnelles est p<strong>la</strong>cé au cœur des<br />
exig<strong>en</strong>ces d’employabilité des secteurs économiques. Les acteurs de <strong>la</strong> formation<br />
initiale et continue ont r<strong>en</strong>forcé les li<strong>en</strong>s et les habitudes de travail <strong>en</strong>tre eux. Les<br />
lieux d’échanges <strong>en</strong>tre les décideurs sur <strong>la</strong> formation initiale et professionnelle se<br />
sont développés autour des objectifs fixés par le CPRDFP et le CRDE.<br />
L'é<strong>la</strong>boration d'une carte régionale des formations professionnelles s'est appuyée<br />
sur davantage de concertations. La formation des adultes demandeurs d’emploi<br />
ou <strong>en</strong> emploi permet de pallier les besoins de plus court terme, alors que <strong>la</strong><br />
formation initiale, qui r<strong>en</strong>contre toujours des freins <strong>pour</strong> adapter son offre,<br />
évolue plus l<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> fonction de besoins de plus long terme. Le PRES a<br />
<strong>en</strong>gagé, dès sa constitution, des actions structurantes qui ont <strong>pour</strong> effet de lui<br />
donner une visibilité nationale, voire internationale <strong>pour</strong> certaines spécialités. Les<br />
bourses doctorales sont maint<strong>en</strong>ues à un niveau élevé.<br />
On assiste à une mise <strong>en</strong> réseau efficace des acteurs de <strong>la</strong> recherche, dans un<br />
contexte europé<strong>en</strong> dynamique, à l’échelle de l’axe Paris Seine <strong>Normandie</strong>. La<br />
réindustrialisation et <strong>la</strong> relocalisation des activités favoris<strong>en</strong>t le mainti<strong>en</strong> des<br />
activités de recherche, voire le retour de <strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> région.<br />
La formation étant mieux rémunérée, les jeunes se form<strong>en</strong>t davantage dans les<br />
systèmes de formation initiale et continue, ce qui diminue <strong>la</strong> dichotomie du tissu<br />
social du territoire. Le travail non officiel est fortem<strong>en</strong>t freiné puisque le marché<br />
du travail permet une insertion plus facile à tous les demandeurs d'emploi.<br />
4/ Effets sociaux issus de <strong>la</strong> situation économique favorable<br />
L'insertion plus facile des offreurs de travail sur le marché inverse un certain<br />
mouvem<strong>en</strong>t de ghettoïsation subi par certaines villes au début du siècle. Il<br />
s'<strong>en</strong>suit une baisse des incivilités (dégradation des bi<strong>en</strong>s publics et privés), des<br />
viol<strong>en</strong>ces (crimes, vols, viol<strong>en</strong>ces conjugales,...), des externalités négatives<br />
(drogues, prostitution, alcoolisme,...).<br />
La région a retrouvé un ballon d'oxygène par cette évolution économique. Elle<br />
voit ses recettes fiscales augm<strong>en</strong>ter (hausse des rev<strong>en</strong>us des ménages et des<br />
sociétés, hausse de <strong>la</strong> consommation et re<strong>la</strong>tive stabilité de l'épargne). Les<br />
collectivités locales sont moins soumises au problème de <strong>la</strong> dette (équilibre<br />
budgétaire retrouvé, baisse du rapport dette/PRB).<br />
Les dép<strong>en</strong>ses, notamm<strong>en</strong>t sociales et de formation, des collectivités peuv<strong>en</strong>t<br />
rester re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t stables, voire augm<strong>en</strong>ter (meilleure couverture santé et<br />
retraite, amélioration de l'accès aux soins, investissem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> capital<br />
humain,...).<br />
Octobre 2012 174
Sc<strong>en</strong>ario S3<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> peut desserrer ses contraintes financières et augm<strong>en</strong>ter ses<br />
charges (personnel, consommation, investissem<strong>en</strong>ts et transferts), ce qui conduit<br />
à une amélioration de l'<strong>en</strong>semble de l'offre régionale vis-à-vis des citoy<strong>en</strong>s.<br />
La contrainte sur le système social, notamm<strong>en</strong>t de santé, est moins forte puisque<br />
les prélèvem<strong>en</strong>ts locaux peuv<strong>en</strong>t être plus importants dus à une augm<strong>en</strong>tation<br />
du nombre de sa<strong>la</strong>riés, une augm<strong>en</strong>tation des sa<strong>la</strong>ires, à des plus grande facilité<br />
de paiem<strong>en</strong>t et d'investissem<strong>en</strong>t des <strong>en</strong>treprises et ménages. La prise <strong>en</strong> charge<br />
de certaines popu<strong>la</strong>tions devi<strong>en</strong>t plus facile <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région (santé, famille,<br />
handicapés et troisième âge dép<strong>en</strong>dant, pauvreté, formation), d'autant plus<br />
qu'elle reste une région jeune. 50<br />
Les difficultés économiques desserrées font qu’on peut mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce des<br />
propositions de redéfinition des politiques sociales locales, certes délimitées par<br />
les politiques nationales.<br />
Parmi les mesures nationales prises <strong>pour</strong> adapter les modalités de financem<strong>en</strong>t<br />
des dép<strong>en</strong>ses de santé, une priorité nationale a été mise sur <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge<br />
du vieillissem<strong>en</strong>t. Ses effets sont positifs sur <strong>la</strong> situation de <strong>la</strong> région et les<br />
acteurs locaux ont pu flécher des financem<strong>en</strong>ts sur d’autres priorités locales <strong>en</strong><br />
agissant sur <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> matière de santé et sur <strong>la</strong> démographie médicale.<br />
Parmi les actions <strong>en</strong>gagées de concert au niveau national et local, une pression<br />
« efficace » sur les <strong>la</strong>boratoires pharmaceutiques qui sont <strong>en</strong>gagés sur <strong>la</strong><br />
réduction des coûts <strong>en</strong> préservant les activités prés<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> région.<br />
Le rationnem<strong>en</strong>t de l’offre (baisse du nombre de p<strong>la</strong>ces, de médecins, de<br />
prescriptions) est <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t comp<strong>en</strong>sé par une amélioration de <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et<br />
de l’organisation de l’accès aux premiers soins, sans <strong>en</strong>tacher <strong>la</strong> qualité de<br />
l’offre. Les retards de <strong>la</strong> région comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à être rattrapés.<br />
En matière de prév<strong>en</strong>tion, que ce soit dans <strong>la</strong> médecine du travail ou dans <strong>la</strong><br />
médecine sco<strong>la</strong>ire (fortem<strong>en</strong>t déficitaires <strong>en</strong> France) ou <strong>en</strong>core de l’éducation à <strong>la</strong><br />
santé, les systèmes de médecine prév<strong>en</strong>tive ont été régénérés, appuyés par une<br />
interv<strong>en</strong>tion des acteurs locaux qui ont fixé des priorités avec certains secteurs<br />
professionnels ou sur certaines zones sco<strong>la</strong>ires où les besoins étai<strong>en</strong>t f<strong>la</strong>grants.<br />
Des moy<strong>en</strong>s locaux ont été fléchés sur <strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> pointe, notamm<strong>en</strong>t au<br />
CHUR, ainsi que sur <strong>la</strong> valorisation de <strong>la</strong> recherche des <strong>la</strong>boratoires. Les progrès<br />
sont facilités par <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> synergie des compét<strong>en</strong>ces au sein des <strong>la</strong>boratoires<br />
de l’espace Paris Seine <strong>Normandie</strong>. La région bénéficie des retombées de ses<br />
découvertes <strong>en</strong> termes d’attractivité.<br />
L’âge et <strong>la</strong> morbidité recul<strong>en</strong>t de façon plus ou moins équilibrée. Il a été créé un<br />
diplôme « infirmier clinici<strong>en</strong> » interv<strong>en</strong>ant <strong>en</strong> première ligne <strong>pour</strong> donner les<br />
soins courants et assurer <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge des pathologies chroniques. Les<br />
maisons de santé se sont développées de façon équilibrée sur le territoire.<br />
Le numerus c<strong>la</strong>usus a été augm<strong>en</strong>té dans <strong>la</strong> région depuis plus de dix ans et les<br />
formés <strong>en</strong> médecine générale et spécialités comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à s’installer sur le<br />
territoire régional grâce à des mesures incitatives d’aide à l’instal<strong>la</strong>tion.<br />
Le lobbying exercé par les acteurs locaux au niveau national a permis de rétablir<br />
un rééquilibre dans l’attribution des quotas des formations paramédicales <strong>en</strong><br />
faveur de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et <strong>la</strong> Région a pu procéder à leur répartition sur<br />
les territoires de manière équilibrée selon les besoins.<br />
Les coopérations <strong>en</strong>tre les professionnels de santé s’organis<strong>en</strong>t et contribu<strong>en</strong>t à<br />
r<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> région plus attractive <strong>pour</strong> les nouveaux diplômés.La démographie<br />
médicale s’est améliorée compte t<strong>en</strong>u des retards que connaissait <strong>la</strong> région.<br />
50 Cf. fiches variable offre de soin (les politiques sociales) et démographie<br />
Octobre 2012 175
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Le système mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>pour</strong> limiter le nombre de pratici<strong>en</strong>s non conv<strong>en</strong>tionnés<br />
sur le territoire contribue dans ce contexte d’attractivité retrouvée à limiter les<br />
inégalités dans l’offre de soins. Les maisons de santé se sont développées et sont<br />
le lieu habituel d’accès au soin primaire.<br />
5/ L'impact <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal et les énergies<br />
Pour maint<strong>en</strong>ir une politique de développem<strong>en</strong>t durable, les pouvoirs publics sont<br />
très prés<strong>en</strong>ts. Ils tir<strong>en</strong>t leurs ressources de <strong>la</strong> croissance. Le pot<strong>en</strong>tiel industriel<br />
de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur. La Région est l’interlocutrice de l’Etat<br />
au nom des autres collectivités territoriales Haut Normandes.<br />
Sur le p<strong>la</strong>n <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal, les effets peuv<strong>en</strong>t se contreba<strong>la</strong>ncer et <strong>la</strong> situation<br />
reste contrastée : <strong>la</strong> région, du fait de sa production industrielle et malgré des<br />
efforts sout<strong>en</strong>us, reste fortem<strong>en</strong>t émettrice de gaz à effet de serre.<br />
En effet, d'un côté, <strong>la</strong> hausse de <strong>la</strong> production et des services liés a conduit à<br />
une augm<strong>en</strong>tation des nuisances (pollution de l'air, de l'eau, nuisances<br />
sonores,...).<br />
Cep<strong>en</strong>dant, d'autre part, les <strong>en</strong>treprises peuv<strong>en</strong>t, par le développem<strong>en</strong>t de<br />
leurs activités, investir dans des combinaisons de production <strong>en</strong>traînant moins<br />
d'externalités négatives sur l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (hausse de l’investissem<strong>en</strong>t dans<br />
des démarches de développem<strong>en</strong>t durable). Notamm<strong>en</strong>t, le développem<strong>en</strong>t des<br />
énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles est possible avec les champs d’éoli<strong>en</strong> <strong>en</strong> mer qui<br />
fonctionn<strong>en</strong>t à plein régime depuis au moins 5 ans.<br />
6/ les flux migratoires<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> réussit à inverser les flux migratoires (moins de sorties et<br />
plus d'<strong>en</strong>trées de jeunes qualifiés sur le territoire normand).<br />
7/ le rayonnem<strong>en</strong>t culturel et <strong>la</strong> « gouvernance » au s<strong>en</strong>s de<br />
l’appropriation de l’id<strong>en</strong>tité<br />
Une coordination <strong>en</strong>tre décideurs politiques et acteurs culturels se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
sous l’effet de <strong>la</strong> réforme territoriale, une capacité politique de changem<strong>en</strong>t est<br />
avérée chez les acteurs qui se concert<strong>en</strong>t, mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce des politiques<br />
culturelles aux différ<strong>en</strong>ts échelons, optimis<strong>en</strong>t les ressources rares et les<br />
financem<strong>en</strong>ts, rationalis<strong>en</strong>t leurs interv<strong>en</strong>tions et opèr<strong>en</strong>t des choix forts.<br />
Les coopérations dépass<strong>en</strong>t le territoire régional, à l’image du tourisme <strong>la</strong> culture<br />
est portée à l’échelle interrégionale, voire à l’échelle du projet Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>.<br />
Dans le domaine culturel, c’est bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> fin de « l’exception culturelle à <strong>la</strong><br />
Française » et l’ouverture du secteur sur <strong>la</strong> sphère économique <strong>en</strong>traine un<br />
cercle vertueux dans lequel les intérêts sont partagés et compris par tous les<br />
acteurs quant aux retombées <strong>en</strong> terme d’attractivité <strong>pour</strong> le territoire.<br />
La culture ne reste pas isolée, elle est considérée comme une exception plutôt<br />
bi<strong>en</strong> sout<strong>en</strong>ue par les élus et est intégrée comme une composante naturelle de<br />
chaque acte de <strong>la</strong> société, comme élém<strong>en</strong>t d’attractivité au même titre qu’un<br />
service public comme une crèche ou une école.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des pratiques de recours au numérique véhicul<strong>en</strong>t l’image<br />
d’une région dynamique, accompagn<strong>en</strong>t les efforts des professionnels et<br />
répond<strong>en</strong>t aux att<strong>en</strong>tes des publics friands de découverte et d’une offre de<br />
services coordonnée. Evénem<strong>en</strong>ts régionaux et nationaux s’<strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t l’un<br />
l’autre, les retombées extérieures r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’id<strong>en</strong>tité des (hauts)<br />
normands.<br />
Octobre 2012 176
Sc<strong>en</strong>ario S4<br />
IV - Sc<strong>en</strong>ario S4 : « L'euphorie normande »<br />
Après une période de crise financière et économique (2007 – 2014), les Etats et<br />
les ag<strong>en</strong>ts économiques ont repris confiance <strong>en</strong> l'av<strong>en</strong>ir. La croissance s'est<br />
<strong>en</strong>suite accélérée et les échanges internationaux (importations et exportations)<br />
se sont développés plus rapidem<strong>en</strong>t que le PIB mondial. Tous les pays ont<br />
bénéficié de cette déc<strong>en</strong>nie « glorieuse » qui a permis l'élévation des rev<strong>en</strong>us<br />
moy<strong>en</strong>s nationaux et le développem<strong>en</strong>t des c<strong>la</strong>sses moy<strong>en</strong>nes.<br />
Les pays à hauts rev<strong>en</strong>us, <strong>en</strong> début de période, ont pu de ce fait exporter<br />
davantage et, notamm<strong>en</strong>t, des bi<strong>en</strong>s de luxe et de haute technicité, c'est-à-dire<br />
à forte valeur ajoutée. L'Europe s'est r<strong>en</strong>forcée p<strong>en</strong>dant toute cette période, se<br />
dés<strong>en</strong>dettant tout <strong>en</strong> augm<strong>en</strong>tant les dép<strong>en</strong>ses étatiques dans le domaine social<br />
et <strong>la</strong> formation. Cette période de croissance économique mondiale a conduit à<br />
une réduction des t<strong>en</strong>sions politiques aussi bi<strong>en</strong> mondiales qu'internes aux<br />
différ<strong>en</strong>ts pays et zones.<br />
Les pays les moins riches au début de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>nie 2010 ont connu égalem<strong>en</strong>t<br />
une amélioration de leur situation, ce qui a fortem<strong>en</strong>t impulsé <strong>la</strong> demande<br />
mondiale. Le progrès technique et <strong>la</strong> découverte de nouveaux gisem<strong>en</strong>ts de<br />
facteurs de production et de sources d'énergies ont permis de limiter les t<strong>en</strong>sions<br />
sur les prix et ainsi favoriser le développem<strong>en</strong>t harmonieux de <strong>la</strong> production<br />
mondiale.<br />
L'Europe, <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> tir<strong>en</strong>t leurs épingles du jeu de ce<br />
contexte économique favorable. La France et ses régions a connu une longue<br />
phase continue de croissance de son PIB. Dans l'analyse qui suit, elle se produit<br />
après une forte accélération et un assainissem<strong>en</strong>t du mouvem<strong>en</strong>t de<br />
mondialisation des économies avec un plus <strong>la</strong>rge accès aux différ<strong>en</strong>ts marchés<br />
(suppression totale des droits de douanes, quotas, normes,...un contrôle et une<br />
rationalité plus développés des politiques d'ouverture).<br />
1/ Les grands projets d'infrastructure<br />
L’Europe des Etats est aussi l’Europe des Régions. Grâce à une forme appropriée<br />
de l’utilisation des crédits, les projets à long terme ont re<strong>la</strong>ncé une politique<br />
économique plus interv<strong>en</strong>tionniste. Les projets stimu<strong>la</strong>nt à <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> concurr<strong>en</strong>ce<br />
et <strong>la</strong> coopération <strong>en</strong>tre les régions à l’échelle de l’Europe sont <strong>en</strong>couragés par<br />
l’Union Europé<strong>en</strong>ne. Le pot<strong>en</strong>tiel de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> est mis <strong>en</strong> valeur.<br />
Les projets « Paris Seine <strong>Normandie</strong> » ont fini par s’imposer. Adossée aux<br />
infrastructures éoli<strong>en</strong>nes et à <strong>la</strong> LNPN, <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> connaît une nouvelle<br />
notoriété qu’elle a su accompagner d’évènem<strong>en</strong>ts culturels de portée<br />
internationale. Ces nouvelles infrastructures sont aussi bénéfiques <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong><br />
que <strong>pour</strong> <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong>. La recherche privée et publique normande<br />
s’organise et devi<strong>en</strong>t l’une des six premières <strong>en</strong> France. De fait, <strong>la</strong> coopération<br />
devi<strong>en</strong>t une évid<strong>en</strong>ce y compris avec l’Ile de France.<br />
La massification des transports internationaux et notamm<strong>en</strong>t les transports<br />
maritimes font du Havre une des portes maritimes importantes de l’Europe<br />
occid<strong>en</strong>tale. Cet objectif a pu être atteint par l'action de l’Etat et des Régions<br />
avoisinantes.<br />
Les pays occid<strong>en</strong>taux ont retrouvé <strong>la</strong> croissance. Croissance et développem<strong>en</strong>t<br />
durable sont compatibles. Pour maint<strong>en</strong>ir une politique de développem<strong>en</strong>t<br />
durable, les pouvoirs publics sont très prés<strong>en</strong>ts. Ils tir<strong>en</strong>t leurs ressources de <strong>la</strong><br />
croissance.<br />
Les grands projets d'infrastructure ont été réalisés ainsi que le mail<strong>la</strong>ge territorial<br />
et <strong>la</strong> multimodalité est réussie. Les flux irrigu<strong>en</strong>t tout le territoire. Les<br />
Octobre 2012 177
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
contournem<strong>en</strong>ts et raccordem<strong>en</strong>ts sont réalisés. La sécurité est augm<strong>en</strong>tée. Les<br />
connexions aux modes doux font l’objet de toutes les att<strong>en</strong>tions. Les<br />
raccordem<strong>en</strong>ts aux réseaux à grande vitesse europé<strong>en</strong> profit<strong>en</strong>t à tous grâce au<br />
développem<strong>en</strong>t des lignes infrarégionales.<br />
On note une optimisation du trafic fret grâce à l’imp<strong>la</strong>ntation d’un terminal de<br />
transport combiné <strong>en</strong> région. Les travaux de mise à niveau des ouvrages de <strong>la</strong><br />
Seine sont réalisés, le Canal Seine Nord ne se fait pas aussi vite que prévu. Les<br />
parts de marché augm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t. Port 2000 a réussi à capter des tonnages<br />
jusqu’alors <strong>destin</strong>és aux ports du Nord grâce au développem<strong>en</strong>t des liaisons vers<br />
son hinter<strong>la</strong>nd et aux ports secondaires qui jou<strong>en</strong>t leur rôle dans le cabotage le<br />
long d’une autoroute de <strong>la</strong> Mer vers l’Espagne. Le trafic passager s’int<strong>en</strong>sifie <strong>pour</strong><br />
le transmanche Le trafic transat<strong>la</strong>ntique se développe.<br />
Les accès ferroviaires et routiers à l’aéroport de Deauville sont réalisés. Il devi<strong>en</strong>t<br />
l’aéroport international utilisé par les décideurs du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong><br />
qui lou<strong>en</strong>t son accès fluide. L'aérodrome de Boos garde et développe sa<br />
p<strong>la</strong>teforme médicale <strong>pour</strong> les greffes pratiquées au CHU.<br />
L’EPR de P<strong>en</strong>ly s'est fait et <strong>la</strong> Région a anticipé et accompagné ce grand projet :<br />
formation des jeunes et des actifs <strong>en</strong> recherche d'emploi sur le bassin dieppois et<br />
au niveau régional <strong>pour</strong> <strong>la</strong> phase chantier, anticipation des reconversions post<br />
chantier par id<strong>en</strong>tification des compét<strong>en</strong>ces acquises et report sur d'autres<br />
"grands chantiers" régionaux ou hors région, formation <strong>en</strong> amont de personnels<br />
qualifiés <strong>pour</strong> l'exploitation du site post chantier. De ce fait, le projet a été bi<strong>en</strong><br />
accepté compte t<strong>en</strong>u de ses retombées à court, moy<strong>en</strong> et long termes.<br />
Grâce à l’innovation portée par le CRIHAN, La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> devi<strong>en</strong>t une<br />
région pilote dans le domaine des e-services qui se développ<strong>en</strong>t dans tous les<br />
domaines et sur tout le territoire.<br />
Un des objectifs du SCORAN répondait à l’ambition nationale de proposer un<br />
accès très haut débit à l’<strong>en</strong>semble des foyers, selon les technologies les plus<br />
adaptées aux territoires. Cet objectif a été réalisé dans les temps impartis par<br />
une conc<strong>en</strong>tration des moy<strong>en</strong>s de tous les interv<strong>en</strong>ants et une accélération du<br />
rythme, favorisant un aménagem<strong>en</strong>t équilibré du territoire ainsi qu’une équité<br />
d’accès au Très Haut Débit. Les TIC ont facilité <strong>la</strong> déconc<strong>en</strong>tration de certaines<br />
activités depuis les c<strong>en</strong>tres urbains vers des territoires moins d<strong>en</strong>ses contribuant<br />
ainsi à un aménagem<strong>en</strong>t du territoire plus harmonieux.<br />
Des infrastructures performantes et apportant une garantie de services optimale<br />
ont été mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, offrant ainsi aux communes rurales les mêmes conditions<br />
que celles offertes aux grands c<strong>en</strong>tres urbains.<br />
Le THD et l’apport des TIC dans le cadre de projets territoriaux assur<strong>en</strong>t une<br />
nouvelle dim<strong>en</strong>sion au projet <strong>en</strong> favorisant les échanges (p<strong>la</strong>te-forme<br />
col<strong>la</strong>borative,…), <strong>en</strong> démultipliant les supports de communication (site Internet,<br />
site Internet mobile, application mobile embarquée,…) et <strong>en</strong> offrant de nouveaux<br />
services par l’apport de technologies nouvelles (géo localisation,…).<br />
Des outils de travail fonctionn<strong>en</strong>t depuis plusieurs années dans une logique de<br />
mutualisation (comme par exemple : les télésoins et <strong>la</strong> téléassistance à domicile)<br />
et d’interopérabilité des systèmes d’information (télé imagerie,…). Les<br />
architectures complètes sont sécurisées et assur<strong>en</strong>t une continuité de service<br />
dans des conditions maximales de sécurité. Compte t<strong>en</strong>u de certaines politiques<br />
publiques dans le domaine de l’action sociale relevant directem<strong>en</strong>t du domaine<br />
de compét<strong>en</strong>ces de collectivités locales (Conseils Généraux,…), il apparaît<br />
primordial que l’action des acteurs publics soit réalisée de manière cohér<strong>en</strong>te et<br />
concertée.<br />
Octobre 2012 178
Sc<strong>en</strong>ario S4<br />
Les <strong>en</strong>jeux s’appliqu<strong>en</strong>t aussi bi<strong>en</strong> aux services à <strong>destin</strong>ation des citoy<strong>en</strong>s qu’aux<br />
re<strong>la</strong>tions <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>tes administrations. Le THD facilite les échanges et<br />
l’instruction de dossiers administratifs. Il favorise égalem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce de<br />
nouveaux services à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à l’image des dispositifs d’alertes et de gestion<br />
de crise.<br />
La pose de fourreaux dans le cadre de travaux de génie civil est un plus.<br />
L’<strong>en</strong>semble des élus locaux ont été s<strong>en</strong>sibilisés à ces <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts qui sont<br />
m<strong>en</strong>tionnés dans les SCOT.<br />
Ces développem<strong>en</strong>ts ont égalem<strong>en</strong>t permis l'amélioration des supports <strong>en</strong><br />
matière d’éducation et d’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t. L’acc<strong>en</strong>t a été mis sur <strong>la</strong> maint<strong>en</strong>ance<br />
des outils mis à disposition du primaire et du secondaire. Le THD assure une<br />
équité d’accès au service. Il facilite <strong>la</strong> consultation des ressources <strong>en</strong> simultané<br />
(ex : podcast) et <strong>la</strong> visioconfér<strong>en</strong>ce dev<strong>en</strong>ue incontournable dans l’appr<strong>en</strong>tissage<br />
des <strong>la</strong>ngues (re<strong>la</strong>tions avec des élèves d’autres c<strong>la</strong>sses à l’étranger).<br />
La vidéosurveil<strong>la</strong>nce s’est généralise (CODAH, CREA, CA Seine-Eure). Elle repose<br />
généralem<strong>en</strong>t sur l’architecture fibre développée par les agglomérations. Les<br />
collectivités ont r<strong>en</strong>forcé leur politique d’e-administration <strong>en</strong> développant les<br />
services aux citoy<strong>en</strong>s (p<strong>la</strong>te-forme de services web, télé procédures,…) et <strong>en</strong><br />
modernisant les échanges avec les autres administrations (dématérialisation de<br />
procédures). Les EPCI ont acc<strong>en</strong>tué et facilité leurs échanges avec leurs<br />
communes membres (systèmes d’information géographique partagé, extranet,<br />
modernisation des échanges de docum<strong>en</strong>ts, p<strong>la</strong>te-forme, mutualisée de marchés<br />
publics,…).<br />
Des projets innovants ont été développés : « l’alerte box » (prév<strong>en</strong>tion des<br />
risques industriels) supportée par le réseau fibre de Gonfreville l’Orcher est<br />
généralisée au territoire régional. Les services numériques à <strong>la</strong> personne se<br />
développ<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t.<br />
Cet <strong>en</strong>semble d'outils novateurs a permis d'accroître les richesses et l’activité<br />
économique du territoire. Beaucoup d’<strong>en</strong>treprises considèr<strong>en</strong>t le manque de débit<br />
comme rédhibitoire lors d’un choix d’imp<strong>la</strong>ntation.<br />
Les acteurs observ<strong>en</strong>t un problème général d’acculturation sur les pot<strong>en</strong>tialités<br />
de services offertes par le très haut débit, expliquant <strong>en</strong> partie le peu de projets<br />
FTTH ou THD mis <strong>en</strong> œuvre par les collectivités locales au profit de projets de<br />
montée <strong>en</strong> débit et de couverture des zones d’ombre. Une politique volontariste<br />
<strong>en</strong> matière de THD a contribué à créer de <strong>la</strong> valeur ajoutée économique et à<br />
donner une image valorisante de précurseur à <strong>la</strong> Région.<br />
Les chercheurs, répartis sur tout le territoire, mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce des projets à<br />
dim<strong>en</strong>sion interrégionale. Le stockage et les échanges de données constitu<strong>en</strong>t<br />
des problématiques importantes. Les besoins <strong>en</strong> calcul numérique et <strong>en</strong><br />
traitem<strong>en</strong>t de données ne cess<strong>en</strong>t d’augm<strong>en</strong>ter (post traitem<strong>en</strong>t dynamique).<br />
Cette t<strong>en</strong>dance nécessite donc beaucoup plus d’interactivité <strong>en</strong>tre les acteurs.<br />
L’avènem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> connexion mobile, l’augm<strong>en</strong>tation constante des échanges de<br />
cont<strong>en</strong>us multimédias ou <strong>en</strong>core l’apparition de <strong>la</strong> TV <strong>Haute</strong> Définition et de <strong>la</strong> TV<br />
3D sont des exemples d’usages qui confort<strong>en</strong>t <strong>la</strong> nécessité de se doter<br />
d’infrastructures plus performantes permettant des échanges de plus <strong>en</strong> plus<br />
lourds. L’apport du THD a favorisé les projets limitant les empruntes carbones<br />
(visioconfér<strong>en</strong>ce) et les consommations énergétiques (« smart Grid »).<br />
2/ Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u<br />
Il est évid<strong>en</strong>t qu'une croissance forte au niveau mondial sur longue période<br />
s'accompagne de créations d'activités dans les secteurs industriels historiques<br />
qui innov<strong>en</strong>t (automobile, métallurgie, raffinage et pétrochimie,...) et le<br />
Octobre 2012 179
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
bâtim<strong>en</strong>t, mais aussi dans des activités nouvelles développées dans<br />
l’aéronautique, <strong>la</strong> chimie fine, les équipem<strong>en</strong>ts de transport, l’économie verte...<br />
Ces créations d'activité conduis<strong>en</strong>t donc à une forte baisse du chômage par de<br />
fortes créations d'emplois qualifiés et non qualifiés. 51<br />
La croissance d'un emploi « industriel » a des externalités positives sur le secteur<br />
tertiaire marchand et, notamm<strong>en</strong>t, dans les secteurs de logistique industrielle<br />
(activités portuaires, transport de marchandises,...), mais aussi dans les secteurs<br />
de proximité (aide ménagère, jardinier, petits boulots,...) <strong>en</strong> passant égalem<strong>en</strong>t<br />
par le commerce.<br />
La hausse de l'emploi dans l'économie se traduit par des pressions fortes à <strong>la</strong><br />
hausse des sa<strong>la</strong>ires et par une amélioration de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital.<br />
La hausse des sa<strong>la</strong>ires accroît fortem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> consommation des ménages<br />
amplifiant le processus de croissance. Le nombre des ménages français, pouvant<br />
être considérés comme vivants au seuil de pauvreté ou <strong>en</strong> dessous (12%<br />
aujourd'hui), a nettem<strong>en</strong>t diminué (8%). Même si les coûts du logem<strong>en</strong>t, de<br />
l'eau, gaz et électricité se sont accrus du fait d'une forte concurr<strong>en</strong>ce mondiale<br />
sur les énergies et de <strong>la</strong> plus grande rareté de ces ressources énergétiques, les<br />
contraintes financières apparaiss<strong>en</strong>t moins fortes.<br />
La baisse du chômage s'est traduite par une diminution de sa durée, permettant<br />
de mieux indemniser les demandeurs d'emploi <strong>en</strong> niveau et dans le temps. La<br />
précarisation du travail se réduit <strong>pour</strong> l'<strong>en</strong>semble de <strong>la</strong> société, tous secteurs et<br />
toutes qualifications confondus.<br />
La hausse de <strong>la</strong> r<strong>en</strong>tabilité du capital productif permet d'accélérer<br />
l'investissem<strong>en</strong>t des <strong>en</strong>treprises qui amélior<strong>en</strong>t leur compétitivité dans de<br />
multiples domaines (R&D, innovations, production,...). Ce mouvem<strong>en</strong>t<br />
particulièrem<strong>en</strong>t fort dans les grandes <strong>en</strong>treprises se propage égalem<strong>en</strong>t aux<br />
PMI, notamm<strong>en</strong>t les sous-traitantes qui voi<strong>en</strong>t leurs activités progresser à un<br />
rythme sout<strong>en</strong>u. Le tissus artisanal se développe sur des secteurs porteurs sur le<br />
p<strong>la</strong>n technologique et plus traditionnels et à forte valeur ajoutée. De plus, une<br />
relocalisation de certaines activités n'est pas exclue, puisque <strong>la</strong> hausse de<br />
r<strong>en</strong>tabilité du capital fait que les firmes multinationales s'imp<strong>la</strong>nt<strong>en</strong>t dans des<br />
zones d'investissem<strong>en</strong>t où le travail, bi<strong>en</strong> que plus cher, est qualifié et donc plus<br />
effici<strong>en</strong>t.<br />
La hausse du coût de l’énergie est <strong>la</strong> conséqu<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> forte concurr<strong>en</strong>ce<br />
mondiale sur les énergies et de <strong>la</strong> plus grande rareté des ressources<br />
énergétiques, n'est pas <strong>pour</strong> autant un élém<strong>en</strong>t récessif. Le marché intérieur<br />
europé<strong>en</strong>, à lui seul, suffit <strong>pour</strong> <strong>en</strong>visager <strong>la</strong> ré industrialisation de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong>. La stratégie à l’international poussée par les institutionnels <strong>en</strong> li<strong>en</strong><br />
avec les filières et les <strong>en</strong>treprises, appuyée par une stratégie off<strong>en</strong>sive auprès<br />
des investisseurs étrangers, r<strong>en</strong>force l’attractivité vers les <strong>en</strong>treprises<br />
étrangères.<br />
Les filières qui compos<strong>en</strong>t l’id<strong>en</strong>tité industrielle dominante régionale : secteur<br />
automobile, pièces détachées aéronautique et spatial, verre, pétrochimie et<br />
pharmacie, ont réussi leur mutation <strong>en</strong> intégrant de nouvelles technologies :<br />
combustion propre, moteur électrique, nouveaux process,… Ces secteurs sont à<br />
<strong>la</strong> fois porteurs de croissance et d’emplois (portuaire et logistique, chimie,<br />
biotechnologies, santé pharmacie, énergies nouvelles…).<br />
3/ Formation et Société de <strong>la</strong> connaissance<br />
La formation étant mieux rémunérée, les jeunes se form<strong>en</strong>t davantage dans les<br />
51 Cf. Fiche variable sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion croissance / emploi / chômage<br />
Octobre 2012 180
Sc<strong>en</strong>ario S4<br />
systèmes de formation initiale et continue, ce qui diminue <strong>la</strong> dichotomie de <strong>la</strong><br />
société. Le travail non officiel est fortem<strong>en</strong>t freiné puisque le marché du travail<br />
permet une insertion plus facile à tous les demandeurs d'emploi.<br />
On assiste à une insertion plus facile des offreurs de travail sur le marché, ce qui<br />
inverse le mouvem<strong>en</strong>t de ghettoïsation subi par certaines villes au début du<br />
siècle. Il s'<strong>en</strong>suit une baisse des incivilités (dégradation des bi<strong>en</strong>s publics et<br />
privés), des viol<strong>en</strong>ces (crimes, vols, viol<strong>en</strong>ces conjugales,...), des externalités<br />
négatives (drogues, prostitution, alcoolisme,...).<br />
L’élévation des niveaux de formation initiale et de qualification des actifs a été<br />
significative et les opportunités structurelles qu’offrait l’économie régionale ont<br />
permis, grâce à <strong>la</strong> coordination de tous les acteurs de l’ori<strong>en</strong>tation, de <strong>la</strong><br />
formation, de l’emploi, de pr<strong>en</strong>dre de l’avance sur <strong>la</strong> moy<strong>en</strong>ne des régions qui ne<br />
disposai<strong>en</strong>t pas des mêmes ressources. La formation est un des piliers qui<br />
permettra à <strong>la</strong> région de relever le défi de <strong>la</strong> société de <strong>la</strong> connaissance.<br />
Les niveaux de sortie de formation initiale ainsi que le volume de formés par<br />
niveau se sont accrus. Les jeunes sort<strong>en</strong>t davantage diplômés qu’<strong>en</strong> moy<strong>en</strong>ne <strong>en</strong><br />
France et les taux de <strong>pour</strong>suite d’étude et de sco<strong>la</strong>risation dans l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t<br />
supérieur progress<strong>en</strong>t significativem<strong>en</strong>t.<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> devi<strong>en</strong>t attractive et les emplois offerts permett<strong>en</strong>t aux<br />
jeunes de s’insérer <strong>en</strong> nombre.<br />
La notion de FTLV est <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t intégrée par les <strong>en</strong>treprises et les individus qui<br />
ont été confortés lors des appr<strong>en</strong>tissages fondam<strong>en</strong>taux dans leur capacité<br />
d’appr<strong>en</strong>dre à appr<strong>en</strong>dre tout au long de <strong>la</strong> vie.<br />
L'appareil de formation initiale et continue adapte son offre au volume des<br />
personnes à former et <strong>en</strong> fonction des reconversions opérées dans <strong>la</strong> région et il<br />
anticipe les besoins à moy<strong>en</strong> long terme. Les qualifications sont adaptées aux<br />
besoins des secteurs <strong>en</strong> forte mutation et pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>en</strong> compte les nouvelles<br />
exig<strong>en</strong>ces du développem<strong>en</strong>t durable.<br />
Le développem<strong>en</strong>t durable est intégré dans l’offre de formation professionnelle<br />
initiale ou continue et dans les référ<strong>en</strong>tiels de certification <strong>en</strong> cib<strong>la</strong>nt<br />
prioritairem<strong>en</strong>t les secteurs et filières clés nécessitant des évolutions fortes et<br />
rapides. L'appareil de formation adapte son offre <strong>en</strong> fonction des reconversions<br />
de <strong>la</strong> région sur les éco-industries et le tertiaire.<br />
La GPEC dans les <strong>en</strong>treprises est un outil répandu de gestion des ressources<br />
humaines, mettant ainsi les individus <strong>en</strong> capacité de changer de secteur dans le<br />
respect de leurs aspirations personnelles. L’accès à <strong>la</strong> connaissance comme<br />
l’acquisition de compét<strong>en</strong>ces professionnelles sont valorisées.<br />
La formation initiale, davantage <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec le monde économique, a r<strong>en</strong>forcé<br />
l’éducation à l’ori<strong>en</strong>tation et l’évaluation par les acquis qui r<strong>en</strong>force les facultés<br />
d’appr<strong>en</strong>tissage des savoirs.<br />
Des spécialités se structur<strong>en</strong>t autour de nouveaux besoins économiques<br />
régionaux <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec l’importance avec <strong>la</strong> façade maritime, du projet Paris<br />
Seine <strong>Normandie</strong>, de l’énergie, de <strong>la</strong> logistique.<br />
En particulier, une filière complète maritime/fluvial/pêche/mer s’est structurée et<br />
développée à partir du pot<strong>en</strong>tiel de formation existant <strong>pour</strong> accompagner les<br />
besoins liés à <strong>la</strong> filière de l’éoli<strong>en</strong> offshore.<br />
Les acteurs coordonnés à l’échelle régionale sur les politiques d’ori<strong>en</strong>tation<br />
re<strong>la</strong>y<strong>en</strong>t et diffus<strong>en</strong>t les besoins.<br />
Une évaluation des politiques publiques de formation est systématique <strong>pour</strong><br />
répondre aux objectifs de moy<strong>en</strong> long terme partagés par les différ<strong>en</strong>ts acteurs<br />
dans les lieux de concertation instaurés grâce aux différ<strong>en</strong>ts contrats régionaux ;<br />
Octobre 2012 181
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
le CPRDFP est l’outil de <strong>la</strong> démarche stratégique suivie et évaluée par le CCREFP.<br />
Le e-learning s’est développé avec les accès facilités au très haut débit et le<br />
monde <strong>en</strong>seignant a totalem<strong>en</strong>t adopté ces usages après une phase<br />
d’accompagnem<strong>en</strong>t professionnel volontariste autour de <strong>la</strong> formation à distance.<br />
Ces usages ont accompagné les int<strong>en</strong>tions de subsidiarité dans l’organisation<br />
territoriale des formations sur les sites spécialisés dès le niveau secondaire qui<br />
gagn<strong>en</strong>t <strong>en</strong> lisibilité tout <strong>en</strong> restant accessibles. C’est notamm<strong>en</strong>t le cas <strong>pour</strong> les<br />
<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts supérieurs au sein du PRES qui a m<strong>en</strong>é une politique volontariste<br />
structurante <strong>en</strong> faisant le choix de se positionner et de faire émerger des<br />
formations dans ses champs de compét<strong>en</strong>ce id<strong>en</strong>tifiés. La visibilité nationale,<br />
voire internationale <strong>pour</strong> certaines formations est acquise.<br />
Les bourses doctorales régionales sont r<strong>en</strong>forcées, certaines sont fléchées sur<br />
des thèmes <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec les problématiques du territoire haut-normand et les<br />
chercheurs bénéfici<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> part des part<strong>en</strong>aires locaux de mesures<br />
d’accompagnem<strong>en</strong>t social à <strong>la</strong> formation.<br />
On a assisté à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> réseau efficace des acteurs de <strong>la</strong> recherche dans un<br />
contexte europé<strong>en</strong> dynamique, à l’échelle Paris Seine <strong>Normandie</strong>. La ré<br />
industrialisation et <strong>la</strong> relocalisation des activités ont favorisé le mainti<strong>en</strong> des<br />
activités de recherche, voire le retour de <strong>la</strong> recherche.<br />
Ainsi, l'Etat et les régions ont retrouvé un ballon d'oxygène par cette évolution<br />
économique. L'Etat voit ses recettes fiscales augm<strong>en</strong>ter (hausse des rev<strong>en</strong>us des<br />
ménages et des sociétés, hausse de <strong>la</strong> consommation et re<strong>la</strong>tive stabilité de<br />
l'épargne). Chaque <strong>en</strong>tité est moins soumise au problème de <strong>la</strong> dette (équilibre<br />
budgétaire retrouvé, baisse du rapport dette/PIB). Leurs dép<strong>en</strong>ses, notamm<strong>en</strong>t<br />
sociales, peuv<strong>en</strong>t rester re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t stables, voire augm<strong>en</strong>ter (meilleure<br />
couverture santé et retraite, amélioration de l'accès aux soins, investissem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>en</strong> capital humain,...<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> peut desserrer les contraintes financières et augm<strong>en</strong>ter ses<br />
charges (personnel, consommation, investissem<strong>en</strong>ts et transferts), ce qui conduit<br />
à une amélioration de l'<strong>en</strong>semble de l'offre régionale vis-à-vis des citoy<strong>en</strong>s.<br />
4/ Effets sociaux issus de <strong>la</strong> situation économique favorable<br />
La contrainte sur le système social est moins forte puisque les cotisations sont à<br />
<strong>la</strong> hausse due à une augm<strong>en</strong>tation du nombre de cotisants, une augm<strong>en</strong>tation<br />
des sa<strong>la</strong>ires, à de plus grandes facilités de paiem<strong>en</strong>t des cotisations (<strong>en</strong>treprises<br />
et ménages) ou à moins d'exonérations de charges sociales dans certains<br />
secteurs. La prise <strong>en</strong> charge de certaines popu<strong>la</strong>tions devi<strong>en</strong>t plus facile <strong>pour</strong> les<br />
régions (santé, famille, handicapés et troisième âge dép<strong>en</strong>dant, pauvreté,<br />
formation). 52<br />
Parmi les mesures nationales prises <strong>pour</strong> adapter les modalités de financem<strong>en</strong>t<br />
des dép<strong>en</strong>ses de santé, une priorité nationale a été mise sur <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge<br />
du vieillissem<strong>en</strong>t. Ses effets sont positifs sur <strong>la</strong> situation de <strong>la</strong> région et les<br />
acteurs locaux ont pu flécher des financem<strong>en</strong>ts sur d’autres priorités locales <strong>en</strong><br />
agissant sur <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> matière de santé et sur <strong>la</strong> démographie médicale.<br />
Parmi les actions <strong>en</strong>gagées de concert au niveau national et local, une pression<br />
« efficace » sur les <strong>la</strong>boratoires pharmaceutiques qui sont <strong>en</strong>gagés sur <strong>la</strong><br />
réduction des coûts <strong>en</strong> préservant les activités prés<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> région.<br />
Le rationnem<strong>en</strong>t de l’offre (baisse du nombre de p<strong>la</strong>ces, de médecins, de<br />
prescriptions) est <strong>en</strong>tamé grâce à une amélioration de <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et de<br />
52 Cf. fiche variable offre de soins (les politiques sociales)<br />
Octobre 2012 182
Sc<strong>en</strong>ario S4<br />
l’organisation de l’accès aux premiers soins, sans <strong>en</strong>tacher <strong>la</strong> qualité de l’offre.<br />
Les retards de <strong>la</strong> région comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à être rattrapés.<br />
En matière de prév<strong>en</strong>tion, que ce soit dans <strong>la</strong> médecine du travail, <strong>la</strong> médecine<br />
sco<strong>la</strong>ire (fortem<strong>en</strong>t déficitaires <strong>en</strong> France), ou de l’éducation à <strong>la</strong> santé, les<br />
systèmes de médecine prév<strong>en</strong>tive sont généralisés, appuyés sur le dialogue<br />
social instauré au sein des <strong>en</strong>treprises ; les dépistages se sont systématisés et<br />
ce, de façon équilibrée <strong>en</strong>tre secteurs professionnels et <strong>en</strong>tre territoires de <strong>la</strong><br />
région. Ils pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t une part importante dans le recul des pathologies lourdes <strong>en</strong><br />
région.<br />
Les progrès techniques ont fait reculer l’âge d’apparition des pathologies. La<br />
Télésanté et <strong>la</strong> télémédecine se sont développées grâce à <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce du<br />
THD couvrant le territoire.<br />
En matière de démographie médicale, le légis<strong>la</strong>teur est interv<strong>en</strong>u <strong>pour</strong> créer un<br />
diplôme « ’infirmer clinici<strong>en</strong> » interv<strong>en</strong>ant <strong>en</strong> première ligne <strong>pour</strong> donner les<br />
soins courants et assurer <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> charge des pathologies chroniques. Les<br />
maisons de santé se sont développées de façon équilibrée sur le territoire. Le<br />
numerus c<strong>la</strong>usus a été augm<strong>en</strong>té dans <strong>la</strong> région depuis plus de dix ans et les<br />
formés <strong>en</strong> médecine générale et spécialités comm<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t à s’installer sur le<br />
territoire régional grâce à des mesures incitatives d’aide à l’instal<strong>la</strong>tion.<br />
Le lobbying exercé par les acteurs locaux au niveau national a permis de rétablir<br />
un rééquilibre dans l’attribution des quotas des formations paramédicales <strong>en</strong><br />
faveur de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et <strong>la</strong> Région a pu procéder à leur répartition sur<br />
les territoires de manière équilibrée selon les besoins.<br />
Les coopérations <strong>en</strong>tre les professionnels de santé s’organis<strong>en</strong>t et contribu<strong>en</strong>t à<br />
r<strong>en</strong>dre <strong>la</strong> région plus attractive <strong>pour</strong> les nouveaux diplômés. La démographie<br />
médicale s’est améliorée compte t<strong>en</strong>u des retards que connaissait <strong>la</strong> région.<br />
Le système mis <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>pour</strong> limiter le nombre de pratici<strong>en</strong>s non conv<strong>en</strong>tionnés<br />
sur le territoire contribue dans ce contexte d’attractivité retrouvée à limiter les<br />
inégalités dans l’offre de soins.<br />
L’usager du système de soin a un niveau de connaissance qui le r<strong>en</strong>d plus<br />
exig<strong>en</strong>t par rapport au traitem<strong>en</strong>t de ses demandes. L’adhésion de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
est acquise <strong>en</strong> matière de télésanté, de télémédecine, télé exam<strong>en</strong>, e-<br />
prescription… et de face-à-face avec le ou les professionnels de santé.<br />
5/ L'impact <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal et les énergies<br />
Sur le p<strong>la</strong>n <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal, les effets peuv<strong>en</strong>t se contreba<strong>la</strong>ncer. D'un côté, <strong>la</strong><br />
hausse de <strong>la</strong> production et des services liés comporte le risque d’une<br />
augm<strong>en</strong>tation des nuisances (pollution de l'air, de l'eau, nuisances sonores,...).<br />
Cep<strong>en</strong>dant, les <strong>en</strong>treprises peuv<strong>en</strong>t, par le développem<strong>en</strong>t de leur activité,<br />
investir dans des combinaisons de production <strong>en</strong>traînant moins d'externalités<br />
négatives sur l'<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (hausse de l’investissem<strong>en</strong>t dans des démarches<br />
de développem<strong>en</strong>t durable).<br />
Du côté des ménages, une véritable amélioration de l’habitat existant a été<br />
<strong>en</strong>gagée par les particuliers et par les organismes de logem<strong>en</strong>t social publics et<br />
privés (souti<strong>en</strong> à l’acquisition de logem<strong>en</strong>ts à basse consommation ou énergie<br />
positive et développem<strong>en</strong>t de formes locatives innovantes).<br />
Du côté des <strong>en</strong>treprises, <strong>la</strong> reprise économique ti<strong>en</strong>t davantage compte des<br />
considérations <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales. Les émissions de CO 2 recul<strong>en</strong>t fortem<strong>en</strong>t. Les<br />
techniques de stockage de CO 2 sont opérationnelles. 23% des énergies produites<br />
<strong>en</strong> France sont désormais issues des énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles (cf. objectif du<br />
Gr<strong>en</strong>elle de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t atteint).<br />
Octobre 2012 183
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les éco-<strong>en</strong>treprises devi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong> plus efficaces. Les modes de<br />
production et de consommation s’ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t vers une économie plus sobre <strong>en</strong><br />
ressources naturelles.<br />
L’affichage des caractéristiques <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales sur les produits de<br />
consommation courante ori<strong>en</strong>te les choix des consommateurs et souti<strong>en</strong>t les<br />
démarches d’éco-conception des <strong>en</strong>treprises. C’est le modèle qui s’impose peu à<br />
peu. On fait ici le pari du long terme : plus <strong>la</strong> richesse s’accroit, plus il est facile<br />
de choisir son énergie.<br />
Les <strong>en</strong>treprises régionales ont eu les moy<strong>en</strong>s de miser sur l’innovation. Les<br />
processus de production de bi<strong>en</strong>s et de services inclu<strong>en</strong>t une dim<strong>en</strong>sion<br />
« durable » ; les produits finis sont eux aussi « durables.<br />
Le Développem<strong>en</strong>t d’un réseau des trames vertes et bleues, à toutes les échelles<br />
de territoire, assure aux espèces une continuité territoriale leur permettant ainsi,<br />
de circuler, de s’alim<strong>en</strong>ter, de se reproduire et d’assurer leur survie, dans un<br />
contexte global de changem<strong>en</strong>t climatique et de fragm<strong>en</strong>tation des espaces.<br />
L’amélioration de <strong>la</strong> qualité paysagère, tant visuelle que par <strong>la</strong> diversité de <strong>la</strong><br />
flore est réelle.<br />
Dans notre région, le réchauffem<strong>en</strong>t climatique est freiné, <strong>en</strong> partie <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec<br />
une action internationale <strong>pour</strong> <strong>en</strong> limiter l’importance. Les mesures d’urbanisme<br />
sont fermes et on ne signale plus aucune construction dans les zones à risques.<br />
Les P<strong>la</strong>ns de Prév<strong>en</strong>tions des Risques Technologiques (PPRT) sont appliquées.<br />
Les innovations multiples et le développem<strong>en</strong>t des énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles ont eu<br />
<strong>pour</strong> conséqu<strong>en</strong>ce <strong>la</strong> fermeture de plusieurs c<strong>la</strong>ssés SEVESO.<br />
6/ les flux migratoires<br />
La <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> réussit à inverser les flux migratoires (moins de sorties et<br />
plus d'<strong>en</strong>trées de jeunes qualifiés sur le territoire normand), grâce à sa plus<br />
grande attractivité.<br />
7/ le rayonnem<strong>en</strong>t culturel et <strong>la</strong> « gouvernance » au s<strong>en</strong>s de<br />
l’appropriation de l’id<strong>en</strong>tité<br />
Une coordination <strong>en</strong>tre décideurs politiques et acteurs culturels se met <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
sous l’effet de <strong>la</strong> réforme territoriale. Une capacité politique de changem<strong>en</strong>t est<br />
avérée chez les acteurs qui se concert<strong>en</strong>t, mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce des politiques<br />
culturelles aux différ<strong>en</strong>ts échelons, optimis<strong>en</strong>t les ressources rares et les<br />
financem<strong>en</strong>ts, rationalis<strong>en</strong>t leurs interv<strong>en</strong>tions et opèr<strong>en</strong>t des choix forts.<br />
Les coopérations dépass<strong>en</strong>t le territoire régional, à l’image du tourisme <strong>la</strong> culture<br />
est portée à l’échelle interrégionale, voire à l’échelle du projet Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong>.<br />
La culture ne reste pas isolée, elle est considérée comme une exception plutôt<br />
bi<strong>en</strong> sout<strong>en</strong>ue par les élus et est intégrée comme une composante naturelle de<br />
chaque acte de <strong>la</strong> société, comme élém<strong>en</strong>t d’attractivité au même titre qu’un<br />
service public comme une crèche ou une école.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des pratiques de recours au numérique véhicul<strong>en</strong>t l’image<br />
d’une région dynamique, accompagn<strong>en</strong>t les efforts des professionnels et<br />
répond<strong>en</strong>t aux att<strong>en</strong>tes des publics friands de découverte et d’une offre de<br />
services coordonnée. Evènem<strong>en</strong>ts régionaux et nationaux s’<strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t l’un<br />
l’autre, les retombées extérieures r<strong>en</strong>forc<strong>en</strong>t le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’id<strong>en</strong>tité des (hauts)<br />
normands.<br />
Octobre 2012 184
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
Partie III<br />
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
L’ARCHITECTURE DES PROPOSITIONS :<br />
Comm<strong>en</strong>t elle est bâtie : explication des options prises selon <strong>la</strong> nature des sc<strong>en</strong>arii sur 1<br />
ou 2 projets « réalistes » <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
LES PRECONISATIONS<br />
1 - Les grands projets incontournables <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et au-delà<br />
• Accessibilité numérique<br />
• Energies<br />
• Autres grands projets d’infrastructures d’accessibilité – <strong>la</strong> thématique portuaire<br />
• Infrastructures routières et ferroviaires<br />
2 - L’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong> croissance<br />
• Formation<br />
• Recherche<br />
3 – Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u<br />
4 – L’Environnem<strong>en</strong>t, amélioration des bonnes pratiques<br />
5 - L’amélioration de l’accès aux soins, un passage indisp<strong>en</strong>sable <strong>pour</strong> rompre avec <strong>la</strong><br />
pénurie<br />
6 – Des flux migratoires inversés<br />
7 – Rayonnem<strong>en</strong>t culturel et tourisme comme vecteurs d’id<strong>en</strong>tité<br />
8 – La gouvernance du développem<strong>en</strong>t durable<br />
Octobre 2012 185
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 186
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
« En période de rigueur budgétaire, l’important n’est pas de ne plus dép<strong>en</strong>ser<br />
mais de faire les bons choix »<br />
L’ARCHITECTURE DES PROPOSITIONS :<br />
Dans le contexte mouvant et incertain que nous avons décrit, <strong>la</strong> définition<br />
d’<strong>en</strong>jeux stratégiques et <strong>la</strong> construction de propositions avec un horizon temporel<br />
rapproché et inchangé à <strong>2025</strong> a conduit à un exercice prospectif emprunt de<br />
réalisme, évitant les originalités provocatrices, mais ne s’interdisant pas<br />
quelques « paris » sur l’av<strong>en</strong>ir…<br />
Cet exercice sera utilem<strong>en</strong>t complété par les travaux à v<strong>en</strong>ir des différ<strong>en</strong>tes<br />
commissions du CESER qui ont <strong>la</strong>ncé des réflexions sur des sujets majeurs <strong>pour</strong><br />
le développem<strong>en</strong>t du territoire : accessibilité numérique, flux portuaires, PRES,<br />
services supérieurs, éducation popu<strong>la</strong>ire, illettrisme…<br />
A l’horizon <strong>2025</strong>, l’ess<strong>en</strong>tiel est de repérer et d’afficher quelles ambitions les<br />
acteurs, au premier rang desquels <strong>la</strong> Région, peuv<strong>en</strong>t porter <strong>pour</strong> être à <strong>la</strong><br />
hauteur des <strong>en</strong>jeux du dynamisme territorial défini comme le développem<strong>en</strong>t du<br />
territoire équilibré et respectueux de <strong>la</strong> qualité de vie.<br />
Parmi les 4 situations décrites à <strong>2025</strong>, les sc<strong>en</strong>arii S1 et S4 sont peu probables<br />
mais pas impossibles et correspond<strong>en</strong>t aux visions haute et basse de l’économie<br />
de demain.<br />
Dans les sc<strong>en</strong>arii S2 et S3, <strong>la</strong> situation est celle d’une amélioration du contexte<br />
économique mondial et national, dans <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> région peut pr<strong>en</strong>dre deux voies<br />
différ<strong>en</strong>tes suivant ses capacités d’anticipation, pas suffisantes <strong>pour</strong> se mettre <strong>en</strong><br />
situation de bénéficier des retombées de cette embellie (S2) ou suffisantes (S3).<br />
Ils ont été jugés « réalistes » <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et amèn<strong>en</strong>t à des<br />
propositions de plusieurs ordres sur nos possibilités de développem<strong>en</strong>t. Après<br />
un bref rappel du contexte, l’<strong>en</strong>jeu principal est mis <strong>en</strong> lumière, puis les réponses<br />
sont apportées aux questions suivantes :<br />
• quelles actions, quels leviers, quels acteurs …<strong>pour</strong> t<strong>en</strong>dre vers <strong>la</strong> situation<br />
<strong>en</strong> <strong>2025</strong> décrite dans le sc<strong>en</strong>ario S3, sc<strong>en</strong>ario audacieux et néanmoins<br />
atteignable,<br />
ou…<br />
• quel <strong>en</strong>jeu a minima, quel écueil éviter, quelles actions <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre <strong>pour</strong><br />
ne pas subir, ou du moins limiter, les problèmes r<strong>en</strong>contrés <strong>en</strong> <strong>2025</strong> et<br />
suggérés dans le sc<strong>en</strong>ario S2.<br />
Les propositions et leur hiérarchisation ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compte de l’état et de l’évolution<br />
des contraintes financières ainsi que des situations réglem<strong>en</strong>taires sur <strong>la</strong> période.<br />
Le contexte externe des deux sc<strong>en</strong>arii étant le même, les propositions sont bâties<br />
autour des effets de levier que <strong>pour</strong>ront générer les priorités et les choix opérés<br />
par les acteurs <strong>en</strong> région ou à l’échelon national, voire international.<br />
Elles ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t aussi compte de l’horizon re<strong>la</strong>tivem<strong>en</strong>t court de <strong>2025</strong>, soit un peu<br />
plus d’une déc<strong>en</strong>nie, durant <strong>la</strong>quelle tous les leviers existants n’auront pas le<br />
même poids effectif. En effet, le « temps de l’action », notamm<strong>en</strong>t de l’action<br />
publique, est souv<strong>en</strong>t long. De plus, <strong>la</strong> réduction des marges de manœuvre des<br />
Régions <strong>en</strong> matière de fiscalité locale, depuis les dernières réformes, est <strong>en</strong>core<br />
réc<strong>en</strong>te et permet difficilem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>visager quelle sera l’évolution des bases de <strong>la</strong><br />
seule ressource fiscale de <strong>la</strong> CVAE (Cotisation sur <strong>la</strong> Valeur Ajoutée des<br />
Entreprises).<br />
Octobre 2012 187
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
C’est au travers de docum<strong>en</strong>ts stratégiques dont dispose déjà <strong>la</strong> collectivité<br />
régionale ou de l’é<strong>la</strong>boration de différ<strong>en</strong>ts schémas, auxquels elle participe sur<br />
nombre de ses compét<strong>en</strong>ces propres ou sur des domaines de compét<strong>en</strong>ces<br />
actuellem<strong>en</strong>t partagées, qu’elle <strong>pour</strong>ra inclure les priorités ou moy<strong>en</strong>s d’action<br />
préconisés, infléchir le cas échéant leur déroulem<strong>en</strong>t ou peser sur les<br />
ori<strong>en</strong>tations stratégiques <strong>en</strong> cours de définition.<br />
Si les incertitudes sont <strong>en</strong>core grandes, quant à <strong>la</strong> prise <strong>en</strong> main par les<br />
décideurs d’un certain nombre de compét<strong>en</strong>ces nouvelles dans le contexte de<br />
l’annonce d’un nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation, les interrogations ont été posées<br />
sur <strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce de l’échelon régional ou plus local dans un certain nombre de<br />
champs d’interv<strong>en</strong>tions. Nous avons considéré que <strong>la</strong> « légitimité à agir »<br />
permettait de colorer, parfois et d’ores et déjà, le trait de certaines propositions.<br />
Enfin au travers des ressources fiscales de <strong>la</strong> CVAE, <strong>la</strong> Région garde un li<strong>en</strong> avec<br />
l’économie de son territoire et indirectem<strong>en</strong>t sur les capacités de cette économie<br />
à lui procurer des recettes.<br />
Nous affirmons des positions <strong>pour</strong> accompagner l’ambition d’une région dont <strong>la</strong><br />
position est confortée <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
LES PRECONISATIONS<br />
1 - Les grands projets incontournables <strong>pour</strong> <strong>la</strong> région et au-delà<br />
• Accessibilité numérique<br />
La t<strong>en</strong>dance lourde <strong>en</strong> matière d’accessibilité numérique est « <strong>la</strong><br />
connexion » comme mode économique et social. Les collectivités au travers du<br />
contrat « 276 », passé <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> Région et les Départem<strong>en</strong>ts, ont déjà affiché leur<br />
volontarisme. Ils ont pris des <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts à l’horizon de 15 ans <strong>pour</strong> faire<br />
progresser l’accessibilité au THD -Très Haut Débit- par palier via le raccordem<strong>en</strong>t<br />
par <strong>la</strong> fibre optique, qui reste « LA » technologie du THD.<br />
Pour autant, il convi<strong>en</strong>t de rappeler que <strong>la</strong> fibre optique ne permettra pas de<br />
couvrir l’intégralité du territoire. Des technologies dites « palliatives » devront<br />
alors être mises <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce. A cet égard, le satellite demeure le recours <strong>en</strong> cas<br />
d’impossibilité d’installer <strong>la</strong> fibre, même si le satellite induit des pertes <strong>en</strong> termes<br />
de flux et de qualité de réception.<br />
La priorité <strong>en</strong> région doit être accordée au déploiem<strong>en</strong>t du THD - et à ses usages<br />
sur tout le territoire. Dans une dynamique de territoire proposée dans le sc<strong>en</strong>ario<br />
S3, il faut contourner <strong>la</strong> phase de rattrapage de couverture <strong>en</strong> haut-débit <strong>pour</strong><br />
privilégier le « bond direct » vers le Très Haut Débit.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de créer les conditions de l’aménagem<strong>en</strong>t numérique<br />
du territoire totalem<strong>en</strong>t abouti <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, garantissant son accessibilité<br />
immatérielle et organisationnelle. Il accompagne <strong>la</strong> croissance sur l’<strong>en</strong>semble de<br />
<strong>la</strong> région dans le respect de l’équilibre territorial <strong>en</strong>tre espaces urbains et ruraux.<br />
Pour ce faire il ne peut être <strong>en</strong>visagé que de combler le fossé plutôt que de<br />
t<strong>en</strong>ter de le réduire. Prioriser ce choix d’investissem<strong>en</strong>t sur les autres types<br />
d’infrastructures comparativem<strong>en</strong>t plus couteuses, plus longues à mettre <strong>en</strong><br />
œuvre et dont <strong>la</strong> réalisation est soumise à des financem<strong>en</strong>ts coordonnés avec<br />
des choix d’aménagem<strong>en</strong>t nationaux, est une décision à <strong>la</strong> portée des acteurs<br />
locaux qui établiss<strong>en</strong>t leur stratégie dès 2012. Il faut <strong>pour</strong> ce<strong>la</strong> qu’ils pès<strong>en</strong>t<br />
Octobre 2012 188
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
fortem<strong>en</strong>t et de concert <strong>pour</strong> infléchir <strong>la</strong> vision <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t répandue du « pas à<br />
pas » qui porte <strong>en</strong> elle le risque de faire perdurer <strong>la</strong> « fracture numérique » <strong>en</strong><br />
maint<strong>en</strong>ant des zones qui auront toujours une technologie de retard.<br />
La question ne peut plus être « faut-il du THD partout ? » dans une région qui<br />
porte une ambition que tous doiv<strong>en</strong>t pouvoir partager <strong>en</strong> s’<strong>en</strong> appropriant tous<br />
les usages, y compris ceux des habitants les plus isolés <strong>pour</strong> lesquels<br />
l’accessibilité physique aux différ<strong>en</strong>ts services est parfois difficile.<br />
Nombre d’acteurs, publics et privés, sont directem<strong>en</strong>t concernés. Il revi<strong>en</strong>t à <strong>la</strong><br />
Région de porter cette stratégie <strong>pour</strong> leur faire partager <strong>la</strong> même ambition,<br />
ce qui r<strong>en</strong>forcera leur poids collectif face aux opérateurs privés de<br />
télécommunication.<br />
Partager est aussi une nécessité <strong>pour</strong> démystifier le coût d’un tel investissem<strong>en</strong>t<br />
estimé à 20 milliards <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble du territoire national, soit 1 milliard par an.<br />
Ce coût reposera <strong>pour</strong> un tiers sur les opérateurs privés (dans les zones réputées<br />
les plus r<strong>en</strong>tables) et <strong>pour</strong> le reste sur chaque interv<strong>en</strong>ants publics <strong>pour</strong> les zones<br />
dites « b<strong>la</strong>nches ou grises ». A l’échelle de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, l’investissem<strong>en</strong>t<br />
global n’excèderait pas 2 milliards d’euros.<br />
Le coût du THD <strong>pour</strong> tous doit être perçu comme un coût d’investissem<strong>en</strong>t, c'està-dire<br />
sur lequel on peut <strong>en</strong>visager un retour. Comme <strong>pour</strong> l’électricité <strong>en</strong> son<br />
temps, il est <strong>en</strong>core difficile de mesurer le retour sur investissem<strong>en</strong>t dans le cas<br />
du déploiem<strong>en</strong>t du THD. A l’échelle nationale, ce sont près de 360 000 emplois<br />
qui sont att<strong>en</strong>dus et près de 20 milliards d’euros de gain. La r<strong>en</strong>tabilité peut être<br />
au r<strong>en</strong>dez vous des déploiem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> direction des zones peu ou pas couvertes<br />
susceptibles de générer des taux de raccordem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> meilleurs que sur les<br />
zones d<strong>en</strong>sifiées <strong>en</strong> popu<strong>la</strong>tion et <strong>en</strong> activités disposant déjà du haut débit. Le<br />
THD est déterminant d’une part, <strong>en</strong> raison des ressources que génèreront les<br />
acteurs économiques prés<strong>en</strong>ts sur le territoire et d’autre part, par l’effet de levier<br />
qu’il peut avoir sur les int<strong>en</strong>tions d’imp<strong>la</strong>ntation d’activités. Il modifie le rapport<br />
au territoire, à <strong>la</strong> distance, à <strong>la</strong> mobilité des bi<strong>en</strong>s et des personnes. Enfin le<br />
déploiem<strong>en</strong>t du THD est un « chantier » <strong>en</strong> lui-même qui peut générer des<br />
emplois industriels et de service. Les <strong>en</strong>treprises susceptibles d’intégrer cette<br />
économie du THD au s<strong>en</strong>s d’une véritable filière, <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t être repérées et<br />
ciblées dans le cadre des aides incitatives de <strong>la</strong> Région.<br />
La Région doit p<strong>la</strong>cer l’accessibilité numérique au cœur de sa communication<br />
<strong>pour</strong> valoriser <strong>la</strong> capacité de l’<strong>en</strong>semble du territoire auprès des investisseurs.<br />
Cette communication récurr<strong>en</strong>te portera sur les choix d’une stratégie régionale<br />
ambitieuse auprès des ag<strong>en</strong>ts économiques et au-delà des territoires, dans<br />
toutes les initiatives économiques à l’export et devra re<strong>la</strong>yer régulièrem<strong>en</strong>t<br />
toutes les avancées locales.<br />
La recherche de coopérations, <strong>en</strong>tre opérateurs privés et collectivités <strong>pour</strong> le<br />
déploiem<strong>en</strong>t é<strong>la</strong>rgi, doit privilégier les financem<strong>en</strong>ts mixtes <strong>pour</strong> ne pas recourir<br />
à des taxes supplém<strong>en</strong>taires. Le recours év<strong>en</strong>tuel à des part<strong>en</strong>ariats publics<br />
privés (PPP) doit être examiné avec <strong>la</strong> plus grande vigi<strong>la</strong>nce quant au respect des<br />
intérêts des collectivités et des opérateurs. Dans le cadre de leurs travaux<br />
d’infrastructures et de voirie, les acteurs publics doiv<strong>en</strong>t confier à des <strong>en</strong>treprises<br />
de travaux publics ou de génie civil les opérations d’instal<strong>la</strong>tion des réseaux dès<br />
que ce<strong>la</strong> est possible, qu’ils dissoci<strong>en</strong>t des opérations d’exploitation par les<br />
opérateurs, dans l’objectif de faire baisser les coûts et de ne pas hypothéquer<br />
l’av<strong>en</strong>ir.<br />
Enfin, <strong>pour</strong> compléter ces axes d’interv<strong>en</strong>tion volontaristes portant sur le<br />
déploiem<strong>en</strong>t des accès au THD, les acteurs locaux, chacun auprès de leur public<br />
Octobre 2012 189
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
cible, doiv<strong>en</strong>t anticiper <strong>en</strong> préparant les popu<strong>la</strong>tions les plus éloignées au<br />
développem<strong>en</strong>t des usages du numérique, via les lieux de formation ou d’accueil<br />
des publics sur les territoires des différ<strong>en</strong>tes collectivités. Pour sa part <strong>la</strong> Région<br />
peut décider de re<strong>la</strong>yer l’<strong>en</strong>semble des initiatives des associations et divers<br />
acteurs de l’éducation popu<strong>la</strong>ire déjà impliqués, capitaliser et diffuser les<br />
pratiques <strong>en</strong> s’appuyant sur les têtes de réseaux autour d’une « charte ambition<br />
et qualité » qui table sur l’exploitation du meilleur des réseaux tout <strong>en</strong> refusant<br />
les plus fortes dérives.<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t, dans le cadre des ori<strong>en</strong>tation du CPRDFP, elle doit anticiper <strong>en</strong><br />
portant tout projet qui favorise <strong>la</strong> formation professionnelle des jeunes et des<br />
adultes dans le domaine des technologies de l’information et de <strong>la</strong><br />
communication, des réseaux et services liés au déploiem<strong>en</strong>t du THD, quelle que<br />
soit <strong>la</strong> technologie support.<br />
Dans l’hypothèse où, <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où<br />
les choix de couverture auront été réalisés par les seuls opérateurs, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est alors d’éviter que ces choix de couverture sélective ne pénalis<strong>en</strong>t<br />
trop fortem<strong>en</strong>t l’équilibre territorial. L’offre <strong>en</strong> THD, re<strong>la</strong>yée par les collectivités,<br />
doit alors être ciblée sur des territoires de projets où il y a lieu de ret<strong>en</strong>ir ou<br />
d’attirer de l’activité. La collectivité devra alors définir des priorités<br />
géographiques et temporelles de zones où flécher l’investissem<strong>en</strong>t public.<br />
En tout état de cause, jouer d’influ<strong>en</strong>ce auprès du légis<strong>la</strong>teur est primordial <strong>pour</strong><br />
faire évoluer rapidem<strong>en</strong>t une réglem<strong>en</strong>tation, fruit d’une histoire qui a <strong>la</strong>issé le<br />
champ libre aux opérateurs, vers un modèle où l’acteur et le financeur public<br />
puiss<strong>en</strong>t contractualiser avec l’opérateur privé, imposer le partage des<br />
contraintes et <strong>en</strong> somme partager les coûts et les avantages.<br />
Le rôle des élus locaux est ici ess<strong>en</strong>tiel. En effet, <strong>la</strong> réglem<strong>en</strong>tation aujourd’hui<br />
ne prévoit pas de contraintes (contreparties financières par exemple) si les<br />
opérateurs privés ne réalis<strong>en</strong>t pas leurs <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts. En revanche, le simple fait<br />
qu’un opérateur se positionne sur une zone interdit aux collectivités locales de<br />
bénéficier des investissem<strong>en</strong>ts d’av<strong>en</strong>ir sur <strong>la</strong>dite zone. Et ce, même si au final<br />
l’opérateur se retire de <strong>la</strong> zone.<br />
• Energies<br />
Le second secteur sur lequel le CESER souhaite afficher des priorités est<br />
celui des énergies, dans lequel <strong>la</strong> hausse des coûts apparaît comme une<br />
t<strong>en</strong>dance lourde irréversible quel que soit leur mode de production.<br />
Parce que <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, forte consommatrice mais surtout, grande<br />
productrice d’énergies, est particulièrem<strong>en</strong>t exposée aux conséqu<strong>en</strong>ces des<br />
bouleversem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> cours et à v<strong>en</strong>ir dans le domaine des énergies,<br />
l’é<strong>la</strong>rgissem<strong>en</strong>t du bouquet énergétique et l’augm<strong>en</strong>tation de <strong>la</strong> part des énergies<br />
inépuisables ou r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles dans <strong>la</strong> production d’électricité est primordiale au<br />
regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.<br />
Le P<strong>la</strong>n Climat Energies « PCE » adopté par <strong>la</strong> Région dès 2007 et ses<br />
déclinaisons opérationnelles successives constitu<strong>en</strong>t une démarche de progrès<br />
visant à adapter l’<strong>en</strong>semble des politiques régionales aux priorités que<br />
constitu<strong>en</strong>t <strong>la</strong> réduction des émissions de gaz à effet de serre, <strong>la</strong> maîtrise des<br />
consommations d’énergies et le développem<strong>en</strong>t des énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles. Avec<br />
<strong>la</strong> création de <strong>la</strong> « filière énergie » <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> 2009, <strong>la</strong> Région a su<br />
asseoir ses priorités contractuellem<strong>en</strong>t avec les opérateurs de <strong>la</strong> filière.<br />
Octobre 2012 190
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
Les décisions sur le déploiem<strong>en</strong>t des grands projets énergétiques ne dép<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
pas exclusivem<strong>en</strong>t des acteurs locaux. Ceux-ci peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong> revanche peser sur les<br />
décisions et maximiser les retombées des projets <strong>en</strong> anticipant sur leur<br />
accompagnem<strong>en</strong>t.<br />
Au sein d’un mix énergétique, <strong>la</strong> Région doit accorder <strong>en</strong> priorité ses moy<strong>en</strong>s à <strong>la</strong><br />
structuration d’une filière éoli<strong>en</strong>ne. Elle doit être <strong>en</strong> capacité d’accompagner le<br />
développem<strong>en</strong>t de l’éoli<strong>en</strong> off-shore dans le cadre de l’appel à projet national.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de <strong>pour</strong>suivre <strong>en</strong> région le développem<strong>en</strong>t d’une offre<br />
d’énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles fondée sur un mix énergétique <strong>pour</strong> répondre à <strong>la</strong><br />
demande régionale et aux exportations. Cet <strong>en</strong>jeu vise égalem<strong>en</strong>t à améliorer<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> région.<br />
La réalisation des parcs éoli<strong>en</strong>s et de l’EPR de P<strong>en</strong>ly doit générer des retombées<br />
économiques <strong>en</strong> termes d’emplois directs et indirects <strong>en</strong> région, durant <strong>la</strong> phase<br />
de chantier et au-delà. Les métiers les plus impactés sont ceux de <strong>la</strong> conception,<br />
de <strong>la</strong> fabrication, de l’instal<strong>la</strong>tion, notamm<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> les énergies r<strong>en</strong>ouve<strong>la</strong>bles,<br />
ainsi que ceux de <strong>la</strong> maint<strong>en</strong>ance, toutes formes d’énergies confondues, <strong>en</strong>fin<br />
ceux du diagnostic énergétique, du contrôle qualité, du conseil et de l’assistance.<br />
La Région doit donc flécher prioritairem<strong>en</strong>t des moy<strong>en</strong>s sur cette filière au<br />
travers de ses dispositifs d’interv<strong>en</strong>tion <strong>en</strong> direction des acteurs économiques et<br />
valoriser ce choix <strong>pour</strong> peser dans l’interface avec les décideurs au p<strong>la</strong>n national.<br />
<strong>Quel</strong> que soit le grand projet d’infrastructure énergétique dont il s’agit, il est<br />
indisp<strong>en</strong>sable d’accompagner <strong>en</strong> amont <strong>la</strong> montée <strong>en</strong> qualification des sa<strong>la</strong>riés et<br />
demandeurs d’emploi du territoire, ainsi que des jeunes <strong>en</strong> formation initiale<br />
autour des besoins <strong>en</strong> qualification repérés. Il s’agit de préparer aux métiers<br />
utiles sur les chantiers <strong>en</strong> construction, ou sur l’exploitation des futurs sites <strong>pour</strong><br />
maximiser les retombées économiques et <strong>en</strong> emploi, ainsi que <strong>la</strong> reconversion<br />
des activités à l’issue des phases de chantier.<br />
Ces volets « compét<strong>en</strong>ces » des grands projets doiv<strong>en</strong>t être é<strong>la</strong>borés à l’échelle<br />
du territoire par <strong>la</strong> Région, <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec <strong>la</strong> filière « énergies ». Le CREFOR qui a<br />
constitué les bases d’information sur les compét<strong>en</strong>ces et qualifications mises <strong>en</strong><br />
œuvre dans <strong>la</strong> filière « énergies » dans le cadre de ses missions d’observation de<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion emploi-formation, doit le piloter <strong>en</strong> créant une synergie <strong>en</strong>tre les<br />
part<strong>en</strong>aires publics locaux des territoires concernés, les branches<br />
professionnelles et les part<strong>en</strong>aires sociaux.<br />
Enfin, les innovations techniques liées à <strong>la</strong> nouvelle forme de production et de<br />
stockage d’énergies nouvelles sont loin d’être abouties, que ce soit <strong>pour</strong> l’éoli<strong>en</strong><br />
off-shore ou le photovoltaïque. Ce dernier représ<strong>en</strong>te une opportunité dans <strong>la</strong><br />
région, particulièrem<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> <strong>pour</strong>vue <strong>en</strong> surfaces exploitables, notamm<strong>en</strong>t dans<br />
toutes les zones industrielles et logistiques. La Région doit investir une partie des<br />
moy<strong>en</strong>s qu’elle dédie à <strong>la</strong> recherche publique par exemple dans le cadre d’un<br />
appel à projet ciblé <strong>en</strong> invitant à coupler moy<strong>en</strong>s de recherche des <strong>la</strong>boratoires<br />
privés et moy<strong>en</strong>s universitaires et régionaux dédiés.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, l’<strong>en</strong>jeu<br />
a minima est de gagner <strong>en</strong> retombées locales <strong>en</strong> terme d’emplois <strong>en</strong> qualifiant<br />
<strong>la</strong> main-d’œuvre disponible au moins sur <strong>la</strong> phase chantier afin d’éviter le<br />
mécont<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t social <strong>la</strong>t<strong>en</strong>t lié à l’instal<strong>la</strong>tion de nouveaux sites éoli<strong>en</strong>s ou<br />
nucléaires sans bénéfice <strong>en</strong> retour.<br />
Octobre 2012 191
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• Autres grands projets d’infrastructures d’accessibilité – <strong>la</strong> thématique<br />
portuaire<br />
Les autres grands projets d’infrastructures <strong>en</strong> matière d’accessibilité<br />
régionale sont dominés par <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité de <strong>la</strong> « thématique<br />
portuaire » <strong>en</strong> raison de son li<strong>en</strong> avec le grand projet « Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong> »<br />
Pour mémoire, dans le rapport du Commissaire général <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t<br />
de <strong>la</strong> vallée de <strong>la</strong> Seine, <strong>la</strong> thématique portuaire est prés<strong>en</strong>tée comme le 2 ème<br />
acte du Grand Paris. La transformation de <strong>la</strong> « Ville monde » <strong>en</strong> « Grand Paris<br />
maritime » induit que Le Havre devi<strong>en</strong>ne port du Grand Paris et que <strong>la</strong> Seine<br />
devi<strong>en</strong>ne axe nourricier.<br />
Améliorer les positions respectives des ports du Havre et de Rou<strong>en</strong> suppose<br />
l’implication forte des milieux économiques avec, <strong>en</strong> re<strong>la</strong>is, des interv<strong>en</strong>tions<br />
publiques.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’importer et d’exporter des flux de marchandises <strong>en</strong><br />
phase avec <strong>la</strong> croissance de l’activité, notamm<strong>en</strong>t celle générée par les besoins<br />
de l’Ile de France, dans le cadre d’un projet global « gagnant-gagnant » <strong>pour</strong> les<br />
francili<strong>en</strong>s et les normands. C’est l’exist<strong>en</strong>ce d’un tel projet qui doit justifier le<br />
remode<strong>la</strong>ge des infrastructures.<br />
L’<strong>en</strong>semble des commissions du CESER travaille à l’heure actuelle sur<br />
l’id<strong>en</strong>tification de propositions de nature à accompagner un projet de<br />
développem<strong>en</strong>t territorial à une telle échelle profitant à l’<strong>en</strong>semble des territoires<br />
et les conclusions n’<strong>en</strong> sont pas r<strong>en</strong>dues. La Région devra saisir toutes les<br />
opportunités qui sortiront des études du CESER, notamm<strong>en</strong>t celle sur les flux<br />
portuaires. Néanmoins, des pistes peuv<strong>en</strong>t être id<strong>en</strong>tifiées, <strong>pour</strong> lesquelles il<br />
convi<strong>en</strong>dra de retravailler l’aspect opérationnel.<br />
La tâche de <strong>la</strong> Région consiste dans un premier temps à capitaliser sur les<br />
re<strong>la</strong>tions ou coopérations qu’elle a développées avec <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong> et l’Ile<br />
de France. La finalité est de valoriser le débouché maritime du port du Havre et<br />
de rechercher des alliances hors des trois régions (Arc Manche). Elle doit inciter<br />
les acteurs portuaires à spécifier c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t les qualifications des ports :<br />
« cont<strong>en</strong>eurisation » au Havre et « groupage-dégroupage-logistique » à Rou<strong>en</strong>.<br />
En matière agricole, <strong>la</strong> notoriété de <strong>la</strong> « cotation Rou<strong>en</strong> » sur le fret céréales<br />
garantit <strong>la</strong> valeur ajoutée des « services » apportés au produit brut.<br />
La Région doit communiquer les atouts et les complém<strong>en</strong>tarités des deux ports<br />
aux investisseurs. Elle doit égalem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer ses aides à l’export et valoriser<br />
avec l’<strong>en</strong>semble des acteurs économiques sur le territoire <strong>la</strong> « porte maritime du<br />
Havre » auprès des exportateurs de produits fabriqués <strong>en</strong> France. Cette<br />
valorisation permettra de réduire le déséquilibre <strong>en</strong>tre l’importation et<br />
l’exportation de nos ports tout <strong>en</strong> limitant les problèmes de sécurité maritime<br />
dans le corridor Manche.<br />
Les investisseurs doiv<strong>en</strong>t être incités à créer de <strong>la</strong> valeur ajoutée autour du<br />
transit dans les ports grâce à l’imp<strong>la</strong>ntation d’unités de transformation et<br />
d’assemb<strong>la</strong>ge <strong>en</strong> proximité. Les flux de marchandises <strong>en</strong> cont<strong>en</strong>eurs ne doiv<strong>en</strong>t<br />
pas que « transiter » sur notre territoire mais permettre de localiser sur leur<br />
passage des unités de production. Ils sont l’occasion de créer de <strong>la</strong> valeur<br />
ajoutée et peuv<strong>en</strong>t de ce fait induire une meilleure r<strong>en</strong>tabilité des ruptures de<br />
charge qui exist<strong>en</strong>t sur les ports. Ainsi <strong>la</strong> Région, <strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec les autres<br />
collectivités, doit aider à créer des réserves foncières <strong>pour</strong> imp<strong>la</strong>nter ces unités<br />
Octobre 2012 192
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
dans des zones d’activités, <strong>en</strong> offrant un accès « multimodal », le cas échéant<br />
sur des friches industrielles reconverties.<br />
Enfin, elle doit guider ses choix d’investissem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte des gains de<br />
compétitivité source de valeur ajoutée qu’ils sont susceptibles d’apporter dans <strong>la</strong><br />
chaîne logistique des transports de fret portuaire et fluvial.<br />
Dans l’hypothèse où, <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où<br />
l’amélioration de <strong>la</strong> position du Havre et de Rou<strong>en</strong> n’est pas atteinte, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est d’éviter sa dégradation. Il s’agit de pouvoir faire <strong>en</strong>trer et sortir des<br />
flux justifiant des infrastructures qui devront être alors priorisées : <strong>la</strong> chatière au<br />
Havre assurant un li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre port 2000 et le port de l’estuaire, <strong>la</strong> réalisation des<br />
infrastructures manquantes autour de l’axe fluvial Paris - Rou<strong>en</strong> - Le Havre <strong>pour</strong><br />
être prêt quand le Canal Seine Nord Europe « CSNE » sera opérationnel.<br />
• Infrastructures routières et ferroviaires<br />
Quant aux infrastructures routières et ferroviaires, l’<strong>en</strong>jeu stratégique<br />
est de mettre l’accessibilité au service du développem<strong>en</strong>t harmonieux du<br />
territoire <strong>en</strong> facilitant l’organisation des flux économiques et humains. Plusieurs<br />
projets d’investissem<strong>en</strong>t réalisés <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>en</strong> constitu<strong>en</strong>t l’ossature et facilit<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce de <strong>la</strong> multimodalité : <strong>la</strong> nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> compr<strong>en</strong>ant une<br />
offre de services tertiaires, <strong>la</strong> LNPN <strong>en</strong> construction, le contournem<strong>en</strong>t Est de<br />
Rou<strong>en</strong>, le développem<strong>en</strong>t de l’aéroport de Deauville et <strong>la</strong> facilité d’accès accrue à<br />
Roissy. C’est à l’heure où les priorités sont ré-établies au niveau national que <strong>la</strong><br />
Région doit résolum<strong>en</strong>t s’afficher comme leader et démultiplier ses efforts <strong>pour</strong><br />
emporter l’adhésion de tout un territoire. Elle doit plus que jamais convaincre<br />
tous ses part<strong>en</strong>aires de <strong>la</strong> nécessité de faire corps tout de suite <strong>en</strong> affirmant une<br />
ambition commune autour de ces grands projets d’infrastructures. Il faut faire<br />
converger les moy<strong>en</strong>s financiers avec un échéancier concordant <strong>pour</strong> peser sur<br />
les choix immin<strong>en</strong>ts qui conditionn<strong>en</strong>t notre état <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
Le CESER r<strong>en</strong>voie aux différ<strong>en</strong>ts travaux m<strong>en</strong>és dans le cadre de l’avis sur « les<br />
infrastructures », sur « <strong>la</strong> cohér<strong>en</strong>ce de l’aménagem<strong>en</strong>t des territoires », sur « <strong>la</strong><br />
mobilité généralisée <strong>en</strong> 2050 », sur « <strong>la</strong> LNPN ». Ils seront éc<strong>la</strong>irés à nouveau à<br />
l’issue des travaux <strong>en</strong> cours au sein de toutes les commissions autour de l’Axe<br />
Paris Seine <strong>Normandie</strong>.<br />
Si dans l’hypothèse du sc<strong>en</strong>ario S2, les grands projets d’infrastructure ne sont<br />
pas réalisés, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de lutter contre les effets néfastes de<br />
l’<strong>en</strong>gorgem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> région qui a accumulé des retards dans <strong>la</strong> réalisation de ses<br />
infrastructures.<br />
La Région doit alors cibler les efforts financiers sur le confort des lignes<br />
voyageurs infrarégionales, <strong>pour</strong> lesquelles elle a déjà fortem<strong>en</strong>t amélioré les<br />
liaisons. Les autres collectivités doiv<strong>en</strong>t aussi participer à l’effort sur l’<strong>en</strong>semble<br />
des transports collectifs. Les part<strong>en</strong>aires peuv<strong>en</strong>t s’organiser <strong>pour</strong> accompagner<br />
les initiatives associatives autour des modes « covoiturage », proposer des<br />
solutions organisées de stationnem<strong>en</strong>t autour des nœuds (covoiturage ou<br />
transports <strong>en</strong> commun), selon l’échelon de territoire concerné, avec une<br />
dynamique que <strong>la</strong> Région impulse.<br />
Enfin, <strong>la</strong> nouvelle gare de Rou<strong>en</strong> doit intégrer une offre nouvelle de surfaces de<br />
bureaux. Le projet doit quant à lui comporter dès sa conception le p<strong>la</strong>n de<br />
développem<strong>en</strong>t et de raccordem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Gare. Les part<strong>en</strong>aires doiv<strong>en</strong>t s’<strong>en</strong>gager<br />
à constituer les réserves <strong>pour</strong> les raccordem<strong>en</strong>ts futurs dans le cadre des p<strong>la</strong>ns<br />
d’aménagem<strong>en</strong>ts. Les docum<strong>en</strong>ts d’urbanisme sont à construire.<br />
Octobre 2012 193
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Dans le cadre des projets m<strong>en</strong>és hors région, le barreau mantois constitue un<br />
point s<strong>en</strong>sible sur <strong>la</strong> réalisation duquel l’<strong>en</strong>semble des part<strong>en</strong>aires régionaux<br />
doiv<strong>en</strong>t porter toute leur att<strong>en</strong>tion et peser fermem<strong>en</strong>t.<br />
2 – L’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong> croissance<br />
Si <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de cause à effet existe bi<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> croissance d’une part, <strong>la</strong><br />
hausse de l’emploi et <strong>la</strong> baisse du chômage d’autre part, les effets de <strong>la</strong><br />
croissance sur <strong>la</strong> baisse du chômage dans <strong>la</strong> région sont moins efficaces qu’<strong>en</strong><br />
moy<strong>en</strong>ne, ce qui est révé<strong>la</strong>teur de <strong>la</strong> moindre capacité de notre région à profiter<br />
d’embellies sur l’emploi.<br />
Une des caractéristiques de <strong>la</strong> région est le retard récurr<strong>en</strong>t affiché par les<br />
indicateurs <strong>en</strong> matière de formation et d’élévation des niveaux de qualification<br />
des jeunes <strong>en</strong> formation initiale et des actifs et ce malgré les points gagnés au fil<br />
des ans.<br />
Par ailleurs, <strong>la</strong> faiblesse du poids de <strong>la</strong> recherche publique, face il est vrai à une<br />
prés<strong>en</strong>ce forte de <strong>la</strong> recherche privée, y est égalem<strong>en</strong>t constatée de longue date.<br />
S’il est une évid<strong>en</strong>ce que <strong>la</strong> structuration des pôles de compétitivité et le<br />
volontarisme de l’action régionale au travers du Contrat de Projet Etat-Région<br />
ont permis de progresser nettem<strong>en</strong>t. Le PRES naissant ne permet pas <strong>en</strong>core de<br />
recul sur sa capacité à r<strong>en</strong>forcer <strong>la</strong> position de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> matière de<br />
recherche et d’innovation.<br />
La région doit gagner du terrain <strong>en</strong> cons<strong>en</strong>tant les efforts nécessaires non<br />
seulem<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> maint<strong>en</strong>ir sa situation mais <strong>pour</strong> rattraper ses retards <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
C’est un « coup d’accélérateur » nécessaire <strong>pour</strong> l’<strong>en</strong>semble de sa ressource<br />
humaine <strong>pour</strong> afficher des compét<strong>en</strong>ces d’égal à égal avec les autres régions.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est une réelle montée <strong>en</strong> gamme dans l’économie de <strong>la</strong><br />
connaissance <strong>pour</strong> accompagner les mutations de l’économie régionale, <strong>pour</strong><br />
offrir aux haut-normands de meilleures conditions d’insertion dans l’emploi,<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> les jeunes et les femmes, ainsi que davantage de sécurité dans<br />
leur parcours professionnel et <strong>en</strong>fin, <strong>pour</strong> favoriser l’attractivité du territoire visà-vis<br />
des jeunes ou des actifs.<br />
Les possibilités d’action nouvelles des acteurs locaux, notamm<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Région,<br />
sont <strong>en</strong> discussion dans le cadre de <strong>la</strong> préparation d’un nouvel acte de <strong>la</strong><br />
déc<strong>en</strong>tralisation sur le thème de l’Ori<strong>en</strong>tation ainsi que dans le domaine de <strong>la</strong><br />
Politique de l’Emploi, de <strong>la</strong> formation initiale jusqu’à <strong>la</strong> recherche, du souti<strong>en</strong> à<br />
l’innovation. La Région devra les mettre au service des défis à relever,<br />
notamm<strong>en</strong>t celui d’apporter une solution à <strong>la</strong> demande des publics de s’adresser<br />
à un guichet unique <strong>pour</strong> les aider dans leur parcours professionnel.<br />
• Formation<br />
En matière de formation, <strong>la</strong> Région doit donner <strong>la</strong> priorité, dans le cadre<br />
de ses compét<strong>en</strong>ces actuelles, à l’adaptation des formations et des qualifications<br />
aux besoins ainsi qu’au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des outils de coordination <strong>en</strong>tre les acteurs<br />
de <strong>la</strong> formation.<br />
Après l’adoption concomitante du CRDE et du CPRDFP <strong>en</strong> 2011,qui donn<strong>en</strong>t des<br />
ori<strong>en</strong>tations stratégiques converg<strong>en</strong>tes aux efforts à réaliser <strong>en</strong> matière de<br />
formation et de développem<strong>en</strong>t de l’emploi, <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre des préconisations<br />
figurant au CPRDFP n’est pas rapide et n’a pu <strong>en</strong>core faire l’objet de retour<br />
d’évaluation devant le CCREFP « comité de coordination régionale emploi<br />
Octobre 2012 194
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
formation professionnelle». Une <strong>en</strong>vergure plus forte est à donner à ce contrat,<br />
elle est requise <strong>pour</strong> assurer une « montée <strong>en</strong> gamme » recherchée.<br />
A ce titre, le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t du CCREFP apparaît nécessaire dans son rôle <strong>pour</strong><br />
piloter, coordonner et mettre <strong>en</strong> synergie les acteurs de <strong>la</strong> formation dans les<br />
trois missions que sont l’anticipation des besoins, l’adaptation de l’offre et<br />
l’ori<strong>en</strong>tation de tous les publics. La Région aujourd’hui légitimem<strong>en</strong>t reconnue<br />
comme chef de file aux côtés de ses part<strong>en</strong>aires, doit y contribuer. Ce comité<br />
peut être doté du rôle de « Chancelier de <strong>la</strong> formation » <strong>en</strong> région.<br />
Dans l’exercice de ses missions au quotidi<strong>en</strong> et <strong>pour</strong> l’accompagner dans ses<br />
tâches d’anticipation, <strong>la</strong> Région peut <strong>en</strong>core davantage r<strong>en</strong>forcer le recours aux<br />
lieux d’expertise déjà constitués et id<strong>en</strong>tifiés : Cité des métiers dans ses missions<br />
fondatrices (accueil, information, ori<strong>en</strong>tation sur les métiers et <strong>la</strong> formation), le<br />
CREFOR (anticipation des besoins <strong>en</strong> emplois, re<strong>la</strong>tions avec les branches,<br />
filières, observatoires, territoires de projets), IRGOUV (formation continue)…. A<br />
titre d’exemple, <strong>la</strong> reproduction de façon récurr<strong>en</strong>te d’<strong>en</strong>quêtes sur les<br />
r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>ts de main-d’œuvre ainsi que de dialogues avec les branches ou<br />
les filières sur les évolutions qualitatives des compét<strong>en</strong>ces dans les métiers est<br />
une nécessité <strong>pour</strong> affiner sa visibilité à moy<strong>en</strong> et long termes, surtout <strong>en</strong> cette<br />
période de grande instabilité dans l’emploi conséqu<strong>en</strong>ce des réformes sur les<br />
retraites qui vont impacter d’ici à <strong>2025</strong> les sorties de l’emploi.<br />
Tous les commanditaires de formation continue, <strong>en</strong> particulier <strong>la</strong> Région, doiv<strong>en</strong>t<br />
se soucier du mainti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> qualité des prestations des offreurs de formation<br />
continue <strong>en</strong> leur permettant d’anticiper et de faire évoluer parallèlem<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
professionnalisation de leurs formateurs. Il faut leur garantir davantage de<br />
lisibilité sur les stratégies d’évolution de <strong>la</strong> commande publique à moy<strong>en</strong> terme<br />
<strong>en</strong> région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et instaurer des temps de dialogue et de<br />
communication autour de ces stratégies.<br />
Dans un champ d’interv<strong>en</strong>tion qui lui est propre, celui de l’appr<strong>en</strong>tissage, <strong>la</strong><br />
Région doit assurer les possibilités de montée <strong>en</strong> qualification au sein de cette<br />
voie de formation <strong>en</strong> amplifiant le développem<strong>en</strong>t des formations supérieures <strong>en</strong><br />
appr<strong>en</strong>tissage. C’est une voie différ<strong>en</strong>ciée d’accès aux plus hauts niveaux de<br />
qualification <strong>pour</strong> les formations professionnelles. Elle ouvre des possibilités de<br />
<strong>pour</strong>suite d’étude à certains publics qui n’y aurai<strong>en</strong>t pas accédé, tout <strong>en</strong><br />
augm<strong>en</strong>tant les li<strong>en</strong>s avec les <strong>en</strong>treprises et les opportunités d’insertion plus<br />
rapide des jeunes dans l’emploi.<br />
<strong>Quel</strong>le que soit <strong>la</strong> voie de formation, sur <strong>la</strong> base du volontarisme, <strong>la</strong> Région et les<br />
collectivités doiv<strong>en</strong>t investir dans des actions de souti<strong>en</strong> logistique des publics <strong>en</strong><br />
formation à tous les niveaux d’étude que ce soit sous forme de bourses, d’aide à<br />
l’accès au logem<strong>en</strong>t, d’aide au transport, de prév<strong>en</strong>tion santé… Si l’offre de<br />
formation ne peut être démultipliée <strong>en</strong> tout point du territoire, il est une<br />
contrepartie que les mêmes décideurs doiv<strong>en</strong>t pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte : celle de<br />
faciliter l’accès aux formations <strong>pour</strong> tous sur l’<strong>en</strong>semble du territoire et de<br />
permettre <strong>la</strong> mobilité nécessaire <strong>pour</strong> suivre des cursus offrant des perspectives<br />
d’insertion mais éloignés géographiquem<strong>en</strong>t. Aussi pertin<strong>en</strong>te que soit une carte<br />
des formations au regard des <strong>en</strong>jeux et des besoins d’une économie régionale,<br />
elle n’a de s<strong>en</strong>s que si les publics s’y <strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t et <strong>pour</strong>suiv<strong>en</strong>t leur parcours<br />
jusqu’aux qualifications requises<br />
Quant à <strong>la</strong> lutte contre l’illettrisme, elle apparaît au premier p<strong>la</strong>n des sujets<br />
d’intérêt régional à pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte dès à prés<strong>en</strong>t et qui sous-t<strong>en</strong>d <strong>en</strong> partie<br />
<strong>la</strong> réussite des autres actions m<strong>en</strong>ées <strong>en</strong> matière de formation <strong>pour</strong> que tous les<br />
haut-normands bénéfici<strong>en</strong>t des efforts <strong>en</strong>trepris. Une saisine étant <strong>en</strong> cours sur<br />
Octobre 2012 195
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
ce sujet, les préconisations précises seront disponibles <strong>en</strong> 2013. Le CESER<br />
souhaite néanmoins souligner que c’est une « mise » régionale incontournable<br />
<strong>pour</strong> une « cause » régionale à gagner qui concerne l’<strong>en</strong>semble des acteurs et<br />
qui ne peut att<strong>en</strong>dre, quel que soit l’horizon temporel que l’on se fixe et, <strong>en</strong><br />
l’occurr<strong>en</strong>ce, compte t<strong>en</strong>u des ambitions à atteindre <strong>en</strong> <strong>2025</strong>.<br />
Enfin, le créneau très particulier de <strong>la</strong> formation aux « métiers exercés <strong>en</strong> mer »<br />
doit être investi <strong>pour</strong> préparer <strong>la</strong> main-d’œuvre de demain, jeunes ou adultes et<br />
accompagner les projets de nouvelles filières économiques : travail de repérage<br />
des compét<strong>en</strong>ces requises <strong>en</strong> matière de transport maritime, de maint<strong>en</strong>ance<br />
des matériels ou des ouvrages réalisés <strong>en</strong> milieu marin, de logistique à quai,<br />
id<strong>en</strong>tification des qualifications liées à <strong>la</strong> technicité de ces métiers, reconversion<br />
possible de main-d’œuvre des secteurs de <strong>la</strong> pêche… La Région peut concevoir<br />
un chantier grandeur réelle de gestion prévisionnelle des emplois et des<br />
compét<strong>en</strong>ces territoriales GPECT autour de ce thème.<br />
• Recherche<br />
En matière de recherche, une nécessité urg<strong>en</strong>te est d’attirer des tal<strong>en</strong>ts et de<br />
stabiliser les chercheurs sur le territoire <strong>pour</strong> redynamiser <strong>la</strong> recherche régionale<br />
publique, de faire perdurer <strong>la</strong> notoriété de certains <strong>la</strong>boratoires <strong>en</strong> anticipant les<br />
r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>ts des chercheurs qui ont fait leur r<strong>en</strong>ommée, ainsi que de mettre<br />
les énergies au service du développem<strong>en</strong>t des activités nouvelles ou thématiques<br />
porteuses <strong>pour</strong> l’économie régionale et le développem<strong>en</strong>t socio-économique du<br />
territoire. Les systèmes de bourses doctorales et post-doctorales du Conseil<br />
régional, dont <strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce est reconnue et sur lesquelles <strong>la</strong> Région mobilise<br />
d’importants moy<strong>en</strong>s depuis longtemps, permett<strong>en</strong>t suffisamm<strong>en</strong>t de recul <strong>pour</strong><br />
évaluer si les conditions d’octroi <strong>en</strong> termes de nombre et de durée d’allocations<br />
assur<strong>en</strong>t réellem<strong>en</strong>t d’atteindre l’objectif d’ancrer les chercheurs de tal<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> les accueil<strong>la</strong>nt dans <strong>la</strong> durée et <strong>en</strong> favorisant par <strong>la</strong> suite<br />
leur embauche.<br />
La Région doit être <strong>en</strong> capacité et s’autoriser à cibler des projets particulièrem<strong>en</strong>t<br />
prometteurs <strong>pour</strong> l’av<strong>en</strong>ir régional. Dès lors qu’ils sont contractualisés avec l’Etat<br />
et les <strong>la</strong>boratoires, des moy<strong>en</strong>s mis <strong>en</strong> synergie permettrai<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t un<br />
rapprochem<strong>en</strong>t avec les <strong>en</strong>treprises et les <strong>la</strong>boratoires de recherche privés et des<br />
avancées plus rapides et ciblées sur des innovations dans des secteurs qui<br />
confèr<strong>en</strong>t une spécificité à notre économie régionale. A ce titre, <strong>la</strong> Région doit<br />
flécher une partie de ses <strong>en</strong>veloppes (allocations doctorales et post-doctorales ou<br />
fonds alloués à <strong>la</strong> recherche <strong>en</strong> région) sur ces cibles qui <strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t donner lieu à<br />
des appels d’offres <strong>la</strong>ncés <strong>en</strong> complém<strong>en</strong>t des fonds alloués aux projets portés<br />
par les GRR.<br />
Quant aux acteurs du PRES, ils doiv<strong>en</strong>t sans tarder mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce une stratégie<br />
commune de r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> lisibilité de <strong>la</strong> recherche régionale avec une<br />
culture r<strong>en</strong>ouvelée d’ouverture, que ce soit <strong>en</strong> termes de part<strong>en</strong>ariat ou d’échelle<br />
territoriale, <strong>pour</strong> avoir gagné <strong>en</strong> lisibilité nationale et internationale d’ici <strong>2025</strong>.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où les<br />
retards <strong>en</strong> termes de formation et de recherche ne sont pas comblés, l’<strong>en</strong>jeu a<br />
minima est d’éviter qu’ils ne se creus<strong>en</strong>t et de ret<strong>en</strong>ir les jeunes diplômés.<br />
Il faut dès lors miser davantage auprès des jeunes sur <strong>la</strong> valorisation des filières<br />
nouvelles de spécialisation industrielle comme celles portant sur les énergies<br />
nouvelles ou <strong>la</strong> maîtrise des risques…qui sont davantage connotées « industries<br />
<strong>en</strong> pointe » qu’industries traditionnelles ou vieillissantes.<br />
Par ailleurs, le mainti<strong>en</strong> des financem<strong>en</strong>ts publics locaux <strong>en</strong> matière de recherche<br />
à un haut niveau ne peut souffrir de concession. Il est ess<strong>en</strong>tiel d’œuvrer <strong>pour</strong><br />
attirer des financem<strong>en</strong>ts europé<strong>en</strong>s dans le cadre du programme opérationnel<br />
Octobre 2012 196
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
2014-2020 <strong>en</strong> cours de définition ainsi que de pousser les acteurs du PRES à<br />
définir une stratégie de développem<strong>en</strong>t lisible basée sur l’ouverture au monde<br />
économique.<br />
Enfin, il faut <strong>en</strong>visager immédiatem<strong>en</strong>t une politique de lutte contre l’illettrisme,<br />
ciblée <strong>en</strong> premier lieu sur l’illettrisme au travail, <strong>pour</strong> limiter <strong>la</strong> précarisation des<br />
actifs et créer les conditions de leur retour <strong>en</strong> formation, dès lors qu’ils sont<br />
touchés par une rupture dans l’emploi.<br />
3 – Un développem<strong>en</strong>t économique sout<strong>en</strong>u<br />
70% des échanges mondiaux se font <strong>en</strong>tre pays riches. Pour r<strong>en</strong>ouer avec <strong>la</strong><br />
croissance de l’industrie <strong>en</strong> région, il faut dépasser l’aire d’influ<strong>en</strong>ce des<br />
industries traditionnelles, <strong>pour</strong> lesquelles les marchés intérieurs n’assur<strong>en</strong>t plus<br />
que des débouchés de « r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t », <strong>en</strong> al<strong>la</strong>nt chercher des leviers de<br />
croissance ailleurs sur des nouveaux marchés extérieurs. Par ailleurs, le grand<br />
marché intérieur des pays développés peut absorber des produits issus des<br />
industries nouvelles ou qui ont réussi leur transition ou mutation économique.<br />
La région rev<strong>en</strong>dique une forte id<strong>en</strong>tité industrielle et agricole qu’elle assume et<br />
sur <strong>la</strong>quelle elle doit appuyer son développem<strong>en</strong>t économique.<br />
La région doit être <strong>en</strong> capacité de créer des produits ou services avec des<br />
débouchés correspondant au contexte des flux d’échanges de <strong>2025</strong>, c’est-à-dire<br />
qui se v<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t <strong>en</strong> raison d’un choix pertin<strong>en</strong>t de l’aire géographique de<br />
<strong>destin</strong>ation des produits et de leur caractère innovant<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de r<strong>en</strong>ouer avec <strong>la</strong> croissance de l’industrie <strong>en</strong> région.<br />
Avec tous les part<strong>en</strong>aires économiques du territoire, l’Etat et les experts du<br />
développem<strong>en</strong>t, <strong>la</strong> Région peut participer au r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des aides à<br />
l’innovation, à <strong>la</strong> diffusion technologique et à l’exportation. Ces dim<strong>en</strong>sions sont<br />
intégrées dans ses interv<strong>en</strong>tions <strong>en</strong> direction des <strong>en</strong>treprises et <strong>la</strong> priorité doit<br />
être donnée à <strong>la</strong> coordination, voire parfois <strong>la</strong> converg<strong>en</strong>ce des moy<strong>en</strong>s de tous<br />
les acteurs sur les mêmes cibles et, dans le même temps, <strong>pour</strong> des résultats<br />
amplifiés.<br />
En matière d’innovation, les acteurs doiv<strong>en</strong>t se rapprocher <strong>pour</strong> définir quel<br />
souti<strong>en</strong> complém<strong>en</strong>taire peut être accordé aux <strong>la</strong>boratoires publics de recherche<br />
et <strong>pour</strong> développer une culture de « brevets » là où l’évaluation académique<br />
accorde toute <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong> culture de <strong>la</strong> publication. La Région peut <strong>en</strong>visager le<br />
fléchage d’une partie des financem<strong>en</strong>ts « recherche » au profit de projets m<strong>en</strong>és<br />
<strong>en</strong> part<strong>en</strong>ariat avec des <strong>en</strong>treprises et leurs <strong>la</strong>boratoires privés de recherche ou<br />
avec des <strong>la</strong>boratoires étrangers, <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec une politique volontaire d’ouverture<br />
du PRES qui <strong>en</strong>gagera des actions structurantes et visibles par les part<strong>en</strong>aires.<br />
En ce qui concerne les thématiques de recherche, <strong>la</strong> Région doit valoriser l’intérêt<br />
qu’elle a déjà signifié <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> recherche dans le domaine de<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. L’occasion doit être saisie de monter <strong>en</strong> puissance une filière<br />
d’excell<strong>en</strong>ce fondée sur une expéri<strong>en</strong>ce acquise p<strong>en</strong>dant plusieurs déc<strong>en</strong>nies <strong>en</strong><br />
matière de gestion des risques, <strong>en</strong> fléchant une partie des crédits <strong>en</strong> matière de<br />
recherche sur ce domaine particulier du réseau dédié à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. La<br />
région, dans son <strong>en</strong>semble, est prête à assumer cette spécificité liée à <strong>la</strong><br />
prés<strong>en</strong>ce d’industries à risque sur son territoire, que ce soi<strong>en</strong>t les collectivités,<br />
les part<strong>en</strong>aires sociaux, les universitaires. Elle peut <strong>en</strong> faire un atout avec l’aide<br />
des industriels <strong>pour</strong> lesquels les savoirs et les innovations <strong>en</strong> matière de gestion<br />
des risques majeurs sont de l’ordre du « non concurr<strong>en</strong>tiel » et où <strong>la</strong><br />
capitalisation bénéficie à toute <strong>la</strong> société.<br />
Octobre 2012 197
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les propositions concernant le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> position de ses deux grands<br />
ports de Rou<strong>en</strong> et du Havre (image, qualité des infrastructures, accessibilité et<br />
rapidité,…) doit permettre d’affirmer <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> à<br />
l’international <strong>en</strong> favorisant l’imp<strong>la</strong>ntation des <strong>en</strong>treprises haut normandes à<br />
l’étranger, l’exportation de ses produits (bi<strong>en</strong>s ou services) et de développer des<br />
emplois industriels, logistiques et tertiaires. Elles doiv<strong>en</strong>t s’accompagner d’un<br />
r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des stratégies, notamm<strong>en</strong>t de communication, vers les <strong>en</strong>treprises<br />
nationales et internationales.<br />
Le rapport du CESR <strong>en</strong> 2008 sur les mutations économiques mettait déjà l’acc<strong>en</strong>t<br />
sur le poids des activités industrielles dans l’économie, évoquait les principales<br />
mutations prévisibles dans les 10 ans à v<strong>en</strong>ir et mettait <strong>en</strong> exergue 3 points<br />
ess<strong>en</strong>tiels :<br />
- quel que soit le secteur industriel, ce sont les secteurs d’excell<strong>en</strong>ce, de haute<br />
technicité et créateurs de forte valeur ajoutée qui se mainti<strong>en</strong>dront,<br />
- l’interdép<strong>en</strong>dance des différ<strong>en</strong>ts secteurs industriels haut-normands doit être<br />
prise <strong>en</strong> compte dans <strong>la</strong> stratégie industrielle régionale,<br />
- l’attractivité du territoire régional reste un facteur déterminant <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
pér<strong>en</strong>nisation des activités industrielles <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Si <strong>la</strong> région souhaite conserver des activités industrielles fortes et performantes<br />
sur son territoire, l’implication des pouvoirs publics et leur souti<strong>en</strong> aux<br />
<strong>en</strong>treprises sont nécessaires et seront déterminants.<br />
Le Conseil Régional peut jouer un rôle moteur dans le r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t de<br />
l’attractivité de notre territoire. Compte t<strong>en</strong>u de <strong>la</strong> configuration de <strong>la</strong> taille des<br />
<strong>en</strong>treprises <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, <strong>la</strong> Région doit aider à structurer les re<strong>la</strong>tions<br />
<strong>en</strong>tre les PME et les grandes <strong>en</strong>treprises, ess<strong>en</strong>tielles <strong>pour</strong> l’équilibre des<br />
activités, <strong>en</strong> :<br />
- sout<strong>en</strong>ant les opérations d’investissem<strong>en</strong>t des PME répondant aux besoins<br />
exprimés par les donneurs d’ordres, malgré les risques parfois avérés de voir<br />
le donneur d’ordre se tourner vers d’autres sous-traitants ;<br />
- favorisant le dialogue <strong>en</strong>tre sous-traitants locaux et grands groupes<br />
notamm<strong>en</strong>t lorsque ceux-ci cess<strong>en</strong>t leur activité <strong>en</strong> région.<br />
La Région doit afficher c<strong>la</strong>irem<strong>en</strong>t ses objectifs dans le cadre des contrats qu’elle<br />
passe avec les filières économiques et les branches professionnelles. Elle peut,<br />
par ce biais, aider à <strong>la</strong> consolidation des métiers de l’artisanat et de <strong>la</strong><br />
maint<strong>en</strong>ance <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t représ<strong>en</strong>tés dans le tissu d<strong>en</strong>se de PME locales.<br />
Enfin dans le cadre de sa politique économique, elle doit établir des contacts<br />
réguliers avec les responsables et décideurs des grands groupes prés<strong>en</strong>ts <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dont les sièges sont basés à l’extérieur de notre région.<br />
Elle doit accompagner l’anticipation des restructurations, plutôt qu’agir de<br />
manière curative a posteriori avec des politiques de revitalisation. A cet effet, elle<br />
doit s’interroger sur <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce, à l’échelle des bassins d’emploi de <strong>la</strong><br />
région, de réseaux d’anticipation, d’une gestion prévisionnelle des emplois et des<br />
compét<strong>en</strong>ces (GPEC) et de p<strong>la</strong>ns de formation concertés. Une structure<br />
perman<strong>en</strong>te <strong>pour</strong>ra être mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce à cet effet, regroupant par bassin d’emploi<br />
les grands acteurs économiques, les part<strong>en</strong>aires sociaux, les élus locaux…<br />
Cette démarche r<strong>en</strong>forcera par ailleurs l’id<strong>en</strong>tification des <strong>en</strong>treprises au<br />
territoire et <strong>la</strong> négociation, <strong>en</strong> amont des crises, <strong>en</strong>tre part<strong>en</strong>aires.<br />
Quant au financem<strong>en</strong>t des reprises d’<strong>en</strong>treprises, son inscription doit figurer au<br />
nombre des missions d’un pôle public financier qui reste à constituer, regroupant<br />
les institutions publiques et semi-publiques du crédit (<strong>la</strong> Banque de France, <strong>la</strong><br />
Caisse des dépôts et consignation, le Crédit foncier, Oséo <strong>pour</strong> le financem<strong>en</strong>t<br />
des PME…), chargé de promouvoir les financem<strong>en</strong>ts d’une croissance de qualité<br />
économique, sociale et écologique.<br />
Octobre 2012 198
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
L’<strong>en</strong>jeu de r<strong>en</strong>ouer avec <strong>la</strong> croissance de l’industrie ne doit pas occulter celui du<br />
développem<strong>en</strong>t des activités tertiaires notamm<strong>en</strong>t le tertiaire supérieur<br />
thématique sur <strong>la</strong>quelle le CESER a <strong>en</strong>tamé une réflexion et dont il faudra ret<strong>en</strong>ir<br />
les <strong>en</strong>jeux au terme de <strong>2025</strong>. La croissance de ces activités a un effet indirect<br />
sur l’économie résid<strong>en</strong>tielle et prés<strong>en</strong>tielle.<br />
Enfin, le caractère agricole de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, où les 2/3 du territoire sont<br />
couverts par les activités agricoles qui emploi<strong>en</strong>t 3% des actifs, <strong>en</strong> fait un<br />
secteur économique d’importance qui connait de fortes mutations avec des<br />
<strong>en</strong>jeux qui lui sont propres. La t<strong>en</strong>dance constante à <strong>la</strong> conc<strong>en</strong>tration des<br />
activités pose l’<strong>en</strong>jeu de <strong>la</strong> productivité des services logistiques (dépôt,<br />
transport…) liés à l’agriculture, de <strong>la</strong> pér<strong>en</strong>nité sur le territoire d’industries de<br />
transformation agro-alim<strong>en</strong>taires « historiques » qui sauront muter vers des<br />
activités innovantes et qui pès<strong>en</strong>t depuis toujours favorablem<strong>en</strong>t dans <strong>la</strong> ba<strong>la</strong>nce<br />
du commerce extérieur. C’est aussi celui de déterminer <strong>la</strong> part des surfaces à<br />
consacrer au déploiem<strong>en</strong>t d’autres modes de cultures, dans le but d’une part, de<br />
limiter l’impact de l’agriculture int<strong>en</strong>sive sur l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et d’autre part, de<br />
permettre une ori<strong>en</strong>tation plus importante vers des cultures « bio », notamm<strong>en</strong>t<br />
<strong>pour</strong> le maraîchage.<br />
Compte t<strong>en</strong>u de l’importance de ce secteur, <strong>la</strong> Région doit veiller à apporter un<br />
souti<strong>en</strong> à l’aune de celui qu’elle apporte à l’<strong>en</strong>semble des activités économiques<br />
prés<strong>en</strong>tes sur le territoire comme elle l’a d’ailleurs évoqué dans le CRDE, <strong>en</strong><br />
valorisant l’<strong>en</strong>semble des ressources locales dans les activités agro industrielles<br />
(ressource bois, ressource halieutique…). Dans ce cadre, elle doit s’interroger sur<br />
<strong>la</strong> pertin<strong>en</strong>ce et <strong>la</strong> faisabilité à <strong>2025</strong> d’un modèle économique qui re conc<strong>en</strong>tre<br />
sur le territoire l’<strong>en</strong>semble des activités de <strong>la</strong> filière lin, notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong><br />
transformation de <strong>la</strong> production actuellem<strong>en</strong>t délocalisée à l’étranger.<br />
Dans l’hypothèse où, <strong>en</strong> <strong>2025</strong>, <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où le<br />
manque d’efficacité économique est avéré, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de lutter<br />
contre <strong>la</strong> désindustrialisation de <strong>la</strong> région.<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer et communiquer autour des dispositifs de portage<br />
d’<strong>en</strong>treprise et d’aide au développem<strong>en</strong>t (couveuses, incubateurs, pépinières,<br />
usines re<strong>la</strong>is, …), progresser sur <strong>la</strong> spécialisation du territoire <strong>en</strong> matière de <strong>la</strong><br />
prév<strong>en</strong>tion et de gestion des risques industriels (industriels, chercheurs publics et<br />
privés, pouvoirs publics…).<br />
Enfin, il faut optimiser les retombées du fléchage des investissem<strong>en</strong>ts publics <strong>en</strong><br />
matière de THD <strong>en</strong> faisant de celui-ci un facteur de dynamisme repérable et<br />
repéré par les <strong>en</strong>treprises, grâce à une politique de communication sout<strong>en</strong>ue<br />
autour de cette priorité régionale. Elle sera bénéfique à <strong>la</strong> fois au développem<strong>en</strong>t<br />
des activités de services mais égalem<strong>en</strong>t dans tous les projets<br />
d’accompagnem<strong>en</strong>t à <strong>la</strong> reprise et à <strong>la</strong> transmission d’<strong>en</strong>treprises PME PMI<br />
régionales qui sont parfois m<strong>en</strong>acées faute de repr<strong>en</strong>eur.<br />
4 – L’Environnem<strong>en</strong>t, amélioration des bonnes pratiques<br />
Les possibilités d’actions nouvelles, des acteurs locaux et surtout de <strong>la</strong> Région,<br />
sont <strong>en</strong> discussion dans le cadre de <strong>la</strong> préparation d’un nouvel acte de <strong>la</strong><br />
déc<strong>en</strong>tralisation sur les thèmes de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et de <strong>la</strong> biodiversité. La<br />
Région devra les mettre au service des défis à relever et, <strong>en</strong> tout état de cause,<br />
faire valoir ses priorités dans l’é<strong>la</strong>boration et les révisions futures des 2 schémas<br />
régionaux SRCAE (climat air énergie) – <strong>pour</strong> définir les ori<strong>en</strong>tations stratégiques<br />
de <strong>la</strong> transition énergétique à l’échelle du territoire- et SRCE (cohér<strong>en</strong>ce<br />
écologique) – <strong>pour</strong> définir les stratégies de <strong>la</strong> conservation et de <strong>la</strong> gestion<br />
durable de <strong>la</strong> biodiversité. Les part<strong>en</strong>aires doiv<strong>en</strong>t se doter de ces deux schémas<br />
qui les <strong>en</strong>gageront, avec au premier p<strong>la</strong>n <strong>la</strong> collectivité régionale.<br />
Octobre 2012 199
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Celle-ci devra s’assurer que ces schémas sont bi<strong>en</strong> dotés d’outils d’évaluation<br />
<strong>pour</strong> que les objectifs fixés soi<strong>en</strong>t effectivem<strong>en</strong>t mesurés et atteints.<br />
L’animation régulière des acteurs doit être impulsée par <strong>la</strong> Région avec, <strong>en</strong> ligne<br />
de mire, <strong>la</strong> priorité à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion <strong>en</strong>tre l’homme et son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’ancrer le développem<strong>en</strong>t durable dans les pratiques<br />
de consommation et de production, de conservation des ressources naturelles et<br />
de <strong>la</strong> biodiversité, ainsi que d’« <strong>en</strong>granger » autour des progrès énergétiques.<br />
Dans son champ de compét<strong>en</strong>ce « éducation et formation », <strong>la</strong> Région peut<br />
toucher directem<strong>en</strong>t les jeunes et actifs au travers des programmes de<br />
formation. Elle peut aussi accompagner le changem<strong>en</strong>t des comportem<strong>en</strong>ts<br />
individuels par l’éducation à l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t et au développem<strong>en</strong>t durable, par<br />
<strong>la</strong> s<strong>en</strong>sibilisation et l’éducation aux économies d’énergies <strong>pour</strong> préparer les<br />
changem<strong>en</strong>ts de consommation et les économies d’énergie de demain.<br />
Les opérations de s<strong>en</strong>sibilisation doiv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t couvrir le domaine de<br />
l’habitat et de <strong>la</strong> construction et <strong>la</strong> Région doit s’<strong>en</strong>gager avec les collectivités<br />
compét<strong>en</strong>tes <strong>pour</strong> atteindre les ménages et les bailleurs (privés ou sociaux). Les<br />
progrès à faire sont <strong>en</strong>core importants <strong>pour</strong> atteindre les normes d’efficacité<br />
énergétique sur les bâtim<strong>en</strong>ts anci<strong>en</strong>s (99% du parc).<br />
La Région doit favoriser et amplifier le dialogue <strong>en</strong>tre tous les interv<strong>en</strong>ants sur<br />
les espaces naturels dans les instances ad hoc de pilotage des schémas <strong>pour</strong><br />
faire converger les visions complém<strong>en</strong>taires qu’ont les uns et les autres d’une<br />
seule et même logique qui les anime, à savoir <strong>la</strong> gestion des ressources<br />
naturelles respectueuse de <strong>la</strong> biodiversité.<br />
La Région doit veiller à <strong>la</strong> déf<strong>en</strong>se de nouveaux <strong>en</strong>jeux : déploiem<strong>en</strong>t de son<br />
expertise, ses études et conseils auprès des communautés de communes ou des<br />
communes <strong>pour</strong> accompagner les politiques locales de développem<strong>en</strong>t durable,<br />
de protection de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t, d’aménagem<strong>en</strong>t des espaces, de gestion de <strong>la</strong><br />
distribution d’eau (syndicats) et de <strong>la</strong> qualité de l’eau potable.<br />
Elle doit aussi s’assurer que le développem<strong>en</strong>t industriel ou l’imp<strong>la</strong>ntation de<br />
nouvelles activités n’empièt<strong>en</strong>t plus sur les terres agricoles et ne déséquilibr<strong>en</strong>t<br />
pas l’espace et <strong>la</strong> biodiversité. Un chantier à part <strong>en</strong>tière autour de <strong>la</strong><br />
réutilisation de friches industrielles doit s’ouvrir. Il s’agit de déterminer dans<br />
quelles conditions et <strong>pour</strong> quel type d’activité ces friches peuv<strong>en</strong>t être réutilisées<br />
avant l’exploitation de nouveaux espaces naturels. Cette réflexion doit impliquer<br />
l’<strong>en</strong>semble des part<strong>en</strong>aires et notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> Région au titre de sa compét<strong>en</strong>ce<br />
économique et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tale.<br />
Elle doit égalem<strong>en</strong>t id<strong>en</strong>tifier des moy<strong>en</strong>s de recherche <strong>pour</strong> améliorer <strong>la</strong><br />
connaissance sci<strong>en</strong>tifique <strong>en</strong> matière de mesure de <strong>la</strong> biodiversité (observatoire<br />
régional de <strong>la</strong> biodiversité étoffé dans ses missions). A minima, le SRCE devra<br />
prévoir <strong>la</strong> création d’un lieu répertoriant et rassemb<strong>la</strong>nt les données <strong>en</strong> matière<br />
de biodiversité <strong>en</strong> li<strong>en</strong> avec les schémas d’urbanisme.<br />
Enfin, <strong>en</strong> termes de dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>ts, tous les part<strong>en</strong>aires <strong>en</strong> charges des<br />
infrastructures doiv<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>forcer les moy<strong>en</strong>s <strong>pour</strong> accroître l’éco mobilité,<br />
notamm<strong>en</strong>t <strong>la</strong> réalisation de pistes cyc<strong>la</strong>bles.<br />
5 - L’amélioration de l’accès aux soins, un passage indisp<strong>en</strong>sable <strong>pour</strong><br />
rompre avec <strong>la</strong> pénurie<br />
La raréfaction des ressources dans le domaine des politiques de santé <strong>la</strong>isse à<br />
Octobre 2012 200
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
p<strong>en</strong>ser que <strong>la</strong> redéfinition des politiques sociales est une nécessité. Sachant que<br />
ces décisions ne relèveront pas du niveau régional, celui-ci peut cep<strong>en</strong>dant<br />
utiliser ses moy<strong>en</strong>s d’action sur l’amélioration de <strong>la</strong> situation régionale,<br />
aujourd’hui dégradée <strong>en</strong> matière d’indicateurs de santé publique et d’accès aux<br />
soins. L’hypothèse d’une prise <strong>en</strong> charge au niveau national des interv<strong>en</strong>tions<br />
liées à <strong>la</strong> vieillesse, à <strong>la</strong> dép<strong>en</strong>dance et à l’allongem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> durée de vie est<br />
énoncée dans le sc<strong>en</strong>ario S2, <strong>en</strong> raison des difficultés actuelles du financem<strong>en</strong>t<br />
local qui n’a pas les moy<strong>en</strong>s d’adapter ses ressources. Sa vérification dép<strong>en</strong>dra<br />
de l’aboutissem<strong>en</strong>t des réflexions <strong>en</strong>gagées nationalem<strong>en</strong>t sur le financem<strong>en</strong>t<br />
global de <strong>la</strong> protection sociale. Ces discussions devront aboutir à une meilleure<br />
pertin<strong>en</strong>ce dans l’adéquation des moy<strong>en</strong>s aux ressources et permettre de miser<br />
sur un mainti<strong>en</strong> des marges de manœuvre locales.<br />
En réponse aux besoins cruciaux liés au déficit de professionnels de santé <strong>en</strong><br />
région et à <strong>la</strong> situation socio-sanitaire préoccupante, <strong>la</strong> région ne peut « se<br />
<strong>la</strong>isser vivre » <strong>en</strong> matière de santé et doit repr<strong>en</strong>dre un pas d’avance et gagner<br />
<strong>en</strong> attractivité.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de permettre un accès aux soins équilibré et de rompre<br />
avec <strong>la</strong> situation de pénurie régionale dans l’offre de soins.<br />
Dans les champs d’interv<strong>en</strong>tion qui sont les si<strong>en</strong>s ou dans lesquels elle a souhaité<br />
s’investir <strong>en</strong> matière de santé et d’offre de soins, <strong>la</strong> Région doit prioriser le<br />
déploiem<strong>en</strong>t des nouvelles pratiques de <strong>la</strong> télémédecine et de <strong>la</strong> télésanté, <strong>en</strong><br />
s’appuyant sur l’avance acquise grâce aux efforts cons<strong>en</strong>tis <strong>en</strong> matière de<br />
développem<strong>en</strong>t du numérique sur son territoire.<br />
Le développem<strong>en</strong>t des maisons médicales, auxquelles elle participe sur les<br />
territoires où il y a urg<strong>en</strong>ce à améliorer l’accès aux soins, gagnera aussi <strong>en</strong><br />
efficacité à moy<strong>en</strong> terme grâce à ces technologies que <strong>la</strong> Région peut inciter à<br />
mettre <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce lors de <strong>la</strong> définition des conv<strong>en</strong>tions de part<strong>en</strong>ariat.<br />
Elle peut ainsi mobiliser une partie de ses aides à <strong>la</strong> recherche sur le secteur de<br />
<strong>la</strong> télémédecine et de <strong>la</strong> télésanté (programmes de recherches et équipem<strong>en</strong>ts)<br />
ainsi que pousser à <strong>la</strong> professionnalisation de tous les acteurs de santé publique<br />
sur ces nouvelles techniques au fur et à mesure de leur déploiem<strong>en</strong>t. En effet,<br />
leur utilisation ne <strong>pour</strong>ra être optimale que si elles sont répandues dans toute <strong>la</strong><br />
chaîne de prise <strong>en</strong> charge médicale et paramédicale, jusqu’à l’interv<strong>en</strong>tion auprès<br />
des personnes à domicile. Que ce soit dans le cadre de ses compét<strong>en</strong>ces <strong>en</strong><br />
matière de formation sanitaire et sociale aux côtés des écoles spécialisées, dans<br />
ses re<strong>la</strong>tions avec l’université dans le cadre de « l’universitarisation » des<br />
formations supérieures, ou <strong>en</strong>core aux côtés des professionnels qu’elle r<strong>en</strong>contre<br />
au sein du contrat d’objectif de <strong>la</strong> branche sanitaire et sociale, elle doit mobiliser<br />
ses part<strong>en</strong>aires sur cet objectif stratégique et définir les moy<strong>en</strong>s opérationnels<br />
les plus adéquats.<br />
Mais, ces nouvelles technologies, représ<strong>en</strong>tant une réelle opportunité <strong>pour</strong><br />
améliorer l’accès aux soins <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, ne sont pas l’unique solution.<br />
Par <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>ce des acteurs politiques locaux et représ<strong>en</strong>tants à l’Assemblée<br />
Nationale, <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> doit être <strong>en</strong> mesure de peser <strong>pour</strong> influer et faire<br />
évoluer favorablem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> démographie médicale et paramédicale <strong>en</strong> région<br />
(répartition des quotas nationaux, financem<strong>en</strong>t des grands équipem<strong>en</strong>ts des<br />
structures hospitalières publiques et privées…). La collectivité régionale de son<br />
côté doit maint<strong>en</strong>ir l’affichage de ses priorités sur l’aide à <strong>la</strong> recherche régionale<br />
dans le secteur médical et globalem<strong>en</strong>t dans le pôle CBS chimie-biologie-santé,<br />
ainsi que sur l’aide à <strong>la</strong> valorisation de <strong>la</strong> recherche, notamm<strong>en</strong>t par <strong>la</strong> régu<strong>la</strong>rité<br />
des congrès de spécialistes aidés par <strong>la</strong> Région.<br />
Octobre 2012 201
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Dans tous les cas de figure, le meilleur accès aux soins <strong>pour</strong> tous sera aussi<br />
facilité par une meilleure prév<strong>en</strong>tion qui diminue les risques de pathologies<br />
lourdes. Dans ce domaine, <strong>la</strong> Région doit utiliser les li<strong>en</strong>s qu’elle a instaurés<br />
avec les <strong>en</strong>treprises, publiques et privées, au sein des contrats d’objectif de<br />
branches <strong>pour</strong> inciter à faire de <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et de <strong>la</strong> santé au travail une<br />
priorité. Sur les territoires, dans le cadre des représ<strong>en</strong>tations qu’elle occupe au<br />
sein des instances réunissant les acteurs de <strong>la</strong> formation ou dans le champ de<br />
l’éducation popu<strong>la</strong>ire, dans le cadre de ses re<strong>la</strong>tions avec les différ<strong>en</strong>tes<br />
collectivités, elle doit re<strong>la</strong>yer ce message sur l’importance à agir sur les risques<br />
épidémiologiques avérés <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> et accompagner, au titre de ses<br />
différ<strong>en</strong>tes interv<strong>en</strong>tions, <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion et l’éducation à <strong>la</strong> santé, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
direction des jeunes et des familles.<br />
6 – Des flux migratoires inversés<br />
La caractéristique des flux migratoires <strong>en</strong> région, jusqu’aux années 70-80, est <strong>la</strong><br />
forte corré<strong>la</strong>tion de sa croissance démographique avec les opportunités<br />
économiques, industrielles ou les opportunités d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire<br />
impulsées de l’extérieur.<br />
La prise <strong>en</strong> main de cette composante est donc difficile, mais un développem<strong>en</strong>t<br />
sout<strong>en</strong>u d’activités dans <strong>la</strong> région peut attirer des popu<strong>la</strong>tions d’autres régions<br />
avoisinantes, tout comme c’est déjà le cas <strong>pour</strong> les actifs de l’Ile de France.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est d’attirer des popu<strong>la</strong>tions tout <strong>en</strong> gardant un équilibre<br />
sur le territoire <strong>en</strong>tre jeunes, actifs, s<strong>en</strong>iors et 3 ème âge <strong>pour</strong> minimiser les<br />
conséqu<strong>en</strong>ces négatives d’une trop forte spécificité de c<strong>la</strong>sses d’âges sur un<br />
territoire donné.<br />
L’attractivité des popu<strong>la</strong>tions est, dans bi<strong>en</strong> des cas, une résultante des actions<br />
qui seront <strong>en</strong>treprises dans les domaines précédemm<strong>en</strong>t cités : <strong>la</strong> couverture<br />
numérique <strong>en</strong> THD, les facilités d’accessibilité, les parcours de formation et<br />
d’insertion dans l’emploi, l’accès aux qualifications supérieures <strong>en</strong> région, le<br />
r<strong>en</strong>forcem<strong>en</strong>t des activités nouvelles et innovantes <strong>en</strong> région porteuses<br />
d’emplois, <strong>la</strong> dynamique régionale au sein du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>,<br />
l’accès aux soins de qualité, le respect des espaces naturels et les pratiques<br />
partagées de développem<strong>en</strong>t durable …<br />
<strong>Quel</strong>ques priorités cep<strong>en</strong>dant peuv<strong>en</strong>t être définies <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, qui<br />
au regard du phénomène général de vieillissem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, doit veiller<br />
plus particulièrem<strong>en</strong>t au r<strong>en</strong>ouvellem<strong>en</strong>t de main-d’œuvre dans certains<br />
secteurs, où les actifs de plus de 55 ans seront proportionnellem<strong>en</strong>t plus<br />
nombreux dès 2020.<br />
La cible est donc les jeunes et les politiques d’accompagnem<strong>en</strong>t social qui sont<br />
décrites au chapitre « l’humain, pilier du progrès et de <strong>la</strong> croissance». Elles sont<br />
tournées particulièrem<strong>en</strong>t vers les jeunes <strong>en</strong> formation, plus spécifiquem<strong>en</strong>t vers<br />
les étudiants <strong>pour</strong> les aider à suivre leur parcours et à s’insérer <strong>en</strong> région. Il ne<br />
s’agit pas de limiter <strong>la</strong> mobilité des jeunes, y compris ceux qui part<strong>en</strong>t étudier<br />
ailleurs, cette démarche étant éminemm<strong>en</strong>t formatrice, mais bi<strong>en</strong> d’inciter des<br />
jeunes à v<strong>en</strong>ir ou à rev<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> région grâce aux actions <strong>en</strong>treprises <strong>pour</strong> faciliter<br />
les conditions de leur <strong>en</strong>trée dans <strong>la</strong> vie active.<br />
Il ne revi<strong>en</strong>t pas à <strong>la</strong> Région seule de les mettre <strong>en</strong> œuvre mais à tous les<br />
part<strong>en</strong>aires concernés selon les niveaux de formation ou le type d’aide <strong>en</strong>visagée<br />
(aide à caractère social, logem<strong>en</strong>t, culture, …). Elle doit néanmoins convaincre<br />
que l’attrait des jeunes est un facteur-clé <strong>pour</strong> l’av<strong>en</strong>ir, indisp<strong>en</strong>sable <strong>pour</strong><br />
conduire au dynamisme régional.<br />
Octobre 2012 202
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
Sur les domaines d’interv<strong>en</strong>tion qu’elle a investis, <strong>la</strong> Région peut r<strong>en</strong>forcer les<br />
mesures attractives <strong>pour</strong> les jeunes chercheurs et <strong>pour</strong> faciliter l’<strong>en</strong>trée et <strong>la</strong><br />
réussite des parcours des lycé<strong>en</strong>s dans l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur.<br />
Enfin, des offres de services aux popu<strong>la</strong>tions susceptibles de s’imp<strong>la</strong>nter dans <strong>la</strong><br />
région avec l’arrivée de nouvelles activités économiques ou le développem<strong>en</strong>t<br />
d’<strong>en</strong>treprises régionales doiv<strong>en</strong>t pouvoir être proposées dans le cadre de<br />
programmes concertés <strong>en</strong>tre collectivités à l’échelle infra territoriale.<br />
7 – Rayonnem<strong>en</strong>t culturel et tourisme comme vecteurs d’id<strong>en</strong>tité<br />
La culture et le tourisme sont les atouts d’un territoire. La <strong>Normandie</strong> fait partie<br />
des trois ou quatre régions françaises id<strong>en</strong>tifiées dans le monde <strong>en</strong>tier. Mais les<br />
réc<strong>en</strong>tes études du CESER ont mis <strong>en</strong> lumière un constat paradoxal, celui d’une<br />
offre culturelle abondante et riche, d’acteurs impliqués, mais d’un manque de<br />
lisibilité de cette offre et des politiques. Elles ont pointé une abs<strong>en</strong>ce de culture<br />
de réseau et d’un évènem<strong>en</strong>t d’<strong>en</strong>vergure qui donn<strong>en</strong>t une image susceptible de<br />
générer un véritable s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d’appart<strong>en</strong>ance qui se construit dans <strong>la</strong> durée.<br />
Dans un cadre financier de plus <strong>en</strong> plus contraint, les choix opérés par les<br />
décideurs dans ce domaine sont d’autant plus cruciaux.<br />
Il convi<strong>en</strong>t d’aller vers <strong>la</strong> conquête d’une id<strong>en</strong>tité territoriale porteuse de<br />
dynamisme et d’attractivité à <strong>la</strong> fois <strong>en</strong> matière culturelle et touristique.<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de faire évoluer rapidem<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vision du dynamisme<br />
culturel et touristique comme un véritable outil d’aménagem<strong>en</strong>t du territoire.<br />
Le CESER r<strong>en</strong>voie à ses réc<strong>en</strong>ts rapports sur <strong>la</strong> culture où, parmi les propositions<br />
déjà émises, on peut citer <strong>la</strong> création d’un observatoire des pratiques culturelles<br />
et d’un Comité Régional de <strong>la</strong> Culture, l’établissem<strong>en</strong>t d’un schéma régional de<br />
développem<strong>en</strong>t culturel avec un chef de file id<strong>en</strong>tifié et une stratégie commune<br />
d’interv<strong>en</strong>tion autour d’un axe stratégique c<strong>la</strong>ir. L’idée déf<strong>en</strong>due est celle d’une<br />
vision « intégrée » de <strong>la</strong> culture comme une composante naturelle de chaque<br />
acte de <strong>la</strong> société qui imprègne les politiques de cohésion sociale, l’économie,<br />
l’aménagem<strong>en</strong>t du territoire, l’éducation, l’international, le handicap et<br />
l’accessibilité, le développem<strong>en</strong>t durable… et comme élém<strong>en</strong>t d’attractivité au<br />
même titre qu’un service public. Cette vision présuppose de nouveaux modes de<br />
gouvernance, plus participatifs et un part<strong>en</strong>ariat r<strong>en</strong>ouvelé <strong>en</strong>tre Etat,<br />
collectivités et acteurs culturels, les grands acteurs économiques du territoire<br />
dans le cadre d’un fonctionnem<strong>en</strong>t décloisonné, l’intérêt d’attractivité et de<br />
rayonnem<strong>en</strong>t étant partagé par tous.<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t s’approprier une id<strong>en</strong>tité de territoire é<strong>la</strong>rgi <strong>en</strong> <strong>2025</strong> à<br />
l’échelle de l’Axe Paris Seine <strong>Normandie</strong> qui s’appuie sur les cohér<strong>en</strong>ces<br />
d’id<strong>en</strong>tités historiques d’une part et, sur les cohér<strong>en</strong>ces économiques, sociales et<br />
<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales de Paris, Rou<strong>en</strong>, le Havre, Ca<strong>en</strong> et Cherbourg, d’autre part,<br />
<strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte de <strong>la</strong> proximité de <strong>la</strong> région parisi<strong>en</strong>ne très prégnante <strong>pour</strong> <strong>la</strong><br />
fréqu<strong>en</strong>tation touristique de <strong>la</strong> région.<br />
En matière d’évènem<strong>en</strong>tiel, les bases sont posées et doiv<strong>en</strong>t être utilisées <strong>pour</strong><br />
consolider à cette échelle de territoire deux événem<strong>en</strong>ts d’<strong>en</strong>vergure nationale et<br />
internationale qui fonctionn<strong>en</strong>t, autour des id<strong>en</strong>tités régionales et leur<br />
universalité, <strong>en</strong> leur donnant un rythme lisible <strong>en</strong> alternance au moins tous les<br />
deux ans : d’une part, l’Armada et l’id<strong>en</strong>tité de <strong>la</strong> mer, du fleuve, du voyage, de<br />
l’échange <strong>en</strong>tre les cultures, avec des croisières sur l’axe Paris Seine <strong>Normandie</strong><br />
et le développem<strong>en</strong>t de produits touristiques ad hoc symboles de <strong>la</strong> région<br />
industrielle fluviale et maritime, … et d’autre part <strong>Normandie</strong> Impressionniste<br />
Octobre 2012 203
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
et le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre les paysages, le développem<strong>en</strong>t industriel de <strong>la</strong> Seine, le chemin<br />
de fer…. Le rythme est important <strong>pour</strong> dépasser le stade de « l’émerveillem<strong>en</strong>t »<br />
et faire durer l’évènem<strong>en</strong>tiel afin de le faire évoluer avec son temps et de ne pas<br />
le figer ou le « patrimonialiser ».<br />
C’est aussi l’échelle de territoire à <strong>la</strong>quelle il faut valoriser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce des<br />
établissem<strong>en</strong>ts culturels et d’éducation artistique régionaux, que ce soi<strong>en</strong>t les<br />
musées, les conservatoires, les écoles d’arts. Une offre complém<strong>en</strong>taire,<br />
notamm<strong>en</strong>t dans le domaine des <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts artistiques supérieurs, attractive<br />
<strong>pour</strong> les francili<strong>en</strong>s doit être proposée à partir de l’évaluation préa<strong>la</strong>ble des<br />
points de saturation de ces structures <strong>en</strong> Ile de France. C’est <strong>en</strong>fin l’échelle à<br />
<strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> Région doit consolider les réseaux de professionnels dans les<br />
différ<strong>en</strong>ts secteurs (Réseau des Musiques Actuelles de <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong>, Pôles<br />
régionaux, musique, arts visuels) et <strong>en</strong> les incitant à s’ouvrir sur <strong>la</strong> Manche et<br />
l’At<strong>la</strong>ntique.<br />
Les acteurs doiv<strong>en</strong>t aussi dépasser l’échelle territoriale de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
afin de créer une ouverture internationale dans les créations, dans les diffusions,<br />
dans <strong>la</strong> communication : <strong>la</strong> Grande-Bretagne, voire les Etats-Unis, font partie<br />
intégrante de l’id<strong>en</strong>tité historique de <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> et permettrai<strong>en</strong>t de « v<strong>en</strong>dre<br />
l’id<strong>en</strong>tité culturelle normande à l’étranger ». La recherche de lisibilité<br />
internationale doit <strong>en</strong>fin s’appuyer sur <strong>la</strong> <strong>pour</strong>suite des politiques de c<strong>la</strong>ssem<strong>en</strong>t<br />
au patrimoine mondial de l’Unesco et des <strong>la</strong>bels internationaux ainsi que sur <strong>la</strong><br />
réflexion autour d’une « capitale europé<strong>en</strong>ne » de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong> région.<br />
Enfin, <strong>pour</strong> accompagner une vision « intégrée » de <strong>la</strong> culture comme une<br />
composante naturelle de chaque acte de <strong>la</strong> société, il faut inciter les acteurs à<br />
s’ouvrir et à rep<strong>en</strong>ser <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du privé dans le financem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong><br />
favorisant des stratégies de mécénats cohér<strong>en</strong>tes (création de fondations<br />
territoriales), articulées sur les intérêts communs des <strong>en</strong>treprises (recherche<br />
d’image <strong>en</strong> interne ou de notoriété à l’externe) et du territoire régional.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où<br />
seuls les territoires parvi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à se mobiliser <strong>pour</strong> développer une offre<br />
culturelle de proximité, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de conjuguer les initiatives<br />
infrarégionales <strong>pour</strong> maint<strong>en</strong>ir les positions actuelles <strong>en</strong> matière de pratique, de<br />
création, de fréqu<strong>en</strong>tation culturelle et touristique et de valorisation du<br />
patrimoine, sachant qu’il n’y a pas forcém<strong>en</strong>t de « réconciliation » à opérer <strong>en</strong>tre<br />
le public et les arts.<br />
La Région doit alors mettre <strong>en</strong> œuvre les moy<strong>en</strong>s <strong>pour</strong> conjuguer le<br />
développem<strong>en</strong>t culturel des territoires avec un projet culturel régional et inciter<br />
les professionnels à combiner l’offre culturelle et l’offre touristique. La priorité<br />
donnée par <strong>la</strong> Région au développem<strong>en</strong>t du THD est une opportunité <strong>pour</strong><br />
faciliter ce coup<strong>la</strong>ge, <strong>en</strong> permettant <strong>la</strong> communication groupée de tout type<br />
d’offre vers le grand public, localem<strong>en</strong>t ou nationalem<strong>en</strong>t.<br />
Il est incontournable de maint<strong>en</strong>ir un évènem<strong>en</strong>t annuel fédérateur autour de <strong>la</strong><br />
richesse aquatique et, a minima, de consolider l’id<strong>en</strong>tité de l’Armada et de<br />
<strong>Normandie</strong> Impressionniste. Les collectivités locales avec le souti<strong>en</strong> de <strong>la</strong> Région<br />
peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t tirer opportunité de l’image de l’axe « Paris Seine<br />
<strong>Normandie</strong> » <strong>pour</strong> développer d’une part, des résid<strong>en</strong>ces d’écritures <strong>pour</strong><br />
scénaristes ou <strong>en</strong>core des résid<strong>en</strong>ces d’artistes, notamm<strong>en</strong>t dans l’Eure et,<br />
d’autre part, des vil<strong>la</strong>ges animés le long de <strong>la</strong> Seine autour des jardins, des<br />
écrivains, de <strong>la</strong> culture industrielle de <strong>la</strong> vallée, <strong>en</strong> exploitant <strong>la</strong> thématique du<br />
développem<strong>en</strong>t durable.<br />
Octobre 2012 204
Les préconisations à <strong>2025</strong><br />
Les souti<strong>en</strong>s des différ<strong>en</strong>ts financeurs doiv<strong>en</strong>t être maint<strong>en</strong>us <strong>pour</strong> conserver le<br />
niveau de nos établissem<strong>en</strong>ts culturels et d’éducation artistique d’exception, mais<br />
ils devront être augm<strong>en</strong>tés <strong>pour</strong> développer les pratiques amateurs qui<br />
contribu<strong>en</strong>t à l’appét<strong>en</strong>ce <strong>pour</strong> <strong>la</strong> culture, étant un gage du dynamisme des<br />
initiatives locales sur les territoires. Le rapprochem<strong>en</strong>t avec <strong>la</strong> demande du public<br />
permet de faire évoluer l’offre avec <strong>la</strong> société.<br />
La Région doit <strong>en</strong>fin inciter au développem<strong>en</strong>t d’initiatives autour du couple<br />
« patrimoine historique» / « modernité ». Le patrimoine est un véhicule de<br />
modernité et <strong>la</strong> richesse de <strong>la</strong> région devrait être un support lui permettant de<br />
pr<strong>en</strong>dre un temps d’avance.<br />
8 - La gouvernance du développem<strong>en</strong>t durable<br />
Les différ<strong>en</strong>tes propositions qui précèd<strong>en</strong>t évoqu<strong>en</strong>t <strong>la</strong>rgem<strong>en</strong>t le part<strong>en</strong>ariat<br />
<strong>en</strong>tre acteurs du développem<strong>en</strong>t du territoire, qu’ils soi<strong>en</strong>t publics ou privés,<br />
ainsi que le part<strong>en</strong>ariat avec les acteurs <strong>en</strong> dehors du territoire.<br />
Cette question d’échelle territoriale et de gouvernance est au cœur de <strong>la</strong> réussite<br />
des initiatives qui seront prises <strong>pour</strong> aller « vers une <strong>Normandie</strong> audacieuse et<br />
plus forte »<br />
L’<strong>en</strong>jeu stratégique est de changer <strong>la</strong> culture de territoire <strong>pour</strong> positionner <strong>la</strong><br />
<strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> dans un <strong>en</strong>semble plus <strong>la</strong>rge (Paris Seine <strong>Normandie</strong> … et moi,<br />
… et lui, le francili<strong>en</strong>) et de faire converger et concorder dans le temps les<br />
moy<strong>en</strong>s financiers de tous les acteurs, de convaincre que <strong>la</strong> région ne doit plus<br />
« att<strong>en</strong>dre » ce qui ne vi<strong>en</strong>dra plus de l’extérieur…<br />
Si <strong>la</strong> Région n’a pas des moy<strong>en</strong>s d’action dans tous les domaines, elle reste<br />
l’échelon territorial pertin<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> impulser les choix prioritaires, décider les<br />
acteurs à adopter un p<strong>la</strong>n stratégique de développem<strong>en</strong>t, à adhérer et à se<br />
mettre <strong>en</strong> mouvem<strong>en</strong>t. Elle le sera probablem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core davantage par <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
qui lui sera dévolue à l’issu du nouvel acte de déc<strong>en</strong>tralisation <strong>en</strong> chantier.<br />
Aussi <strong>la</strong> prospective <strong>2025</strong> proposée doit reposer sur les moy<strong>en</strong>s d’actions<br />
spécifiques qui sont ceux des schémas de développem<strong>en</strong>t dans tous les domaines<br />
concernés auxquels <strong>la</strong> Région participe, qu’ils <strong>en</strong> soi<strong>en</strong>t au stade de <strong>la</strong> définition<br />
ou de <strong>la</strong> mise <strong>en</strong> œuvre. Leur infléchissem<strong>en</strong>t peut interv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> cours de<br />
réalisation, dès lors qu’ils peuv<strong>en</strong>t être évalués.<br />
Elle doit ainsi développer et valoriser sa participation à des réflexions sur <strong>la</strong> mise<br />
<strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce et <strong>la</strong> redéfinition à v<strong>en</strong>ir de schémas (voire de nouvelles compét<strong>en</strong>ces<br />
issues du nouvel acte de <strong>la</strong> déc<strong>en</strong>tralisation) - SCORAN, SRIT, aménagem<strong>en</strong>t du<br />
territoire, SRCAE, SRCE, éoli<strong>en</strong>…, - saisir les opportunités des « révisions» de<br />
politiques contractuelles à v<strong>en</strong>ir – programmes europé<strong>en</strong>s, C8, CPER, contrats de<br />
territoires, Contrat 276…<br />
De même que chaque acteur doit être <strong>en</strong> capacité d’évaluer ses propres<br />
politiques d’interv<strong>en</strong>tion, avec des moy<strong>en</strong>s dédiés et précisés dès <strong>la</strong> définition<br />
d’une interv<strong>en</strong>tion ou d’un <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t contractuel, <strong>la</strong> question de<br />
l’é<strong>la</strong>rgissem<strong>en</strong>t de l’évaluation des politiques publiques aux différ<strong>en</strong>ts schémas<br />
régionaux est incontournable. Elle requiert une animation régulière par le chef de<br />
file ou par <strong>la</strong> Région qui peut s’emparer de cette prérogative. Le croisem<strong>en</strong>t<br />
d’analyse de tous les interv<strong>en</strong>ants à un schéma redouble son efficacité<br />
puisqu’elle donne lieu à des constats partagés par les acteurs. L’anticipation, les<br />
ambitions et les choix à opérer <strong>en</strong> sont d’autant plus facilem<strong>en</strong>t partagés eux<br />
aussi.<br />
Octobre 2012 205
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Les différ<strong>en</strong>ts acteurs doiv<strong>en</strong>t saisir toutes les opportunités et préconisations qui<br />
sortiront des études du CESER à l’horizon de fin 2013, sachant que tous les<br />
sujets <strong>en</strong> cours non achevés complèteront directem<strong>en</strong>t le prés<strong>en</strong>t. Ces sujets<br />
sont le numérique <strong>en</strong> région, le projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>, les flux portuaires,<br />
le PRES, le tertiaire supérieur, l’éducation popu<strong>la</strong>ire, l’illettrisme.<br />
La Région doit par ailleurs pousser à faire partager des nouveaux indicateurs de<br />
mesure de <strong>la</strong> richesse régionale, complém<strong>en</strong>taires à celui du PIB <strong>en</strong> incluant les<br />
deux autres piliers du développem<strong>en</strong>t durable que sont le social et<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal <strong>pour</strong> faire pr<strong>en</strong>dre toute son importance à <strong>la</strong> mesure de <strong>la</strong><br />
qualité de vie sur le territoire lorsqu’il est question de qualifier <strong>la</strong> croissance<br />
régionale. Il s’agit notamm<strong>en</strong>t de l’indicateur de développem<strong>en</strong>t humain IDH,<br />
utilisé depuis les années 1990 par le Programme des Nations Unies <strong>pour</strong> le<br />
Développem<strong>en</strong>t, qui établit une moy<strong>en</strong>ne de trois indicateurs reflétant le niveau<br />
de vie, l’éducation et <strong>la</strong> santé. Une adaptation des données sources permet aussi<br />
de comparer les territoires infrarégionaux <strong>en</strong>tre eux avec cette vision é<strong>la</strong>rgie de<br />
<strong>la</strong> « richesse » et montre que <strong>la</strong> région arrive au 18 ème rang sur les 22 régions<br />
alors qu’elle se situe au 6 ème rang <strong>pour</strong> le PIB par habitant <strong>en</strong> 2008 53 .<br />
Enfin l’<strong>en</strong>semble des acteurs locaux doit assurer l’association <strong>en</strong> amont des<br />
popu<strong>la</strong>tions au déploiem<strong>en</strong>t de projets de territoires régionaux qui est souv<strong>en</strong>t<br />
gage de réussite.<br />
Dans l’hypothèse où <strong>en</strong> <strong>2025</strong> <strong>la</strong> situation connue est celle du sc<strong>en</strong>ario S2, où <strong>la</strong><br />
gouvernance se situe plutôt au niveau des territoires métropolitains, des<br />
agglomérations, des bassins de vie, l’<strong>en</strong>jeu a minima est de réussir à agir de<br />
« concert <strong>en</strong>tre acteurs » du territoire <strong>pour</strong> limiter son appauvrissem<strong>en</strong>t et<br />
« maint<strong>en</strong>ir sa position re<strong>la</strong>tive ».<br />
Dans ce contexte, il convi<strong>en</strong>t de miser sur un « leadership régional » <strong>pour</strong><br />
conduire quelques projets de grande ampleur qui nécessiterai<strong>en</strong>t de mutualiser<br />
les ambitions. La collectivité régionale doit montrer une volonté accrue.<br />
Dans ce contexte, il convi<strong>en</strong>t de miser sur un « leadership régional » <strong>pour</strong><br />
conduire quelques projets de grande ampleur qui nécessiterai<strong>en</strong>t de mutualiser<br />
les ambitions. La collectivité régionale doit montrer une volonté accrue.<br />
Par ailleurs, « le chef de filât » unique est souv<strong>en</strong>t posé comme un postu<strong>la</strong>t. Mais<br />
il doit t<strong>en</strong>ir compte <strong>pour</strong> <strong>la</strong> réussite des projets des différ<strong>en</strong>ts acteurs concernés<br />
et de leurs échéances, qui ne sont pas forcém<strong>en</strong>t les mêmes. Le recul <strong>pour</strong><br />
assurer une vision globale est néanmoins nécessaire à l’échelle régionale et c’est<br />
ce rôle a minima qui doit être investi par <strong>la</strong> collectivité<br />
53 Réf : – ARF Janvier 2012 - Conseil Régional Nord – Pas de Ca<strong>la</strong>is « Développem<strong>en</strong>t durable : <strong>la</strong><br />
révolution des nouveaux indicateurs »<br />
Octobre 2012 206
Conclusion<br />
Conclusion<br />
Octobre 2012 207
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 208
Conclusion<br />
Dans le contexte mouvant et incertain que nous connaissons, <strong>la</strong> définition<br />
d’<strong>en</strong>jeux stratégiques et <strong>la</strong> construction de propositions avec un horizon temporel<br />
rapproché à <strong>2025</strong> a conduit à un exercice de prospective emprunt de réalisme,<br />
évitant les originalités provocatrices, mais ne s’interdisant pas quelques paris sur<br />
l’av<strong>en</strong>ir.<br />
Aussi, dans <strong>la</strong> mesure où certains travaux thématiques des commissions ne sont<br />
pas terminés (les flux portuaires, l’accessibilité numérique, les services<br />
supérieurs…), <strong>la</strong> section a dû faire des choix, consci<strong>en</strong>te que ces travaux<br />
<strong>pour</strong>rai<strong>en</strong>t aboutir à des avis plus ou moins éloignés des préconisations du<br />
rapport. Ces dernières doiv<strong>en</strong>t être appréh<strong>en</strong>dées comme un « tout », résultant<br />
d’une analyse d’un système global et <strong>en</strong> cohér<strong>en</strong>ce avec les objectifs du sc<strong>en</strong>ario<br />
privilégié à un horizon de 15 ans.<br />
Le cas échéant, l’analyse prospective peut être reprise à l’issue des travaux <strong>en</strong><br />
cours au sein de toutes les commissions autour du projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>,<br />
<strong>pour</strong> éc<strong>la</strong>irer <strong>la</strong> vision à une échéance <strong>en</strong>core plus lointaine, 2030-2040.<br />
Quoi qu’il <strong>en</strong> soit, il est fondam<strong>en</strong>tal de réfléchir à <strong>la</strong> manière d’appréh<strong>en</strong>der le<br />
concept de développem<strong>en</strong>t, tant <strong>en</strong>tre les organisations de <strong>la</strong> société civile,<br />
qu’<strong>en</strong>tre elles et les institutions politiques. Un saut qualitatif <strong>en</strong> matière<br />
d’égalité, de coopération et de soins est l’unique voie <strong>pour</strong> réduire les dommages<br />
des crises concomitantes : une crise écologique (changem<strong>en</strong>t climatique, perte<br />
de biodiversité, etc.), une crise sociale (augm<strong>en</strong>tation des inégalités, chômage,<br />
précarisation du travail, etc.) et une crise économique (préémin<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong><br />
finance sur l’économie, insuffisance de <strong>la</strong> croissance, perte d’emploi, etc.), qui<br />
peuv<strong>en</strong>t à leur tour donner naissance à d’autres évènem<strong>en</strong>ts générant des<br />
t<strong>en</strong>sions (accès au logem<strong>en</strong>t, à l’eau, à l’alim<strong>en</strong>tation, etc.)<br />
A une plus vaste échelle, le CESE, <strong>pour</strong> sa part, estime que <strong>la</strong> voie <strong>pour</strong> sortir de<br />
<strong>la</strong> crise systémique de <strong>la</strong> zone euro ne passe ni par un retour aux égoïsmes<br />
nationaux, ni par <strong>la</strong> réduction des droits, mais plutôt par un changem<strong>en</strong>t des<br />
politiques économiques, par <strong>la</strong> re<strong>la</strong>nce de <strong>la</strong> compétitivité, par <strong>la</strong> consolidation de<br />
l’égalité, par de <strong>la</strong> solidarité et de <strong>la</strong> cohésion. Ce<strong>la</strong> permettrait de rétablir <strong>la</strong><br />
confiance des citoy<strong>en</strong>s <strong>en</strong>vers le projet europé<strong>en</strong> et <strong>la</strong> possibilité d’un<br />
redressem<strong>en</strong>t du modèle social europé<strong>en</strong>, face aux risques que comporterait,<br />
<strong>pour</strong> tous, une impossibilité de résoudre <strong>la</strong> crise, qui <strong>pour</strong>rait m<strong>en</strong>er à une<br />
rupture et à l’échec de l’idée même d’Europe.<br />
Une des préconisations a soulevé un vif intérêt <strong>pour</strong> notre groupe de réflexion,<br />
celle du nécessaire partage des nouveaux indicateurs de mesure de <strong>la</strong> richesse<br />
<strong>pour</strong> é<strong>la</strong>borer des indicateurs complém<strong>en</strong>taires au PIB. Ce<strong>la</strong> concerne avant tout<br />
l’étude d’indices représ<strong>en</strong>tatifs de <strong>la</strong> qualité de vie et des conditions sociales des<br />
personnes, <strong>en</strong> rapport avec <strong>la</strong> sout<strong>en</strong>abilité d’un système économique vecteur de<br />
progrès humain.<br />
A l’instar du Conseil Economique Social Europé<strong>en</strong>, « il convi<strong>en</strong>t que <strong>la</strong> société<br />
civile, <strong>en</strong> conjonction avec les autres acteurs sociaux et institutionnels, repère les<br />
champs d’interv<strong>en</strong>tion dans lesquels se marque le progrès d’une société, <strong>en</strong><br />
déterminant les domaines spécifiques et les phénomènes sail<strong>la</strong>nts, aux p<strong>la</strong>ns<br />
économique, social et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tal. Il convi<strong>en</strong>t de réfléchir comm<strong>en</strong>t cette<br />
démarche peut s’effectuer, par le recours à quels instrum<strong>en</strong>ts d’information, de<br />
consultation et de participation. ». Lorsqu’il est question de qualifier <strong>la</strong> croissance<br />
régionale, <strong>la</strong> mesure de <strong>la</strong> qualité de <strong>la</strong> vie doit avoir toute sa p<strong>la</strong>ce.<br />
Octobre 2012 209
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Un modèle reste à inv<strong>en</strong>ter <strong>en</strong>tre l’Europe, l’Etat et les territoires. Il y a une<br />
nécessaire complém<strong>en</strong>tarité à trouver <strong>en</strong>tre l’Etat et les collectivités territoriales,<br />
dont les Régions, qui doiv<strong>en</strong>t tous contribuer à l’effort national de retour à<br />
l’équilibre budgétaire. En période de rigueur budgétaire, « l’ess<strong>en</strong>tiel, plus que<br />
réduire voire supprimer les dép<strong>en</strong>ses, est de faire les bons choix ». Pourquoi ne<br />
pas se servir de <strong>la</strong> crise <strong>pour</strong> rationaliser, pr<strong>en</strong>dre des décisions, r<strong>en</strong>forcer les<br />
solidarités et relégitimer <strong>la</strong> participation des citoy<strong>en</strong>s ?<br />
Reste égalem<strong>en</strong>t à redéfinir <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce du débat public et de <strong>la</strong> société civile dans<br />
l’organisation de <strong>la</strong> démocratie afin de donner corps au dialogue civil, à <strong>la</strong><br />
démocratie sociale et sociétale.<br />
La nature des projets se heurte à <strong>la</strong> multiplicité des acteurs qui, dans leurs<br />
compét<strong>en</strong>ces et prérogatives, n’ont pas tous les mêmes temporalités ni les<br />
mêmes préoccupations. L’objet de ce docum<strong>en</strong>t est de permettre, modestem<strong>en</strong>t,<br />
d’<strong>en</strong>trevoir ce que <strong>la</strong> collectivité régionale peut att<strong>en</strong>dre ou <strong>pour</strong>rait att<strong>en</strong>dre du<br />
futur sans <strong>pour</strong> autant définir « qui paye quoi ? », mais <strong>en</strong> insistant sur <strong>la</strong><br />
nécessaire coordination des interv<strong>en</strong>ants.<br />
De tout temps, l’Homme a voulu connaître son av<strong>en</strong>ir et chercher ce qui le<br />
rassure. Que ce soi<strong>en</strong>t les oracles, les prophètes, les voyants, les philosophes et<br />
même … les ag<strong>en</strong>ces de notation, chacun cherche cet autre petit élém<strong>en</strong>t qui<br />
<strong>pour</strong>rait faire que demain soit autrem<strong>en</strong>t.<br />
Octobre 2012 210
Annexes<br />
Annexes<br />
Cahier des charges<br />
Liste des personnes auditionnées et remerciem<strong>en</strong>ts<br />
Liste des variables de 2004<br />
Sources docum<strong>en</strong>taires<br />
Liste des sigles utilisés<br />
Bref glossaire de <strong>la</strong> méthode des sc<strong>en</strong>arii<br />
Octobre 2012 211
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Octobre 2012 212
Annexes<br />
Cahier des charges<br />
(validation <strong>en</strong> Bureau : 24 mai 2011)<br />
Intitulé provisoire<br />
<strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> à l’horizon<br />
<strong>2025</strong> ?<br />
Origines du projet Actualisation du rapport réalisé <strong>en</strong> 2004<br />
Définition des objectifs<br />
- Actualisation d’un rapport établi selon <strong>la</strong><br />
méthode de prospective exploratoire (que peutil<br />
adv<strong>en</strong>ir ?)<br />
- Prolongation du rapport par <strong>la</strong> méthode de <strong>la</strong><br />
prospective stratégique (que puis-je faire ?)<br />
Méthodes de travail<br />
Destinataires<br />
- Constat de l’évolution des variables <strong>en</strong>tre 2004<br />
2011<br />
- Prise <strong>en</strong> compte d’év<strong>en</strong>tuelles nouvelles<br />
variables au vu des évolutions constatées<br />
- Redéfinition du sc<strong>en</strong>ario idéal de 2004<br />
- Auditions<br />
- Ajustem<strong>en</strong>t du sc<strong>en</strong>ario idéal<br />
- Propositions d’actions <strong>pour</strong> y parv<strong>en</strong>ir<br />
- Présid<strong>en</strong>t du CESER,<br />
- Ensemble du CESER,<br />
- Présid<strong>en</strong>t du Conseil Régional<br />
Cadrage du sujet<br />
Le rapport traitera les différ<strong>en</strong>tes variables<br />
id<strong>en</strong>tifiées <strong>en</strong> 2004 et sera <strong>en</strong>richi par <strong>la</strong> prise <strong>en</strong><br />
compte de variables nouvelles<br />
France des travaux<br />
A définir selon les nouvelles interrogations qui<br />
apparaîtront à l’issue<br />
de <strong>la</strong> phase de constat<br />
de <strong>la</strong> phase des auditions<br />
Gouvernance<br />
L’option ret<strong>en</strong>ue est de ne pas constituer de<br />
COPIL, l’<strong>en</strong>semble des travaux sera m<strong>en</strong>é par <strong>la</strong><br />
section prospective.<br />
Présid<strong>en</strong>t, rapporteur<br />
- Présid<strong>en</strong>te : Nicole GOOSSENS<br />
- Rapporteur : Gérard DUTHIL<br />
Octobre 2012 213
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Liste des personnes auditionnées et remerciem<strong>en</strong>ts<br />
La Section prospective ti<strong>en</strong>t à remercier tous ceux qui ont bi<strong>en</strong> voulu<br />
s’associer à ses travaux, <strong>en</strong> particulier les personnes auditionnées :<br />
Monsieur Patrick CHABERT – Conseiller Economique Social Environnem<strong>en</strong>tal<br />
Régional – Présid<strong>en</strong>t du Groupe de travail « acteurs, culture et territoires – Actes<br />
II et III » (octobre 2010)<br />
Thème rayonnem<strong>en</strong>t culturel (1 er septembre 2011)<br />
Madame Emmanuèle JEANDET-MENGUAL- Conseillère Régionale Vice Présid<strong>en</strong>te<br />
Culture<br />
Thème rayonnem<strong>en</strong>t culturel (15 septembre 2011)<br />
Monsieur André LAUDE – Directeur G<strong>en</strong>eral SENALIA – Présid<strong>en</strong>t du Conseil de<br />
Surveil<strong>la</strong>nce du GPMR<br />
Thème transports et accessibilité fluviale et maritime (29 septembre 2011)<br />
Madame Roxane SIMEON – Etudiante <strong>en</strong> Master II d’économie appliquée à<br />
l’Université de Rou<strong>en</strong><br />
Thème diagnostic territorial / cas de Gonfreville L’Orcher (2 février 2012)<br />
Monsieur Bruno THENAIL – Chef de Projet CAMIS – Région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
Thème transports et accessibilité / re<strong>la</strong>tions internationales et communautaires<br />
(29 septembre 2011)<br />
La Section remercie ses membres <strong>pour</strong> leurs travaux et <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>tation qu’ils<br />
<strong>en</strong> ont faite durant les séances de travail :<br />
Monsieur D<strong>en</strong>ys DECLERCQ<br />
Thème transports et accessibilité fluviale et maritime (29 septembre 2011)<br />
Monsieur Gérard DUTHIL – Economiste à l’Université de Rou<strong>en</strong> – Personnalité<br />
extérieure de <strong>la</strong> section prospection – Rapporteur de l’étude<br />
Thème Croissance Emploi Chômage (5 janvier 2012)<br />
Thème filières économiques (19 janvier 2012)<br />
Thème politiques sociales <strong>en</strong> France (16 février 2012)<br />
Monsieur A<strong>la</strong>in GERBEAUD<br />
Thème dynamisme territorial (retours ateliers DATAR 2040) (8 décembre 2011)<br />
Madame Nicole GOOSSENS, Présid<strong>en</strong>te de <strong>la</strong> Section et du rapport<br />
Thème dynamisme territorial (retours ateliers DATAR 2040) (24 novembre 2011)<br />
Monsieur Jean Pierre LEGALLAND<br />
Thème mondialisation (20 octobre 2011)<br />
Monsieur Jean Luc LEGER – Rapporteur du Groupe de travail « acteurs, culture et<br />
territoires – Actes II et III » (octobre 2010)<br />
Thème rayonnem<strong>en</strong>t culturel (1 er septembre 2011)<br />
Octobre 2012 214
Annexes<br />
Madame Regine LOISEL<br />
Thème transport et accessibilité (10 Novembre 2011)<br />
Thème dynamisme territorial (retours ateliers DATAR 2040) (24 novembre 2011)<br />
Monsieur A<strong>la</strong>in MALMARTEL – Directeur Régional de L’INSEE <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> –<br />
Personnalité extérieure de <strong>la</strong> section prospection<br />
Thème démographie (9 juin 2011)<br />
Monsieur Bernard PROUST – Professeur des Universités – Personnalité extérieure<br />
de <strong>la</strong> section prospection<br />
Thème offre de soins (2 février 2012)<br />
Monsieur Richard TURCO – Directeur G<strong>en</strong>eral Adjoint des Services de <strong>la</strong> Ville de<br />
Rou<strong>en</strong> – Personnalité extérieure de <strong>la</strong> section prospection – Présid<strong>en</strong>t du Groupe<br />
de travail « <strong>la</strong> culture <strong>en</strong> Région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> : quel rayonnem<strong>en</strong>t national<br />
et international ? – Acte I » (mai 2009)<br />
Thème rayonnem<strong>en</strong>t culturel (25 août 2011)<br />
Monsieur Jean Dominique WAGRET<br />
Thème dynamisme territorial (retours ateliers DATAR 2040) (8 décembre 2011)<br />
Thème filières économiques (19 janvier 2012)<br />
Thème innovation recherche (23 février 2012)<br />
Octobre 2012 215
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Liste des variables de 2004<br />
Variables<br />
Sous-variables<br />
Rapprochem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> <strong>Haute</strong> et <strong>la</strong> Basse-<strong>Normandie</strong><br />
Stratégie d’alliances<br />
Coopérations interrégionales<br />
Re<strong>la</strong>tions internationales intracommunautaires<br />
Re<strong>la</strong>tions internationales extracommunautaires<br />
Taux de natalité<br />
Démographie<br />
Taux de mortalité<br />
Soldes migratoires<br />
accessibilité ferroviaire<br />
Accessibilité aéri<strong>en</strong>ne<br />
Accessibilité<br />
Accessibilité routière<br />
Accessibilité fluviale<br />
Accessibilité maritime<br />
Accessibilité immatérielle et organisationnelle<br />
Risques<br />
Qualité de vie<br />
Développem<strong>en</strong>t durable<br />
Filières économiques, innovation et recherche<br />
Activités de service<br />
Formation<br />
Dynamisme territorial<br />
Rayonnem<strong>en</strong>t culturel<br />
Octobre 2012 216
Annexes<br />
Sources docum<strong>en</strong>taires<br />
Les sources docum<strong>en</strong>taires sont prés<strong>en</strong>tées au fur et à mesure, principalem<strong>en</strong>t<br />
dans <strong>la</strong> partie I consacrée à <strong>la</strong> définition et à <strong>la</strong> prés<strong>en</strong>tation des variables, au<br />
sein de chacune des « fiches variables ».<br />
Tous les avis et rapports du CESER sont disponibles sur le site internet du<br />
CESER, dans <strong>la</strong> rubrique Travaux et publication :<br />
www.ceser.haut<strong>en</strong>ormandie.fr<br />
La Section prospective s’est particulièrem<strong>en</strong>t appuyée sur les travaux suivants,<br />
prés<strong>en</strong>tés par ordre chronologique :<br />
• LE RAPPORT A ACTUALISER : « quel <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>2025</strong> », CESER, octobre 2004<br />
• « Les énergies <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> : bi<strong>la</strong>n et perspectives stratégiques<br />
économiques, sociales et <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>tales », CESER, janvier 2007<br />
• « Recherche et innovation, moteur du développem<strong>en</strong>t économique<br />
régional », CESER, septembre 2007<br />
• « Acte I : Rayonnem<strong>en</strong>t national et international de <strong>la</strong> culture <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<br />
<strong>Normandie</strong> », CESER, mai 2009<br />
• « Les infrastructures de transport <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> », CESER, mai<br />
2009<br />
• « Avis sur le schéma régional des infrastructures de transport », CESER,<br />
novembre 2009<br />
• « Les mutations économiques et l’évolution de l’emploi dans le secteur<br />
industriel », CESER, décembre 2009<br />
• « L’ori<strong>en</strong>tation tout au long de <strong>la</strong> vie <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> », CESER, juin<br />
2010<br />
• « Culture, acteurs et territoires, actes II et III : vers un schéma régional<br />
de développem<strong>en</strong>t culturel », CESER, octobre 2010<br />
• « Vers une mobilité généralisée <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> 2050 », CESER,<br />
octobre 2010<br />
• « La cohér<strong>en</strong>ce de l’aménagem<strong>en</strong>t des territoires <strong>en</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »,<br />
CESER, octobre 2010<br />
• « Avis sur le contrat régional de développem<strong>en</strong>t économique CRDE »,<br />
CESER, mai 2011<br />
• « Avis sur le contrat de p<strong>la</strong>n régional de développem<strong>en</strong>t des formations<br />
professionnelles », CESER, mai 2011<br />
• « Avis sur le schéma régional éoli<strong>en</strong> terrestre de <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »,<br />
CESER, juin 2011<br />
• « Les <strong>en</strong>jeux du projet de ligne nouvelle <strong>en</strong>tre Paris et <strong>la</strong> <strong>Normandie</strong> »,<br />
CESER, mai 2011<br />
• « Recueil de statistiques générales de <strong>la</strong> région <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> »,<br />
CESER, 1 ère édition chiffres 2010<br />
Les travaux de <strong>la</strong> Section prospective seront complétés à l’horizon de fin 2013<br />
sur divers sujets majeurs <strong>pour</strong> le développem<strong>en</strong>t du territoire, actuellem<strong>en</strong>t à<br />
l’étude dans les différ<strong>en</strong>tes commissions du CESER :<br />
• les flux portuaires (2 ème commission),<br />
• l’éducation popu<strong>la</strong>ire (3 ère commission),<br />
Octobre 2012 217
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
• l’accessibilité numérique, les services supérieurs (4 ème commission),<br />
• le PRES, l’illettrisme (5 ème commission),<br />
L’<strong>en</strong>semble de ces études contribuant <strong>pour</strong> partie à alim<strong>en</strong>ter <strong>la</strong> réflexion de fond<br />
sur le projet Paris Seine <strong>Normandie</strong>, <strong>en</strong> id<strong>en</strong>tifiant des propositions <strong>pour</strong><br />
accompagner le développem<strong>en</strong>t territorial à cette échelle de territoire.<br />
Octobre 2012 218
Annexes<br />
Liste des sigles utilisés<br />
ADSL …………….. Asymmetric Digital Subscriber Line<br />
AIO …………….. Accueil Information Ori<strong>en</strong>tation<br />
ALD …………….. Affection de Longue Durée<br />
AMII …………….. Appel à Manifestation d’Int<strong>en</strong>tions d’Investissem<strong>en</strong>t<br />
ANS …………….. Ag<strong>en</strong>ce Nationale de Santé<br />
AOT …………….. Autorité Organisatrice des Transports<br />
ARIA …………….. Analyse, Recherche et Information sur les Accid<strong>en</strong>ts (base de<br />
données)<br />
ARS …………….. Ag<strong>en</strong>ce Régionale de Santé<br />
ARTT …………….. Aménagem<strong>en</strong>t et Réduction du Temps de Travail<br />
BEP …………….. Brevet d’Etudes Professionnelles<br />
C8 …………….. Confér<strong>en</strong>ce des 8 régions du bassin parisi<strong>en</strong><br />
CAMIS …………….. Channel Arc Manche Integrated Strategy<br />
CAP …………….. Certificat d’Aptitude Professionnelle<br />
CBS …………….. Chimie Biologie Santé<br />
CCIR …………….. Chambre de Commerce et D’industrie Régionale<br />
CCREFP …………….. Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de <strong>la</strong> Formation<br />
Professionnelle<br />
CDD …………….. Contrat à Durée Déterminée<br />
CESE …………….. Conseil Economique et Social Europé<strong>en</strong><br />
CESER …………….. Conseil Economique Social et Environnem<strong>en</strong>tal Régional<br />
CG 27 …………….. Conseil Général de l’Eure<br />
CG 76 …………….. Conseil général de Seine Maritime<br />
CHUR …………….. C<strong>en</strong>tre Hospitalier Universitaire Régional<br />
CIF …………….. Congé Individuel Formation<br />
CIFRE …………….. Conv<strong>en</strong>tion industrielle de formation <strong>pour</strong> <strong>la</strong> recherche <strong>en</strong><br />
<strong>en</strong>treprise<br />
CNRS …………….. C<strong>en</strong>tre National de <strong>la</strong> Recherche Sci<strong>en</strong>tifique<br />
CODAH …………….. Communauté d’Agglomération du Havre<br />
CPER …………….. Contrat de Projet Etat Région<br />
CPRDF …………….. Contrat de P<strong>la</strong>n Régional de Développem<strong>en</strong>t des Formations<br />
professionnelles<br />
CRC …………….. Comité Régional de <strong>la</strong> Culture<br />
CRDE …………….. Contrat Régional de Développem<strong>en</strong>t Economique<br />
CREA …………….. Communauté d’agglomération Rou<strong>en</strong>-Elbeuf-Austreberthe<br />
CREFOR …………….. C<strong>en</strong>tre Ressources Emploi FORmation<br />
CRIHAN …………….. C<strong>en</strong>tre de Ressources Informatiques <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong><br />
CRT …………….. Comité Régional du Tourisme<br />
CSNE …………….. Canal Seine Nord Europe<br />
CVAE …………….. Cotisation sur <strong>la</strong> Valeur Ajoutée des Entreprises<br />
DATAR …………….. Délégation interministérielle à l’aménagem<strong>en</strong>t du territoire et à<br />
l’attractivité régionale<br />
DEPP …………….. Direction de l’évaluation, de <strong>la</strong> prospective et de <strong>la</strong> performance<br />
DEPS …………….. Départem<strong>en</strong>t des études de <strong>la</strong> prospective et des statistiques<br />
(ministère de <strong>la</strong> culture)<br />
DGESIP …………….. Direction de l’évaluation, de <strong>la</strong> prospective et de <strong>la</strong> performance<br />
DRAAF …………….. Direction Régionale de l’Alim<strong>en</strong>tation, de l’Agriculture et de <strong>la</strong><br />
Forêt<br />
EPCI …………….. Etablissem<strong>en</strong>t Public de Coopération Intercommunale<br />
EPF …………….. Etablissem<strong>en</strong>t Public Foncier<br />
EPR …………….. European Pressurized Reactor<br />
ERC …………….. European Research Council<br />
ERDF …………….. Electricité Réseau Distribution de France<br />
ETI …………….. Entreprise de Taille Intermédiaire<br />
FAT …………….. Fonds <strong>pour</strong> l’Aménagem<strong>en</strong>t du Territoire<br />
FEADER …………….. Fonds Europé<strong>en</strong> Agricole <strong>pour</strong> le Développem<strong>en</strong>t Rural<br />
Octobre 2012 219
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
FEDER …………….. Fonds europé<strong>en</strong> de développem<strong>en</strong>t régional<br />
FMN …………….. Firme Multi Nationale<br />
FNADT …………….. Fonds National <strong>pour</strong> l'Aménagem<strong>en</strong>t et le Développem<strong>en</strong>t du<br />
Territoire<br />
FRAC …………….. Fonds Régional d'Art Contemporain<br />
FRADT …………….. Fonds Régional <strong>pour</strong> l'Aménagem<strong>en</strong>t et le Développem<strong>en</strong>t du<br />
Territoire<br />
FSE …………….. Fonds Social Europé<strong>en</strong><br />
FTLV …………….. Formation Tout au Long de <strong>la</strong> Vie<br />
FTTB …………….. « Fiber to the building »<br />
FTTH …………….. « Fiber to the home »<br />
FTTLA …………….. « Fiber To The Last Amplifier »<br />
GAEC …………….. Groupem<strong>en</strong>t Agricole d’Exploitation <strong>en</strong> Commun<br />
GES …………….. Gaz à Effet de Serre<br />
GIEC …………….. Groupe d’experts Internationaux sur l’Evolution du Climat<br />
GPEC …………….. Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compét<strong>en</strong>ces<br />
GPECT …………….. Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compét<strong>en</strong>ces<br />
Territoriales<br />
GPMR …………….. Grand Port Maritime de Rou<strong>en</strong><br />
GRR …………….. Grand Réseau de Recherche<br />
HACCP …………….. Hazard Analysis Critical Control Point<br />
HAP …………….. Hydrocarbure Aromatique Polycyclique<br />
HCSP …………….. Haut Conseil de Santé Publique<br />
HD …………….. Haut Débit<br />
HPST …………….. Hôpital, Pati<strong>en</strong>ts, Santé, Territoires<br />
ICF ……………. Indicateur Conjoncturel de Fécondité<br />
ICPE …………….. Instal<strong>la</strong>tion C<strong>la</strong>ssée <strong>pour</strong> <strong>la</strong> Protection de l'Environnem<strong>en</strong>t<br />
IDE …………….. Investissem<strong>en</strong>ts Directs à l’Etranger<br />
IDH …………….. Indice de Développem<strong>en</strong>t Humain<br />
IFREMER …………….. Institut français de recherche <strong>pour</strong> l’exploitation de <strong>la</strong> me<br />
INRA …………….. Institut National de Recherche Agronomique<br />
INSEE …………….. Institut National de <strong>la</strong> Statistique et des Etudes Economiques<br />
INSERM …………….. Institut national de santé et de <strong>la</strong> recherche médicale<br />
IRGOUV …………….. Instance Régionale de Gouvernance de <strong>la</strong> formation continue<br />
IVA …………….. Insertion Vie Active<br />
IVQ …………….. Information Vie Quotidi<strong>en</strong>ne<br />
LNPN …………….. Ligne Nouvelle Paris <strong>Normandie</strong><br />
LOADDT …………….. Loi d'ori<strong>en</strong>tation <strong>pour</strong> l'aménagem<strong>en</strong>t et le développem<strong>en</strong>t<br />
durable du territoire<br />
LTE …………….. Long Term Evolution<br />
NAF …………….. Nom<strong>en</strong>c<strong>la</strong>ture d’Activités Française<br />
NRA …………….. Nœud de Raccordem<strong>en</strong>t d'Abonnés<br />
ODIT …………….. Observation, Développem<strong>en</strong>t et Ingénierie Touristiques<br />
ONDAM …………….. Objectif National des Dép<strong>en</strong>ses d'Assurance Ma<strong>la</strong>die<br />
ONG …………….. Organisation Non Gouvernem<strong>en</strong>tale<br />
ORECO …………….. Observatoire REgional de <strong>la</strong> COmpétitivité<br />
OSC …………….. Organisations de <strong>la</strong> Société Civile<br />
PAC …………….. Politique Agricole Commune<br />
PCB …………….. Polychlorobiphényles<br />
PCE …………….. P<strong>la</strong>n Climat Energie<br />
PCS …………….. Professions et Catégories Socioprofessionnelles<br />
PDR …………….. P<strong>la</strong>n de Dép<strong>la</strong>cem<strong>en</strong>t Régional<br />
PIB …………….. Produit Intérieur Brut<br />
PME …………….. Petites et Moy<strong>en</strong>nes Entreprise<br />
PMI …………….. Petites et Moy<strong>en</strong>nes Industries<br />
PPRT …………….. P<strong>la</strong>n de Prév<strong>en</strong>tion des Risques Technologiques<br />
PRB …………….. Produit Régional Brut<br />
Octobre 2012 220
Annexes<br />
PRDF …………….. P<strong>la</strong>n Régional de Développem<strong>en</strong>t des Formations<br />
professionnelles<br />
PRES …………….. Pole de recherche et d'Enseignem<strong>en</strong>t Supérieur<br />
PRS …………….. Pole Régional de Santé<br />
R&D …………….. Recherche et Développem<strong>en</strong>t<br />
RGPP …………….. Révision Générale des Politiques Publiques<br />
RIP …………….. Réseau d’Initiative Publique<br />
RP 2006 …………….. Rec<strong>en</strong>sem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong> Popu<strong>la</strong>tion 2006<br />
RTT …………….. Réduction du Temps de Travail<br />
SAPN …………….. Société d'Autoroute Paris <strong>Normandie</strong><br />
SCORAN …………….. Stratégie de cohér<strong>en</strong>ce régionale d’aménagem<strong>en</strong>t numérique <strong>en</strong><br />
<strong>Haute</strong>- <strong>Normandie</strong><br />
SCOT …………….. Schéma de Cohér<strong>en</strong>ce Territoriale<br />
SDAN …………….. Schéma Départem<strong>en</strong>tal d'Aménagem<strong>en</strong>t Numérique<br />
SEINE …………….. Système d'Enquêtes <strong>pour</strong> l'INsertion professionnelle <strong>en</strong> Emploi<br />
SIG …………….. Système d'Information Géographique<br />
SMIC …………….. Sa<strong>la</strong>ire Minimum Interprofessionnel de Croissance<br />
SNCF …………….. Société Nationale des Chemins de Fer<br />
SNDD …………….. Stratégie nationale du développem<strong>en</strong>t durable<br />
SPO<br />
Service Public de l’Ori<strong>en</strong>tation<br />
SPPPI …………….. Secrétariat perman<strong>en</strong>t <strong>pour</strong> <strong>la</strong> prév<strong>en</strong>tion des pollutions et des<br />
risques industriels<br />
SRADT …………….. Schéma Régional de Développem<strong>en</strong>t et d'Aménagem<strong>en</strong>t du<br />
Territoire<br />
SRCAE …………….. Schéma Régional Climat Air Energie<br />
SRCE …………….. Schéma Régional de Cohér<strong>en</strong>ce Ecologique<br />
SRDE …………….. Schéma Régional de Développem<strong>en</strong>t Economique<br />
SRIT …………….. Schéma Régional des Infrastructures et des Transports<br />
SROS …………….. Schéma Régional d'Organisation Sanitaire<br />
STRATER …………….. Projet du service de coordination stratégique des territoires -<br />
diagnostic chiffré <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t supérieur recherche <strong>Haute</strong> et<br />
Basse-<strong>Normandie</strong><br />
TAA …………….. Tarification à l'Acte<br />
TER …………….. Trains Express Régionaux<br />
THD …………….. Très Haut Débit<br />
TIC …………….. Technologies de l'Information et de <strong>la</strong> Communication<br />
VAE …………….. Validation des Acquis de l'Expéri<strong>en</strong>ce<br />
ZAE …………….. Zone d’Activité Economique<br />
Octobre 2012 221
CESER <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>Quel</strong> <strong>destin</strong> <strong>pour</strong> <strong>la</strong> <strong>Haute</strong>-<strong>Normandie</strong> <strong>en</strong> <strong>2025</strong> ?<br />
Bref glossaire de <strong>la</strong> méthode des sc<strong>en</strong>arii<br />
Base prospective : <strong>en</strong>semble des variables qui influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t le système étudié.<br />
Composante ou sous-système : <strong>en</strong>semble de variables liées autour d’un<br />
même thématique ou d’un même groupe d’acteurs.<br />
Variable (d’influ<strong>en</strong>ce) : facteur, paramètre, ou déterminant qui influe sur le<br />
système. Elém<strong>en</strong>t du système qui exerce ou est susceptible d’exercer une<br />
influ<strong>en</strong>ce sur le problème étudié. Souv<strong>en</strong>t une variable dans un système<br />
prospectif est un mé<strong>la</strong>nge de facteur et d’acteur (un facteur évolue le plus<br />
souv<strong>en</strong>t sous l’influ<strong>en</strong>ce d’un acteur ou de plusieurs acteurs).<br />
Variables-clés : les variables les plus influ<strong>en</strong>tes sur le système considéré (les<br />
plus dép<strong>en</strong>dantes sont écartées).<br />
Indicateurs : instrum<strong>en</strong>ts de mesure ou d’observation de <strong>la</strong> t<strong>en</strong>dance. Indices,<br />
ratios ou listes de faits permettant de mesurer ou d’observer l’évolution d’une<br />
variable dans le temps.<br />
Invariant : phénomène supposé perman<strong>en</strong>t jusqu’à l’horizon étudié.<br />
T<strong>en</strong>dance : Une t<strong>en</strong>dance est une transformation mesurable ou observable au<br />
sein d’un système donné et qui porte <strong>en</strong> germe les dynamiques et<br />
comportem<strong>en</strong>ts futurs de ce système.<br />
T<strong>en</strong>dance lourde : transformation significative et sur une période suffisamm<strong>en</strong>t<br />
longue <strong>pour</strong> que l’on puisse prévoir son évolution dans le temps. Une variable ou<br />
un facteur d’influ<strong>en</strong>ce caractérisé par une t<strong>en</strong>dance lourde ne donnera lieu qu’à<br />
une seule hypothèse prospective.<br />
Signal faible ou fait porteur d’av<strong>en</strong>ir : signes infimes dans leurs dim<strong>en</strong>sions<br />
prés<strong>en</strong>tes mais pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t imm<strong>en</strong>ses par les conséqu<strong>en</strong>ces virtuelles. La<br />
plupart des facteurs de changem<strong>en</strong>t politiques, économiques, technologiques ou<br />
culturels sont des variables à peine perceptibles aujourd’hui et qui peuv<strong>en</strong>t<br />
constituer les t<strong>en</strong>dances lourdes de demain.<br />
Hypothèse : Évolution ou état possible d’une variable à un horizon donné.<br />
Hypothèse t<strong>en</strong>dancielle : hypothèse reposant sur <strong>la</strong> prolongation de <strong>la</strong><br />
t<strong>en</strong>dance passée.<br />
Hypothèse <strong>en</strong> rupture : hypothèse reposant sur une discontinuité par rapport<br />
à l’évolution passée ; état lié à un changem<strong>en</strong>t de t<strong>en</strong>dance ou une bifurcation<br />
par rapport au passé.<br />
Incertitudes majeures : elles port<strong>en</strong>t sur des sujets cruciaux <strong>pour</strong> lesquels<br />
l’av<strong>en</strong>ir est très ouvert et les évolutions difficilem<strong>en</strong>t prévisibles. Elles peuv<strong>en</strong>t se<br />
prés<strong>en</strong>ter sous forme de « questions clefs ».<br />
Sc<strong>en</strong>ario : jeu cohér<strong>en</strong>t d’hypothèses conduisant d’une situation d’origine à une<br />
situation future. Un sc<strong>en</strong>ario est une description du système à un horizon donné<br />
et du cheminem<strong>en</strong>t conduisant à son état final.<br />
Sc<strong>en</strong>ario exploratoire : sc<strong>en</strong>ario explorant le spectre des futurs possibles.<br />
Sc<strong>en</strong>ario normatif ou stratégique : sc<strong>en</strong>ario explorant le spectre des futurs<br />
souhaitables et réalisables.<br />
Enjeu : Problématique id<strong>en</strong>tifiée qui porte <strong>en</strong> elle un pot<strong>en</strong>tiel de changem<strong>en</strong>ts,<br />
positifs (opportunités) ou négatifs (m<strong>en</strong>aces) et qu’il est nécessaire de pr<strong>en</strong>dre<br />
<strong>en</strong> compte <strong>pour</strong> construire une prospective et déterminer une stratégie. L’<strong>en</strong>jeu<br />
est ce qui, sur le terrain ou le champ de bataille, peut être perdu ou gagné. Un<br />
des rôles de <strong>la</strong> prospective consiste à id<strong>en</strong>tifier des <strong>en</strong>jeux futurs, imaginables et<br />
surtout de long terme.<br />
Levier de changem<strong>en</strong>t : moy<strong>en</strong> d’action dont dispose un acteur <strong>pour</strong> provoquer<br />
un changem<strong>en</strong>t dans un système.<br />
Octobre 2012 222