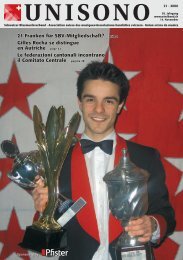Dirigentin/Dirigent - Schweizer Blasmusikverband
Dirigentin/Dirigent - Schweizer Blasmusikverband
Dirigentin/Dirigent - Schweizer Blasmusikverband
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
l’utilisation de machines de fabrication<br />
très performantes. Elle est fonction<br />
de sa texture naturelle qui fait sa<br />
souplesse et la rend plus ou moins<br />
spongieuse, donc sensible à la salive.<br />
Les anches sont calibrées sur une<br />
échelle de 2 à 4 suivant la force,<br />
c’est-à-dire leur souplesse. Chaque<br />
anche s’améliore quand on la joue<br />
mais sans trop en abuser au risque<br />
de l’user. Il faut donc pouvoir la laisser<br />
se reposer dans un endroit frais<br />
et sec. De plus, chaque anche sonne<br />
différemment suivant la morphologie<br />
du musicien et de ses exigences,<br />
d’où l’usage de la retouche par l’instrumentiste<br />
qui consiste à modifier<br />
l’une des ses parties.<br />
Quelques conseils de<br />
retouche<br />
Si l’anche sonne mais est un peu<br />
dure, une diminution de l’épaisseur<br />
des côtés de l’arrière vers l’avant<br />
avec du papier arasif permettra d’affaiblir<br />
légèrement la durété de<br />
l’anche et donnera un son avec<br />
moins de souffle et plus de puissance.<br />
Si la dureté persiste, on peut retoucher<br />
très légèrement de la droite<br />
vers la gauche, ce qui réduit la teneur<br />
en bois de l’âme et facilite son<br />
battement.<br />
Au contraire, si elle est trop<br />
faible, il faut tailler légèrement la<br />
pointe à l’aide d’un coupe-anche.<br />
Les différentes façons de placer<br />
l’anche sur le bec feront, elles aussi,<br />
varier la réponse de celle-ci et c’est<br />
au musicien de découvrir la palette<br />
de ses possibilités.<br />
L’anche double<br />
Les instruments construits sur le<br />
principe de l’anche double sont très<br />
anciens et très répandus dans de<br />
nonbreuses civilisations. La chalémie,<br />
au XIIe siècle, tient une grande<br />
place en Europe. Après divers perfectionnements<br />
sous la Renaissance,<br />
le hautbois lui succède au XVIIe siécle. L’hauboïste pour jouer doit<br />
rentrer les lèvres et pincer l’anche<br />
entre celles-ci. Ainsi, il force l’air à<br />
haute pression entre les deux languettes<br />
de roseau qui s’entrechoquent<br />
en vibrant. Le hautbois est<br />
désormais représentatif de la famille<br />
des instruments à anche double<br />
(basson, cor anglais, bombarde, musette,<br />
cromorne,…).<br />
L’hautboïste se doit de savoir<br />
ajuster ses anches. L’équilibrage est<br />
fort complexe et demande une certaine<br />
connaissance et habileté. Il en va<br />
de même pour le bassoniste: si<br />
l’anche est trop dure, il faut veiller à<br />
ce que le milieu ne soit pas trop épais<br />
par rapport aux bords. Si elle est trop<br />
tendre, essayer de tirer et resserrer les<br />
deux premières bagues et si cela ne<br />
suffit pas, pincer l’anche des deux côtés.<br />
Trop clair ou trop brillant: gratter<br />
les bords de chaque côté…<br />
Simple ou double, l’anche permet<br />
d’obtenir une diversité de<br />
timbres et de couleurs, mais il ne<br />
faut pas oublier l’anche libre qui<br />
offre aussi autant de possibilités.<br />
L’anche libre<br />
L’anche libre est une languette<br />
de roseau ou de métal fixée à l’une<br />
de ses extrémités, et dont la partie<br />
libre peut se mouvoir d’un côté ou<br />
de l’autre de son axe. Elle est soit découpée<br />
dans une plaque sur trois côtés,<br />
soit fixée sur un support à l’aide<br />
d’un moyen mécanique.<br />
Sous la pression de l’air, la languette<br />
se déplace pour revenir à sa<br />
place, coupant et rétablissant successivement<br />
le courant d’air. C’est ce déplacement<br />
d’air qui va générer le son.<br />
Quelle que soit l’intensité de<br />
l’air ou la lattitude<br />
de déplacement<br />
de la lamelle, les<br />
vibrations ne<br />
changent pas.<br />
Elles sont dites<br />
isochrones, c’està-dire<br />
qu’elles accomplissenttou-<br />
Anche double (hautbois) Scheng, orgue à bouche chinois.<br />
jours un nombre égal de vibrations<br />
quel que soit l’écartement pris par la<br />
lamelle sous la pression de l’air. On<br />
peut ainsi modifier l’intensité sonore<br />
sans altérer la hauteur, atout très important<br />
pour certains instruments<br />
comme l’accordéon, et passer du<br />
pianissimo au fortissimo.<br />
Alors<br />
qu’elle est<br />
présente très<br />
tôt en Asie,<br />
l’usage de<br />
l’anche libre<br />
semble avoir<br />
été adopté<br />
assez tardivement<br />
en<br />
Occident.<br />
Le<br />
sheng, orgue<br />
à bouche<br />
d’origine<br />
chinoise, apparaitcomme<br />
l’ancêtre de nos instruments<br />
aérophones à anches libres.<br />
L’anche libre se met à vibrer<br />
lorsque la colonne d’air s’investit, à<br />
l’inverse de l’orgue ancien, où la colonne<br />
d’air en coupant le bord supérieur<br />
du tuyau provoque la vibration.<br />
Le sheng chinois ancien était<br />
composé d’un réservoir fabriqué dans<br />
une courge séchée évidée sur laquelle<br />
on fixait des tuyaux en bambou sur<br />
deux rangées parallèles. L’anche libre<br />
était en bambou. Dans sa version moderne,<br />
il est constitué d’un réservoir à<br />
air comportant une embouchure, de<br />
tuyaux munis chacun intérieurement<br />
dans la partie inférieure d’une anche<br />
libre en métal pouvant fonctionner<br />
par aspiration ou compression quand<br />
le musicien bouche le trou situé sur le<br />
côté du tuyau. Chaque tuyau peut<br />
sonner individuellement. Le jeu traditionnel<br />
se fait en accord même si le<br />
jeu soliste est possible. Le son s’obtient<br />
en aspirant et en expirant comme<br />
pour l’harmonica.<br />
On trouve l’introduction de<br />
l’anche libre en Europe à partir du<br />
XVIIIe Anche d’harmonica.<br />
Anche d’accordéon.<br />
siècle, période où on s’intéresse<br />
à la Chine, et les premières traces<br />
de l’anche métallique semblent se<br />
situer en Hollande.<br />
C’est la période où une multitude<br />
d’instruments voit le jour sur le<br />
principe de faire la gamme avec une<br />
lame et où le principe de l’anche<br />
Revue des musiques<br />
Systèmes d’anche pour orgue.<br />
libre est appliqué à toute une série<br />
d’instuments tels que orgues, harmoniums,<br />
accordéons, concertinas,<br />
harmonicas et mélodicas. Les premiers<br />
harmonicas datent de 1820 et<br />
peuvent être considérés comme des<br />
orgues à bouche.<br />
Le mécanisme de l’harmonica repose<br />
sur le principe suivant: quand on<br />
souffle, l’air fait vibrer les anches situées<br />
en avant de l’instrument et<br />
quand on aspire il fait vibrer celles situées<br />
en arrière. Chaque trou de l’harmonica<br />
chromatique est muni de<br />
quatre anches. Les harmonicas sont<br />
considérés comme l’ancêtre des accordéons.<br />
Plus précisément l’association<br />
d’un harmonica à bouche avec un<br />
soufflet à main sera le point de départ<br />
d’une nouvelle famille: les accordéons.<br />
Les concertins, les accordions et<br />
les mélodéons, instruments à anches<br />
libres, font leur apparition au début<br />
du XIXe siècle. Ils sont tous munis<br />
d’un clavier et d’un soufflet extensible<br />
qui envoie de l’air sur les anches.<br />
L’accordéon a un son uniforme<br />
et reste accordé très longtemps, le<br />
bandonéon qui n’a pas de boîte de<br />
résonnance est plus expressif, le son<br />
sortant directement.<br />
Conclusion<br />
Si l’orgue est un des instruments<br />
les plus anciens encore joué de nos<br />
jours – ses origines remontent au IIIe siècle avant J.C. avec l’hydraule –, la<br />
version que nous lui connaissons<br />
avec des jeux d’anches remonte au<br />
XVe siècle.<br />
L’orgue actuel peut associer<br />
l’anche battante et anche libre et résume<br />
à lui seul la richesse de cette petite<br />
lame. Battante, simple ou double,<br />
en roseau ou en métal, sa simplicité<br />
est dotée d’une extraordinaire qualité<br />
sonore qui n’a pas fini de séduire.<br />
Christine Bergna<br />
(tiré du Journal de la CMF,<br />
no 503, décembre 2002)<br />
UNISONO 3 •2003 39